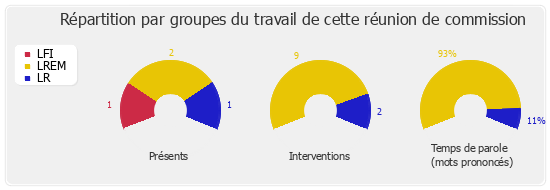Commission d'enquête sur l'alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance
Réunion du jeudi 31 mai 2018 à 9h15
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures quinze.

Mes chers collègues, nous accueillons ce matin une délégation de chercheurs de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) conduite par Mme Monique Axelos, directrice scientifique « alimentation et bioéconomie ».
Nous recevons ainsi M. Didier Dupont, directeur d'unité adjoint du laboratoire « science et technologie du lait et des oeufs », M. Fabrice Pierre qui représente l'unité de toxicologie alimentaire, dénommée TOXALIM, M. Louis-Georges Soler, de l'unité « alimentation et sciences sociales » (ALISS). Ils sont accompagnés par Mme Claire Brennetot, conseillère du président de l'INRA pour les relations parlementaires et institutionnelles.
La commission d'enquête se devait de rencontrer des chercheurs de l'INRA dès la première phase de ses travaux. En effet l'INRA est un établissement qui constitue un des socles de la recherche publique en France. Ses unités de recherche et ses laboratoires sont implantés sur l'ensemble du territoire. Par tradition, ses chercheurs ont l'habitude du travail en commun avec les filières de production. De plus, l'INRA poursuit de nombreuses études communes avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou encore l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), ainsi qu'avec de nombreux établissements d'enseignement et des universités, en France et à l'étranger.
Nos premières auditions ont notamment porté sur les risques sanitaires de l'alimentation. Avec le professeur Serge Hercberg et la docteure Mathilde Touvier, la commission s'est penchée sur une étude récente faisant apparaître un lien entre une alimentation ultra-transformée et une augmentation du risque de cancer. Nous avons également entendu l'équipe de Pierre Rustin, relevant à la fois du CNRS et de l'INSERM, qui alerte de l'utilisation massive de certains fongicides de la catégorie des SDHI, inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.
Bien sûr, l'alimentation ne peut être perçue sous le seul angle des dangers qu'elle représente. Mais l'INRA se doit d'être en première ligne sur les méthodes alternatives aux pesticides de synthèse, aux insecticides comme aux fongicides.
Un autre sujet d'importance est celui des additifs. Là encore, des progrès restent à accomplir au regard des grandes tendances de l'évolution de la consommation.
Je vous propose de commencer par un exposé liminaire de vingt minutes – je vous laisse le soin de répartir ce temps entre vous. Ensuite, je vous poserai des questions auxquelles votre propos liminaire n'aurait pas répondu, puis je donnerai parole à notre rapporteure, Mme Michèle Crouzet.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Mme Monique Axelos, M. Didier Dupont, M. Fabrice Pierre, M. Louis-Georges Soler et Mme Claire Brennetot prêtent successivement serment.

Par souci de transparence, je signalerai que je suis moi-même fonctionnaire de l'INRA, en disponibilité jusqu'à la fin de mon mandat.
Je voudrais d'abord dresser le tableau des défis auxquels nous devons faire face dans le domaine de l'alimentation, avant de présenter les grandes orientations de nos travaux. Mes collègues présenteront ensuite certaines de ces études de manière plus détaillée, puis nous répondrons à vos questions.
Il faut commencer par rappeler les développements positifs qui expliquent la situation paradoxale dans laquelle nous nous trouvons et les défis actuels. Au cours des cinquante dernières années, la production alimentaire mondiale a été multipliée par 3, alors que la population a augmenté d'un facteur 2,3. Ce succès quantitatif masque cependant des situations très contrastées. En effet, on compte 820 millions de personnes sous-alimentées, 2 milliards de personnes carencées et plus d'un milliard de personnes obèses.
D'un point de vue sanitaire, le tableau est néanmoins positif : on constate de moins en moins de crises sanitaires majeures et un gain d'espérance de vie lié à la sécurité sanitaire et à la sécurité de l'alimentation. Toutefois, on constate de nouveaux risques en termes de santé publique liés à la mondialisation comme l'antibiorésistance qui risque de devenir la première cause de mortalité au monde, la dissémination des pathogènes non endémiques qui représente un risque pour l'homme ainsi que pour l'animal et qui génère des pertes économiques importantes.
En outre, l'accès à l'alimentation a été facilité par la diminution des prix. Cependant, France n'échappe pas aux problèmes de santé liés à l'alimentation, comme cela a été rappelé par l'étude individuelle nationale des consommations alimentaires, INCA 3, ainsi que par les rapports de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On constate effectivement une augmentation des maladies chroniques : 25 % des cas de mortalité précoce seraient dus aux maladies cardiovasculaires, au diabète ou à certains cancers liés à la consommation alimentaire et à la faible activité physique — c'est la conjonction de ces deux facteurs qui est importante. On constate également une augmentation du surpoids et de l'obésité, qui concernent 51 % des adultes et 17 % des enfants.
Ces problèmes de santé sont très fortement corrélés avec le niveau de revenus et d'études.
L'alimentation est un vrai marqueur des inégalités sociales en France, où 12 % des adultes sont en situation d'insécurité alimentaire pour des raisons financières. Cette situation tend à s'aggraver.
Il faut aussi signaler l'apparition de nouveaux comportements. Ainsi, on constate une augmentation de la consommation de produits transformés hors du domicile, qui accompagne l'évolution de nos modes de vie marquée par l'urbanisation, le travail des femmes et la réduction de la durée des repas. On note également une forte augmentation des compléments alimentaires qu'a révélée l'étude INCA 3, laquelle est assez surprenante et qui vient sans doute compenser ou justifier des comportements alimentaires plus ou moins déséquilibrés. De nouvelles habitudes alimentaires qui présentent potentiellement des risques émergent dans les pays développés, comme la mode de manger cru qui pose des problèmes en termes de sécurisation des procédés et de gestion sanitaire, ainsi que des régimes d'éviction partielle ou totale de certains aliments. Tous ces nouveaux comportements doivent être étudiés afin d'en apprécier les conséquences sur le long terme, lesquelles sont difficiles à évaluer.
Comme vous le savez, l'INRA est bâtie autour d'un tryptique : agriculture, environnement, alimentation et bioéconomie. Comme nous l'exposons dans notre document d'orientation, notre ambition est de contribuer à relever ce défi sans précédent qui consiste à nourrir la planète en quantité suffisante, avec une alimentation sûre et saine, dans des conditions durables, en tenant compte du changement climatique, de l'urbanisation et de l'augmentation de la population.
Nous n'examinerons pas aujourd'hui la question des effets négatifs de l'alimentation sur la planète. Si nous nous concentrons sur la question de l'alimentation elle-même, nous travaillons sur deux grands axes qui sont associés : les liens entre l'alimentation et la santé, d'une part, la durabilité de l'alimentation, d'autre part. Il existe deux leviers d'action : l'offre et la demande alimentaires.
En ce qui concerne l'offre, nous menons des études, que vous présentera M. Didier Dupont, sur la construction des qualités des produits, sur l'impact nutritionnel des aliments et des régimes alimentaires, en examinant notamment les interactions entre les aliments et le microbiote, les rapports de l'alimentation et du cerveau, les liens avec le cancer. Nous nous attachons à comprendre les mécanismes physiologiques sous-jacents, car nos travaux se fondent sur une logique de prévention et non sur une logique curative. Sur l'autre axe, nous étudions notamment l'exposition à des agents contaminants par l'intermédiaire de l'alimentation, examinant en particulier l'exposition à de faibles doses et les « cocktails ». Nous nous efforçons donc de caractériser ces risques afin d'établir comment les prévenir et les prendre en compte.
En ce qui concerne la demande alimentaire, nous nous efforçons d'établir une sociologie de l'alimentation, c'est-à-dire de comprendre ce qui détermine les consommateurs, ou plutôt les « mangeurs », en étudiant en particulier leurs comportements paradoxaux. Nous cherchons ainsi à établir quels seraient les leviers de changement et quelles sont les recommandations acceptables.
Comme je vous l'ai dit, nous cherchons à proposer des régimes alimentaires sains, sûrs et durables. Nous travaillons également sur la réduction des déchets et sur l'amélioration de l'efficacité des ressources primaires. Nous devons en effet faire en sorte qu'aucun des maillons de la chaîne de l'industrie agroalimentaire ne gaspille la ressource primaire que constitue une production agricole. Ce travail suppose des pratiques agroécologiques auxquelles vous faisiez référence et entraîne de nouvelles questions en termes de variabilité des matières premières et par conséquent de variabilité des produits.
Constatant que l'alimentation possède un ancrage territorial, nous travaillons sur l'alimentation des villes, en étudiant l'agriculture urbaine, périurbaine, la résilience et l'innovation sociale.
Je conclurai en disant que la grande pluridisciplinarité de l'INRA nous permet vraiment de développer une approche systémique. En effet, ces questions ne peuvent pas être traitées séparément. Il est nécessaire de prendre l'ensemble du système en compte pour essayer de limiter les effets négatifs à long terme. Comme vous l'avez rappelé, nous développons toutes ces approches avec des partenaires institutionnels et académiques français mais aussi européens ou internationaux, ainsi qu'avec des partenaires privés et de plus en plus avec des représentants de la société civile. Nous cherchons en effet à développer le dialogue, lequel est nécessaire à l'engagement de tous les acteurs.
Je suis économiste, directeur de recherche dans l'unité ALISS. Permettez-moi de vous présenter nos travaux en quelques mots. Notre recherche comprend trois volets.
Monique Axelos a d'ailleurs évoqué le premier volet, à savoir l'analyse de la demande alimentaire et des comportements de consommation. Nous cherchons en effet à comprendre les arbitrages des consommateurs en fonction des différentes caractéristiques des produits qui sont mis sur le marché, en prenant en compte le prix mais aussi la praticité ainsi que des caractéristiques nutritionnelles ou environnementales.
Le deuxième volet de notre travail consiste à étudier le fonctionnement des filières agroalimentaires en analysant les stratégies et les comportements des entreprises qui constituent ces filières et leur impact sur les caractéristiques des produits mis sur le marché. Là encore, nous n'examinons pas seulement le prix mais aussi la qualité et la variété de ces produits, ce qui permet d'examiner les rapports entre l'organisation des filières et les caractéristiques de l'offre alimentaire.
Le troisième volet consiste à évaluer les politiques publiques dans le champ de l'alimentation, en lien avec les politiques de la concurrence, de l'environnement et de la santé publique — en particulier en matière de nutrition. Dans le champ que je vous ai présenté, l'équipe au sein de laquelle je travaille étudie principalement les questions nutritionnelles au cours des dix dernières années. Nous nous intéressons donc aux politiques nutritionnelles et nous essayons de comprendre comment les consommateurs prennent en compte la dimension nutritionnelle des produits qu'ils achètent et plus généralement comment ils arbitrent leurs choix alimentaires. Nous menons également des études sur l'offre alimentaire.
En outre, j'ai participé à la création en 2008 de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation (OQALI) en partenariat avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Ce dispositif a été proposé dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS) ; il est financé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et par le ministère de la santé. Cet observatoire est en charge du suivi de l'évolution des produits. Il élabore donc un ensemble d'outils pour mesurer l'évolution des caractéristiques nutritionnelles des produits alimentaires. L'OQALI s'est également vu confier le suivi de la mise en place des chartes de progrès nutritionnel mises en place dans le cadre du PNNS et du Programme national pour l'alimentation (PNA), qui ont été signées individuellement ou collectivement par certains industriels et par certains distributeurs avec les pouvoirs publics. Enfin, l'OQALI est également en charge du suivi du Nutri-Score qui est mis en place progressivement et de l'évaluation de son impact.
Au cours des dernières années, mes collègues et moi nous sommes efforcés de développer une approche « coût-bénéfice », afin d'évaluer les politiques en établissant la balance entre les coûts pour les différents acteurs et les gains en matière notamment de consommation et de santé. Nous avons développé des programmes pluridisciplinaires réunissant des économistes, des nutritionnistes et des épidémiologistes afin d'analyser l'impact des régimes alimentaires en prenant en compte les dimensions économiques, environnementales et nutritionnelles. En particulier, avec des collègues nutritionnistes, nous avons étudié comment la consommation de bio, en croissance ces dernières années, participe de cette dynamique. Quels sont les effets économiques, nutritionnels et environnementaux de cette consommation de bio, lorsque l'on tient compte des évolutions du régime alimentaire ?
Je suis directeur de recherche au centre INRA de Rennes je travaille sur la qualité des produits laitiers et des ovoproduits, c'est-à-dire des produits à base d'oeuf.
Comme vous l'a dit Madame Axelos dans son introduction, l'INRA développe des recherches sur la construction raisonnée des qualités de l'aliment, d'un point de vue nutritionnel, sensoriel et hygiénique. Nous travaillons également sur la durabilité du système alimentaire. Nous nous intéressons à la transformation en aliments des matières premières, qu'elles soient d'origine végétale ou animale. Nous étudions comment les constituants de l'aliment forment la structure de la matrice alimentaire, comment ces aliments sont déconstruits dans le tube digestif de l'homme, et nous cherchons à établir les conséquences sur sa santé. Nos analyses vont donc vraiment de la matière première jusqu'à l'homme.
Dans ce cadre, les travaux que nous avons menés au cours des dix dernières années ont montré qu'un aliment ne se résume pas à l'addition d'une certaine proportion de protéines, de lipides, de sucre et de micronutriments, mais que l'organisation de ces constituants, la structure de l'aliment, joue un rôle essentiel, pour la dégradation dans le tube digestif en particulier, et plus généralement pour la santé de l'homme.
Nos travaux portent sur l'alimentation de l'adulte sain, comme l'a dit Monique Axelos, dans une optique de prévention des pathologies liées à l'alimentation, mais aussi et surtout sur des populations ciblées qui ont des besoins nutritionnels spécifiques. En particulier, nous travaillons beaucoup sur l'alimentation du nouveau-né, qu'il soit né à terme ou prématuré. Nous partons du constat que le lait maternel est l'aliment idéal pour l'enfant ; nous cherchons à étudier sa digestion afin de développer des formules infantiles de nouvelle génération qui soient beaucoup plus respectueuses de la santé de l'enfant. Nous travaillons également sur d'autres populations, comme les seniors, afin de développer une offre de produits alimentaires spécifiquement adaptée à leurs besoins, qui permette en particulier de limiter les carences en protéines et en certains minéraux. Comme l'a dit Louis-Georges Soler, nous travaillons également sur les personnes en surpoids ou obèses. Ainsi, dans le cadre de projets européens, nous venons de terminer un travail sur la réduction du sel, du sucre et des matières grasses dans les produits alimentaires, et un autre sur le développement d'aliments fonctionnels pour limiter les risques de développement de maladies cardiovasculaires. Enfin, nous travaillons sur les personnes allergiques.
Tous ces travaux nécessitent vraiment une approche multidisciplinaire. Nous réunissons donc des spécialistes de l'aliment, tels que des microbiologistes ou des physico-chimistes, mais également des nutritionnistes et des médecins. En particulier, nous travaillons beaucoup avec des pédiatres, les gériatres et des gastro-entérologues qui nous aident à conduire nos recherches.
Ces recherches sont menées dans un contexte international assez compétitif. Ce sont vraiment des questions d'actualité, sur lesquelles de nombreux pays travaillent. Il faut constater que l'INRA est vraiment un leader au niveau international. Ainsi, j'anime depuis sept ou huit ans un réseau international qui regroupe des chercheurs de 140 instituts dans 40 pays, qui comprend donc non seulement des pays européens, mais aussi les États-Unis, la Chine ou le Japon. Or les chercheurs de l'INRA sont vraiment les fers de lance de ce type de réseau.
Je suis physiologiste, directeur de recherche au centre Occitanie-Toulouse de l'INRA, spécialiste de la relation entre alimentation, additifs, et risques de cancer.
Notre alimentation est tout d'abord la source d'énergie, de nutriments et de micro-nutriments qui sont indispensables à notre métabolisme de base, à notre croissance et à notre développement cognitif. Ces effets constituent l'ensemble de ce que nous appelons « bénéfice nutritionnel ».
C'est également une question sociétale, que l'on peut analyser grâce à des données scientifiques qui sont maintenant solides.
Enfin, l'alimentation constitue un risque. La toxicité de notre alimentation peut avoir différentes origines. Premièrement, dans le cas des aliments transformés, elle peut provenir de produits qui sont intentionnellement rajoutés, les additifs. Nous pourrons ainsi revenir, si vous le souhaitez, sur la démonstration récente des effets du dioxyde de titane, cette fraction nanoparticulaire présente dans le piment blanc de notre alimentation. Deuxièmement, la toxicité peut également provenir de différents produits non intentionnellement rajoutés, comme des produits néo-formés, qui vont apparaître pendant la transformation, mais aussi pendant la préparation à la maison de ces aliments. Ainsi, les cuissons à haute température génèrent des amines hétérocycliques ; l'ajout de nitrites provoque l'apparition de composés N-nitrosés, considérés comme mutagènes. Troisièmement, la toxicité peut provenir des composants chimiques tels que les résidus de pesticides. Quatrièmement, elle peut provenir des nutriments eux-mêmes, en cas de consommation excessive ou de déséquilibre nutritionnel. Un tel déséquilibre peut contribuer à l'émergence de pathologies chroniques.
Afin de prendre en compte cette diversité, l'INRA promeut l'étude des cocktails, c'est-à-dire l'exposition multiple à de faibles doses, étude qui est indispensable pour analyser correctement les risques que présente notre alimentation. Nous travaillons d'abord à identifier de nouveaux dangers en étudiant les molécules au niveau individuel, comme pour le dioxyde de titane, mais aussi en analysant des « effets cocktail » ; nous fournissons ainsi des éléments académiques aux agences d'évaluation. Ensuite, lorsque des risques sont établis, nous nous efforçons d'en comprendre les mécanismes de façon à proposer des stratégies de prévention. Enfin, comme l'a souligné Monique Axelos, nous agissons en interaction avec des partenaires industriels de façon à les inciter et à les aider à modifier les produits mis en marché sur la base de d'éléments scientifiques.

La diversité de la délégation ne facilite guère le travail qui consiste à sérier les sujets. Je vous poserai cependant un premier ensemble de questions en réaction à vos présentations. Madame Axelos, monsieur Soler, vous avez mentionné de nouveaux comportements alimentaires que vous observez au niveau mondial et plus particulièrement en France. Quels sont les déclencheurs de ces changements de comportement ? Qu'est-ce qui amène les consommateurs à changer leurs habitudes et à prendre de nouvelles décisions, que celles-ci soient bénéfiques ou néfastes ? Monsieur Soler, pourriez-vous revenir sur les arbitrages que vous évoquiez ? Pourriez-vous nous exposer davantage les travaux de l'unité ALISS sur l'approche coût-bénéfice, qui nous intéresse au plus haut point ? En particulier, êtes-vous en mesure de quantifier les externalités négatives de notre modèle de consommation ? Nous sentons en effet dans la société une forte demande pour que ce modèle évolue. L'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) avait procédé en 2016 à un chiffrage des externalités négatives. L'INRA travaille-t-il à actualiser ces chiffres ?
En ce qui concerne les comportements de consommation, il faut opérer une distinction entre ce que les personnes déclarent et ce que l'on observe réellement. La situation actuelle est en effet paradoxale : les réponses qu'apportent les consommateurs aux questionnaires ne sont pas entièrement cohérentes avec les choix alimentaires et les actes d'achat observés.
Nous constatons, sur les trente ou quarante dernières années, une distanciation croissante entre le consommateur et son alimentation. C'est le résultat d'une externalisation de la production de l'alimentation qui a désormais lieu hors du ménage et correspond à une augmentation de l'achat de produits transformés. Elle résulte également d'évolutions technologiques qui ont permis d'aller plus loin dans la dissociation entre le lieu et le temps de la production et ceux de consommation. Cette distanciation a donc plusieurs dimensions, relevant notamment de la technologie et de la perception de l'alimentation. C'est le résultat d'un processus de fractionnement-assemblage qui est au coeur des dynamiques industrielles : d'un côté, la production agricole s'est standardisée, évolution qui la rapproche de l'industrie, tandis qu'au niveau industriel, la production s'est fractionnée, puis assemblée à une étape ultérieure. La variété des caractéristiques des produits se réduit au niveau agricole, tandis qu'elle augmente au niveau industriel. Cela a entraîné un déplacement des leviers d'action sur l'offre alimentaire ainsi que de la valeur depuis l'amont vers l'aval. Tous ces éléments sont pris en compte dans le discours des consommateurs.
En revanche, les actes d'achat ne reflètent pas nettement ces évolutions. Certes, on observe bien une croissance de la consommation des produits bio, qui reflète cette préoccupation de réduire la distance avec l'alimentation, et une fraction des consommateurs tend à privilégier des circuits courts. Les produits bio ne représentent cependant que 3 % des dépenses alimentaires des ménages. On constate donc une transformation des représentations du rapport à l'alimentation, et cependant les actes d'achats demeurent tirés par les prix, la praticité et surtout par les qualités sensorielles des produits. En effet, les expérimentations montrent que le premier déterminant du choix d'un produit reste l'élément sensoriel. Il faut effet tenir compte des contraintes de la vie domestique, notamment du temps de préparation. J'espère avoir répondu à votre question.
En ce qui concerne la balance coût-bénéfice, nous nous attachons donc à intégrer à l'analyse des politiques et des changements de comportement alimentaire à la fois les gains et les coûts. Nous ne disposons pas encore d'une balance économique qui tienne compte de l'ensemble des dimensions. En revanche, nous sommes capables de calculer, dans la gamme des régimes alimentaires observés, en France ou au niveau international, ce que gagne et ce que perd un consommateur qui passerait d'un extrême à l'autre, par exemple en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de bénéfice nutritionnel et de budget.
Nous avons intégré ces éléments dans une analyse des recommandations alimentaires, telles que celle qui invite à manger davantage de fruits et de légumes. Si on modélise, avec les données dont on dispose, les conséquences d'une croissance de la consommation de fruits et de légumes, en tenant compte des modifications que cela entraîne sur le reste du régime alimentaire, ne serait-ce qu'en raison du coût de cette consommation supplémentaire, on observe des bénéfices nutritionnels et environnementaux ainsi qu'un coût légèrement supérieur. En particulier, le coût d'adoption est assez élevé, étant donné que les fruits et légumes ne sont pas les aliments que les consommateurs préfèrent en ce moment. Cependant, si l'on prend en compte l'ensemble des dimensions, cette recommandation apparaît comme efficace, au sens où les gains excèdent les coûts. Voici donc un exemple de l'approche « coût-bénéfice » que nous développons.
Une partie de nos travaux actuels consiste précisément à comprendre quels sont les facteurs qui déterminent les changements de comportement alimentaire. Nous avons notamment pour objectif de mettre le consommateur en capacité de faire des choix éclairés pour sa santé, afin de réduire l'écart entre les déclarations et les actes d'achats.

Madame, votre propos fait écho avec ce que nous disait hier la directrice générale de l'association Foodwatch France, qui affirmait qu'il était nécessaire d'armer le consommateur pour qu'il puisse prendre ses décisions. Cette modification de la demande est en effet un levier important, même si ce n'est pas le seul.
Monsieur Soler, vous avez constaté le déplacement de la valeur de l'amont vers l'aval de la production et une standardisation de la production agricole. Profitant du fait que nous recevons une délégation très large de l'INRA, qui comprend aussi la conseillère du président-directeur général pour les relations parlementaires et institutionnelles, je souhaiterais justement vous questionner sur le rôle de l'INRA dans l'accompagnement de la standardisation. Les missions de l'INRA aujourd'hui peuvent-elles être les mêmes qu'au moment de sa fondation ? L'INRA fait de l'alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous en quantité et en qualité suffisantes une de ses priorités thématiques. Pour autant, lorsqu'il a été créé, au sortir de la guerre, l'INRA visait avant tout une augmentation de la quantité. Estimez-vous que cette orientation s'est infléchie, pour promouvoir la qualité et la santé ? Constatez-vous un tel basculement ?
Il est certain que l'INRA a évolué en fonction des changements de la société. Il n'a plus la même raison d'être qu'à la sortie de la guerre. Depuis une vingtaine d'années, l'INRA s'est engagé dans l'agro-écologie, notamment avec l'initiative « 4 pour 1 000 ». Nous réfléchissons aux conséquences des changements agricoles sur l'alimentation. Ici encore, l'approche « coût-bénéfice » est importante parce que des arbitrages seront nécessaires entre les dimensions nutritionnelle et environnementale, par exemple. Toutes nos unités, à commencer par le département « alimentation humaine », prennent en compte la durabilité.
Comme l'a montré Louis-Georges Soler, il est important d'évaluer l'impact environnemental d'une recommandation comme celle de manger des fruits et des légumes. En effet, consommer des fruits et des légumes qui viennent de l'autre bout de la planète ne sera pas une solution ! Il est donc nécessaire de développer une approche systémique.
Le département « alimentation humaine » évoqué par Monique Axelos est, par exemple, en interaction avec la filière de la charcuterie, aliment transformé par définition, afin de modifier les produits mis sur le marché de manière à restaurer la balance entre bénéfice et risque nutritionnels. Cette filière est en train de passer d'une production de masse à une consommation moindre, notamment à cause de l'impact de ces produits sur le risque cancérigène colorectal. Ces produits ont néanmoins un bénéfice nutritionnel important, car ils contiennent du fer, qui est important pour éviter les anémies ferriprives. Il faut donc intégrer l'impact toxique et le bénéfice nutritionnel de la consommation de ces produits dans une démarche globale. Cela permettra de proposer une nouvelle offre qui conserve l'intérêt nutritionnel de ces produits tout en limitant le risque associé.
Il est exact qu'au sortir de la guerre, l'INRA avait un objectif quantitatif. Développer une agriculture qui permette de nourrir l'ensemble de la population constituait alors un véritable défi. Le contexte a changé, du moins au niveau national. Nous développons donc une approche qualitative, afin d'améliorer l'offre alimentaire dans son ensemble. En effet, comme l'a évoqué Monique Axelos dans son introduction, nous n'étudions pas seulement les aliments mais les différents régimes alimentaires. En effet, la qualité des aliments s'est améliorée ; cependant si on développe des aliments parfaits au niveau nutritionnel, mais qui sont consommés au sein d'un régime complètement délétère, le perfectionnement de l'aliment n'aura pas d'effet positif. Nous cherchons donc à développer une vision globale de l'alimentation humaine.

Je vous remercie pour ces premiers éléments de réponse. Vous avez présenté le nouveau paradigme qui consiste à développer une alimentation de qualité et durable. Je souhaiterais vous poser quelques questions sur l'agriculture bio. Vous avez évoqué cette question centrale pour notre sujet, qui fait l'objet d'une demande sociétale forte, dans votre propos liminaire.
Aujourd'hui, 30 % de la consommation française de produits bio est constituée par des produits importés. Que pensez-vous du rapport coût-bénéfice de la consommation bio actuelle en France ? Le bénéfice nutritionnel compense-t-il les externalités négatives ?
L'objectif d'atteindre 15 % de surface agricole en bio, un objectif voté hier en première lecture, vous paraît-il répondre à la demande et aux enjeux que vous identifiez ?
Je vais tâcher de répondre en partant de la consommation. Nous avons en effet travaillé sur la consommation de produits bio à partir de données sur les achats alimentaires, ainsi que sur l'étude de cohorte NutriNet en partenariat avec nos collègues épidémiologistes et nutritionnistes.
Si l'on classe l'ensemble des individus de la population en prenant pour gradient la proportion de bio dans leur alimentation, on peut faire plusieurs constats. Tout d'abord, l'engagement dans la consommation bio est corrélé avec une modification du régime alimentaire : les personnes qui achètent des produits bio consomment davantage de fruits et de légumes, mangent moins de viande et de charcuterie, consomment moins d'alcool et de plats transformés. On constate donc une modification simultanée du degré d'engagement dans la consommation bio et du régime alimentaire. Par conséquent, il est très difficile de poser la question du bio sans poser en même temps celle des régimes alimentaires pour plusieurs raisons. La première raison est économique : quand on balaye ce gradient, le coût de l'alimentation augmente d'environ 15 % entre ceux qui ne consomment aucun produit bio et le quintile formé par ceux qui en consomment le plus. Ainsi, s'engager dans le bio augmente les dépenses alimentaires. Toutefois, si l'on ne tenait compte que de l'effet direct de l'achat de produits bio, cette augmentation serait de 25 %. Le fait que l'on modifie également le régime alimentaire réduit donc le surcoût associé à l'engagement dans la consommation de produits bio.
Je n'ai envisagé jusqu'à présent que le budget alimentaire. Si on intègre toutes les dimensions sanitaires, nutritionnelles et environnementales, là encore, le bénéfice provient très largement du changement de régime alimentaire. Le coût de la consommation bio peut être apprécié en étudiant l'effet sur l'occupation des sols : comme les rendements sont plus faibles, l'agriculture bio requiert des surfaces plus grandes pour couvrir les besoins de production associés au changement de régime alimentaire. En revanche, la consommation bio diminue l'exposition aux contaminants. Ces différents éléments peuvent être quantifiés physiquement : nous avons donc les moyens de mesurer ce qu'on peut gagner sur le plan environnemental et nutritionnel et ce que cela coûte étant donné les prix actuels. En effet, comme vous le savez, si on augmente la demande publique de bio et la production, les prix seront probablement modifiés. Nous travaillons actuellement à intégrer cette modification des prix.

Nous retrouvons le problème que vous avez mentionné précédemment : l'alimentation est aujourd'hui un marqueur social.
La variable majeure de la consommation bio est l'éducation.
Il n'existe pas de dichotomie entre d'une part, la culture bio, et d'autre part, celle de l'agriculture industrielle. Changer de pratiques alimentaires permettrait d'améliorer notre alimentation, qui comprendrait moins de contaminants, d'intrants et de pesticides, de choisir des produits de meilleure qualité, sans que cela implique d'opposer culture bio ou industrielle. Nous nous efforçons donc d'aller vers cette logique d'agro-écologie, d'améliorer nos pratiques sans que cela signifie nécessairement consommer davantage bio.

Je vais tâcher de regrouper mes questions. Quel critère établir pour définir les aliments ultra-transformés ? La classification NOVA vous paraît-elle pertinente ? N'y a-t-il pas ici encore un paradoxe ? En effet, ces aliments sont microbiologiquement sains et pourtant on a établi que ces aliments posent des problèmes de santé publique.
Par ailleurs, j'ai évoqué dans mon introduction les SDHI présents dans de nombreux fongicides. L'unité TOXALIM travaille-t-elle sur cette question ? A-t-elle été amenée à les évaluer avant leur mise en marché ? Si oui, quelles sont ses conclusions ? Sinon, pourquoi n'avoir pas procédé à cette évaluation ?
La classification NOVA, proposée par des chercheurs brésiliens, elle a le mérite d'exister, même si elle peut être considérée comme simpliste. Elle distingue quatre grandes classes de produits, les aliments frais ou peu transformés, les ingrédients culinaires qui sont transformés, les aliments transformés et les aliments ultra-transformés, dont la formulation industrielle comporte au moins quatre ingrédients rajoutés. L'INRA travaille à rendre cette classification plus pertinente pour tenir compte notamment des différents procédés de fabrication. Nous conduisons également un certain nombre de recherches afin d'établir comment modifier certains aliments ultra-transformés. Ainsi, les formules infantiles que j'ai évoquées dans mon propos liminaire sont considérées d'après la classification NOVA comme des aliments ultra-transformés. En effet, ces formules sont produites par une série de traitements thermiques qui entraînent une forte dénaturation de l'agrégation des protéines, de sorte que la résistance à la digestion est modifiée — cet effet est très clairement établi. Le processus d'homogénéisation, qui assure la stabilité du produit, n'est pas non plus sans conséquence sur la digestion des lipides. Nous venons de commencer une nouvelle recherche, dans le cadre d'un projet académique financé uniquement par des fonds publics, sans fonds provenant de l'industrie, afin de revoir complètement l'itinéraire technologique, c'est-à-dire le processus de fabrication, pour le rendre beaucoup plus doux afin d'éviter ces phénomènes de dénaturation liés au traitement thermique extensif.
En outre, l'offre alimentaire de la grande distribution est très orientée vers les aliments ultra-transformés. Ainsi, je lisais hier une étude qui montre qu'en Nouvelle-Zélande, 83 % des aliments vendus dans un supermarché appartiennent à la catégorie des produits ultra-transformés. Par conséquent, quelqu'un qui fait ses courses au supermarché ne dispose pas de beaucoup de choix autres que les produits ultra-transformés. Peut-être faut-il donc chercher à rééquilibrer l'offre.
Effectivement, nos collègues au sein du département « Caractérisation et élaboration des produits issus de l'agriculture » (CEPIA) cherchent à décrire plus précisément ces caractéristiques d'ultra-transformation en essayant de proposer, non seulement une grille a priori, mais aussi une caractérisation des procédés industriels, en tenant compte notamment de leur nombre ou de l'énergie qui est consommée. Ils ont travaillé sur les pizzas industrielles, qui font partie des produits ultra-transformés et ils ont constaté une très grande variabilité dans le nombre — jusqu'à 30 dans une pizza ! — et le type des additifs. Il faut tenir compte de cette variété importante dans l'offre de produits ultra-transformés, et intégrer dans l'analyse la variabilité à l'intérieur d'une famille de produits.
Ensuite, on étudie des données épidémiologiques afin de comprendre les mécanismes qui expliqueraient le lien entre le niveau de la consommation de produits « ultra-transformés » et la santé des consommateurs. Nous ne connaissons pas encore bien ces mécanismes. Est-ce parce que les produits ultra-transformés sont plus salés ou plus gras qu'ils ont un effet sur la santé ? Dans ce cas, étudier l'effet des produits ultra-transformés serait simplement une autre manière d'étudier l'effet de ces composants nutritionnels. Ou bien l'effet des produits ultra-transformés est-il un effet de matrice ? Pour une même quantité de sel, selon la nature de la matrice, qui dépend beaucoup du processus industriel, l'impact sur la santé serait alors différent. Dans ce second cas, ce n'est pas la teneur en sel en tant que telle qui est problématique mais le processus et la structure du produit. Ou bien est-ce l'effet d'autres mécanismes encore ? Ce serait le cas si, par exemple, un produit plus salé comporte plus d'additifs. L'effet viendrait alors non du sucre ou du sel mais de l'additif. C'est un véritable enjeu pour la recherche de bien comprendre les mécanismes par lesquels passe la relation entre produits ultra-transformés et les effets sur la santé.
Je pense effectivement qu'il est indispensable de comprendre les mécanismes pour prévenir les risques établis. Pour cela, il faut associer des approches épidémiologiques qui établissent des corrélations et non des relations de causalité avec des études expérimentales sur des modèles animaux ou cellulaires qui, elles, permettront d'établir des relations de causalité. En effet, pour établir des relations de causalité, il faut intervenir et non pas simplement observer.
Ainsi, l'association systématique entre l'unité de Mathilde Touvier de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN) et l'unité TOXALIM, et plus particulièrement avec mon équipe, permet de combiner approches épidémiologique et expérimentale.
Par ailleurs, une équipe de TOXALIM a travaillé très récemment sur les SDHI, en collaboration avec l'équipe de chercheurs de l'INSERM et du CNRS que vous avez citée. Pourquoi ne pas nous y être intéressés avant ? Ce produit ne faisait pas l'objet d'alertes particulières, or la question du choix des molécules, des contaminants, des additifs sur lesquels s'investir dans un travail de recherche est vraiment une question importante. Ainsi, dans les projets menés par l'INRA, tels que le projet EuroMix, il est nécessaire de définir qualitativement et quantitativement les molécules auxquelles on est exposées et qui sont les plus associées au risque, ce qui implique de conduire des études ciblées sur une molécule.
Il est désormais nécessaire d'étudier les cocktails de molécules. Là aussi, l'association entre épidémiologie et observations expérimentales est déterminante. Les études d'observation qui analysent les contaminants dans les aliments ou l'exposition de la population permettent de définir les « cocktails » de molécules sur lesquelles il faut s'investir. Au niveau expérimental, nous travaillons donc sur des molécules telles que le SDHI, mais nous développons également une approche plus globale, plus représentative de l'exposition sous forme de mélange de molécules à de faibles doses.

Merci pour cet exposé qui nous montre l'importance de la recherche et l'ampleur des domaines qui sont étudiés à l'INRA. Je souhaiterais vous interroger sur le fond.
Nous avons évoqué les effets sur la santé humaine des SDHI qui empêchent le développement des champignons. Ces fongicides avaient cependant reçu une autorisation de mise sur le marché de l'ANSES. Comment l'expliquer ? Aujourd'hui, nous constatons des effets graves ; or le temps de la recherche est très long. Il sera ainsi très long d'établir les « effets cocktail » que vous évoquiez. Pendant ce temps, doit-on accepter que soient mis en vente des produits qui contiennent jusqu'à 30 additifs, comme ceux que vous évoquiez tout à l'heure ? Nous ne devons plus accepter que des aliments soient à ce point transformés. La recherche ne finira jamais, ce qui en un sens est normal parce qu'il y aura toujours de nouvelles études à conduire. Toutefois il faut tout de même répondre aux alertes sanitaires qui sont actuelles et très fortes.
Il faut intégrer aux études sur l'alimentation les coûts sanitaires, comme le soulignait M. le président. Ces coûts sont très importants, car la santé elle-même a des effets sur d'autres domaines. Ainsi, les personnes obèses sont freinées au travail et dans leur vie quotidienne. Certes, il faut tenir compte des enjeux économiques et de l'industrie, mais il faut également s'interroger sur la qualité de l'alimentation. Or les produits naturels constituent la meilleure des nourritures. Il faut donc tâcher de promouvoir l'alimentation la plus naturelle possible, tout en tenant compte des effets sur environnement, par exemple lorsque l'on procède à une plantation il faut s'assurer que celle-ci ne consommera pas trop d'eau.
Pensez-vous qu'il faut limiter le nombre d'additifs dans les produits mis sur le marché ?
Nous avons reçu hier Mme Karine Jacquemart, la directrice générale de Foodwatch France, et nous sommes revenus avec elle sur la contamination des aliments par les huiles minérales contenues dans les emballages, dont les effets ont été testés en laboratoire. L'ANSES avait rendu un avis et émis des recommandations sur ce sujet. Travaillez-vous sur ces questions à l'INRA ? En Allemagne, un système de précaution a été établi, qui consiste notamment à changer les emballages en carton. Nous avons besoin de vous pour nous dire quelles mesures nous devons prendre pour prévenir cet effet, quelles actions doivent prendre les industriels, d'autant plus que vous connaissez leurs problématiques étant donné que vous travaillez avec eux.
Il est en effet essentiel de connaître les causes des effets « cocktail ». Comment agir dès aujourd'hui pour prévenir les risques ? Que faire ? Quand un médecin prescrit plus de quatre médicaments, on ne sait pas quel est l'effet de cette combinaison, d'autant moins que l'effet de certains médicaments est inhibé par les autres. De même, à quel niveau doit-on estimer qu'un produit contient trop d'additifs ? Quelles doses de sucre, de sel, faut-il ne pas dépasser ? On sait que ce sont des causes majeures de la « malbouffe » et que les conséquences de ce mode d'alimentation sont énormes. Êtes-vous en mesure de nous proposer un curseur ?
Tout d'abord, l'INRA n'évalue ni ne réglemente ; en revanche, il fournit des éléments scientifiques aux agences d'évaluation. Prenons le cas du dioxyde de titane, que je connais bien. Sur la base d'éléments scientifiques suffisamment solides, l'INRA a conduit une étude qui a mis en évidence un nouveau danger. L'INRA fournit les éléments académiques à l'ANSES et à l'European Food Safety Authority (EFSA), et sur cette nouvelle base académique, l'EFSA réévalue l'effet des additifs. Il faut bien comprendre que l'autorisation initiale des additifs fait suite à une évaluation de l'EFSA sur la base d'études technologiques mais aussi toxicologiques fournies par le demandeur. Cette évaluation comprend notamment des études de métabolisme, de géno-toxicité, et de cancérogénicité. Si ces additifs sont autorisés, c'est donc qu'ils ont rempli ce cahier des charges. Toutefois, pour de nombreux éléments, l'autorisation s'est appuyée sur des études menées dans les années 1990, 1980, ou 1970. C'est pourquoi on conduit aujourd'hui une réévaluation de ces additifs au niveau individuel. Peut-être est-ce là que le bât blesse, car on évalue ces additifs au niveau individuel et on ne mesure pas l'effet de leur combinaison.
Il faut effectivement donner des éléments d'aide à la décision publique pour accélérer cette démarche. Certains projets européens, comme le projet EuroMix, visent à proposer des modèles mathématiques afin d'évaluer plus facilement la toxicité de ces mélanges. Le Laboratoire d'étude des résidus et contaminants dans les aliments (LABERCA), à Nantes, travaille ainsi à mieux connaître l'exposition du consommateur pour ensuite, sur la base d'approches in vivo cellulaires et de modèles mathématiques, anticiper l'effet de cette exposition multiple. Toutefois, la recherche actuelle consiste à construire les outils de l'évaluation et à identifier les « cocktails » auxquels nous sommes exposés et non, pour l'instant, à établir les effets de cette exposition.
Il existe un réel décalage entre le temps législatif, le temps médiatique, le temps de l'évaluation et le temps scientifique. Permettez-moi de l'illustrer une nouvelle fois avec l'exemple du dioxyde de titane : il nous a fallu cinq ans de travail pour produire l'évaluation de l'effet d'un seul additif sur une seule pathologie chronique, c'est-à-dire pour établir le risque de cancérogénicité. Le travail que nous menons dans le cadre de ces projets européens est effectivement très long. Nous cherchons notamment à développer des nouveaux outils mathématiques pour modéliser au mieux ces « effets cocktail ».
Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame la rapporteure, pour dire que la recherche prend du temps, d'abord pour identifier les problèmes puis pour trouver une solution. Certains problèmes ont cependant été correctement anticipés. Je vous en donnerai un exemple concernant les additifs. Il y a quatre ou cinq ans, un consortium d'industriels laitiers français est venu nous voir en disant : « Nous utilisons beaucoup d'additifs dans les produits laitiers, tels que des texturants, des stabilisants, des antifongiques. Nous voudrions que vous travailliez sur ce sujet afin de supprimer complètement ces additifs dans les produits laitiers. » Nous avons développé une stratégie scientifique grâce à un financement interrégional des régions Bretagne et Pays-de-la-Loire et nous sommes parvenus à trouver des molécules présentes à l'état naturel dans les produits laitiers qui ont parfois une efficacité supérieure aux additifs. Ainsi, des molécules qui résultent du métabolisme, de bactéries présentes dans les produits laitiers, ont un effet antifongique supérieur aux éléments rajoutés actuellement dans les produits laitiers à cet effet. Nous avons également travaillé sur des assemblages de protéines laitières qui permettent de texturer le produit.
Nos travaux visent à produire une connaissance et nous avons atteint cet objectif. Ensuite, c'est aux industriels de s'emparer de cette connaissance et de la traduire dans des produits. Ils y ont intérêt, parce qu'ils veulent développer un clean label pour ces produits, c'est-à-dire proposer des produits laitiers qui soient uniquement faits à base de molécules laitières. Nous leur avons donné des outils et des solutions, c'est désormais à eux de les appliquer à leurs produits.
On peut également prendre l'exemple de l'interaction entre TOXALIM et la filière charcuterie, pour laquelle se pose le problème des additifs tels que le sel et les nitrites. Nous espérons que le travail que nous menons depuis dix ans sur ces questions aboutira prochainement à la mise en place de nouveaux procédés de fabrication des charcuteries visant à diminuer ou supprimer ces additifs afin de limiter l'impact sur la cancérogenèse colorectale. Nous fournissons donc effectivement des éléments scientifiques aux filières. Certaines filières prennent bien en compte le résultat de nos recherches, mais cette prise en compte dépend des incitations. Il faut les inciter à modifier systématiquement certains produits.

Ces exemples donnent espoir. Et de fait, il ne faut pas être pessimiste ; ce serait la pire des attitudes. La science permet faire tant de belles choses !
Je voudrais revenir sur la question de l'agriculture biologique. Je suis moi-même fille et soeur d'éleveurs – mon frère élève des animaux. J'habite dans l'Yonne, or le nord de l'Yonne est très cultivé ; c'est désolant de voir à quel point les sols sont maltraités ! Le sol n'a plus de consistance, on ne voit plus de vers de terre… Il est dans un état catastrophique. J'ai suivi les travaux de Claude Bourguignon, qui est désespéré qu'on étudie beaucoup moins aujourd'hui la microbiologie des sols. C'est pourquoi il me semble nécessaire d'enseigner dans les lycées agricoles, par exemple, le fait que les sols se sont terriblement appauvris et que la biodiversité est nécessaire pour nourrir la population de manière saine et durable. En outre, dans quelque temps, avec notamment la suppression du glyphosate, il y aura beaucoup moins de produits phytosanitaires, il faut donc trouver une solution alternative assez rapidement.
Sans doute la direction « agriculture » pourra-t-elle vous apporter plus de détails que la direction alimentation sur ces questions. En revanche, je puis vous assurer que l'INRA étudie la question des sols et celle des interactions du sol avec la plante à travers les micro-organismes, ce qu'on appelle le phytobiome, le microbiome du sol. En effet, nous avons tout à fait conscience de la nécessité de comprendre ces interactions et ces écosystèmes microbiens pour restaurer la qualité et la diversité des sols. Nous pouvons vous remettre un document sur ces questions.
C'est effectivement l'une de nos préoccupations. Nous avons publié des travaux sur ces questions, qui sont à la disposition des enseignants. Nous développons également des instruments pour relier l'enseignement, la recherche et les agriculteurs eux-mêmes, qui travaillent dans des fermes qui appartiennent au réseau de démonstration, d'expérimentation et de production de références sur les systèmes économes en phytosanitaires (DEPHY). Nous nous sommes donc bien emparés de cette question.

Permettez-moi de revenir sur la question de ma collègue concernant les SDHI et les travaux d'évaluation. Monsieur Pierre, vous répondez que le rôle de l'INRA est d'éclairer la décision publique. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Pouvez-vous donc nous éclairer aujourd'hui, puisque la décision publique nous appartient en partie ? Vous avez expliqué que, pour mettre en marché un additif, c'est le demandeur qui établit le dossier qui est examiné ensuite par les organismes d'évaluation. Étant donné votre expertise scientifique, jugez-vous que ce processus est adéquat ? Pensez-vous qu'il faut modifier le processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché, au regard des enjeux de plus en plus importants ? Depuis le début de ces auditions, nous constatons que beaucoup d'évaluations sont conduites a posteriori : une fois que l'on a documenté un problème, on se pose la question de remettre en cause l'autorisation de mise sur le marché. Encore une fois, d'après votre expertise scientifique, pensez-vous que ces processus d'évaluation sont institués correctement, que le timing est le bon ?
Effectivement, le problème du timing est important, car il y a un décalage entre le temps nécessaire aux scientifiques pour accumuler de nouvelles données et l'attente du législateur ou des évaluateurs. C'est un réel problème.
Les nouveaux outils pour modéliser la toxicité des additifs, des contaminants ou des perturbateurs endocriniens sont vraiment importants. Une réévaluation systématique des additifs mis en marché avant 2009 a été mise en oeuvre par les agences d'évaluation et doit se terminer en 2020. Outre cette réévaluation systématique, toute publication de nouveaux résultats par les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) peut conduire à entreprendre une évaluation. C'est ce qui s'est produit dans le cas du dioxyde de titane : une nouvelle publication en janvier 2017 a été à l'origine de la saisine. L'évaluation peut donc être faite à ces deux niveaux, du fait de la réévaluation systématique ou de la publication de nouveaux résultats par les EPST qui donne lieu à la saisine de l'ANSES et de l'EFSA.
Il est certain qu'il faut établir des priorités entre les différentes molécules sur lesquelles on doit travailler. En ce qui concerne le SDHI, nous ne disposons pour l'instant que de données obtenues in vitro : pour établir un nouveau danger potentiel, il faudrait disposer de données in vivo sur des modèles animaux et de données épidémiologiques. En effet, il est important de définir de manière quantitative et qualitative à quoi les consommateurs sont exposés de manière à établir des priorités entre nos travaux pour fournir de nouveaux éléments aux agences d'évaluation. La définition quantitative et qualitative de l'exposome permettra de définir les familles de molécules à étudier en priorité. En effet, comme vous l'avez dit, il existe une infinité de « cocktails » possibles, de sorte que si on adopte une approche non systématique de cet « effet cocktail », on donnera pratiquement un coup d'épée dans l'eau. Il est vraiment nécessaire de définir qualitativement et quantitativement les « cocktails » sur lesquels nous devrons concentrer les recherches.
Nous sommes donc dans une phase de transition : nous passons d'une évaluation molécule par molécule, qui a permis d'évaluer la cancérogénicité de nombreux additifs, à l'évaluation d'« effets cocktail ».

Je tâcherai de poser une question courte et percutante. J'avoue être un peu perplexe quant à la place des scientifiques dans ce dispositif d'évaluation. En effet, je comprends que l'on soit nuancé, que l'on insiste sur la nécessité de développer une méthodologie pour faire la preuve d'une hypothèse. Toutefois, je suis frappée par la variété des positions des scientifiques que nous avons rencontrés. J'ai ainsi entendu un directeur de recherche du CNRS dire que sa hiérarchie avait bloqué une information qu'il avait voulu transmettre au sujet des SDHI. Je m'interroge donc sur l'efficacité des dispositifs d'alerte au sein même du dispositif scientifique. Je suis un peu perplexe sur la place que vous occupez, messieurs, dans la nécessaire mobilisation de l'opinion publique face au danger que présentent tous ces produits chimiques. Dans le domaine du changement climatique, il a fallu la mobilisation forte des scientifiques au sein du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour qu'enfin les scientifiques se mettent d'accord et se fassent entendre.
Nous autres, représentants politiques, entendons une chose et son contraire. Nous entendons certains avis très nuancés, d'autres au contraire très engagés. Qu'en est-il du principe de précaution ? Comment comprenez-vous votre travail d'un point de vue éthique, au sein de la société ? N'est-il pas nécessaire qu'à un moment ou à un autre, vous sortiez de votre réserve pour vous imposer davantage face aux lobbyistes et pour soutenir l'action politique ?

Chère collègue, permettez-moi de préciser un point. Je ne pense pas que le professeur Rustin ait affirmé qu'il avait été bloqué par sa hiérarchie.

J'ai eu l'occasion de l'entendre en privé, et il m'a raconté les difficultés qu'il avait rencontrées, et même comment sa hiérarchie l'a « lâché » – disons le mot.
Il faut se souvenir que les données dont nous disposons sont principalement des données in vitro, et ne pas créer d'anxiété inutile. En effet, il est très difficile de trouver un équilibre entre l'alerte et la déclaration anxiogène. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Le principe de précaution lui-même relève du législateur.
En tant que scientifiques, nous devons rester factuels. Les faits sont constitués par les données scientifiques accumulées. Or, de fait, avec les méthodes d'évaluation actuelles qui reposent largement sur des approches in vivo, lesquelles demandent des expérimentations longues et parfois une exposition d'un an des modèles animaux, le temps d'accumulation des données est malheureusement long. Mais ce temps est nécessaire pour assurer des bases scientifiques solides.

La réponse est presque plus courte que la question ! Permettez-moi donc d'en remettre une couche, si vous me passez l'expression. Je me faisais la même remarque avant que Mme Toutut-Picard pose la question : nous nous interrogeons devant l'écart entre le discours très fort de certains scientifiques que nous avons reçus qui cherchent justement à alerter la population, et le vôtre, qui est plus mesuré, voire un peu policé.
J'entends bien que, dans le domaine scientifique, on s'appuie le plus possible sur des expérimentations solides et sur des faits. Cependant, nous sommes face à un problème lorsque nous constatons l'ensemble des additifs, les pesticides qui sont présents dans notre alimentation. En effet, il est certain que les expériences seront faites in vitro ou sur des modèles animaux : on n'exposera pas une cohorte humaine aux SDHI ou à des pesticides. L'ensemble des faits sur lesquels s'appuie le professeur Rustin nous semble suffisamment solide pour que l'on puisse lancer l'alerte. Le professeur Rustin, par exemple, est sorti de cette réserve qu'évoquait Mme Toutut-Picard, considérant que l'enjeu de santé était suffisamment important pour publier une tribune avec d'autres scientifiques – le fait que cette démarche soit collective accroît la force probante de cette déclaration.
Dans votre réponse très policée et très courte à la question de Mme Toutut-Picard, on sent aussi ce décalage.
C'est aussi une question de moyens – nous pouvons aborder le problème du financement de la recherche si vous le souhaitez. Le financement de la recherche qui repose uniquement sur des appels d'offres pose problème. Ainsi, il n'y a plus d'appel d'offres ciblé sur ces questions, par conséquent il n'est pas toujours évident de trouver des financements. L'Agence nationale de la recherche (ANR) n'est pas la plus prompte à financer ce type de projets qui relèvent de l'évaluation. Reste l'ANSES qui finance effectivement ce type de projets, cependant la hauteur de ces financements n'est pas toujours suffisante pour proposer une réponse globale. Financer ces projets est donc un vrai problème.
Les résultats que nous fournissons sont très clairs, dans le cas du dioxyde de titane et des nanoparticules, pour prendre des exemples que je connais bien. Ces résultats ont permis de soulever un nouveau risque qui a été présenté au niveau scientifique et au niveau médiatique et qui a permis d'avertir concernant un « potentiel nouveau danger » – je reprends là les termes de l'ANSES – associé à cet additif. Il est malheureusement logique que l'ANSES ne conclue pas sur la base d'une seule étude sur un modèle animal à un risque avéré pour l'homme.
Permettez-moi de prendre une image pour illustrer la différence entre le risque et le danger. Il existe un danger de se faire écraser quand on traverse la route, mais le risque est différent si l'on traverse une route départementale dans le Gers ou si on traverse l'autoroute A1 à l'heure de pointe. Aujourd'hui, pour de nombreux additifs, le danger a été avéré mais le risque n'est pas établi. Or le risque dépend de l'exposition et de l'impact sur la santé. Cette évaluation du risque est encore plus longue que la mise en évidence d'un danger – je suis le premier à le déplorer, mais c'est ainsi. La mise en évidence d'un danger est factuelle et peut être établie sur un modèle animal. Dans le cas du dioxyde de titane, elle a tout de même pris trois ans de travail sur la base d'un projet ANSES. Mais la quantification du risque, qui requiert des études épidémiologiques et une évaluation précise de l'exposition de la population générale à cette fraction nanoparticulaire, va demander encore malheureusement beaucoup de temps.

Permettez-moi de réfuter l'analogie avec la départementale du Gers et l'autoroute : dans le cas des additifs, nous sommes d'accord sur le fait que le danger est quasiment avéré…
Mais justement, tout le problème est dans ce « quasiment » ! Tout le problème est de savoir à quel moment on est sûr que ce danger est avéré pour l'homme. Pour l'instant, nous avons une donnée solide – c'est moi qui ai publié ces résultats dans une très bonne revue ; je peux donc vous en parler très clairement –, mais il s'agit d'une expérimentation sur un modèle animal.

Nous en revenons au curseur que j'évoquais tout à l'heure. Je voudrais savoir à quel moment vous pouvez sortir du bois et dévoiler un risque.

La question est aussi de savoir quelle est l'instance décisionnaire qui affirme que l'on passe d'un simple risque à un véritable danger. Le cas du SDHI, par exemple, fait apparaître toute une nouvelle catégorie de perturbateurs métaboliques, et non endocriniens. C'est donc un nouvel ensemble de risques qui apparaît. Qui va prendre la décision de faire des recherches dans ce domaine et qui va distribuer l'argent en fonction de priorités sanitaires ?
Comme cela a été dit, le système actuel d'évaluation est basé sur des conclusions de l'ANSES et de l'EFSA. C'est à nous de fournir des éléments académiques aux agences d'évaluation, comme nous le faisons effectivement. Permettez-moi de le répéter : nous devons établir des priorités dans nos investissements. En effet, ni nos forces ni nos moyens ne sont illimités. Nous devons donc définir quelles sont les familles de molécules les plus importantes à étudier. Les études actuelles de l'exposome sont très utiles pour avancer dans cette direction.
Il est vrai que l'évaluation est actuellement conduite par des agences nationales ou, dans le cas de l'EFSA, européenne, et que ce sont elles qui concluent de manière définitive.

Permettez-moi de revenir sur la distinction entre danger avéré et risque. Dans cette affaire, nous sommes toujours les perdants ! Le principe de précaution est assez peu appliqué aujourd'hui. Il me semble que la procédure dans le domaine de l'alimentation est l'inverse de celle qui existe dans l'industrie pharmaceutique. En effet, dans le domaine pharmaceutique, on s'assure du bénéfice du médicament pour la santé avant la mise en marché. En revanche, dans le domaine de l'alimentation, on est toujours en retard par rapport à la mise en marché.
Peut-être n'ai-je pas été clair, mais non, le processus n'est pas inverse. Avant la mise sur le marché, le demandeur doit fournir des études métaboliques, des études de génotoxicité, de reprotoxicité et de cancérogénicité. Ce dossier existe donc avant la mise en marché et il est avéré. Toutefois, pour beaucoup de molécules, ces données remontent aux années 1970 à 1990 ; or à cette époque, certains phénomènes comme la fraction nanoparticulaire – pour reprendre un cas que je connais bien – n'étaient pas du tout connus ; c'est pour cela que l'on procède à une réévaluation. Donc ces dossiers existent, mais les outils utilisés pour fournir ces données n'étaient pas les mêmes.
Encore une fois, il est indispensable d'établir des priorités en ce qui concerne les familles de molécules à étudier, parce que les combinaisons sont infinies ! Il faut également perfectionner les modèles mathématiques pour améliorer les prédictions. On ne pourra pas répondre avec un coup de baguette magique à vos attentes ! Il faut donc choisir où l'on investit, sur la base d'études qui permettent de mieux comprendre l'exposome. Il est vrai que l'INRA a également pour objectif de proposer de nouveaux outils et de nouvelles approches pour l'évaluation qui ne soient pas basées seulement sur l'in vivo pour répondre au plus vite et au mieux aux nouveaux risques. Cependant cette démarche est en cours d'élaboration.
Ce peut être le producteur de l'additif ou un utilisateur.
Il peut s'agir d'un industriel qui va l'utiliser dans son processus de fabrication. Ensuite, sur la base du document fourni sur les études de métabolisme, de cancérogénicité et de reprotoxicité, l'EFSA calcule une dose journalière admissible (DJA). Si cette DJA est dépassée, étant donné les niveaux de consommation attendus, le produit ne sera pas autorisé ; en revanche, si la DJA n'est pas dépassée, le produit peut être autorisé. Mais cela ne relève pas du tout de l'INRA mais des agences d'évaluation.

Nous avons besoin d'éclaircissements. J'essaie de faire le béotien. Le demandeur qui constitue son dossier d'autorisation de mise en marché procède-t-il à une recherche bibliographique sur son produit, en s'appuyant sur les observateurs publics et indépendants qui ont procédé à des études qui permettent de conclure à une innocuité du produit, ou ces demandeurs produisent-ils eux-mêmes des études « scientifiques » pour étayer l'innocuité de la molécule, de l'additif ou du pesticide qu'ils veulent mettre sur le marché ?
Si vous vous concentrez sur ces questions, il est nécessaire de vous tourner vers les agences d'évaluation nationale et européenne, c'est-à-dire l'ANSES et l'EFSA, qui vous répondront beaucoup plus précisément que moi, car ce n'est pas mon métier.
Nous devons effectivement fournir des résultats d'études. Permettez-moi de prendre une nouvelle fois l'exemple du dioxyde de titane. Nous avons établi les effets sur le risque de cancer du dioxyde de titane à des doses très fortes, sur des modèles animaux. Le dossier a été établi sur la base d'une étude des années 1970 qui est toujours disponible. Mais dans le cas du dioxyde de titane, les modes de production et les modèles d'évaluation de l'impact sur la santé ont changé depuis. On est aujourd'hui en mesure de constater que la fraction nanoparticulaire est supérieure aux normes, d'où la nécessité d'une réévaluation. Une évaluation a donc été conduite dans les années 1970, sur la base de doses supérieures à 1 000 milligrammes par kilo de poids corporel – je donne ce chiffre de mémoire –, et cette évaluation n'avait pas constaté d'effet sur le modèle animal utilisé à cette époque-là.

À vous écouter, j'ai l'impression d'une partie de cache-cache engagée entre les chercheurs, les instituts de contrôle et de surveillance et les industriels, dans laquelle la force publique a toujours énormément de retard et passe son temps à essayer de le rattraper. Vous parlez de données de 1970… Cela m'effraie, car nous sommes en 2018 et certaines problématiques s'imposent à nous, ici et maintenant.
Ensuite, vous vous référez tout le temps à l'EFSA. J'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de l'EFSA puisque j'ai fait partie d'une délégation qui accompagnait la secrétaire d'État Brune Poirson lorsqu'elle s'est rendue à Parme pour les rencontrer. Je leur ai posé cette question des outils ; j'ai demandé depuis combien d'années la dose journalière admissible d'exposition à des produits toxiques (DJA) n'avait pas évolué. En outre, la DJA est la même pour un bébé, un vieillard, un individu en bonne santé ou une personne malade.
Le flottement actuel du référentiel scientifique est extrêmement inquiétant. Quand on s'adresse à des agences ou à des chercheurs comme vous, on nous renvoie toujours vers des espèces de vigies que sont l'EFSA ou l'ANSES, et quand on gratte un peu, on se rend compte qu'elles sont dépassées par les événements. C'est l'impression que m'a fait l'EFSA, par exemple, qui se raccroche aux DJA, alors que ses outils n'évoluent pas – peut-être par manque de financement et par manque de volonté politique de mettre de l'argent là où il faudrait qu'il soit. Il n'en reste pas moins que ce que vous nous dites est assez inquiétant. Ce n'est pas une attaque contre vous personnellement, c'est le système lui-même qui est inquiétant, car on ne voit pas à quel endroit se situent les outils ou les offices de protection de la population. Il n'y a pas une instance qui ait un regard sur tout le panel des données scientifiques et qui oblige à une réactualisation, qui se situe à l'avant-garde et non pas toujours à la traîne de la connaissance scientifique.
Je ne travaille pas du tout sur les aspects toxicologiques ou sur les contaminants, aussi je ne suis pas bien placé pour vous en parler. Mais je voudrais apporter quelques précisions sur les relations entre l'EFSA, par exemple, et les organismes de recherche publique comme l'INRA. L'EFSA anticipe certains problèmes potentiels, par exemple du fait de l'arrivée sur le marché de nouvelles protéines issues d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans ce cas, l'EFSA a clairement identifié le problème et cherche désormais des solutions. Dernièrement, ils ont mandaté une des équipes de l'INRA et des équipes d'autres instituts européens pour travailler sur des outils de prédiction du risque allergique de ces nouvelles protéines. Nous ne sommes pas allés les chercher, c'est eux qui ont formulé ce besoin de disposer d'une palette d'outils pour évaluer ces protéines qui seront mises en marché dans quelques années. Il existe donc des relations étroites entre ces différentes institutions et, dans le domaine que je connais en tout cas, l'EFSA est très au courant de ce qui se passe et de ce qui risque d'arriver sur le marché alimentaire.

Effectivement, l'EFSA commence un peu à bouger depuis que leur budget a été menacé, ce qui les a secoués !
Pour être clair, j'adorerais vous répondre favorablement.
Oui, pour l'instant, nous ne sommes effectivement pas capables d'établir la toxicité de l'ensemble des mélanges auxquels nous sommes exposés. Certains mélanges sont étudiés sur la base, encore une fois, d'une définition qualitative et quantitative précise des molécules auxquelles nous sommes exposés. Or parfois ces mélanges ont des effets supra-additifs, c'est-à-dire supérieurs à l'addition de l'effet de chacune des molécules ou parfois ils ont des effets infra-additifs. Par conséquent, la question n'est pas aussi simple que cela ! Nous ne pouvons pas dire que tous les additifs ont des effets délétères ou que tous les « cocktails » ont des effets délétères. En fonction des moyens que nous avons à notre disposition et du système d'évaluation actuel, nous fournissons le maximum d'informations scientifiques pour que l'évaluation soit la plus précise possible. Il n'en reste pas moins que le temps scientifique peut paraître long.

Je souhaiterais que vous apportiez une précision. Vous évoquiez les « demandeurs », j'imagine que ce sont des industriels qui élaborent de nouveaux produits ou de nouveaux additifs. La pizza aux 30 additifs que nous évoquions tout à l'heure est sur le marché, nous pouvons tous en manger. Ainsi, si le fabricant ne demande rien, on se base toujours sur des analyses anciennes, il n'y a pas d'obligation de réévaluation, compte tenu du caractère périmé des analyses qui étaient très bien autrefois mais qui sont aujourd'hui totalement dépassées.
Comme je l'ai dit, la réévaluation est en cours et sera terminée en 2020. Tous les additifs qui sont autorisés auront donc été réévalués. Prenons un exemple dans un domaine que je connais bien, la relation entre l'alimentation dans sa globalité – et non pas uniquement les additifs – et le cancer. Les évaluations sont conduites notamment par le Fonds mondial de recherche contre le cancer (WCRF) qui réévalue systématiquement l'ensemble des associations entre alimentation et cancer. Ce sont des évaluations qui ont commencé en 1997 ; des réévaluations ont eu lieu en 2007, en 2010, en 2011, et récemment, en 2017. Peut-être cette réévaluation de l'impact de notre alimentation sur les maladies chroniques n'est-elle pas assez visible pour que vous la connaissiez, mais elle a bien lieu. Elle est systématique et établie sur la base de la littérature scientifique car effectivement, elle ne peut se faire que sur la base des données scientifiques que nous fournissons. En ce qui concerne la relation entre alimentation et cancer, peut-être les médias et les législateurs découvrent-ils le risque lié à la consommation de produits carnés, mais les scientifiques ont alerté de ce risque dès 1997. Ce risque a été confirmé en 2007 et en 2011 et il est pris en compte par l'OMS depuis 2015.

Certes, mais l'OMS n'est pas la France ! Les produits qui entrent sur le territoire avec les autorisations de mise sur le marché classiques sont-ils soumis également à vos analyses ? Ainsi, étant donné les accords commerciaux internationaux, certains produits arriveront sur le territoire français après avoir subi un contrôle lors de leur sortie du pays exportateur mais pas au moment de leur entrée sur notre territoire. Dans quelle mesure est-on protégé contre des additifs, quels qu'ils soient, qu'on n'aurait pas eu à analyser et pour lesquels il y a déjà des autorisations de mise sur le marché ?
Je vous ai invités tout à l'heure à vous tourner vers l'ANSES et l'EFSA ; cette fois-ci, je vous invite à vous tourner vers la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui est chargée de procéder à ces contrôles.
Nous pouvons toutefois affirmer que l'évaluation et l'autorisation des additifs sont faites pour l'instant molécule par molécule. Ainsi, dans une pizza qui contient plusieurs additifs, chacun d'entre eux est autorisé sur la base d'une évaluation, mais l'« effet cocktail » n'est pas pris en compte dans l'évaluation actuelle. Néanmoins, nous nous investissons dans cette étude.

Revenons sur la question des moyens. Comme vous l'avez dit, l'ANR ne s'intéresse pas particulièrement à ces sujets. Sur les thèmes sur lesquels elle investit, les taux de réussite sont d'environ 10 %. Les financements de l'ANSES ne sont pas non plus pléthoriques. Nous sommes conscients de la nécessité que les évaluations soient mises en oeuvre rapidement. Les moyens dont vous disposez, notamment au niveau du département alimentation et bioéconomie, vous semblent-ils suffisants pour faire votre travail dans des conditions correctes ?
Permettez-moi de faire une réponse courte et indépendante de l'institut pour lequel je travaille. La réponse est claire : non, les moyens ne sont pas suffisants. Je suis également expert pour l'Institut thématique multi-organisme cancer (ITMO Cancer) et, dans ce cadre, nous sommes en train de rédiger un texte sur le malaise des chercheurs. Il ne faut pas négliger que le fait de répondre systématiquement à des appels d'offres avec un taux de réussite très faible, en particulier pour les jeunes recrutés, est très déstructurant. Le fait de se trouver entre le marteau et l'enclume, entre les agences d'évaluation, le législateur et les médias, comme on le voit aujourd'hui, n'est pas évident non plus. Il est de fait que la situation actuelle qui exige que nous nous transformions de chercheurs en chercheurs de financement n'est pas satisfaisante et qu'elle ne permet pas de répondre le plus rapidement possible à ces questions qui sont déterminantes – nous sommes les premiers à nous en préoccuper.
Je pense donc qu'il y a effectivement une réflexion à poursuivre sur le rééquilibrage entre la subvention d'État et la situation où tous les financements reposent sur des appels d'offres, afin d'établir des priorités. Sur ce type de questions, l'ANR a développé par le passé des programmes centrés sur l'alimentation, les programmes nationaux de recherche en alimentation et nutrition humaine (PNRA) à la création de l'ANR, puis le programme « alimentation et industries alimentaires » (ALIA). Mais aujourd'hui ce type de programmation ciblée n'existe plus. Je pense qu'un retour à ce type de programmation ciblée des financements pourrait contribuer à répondre aux enjeux actuels.
Je partage également ces préoccupations, pour être chercheur moi-même. Au niveau européen, le neuvième Programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (PCRD) est en train d'être construit. Nous sommes actuellement dans une logique de lobbying pour introduire le mot « alimentation » qui n'apparaissait même pas dans les premiers brouillons que nous avons reçus de ce programme. Ces brouillons comprenaient une partie santé, une autre sur le climat, sur la nature et sur l'environnement, et par conséquent l'alimentation était dispersée entre ces différentes parties, ce qui conduit à perdre de vue son importance. On a réussi à reprendre la rédaction avec la Commission européenne et l'ensemble des chercheurs pour constituer l'alimentation comme une catégorie à part entière. Nous nous efforçons notamment de faire réapparaître la sécurité sanitaire qui avait complètement disparu des deux derniers programmes-cadre. Si ces notions n'apparaissent pas, nous ne parvenons plus à obtenir des fonds sur ces thématiques. L'institution s'efforce donc bien de faire réémerger ces thèmes de recherche.

Dans le cadre du plan national santé environnement (PNSE), il y a bien des thématiques qui pourraient vous aider à vous faire entendre et à obtenir des financements. En outre, il est décliné en plans régionaux. Ne serait-ce pas une solution pour vous intégrer à une démarche nationale portée en l'occurrence par le ministère de la Santé et pour décrocher des financements ?
Il se trouve que je fais partie du groupe de réflexion pour définir le périmètre du prochain PNSE 4. C'est bien l'enjeu des réflexions que nous développerons notamment lors d'une réunion qui aura lieu les 13 et 14 juin pour exposer le périmètre que nous proposons pour le PNSE 4. L'alimentation fait assurément partie de ce périmètre.

Est-il envisagé d'intégrer cette nouvelle catégorie de dangers que constituent les perturbateurs métaboliques ?
Certes, il est normal de se centrer sur un type de molécule quand il a fait l'objet d'une actualité récente. Toutefois, ces perturbations métaboliques par des contaminants chimiques ou par des résidus de pesticides sont bien connus et ne constituent pas une spécificité des SDHI. De nouvelles données sur les mélanges de pesticides présents dans la consommation humaine et les perturbations métaboliques paraîtront prochainement dans la revue Environmental Health Perspectives (EHP). Les équipes de l'INRA travaillent donc effectivement sur ces sujets, en particulier sur le syndrome métabolique, sur les risques d'obésité et de diabète qui y sont associés.
Je suis désolé d'être un peu gris dans mes conclusions, mais je suis obligé de me limiter à la portée des conclusions des études publiées sur l'effet métabolique de ces pesticides à la dose équivalente à la DJA. Je suis désolé d'insister sur ce point mais, en tant que scientifiques, nous devons être factuels. La portée des conclusions de notre travail dépend des modèles que nous utilisons. Ainsi, lorsque je travaille sur un modèle animal au stade précoce de la carcinogenèse colorectale, je ne peux pas établir de conclusion quant à l'effet un stade terminal de la pathologie et je ne peux pas extrapoler directement à l'homme. C'est effectivement frustrant, mais la rigueur scientifique impose ce langage, qui est peut-être un peu gris mais qui est factuel.

Nous approchons du terme de cette audition. Nous avons eu des discussions intéressantes qui nous ont amenés à nous concentrer sur quelques sujets, et par conséquent nous n'avons pas pu en examiner beaucoup d'autres. Si vous avez quelques éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance et que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, du fait du large spectre des discussions que nous avons eues ce matin, je vous propose de prendre quelques minutes pour le faire.
Je veux bien répondre à une question que vous n'avez pas posée. Étant donné que la thématique générale est l'alimentation industrielle, j'imaginais que nous parlerions davantage de la qualité nutritionnelle de celle-ci et de son évolution. Je voudrais donc vous exposer quelques résultats observés par l'OQALI créé il y a une dizaine d'années pour observer l'évolution des caractères de ces produits. Tout un travail a été mené en partenariat avec l'ANSES pour mesurer la dynamique de l'évolution de la teneur en sel, en sucre, en matières grasses, en acides gras saturés de l'offre alimentaire. Essayons de résumer en quelques mots les observations réalisées au cours des sept dernières années. Permettez-moi d'apporter d'abord une précision : dans le domaine des scénarios, de la modélisation et de la simulation, de nombreuses publications établissent que les gains potentiels, en termes d'exposition au sucre ou au sel, par exemple, qui pourraient être permis par la reformulation des produits alimentaires, c'est-à-dire par l'action sur l'offre alimentaire, sont significatifs. Autrement dit, l'action sur l'offre alimentaire pourrait avoir des effets significatifs sur la consommation de sel, de sucre ou autre des consommateurs finaux et donc engendrer potentiellement des gains en termes de santé. Les gains que l'on pourrait obtenir en agissant sur l'offre sont peut-être plus forts que ce qu'on peut obtenir par une modification réaliste à court terme des comportements de consommation. Dans le domaine de l'alimentation, il y a donc bien un enjeu véritable du côté de l'offre.
Depuis une dizaine d'années maintenant, des dispositifs ont été mis en place, comme les chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnel, les chartes PNNS, ou les chartes PNA. Il y a donc eu des essais pour essayer d'inciter l'industrie, de manière générale, à reformuler les produits et donc à réduire les teneurs en sel ou en sucre.
Où en sommes-nous aujourd'hui ? Prenons un peu de recul sur les sept dernières années. Le bilan est contrasté. Si on observe l'ensemble des familles de produits que l'on caractérise comme alimentation industrielle transformée, dans environ 20 % de ces familles – je vous donne ce chiffre à la louche –, on note des variations significatives de la teneur moyenne en sel, en acides gras saturés, et éventuellement en sucre. Certaines de ces variations sont même très significatives : ainsi, dans les chips qui sont sur le marché, on observe une réduction de plus de 60 % de la teneur en acides gras saturés, liée au fait que les industriels ont remplacé l'huile de palme par d'autres huiles qui en contiennent moins, et une réduction de la teneur en sel de l'ordre de 10 % à 15 %. Les autres évolutions n'atteignent sans doute pas cette ampleur, mais on constate tout de même des réductions significatives de la teneur en sel de la charcuterie ou d'autres catégories de produits. On observe donc des changements pour certaines marques, certaines familles de produits ou certains secteurs industriels.
Je pense que les démarches qui ont été mises en place à travers les chartes, par exemple, ont créé un contexte qui s'est révélé être relativement incitatif, même si on peut regretter, par exemple, le fait qu'on ne constate de changements que pour 20 % des familles de produits.
L'enjeu aujourd'hui, selon moi, est justement de trouver comment généraliser ce processus. En effet, l'impact au niveau des consommateurs finaux de ces variations de la teneur en sel, par exemple, reste très faible. Ainsi, nous avons estimé avec des collègues de l'ANSES que les modifications de reformulation observées se traduisent par une réduction de moins de 1 % de la consommation en sel des consommateurs finaux. Le bilan est donc contrasté, car on observe bien des évolutions mais l'impact sur les consommateurs reste faible. L'enjeu majeur de l'action publique des prochaines années est donc bien de trouver comment généraliser cette dynamique de manière à avoir un effet plus fort sur la santé des consommateurs.

Merci d'avoir abordé la question que nous n'avions pas posée. Consacrons-y les quelques minutes qui nous restent. Hier, la directrice générale de Foodwatch France affirmait que si nous n'imposons pas un cadre réglementaire contraignant, l'industrie ne prendra pas l'initiative de réduire la teneur en sel, en acides gras saturés, sauf si la demande est assez forte. Vous dites que l'on constate un changement pour 20 % environ des familles de produits et vous demandez comment généraliser ces changements. Pensez-vous qu'une contrainte réglementaire permettrait une telle généralisation ? Comment la mettre en place ? J'imagine que la variabilité de la teneur en sel, en acides gras, en sucre, est très grande selon les familles de produits, pour des motifs divers, dans certains cas en raison du processus industriel et dans d'autres pour le goût — il faut tenir compte de l'hédonisme que vous évoquiez tout à l'heure. Comment faire alors pour instituer un cadre général ?
C'est en effet la question centrale : quels outils peuvent permettre d'accompagner le processus ? Il en existe plusieurs. Le Nutri-Score participe d'une telle démarche et constitue un premier levier. Son objectif est en effet de proposer un support permettant de créer des incitations à la reformulation. Comme je vous l'ai dit, l'OQALI sera en charge du suivi du Nutri-Score. Il faudra en effet en mesurer l'impact. Combien d'industriels l'utiliseront ? Permettra-t-il de créer une dynamique d'amélioration de la qualité des produits ?
Un deuxième levier est constitué par les taxes nutritionnelles, c'est-à-dire des taxes qui sont liées à la teneur de certains aliments en sucre, par exemple, comme une taxe sur les sodas. De telles taxes pourraient affecter les arbitrages en termes de qualité des produits ; à ce stade, nous n'en sommes pas totalement sûrs : les études actuelles nous permettent de dire quel serait l'effet de telles taxes sur les quantités consommées et sur les prix, mais pas encore de comprendre comment elles modifieraient les arbitrages de l'industrie en ce qui concerne les types de produits et leurs caractéristiques. Ces travaux sont en cours.
Le troisième levier consiste dans l'action directe sur l'offre, soit par le biais de chartes, de négociations entre les pouvoirs publics et les entreprises, comme celles qui ont eu lieu au Royaume-Uni, qui se sont avérées assez efficaces en ce qui concerne la teneur en sel des aliments, ou comme celles qui sont en cours aux Pays-Bas.
Enfin, il y a la réglementation qui consiste à établir des standards. Ainsi, le Danemark a mis en place il y a quelques années un standard, à savoir une teneur maximum en acides gras saturés pour une série de produits. Cependant, comme vous l'avez remarqué, il est difficile de définir un standard étant donné la très forte hétérogénéité des catégories. On peut envisager un standard un seul nutriment qui est en jeu dans un produit et que ce nutriment n'a pas d'interaction, y compris d'un point de vue technologique, avec d'autres composants du produit. En revanche, dans des familles de produits dans lesquelles tous les nutriments sont en interaction, si on réduit le sucre et que cela augmente les coûts, ou que pour maintenir les propriétés du produit il faut augmenter la matière grasse, le gain n'est pas assuré, et par conséquent il est compliqué de mettre en place des standards. En effet, les pouvoirs publics ne sont pas très à l'aise pour définir des standards dès lors qu'existent des contraintes technologiques complexes. Ainsi, pour répondre à votre question, les standards peuvent être efficaces et pertinents quand existe une variable simple qui permet de définir le niveau de qualité du produit. En revanche, lorsque les variables sont complexes, il faudrait plutôt privilégier d'autres leviers d'action. Il est certain que les démarches qui reposent sur ce que l'on appelle des « accords volontaires », qui sont en fait des négociations instituées par les pouvoirs publics avec l'industrie, lorsqu'elles fonctionnent, sont ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, car elles sont moins coûteuses pour chacun. Reste à savoir comment les faire marcher.
Je terminerai en affirmant qu'une certaine constance des politiques publiques est nécessaire pour améliorer l'alimentation. En effet, il est difficile de modifier les qualités nutritionnelles des produits parce car il existe des rigidités partout : dans les comportements des consommateurs, plus fortement encore dans le comportement des entreprises parce qu'elles sont liées par de multiples contrats. Les études de l'évolution des politiques nutritionnelles montrent que chaque levier d'action pris individuellement a un effet faible. Par conséquent, on ne peut progresser que si on combine les outils ; il faut donc jouer un peu sur l'offre, un peu sur la demande. Mais surtout, il faut inscrire ces outils dans la durée, d'où la nécessité d'une constance des politiques publiques. Il ne faut pas changer de direction dès lors que l'on s'aperçoit un peu trop vite que l'on ne constate pas de modifications suffisantes.
Permettez-moi de revenir une dernière fois sur l'exemple de la filière charcuterie. Sur la base de données sur le lien entre la consommation de charcuterie et le cancer colorectal, nous travaillons depuis dix ans pour établir plusieurs stratégies qui permettraient de limiter le risque. Que manger en même temps que les charcuteries ? Comment élever les animaux ? Comment produire ces charcuteries ? Sur la base de ces différentes stratégies, afin qu'elles aient un impact sur l'ensemble de la population, on a défini des collaborations avec la filière pour modifier les produits sur le marché, établir de nouvelles recommandations et modifier les filières de production et d'élevage des animaux. On peut donc aussi envisager des démarches actives des filières, sur la base des résultats scientifiques, pour limiter les risques de maladies chroniques associés à la consommation d'un produit.

Nous arrivons au terme de cette audition. Nous retiendrons, en guise de conclusion, votre appel à la constance des politiques publiques. Que cela inspire notre action pour les quatre années à venir. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un bon retour dans vos unités et vous remercions pour votre contribution.
La séance est levée à onze heures vingt.
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 31 mai 2018 à 9 h 15
Présents. - Mme Michèle Crouzet, M. Loïc Prud'homme, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Pierre Vatin
Excusés. - M. Julien Aubert, M. Christophe Bouillon