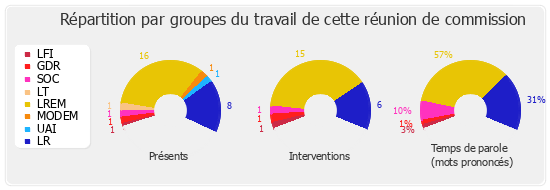Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 5 juin 2019 à 16h20
La réunion
Présidence
La commission, réunie en commission d'évaluation des politiques publiques, entend Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et M. Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et auprès du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique.

Je présenterai l'analyse de l'exécution des crédits de la mission Engagements financiers de l'État avant d'exposer mon sujet d'évaluation, qui concerne l'obligation assimilable du Trésor verte, émise par la France depuis janvier 2017.
Du point de vue de l'exécution, il apparaît que les dépenses liées à la charge de la dette et de la trésorerie de l'État sont supérieures de 344 millions d'euros à la prévision de la loi de finances initiale (LFI). En effet, l'inflation a été plus forte qu'anticipé, ce qui entraîne un surcoût lié aux titres de dette qui sont indexés sur elle. Toutefois, la charge de la dette de l'État a diminué de 0,2 milliard d'euros par rapport à 2017, tandis que l'encours de la dette a progressé de 70 milliards d'euros, s'établissant à 1 756 milliards.
Cette situation est tout à fait exceptionnelle : à mesure que la dette de l'État augmente, la charge de la dette diminue. Cela illustre un contexte macroéconomique et financier tout à fait particulier, avec des taux historiquement bas et une politique monétaire qui reste accommodante. Néanmoins, je voudrais rappeler l'engagement de la majorité parlementaire de maîtriser l'endettement de l'État, malgré ces conditions de financement très favorables.
En 2018, le besoin de financement s'est établi à 192 milliards d'euros, au lieu des 202,6 milliards d'euros anticipés en LFI. Cela est lié à un déficit à financer plus faible que prévu.
Le programme Appels en garantie de l'État présente un niveau de sous-exécution conforme aux exercices précédents – 44,6 millions d'euros au lieu de 104,1 millions d'euros. Cela illustre la prudence des prévisions du Gouvernement en matière d'appels en garantie. Par ailleurs, je me félicite d'avoir obtenu la transmission du rapport sur l'exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, prévu à l'article 24 de la loi de programmation des finances publiques de 2018 et du tableau d'inventaire des garanties recensées de l'État (TIGRE), que j'avais demandé l'année dernière lors de ces travaux d'évaluation. Notre Printemps de l'évaluation sert bien à quelque chose ! Ces rapports présentent des informations intéressantes sur les garanties accordées par l'État.
Je tiens à saluer le fait qu'aucune autorisation d'octroi de garantie n'ait figuré en loi de finances rectificative (LFR) de fin d'année, contrairement à ce qui s'est passé lors des exercices précédents. Il s'agit, selon moi, d'une véritable avancée pour le Parlement. Les autorisations de garantie de l'État méritent en effet de figurer en loi de finances initiale, afin de permettre aux parlementaires d'analyser et de débattre de ces dispositions dans des conditions pleinement satisfaisantes.
L'exécution du programme Épargne est en sous-consommation par rapport à la LFI, comme lors des exercices précédents. Cela illustre le désintérêt des épargnants à l'égard des prêts d'épargne logement et des comptes épargne logement, dont les taux ne sont pas compétitifs par rapport aux taux de marché. Cependant, le programme Épargne retrace trente dépenses fiscales représentant environ 5,9 milliards d'euros. Je relève que, parmi ces dépenses fiscales, onze ne sont pas chiffrables et trois ont un montant insignifiant, inférieur à 0,5 million d'euros – autrement dit, près de la moitié des dépenses fiscales recensées dans le programme sont concernées. Madame la secrétaire d'État, pourrions-nous envisager la mise en place d'un travail visant à la suppression de certaines d'entre elles lors de la prochaine loi de finances, afin de contribuer à la simplification de la fiscalité française ?
Enfin, le programme Dotation du Mécanisme européen de stabilité présente une dépense de 100 millions d'euros en 2018, alors qu'il n'était doté de crédits ni en loi de finances initiale ni en loi de finances rectificative. Cette dépense est liée à la décision prise par la France de rétrocéder les intérêts perçus par la Banque de France sur le capital placé par le Mécanisme européen de stabilité (MES) auprès de celle-ci, sous réserve d'un engagement similaire d'un autre État membre. Il apparaît que seule l'Allemagne applique un mécanisme similaire. Un décret du 26 décembre 2018 a ainsi ouvert 100 millions d'euros sur ce programme et annulé un montant équivalent sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission Crédits non répartis. Je ne peux que regretter l'absence de dotation en LFI et en LFR, qui remet en cause la sincérité de la budgétisation du programme. Si la dépense n'était pas certaine en 2018, elle était hautement probable. Par ailleurs, la Cour des comptes conteste l'utilisation des crédits non répartis pour le financement du programme.
Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est pour l'exercice 2019 ? Faudra-t-il de nouveau financer une rétrocession des intérêts perçus par la Banque de France sur le capital placé par le MES auprès de celle-ci ? Si cette perspective était probable, pourrions-nous convenir de prévoir cette dotation dès la prochaine LFR, afin d'accroître la sincérité budgétaire de ce programme ?
J'en viens à la thématique d'évaluation de cette année, qui concerne donc l'obligation souveraine verte émise par la France. En janvier 2017, l'Agence France Trésor (AFT) a émis pour la première fois une obligation assimilable du Trésor (OAT) verte. Une OAT verte est un titre d'émission de dette pour lequel l'émetteur s'engage vis-à-vis des investisseurs à ce que les fonds soient utilisés pour financer des dépenses vertes.
Les quatre objectifs de l'OAT verte française visent à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation au changement climatique, à la protection de la biodiversité et à la réduction de la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Un dispositif de sélection des dépenses a été mis en place par différentes directions de l'administration, notamment le Commissariat général au développement durable (CGDD) et le ministère de l'économie et des finances.
D'une maturité de vingt-deux ans, l'OAT verte a été émise à un taux de 1,75 %, pour un montant de 7 milliards d'euros, ce qui en fait l'obligation souveraine verte de référence la plus importante en taille et la plus longue en maturité jamais émise. Près de 200 investisseurs ont apporté leur soutien à cette émission. L'obligation a été réémise plusieurs fois. Le montant de l'encours de l'OAT verte s'élève désormais à 16,5 milliards d'euros. Elle permet de financer des dépenses vertes du budget général de l'État et du programme d'investissements d'avenir (PIA), ainsi que des dépenses fiscales qui représentent une grande majorité des dépenses. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), notamment, est inclus dans les dépenses financées par cette émission de dette ; il représente une part importante des dépenses éligibles. Les fonds levés sont gérés selon les principes d'universalité budgétaire et financent un montant équivalent de dépenses vertes éligibles. Je vous invite à vous référer au rapport sur les allocations de l'OAT verte, qui présente un tableau très complet des dépenses financées par cette émission de dette verte.
Cette innovation française s'inscrit dans un contexte de développement mondial du marché des obligations vertes : celui-ci a atteint un volume d'émissions de 521 milliards de dollars entre 2007 et 2018, dont 167,6 milliards de dollars en 2018. Les États ne sont pas les seuls à utiliser cet instrument : les entreprises s'en servent également. L'année dernière, l'émission d'obligations souveraines vertes a représenté près de 10 % du volume global du marché, avec de nouveaux émetteurs tels que l'Indonésie, la Belgique ou l'Irlande.
Par ailleurs, le marché des obligations vertes se structure progressivement, à travers l'édiction de principes ou de lignes directrices à destination des émetteurs. La Commission européenne a notamment lancé une initiative en faveur de la finance durable, qui vise à mettre en place une taxonomie européenne des dépenses vertes et à définir une norme européenne pour les obligations vertes. Je souligne, à cet égard, que ces sujets sont éminemment politiques : ils ne doivent absolument pas être cantonnés à un débat d'experts. Or, à la suite des auditions que j'ai menées, j'éprouve quelques craintes à cet égard : les discussions menées au sein de la Commission européenne semblent réservées à des experts. À un moment donné, le politique devra avoir son mot à dire sur le classement des dépenses vertes.
L'un des enjeux de l'OAT verte pour la France est de participer à l'établissement d'un standard de marché mondial – en termes de sélection des dépenses éligibles et d'évaluation qualitative. J'aimerais, madame la secrétaire d'État, que vous me rassuriez sur la classification des dépenses et sur les négociations qui sont en cours au niveau de l'Union européenne.
Concernant le bilan de l'outil, j'ai centré mon analyse de l'OAT verte française sur deux aspects : d'une part, les enjeux budgétaires, y compris pour le contribuable – autrement dit, il s'agit de savoir si l'OAT verte est avantageuse, ou bien au contraire neutre par rapport à une OAT normale – et, d'autre part, l'efficience en termes d'impacts environnementaux.
S'agissant des avantages et des inconvénients, je commencerai par observer – même si cet élément n'entre pas dans le cadre des deux aspects sur lesquels je me suis concentrée – que Bercy a travaillé de manière étroite avec le ministère de la transition écologique et solidaire. De la même façon, les services du CGDD et l'AFT ont travaillé main dans la main. La transversalité est un élément essentiel et un point positif de ce nouvel objet.
D'un point de vue financier, il apparaît que l'émission inaugurale de l'OAT verte et les abondements subséquents ont eu lieu dans des conditions de financement globalement comparables à celles d'une OAT normale et de maturité similaire. Un léger différentiel de taux en faveur de l'OAT verte a même pu être identifié, de l'ordre de 0,1 à 0,2 point de base par rapport au taux théorique pour une obligation de même maturité ou de même duration. Ce léger différentiel de taux permettrait de couvrir les coûts administratifs induits par la gestion de l'OAT verte.
Celle-ci est donc neutre pour le contribuable. Cet équilibre entre l'intérêt de l'investisseur et celui du contribuable pourrait cependant être interrogé en cas de remontée des taux d'intérêt. Lors des auditions, les investisseurs ont souligné qu'ils n'étaient pas prêts à « mettre plus » pour acheter une OAT verte. Toutefois, les Pays-Bas, qui ont émis leur première OAT verte il y a peu de temps, peuvent constituer un contre-exemple.
L'OAT verte permet également de capter de nouveaux investisseurs, avec un horizon de placement plus long, qui est adapté aux dépenses environnementales.
J'en viens à l'aspect écologique. Les rapports au sujet de l'OAT verte permettent d'obtenir une vision transversale des mesures qui sont financées par cet outil. En novembre dernier, un rapport du CGDD, évaluant l'impact du crédit d'impôt pour la transition énergétique, a été remis au conseil d'évaluation de l'obligation verte. Il souligne que le CITE contribue bien évidemment au respect par la France de ses objectifs en matière d'atténuation du changement climatique.
Toutefois, je souhaite souligner que l'évaluation des dépenses financées par l'OAT verte est exclusivement d'ordre environnemental : il ne s'agit pas d'évaluer l'efficacité et l'efficience de la dépense en termes économiques ou sociaux – critères qui s'appliqueraient à un outil comme les sustainable bonds, mais ne sont pas pertinents pour l'OAT verte, car tel n'est pas l'objectif de cette obligation. S'il convient de souligner la qualité de l'évaluation de l'impact environnemental, je me demande par ailleurs s'il est judicieux de laisser l'État se contrôler lui-même : pourrait-on imaginer que des organismes extérieurs participent à l'évaluation de l'impact des actions financées par l'OAT verte ?
Concernant le champ des dépenses, il convient de rappeler que les green bond principles ne prévoient pas d'inclure les dépenses financées par les taxes affectées ni celles d'organismes pouvant eux-mêmes contracter une obligation. Il peut sembler utile d'élargir le périmètre des dépenses vertes éligibles en incluant des dépenses actuellement financées par des ressources affectées – je pense au compte d'affectation spéciale (CAS) Transition énergétique. Il convient d'étudier attentivement cette proposition. J'aimerais vous entendre sur ce point également, madame la secrétaire d'État.

Je poserai quelques questions en complément du travail très riche de notre collègue Bénédicte Peyrol. J'aimerais savoir s'il est possible d'améliorer les méthodes de prévision de l'inflation, en France et au sein de la zone euro. En effet, elles ont un impact sur les prévisions de la charge de la dette de l'État. Je me demande pourquoi il est nécessaire de disposer de plus de 200 milliards d'euros de titres de dette de l'État indexés sur l'inflation : n'est-ce pas là un facteur de volatilité de la charge de la dette de l'État ?
Par ailleurs, ne faudrait-il pas arrêter la rétrocession des intérêts perçus par la Banque de France sur le capital placé auprès d'elle au titre de la dotation du Mécanisme européen de stabilité, dans la mesure où seules la France et l'Allemagne procèdent de la sorte depuis 2017 ?
Enfin, je voudrais savoir s'il existe des perspectives d'abondement de l'OAT verte au cours des prochains exercices : est-il envisagé que la France émette de nouvelles OAT vertes ?
En ce qui concerne l'absence de budgétisation en LFI du programme Dotation du Mécanisme européen de stabilité et l'utilisation de la mission Crédits non répartis, vous connaissez les explications techniques – et les avez, du reste, rappelées. Il s'agit d'un sujet politique. Une nouvelle rétrocession des intérêts est prévue en 2019, correspond au minimum aux montants perçus depuis le début de l'année par la Banque de France sur un dépôt qui provient de l'ensemble des États membres du MES. Il reste un petit reliquat sur les montants touchés en 2018, qui n'a pas encore été rétrocédé.
La difficulté, vous l'avez compris, vient du fait que le mécanisme a été accepté par la France pour éviter une érosion du capital de l'institution, mais sous une condition : que d'autres États membres fassent de même. Or, comme vous l'avez très bien rappelé, seuls deux États membres se sont engagés dans cette démarche. Ils représentent quand même 150 millions de personnes – il ne s'agit donc pas d'États membres totalement microscopiques –, mais il est vrai que nous nous sentons un tout petit peu seuls. Pour le moment, nous respectons un engagement que nous avons pris. Toutefois, nous ne l'avons pas renouvelé pour le futur. Nous souhaitons en discuter avec les autres États membres. Soit le mécanisme est plus largement appliqué, ce qui est tout de même la logique qui préside au fonctionnement de l'Union européenne, soit nous ne nous réengagerons pas.
Faut-il, pour accroître la sincérité budgétaire, mettre ces éléments dans la LFR ? La difficulté est d'ordre politique : nous ne bougeons qu'une fois que l'Allemagne a elle aussi pris la décision. Or nos deux pays n'ont pas exactement le même calendrier budgétaire. J'ai le sentiment que, dès lors qu'il est clair que nous allons respecter cet engagement cette année encore et que les montants qui doivent être rétrocédés sont connus, le fait de ne pas les inscrire ne nuit pas à la lisibilité des documents. Nous n'avons donc pas, a priori, l'intention de placer la disposition en LFR. Cela dit, vos deux observations sur le sujet sont tout à fait valides.
J'en viens à l'OAT verte.
En ce qui concerne le projet de règlement en faveur d'une finance durable et le projet de taxonomie européenne, vous avez complètement raison, madame la rapporteure spéciale : c'est à la fois un sujet d'experts et un sujet très politique. La Commission européenne s'appuie sur les travaux d'un groupe technique d'experts. Ce n'est pas un problème, c'est même une très bonne chose que d'être capable d'innover en s'appuyant sur des travaux qui présentent une dimension européenne. Il est bon qu'une expertise européenne puisse être produite sur ces sujets, comme sur les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Cela dit, les discussions sont en cours au sein du Conseil. La France y participe activement, en tant que force de proposition, à un niveau politique, au-delà de l'expertise. Parallèlement, un autre groupe d'experts travaille à la définition d'un standard européen applicable aux obligations vertes. Il a rendu publique une première mouture de son rapport au mois de mars dernier, et la France a été très présente également dans la consultation publique qui a suivi.
D'une manière générale, notre position sur ces travaux peut être exprimée ainsi : implication, expertise, politique. Les trois sont importants. Nous rejoignons donc votre analyse, madame la rapporteure spéciale, et vous pouvez compter sur notre engagement. Nous y avons un intérêt très concret : si nous voulons donner à la place de Paris un rôle primordial en matière de finance verte, il faut aussi que nous puissions contribuer à la définition des normes.
Le différentiel de taux entre l'OAT verte et une OAT classique est légèrement favorable à la première. Il permet au moins de couvrir les coûts administratifs additionnels inhérents à la mise en oeuvre des engagements de transparence pris par l'État lors de l'émission inaugurale. Vous les avez recensés : ce sont notamment des engagements de reporting à propos de l'allocation des fonds et de la performance des dépenses et d'évaluation ex post des impacts environnementaux – en termes d'émissions de CO2 évitées –, pour une croissance soutenable et durable. La logique suivie n'est pas celle d'une maximisation de la rentabilité du point de vue du contribuable. En revanche, un léger bénéfice nous permet à la fois d'être attractif et de rechercher d'autres poches d'investisseurs et, du point de vue des coûts administratifs, d'avoir un programme autofinancé.
Quant aux études d'impact environnemental liées à l'OAT verte, nous avons publié l'an dernier une étude sur le CITE. La réalisation de ces études est confiée à un conseil indépendant qui rassemble des experts de stature internationale, y compris des étrangers. L'avis rendu est public et des rapports sont produits à mi-parcours. En ce qui concerne le CITE, nous nous sommes également appuyés sur des équipes des ministères, mais dans le cadre d'une méthodologie définie ex ante et d'un suivi effectué par des personnalités extérieures aux ministères concernés. Selon moi, c'est un très bon dispositif, qui conjugue, d'une part, méthodologie rigoureuse et indépendance et, d'autre part, une approche efficace pour le recueil des données, notamment via les systèmes d'information. Cela permet aussi une montée en compétences des équipes en interne – ce n'est pas à négliger.
Serait-il opportun d'élargir le champ des dépenses couvertes par l'OAT verte ? Serait-il pertinent d'ajuster le champ du CAS Transition énergétique pour le rendre éligible à l'OAT verte ? Effectivement, madame la rapporteure spéciale, la discussion se poursuit entre les ministères. Évidemment, cela présenterait des avantages : élargir le périmètre de l'OAT verte, ce serait notamment se donner plus de profondeur.
Cependant, le CAS Transition énergétique permet de faire le lien entre des dépenses en faveur de la transition énergétique et des recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui sont affectés, et c'est un mécanisme assez puissant. Une fois dénoués certains liens de la mécanique budgétaire, on ne se souvient pas toujours qu'il y avait une recette à l'appui d'une dépense, et l'on est alors légèrement tenté de revenir sur la dépense en question, en particulier dans un contexte où la dépense publique est examinée avec attention. Je ne trancherai pas ce débat, en cours au sein du Gouvernement. Cela étant, avec la montée en puissance de la transition écologique et énergétique dans tous les programmes que nous menons, le périmètre éligible à l'OAT verte tendra naturellement à s'étendre. Par ailleurs, il n'y aura pas de nouvelle émission à court terme.

Si les dépenses du CAS Transition énergétique étaient éligibles à un financement par les OAT vertes, l'un des avantages serait que nous disposerions d'une évaluation de leur impact environnemental. À l'heure où une commission d'enquête présidée par notre collègue Julien Aubert cherche à évaluer l'efficacité du soutien aux énergies renouvelables, ce serait intéressant, au moins pour nous parlementaires.
Par ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas d'additionnalité, c'est-à-dire que l'OAT verte n'implique pas des investissements supplémentaires. Je n'en espère pas moins, pour ma part, un effet d'entraînement, et je ne souscris absolument pas aux assertions que nous avons pu lire dans une tribune récemment publiée par Le Monde, selon lesquelles c'était un objet inutile. Les auditions que j'ai pu mener montrent au contraire que l'idée d'un possible effet d'entraînement est partagée.
L'OAT verte est un outil utile, mais, effectivement, il faut élargir le champ des dépenses éligibles, parce que notre politique de transition écologique est extrêmement ambitieuse. Il faudra aussi examiner la répartition des dépenses financées entre dépenses d'investissement – parmi elles figurent notamment des dépenses du premier PIA – et dépenses de fonctionnement. Peut-être les documents budgétaires pourront-ils évoluer à cet égard.

Nous avons débattu du CAS Transition énergétique en commission et en séance et nous avons vu à quel point il était dangereux de résumer la politique de transition énergétique à ce CAS – quoiqu'étant dans l'opposition, je ne le fais pas. Certes, le CAS permet de lier certaines dépenses à des recettes, mais sans doute y a-t-il quelque chose à modifier.
Quant aux OAT vertes, Mme Peyrol a évidemment raison. On peut toujours ajouter des crédits budgétaires aux ressources qu'elles procurent ; elles ne suffisent pas, à elles seules, à financer toutes les dépenses vertes. Il s'agit là d'arbitrages budgétaires.
Il me semble que l'OAT a vocation à financer des investissements ou des dépenses valant investissement, c'est-à-dire des dépenses qui permettent des économies futures, des dépenses qui offrent, pour ainsi dire, une forme de retour sur investissement. Il me paraît bon de conserver cette logique. Il y va aussi de l'attractivité de ce produit au plan international ; il faut un concept compréhensible, facile à expliquer, d'une simplicité comparable à celle des produits plain vanilla.
Je suis tout à fait d'accord pour que le reporting soit amélioré. Vous savez que l'Office national des forêts, par exemple, va publier un rapport sur l'amélioration de son empreinte carbone. Je le répète : la transition écologique et énergétique est moins le sujet d'un ministère qu'une problématique « fil rouge » pour l'ensemble des ministères. Je suis bien placée pour savoir qu'il n'est par exemple aucune filière industrielle qui ne soit confrontée à la transition écologique et dont les besoins soient inexistants en la matière, par exemple en termes de compétences.
J'ai omis de répondre à propos des dépenses fiscales du programme Épargne, en particulier ces fameuses onze dépenses non chiffrables, dont trois au montant inférieur à 0,5 million d'euros. Il est assez difficile d'anticiper ces dépenses plus ou moins microscopiques. Toute proposition d'évolution que ferait le Parlement serait considérée avec bienveillance.

Ayant déjà eu l'occasion, la semaine dernière, de m'exprimer sur les missions Direction de l'action du Gouvernement et Publications officielles et information administrative, j'en viens aujourd'hui à la mission Investissements d'avenir. Elle fut créée très récemment, en loi de finances pour 2017, pour servir de support budgétaire au PIA 3. Les deux PIA précédents n'avaient pas bénéficié d'un tel suivi budgétaire : les programmes avaient été ouverts et fermés la même année, à la seule fin de transférer les crédits vers les comptes des opérateurs des PIA.
Cette mission ne comportait en 2017 que des autorisations d'engagement : 10 milliards d'euros ouverts d'un seul coup ; à la fin de l'année 2018, 9 milliards d'euros sur ces 10 milliards d'euros sont engagés. L'exécution 2018 est donc la première à consommer des crédits de paiement. Un peu plus de 1 milliard d'euros a été consommé cette année. Les restes à payer sont donc particulièrement importants – 8 milliards d'euros – et dépendront de l'ouverture des crédits de paiement dans les prochaines années. J'avais d'ailleurs souligné l'an dernier que le décaissement des crédits de paiement était plus lent que prévu initialement, si bien que tout ne sera pas décaissé d'ici à la fin du quinquennat. Ce sera à la majorité de la prochaine législature de continuer – ou d'interrompre – ce que ce gouvernement et le précédent auront commencé.
Je me permets de revenir sur un point que j'avais dénoncé lors de l'examen de la LFR 2018, qui me semble assez emblématique des difficultés posées par ces investissements. Cette LFR 2018 a acté pas moins de dix redéploiements de crédits entre différents programmes du budget de l'État, qui concernent exclusivement des crédits des trois PIA. Les montants de ces redéploiements ne sont pas négligeables : de 2,1 millions d'euros en ce qui concerne le programme Soutien à la politique de l'éducation nationale à 250 millions d'euros en ce qui concerne le programme Valorisation de la recherche. Non seulement ils rendent impossible le suivi de l'exécution de chacun des trois PIA – les redéploiements peuvent intervenir entre les PIA, certains crédits des PIA suivants abondent des actions des PIA précédents – mais ils rendent également illisibles les mouvements de crédits entre les différents programmes du budget de l'État : on découvre en fin de gestion qu'ils bénéficient de crédits PIA non décaissés qui ne figurent pas dans les documents budgétaires portant sur les différentes missions et annexés aux projets de loi de finances.
Comment le Gouvernement entend-il améliorer l'information du Parlement sur les investissements d'avenir ? N'est-il pas nécessaire d'indiquer les crédits issus des PIA non décaissés dans les projets annuels de performances de chaque mission du budget de l'État ?
Je sais que des efforts sont faits pour l'information du Parlement mais il est inutile, madame la secrétaire d'État, de citer les reportings trimestriels ou le « jaune » à destination du Parlement, que sa publication trop tardive prive d'utilité. Et, malgré ces documents, il est très difficile, voire impossible, de suivre un euro voté par le Parlement pour l'un des PIA, de comprendre si, aujourd'hui, il a été dépensé et, le cas échéant, de savoir ce qu'il a financé.
Il est évidemment encore plus difficile d'évaluer si ces investissements ont atteint les objectifs fixés, en termes d'effet de levier, de retour financier et surtout d'impact socio-économique. Je me réjouis donc d'apprendre que le premier PIA – qui date de 2010, je le rappelle – va faire l'objet d'une évaluation, confiée à France Stratégie. Pourriez-vous nous en dire plus sur les points évalués et le calendrier de cette évaluation ?
C'est dans le cadre de cette évaluation du PIA 1 que j'ai choisi ma thématique. Le programme national très haut débit – devenu plan France très haut débit en 2013 – a été lancé en 2010, bénéficiant alors de 2 milliards d'euros du PIA 1. Ce plan est encore en cours de mise en oeuvre, compte tenu du temps long qu'implique le déploiement d'infrastructures sur tout le territoire. L'objectif poursuivi est de couvrir la France en très haut débit d'ici à 2022, en privilégiant la fibre optique.
En matière de couverture numérique, les zones les plus denses et les plus rentables du territoire sont équipées par les opérateurs privés – Orange, SFR, Bouygues et Free – sur leurs fonds propres, alors que les zones les moins denses, où le coût par prise est le plus élevé, sont sous la responsabilité des collectivités territoriales. Pour assurer le déploiement des réseaux d'initiative publique, les fameux RIP, l'État a promis des subventions, financées dans un premier temps par le premier PIA, complété dans un second temps par un nouveau programme du budget général, le programme 343 de la mission Économie.
Les crédits du PIA 1 et du programme 343 sont versés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion, en vertu d'une une convention conclue avec l'État. Quelle qu'en soit l'origine – PIA ou mission Économie –, ils alimentent le Fonds pour la société numérique (FSN), dépourvu de personnalité morale. C'est donc toujours dans une logique « PIA » que ces fonds sont dépensés, malgré le relais de financement de l'État. Cette double source de financement ne simplifie pas la lecture du plan et interroge encore une fois sur le principe d'additionnalité qui justifiait la création des PIA. Cet investissement méritait tout à fait d'être financé dans le cadre des PIA : la couverture numérique du territoire est un investissement de long terme qui améliore la croissance potentielle et suscite des cofinancements privés via les opérateurs. Pourquoi donc, madame la secrétaire d'État, ne pas tout financer sur les PIA ? Inversement, de nombreux projets sont financés par les PIA alors qu'ils ne remplissent absolument pas ces critères. Je pense notamment aux travaux du Grand Palais, qui vont être financés à hauteur de 160 millions d'euros par l'action « Grands défis » du PIA 3. En quoi est-ce un « investissement d'avenir » ? J'avais souligné que cette action, qui représente la modique somme de 700 millions d'euros en autorisations d'engagement, était la poire pour la soif du PIA 3, servant à financer un peu tout et n'importe quoi, selon les besoins du Gouvernement. C'est quand même une enveloppe substantielle de crédits discrétionnaires !
Si, aujourd'hui, près de 3,4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement ont été versés sur le FSN, seuls 495 millions d'euros ont été décaissés : en effet, les subventions de l'État ne sont en réalité que des remboursements aux collectivités une fois que toutes les factures sont payées aux opérateurs. Le calendrier de décaissement fourni par la Caisse des dépôts et consignations est donc tout à fait incertain et le décaissement s'échelonnera vraisemblablement bien au-delà de 2022.
En outre, le suivi de ces crédits est un peu bancal, certains ayant servi à financer d'autres actions que les subventions aux RIP. Ainsi, un avenant à la convention initiale entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations a été conclu en 2016 afin de financer la couverture mobile du territoire ou encore le développement des infrastructures numériques à l'école. Comme le souligne la Cour des comptes dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire, « cette pratique non retranscrite dans les documents budgétaires est d'autant plus discutable que certaines nouvelles dépenses s'inscrivent dans le plan très haut débit et d'autres non ». Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser quel montant servira vraiment à soutenir les collectivités territoriales dans le déploiement du très haut débit ?
Au mois de décembre 2017, et sans concertation avec les collectivités territoriales, le Gouvernement a décidé de la fermeture du guichet FSN des subventions étatiques – il n'y a plus de FSN ! Pourtant, l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre de ce plan France très haut débit estime qu'il manque encore entre 700 et 800 millions d'euros pour finir de couvrir le territoire en réseaux fixes. Cette situation stoppe les projets des collectivités territoriales et fragilise certains territoires, où la population et les entreprises hésitent à s'installer faute d'une bonne qualité de réseau.
Le dispositif dit « AMEL » (appel à manifestation d'engagements locaux) que le Gouvernement propose à la place des crédits de l'État ne rencontre pas le succès escompté et ne permettra pas de couvrir les zones les plus isolées où les opérateurs privés ne voudront pas se lancer. D'après l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), seules 1,7 million de lignes en fibre optique ont été déployées sur les 16,4 millions que compte la zone d'initiative publique, soit à peine 10 %. Même si les déploiements des collectivités s'accélèrent, l'Agence du numérique estime qu'au moins 3,5 millions de locaux demeureront non éligibles au très haut débit en 2022.
À l'heure où une entreprise a absolument besoin d'un accès internet performant pour se développer, à l'heure où l'on ferme les services publics de proximité au motif que les démarches peuvent être faites sur internet, à l'heure où même l'administration fiscale demande que les impôts soient déclarés en ligne – on voit aujourd'hui ce que cela donne... –, à l'heure où le site oups.gouv.fr doit consacrer le droit à l'erreur, comment justifier que l'État abandonne les territoires les plus isolés en matière de couverture numérique ?
Pouvez-vous rassurer les citoyens du monde rural qui nous écoutent et annoncer la réouverture du guichet des subventions de l'État jusqu'à ce que le territoire soit totalement couvert ?

J'irai dans le même sens que notre rapporteure spéciale : il faudrait vraiment que Mme la secrétaire d'État nous explique quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour renforcer le suivi par le Parlement de ces investissements d'avenir. Actuellement, la transparence n'est pas suffisante pour nous permettre une analyse convenable. Je songe en particulier à l'ensemble des dérogations aux principes budgétaires : des programmes qui se transforment en redéploiements de crédits sans le dire, des programmes qui se transforment en débudgétisations sans le dire, des programmes avec des fonds sans personnalité juridique qui servent à exécuter des dépenses dans le cadre des investissements d'avenir. Ces entorses aux principes d'universalité, de spécialité et d'annualité sont vraiment un problème, que souligne la Cour des comptes. Comment justifier de telles dérogations aux principes budgétaires ?

Oui, madame la secrétaire d'État, il faut remettre un peu d'ordre là-dedans. La rapporteure spéciale l'a très bien dit.
La majorité à laquelle j'appartenais est à l'origine des PIA. Leur vocation était bien de financer des dépenses d'avenir, des dépenses d'investissement, qui n'étaient pas financées autrement, et c'est tout. Tout de suite, le Parlement et le Gouvernement ont souligné ce problème. L'exemple du Grand Palais est particulièrement illustratif. Il ne s'agit pas de remettre en cause la qualité de la dépense, mais elle n'a rien à faire dans les PIA. Et puis il y a, par ailleurs, la débudgétisation, le fonctionnement via les opérateurs, l'opacité, malgré la publication par le secrétariat général pour l'investissement (SGPI) de tableaux financiers. Au-delà même de la débudgétisation, des redéploiements de crédits sont probablement masqués. Cela donne un sentiment d'illisibilité.
Les crédits doivent être dépensés conformément à l'objet des PIA. Or ce n'est visiblement pas le cas.

Membre du comité de surveillance du SGPI, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur ces PIA peu respectueux de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et ces débudgétisations. Cela étant, la commission des finances peut s'en saisir et convoquer le secrétaire général pour l'investissement, Guillaume Boudy, l'interroger et lui demander des comptes tout au long de l'année. Nous avons eu exactement la même discussion il y a un an, presque jour pour jour, et nous ne l'avons pas auditionné entre-temps.
En ce qui concerne la consommation des crédits, entre autorisations d'engagement et crédits de paiement, nous gérons un PIA 1 et un PIA 2 en extinction et nous mettons en place un PIA 3 qui comporte des autorisations d'engagement, ce qui offre une visibilité à long terme, et dont les crédits de paiement sont votés chaque année, ce qui permet à la représentation nationale de suivre l'utilisation de ces crédits.
Une évaluation des deux premiers PIA avait été faite par France Stratégie. La mission d'évaluation du comité de surveillance des investissements d'avenir, présidé par Patricia Barbizet, comité auquel Laurent Saint-Martin a fait référence, est plus large. C'est l'ensemble du PIA qui est considéré. Il s'agit d'analyser l'allocation des crédits au regard de la doctrine initiale, de déterminer comment des investissements créent de la croissance à long terme et modifient la trajectoire de la croissance. Il s'agit aussi de mesurer l'impact des différents investissements par secteurs transversaux selon deux axes d'analyse : du point de vue de la transition écologique et du point de vue des différents territoires. Le comité de surveillance doit présenter ses travaux vers la fin de l'année. Nous connaîtrons bien mieux la manière dont ont été investis les crédits et ce à quoi ils servent, et nous saurons si nous sommes parvenus au résultat initialement visé.
Le premier programme de financement du très haut débit s'inscrivait effectivement dans le cadre du premier PIA. Avec la création de l'Agence du numérique, des investissements dont la vocation initiale était de soutenir la croissance ont pris un caractère nettement plus « courant », et cela ne me paraît pas illogique : aujourd'hui, le très haut débit est quasiment un service de première nécessité. C'était d'ailleurs le sens de votre propos : la couverture de l'ensemble des territoires doit être réalisée au plus tôt. Les investissements se trouvent donc financés par voie budgétaire de manière transparente pour le Parlement ; il me semble que nous avons donc plutôt progressé de ce point de vue. Nous avons d'ailleurs débattu du plan France très haut débit dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour cette année. Précisons également que le déploiement du très haut débit au cours des seules deux dernières années a pris la même ampleur qu'au cours des cinq années précédentes cumulées ; cela marque une véritable accélération. C'est cet effort massif qui permet de couvrir le territoire. Les AMEL, pour leur part, sont un succès, qui permettra de réduire la facture du financement public. C'est le 15 juin que seront reçues les dernières offres des opérateurs et l'ARCEP se prononcera.
Sur ces bases, nous pouvons, comme je m'y étais engagé lors de l'examen de projet de loi de finances pour 2019, travailler et envisager la réouverture de ce fameux guichet, pour que soient tenus les engagements très clairs pris par le Président de la République : une couverture à 100 % en très haut débit – pas 100 % en fibre mais 100 % en très haut débit – de l'ensemble du territoire en 2022. Je vous rejoins, madame la rapporteure spéciale : c'est un élément de compétitivité du pays, et il faut régler le problème de ces 3 millions de prises. À mon avis, le plus délicat n'est pas la question, certes sensible, des crédits, c'est celle des compétences, qu'il faut trouver sur le terrain. Il faut recruter 6 000 techniciens pour le déploiement du très haut débit ; nous peinons à y parvenir. Ce problème très pratique est le principal obstacle que nous rencontrons mais, je vous rassure, nous travaillons sur la formation et l'attractivité de ces emplois.
S'agissant toujours de l'amélioration du suivi du PIA, je rappelle la création du Conseil de l'innovation, présidé par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'économie et des finances. Ce Conseil analyse en permanence les dispositifs créés et réunit des chefs d'entreprise contribuant à l'innovation ainsi que les différents ministères concernés. Ils valideront les thématiques qui seront accompagnées, comme celles du Fonds pour l'innovation et l'industrie (FII), mais aussi la réalité des projets soutenus. Ils formuleront des suggestions de réorientation s'ils estiment que les projets soutenus n'atteignent pas les objectifs initialement fixés ou ne correspondent pas aux besoins de montée en compétitivité de l'économie française.
J'entends par ailleurs la question très clairement formulée de l'amélioration de la production de documents budgétaires rendant compte du PIA. Je crois savoir, pour revenir sur le propos de Laurent Saint-Martin que, l'année dernière, vous avez auditionné le secrétaire général du SGPI dans le cadre du Printemps de l'évaluation. Cela n'exclut pas que des améliorations devront être apportées pour le prochain projet de loi de finances (PLF).

Madame la secrétaire d'État, j'ai auditionné le secrétaire général du SGPI. Mais les données dont il dispose ne sont pas très affinées. En outre, l'État procédant à des redéploiements à l'intérieur PIA, il a, lui aussi, des difficultés de lecture. Enfin, compte tenu de l'effet de levier, il est difficile vérifier dans les divers documents ce que les sommes investies représentent en termes d'irrigation du territoire, et au regard des enjeux de développement durable. Si vous pouvez m'apporter des éléments de réponse, je suis preneuse.

Je souhaiterais tout d'abord corroborer les propos de M. Saint-Martin puisque j'ai, moi aussi, l'honneur de siéger au comité de surveillance du SGPI, et que je considère qu'il serait en effet fort utile d'auditionner M. Boudy.
Je suis heureuse, monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, de vous retrouver en cette période de deuxième Printemps de l'évaluation. Une tradition – je l'espère en tout cas – qui nous donne l'occasion de nous intéresser au rapport spécial relatif au développement des entreprises, aux régulations économiques, mais aussi aux prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, qu'avec notre collègue, Xavier Roseren, nous portons depuis l'été 2017.
Les enjeux budgétaires, politiques et économiques sous-tendus par ce programme ne sont pas minces. L'exécution proche du milliard d'euros renvoie à des lignes budgétaires dont l'impact touche des dizaines de milliers d'entreprises chaque année, via, par exemple, l'action de Bpifrance.
Au-delà du sérieux budgétaire, ce programme se distingue par son ambitieuse contribution à la transformation de l'action publique, dont la direction générale des entreprises (DGE) donne un exemple emblématique. Engagée dans une réforme profonde de son organisation, la DGE ne devait procéder qu'à une baisse de ses effectifs de 23 équivalents temps plein (ETP) ; or ceux-ci diminuent finalement de 40 ETP.
Xavier Roseren et moi-même avons tenu à nous entretenir longuement avec son directeur général, M. Thomas Courbe, et c'est avec beaucoup de respect que nous tenons à manifester notre appréciation de la qualité du travail fourni, non pas tant au titre d'une simple baisse brutale des effectifs, mais à celui d'une évolution difficile, mais réussie, opérationnelle, pragmatique et rationnelle. La DGE continue de fournir un accompagnement direct aux entreprises sur un ensemble concentré de missions pour lesquelles son expertise a été clairement identifiée ; modernisation, rationalisation et recherche d'efficacité ont assez exemplairement été de pair.
S'agissant du travail d'évaluation, les motifs d'insatisfaction sont toutefois nombreux, et je regrette de le dire une nouvelle fois après l'avoir déjà exprimé clairement lors des précédents exercices budgétaires. En premier lieu, et malgré tous les efforts entrepris, l'architecture du programme 134 reste illisible ; ses treize actions donnent une vision tronquée de l'effort public pour les entreprises, alors qu'elles financent des politiques aussi diverses que celle de l'artisanat, du tourisme, de l'économie sociale et solidaire et de la protection du consommateur. Elles laissent cependant de côté un ensemble d'acteurs essentiels, par exemple les chambres consulaires, ainsi qu'une partie du soutien à l'innovation, partagé avec d'autres programmes ; elle n'aborde pas l'idée d'articulation comme l'entraide nationale ou les aides locales.
Des responsabilités diluées, une évaluation très difficile, un risque de doublon dans une intervention publique aux crédits éclatés : sur ces questions, la Cour des comptes évoque une démarche de performance très confuse. Nous aimerions avoir votre avis, madame la secrétaire d'État, et vous entendre sur les efforts supplémentaires qui pourraient être entrepris. Dans la même veine, la question de l'évaluation des dépenses fiscales nous tient particulièrement à coeur, et vous le savez, c'est là que l'on retrouve l'essentiel du soutien public aux entreprises, mais aussi la plus grande faille dans son évaluation : 70 niches rattachées au programme 134 pour un montant de 28,5 milliards d'euros !
L'essentiel est bien sûr lié au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), chiffré à 20,1 milliards d'euros, mais les 8,4 milliards restants comprennent des mesures correspondant à des finalités diverses, pléthoriques, pour ne pas dire parfois redondantes. Je voudrais donner ici quelques exemples significatifs : nous avons comptabilisé dix dépenses fiscales incitant au rachat ou la transmission d'entreprise, six de soutien au secteur touristique, quatre encourageant le développement des sociétés de capital-risque ; parmi celles-ci, beaucoup, vingt-sept en tout, ne sont pas chiffrées. Les lacunes dans le pilotage des dispositifs interpellent, le constat est le même année après année, rapport, après rapport, malgré nos rapports spéciaux et malgré ce Printemps de l'évaluation. D'une année à l'autre, le tiers des dépenses du programme a été modifié, ajouté ou supprimé, mais nos interrogations, elles, demeurent.
Ce problème, les parlementaires s'en saisissent – Xavier Roseren et moi-même avons encore interrogé récemment le ministre Gérald Darmanin sur l'évaluation et la mise en cohérence des dispositifs. Force est de constater que nous nous retrouvons face au silence ou à des lacunes. Madame la secrétaire d'État, cette question est cruciale non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les comptes publics. Comment, d'après vous, pourrions-nous parvenir à obtenir des réponses ?
Nous attendons des progrès importants en la matière, qui permettraient une véritable mise en cohérence de tous les dispositifs d'aide aux entreprises. Cette démarche est d'autant plus nécessaire qu'elle pourrait ouvrir la voie à un autre chantier, celui de la rationalisation des impôts de production sur lesquels nous sommes nombreux à souhaiter pouvoir vous entendre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le thème que nous retenons avec mon collègue, Xavier Roseren, pour notre évaluation est celui de l'industrie.

Notre évaluation porte sur les nouveaux outils de la politique industrielle en France. L'industrie est une priorité portée par le Gouvernement, et vous-même, madame la secrétaire d'État, avez déclaré 2019 comme l'année de l'industrie.
L'évaluation de ce dispositif n'est pas une chose aisée, tant les outils mobilisés sont divers. Le Gouvernement mène une politique industrielle cohérente, mais malheureusement peu lisible ; elle gagnerait à mieux associer les structures existantes en plus des nouvelles initiatives. La politique industrielle repose aujourd'hui sur quatre axes prioritaires pour faire émerger une industrie du futur : les compétences, le numérique, les territoires et l'innovation.
S'agissant des compétences, l'investissement est essentiel alors que plus de la moitié des petites et moyennes entreprises (PME) disent aujourd'hui éprouver des difficultés à recruter des profils qualifiés. Le plan d'investissement dans les compétences doit répondre aux besoins de main-d'oeuvre sur les métiers en tension, notamment dans l'industrie. Par ailleurs, le volontariat territorial en entreprise, inspiré du volontariat international en entreprise à l'étranger, permet aux étudiants d'écoles de commerce ou d'ingénieurs de devenir pendant un an le bras droit de nos dirigeants de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire.
Dans le domaine du numérique, l'industrie du futur doit encore émerger en intégrant les différents enjeux. Nous constatons que la France est en retard par rapport à ses voisins en matière de numérisation de l'industrie : elle est au sixième rang européen. Le plan de transformation de l'industrie par le numérique, présenté par le Premier ministre en septembre 2018, permettra d'accompagner les entreprises industrielles vers la numérisation. La plateforme unique France Num doit ainsi accompagner les très petites entreprises (TPE) et les PME dans leur transformation numérique. C'est aussi tout l'enjeu des plateformes d'accélération du futur, qui feront l'objet d'une prochaine publication par notre collègue Anne-Laure Cattelot.
Afin de renforcer l'implantation d'industries sur les territoires, l'initiative « Territoires d'industrie » a par ailleurs été lancée. Elle met à disposition une boîte à outils d'une vingtaine de mesures dont le soutien financier, puisque l'initiative mobilise plus de 1 milliard d'euros, mais également le soutien technique avec des propositions de simplification des procédures administratives.
En matière d'aide à l'innovation, je rejoins ma collègue Olivia Gregoire sur la multiplicité des aides existantes qui nuit à leur efficacité. Le FII est opérationnel depuis cette année. Il doit permettent de dégager 250 millions d'euros annuels pour financer la réalisation de grands défis d'innovation de rupture ainsi que trois plans sectoriels : un plan Deep Tech, un plan nano et un plan batteries. La Cour des comptes a récemment rendu un avis mitigé sur ce fonds en relevant que le FII contribuait à un mouvement de dispersion des aides à l'innovation, qui ont tendance à sortir de plus en plus du budget de l'État.
Avez-vous des éléments de réponse sur ces critiques ? Que pensez-vous de la proposition de la Cour de rebudgétiser le fonds de façon globale sur la politique industrielle ? Ne serait-il pas plus lisible de rassembler les initiatives du Gouvernement, qui sont nombreuses, sous une même bannière ? Pourquoi par exemple ne pas utiliser French Fab ?
Je terminerai en évoquant le soutien aux écosystèmes de l'innovation, pour lequel les orientations nous semblent moins satisfaisantes. Les pôles de compétitivité doivent s'intégrer pleinement dans la politique du Gouvernement ; le Premier ministre a lancé la phase IV de labellisation recentrée sur les pôles les plus efficaces et capables de porter des projets au niveau européen. Le cahier des charges acte d'ailleurs une réforme dans le mode de financement des pôles : les dotations de fonctionnement dépendront désormais des performances – nous saluons vraiment cette initiative qui va vers plus de rationalisation.
Nous avons eu cependant connaissance de problèmes concernant le financement des projets de ces pôles par le Fonds unique interministériel (FUI). Dans certains cas, alors même que les financements avaient été contractualisés, les sommes n'ont pas été versées, ce qui a causé à de nombreuses PME des difficultés de trésorerie. Une solution aurait été trouvée, qui mobilise apparemment les fonds du PIA prévus pour financer les projets structurants des pôles, les projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité (PSPC), en 2020. Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de la solution retenue, et, si tel est le cas, comment seront financés les projets des pôles dans les prochaines années ?
Par ailleurs, une partie du financement de l'innovation des pôles est désormais portée par une enveloppe PSPC-Régions. Il semblerait toutefois que le fonds n'ait pas été mis en place à ce jour, alors même que la date prévue pour les appels à projets était fin mai 2019. Pouvez-vous apporter des précisions à ce sujet ? À quelle date sera créé le PSPC-Régions ? Les appels à projets pour l'année 2019 auront-ils lieu, ou l'année 2019 sera-t-elle une année blanche ?
Enfin, j'appelle votre attention sur l'importance des centres techniques industriels (CTI) dans notre écosystème d'innovation industrielle. Leur financement est assuré soit par une dotation budgétaire, soit, de plus en plus, par une taxe fiscale affectée. Nous avions appelé l'attention sur la réforme de leur financement l'année dernière, menée sans réflexion stratégique. Aussi, quelle place envisagez-vous pour les CTI dans le futur écosystème industriel ? Quelle évolution de leur financement envisagez-vous ? Une baisse du plafond etou du taux de la taxe affectée est-elle encore envisagée en 2020 ? Une contribution volontaire, la fameuse contribution volontaire obligatoire (CVO), visant à remplacer cette taxe affectée est-elle encore d'actualité ou a-t-elle été largement abandonnée ?

Madame la secrétaire d'État, où en est le travail de rationalisation de la mise en cohérence des dépenses fiscales rattachées au programme 134 ?
Le rapporteur spécial vous a interrogé sur la place des pôles de compétitivité dans la politique industrielle. Cette question est en effet importante.
Par ailleurs, le FII a été doté de 10 milliards d'euros par des cessions en apport en titres, et doit produire 250 millions d'euros par an pour soutenir l'innovation. Je souhaiterais savoir comment vous serez garantie de ce rendement.
Avez-vous dressé un bilan des trente-quatre plans de reconquête industrielle lancés sous le quinquennat précédent avant de décider des initiatives en matière industrielle ? Les objectifs ont-ils été atteints ?
Enfin, je veux vous faire part de mes interrogations sur la plus-value de l'initiative « Territoires d'industrie » pour les collectivités régionales, qui sont précisément chargées de la politique économique, et peuvent déjà faire beaucoup de choses. C'est par voie de presse que la plupart d'entre nous ont appris l'existence de ce programme « Territoires d'industrie ». Depuis, je suis interrogé par des collectivités qui n'ont pas été sélectionnées alors qu'elles relevaient à l'évidence de territoires d'industrie. Et des vice-présidents chargés de l'économie des régions m'appellent pour savoir comment fonctionne le dispositif.
Je voudrais donc savoir où est la plus-value de cette initiative, car je serais très content qu'il y ait une.

En tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques sur le programme 134, ce Printemps de l'évaluation est l'occasion pour moi de lancer un SOS pour l'avenir de l'activité de garantie de Bpifrance. L'activité de garantie joue un rôle essentiel de soutien aux petites entreprises qui font la vitalité du tissu économique français.
J'ai pu le mesurer avec force lors des auditions que j'ai menées à l'automne dernier sur la question de l'accès au financement des TPE. L'activité de garantie répond à une faillite de marché, elle rend possible le financement des phases les plus risquées de la vie d'une entreprise ; or ce sont ces phases qui sont justement les plus porteuses de croissance.
En 2018, 8,7 milliards de prêts ont été garantis pour près de 61 000 entreprises, parmi elles, 90 % de TPE ; une affaire sur deux créée dans la restauration, par exemple, en bénéficie. Quelque 640 000 emplois ont été soutenus par ce biais. Avec un effet de levier de 1 à 21, son efficience et son impact positif sur la croissance et le taux de survie des entreprises ne font pas débat.
Or, vous le savez, les moyens de Bpifrance dévolus à cette activité sont gravement menacés. Dans mon rapport pour avis rendu à l'automne dernier, j'ai déploré la suppression de la dotation que l'État accorde à BPI pour financer cette activité. Seuls 10 000 euros ont pu finalement être maintenus à la suite des débats parlementaires, mais ce sont là – disons-le – des montants purement symboliques et dérisoires.
Je vous rappelle qu'en exécution sur l'année 2018, les crédits versés par l'État ont été consommés pour un montant de près de 40 millions d'euros, c'est donc près de 4 000 fois plus que ce qui a été voté lors du PLF 2019. En 2019 et en 2020, au prix d'efforts considérables et d'une réduction de la voilure du dispositif, l'activité de garantie continuera d'être financée par le recyclage des dividendes de Bpifrance.
Cette solution ne sera pas longtemps tenable, car, à partir de 2020, Bpifrance n'aura plus les moyens suffisants pour poursuivre cette activité, alors que les besoins à terme sont estimés à 260 millions d'euros. L'État doit donc prendre sa part, comme il l'a fait par le passé.
Comment ne pas être consterné par ce type de décision ? Quelles sont donc la stratégie et la cohérence du Gouvernement dans ses choix budgétaires ? Quel message adressons-nous ainsi aux entreprises qui font vivre nos territoires ?
Je tiens tout d'abord à remercier Mme Gregoire pour l'hommage rendu à la DGE. La transformation de la DGE, qui s'inscrit dans le programme « Action Publique 2022 », est en effet exemplaire. Exemplaire dans la façon dont elle a été conduite, avec la suppression des trois quarts du réseau de la DGE, ce qui est assez exceptionnel pour un service de l'État. Exemplaire également – et c'est le plus important – dans sa conception stratégique : en partant des missions et en réfléchissant aux compétences ainsi qu'à l'organisation pour un fonctionnement en mode projet et en mode services à l'intention des entreprises. C'est exactement la méthode que nous voulons déployer dans d'autres domaines.
Je prends acte, par ailleurs, des critiques que vous avez pointées à propos du programme 134, qui est effectivement peu lisible – il serait difficile de dire le contraire. Il ne permet pas d'embrasser d'un seul regard l'ensemble des actions conduites au service des entreprises.
S'agissant plus particulièrement des niches fiscales, je nourris moi-même des inquiétudes que nous pouvons collectivement partager, car je n'ai pas encore une expérience complète d'un cycle budgétaire. Je parle donc avec une casquette de « nouveau venu », mais cela permet de conserver intacte une certaine capacité d'étonnement, ce qui est intéressant.
Effectivement, on constate parfois une forme d'injonctions paradoxales résultant de la volonté, que je pense partagée par tous, de simplifier notre fiscalité et du souhait de la modifier par voie d'amendement. Cette simplification répond d'ailleurs à des demandes adressées par des investisseurs étrangers. Si le dernier classement d'Ernst & Young est excellent, vous noterez cependant que la complexité est considérée comme le premier obstacle à notre compétitivité. Notre place dans le classement en termes de complexité administrative et fiscale nous ferait tous collectivement rougir. Je partage donc totalement l'objectif de simplification, mais, lorsqu'on a la chance de défendre un projet de loi de finances dans l'hémicycle au banc des ministres, on est ébloui par notre capacité collective d'amendements et de modifications de la loi fiscale. Nous devrions probablement tous nous discipliner sur ce point.
S'agissant des impôts de production, le ministère de l'économie et des finances ne fait pas mystère que cette question pose un problème de compétitivité aux entreprises françaises, à deux titres. Premièrement parce qu'ils sont massivement plus élevés que dans bien des pays étrangers : 3,5 % du produit intérieur brut (PIB) pour la France et 0,5 % en Allemagne, sept fois supérieurs dans notre pays. Deuxièmement, parce que la croissance progresse de manière beaucoup plus importante que le PIB. Le problème ne s'améliore donc pas : il s'aggrave. Nous traitons de ce sujet dans le Pacte productif 2025, au sein notamment du groupe de travail Industrie. Il s'agit de répondre à la demande du Président de la République de construire des trajectoires longues, incluant un certain nombre d'engagements – transition écologique, énergétique, investissements, etc. – avec l'objectif d'atteindre le plein emploi.
Comment converge-t-on vers le plein emploi, alors que des transitions majeures doivent être accompagnées ? De façon très caricaturale, je ne prendrai que l'exemple du secteur de l'automobile : comment passer du diesel à la batterie électrique ? Ce pacte productif est conçu avec les entreprises, les organisations syndicales et les régions, qui sont, en effet, un acteur majeur du développement économique – ce sont elles qui ont les clefs du camion pour le développement économique des territoires. Nous en avons tiré les conclusions dans la réforme de la DGEs comme dans le dispositif « Territoires d'industrie ».
S'agissant des niches fiscales, vous le savez, leur revue est en cours. Pour ma part, je souhaite que nous portions sur ces niches fiscales une appréciation qui fasse le départ entre les différents dispositifs en fonction de leur objet propre. Certaines d'entre elles apportent des réponses à des problèmes de compétitivité, tel le CICE. Or j'observe qu'Ernst & Young indique que le coût du travail est le deuxième élément pesant sur notre compétitivité internationale. Est-il question de niche fiscale lorsqu'il s'agit d'essayer de limiter l'écart existant entre le coût du travail en France et ceux d'autres pays ? Je ne parle pas de ceux dont le modèle social et environnemental est fortement différent du nôtre : je parle de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, qui sont des compétiteurs. Et pour l'Allemagne, je ne pense pas que l'on puisse dire que son engagement social, sociétal et environnemental est moindre que le nôtre. Il importe à cet égard que nous ayons des visions transversales, des benchmarks. J'ai vu qu'un tel travail de benchmarking avait été réalisé par le rapporteur spécial au sujet de l'export : je m'en réjouis vivement car c'est très utile pour prendre de la hauteur sur différents sujets. Il faut donc apprécier ces niches fiscales pour ce qu'elles apportent, mais aussi dans le cadre de comparaison, car on mitige parfois une difficulté.
S'agissant de la diversité des dispositifs de soutien à la compétitivité, il ne faut pas oublier que nous accompagnons chaque étape de développement des entreprises : l'amorçage, les premières levées de fonds, la commercialisation, le prototypage. Effectivement, on peut avoir tendance à multiplier ces innovations liées au cycle de l'entreprise, et cela pourrait peut-être être simplifié ou rendu plus compréhensible. Cela n'enlève rien à la critique adressée à l'ensemble du dispositif, et qui n'est pas nouvelle puisque, pour être revenue à la politique après quinze ans d'absence, je note que, de ce point de vue, il n'y a pas eu de changements significatifs.
Au sujet de la politique industrielle, vous avez mentionné, monsieur Roseren, le programme d'investissement dans les compétences et le dispositif de volontariat territorial en entreprise, qui provient du programme « Territoires d'industrie ». Je vous rappelle qu'il sera mis en place au mois de septembre prochain. Je souhaite également indiquer que ce programme est transversal à l'ensemble des filières. Chaque contrat stratégique de filière – ou de secteur, parce que certaines filières sont en réalité des secteurs – comprend un travail portant sur les compétences qui manquent, et sur la façon de les récupérer au travers de la déclinaison de plans d'action.
Vous indiquez par ailleurs que la France se situe au seizième rang dans le domaine du numérique. À cet égard, deux dispositifs semblent absolument essentiels : les 10 000 diagnostics numériques et le dispositif de suramortissement permettant aux PME d'investir dans des machines propres à les faire passer à l'industrie 4.0. Je pense machines à commande numérique, fabrication additive ou robot collaboratif, dit « cobot ».
Nous sommes en retard, notamment sur l'Allemagne, qui possède à peu près deux fois plus de robots que la France, appréciation à pondérer toutefois par le poids de son industrie automobile, très robotisée. Nous sommes également en retard sur l'Italie, exemple plus intéressant puisque, a priori, ce surplomb de l'automobile est absent. Et il faut savoir que nous sommes plus souvent comparés à l'Italie qu'à l'Allemagne, même si nous aimerions bien n'être comparés qu'à elle – cela vaut aussi pour le coût du travail.
Aussi, une vraie nécessité d'accélérer ce déploiement s'impose à nous. Celle-ci suppose de travailler demain dans une plus grande proximité avec les régions, puisque nous leur avons confié la contractualisation. Le dispositif date de septembre. Or aucun contrat avec les régions n'a été signé : c'est un constat, je ne jette la pierre à personne. Il reste que si nous voulons que 10 000 PME fassent l'objet de ces diagnostics, il faut accélérer le processus, c'est fondamental.
Quelle est la valeur ajoutée du programme « Territoires d'industrie » ? Elle est évidente pour ceux qui participent à ce programme. Ainsi, à Chalon-sur-Saône, où je me suis rendue lundi dernier, toutes les personnes qui travaillent à des projets dans ce cadre, qu'il s'agisse des chefs d'entreprise ou des élus locaux, d'établissements publics de coopération intercommunale ou de la région – en l'occurrence, le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté –, m'ont indiqué que, si le dispositif était complexe, il leur permettait néanmoins, dans la mesure où il part du terrain, de mieux travailler ensemble.
De fait, il s'agit d'un dispositif très concret. Tout d'abord, le territoire concerné correspond à un bassin d'emploi, et non à une unité administrative, de sorte que, c'est vrai, il est parfois à cheval sur une frontière régionale ou départementale. Ensuite, il consiste à mettre autour de la table les entreprises, les parties prenantes – chambres de commerce et d'industrie (CCI), représentants des organisations syndicales, Union des industries et métiers de la métallurgie... – et la région, pour élaborer des projets très concrets. Il peut s'agir, par exemple, de créer une section d'apprentissage afin de servir les dix industriels proches sur un projet précis, en mettant à disposition un bâtiment désaffecté pour loger les apprentis. C'est ce type de projets qui permettent d'éliminer les petits grains de sable qui nous empêchent de développer, ou de mieux développer, l'industrie. On se plaint du manque de compétences. Or, en la matière, compte tenu des investissements réalisés dans la formation, il faut désormais s'efforcer de rapprocher les personnes des activités – et inversement –, en se penchant sur la question du logement et celle de la mobilité, ou en facilitant la création d'antennes d'apprentissage dans des territoires plus réduits. C'est très concret, et cela ne se décide pas à Paris : voilà ce qu'apporte le programme « Territoires d'industrie ».
Aux présidents de région qui commencent à goûter au plat et à se dire que la sauce n'est finalement pas si mauvaise, je dis : c'est à vous de jouer, maintenant ! Il est vrai qu'il leur est difficile de sauter le pas et de s'emparer de la maîtrise du dispositif, mais celui-ci est à leur service. Il n'y a pas de piège politique. Maintenant, il faut y aller ! Je le dis avec une certaine solennité, car je crois beaucoup à ce dispositif.

Nous pourrions vous aider si nous savions exactement ce qui se passe dans nos territoires.
M'avez-vous contactée à ce sujet ? Pour avoir des échanges réguliers avec Annabelle André-Laurent, qui participe notamment au groupe de travail sur la simplification, je crois pouvoir dire que l'on avance. J'estime que la simplification, par exemple, qui est un enjeu important, doit davantage consister à faciliter la vie des entreprises qu'à organiser le grand soir de la réglementation. En tout état de cause, je suis à votre disposition : nous n'avons jamais refusé de travailler sur ces questions.
J'en viens aux critiques de la Cour des comptes concernant le FII. Tout d'abord, les 250 millions d'euros sont assurés, puisqu'ils font l'objet d'un contrat entre la direction du Trésor et l'Agence des participations de l'État (APE). En fait, il s'agit de fixer l'équivalent d'une OAT à cinquante ans, en prévoyant qu'elle verse 250 millions d'euros sur 10 milliards d'euros. Ainsi on réduit la dette publique et on finance l'investissement. Le budget est donc sanctuarisé.
Par ailleurs, les projets financés sont des projets de transformation majeurs. Dans le domaine de la nanoélectronique, le Fonds contribue au premier dispositif commun à l'ensemble de l'Union européenne. Ce dispositif, qui représente un investissement de 700 millions d'euros, est, pour le dire simplement, financé par des aides d'État assumées par l'Union européenne afin d'entrer dans la compétition face aux Chinois et aux États-Unis ; il est d'une importance cruciale. Quant au projet concernant la batterie électrique, non seulement il est d'une importance majeure pour l'industrie automobile, mais il constitue un signal politique de notre capacité à réunir nos forces pour soutenir des transformations dans l'industrie et, là encore, à être force d'équilibre face à la Chine, aux États-Unis et même à l'Inde.
S'agissant des pôles de compétitivité, vous avez raison, nous avons rationalisé le dispositif. Nous sommes en train d'étudier, avec les régions, la manière dont nous pouvons améliorer encore le suivi. La question, légitime, de savoir si ce n'est pas à ces dernières de prendre la main sur les pôles de compétitivité se pose. Sur ce point, ceux-ci n'ont pas forcément le même avis que les régions. C'est pourquoi ces discussions se prolongent. En tout cas, notre objectif est très simple : nous choisissons le plus efficace.
En ce qui concerne le FUI, les paiements ont été, en effet, un temps suspendus ; j'en suis désolée, car je crois que ce n'est pas ainsi que l'État doit agir. Nous nous sommes efforcés de proposer une solution. Les crédits correspondant à l'ensemble des contrats qui avaient été engagés seront ainsi débloqués d'ici au mois de septembre, en prélevant sur le PIA mais sans toucher à l'enveloppe de 100 millions promise aux PSPC des régions. Là encore, on ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. En ce qui concerne ces PSPC, le calendrier de lancement est en cours de discussion avec les pôles et les régions ; il doit prendre en compte les contraintes de ces dernières et le cycle budgétaire des assemblées plénières. La balle n'est donc pas dans notre camp ; nous sommes plutôt force d'accompagnement en la matière.
Par ailleurs, comme vous l'avez indiqué, le rapport Cattelot apporte un éclairage renouvelé sur l'action des CTI et des comités professionnels de développement économique (CPDE). La vérité commande de dire qu'il nous a conduits à modifier nos positions dans ce domaine. Nous reconnaissons que ces centres peuvent être des acteurs importants, notamment dans la transformation numérique du tissu industriel. La mise en place de nouveaux contrats d'objectifs et de performance pour la période 2020-2022, associant l'État, les CTI et les principales organisations professionnelles concernées, définit un premier cadre de travail que nous voulons renouveler, en renforçant les indicateurs de l'impact de l'action des CTI et des CPDE sur le tissu des PME. Nous réaffirmons également les priorités stratégiques des CPDE : la croissance et l'internationalisation des PME, ainsi que l'innovation et la transformation des PME vers l'industrie du futur. Le Centre technique des industries mécaniques, par exemple, doit jouer un rôle majeur dans cette transformation. Nous souhaitons, par ailleurs, réexaminer la pertinence du statut de CTI ou de CPDE pour les centres dont les activités d'intérêt général sont résiduelles par rapport aux activités commerciales. De manière générale, nous entendons accroître l'exigence de performances mesurables, qu'il s'agisse de productions scientifiques, de gestion, d'accompagnement des PME, poursuivre le décloisonnement des CTI et CPDE, notamment en explorant les pistes de rapprochement là où il permettrait d'offrir un meilleur service aux entreprises et renforcer le pilotage transverse. En regard de ces engagements, il nous semble logique de proposer aux CTI et aux CPDE une visibilité accrue sur leurs moyens financiers. Ainsi, nous proposerons, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, un maintien et non une diminution, de leurs crédits.
J'en viens à l'activité de garantie de Bpifrance. Comme vous l'avez indiqué, monsieur Rolland, fin 2018, nous avons recyclé 300 millions d'euros de l'établissement public à caractère industriel afin de financer trois ans d'activité de garantie dans un format quasi inchangé, soit 60 000 entreprises par an. Nous avons fait oeuvre de bonne gestion budgétaire, puisque nous finançons la trajectoire sur la base des moyens de Bpifrance. Cela ne signifie pas que nous allons fermer le guichet : ce n'est absolument pas ce qui a été dit lors de la présentation du PLF 2019. Ne racontons donc pas que le guichet est fermé, car ce n'est pas la réalité : aujourd'hui, les entreprises bénéficient de garanties, sans lesquelles beaucoup de financements n'existeraient pas. Il faudrait, au demeurant, que les banques financent des projets sans la garantie de Bpifrance ; il est important que nous travaillions ensemble sur ce sujet.
Nous le leur disons.

Mme Dalloz a évoqué le plan France très haut débit et le programme 343 ; je n'y reviendrai donc pas en détail. Je rappellerai simplement que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, j'avais défendu un amendement visant à maintenir le guichet ouvert en allouant à ce programme 200 millions supplémentaires. Cet amendement a été rejeté, mais vous aviez proposé, madame la secrétaire d'État, que soit dressé un bilan des AMEL dans la perspective de l'examen du budget pour 2020. Ce bilan doit être présenté le 15 juin. Ensuite, avez-vous indiqué, nous pourrons discuter d'une réouverture du guichet. Ma question est donc simple : quand aurons-nous des indications sur le calendrier et le montant des crédits ?
En termes de décaissements, je le redis, les projets sont financés. Sur le montant, les besoins et le positionnement dans le cadre du PLF 2020, la réflexion est en cours. La casserole est donc sur le feu...
Je veux ajouter un mot, car il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Les trente-quatre plans de reconquête industrielle ont été repris dans les contrats stratégiques de filières, pour les parties qui n'avaient pas été encore délivrées.

Je commencerai par rappeler un triste constat, connu de tous : le déficit commercial est l'un des plus mauvais indicateurs économiques de notre pays. Il est en effet estimé, pour les seuls échanges de biens, à 60 milliards d'euros en 2018 et il se détériore, notamment en raison de la facture énergétique, en hausse de près de 7 milliards.
Pourquoi la France fait-elle beaucoup moins bien dans ce domaine que la plupart de ses concurrents européens ? De fait, l'Allemagne atteint des excédents records : ceux-ci s'élevaient à 250 milliards d'euros en 2016, à 248 milliards en 2017 et diminuaient légèrement en 2018, pour s'établir à 228 milliards. Ainsi, en ce qui concerne les échanges de bien, le delta Allemagne-France est proche de 300 milliards, et ce depuis de longues années !
Cependant, la situation n'est pas forcément désespérée. L'Italie est en effet passée d'un déficit de 30 milliards en 2010 à un excédent qui a atteint 51,5 milliards en 2016 et s'est maintenu à 47 milliards en 2017. Quant à la situation du Royaume-Uni, elle est bien pire que celle de la France, puisqu'Eurostat évalue son déficit à 180 milliards en 2017.
Une fois ce constat dressé, comment comprendre de telles différences ?
Les facteurs structurels – compétitivité globale de notre économie, positionnement de gamme, innovation... – jouent, bien entendu, un rôle important, voire primordial. Trop d'impôts pèsent sur nos entreprises, donc sur notre compétitivité. Je rappelle que, chaque année, l'industrie française acquitte 70 milliards d'impôts de production de plus que l'industrie allemande.
Mais une partie de l'explication tient également aux structures et outils mis en place par chaque État pour soutenir les exportations, ce que l'on appelle le dispositif public d'appui à l'export et à l'internationalisation des entreprises. C'est ce point que j'ai voulu étudier dans mon rapport. J'ai donc comparé, sous cet aspect, la situation de notre pays à celle de l'Allemagne et à celle de l'Italie. En effet, n'importe quelle entreprise étudie ses concurrents : ses produits, sa démarche marketing, son outil de production, ses prix... J'ai donc adressé aux principaux opérateurs français un questionnaire afin de connaître les données de comparaison à leur disposition. Or, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai constaté que ni la direction générale du Trésor, ni le réseau des CCI, ni le MEDEF n'étaient en mesure de m'apporter la moindre réponse, en dehors de quelques idées générales ! Business France – mais je ne les incrimine pas, car ils sont en pleine réforme – m'a adressé un certain nombre d'éléments, mais je crois que l'on peut aller beaucoup plus loin. En résumé, nous avons tout à faire dans ce domaine. En effet, nous ne pouvons pas nous contenter des statistiques internationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de l'Organisation mondiale du commerce ou du Fonds monétaire international, dont les études se limitent aux éléments macroéconomiques et ne portent ni sur l'aspect qualitatif ni sur les dispositifs publics de soutien à l'export. Du reste, je vous annonce, madame la secrétaire d'État, à moins que le Gouvernement ne confie une mission à un parlementaire sur ce sujet, que je vais poursuivre ce travail, en tant que rapporteur spécial, au cours des mois et des années à venir. Ce devrait être à l'exécutif de réaliser une telle étude, mais puisqu'il ne le fait pas, le Parlement va s'en saisir.
J'ai commencé mon étude comparative en esquissant les grandes lignes des dispositifs publics allemand et italien. Selon les informations que j'ai pu obtenir, les masses budgétaires consacrées au soutien à l'export semblent proches en France, en Allemagne et en Italie. Dans ces trois pays, la part étatique de ces financements s'élève à un peu plus de 200 millions d'euros, mais elle est complétée par une part régionale qui ne fait pas, hélas, l'objet d'une consolidation nationale. Il est donc difficile, à ce stade, d'établir une véritable comparaison des grandes masses budgétaires, puisque le périmètre d'intervention des acteurs n'est pas toujours le même et que la part « export » des politiques économiques ou des différents réseaux n'est pas toujours identifiée.
En Allemagne, le soutien à l'export est organisé par le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Il s'appuie sur l'agence Germany Trade & Invest (GTAI), qui peut être comparée à Business France. Cette agence met à disposition des informations sur les marchés étrangers et accompagne les entreprises sur ces marchés, grâce à sa présence dans cinquante pays. L'Allemagne s'appuie surtout sur son réseau de CCI, qui est très puissant. Elle dispose également d'une structure qui n'a pas d'équivalent en France : la Fédération des salons et des foires (Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft – AUMA). L'Allemagne est en effet un leader mondial dans ce domaine : environ 160 à 180 foires et salons internationaux s'y déroulent chaque année, représentant 180 000 exposants et accueillant jusqu'à 10 millions de visiteurs. Je n'oublie pas, mais je dispose de très peu données dans ce domaine, le rôle que peuvent jouer, directement ou indirectement, les länder.
En Italie, le commerce extérieur est une compétence partagée entre l'État et les régions. L'Italie a procédé à une profonde réforme de son dispositif de soutien à l'internationalisation des entreprises, lancée sous le gouvernement de Mario Monti à compter de 2012. Au niveau de l'État, l'Italian Trade Agency, équivalent de Business France, est compétente en matière de promotion à l'étranger du « Made in Italy » et d'attraction des investissements en Italie. Dans les régions, les guichets pour l'internationalisation des entreprises sont désormais hébergés par les chambres de commerce italiennes, dont le nombre est passé de 105 à 60 depuis 2016. Ces restructurations ont permis de faire émerger des outils communs.
Au-delà des structures, j'ai cherché à identifier les bonnes pratiques étrangères dont nous pourrions nous inspirer en France. J'en ai retenu quatre.
Premièrement, il me paraît nécessaire d'encourager les synergies entre les acteurs publics, comme l'a très bien fait l'Italie. Nous devons ainsi soutenir la mise en oeuvre efficace de la Team France Export et des outils qui l'accompagnent : la plateforme des solutions et le CRM (Customer Relationship Management) commun. À cet égard, je tiens à saluer le déroulement de cette réforme : il ressort des auditions et de mes rencontres avec les chefs d'entreprise que les différents acteurs s'impliquent et semblent plutôt confiants quant à son aboutissement. Cependant, je ne peux que m'inquiéter, en tant que rapporteur spécial, de son financement : la subvention pour charges de service public de Business France, si elle a été maintenue en 2018, se détériorera dans les années à venir. Et je ne parle pas des ressources des CCI, dont vous savez qu'elles ont été considérablement réduites. Comment le Gouvernement compte-t-il maintenir l'effort consenti, sans crédits suffisants ? Encore une fois, je suis inquiet.
À ce propos, Bpifrance, qui est un des atouts de notre pays, dispose d'un outil particulièrement utile aux entreprises : l'assurance prospection, qui s'adresse essentiellement, à hauteur de 90 %, aux PME-PMI de moins de cinquante salariés. Comme je l'ai fait en 2018, je tiens à souligner le problème de financement de cet outil puisque le budget 2019 alloue à cette activité 43,5 millions alors que Bpifrance estime que près de 100 millions seraient nécessaires pour financer, en année pleine, ses contrats d'assurance prospection ! Quels engagements le Gouvernement peut-il prendre dans ce domaine ?
Deuxièmement, il convient de structurer l'organisation par filière. Italiens et Allemands « chassent en meute ». Le manque de solidarité entre les entreprises françaises à l'export est un handicap. L'Italie a créé, grâce au Sistema paese, des cadres de regroupement par filière afin d'agréger les PME en réseaux. Le soutien français s'est trop longtemps focalisé sur les grandes entreprises. Le Gouvernement est-il décidé à s'attaquer à ce problème, au-delà des solutions de portage qui n'ont jamais véritablement fonctionné ?
Troisièmement, nous devons accroître la présence française sur les salons, indispensables au développement des PME. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour faire la lumière sur cette question, mais beaucoup de chefs d'entreprise français me disent que le coût de ces salons est bien moindre pour leurs concurrents italiens et allemands, qui bénéficient, dans ce domaine, d'un soutien fédéral et régional. Que compte faire le Gouvernement pour accentuer son effort en faveur de la présence française dans les salons, qui sont, avec l'assurance prospection, le principal outil de développement des entreprises à l'international ? J'ajoute que j'ai pu observer le Gouvernement allemand, y compris la Chancelière elle-même, est très présent dans ces manifestations, en Allemagne et à l'étranger, et crée ainsi des événements politiques. C'est aussi un moyen de soutenir ses entreprises. En France, les gouvernements – c'est une vieille habitude française – ne sont pas assez présents dans les salons.
Enfin, il faut promouvoir une marque pays. En effet, la réussite à l'export s'appuie également sur la capacité d'un pays à promouvoir sa marque, à rendre désirables ses produits à l'étranger. Ainsi le « Made in Germany » est-il associé à la qualité et à la robustesse. Les tentatives de promotion des produits français n'ont pas été concluantes : l'initiative « Creative France » n'a pas remporté le succès escompté. En revanche, des projets de filière, notamment la French Tech, semblent bien plus efficaces pour positionner la France sur des créneaux dynamiques et innovants. Qu'entendez-vous faire pour poursuivre et étendre de façon systématique ces actions de promotions aux autres filières ?
Vous aurez compris, madame la secrétaire d'État, que ma principale question porte sur la capacité de l'État à établir une comparaison dans la durée de notre politique avec celles des pays concurrents et à s'inspirer de leurs bonnes pratiques et de leurs tarifs, car nous sommes en concurrence. Or, pour gagner la bataille de l'export, il faut s'appuyer sur des comparaisons internationales.

La gestion des garanties d'assurance pour le compte de l'État, qui a été transférée de la Coface à Business France, a permis de réaliser des économies substantielles. En effet, alors que la première avait bénéficié, à ce titre, de 97 millions d'euros en 2016, Bpifrance Assurance Export a perçu 45 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2,3 millions supplémentaires au titre de l'informatique, en 2018. Comment expliquez-vous ces économies, dont je me réjouis ?
Par ailleurs, une nouvelle formule de l'assurance prospection, qui permet aux PME de s'assurer contre les risques d'échec de leurs actions de prospection, a été mise en oeuvre en 2018, après l'annonce de la nouvelle stratégie du Gouvernement pour le commerce extérieur. Cette nouvelle formule ressemble plutôt à une avance remboursable : les entreprises reçoivent une avance de trésorerie de 50 % du budget, qu'elles remboursent graduellement en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans les pays couverts ou qui est prise en charge par l'État si le succès n'est pas avéré. Après la période de franchise de deux ans, ce nouveau produit exige cependant un remboursement forfaitaire maximal de 30 % du budget couvert, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé à l'export. Or, l'avance des frais risque de peser davantage sur le budget de l'État via les appels en garantie. Dès lors, comment expliquer que la dépense de 2018 est inférieure aux prévisions : 18 millions d'euros, sur le programme 114, contre 63 millions prévus ? Quelle est la trajectoire de ces dépenses pour 2019 ?

Je constate qu'aucun programme budgétaire n'est consacré au financement du soutien du commerce extérieur, et je le regrette. Certes, les crédits sont, et c'est logique, rattachés à la mission Économie, mais cette politique dépend du ministère des affaires étrangères depuis que M. Fabius en a exprimé, en son temps, le souhait. Compte tenu du déficit de notre balance commerciale, un tel programme serait, me semble-t-il, de nature à clarifier les choses.

J'approuve votre remarque, madame la présidente. J'ajoute que nous pourrions avoir une approche plus analytique des crédits, y compris ceux d'autres budgets, qui concourent à l'effort de soutien au commerce extérieur – je pense à l'action culturelle, par exemple.
Monsieur Forissier, je vous remercie d'avoir salué la bonne mise en oeuvre de la réforme de Team France Export. En effet, le calendrier est respecté, les équipes sont formées et travaillent sur le terrain, les conventions sont presque toutes signées, et l'outil de CRM, qui est en phase de test, fonctionne.
J'en viens à vos questions. Tout d'abord, le budget de Business France est défini dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de performance qui a été signé en décembre et qui permet, Pascal Cagni et Christophe Lecourtier le confirmeront, de respecter les objectifs que nous leur avons fixés, notamment dans le cadre de cette réforme. Il leur donne même, me semble-t-il, une prévisibilité s'agissant des moyens dont ils peuvent disposer pour mener à bien leurs travaux.
S'agissant des CCI, la trajectoire a été donnée et je rappelle que les régions ont un rôle à jouer en matière d'internationalisation. Cela fait partie de tout ce travail qui consiste à mieux coordonner politique nationale et politique régionale. Je sais que les patrons de région sont sur le terrain puisque je les croise à l'international, et qu'ils accompagnent leur PME. Il faut avoir des objectifs et des budgets partagés.
Je veux saluer le dynamisme de l'assurance prospection. Cet outil, qui fonctionne très bien et qui est bon pour la trajectoire budgétaire du pays sera financé. Je sais que BPI s'inquiète de son business model. On leur demande, comme on le fait pour tout le monde, de nous montrer qu'ils font bien des efforts de performance, qu'ils ont tiré toute la substantifique moelle de la partie activité de marché et que, s'agissant des activités d'intérêt général, les bonnes ressources sont utilisées au bon endroit et avec le maximum d'efficience. Je crois que c'est ce que vous êtes en droit d'attendre de nous.
S'agissant des filières, je précise que chaque contrat stratégique de filière a un volet internationalisation. J'ai réuni le Conseil national de l'industrie internationale que je copréside avec Jean-Baptiste Lemoyne. Nous avons constaté avec Philippe Varin que nous ne sommes pas là où nous voulons être, et que certains secteurs conjuguent un fort chiffre d'affaires en France et de faibles exportations. Selon la loi du cadran, c'est a priori sur ces secteurs-là qu'il faut faire porter les efforts. Nous avons donc décidé, au terme de ce Conseil national, d'établir une feuille de route spécifique pour l'industrie agroalimentaire que nous avons partagée avec Richard Girardot, président de l'Association nationale des industries alimentaires. Il se trouve que le ministre Didier Guillaume, qui porte la partie agriculture du pacte productif, arrive peu ou prou à la même conclusion. Il est possible que Business France ait davantage besoin de se muscler en expertise sur ce sujet-là puisqu'il faut accompagner à la fois les agriculteurs et les transformateurs. Oui, monsieur le rapporteur spécial, j'attends de « chasser en meute » ; c'est clairement le sujet qui nous différencie, notamment de l'Allemagne.
Je partage également votre point de vue s'agissant de notre présence dans les salons. Cette année, je suis allée au salon de Hanovre sous une bannière unique, la French Fab, précisément parce qu'on doit porter cette marque de l'industrie française. Il faut activer un réflexe dans les pays étrangers : la France, ce n'est pas seulement le luxe et le bien-vivre, et éventuellement l'histoire et le tourisme, c'est aussi des industries puissantes. D'où l'idée d'utiliser les codes de la French Tech, un outil qui a extrêmement bien fonctionné, et de réactiver les clubs du MEDEF ou d'entreprises, pays par pays.
Des subventions, des accompagnements sont prévus pour les PME qui participent à des salons. Il est en effet difficile d'avoir une notion exacte de la réalité des budgets des uns et des autres, pays par pays. Les régions font, elles aussi, un effort pour permettre aux PME d'être présentes sur les salons. L'exportation est moins dans les habitudes de nos PME. Nous les accompagnons avec les accélérateurs BPI. Ce sont des programmes d'accompagnement sur deux ans des dirigeants et des comités exécutifs destinés à les faire monter en compétence sur des sujets de transformation numérique, managériale et internationale, qu'il s'agisse de l'exportation ou de la croissance par acquisitions. Ces programmes fonctionnent très bien. Nous avons là un outil puissant de transformation des PME, dont le coût est pris en charge par BPI et qu'il faudra accompagner. Nous souhaitons le déployer de manière systématique. Peut-être allons-nous le mettre à disposition des ETI, qui sont souvent les parents pauvres de nos politiques publiques parce qu'elles sont trop grandes au regard des règlements européens et trop petites pour avoir la puissance de feu des fonctions support qui leur permettent de se payer des avocats et des intermédiaires capables de gérer tous les sujets de transformation.
Vous m'avez interrogé sur la présence des membres du Gouvernement dans ces salons pour soutenir les entreprises. Il faut passer d'un modèle qui consiste à aller dans les grands pays où nous avons des contrats à une présence dans les salons. Comme cela ne vaut pas le coup de partir avec dix PME, il faut réfléchir à la manière dont on peut travailler pour partir avec beaucoup plus de PME afin d'obtenir un maximum d'efficacité. La comparaison avec nos amis européens est intéressante. Par exemple, le Royaume-Uni a un atout que je n'avais pas soupçonné : la famille royale. Dès lors que vous appartenez à la famille royale – et il ne vous aura pas échappé qu'il y a davantage de membres de la famille royale que de ministres –, vous êtes reçu comme un membre du Gouvernement. C'est la même chose pour la Belgique. Nous avons donc besoin d'ambassadeurs – peut-être faudrait-il sensibiliser les députés sur ce point – qui ouvrent systématiquement les portes et qui assurent une présence permanente sur le terrain. En fait, il faut prendre une carte du monde et s'assurer que tous les mois quelqu'un porte à l'étranger a minima le même discours de base qu'il décline ensuite en fonction de considérations, soit du secteur, soit géographiques.
Promouvoir une marque pays est difficile. Quelques tentatives ont été menées, mais elles n'ont pas forcément réussi. Je crois beaucoup à la French Fab. Certes, ce n'est pas du français, mais, à l'international, tout le monde comprend ce que signifie l'expression French Fab. Cela nous permet de surcroît de faire levier avec la French Tech qui, aujourd'hui, est connue au Japon et en Corée, sachant que le coq bleu et le coq rouge sont des éléments de compréhension assez simples.
La sous-exécution de l'assurance prospection – 26 millions au lieu de 41,5 millions en 2018 – est liée à son lancement retardé au 2 mai 2018 pour adapter le processus dans le réseau territorial de BPI utilisé pour la première fois. Il y a simplement un décalage de trésorerie. En termes de projection, l'idée est d'avoir une dynamique. Et comme cette dynamique crée une amélioration du commerce extérieur, on a tout à y gagner. Je considère qu'il y a une forme de retour sur investissement global qu'on doit accompagner.
On s'efforce que la documentation budgétaire relative aux garanties publiques à l'internationalisation des entreprises, réparties sur deux comptes de commerce, soit transparente. Cette segmentation est nécessaire à la prise en compte des spécificités des modalités de soutien, parce que les garanties publiques sont des opérations commerciales. Elles doivent donc, en application de la LOLF, être mises en oeuvre à partir de comptes de commerce : le compte 915, et à la marge pour des garanties en secteur naval le compte 905. Le programme 114 permet de compenser en année n les éventuels déficits des garanties publiques de l'année précédente. Il est donc prévu des dépenses évaluatives. Enfin, la rémunération de Bpifrance assurance export, qui se fait sous la forme d'une commission, est une dépense limitative, donc versée par le programme 134. Cet éclatement des interventions est donc également dû à la LOLF.
En termes transversaux, le Gouvernement travaille dans son ensemble de façon à rééquilibrer la balance du commerce extérieur. De ce point de vue, la question du rattachement des crédits est moins importante que celle de leur bonne utilisation.
Madame la secrétaire d'État, vous n'avez pas vraiment répondu à la question principale que j'ai posée : l'État va-t-il se mettre à faire du benchmarking de façon systématique ?
Les équipes qui sont derrière moi ont frémi en entendant votre question : nous faisons d'ores et déjà du benchmarking. La preuve en est que, chaque année, nous procédons avec notre réseau de services économiques international à une revue pour savoir quelles innovations ont été mises en oeuvre dans chaque pays, et quels nouveaux dispositifs y émergent. Ces éléments sont disponibles. Je comprends à votre question que vous n'en avez pas eu connaissance, et j'en prends acte.
En tout état de cause, vous l'aurez compris, j'ai une vraie demande sur ce sujet qui nous permet de prendre du recul, même si comparaison n'est pas raison. Le tissu français de production, le poids des grandes entreprises, qui ont leur propre organisation, expliquent aussi qu'on n'a pas la même façon de conquérir les marchés à l'international. Mais cela n'empêche pas d'aller prendre les bonnes idées et d'éviter de répéter les échecs que nous pouvons constater dans d'autres pays.

Ce rapport spécial porte sur l'autre partie de la mission Économie, soit les programmes 220 et 305, qui retracent respectivement les dépenses de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de la direction générale du Trésor (DGT). En 2018, l'exécution de ces programmes est conforme à l'autorisation donnée, avec un taux d'exécution entre 97 et 98 %.
Les dépenses de ces deux programmes diminuent depuis plusieurs exercices : depuis 2014, les crédits de paiement exécutés ont baissé en effet de 2,5 % sur le programme 220 et de 10 % sur le programme 305.
J'aborderai directement le thème d'évaluation retenu cette année, qui porte sur le réseau international du Trésor. Il s'agit d'un outil performant qu'il faut mieux articuler avec le reste de la présence de l'État à l'étranger.
En 2018, le réseau compte 128 implantations dans 106 pays et rassemble 622 effectifs, contre 638 en 2017. Le programme 305 prévoit 81 millions d'euros de crédits de paiement pour le financement du réseau, dont 78 % de masse salariale.
La DGT est engagée dans un important processus de réforme depuis plusieurs années. Le réseau a ainsi perdu 25 % de ses effectifs depuis 2008, sans compter les importants transferts réalisés lors de la création de Business France. Depuis 2014, les dépenses du réseau ont baissé de 7 %, passant de 88 millions d'euros à 81 millions d'euros aujourd'hui.
Le réseau international du Trésor connaît donc une attrition continue de ses ressources depuis plusieurs années, ce qui l'a poussé à se réorganiser et à optimiser son fonctionnement. Il s'est réorganisé autour des nouvelles zones de croissance et des postes aux enjeux économiques stratégiques. Alors que les effectifs au niveau global se réduisaient, les présences en Europe ont été réduites plus que proportionnellement au profit de ces nouveaux pôles.
La structure de ses effectifs a également évolué. En 2018, 55 % des agents dans le réseau sont des volontaires internationaux en administration ou des agents de droit local, qui ne bénéficient pas du régime de rémunération des fonctionnaires à l'étranger. Cette proportion atteignait 46 % en 2014.
Le réseau international du Trésor s'inscrit en parallèle dans la réforme des réseaux de l'État à l'étranger. Dans le cadre du programme Action publique 2022, le Premier ministre a décidé une diminution de 10 % de la masse salariale de ces réseaux. Si l'effort devrait en réalité être moindre, entre 8 et 8,5 %, il s'agit d'une baisse conséquente, de l'ordre de 90 millions d'euros.
En parallèle, une réforme de la gestion de ces réseaux a été proposée, afin non seulement d'en optimiser les coûts mais également de donner plus de marges de manoeuvre à l'ambassadeur pour constituer ses équipes en fonction des priorités stratégiques qui lui étaient assignées. L'objectif initial était de fusionner l'ensemble des fonctions dans un cadre d'emploi unique, dans lequel l'ambassadeur aurait pu « piocher » pour constituer ses équipes. Face à de fortes résistances, la réforme a finalement été moins ambitieuse puisqu'elle n'a porté que sur les fonctions support et la gestion immobilière. Les fonctions métiers, qui correspondent aux fonctionnaires de catégorie A, restent à la main des ministères. 79 effectifs de la DGT et environ 6 millions d'euros de crédits ont ainsi été transférés vers le ministère des affaires étrangères en 2019.
Cette réforme est un progrès encourageant pour permettre non seulement des optimisations budgétaires mais également un meilleur pilotage par l'ambassadeur. En particulier, le transfert de la gestion immobilière doit permettre de rationaliser les implantations et de réaliser des économies d'échelle lors des acquisitions ou de la négociation des contrats de location. La mutualisation du parc de véhicules et de chauffeurs favorisera également une gestion plus efficiente.
Je souhaiterais, à ce titre, que des indicateurs soient développés afin de suivre les gains liés à la mise en oeuvre de la réforme. Les ambassadeurs doivent se saisir pleinement des nouveaux leviers dont ils disposent, et il serait intéressant de pouvoir suivre l'évolution de cette mutualisation des fonctions support par le biais des économies réalisées.
Je me suis également intéressé à la manière dont la DGT pilotait son réseau et affectait ses moyens. L'attribution de lettres de mission au chef de service économique à partir de 2013 a été une avancée qui a permis de préciser les priorités de chaque poste. Elles sont transmises au ministère des affaires étrangères pour validation, ce qui est de nature à améliorer la coordination.
Au niveau central, une nouvelle stratégie internationale du Trésor 2019-2023 est en cours d'élaboration, qui doit permettre une amélioration du pilotage du réseau et une meilleure prise en compte de la spécificité des pays et zones couvertes. Je ne peux que souscrire à ces orientations. Il me semble néanmoins que l'évaluation de la performance des postes gagnerait à être renforcée.
Au niveau local, il me semble qu'il faut systématiser la notation par l'ambassadeur du chef de poste du service économique. Cette possibilité existe, mais ne serait pas appliquée systématiquement. L'ambassadeur, qui est comptable de l'activité du poste dans son ensemble, doit disposer de leviers pour en orienter l'action.
Au niveau global, l'indicateur de performance du réseau international du Trésor rattaché au programme 305 me semble insuffisant. Il mesure en effet la part des postes mettant en ligne une information économique actualisée. Or les missions du réseau international du Trésor sont plus vastes et concernent à la fois la production macroéconomique et la promotion des intérêts économiques français.
Je souhaiterais donc, à cet égard, pouvoir suivre l'action du réseau de façon plus précise. Il me semble qu'une refonte de la démarche de performance autour d'une approche par la qualité de service serait opportune. Il s'agirait par exemple de systématiser l'évaluation de la production macroéconomique de la part des administrations sollicitant ces éléments. De plus, il serait envisageable de demander aux entreprises accompagnées de fournir des éléments d'appréciation sur l'action du service économique.
L'activité d'influence économique est plus difficile à mesurer, on en convient, selon cette approche par la qualité. La systématisation de la notation par l'ambassadeur et le développement de l'évaluation interne pourraient permettre de donner une meilleure idée de la performance des chefs de poste.
Pour conclure, le réseau international du Trésor a toute sa place dans les réseaux de l'État à l'étranger, et justifie son existence par l'accompagnement et la promotion des intérêts français stratégiques. Le chef de service économique, conseiller de l'ambassadeur, a un rôle apprécié et d'autant plus essentiel que se développe désormais une diplomatie économique. Les ambassadeurs avaient d'ailleurs été interrogés sur des propositions de diminution de la masse salariale au sein de leur poste lors de la réforme Action publique 2022. À cette occasion, ils avaient rarement indiqué des suppressions d'effectifs au sein des services économiques, ce qui témoigne de la qualité et de l'importance de ces services pour les postes diplomatiques.
La mise sous pression budgétaire a conduit à une importante réorganisation et au renforcement du pilotage stratégique, ce que je salue. Il importe aujourd'hui de rendre mieux compte de ces efforts, en développant une nouvelle approche de la performance.
Je conclurai sur les suites de la réforme Action publique 2022. Nous ne pouvons que saluer le fait que la rationalisation budgétaire des réseaux de l'État à l'étranger s'accompagne d'une réforme managériale. Il sera important de dresser le bilan de l'application de cette réforme, en mesurant les gains d'efficience qui ont été obtenus.
Il appartient désormais aux ambassadeurs de se saisir pleinement des nouveaux leviers d'action et de gestion qui leur sont confiés.
Au regard de mon intervention, je souhaite vous poser quelques questions. Comment envisagez-vous le rôle du réseau international du Trésor dans l'action internationale de la France ? Pourquoi avoir retenu une logique de régionalisation du réseau ? Comment comptez-vous renforcer l'allocation stratégique des moyens du réseau et l'évaluation des différents postes ? Enfin, avez-vous connaissance de difficultés liées à la mise en oeuvre de la réforme des réseaux de l'État à l'étranger ?

Quels sont les points de discussion avec la Banque de France pour améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de surendettement et abaisser les coûts de la prestation ?
Où en est cette opération lourde qu'est le déménagement du centre statistique de l'INSEE dans l'alter Bahnhof de Metz ?
J'en viens à une question qui concerne la valeur ajoutée du service économique à l'étranger face à Business France. Quels sont les grands contrats que la DGT a récemment accompagnés via son réseau international ? Pour rationaliser les coûts du réseau, que pensez-vous de la réforme des indemnités de résidence à l'étranger, dont la grille dépend du ministère des affaires étrangères et non du vôtre ?

Madame la secrétaire d'État, permettez-moi de compléter la première question du rapporteur général. Aujourd'hui, le budget de l'État compense les frais de secrétariat liés à la commission de surendettement. Or si, les dossiers de surendettement ont diminué de moitié depuis 2011, a contrario, une partie du surcoût du secrétariat n'est pas compensée par le budget de l'État. Avez-vous trouvé un compromis, acceptable par tout le monde, pour financer ce surcoût du traitement des dossiers de surendettement par la Banque de France ?
Comme vous l'avez indiqué, une évaluation annuelle du réseau international de la DGT est faite par les ambassadeurs. Il y a en outre une inspection tous les trois ans, des ambassades au cours de laquelle toutes les actions menées sont passées en revue. Enfin, et c'est nouveau, il y a une évaluation tous les dix-huit mois, sur la base de la lettre de mission donnée au réseau du Trésor par l'administration centrale. Le dispositif me semble donc assez complet.
Vous m'interrogez sur le rôle du réseau, ce qui fait écho à la question de la valeur ajoutée que peuvent apporter les services économiques à l'étranger par rapport à Business France. Vous le savez, une nouvelle convention a été signée le 17 juillet 2018 entre la DGT, le ministère des affaires étrangères, le Commissariat général à l'égalité des territoires et Business France. Elle comprend cinq principes-clefs.
Premier élément : les compétences des services économiques portent sur les questions régaliennes présentant un intérêt pour l'attractivité de la France. Je prendrai un exemple concret que j'ai eu à traiter il y a deux semaines : l'exportation du boeuf français en Corée du Sud contre l'importation de la soupe de poulet au citron en France ou en Europe. Nous sommes là confrontés à des questions d'autorisations sanitaires, à des barrières tarifaires ou réglementaires, à la façon dont on documente, etc. Et c'est la même chose avec le Japon ou encore avec l'Égypte. Les problèmes à régler sont nombreux et relèvent soit de sujets individuels d'entreprise, soit de sujets de réglementation et d'amélioration de la relation économique. Cela prend beaucoup de temps parce qu'il faut traquer le décideur, convaincre au niveau technique, mettre le grain de sel au niveau politique, glisser la bonne phrase au bon moment dans le discours en utilisant bien les différentes personnes qui se présentent. Un secrétaire d'État ne parlera pas de la même chose qu'un ministre de l'économie. Et, évidemment, quand c'est le Premier ministre ou le Président de la République, on parle de sujets de grandes personnes. Il faut savoir organiser tout cela et assurer le suivi de tous ces éléments.
Deuxième élément : l'exercice conjoint du service économique de l'ambassade et du bureau de Business France dans leurs domaines de compétences respectifs de la mission générale de la promotion de l'image économique de la France. C'est plus institutionnel mais cela compte beaucoup, notamment dans des pays où l'État est considéré comme important – la Chine, par exemple. C'est une façon de labelliser que l'État soutient telle entreprise, met en avant tel type de filière.
Troisième élément : la prospection détection des cibles, l'entretien, le suivi de projet est majoritairement du ressort du bureau de Business France. Dans un souci de complémentarité, une participation est apportée à l'action de prospection par le service économique dans le cadre d'objectifs fixés par la DGT.
Quatrième élément : le partage de la stratégie et la mise en commun de moyens notamment en termes de fichiers, d'argumentaire, d'appui technique entre Business France et la DGT. Au travers du programme Choose France, nous disposons de tout un ensemble d'argumentaires, dans le secteur de la santé ou de l'aéronautique, par exemple, que nous présentons dans différents langages pour essayer de participer à l'amélioration des relations économiques.
Cinquième élément : l'identification de quarante pays prioritaires représentant 98 % des flux d'investissements directs à l'étranger en France.
Vous le voyez, tout est clairement précisé dans la convention.
Quels sont ces grands contrats ? Il peut s'agir par exemple des acquisitions d'Airbus, des grands contrats d'infrastructures de Transdev ou de la RATP, de Naval Group, de Veolia, etc. Dans les géographies plus complexes, notre assurance export est clairement un élément de finalisation du contrat, quasiment indispensable dans certains cas. En outre, la transparence et l'accompagnement font partie de la marque « France » – l'Allemagne pourrait probablement en dire autant, alors que d'autres pays sont perçus comme moins fiables.
Pourquoi avons-nous régionalisé le réseau ? Cela rentre dans les objectifs de réduction des coûts d'Action publique 2022. Nous avons cherché à y répondre, tout en maintenant le niveau d'efficacité des missions. Il est apparu que la présence dans tous les pays n'était pas indispensable, d'autant que l'appui régional permet de disposer d'une vision à 360°, par plaques : en effet, les échanges sont souvent régionaux et la connaissance de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ou de l'Afrique anglophone dans sa globalité apporte de la hauteur et de la valeur.
Avons-nous connu des difficultés dans la mise en oeuvre de ces réformes sur le terrain ? À ce stade, je n'ai pas de remontées. L'articulation entre Business France et le réseau du Trésor tout comme celle des services économiques et des ambassades – qui disposent désormais d'une équipe unique, en un lieu unique, sur un même organigramme, et non plus de pôles séparés – semblent bien fonctionner.
Le transfert des fonctions support est opérationnel depuis le 1er janvier 2019. À ce stade, je ne vois pas non plus d'éléments d'inquiétude ou de points de vigilance à vous signaler. Je suis prête à échanger si vous en avez de votre côté.

Comment comptez-vous renforcer l'allocation stratégique des moyens du réseau et l'évaluation des différents postes ? S'agissant de la régionalisation, ne multiplie-t-on pas les niveaux de management ? Est-ce toujours très productif et intéressant de devoir en référer à des responsables à Paris, mais aussi régionaux et locaux ? Je m'interroge sur la coordination.
Enfin, vous avez répondu sur l'évaluation mais, l'an prochain, pourrait-on disposer d'éléments plus précis ?
S'agissant de la coordination, les services économiques de niveau régional sont mis en place en cas de besoin, dans une logique d'efficacité. Lorsqu'un groupe ou cluster de pays fonctionne conjointement et échange beaucoup, cette vision régionale est utile. Nous travaillons aussi dans une logique d'efficience de la dépense publique.
J'ai déjà répondu sur l'évaluation et je crois qu'il faut accepter le qualitatif : ainsi, le dossier du boeuf coréen est en cours depuis quinze ans ; il est donc difficile de ne pas être dans le qualitatif ! Si nous mesurons simplement la capacité à obtenir un changement de réglementation, le dernier arrivé récoltera les félicitations pour sa performance, alors qu'il s'agit d'un travail de longue haleine, mené par une succession d'agents publics. Il faut faire confiance à l'intelligence humaine ! Au travers des trois évaluations que nous menons – inspection, ambassadeurs et administration centrale sur la base des lettres de mission –, nous disposons d'éléments. Peut-être faudrait-il vous transmettre une synthèse ? Je vais y réfléchir.
Qu'est-ce qui permettrait de faire baisser le coût de traitement des dossiers de surendettement par la Banque de France ? Il s'agit principalement de la dématérialisation et de la simplification de la procédure depuis le vote de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », ainsi que de la baisse du nombre de dossiers déposés. En 2018, on en comptait 163 000, pour 186 000 dossiers traités. On estime que 150 000 dossiers seront déposés en 2019 et 140 000 en 2020. Nous sommes donc confiants.
Enfin, le déménagement de l'INSEE a été réalisé sans problème en mars 2018, le transfert documentaire devant être opéré en 2019.

Nous accueillons M. Cédric O, pour le dernier rapport, celui de Mme Valérie Rabault, sur les comptes spéciaux Participations financières de l'État, Participation de la France au désendettement de la Grèce et Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics.

Le champ du rapport spécial comporte trois comptes spéciaux dont deux d'affectation spéciale : les participations financières de l'État, la participation de la France au désendettement de la Grèce – ceux dont je vais parler ce soir –, le troisième étant le compte de concours financiers Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics.
Je vais tenter de formuler mes questions aussi précisément que possible afin que nous puissions avoir des réponses également aussi précises que possible ! En 2018, l'État a perçu –au titre de ses participations dans des sociétés non financières – le montant de dividendes le plus faible depuis 2012 – 2,5 milliards d'euros, contre une moyenne de 3,8 milliards entre 2012 et 2017. Le précédent montant le plus faible était de 2,8 milliards d'euros. Avec les privatisations que vous envisagez, ce montant risque mécaniquement de baisser encore puisque, si l'État détient moins de titres, il recevra moins dividendes. Est-ce un aspect que le Gouvernement a pris en compte ? Comment comptez-vous gérer ces moindres recettes budgétaires ?
Le compte spécial relatif aux participations de l'État a un rôle important : c'est le véhicule budgétaire qui permet de mesurer le rôle et la place de l'État actionnaire dans notre économie. Deux particularités se dégagent de l'exercice 2008 : le niveau des mouvements – des achats et des ventes – est inférieur à la moyenne des dix dernières années durant lesquelles l'État vendait en moyenne pour 5 milliards d'euros et investissait également pour 5 milliards d'euros chaque année ; en outre, habituellement, quand l'État achète des titres, les dépenses sont financées par des recettes équivalentes au sein du CAS. Or, en 2018, les dépenses de 4 milliards d'euros ont été financées par des recettes moindres – 2,6 milliards –, ce qui a nécessité de piocher dans le solde du CAS au 31 décembre 2017. Par conséquent, ce solde a été significativement réduit, à 1,5 milliard d'euros au 31 décembre 2018. Au fil des ans, allez-vous ramener ce solde à zéro ? Cela ne risque-t-il pas de limiter très significativement la stratégie actionnariale de l'État ?
La loi de règlement sert normalement à comparer l'exécution par rapport aux crédits votés en loi de finances, afin de nous permettre d'évaluer la manière dont le Gouvernement met en oeuvre la loi que nous avons votée. Je l'ai déjà dit à l'occasion des débats sur tous les projets de loi de finances depuis juin 2017, s'agissant des participations de l'État, l'exercice est un peu « bidon » : nous votons tous les ans 5 milliards d'euros de recettes et 5 milliards de dépenses, afin d'éviter que l'État actionnaire ne mette trop d'informations sur le marché. Quand les sociétés ont besoin d'être recapitalisées par l'APE, ce qui avait été le cas en 2017, l'État pioche dans le budget général.
Madame et monsieur les secrétaires d'État, je vous repose donc la question que j'ai déjà posée à M. Bruno Le Maire, envisagez-vous une évolution ? En l'état, la loi de règlement n'a aucun sens...
L'année 2018, contrairement à 2017, a vu la création du fameux FII, doté de 1,6 milliard d'euros en « cash » et de 8,4 milliards d'euros de titres EDF et Thales, valorisés aujourd'hui à 10,2 milliards d'euros. On aurait donc logiquement pu s'attendre à des investissements dédiés à l'innovation de rupture, puisque c'est l'objectif de ce fonds. Pourtant, aucun n'a été réalisé en 2018. La Cour des comptes l'a d'ailleurs souligné. Envisagez-vous d'investir au moins un euro en 2019 ? Dans son rapport, la Cour des comptes use de termes très durs contre ce fonds. Je l'avais moi-même qualifié d'usine à gaz dès 2017. La Cour des comptes a émis une recommandation n° 10 visant à substituer au Fonds un dispositif de soutien à l'innovation inclus dans le budget général.
Pour ma part, l'année dernière, comme en 2017, je vous avais proposé de modifier la LOLF pour que l'APE puisse percevoir les dividendes des titres qu'elle détient – il est logique qu'un actionnaire perçoive ses dividendes. En loi de finances, nous aurions ensuite déterminé le montant des dividendes versé au budget général de l'État, celui destiné à financer l'innovation de rupture et celui conservé par l'APE. Ce serait à la fois plus lisible et plus logique. La Cour des comptes propose une autre solution. Plus polie que moi, elle ne qualifie pas votre dispositif d'usine à gaz, mais je persiste, c'en est une ! J'espère que vous n'allez pas laisser la situation en l'état.
L'APE compte cinquante-cinq agents. Le Parisien et Le Monde s'en sont faits l'écho, le Premier ministre a dit vouloir étudier la suppression ou la fusion de toutes les structures et agences de moins de cent agents. Madame et monsieur les secrétaires d'État, cela signifie-t-il que vous allez fermer l'APE ou la fusionner avec un autre organisme ? On parle d'une circulaire ; je ne l'ai pas lue, mais elle semble avoir fuité.
J'en viens à mon sixième point – j'en ai sept. Pendant les débats sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE »), M. Le Maire a tenté de nous rassurer : si l'État actionnaire a connu des faiblesses par le passé, cela ne va pas se reproduire, notamment s'agissant de la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) – qu'à ce stade nous avons bloquée avec le référendum d'initiative partagée (RIP). J'espère d'ailleurs que nous allons la bloquer jusqu'au bout, en obtenant toutes les signatures.
Or, en 2018 et même début 2019, plusieurs faits semblent contredire ses propos. Ainsi, le 16 avril dernier, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la procédure de vente des parts de l'État dans la société de l'aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB). Cela souligne les faiblesses juridiques de la vente. Il est d'ailleurs curieux de constater que l'État n'a pas dépêché d'avocats pour le représenter à la cour d'appel, même si je suis satisfaite du jugement.
Deuxième exemple, qui concerne l'État actionnaire – et non les participations de l'État : le 14 juin 2018, le président de General Electric vous a informé qu'il ne respecterait pas son engagement de créer mille emplois. Or l'autorisation de fusion avait été délivrée en 2014 par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, sur la base de cet engagement et du décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 sur les investissements étrangers soumis à autorisation préalable. Pourquoi n'avez-vous pas écrit à General Electric pour lui indiquer que le non-respect de son contrat l'obligeait à verser à l'État français 50 000 euros par emploi non créé ? L'État doit se faire respecter en tant qu'actionnaire. Je n'ai jamais eu de réponse à ma lettre en date du 14 juin 2018... Avez-vous reçu l'argent ? Si c'est le cas, cela me convient !
Ma dernière question sur les participations de l'État concerne la valorisation du portefeuille de l'APE, estimé à 110 milliards d'euros : 75 % est constitué de titres cotés – leur valorisation est simple puisqu'il suffit de se fonde sur leur cours boursier – mais 25 % du portefeuille est constitué de titres non cotés qui ne sont pas réévalués chaque année. La Cour des comptes vous a enjoint de réaliser une réévaluation annuelle. Même si c'est complexe, cela semble aller de soi. L'envisagez-vous ?
Nous avons déjà eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises du compte relatif à la participation de la France au désendettement de la Grèce. En 2015, comme la Grèce n'avait pas souhaité remplir complètement les conditions de son second programme d'assistance financière de juillet 2014, le dispositif de rétrocession des intérêts a été suspendu. Ce dispositif devait être réactivité en 2018 et la France s'était alors engagée à reprendre les versements. Madame et monsieur les secrétaires d'État, pourquoi cet argent n'a-t-il toujours pas été rendu aux Grecs ? Ces derniers ont ainsi contribué à réduire le déficit public de la France de 1,16 milliard d'euros...

Dans le droit fil de mon rapport spécial sur les Investissements d'avenir, je souhaitais souligner l'ambiguïté budgétaire persistante de ce programme : dans le CAS Participations financières de l'État, on retrouve 750 millions de transferts au titre des PIA en dépenses, que l'on retrouve également en recettes dans ce même CAS, sur le budget général. Je tiens à souligner la difficulté à pouvoir retracer l'ensemble des mouvements et leur pertinence.
Pour répondre aux questions de Mme Rabault sur le montant des dividendes, par définition ces derniers sont volatils et les revenus antérieurs ne présagent en aucun cas des revenus futurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont été particulièrement faibles cette année – probablement du fait de certaines opérations ou de réinvestissement sur les sociétés en portefeuille – que ce sera le cas l'année prochaine.
Si nous privatisons, le produit de la privatisation viendra abonder les crédits de l'État. À court terme, la faiblesse de solde du CAS ne me semble pas insurmontable. D'autres gouvernements l'ont montré avant nous : lorsqu'il est nécessaire de le réabonder pour venir en aide à une entreprise, c'est fait. Le solde de 1,5 milliard d'euros est en réalité lié au versement de titres dans le FII. Ces derniers reviendront dans le CAS quand le Fonds aura été abondé en cash – permettez-moi cet anglicisme. Entre 1 et 1,6 milliard d'euros seront alors reversés au CAS.
Envisage-t-on de changer la prévision notionnelle ? Je suis au regret de vous dire que non. Certes, l'exercice est tout à fait artificiel – je vous le concède. Mais les interventions en urgence sont, par définition, imprévisibles. Bien sûr, nous rendons compte au Parlement au fur et à mesure et annonçons notre intention de faire dans certains cas. J'ai peur qu'il n'y ait pas vraiment de bonne solution...
S'agissant des investissements liés à l'innovation de rupture, vous avez raison, nous n'avons pas encore décaissé, ni réalisé de dépenses, pour une bonne et simple raison : il a fallu d'abord choisir des défis, abonder chacun à hauteur de 30 millions d'euros, puis impliquer certaines parties prenantes – scientifiques, industrielles. La phase de mise en place a été assez longue – trop longue à mon goût : il a fallu recruter, discuter les salaires et choisir les grands défis, désormais au nombre de trois – intelligence artificielle et santé, intelligence artificielle et cybersécurité et stockage de l'énergie. Les premiers décaissements auront lieu en 2019. Cela se passe plutôt bien ; la machine est lancée ; les réunions du Conseil de l'innovation se tiennent. Cela va donc bientôt devenir un sujet d'exécution.
Le principe même d'un fonds d'innovation de rupture a donné lieu à beaucoup de discussions intragouvernementales ! Nous avons décidé que ce fonds – destiné à la recherche – devait être pérenne. Il fallait donc s'assurer d'un revenu régulier, non soumis aux aléas de la bourse, pas plus qu'aux aléas des discussions budgétaires. Ces investissements de long terme ne peuvent faire l'objet d'engagements non tenus car il faut plusieurs années pour qu'une société de recherche aboutisse. On ne peut donc couper les crédits subitement. Ce système viable sur le long terme permet par ailleurs de désendetter l'État, à un moment où la France trouve un grand intérêt à ce que ces 10 milliards d'euros viennent en déduction de la dette de l'État.
Afin de ne pas inquiéter les agents de l'APE qui m'accompagnent, je vous confirme que nous n'avons pas prévu de la fermer. Certes, c'est une agence, mais une agence un peu spéciale puisqu'elle est rattachée à la DGT. En outre, la circulaire que vous évoquez ne vise qu'à recenser les agences en question. Ainsi, nous n'avons pas non plus prévu de supprimer l'AFT. Je laisserai Mme Pannier-Runacher vous apporter des précisions sur ce point, ainsi que sur les intérêts de la dette grecque.
S'agissant de l'aéroport de Toulouse, on peut certes regretter la manière dont l'affaire a été menée. Mais nous sommes en cassation car nous ne partageons pas totalement les conclusions du juge administratif. En outre, seul le transfert des titres a été annulé, et non le contrat de cession.
Les titres non cotés sont réévalués par la direction générale des finances publiques (DGFiP) lorsqu'il y a des mouvements significatifs – vous connaissez bien le sujet. Le faire plus régulièrement aurait probablement un intérêt informatif, je le reconnais, mais, en tout état de cause, on ne prendrait pas en compte la valeur actualisée des participations non cotées – puisque la dette est calculée en brut. En outre, je doute de la justesse d'une l'évaluation plus régulière. Enfin, quelle périodicité retiendrait-on ?
Je vais apporter un complément au sujet de l'APE. La circulaire, qui date du 5 juin, vient de nous être envoyée. Il faudra justifier très précisément l'existence des entités et organismes comptant moins de 100 agents. Comme je pense qu'on peut justifier l'utilité de l'APE, il n'est pas question de la supprimer. Afin que tout le monde soit complètement rassuré, il en est de même pour l'AFT.
S'agissant de General Electric, l'application de l'accord a été appréciée à la fin de l'année 2018. C'est peut-être pour cette raison que vous n'avez pas eu de réponse. Il y avait alors 25 créations d'emplois, alors qu'on était précédemment passé par un point haut de 425, le 30 juin 2017 : il y a eu un effort de création d'emplois qui n'a pas pu être poursuivi compte tenu des difficultés de General Electric, qui a supprimé 12 000 emplois dans le monde – la France n'est pas la seule concernée.
Les 50 millions d'euros font l'objet d'un engagement de General Electric. Ce qui est en cours de définition est la manière dont on les gérera : nous avons intérêt à ce que cet argent reste dans un environnement privé afin qu'il ne soit pas traité comme une aide d'État. La question porte sur le dispositif d'utilisation. Faut-il créer une fiducie, par exemple ? Ce ne sera pas, en tout cas, un chèque direct à l'État. Sinon, ce serait considéré comme de l'argent public et il serait plus compliqué de l'utiliser pour la réindustrialisation des sites environnants, ce qui est l'objectif. Nous sommes en train de travailler, au plan juridique, sur un dispositif permettant d'utiliser ces fonds pour la réindustralisation, dans le cadre d'un pilotage privé où General Electric n'aurait pas le dernier mot et qui servirait à des projets soutenables à tous égards. Il n'y a pas d'ambiguïté : General Electric a confirmé le versement des 50 millions d'euros et nous fait grâce des 25 emplois créés, ce qui est élégant.
En ce qui concerne la Grèce, les modalités de rétrocession n'ont été agréées qu'au début de l'année 2019 et les lettres d'instruction aux États ont ensuite été signées. Tout est désormais en place pour transférer les profits. Cela interviendra avant la fin de l'année, potentiellement mi-juillet. C'est davantage un sujet de négociation et de procédures administratives qu'une remise en cause d'un engagement qui a été pris : il sera tenu.

Ma question porte sur l'exécution budgétaire des crédits affectés à l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), qui peut se charger de la maîtrise d'ouvrage, de l'acquisition d'espaces mais aussi de la commercialisation et de la gestion locative des surfaces restructurées.
Nous avons adopté en 2018 la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « ÉLAN », qui permet à l'EPARECA d'intervenir dans les coeurs de ville en difficulté, dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Jusque-là, cet établissement public ne pouvait intervenir que dans les 1 500 quartiers relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville ou dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Un certain nombre de conventions associent déjà l'EPARECA à des projets d'ORT, et il sera prochainement intégré à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) : c'est une mesure de cohérence qui lui permettra d'être associé plus étroitement aux projets de territoire.
En 2018, cet établissement public a reçu une dotation de 5,8 millions d'euros pour l'ensemble de ses activités. Il a employé 41 ETP sous plafond et 3 hors plafond. Pouvez-vous m'indiquer combien d'opérations ont été financées grâce à la dotation versée ? Considérez-vous que ces crédits sont suffisants compte tenu de l'évolution des missions que je viens d'évoquer ?

Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Valérie Rabault à propos de la perte de dividendes résultant des privatisations, car je n'ai pas bien compris votre réponse. Je chiffre la perte à au moins 400 millions d'euros. Je n'imagine pas qu'il n'y ait pas eu d'étude d'impact sur ce sujet. Comment compenser le manque à gagner ?
S'agissant du projet d'alliance Chrysler-Fiat-Renault, on peut anticiper, très logiquement, une baisse du poids de l'État dans la gouvernance du nouvel ensemble et des délocalisations via des mutualisations de l'outil de production à moyen terme. Comment l'État voit-il cette question ? Le conseil d'administration vous a-t-il transmis des études d'impact sur ce sujet ?

Le Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) a progressivement perdu de sa substance en raison du désengagement financier qu'il a subi. Au lieu d'inverser la tendance en donnant à ce fonds une nouvelle jeunesse, afin de soutenir des projets locaux de reprise de commerces et de fonds artisanaux, sa disparition pure et simple a été actée pour « contribuer à l'effort national de maîtrise des dépenses publiques ». Le FISAC ne représentait pourtant que 10,5 millions d'euros en 2018. Dans le même temps, de grands cadeaux ont été consentis dans le cadre d'exonérations sans contreparties, telles que le CICE. Nous souhaiterions remonter le FISAC, en termes de moyens.
Je voudrais également évoquer la fracture numérique qui menace le pays et pourrait s'accentuer. Le Gouvernement veut accélérer la dématérialisation et la numérisation des services publics, dans une logique financière et comptable, alors que des territoires sont oubliés : leurs populations restent dans des zones blanches, sans internet mais aussi sans connexion téléphonique de qualité. Selon le Défenseur des droits, 500 000 personnes sont dans l'incapacité d'accéder à un réseau internet depuis leur domicile. Pour ces personnes matériellement éloignées du numérique et pour toutes celles qui n'y sont pas formées, accéder aux services publics est un véritable calvaire. Le virage « tout numérique » crée des citoyens de seconde zone, ce qui n'est plus acceptable. Que comptez-vous faire pour que les engagements du plan très haut débit soient tenus ?

Je tiens tout d'abord à souligner l'importance des travaux menés dans le cadre de ce second Printemps de l'évaluation. Ils permettent vraiment au Parlement de renforcer son rôle de contrôle de l'exécution budgétaire.
Ma question reprend une partie des éléments qui ont été présentés par Nicolas Forissier, rapporteur spécial pour le commerce extérieur et le soutien à l'exportation de nos PME.
Les politiques publiques figurant dans le programme 134 Développement des entreprises et régulations visent à améliorer la compétitivité et à favoriser un environnement économique propice à la croissance et à l'emploi. En 2018, ces politiques publiques se sont déclinées en plusieurs objectifs, dont celui consistant à soutenir les entreprises étrangères désireuses de s'installer en France. Cet objectif repose largement sur les actions de Business France, qui a déployé en 2018 une stratégie centrée, notamment, sur la détection des projets d'investissement étrangers, en vue de leur réalisation.
Face à un contexte économique mondial crispé et fragilisé, certains États membres de l'Union européenne, dont la France, souhaitent que la prise en compte des intérêts stratégiques européens se traduise par un renforcement de la politique commerciale et du contrôle des investissements étrangers dans les entreprises sensibles.
Alors que les investissements étrangers sont en baisse en Europe, la France est le seul grand pays où ces investissements continuent à progresser. Nous nous sommes hissés au deuxième rang européen en termes d'attractivité, après le Royaume-Uni mais devant l'Allemagne.
J'aimerais savoir de quelle manière les crédits alloués à la détection des projets d'investissements étrangers en France ont été employés.

La question des participations financières de l'État est particulièrement importante quand on fait le bilan de la première année pleine et entière du gouvernement de M. Philippe. Selon les documents budgétaires, les objectifs en la matière sont de veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État et d'assurer le succès des opérations de cession de certaines de ces participations. Je me demande pourquoi certains objectifs que nous jugeons prioritaires, pour notre part, ne sont pas mentionnés – par exemple, veiller à ne pas céder des parts d'entreprises stratégiques, notamment dans le domaine de l'énergie, ou rentables pour l'État. Au regard de ces objectifs, le bilan de l'année 2018 est particulièrement catastrophique. La vente de parts de Safran, pour 1,245 milliard d'euros, a fait en sorte que l'État ne détient plus que 10,81 % du capital de cette entreprise, dont chacun conviendra qu'elle est stratégique. Il y a eu un autre désengagement de l'État d'un secteur stratégique avec la vente de parts d'Engie, même si c'était à des salariés. On pourrait également citer la vente de parts de GIAT Industries, pour 84 millions d'euros.
Tout cela ne fait que préfigurer la catastrophe annoncée avec la vente d'ADP, si le RIP que nous avons proposé ne vient pas la contrecarrer, mais aussi de La Française des jeux (FDJ) et d'Engie. Comme l'a souligné la Cour des comptes, la création du FII a conduit à des opérations inutilement compliquées qui font apparaître un montant de 10 milliards d'euros alors que seuls 250 millions seront, en pratique, consacrés à l'innovation de rupture, puisqu'il s'agira uniquement des intérêts du Fonds. Comme notre collègue du groupe Les Républicains l'a souligné, ils seront inférieurs aux dividendes que rapportent aujourd'hui les entreprises concernées.
Les indicateurs de performance actuels me semblent insuffisants. Je crois qu'il faudrait en ajouter d'autres, relatifs à la perte de souveraineté, aux risques pour les usagers – notamment à travers la question de l'addiction en ce qui concerne la FDJ et celle de la sécurité des passagers du côté d'ADP –, mais aussi aux prix, aux aspects environnementaux et à l'investissement à long terme. On voit qu'on est loin du compte sur ces différents points : le bilan de la première année de M. Macron est bien sombre, et ce qui s'annonce pour 2019 l'est tout autant.
Nous avons, en vendant les participations, un revenu qui est significativement supérieur aux dividendes si on retire quelques milliards d'euros au titre de FDJ – l'État perdra ces dividendes mais il gagnera quelques milliards d'euros dans le même temps. Du point de vue du budget de l'État, cela ne fait que passer de la poche gauche à la poche droite. La question n'est pas de savoir quel est l'argent se trouvant dans le CAS à un instant donné – on sait réabonder le CAS : l'État l'a fait dans le passé, quelle que soit la majorité – mais si l'argent de l'État est utilement immobilisé ou non. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dividendes sont extrêmement liés à la volatilité du marché.
Je note également le soutien du groupe La France insoumise à l'économie de marché et à la bourse... Vous venez de dire qu'il serait beaucoup plus intéressant d'avoir des participations et de compter sur les intérêts plutôt que de réaliser des dépenses publiques. Nous sommes en haut du cycle, mais nous serons peut-être en bas demain, ce qui signifierait des revenus bien inférieurs. L'intérêt de la solution qui a été choisie, même si c'est un peu compliqué, est qu'il y a un revenu assuré, dès lors qu'on fait un placement en bons du Trésor, pour réaliser un investissement dans l'innovation.
Je ne pense pas que je parviendrai à convaincre M. Coquerel, mais je vais quand même essayer d'apporter des éléments de réponse. Safran est une entreprise que je connais extrêmement bien, et je veux vous rassurer : la vente de quelques pourcents des parts de l'État, que j'ai vécue de l'intérieur, n'a absolument rien bouleversé au sein de l'entreprise. En ce qui concerne les activités de défense, elle a continué comme avant à travailler main dans la main avec l'État. Dans le cas d'ADP, et pour l'ensemble des participations, l'idée sous-jacente est que la possession actionnariale d'un certain nombre d'entreprises n'est pas le seul levier de souveraineté dont nous disposons. Il y en a d'autres, dans le cadre de la régulation ou des commandes, qui sont tout aussi efficaces. Il reste à savoir dans chaque cas s'il est plus efficace d'être au capital ou d'exercer la responsabilité de l'État par d'autres moyens. Vous avez évoqué la sécurité des passagers à propos d'ADP : elle ne sera en rien affectée par la privatisation. Elle était déjà réglementée par l'État et elle le restera. Par ailleurs, cela ne veut pas dire que l'État s'interdira de remonter dans le capital dans certains cas, pour protéger des entreprises françaises, par le biais de l'APE ou par d'autres moyens.
J'ai déjà eu l'occasion de dire, monsieur Dufrègne, que je n'ai quasiment aucun mot à retirer du rapport du Défenseur des droits. Il a raison : la question du numérique est vécue par nos concitoyens, dans beaucoup de territoires, comme un facteur et un syndrome de leur abandon par l'État – on l'a bien vu dans le cadre du Grand débat. Nous devons absolument traiter cette urgence. Les annonces relatives aux maisons France services permettent d'apporter un certain nombre d'éléments, mais notre réponse va au-delà. Nous estimons que le New Deal mobile et le plan Très haut débit permettront de tenir la promesse du Gouvernement, qui consiste à apporter une connexion de bon niveau à l'ensemble des citoyens français d'ici à 2022.
Une fois qu'on a internet, encore faut-il savoir s'en servir : aujourd'hui, un Français sur cinq ne sait pas le faire. Ceux qui peuvent être formés doivent l'être et il faut accompagner les autres près de chez eux – il y a, en effet, des gens qui n'utiliseront jamais internet. C'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de faire un certain nombre d'annonces, probablement à la rentrée. Nous en discutons dans le cadre de la dynamique des maisons France services. On peut faire tous les discours que l'on veut sur la technologie, l'intérêt d'internet, la transformation numérique et la compétition à mener avec les États-Unis et la Chine, mais tout cela n'a aucun sens et ne peut pas être entendu si internet signifie l'abandon des Français dans leur quotidien. La condition de la réussite, notamment sur le plan de la souveraineté, est d'être capable de montrer qu'internet est une source de facilité et non d'exclusion.
L'EPARECA a financé six investissements en 2018, monsieur Potterie : à Romainville, Grigny, Lodève, Creil, Auch et Nogent-sur-Oise, dans le cadre de restructurations de centres commerciaux. Ces investissements ont été en partie financés par une dotation de l'État, pour un total d'environ 13,7 millions d'euros. L'EPARECA ajoute à sa dotation initiale de 5,8 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement des financements issus de la revente des centres commerciaux réhabilités. Ces opérations lourdes de restructuration ne représentent qu'une partie de l'activité de l'EPARECA, qui effectue également un travail précieux d'études préalables en matière commerciale et artisanale pour les collectivités qui le sollicitent. Ces études permettent notamment la mise en place de projets d'investissement et de diagnostic en ce qui concerne l'artisanat et le commerce local. L'extension des missions de l'EPARECA qui résulte de la loi ÉLAN va permettre à la future ANCT d'intervenir partout où les collectivités en ont besoin et en font la demande. Il y aura donc une continuité dans la capacité d'accompagnement.
Pour ce qui est du projet de fusion entre Fiat-Chrysler et Renault, vous savez que le ministre de l'économie et des finances, qui suit personnellement ce dossier, a posé quatre conditions : le maintien de l'alliance avec Nissan, qui est un élément de compétitivité pour Renault – au-delà des aléas propres à chacune des marques et du fait que Nissan, objectivement, n'a pas eu des résultats exceptionnels l'année dernière, cela reste un élément important, auquel nous sommes attachés, en termes de puissance de feu à l'international ; le maintien des sites et des emplois, avec des assurances – c'est précisément pour cette raison que nous avons demandé au conseil d'administration de préciser son propos, notamment en ce qui concerne les synergies : ce ne sera pas une étude d'impact, mais c'est le même principe ; une gouvernance équilibrée, parce qu'il y a le projet, tel qu'il est présenté, mais aussi la capacité à influencer sur la gouvernance dans le temps, ce qui est également un élément important ; enfin, la participation de Renault au projet « batterie électrique », qui est central pour l'industrie automobile européenne.
Nous avons assez longuement débattu de l'extinction du FISAC dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Un certain nombre d'éléments de réponse ont été apportés, notamment avec la création de l'ANCT. Les derniers appels à projets ont été exécutés en 2018 : on est dans une gestion en extinction, qui est assumée. Cette structure porte une quantité de crédits disproportionnée – j'ai parlé tout à l'heure de la circulaire évoquée par Mme Rabault. Cela ne veut pas dire que le développement du commerce et de l'artisanat dans les coeurs de ville et les bourgs-centres n'est pas une mission pour laquelle nous souhaitons continuer à exercer un accompagnement. C'est très clairement un enjeu pour le ministère de la cohésion des territoires, au-delà de l'opération « Coeur de ville ». Vous avez également pu voir que nous avons accompagné les commerçants dans le cadre d'un appel à projets pour l'animation des centres-villes qui ont subi le plus de difficultés au moment de la crise des « gilets jaunes ».
L'Union européenne a avancé en adoptant, pour la première fois, une réglementation sur l'investissement étranger, qui comporte un dispositif de screening, ou de revue, des projets et la possibilité d'émettre un avis négatif pour des raisons stratégiques. Par ailleurs, nous défendons une plateforme européenne reposant sur les éléments suivants : une politique commerciale adaptée et, au fond, assez simple, qui doit être marquée par la réciprocité dans l'ouverture des marchés ; une politique industrielle permettant d'accompagner des chaînes de valeur stratégiques – nous venons de le faire pour la nanoélectronique, nous sommes en train de nous engager sur cette voie en ce qui concerne la batterie électrique et nous avons aussi des projets importants au sujet de l'intelligence artificielle, de l'hydrogène et des processus décarbonés, dans le cadre desquels nous voulons concentrer l'innovation afin de créer des filières complètes et de participer à la transformation écologique et énergétique de la façon dont on produit en Europe ; une politique de la concurrence se caractérisant par une adaptation des règles au contexte des plateformes numériques – on peut considérer, comme le font certains économistes, que ce sont des monopoles de fait et qu'il faut donc un droit de la concurrence plus aiguisé en ce qui les concerne : vous connaissez la logique selon laquelle « the winner takes all », ce qui est assez vrai pour des entreprises telles que Google ou Twitter, et par une appréciation de la concurrence et des projets de fusion entre les entreprises européennes en prenant la mesure des marchés importants.
Pour reprendre l'exemple d'Alstom et de Siemens, qui a défrayé la chronique, il faut regarder le marché dans une perspective dynamique, c'est-à-dire en considérant la capacité d'acteurs étrangers à entrer sur le marché. Lorsque des appels d'offres sont ouverts à sept acteurs et que cinq d'entre eux participent jusqu'au dernier tour, on peut considérer qu'il y a une concurrence. On peut adopter des mesures de comportement pour s'assurer que l'acteur fusionné ne tue pas la concurrence, mais l'empêcher de devenir plus fort dans la concurrence mondiale n'a pas de sens. Il faut tenir compte du fait que les marchés sont souvent mondiaux ou composés de différentes plaques géographiques.
S'agissant de Business France, le nombre d'entreprises bénéficiant de prestations de projection sur des marchés étrangers s'est élevé à 10 350 en 2018. L'objectif est qu'environ 11 000 entreprises en bénéficient dans la durée – c'est l'objectif retenu pour 2022.
Membres présents ou excusés
Réunion du mercredi 5 juin 2019 à 16 heures 15
Présents. - M. François André, Mme Émilie Bonnivard, Mme Émilie Cariou, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, M. Éric Coquerel, M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Nicolas Forissier, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. François Jolivet, M. Michel Lauzzana, Mme Véronique Louwagie, Mme Lise Magnier, M. Jean-Paul Mattei, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoit Potterie, Mme Valérie Rabault, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Éric Woerth
Excusés. - M. Jean-Louis Bourlanges, M. M'jid El Guerrab, M. Daniel Labaronne, M. Marc Le Fur, M. Olivier Serva, M. Philippe Vigier
Assistaient également à la réunion. - M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, Mme Christine Hennion, M. Vincent Rolland, Mme Liliana Tanguy
———–——