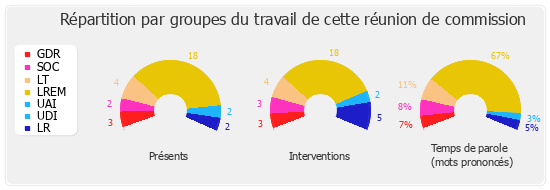Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mardi 4 juin 2019 à 21h00
La réunion
Présidence
La commission, réunie en commission d'évaluation des politiques publiques, entend d'abord M. Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Nous avons la responsabilité, Hervé Pellois et moi-même, de vous présenter nos principaux constats et analyses sur la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales – à l'exception du programme Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation, dont traitera notre collègue Michel Lauzzana –, mais aussi sur le compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural.
Il faut saluer, d'une façon générale, le fait qu'en 2018 l'exécution budgétaire a été plus transparente : le Gouvernement aura consommé 2,76 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 3,44 milliards d'euros en crédits de paiement au titre de la mission qui nous intéresse, soit une exécution à hauteur de 100,4 %. J'y insiste, car c'est la première fois depuis 2013 que la loi de finances initiale est globalement respectée en ce qui concerne l'agriculture, sans ouverture de crédits en gestion, à l'exception de reports de 2017. Nous délivrons donc un réel satisfecit – à quelques nuances près : certains points doivent faire l'objet d'un suivi.
Vous me permettrez de passer rapidement sur le programme support Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture, qui a mobilisé 646 millions d'euros en 2018, soit 98,5 % de la programmation.
J'en viens à l'autre programme dont nous avons la charge, Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture. C'est le véritable pilier de l'action du ministère. Il regroupe 62,5 % des crédits de la mission, soutient ses principaux opérateurs et se voit imputer toutes ses dépenses fiscales. Ce programme a été marqué, en 2018, par un effort de sincérisation. Jusqu'alors, les dépenses de crise étaient chroniquement surexécutées : souvenons-nous notamment du dépassement de 2 644 % en crédits de paiement en 2017 !
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 a inscrit une provision pour aléas de 300 millions d'euros : c'est un instrument utile, qui est également source de transparence. Nous avions déjà salué cette fiabilisation ; nous le faisons de nouveau. Cela étant, nous souhaitons faire deux remarques : d'une part, la provision a servi à couvrir pour partie des dépenses certaines, puisqu'il s'agissait notamment de refus d'apurements par la Commission européenne, même si les montants n'en étaient pas encore connus en fin d'année ; d'autre part, la provision a été ramenée à 200 millions d'euros en 2019, ce qui ne sera vraisemblablement pas suffisant. S'agissant des aléas à venir, je vous exprime ici mes inquiétudes, en particulier – vous le savez, monsieur le ministre, car nous en avons parlé dans ma circonscription de la Meuse – à propos de la peste porcine africaine : la maladie est aux portes du Grand Est.
L'exercice 2018 a par ailleurs permis le début de la mise en oeuvre du Grand plan d'investissement (GPI). Le ministère a été obligé de procéder à des redéploiements, dont un rapprochement avec le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. Il semble que des solutions aient été trouvées, monsieur le ministre, mais nous appelons à la vigilance de tout le Gouvernement sur le suivi d'un projet par nature interministériel comme le GPI : celui-ci doit bel et bien profiter aux exploitants agricoles, sur tout le territoire.
Je voudrais dire un mot des huit opérateurs que soutient le programme budgétaire. Ils auront touché 1,39 milliard d'euros en 2018, soit 7,1 % de plus que prévu. Cette augmentation substantielle appelle quelques explications. Au-delà du panorama général, il y aura beaucoup à dire, par exemple, sur l'Office national des forêts (ONF) et la filière bois qui appelle à être redynamisée, mais nous souhaitons évoquer une nouvelle fois le cas particulier de l'Agence de services et de paiement (ASP). En 2018, le ministère lui a versé près de 1 milliard d'euros. Le principal enjeu est le retour à la normale du calendrier de versement des aides au titre de la politique agricole commune (PAC), ou plutôt, comme on l'entend dire maintenant, la « poursuite du retour à la normale », l'année de référence étant 2015.
La situation est globalement rétablie s'agissant des aides directes et de l'indemnité compensatoire de handicap naturel, ce qui est essentiel ; toutefois, les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l'agriculture biologique font encore l'objet de rattrapages. Le ministère reconnaît que les dossiers qui n'ont pas encore été traités sont les plus complexes et que l'ASP rencontre régulièrement de nouvelles difficultés informatiques. Nous entendons ces difficultés. Nous rappelons cependant que, cette fois, il faut en sortir pour de bon, vu le passif accumulé, et allouer les moyens nécessaires à l'ASP sur le long terme. Retrouver un budget clair et lisible pour le ministère, c'est ce à quoi nous nous sommes attachés, et nous continuons à le faire ; il faut tout autant que les exploitants agricoles s'extraient enfin du marasme des retards de versement d'aides qui ne leur étaient en aucun cas imputables.
Enfin, rappelons que la prochaine programmation de la PAC est nécessairement source d'incertitude. La visibilité sur le calendrier est là aussi faible, mais une chose est sûre : une longue période de transition se profile entre la fin de l'actuelle politique agricole commune et le début de la future. Tous les agents de l'ASP et du ministère reçoivent le soutien de la représentation nationale, évidemment consciente des difficultés auxquels ils doivent faire face. Nous réaffirmons tout aussi fermement que, dans la période intermédiaire qui s'ouvre, la situation des agriculteurs doit impérativement être claire ; il faut qu'ils soient épaulés par un service public efficace.

Avant d'en venir aux questions que nous souhaitons vous poser, monsieur le ministre, j'aimerais aborder deux points : les dépenses fiscales et le thème que nous avons choisi pour ce Printemps de l'évaluation, à savoir les agences de l'eau.
La mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales comporte trente-six niches fiscales, très disparates. Par exemple, la plus coûteuse représente 2 milliards d'euros, la suivante dix fois moins. Le nombre de bénéficiaires, quant à lui, varie de 13 à 40 800, mais n'est connu qu'une fois sur deux. Le montant de cinq niches n'est toujours pas chiffré et celui de cinq autres est simplement estimé à moins de 500 000 euros. Nous nous interrogeons sur ce point, tout comme sur le rattachement au ministère de l'agriculture de la dépense fiscale relative au taux réduit de taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) qui concerne le gazole : seulement 48 % de ses bénéficiaires sont des agriculteurs, le reste relevant surtout du bâtiment ou des travaux publics.
Pour ces raisons, nous avons demandé à vos services de porter à notre connaissance les objectifs qui étaient ceux du législateur lorsque les différentes niches fiscales ont été mises en place. Ces objectifs ont-ils été atteints ? Ces niches favorisent-elles une agriculture durable ? Profitent-elles à un nombre élevé de bénéficiaires ? Onze niches pour la seule filière bois, cela aussi amène à s'interroger...
J'en viens au thème que nous avons retenu ce printemps, à savoir les interactions entre les agences de l'eau et le secteur agricole. Les six agences de l'eau, réparties sur le territoire national, sont sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et correspondent aux bassins hydrographiques. Elles prélèvent des redevances auprès des utilisateurs d'eau, notamment suivant la logique pollueur-payeur, et leur versent des aides en retour afin d'améliorer la qualité des masses d'eau, conformément au principe selon lequel l'eau paie l'eau.
Trois redevances sont prélevées sur le secteur agricole : la redevance pour pollutions diffuses (RPD), celle pour pollution par les activités d'élevage et celle pour le prélèvement d'eau à usage d'irrigation. Les aides prennent des formes variées : le soutien au bio, le financement de matériel pour supprimer ou réduire les pesticides – dans le cadre du plan Écophyto –, la lutte contre les transferts de particules polluantes, la gestion des effluents d'élevage et la résorption des excédents de phosphore, ou encore des actions contre les fuites d'eau. Les derniers chiffres nationaux sont ceux de 2017, année au cours de laquelle les exploitants agricoles auront payé 137 millions d'euros de redevance et bénéficié en retour de 226 millions d'euros de subventions. Le secteur agricole touche donc davantage qu'il ne paie – en l'occurrence, le taux de retour est de 1,5. Nous présenterons dans notre rapport certains chiffres pour l'année 2018 qui nous ont été fournis par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, dont nous sommes allés rencontrer des représentants.
Par ailleurs, les agences de l'eau ont une mission d'animation, de conseil et d'accompagnement des agriculteurs, au moyen de diagnostics d'exploitation, de formations individuelles ou collectives et d'interventions foncières. Nous nous félicitons de la montée en charge des agences de l'eau en faveur de la transition agroécologique. En outre, la loi de finances pour 2019 prévoit une augmentation de 50 millions d'euros du rendement de la RPD, qui passerait de 140 à 190 millions d'euros. Cette hausse sera fléchée vers l'agriculture biologique, de façon à atteindre plus facilement l'objectif de 15 % de la surface agricole utile (SAU) en bio en 2025.
En revanche, nous notons certaines difficultés. Premièrement, ce sont l'ASP et ses délégations régionales qui versent les aides des agences de l'eau aux agriculteurs, dans le cadre de conventions régionales. Or on connaît la situation de l'ASP : pour faire face à ses retards, elle a été conduite à demander des avances aux agences de l'eau et, plusieurs années après, certaines ne savent toujours pas comment l'ASP les a utilisées et ne sont pas en mesure de procéder aux certifications nécessaires. Le défaut de présentation des justificatifs par l'ASP les empêche de traduire en dépenses budgétaires ce qui, au départ, était un mouvement de trésorerie.
Deuxièmement, alors que la gouvernance de terrain est intéressante, les données des agences de l'eau ne sont pas assez consolidées au niveau central. Nos interlocuteurs du ministère de la transition écologique et solidaire ont déclaré « ne pas avoir une grande visibilité », reconnu que « le suivi des aides était défaillant » et avoué « ne pas avoir tous les éléments pour répondre » à nos questions. Le ministère de l'agriculture nous paraît, pour sa part, trop peu impliqué.
Monsieur le ministre, nous souhaitons vous poser quatre questions. Le respect de l'autorisation budgétaire en 2018 semble surtout tenir à l'absence de dépenses importantes pour faire face à des crises : sur quelles réformes travaillez-vous pour réaliser des économies structurelles et résoudre les problèmes que nous venons d'aborder ?
L'absence d'un tableau clair et complet des dépenses fiscales engendrées par les trente-six niches nous inquiète : quelles réflexions menez-vous sur les dépenses fiscales, non seulement dans l'objectif de préserver l'équilibre des comptes de l'État, mais aussi pour orienter nos politiques publiques ?
S'agissant des agences de l'eau, et sans préjudice des prérogatives du ministère de la transition écologique et solidaire, que pensez-vous du problème des avances attribuées à l'ASP sur les aides agricoles ?
Enfin, vos services nous ont indiqué voir des « marges de simplification » concernant la gestion de la redevance pour pollutions diffuses par l'agence Artois-Picardie : quelles sont-elles ?

Je commencerai par remercier mes collègues rapporteurs spéciaux d'avoir abordé la question des niches fiscales. Je vous le dis très clairement, monsieur le ministre : lors du prochain PLF, je continuerai ce que j'ai commencé lors du précédent – avec la complicité d'Amélie de Montchalin, à l'époque –, en proposant la suppression de l'intégralité des niches qui ne sont pas à zéro dans les états budgétaires ou qui ne sont pas chiffrées. C'est malheureusement la seule méthode que j'ai trouvée pour faire en sorte que les chiens sortent de la niche entre la commission et la séance publique...

J'entends bien Charles de Courson : lui aussi connaît bien la question des niches fiscales... Quoi qu'il en soit, je tenais à vous prévenir, monsieur le ministre : le sujet est extrêmement important et nous sommes très frustrés – même si, je le précise, le ministère de l'agriculture, bien évidemment, n'est pas le seul concerné.
Je voudrais poser quelques questions, en complément de celles qui viennent d'être abordées, sur le thème qui a été choisi pour l'évaluation, c'est-à-dire l'accompagnement et le financement de l'agriculture par les agences de l'eau. Je m'étonne quand même que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation soit peu impliqué et peu consulté en dehors de l'échelon des bassins hydrographiques : 0,5 équivalent temps plein travaillé consacré à ces politiques. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce point.
Pour poursuivre la réflexion de notre collègue Hervé Pellois concernant la RPD, ne craignez-vous pas qu'on aboutisse seulement à une augmentation du coût des produits phytosanitaires ? En effet, certains agriculteurs ne peuvent ou ne souhaitent pas changer de mode de production. Malgré l'abondement du fonds de structuration « avenir bio », on risque, en définitive, de ne pas constater une diminution importante de l'utilisation d'intrants chimiques.
Enfin, au-delà du thème qui a été choisi par les rapporteurs spéciaux, je voudrais vous poser deux questions. La première est relative à la forêt. En novembre 2018, le ministère de l'agriculture a lancé un plan d'action interministériel pour la forêt, le PIF – cela ne s'invente pas... Pourriez-vous nous faire un point sur le déploiement de ce plan ? La seconde est relative au dispositif pour les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE). Étant donné que nos collègues de la commission des affaires sociales ne pratiquent pas tout à fait comme nous s'agissant du Printemps de l'évaluation, je me permets un léger Anschluss – vous connaissez mon penchant germanique – sur cette question. L'État compense les moindres recettes perçues par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) au titre de l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'embauche de TO-DE. Ce sont 540 millions d'euros qui ont été consommés en 2018, alors que seuls 480 millions d'euros avaient été inscrits en loi de finances initiale (LFI). Quelles explications pouvez-vous donner à ce dépassement ? Certes, les vendanges ont été précoces et abondantes, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison... Nous faisons ensemble les vendanges du printemps, monsieur le ministre...

Le secteur de l'agriculture biologique connaît actuellement une croissance à deux chiffres. L'objectif annoncé par le Gouvernement est d'atteindre 8 % de la SAU en agriculture biologique en 2020, contre 6 % actuellement. La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (« ÉGALIM ») a relevé cet objectif à hauteur de 15 % d'ici au 31 décembre 2022.
Je souhaite rappeler quelques chiffres. Actuellement, seules 3 % des surfaces en grande culture sont exploitées en production biologique, avec toutefois un développement sans précédent de ce secteur depuis 2015 : l'augmentation des surfaces était de 20 % en 2016 et de 30 % en 2015. J'insiste sur le fait que l'agriculture biologique est un secteur mature, relativement jeune et qui reste contrasté selon les filières. Ainsi, 34 % des surfaces consacrées aux légumes secs sont exploitées en production biologique, 17 % en arboriculture, 18 % en plantes aromatiques, 15 % des ruches, mais seulement 9 % dans la viticulture et 8 % des élevages de poules pondeuses. De même, le développement de l'agriculture biologique est très constaté selon les régions : les fortes croissances en termes de surface et de nombre d'exploitations se concentrent dans les régions où l'agriculture biologique est la plus développée – Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire.
De plus, comme l'ont écrit Émilie Cariou et Hervé Pellois dans leur rapport, le secteur de l'agriculture biologique est victime d'incertitudes quant au soutien public qui lui est accordé. En effet, pour 2018, ont été annoncés le maintien du crédit d'impôt dont bénéficient les producteurs, mais aussi celui des aides au maintien de l'agriculture biologique versées par l'État, ce qui suscite de ma part une série de questions, assez nombreuses.
Le crédit d'impôt pour les exploitations en agriculture biologique a été relevé de 2 500 euros à 3 500 euros par la loi de finances pour 2018, avec un plafonnement, en incluant certaines aides, fixé à 4 000 euros au total. Ce dispositif vous semble-t-il de nature à pérenniser les conversions à l'agriculture biologique ?
Comment les trois dispositifs de soutien à l'agriculture biologique que sont le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) – cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) –, le fonds « avenir bio », géré par l'Agence bio, et le plan « ambition bio » vont-ils s'articuler avec le volet agriculture du grand plan d'investissement ?
La décision, prise en 2017, de transférer 4,2 % du premier pilier de la PAC vers le second pilier a pour objectif de financer les aides à l'agriculture biologique. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous apporter plus de précisions sur ce point ? En effet, il est nécessaire d'avoir un cofinancement des agences de l'eau et des régions pour 25 % de ces aides au maintien. Où en sont vos discussions avec les régions pour explorer d'autres pistes de financement de l'agriculture biologique, telles que le redéploiement du FEADER vers le bio dans les maquettes régionales et le financement par les agences de l'eau ?
En complément de ma question précédente, je souhaiterais revenir sur un point qui a retenu l'attention des syndicats agricoles l'année dernière : la hausse de la redevance pour pollutions diffuses, qui s'applique aux produits phytopharmaceutiques. Il s'agit de faire en sorte qu'elle rapporte environ 50 millions d'euros supplémentaires, qui serviront à financer la conversion à l'agriculture biologique, pour atteindre l'objectif de 15 % de la surface agricole utile en bio. Les agences de l'eau et l'Agence française pour la biodiversité sont chargées de gérer ces financements. Comment l'action de ces deux structures s'est-elle articulée en 2018 et comment s'articulera-t-elle avec les dispositifs d'aide à la conversion à l'agriculture biologique dont j'ai parlé précédemment ? Quel est, selon vous, le niveau d'action le plus pertinent à cet égard ?
Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation. J'aurais vraiment aimé, lorsque j'étais sénateur, pouvoir faire la même chose : c'est un exercice très intéressant, pour les parlementaires surtout, mais aussi, je le dis très sincèrement, pour le Gouvernement, parce que cela permet d'examiner l'exécution budgétaire.
Je remercie les rapporteurs pour leurs commentaires. Cet exercice nous a permis de regarder où nous en étions vraiment de l'exécution du budget de l'année 2018, et c'est très intéressant. Je vais essayer de vous proposer un résumé assez synthétique de la situation.
Vous l'avez dit, madame Cariou, le budget du ministère a été exécuté en 2018 à hauteur de 5,34 milliards d'euros, alors que la LFI prévoyait 5,36 milliards d'euros. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que je n'y suis absolument pour rien : ce n'est pas moi qui ai préparé ce budget puisque je n'aurai été ministre que durant trois mois de cet exercice. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité : ce budget avait été vraiment bien préparé.
Vous avez évoqué les 300 millions pour faire face aux aléas. Il est très important de s'y arrêter. Je crois que c'était une bonne chose de les avoir inscrits en 2018. Il se trouve que les aléas n'ont pas été aussi importants que prévu. Dans la LFI pour 2019, au contraire, 200 millions ont été inscrits, alors que les aléas sont beaucoup plus importants que l'année précédente : il faudra donc faire des ajustements. Mais là n'est pas le sujet de la rencontre d'aujourd'hui : nous en reparlerons peut-être au printemps de l'année prochaine. En ce qui concerne la mobilisation au titre des refus d'apurement par la Commission européenne, nous avions inscrit 178 millions d'euros – vous en avez parlé, sans donner le chiffre. Enfin, 75 millions d'euros ont servi à abonder le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) – ce n'est pas inintéressant.
Par ailleurs, grâce aux efforts qui ont été consentis pendant l'exercice – dont je prends ma part pour les trois derniers mois –, le ministère a contribué à l'objectif de baisse de la dépense publique. Nous avons en effet réussi à annuler 38 millions d'euros de crédits de paiement. Ce n'est pas beaucoup, mais cela mérite d'être signalé. En revanche, le financement des restes à payer de la sécheresse de l'été 2018 nécessitera, en 2019, un abondement de l'État évalué à 130 millions d'euros – vous le voyez, je joue la transparence la plus totale. Le montant des refus d'apurement par la Commission européenne devant être supportés par le budget national s'élèvera, selon nos estimations, à 170 millions d'euros. Nous avons aussi tenu compte du Brexit, même si vous ne l'avez pas évoqué : nous avons dû recruter 112 agents supplémentaires – en contrat à durée déterminée, il est vrai. En effet, le Brexit va bien finir par avoir lieu, à un moment ou à un autre, en octobre ou novembre ou plus tard : en ce qui nous concerne, nos équipes des services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières sont en place, les bâtiments sont prêts, mais il a fallu financer tout cela.
Vous avez parlé de la peste porcine africaine : 5,2 millions d'euros ont été consacrés pour l'instant à cette crise. Le dispositif a plutôt bien fonctionné puisque la France est restée indemne. Je parle seulement ici de l'argent mobilisé en plus, pas du travail des fonctionnaires, évidemment. Vous n'avez pas évoqué en revanche la tuberculose bovine, qui est un véritable problème – nous l'avons abordé lors des questions d'actualité. Nous faisons de plus en plus de contrôles et découvrons donc de plus en plus de cas. Le surcoût par rapport à ce qui était prévu est estimé à 5 millions d'euros.
Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur le budget considéré dans sa globalité. Je voudrais ajouter – je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète car c'est très important – que le budget de l'agriculture ne se limite pas aux crédits nationaux : les cofinancements venant de l'Europe apportent quand même plus de 9 milliards d'euros supplémentaires d'aides directes au développement agricole. Cela compte ! Et les 1,9 milliard de dépenses fiscales aussi.
Pour ce qui concerne le GPI, nous n'en sommes encore qu'aux balbutiements, je dois l'avouer. Des projets sont à l'étude ; pour l'instant, les choses n'avancent pas aussi vite que nous le souhaiterions. Pourtant, la perspective d'utiliser ces 5 milliards pour contribuer au développement est réelle.
S'agissant des opérateurs, je fais globalement le même constat que vous : un certain nombre d'entre eux sont en souffrance, notamment l'ONF et l'ASP. Pour ce qui concerne l'ASP, dont vous avez tous parlé, je ne sais si l'on peut parler de faillite de l'État, mais c'est en tout cas d'un véritable problème. Vous avez utilisé les nouveaux termes qui sont de rigueur – « poursuite du retour à la normale ». Je le dis franchement : le travail qui est fait depuis plusieurs mois déjà par l'ASP et son président pour essayer de sortir de ce marasme est excellent et, pour ma part, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'empêche qu'il est anormal que l'État fasse le constat de dépenses non payées et d'aides qui ne sont pas parvenues à leurs destinataires.
Je n'en fais pas un titre de gloire, mais nous avons totalement soldé les aides bio pour 2016 et réglé 94 % des aides au titre de 2017. Il avait été dit que les choses pourraient aller plus vite. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la « poursuite du retour à la normale ». Malheureusement, je suis au regret de constater que cela ne va pas aussi vite que mon prédécesseur s'y était engagé et que ce que les services nous avaient annoncé. Quand je rencontre les organisations professionnelles agricoles et les personnes concernées, je ne peux pas me contenter de dire : « Regardez, on vient de solder 2016 ! ». L'année 2016, c'était il y a trois ans : il n'est pas anormal qu'elle soit soldée... Je ne peux pas non plus me contenter de dire : « Voyez, pour 2017, on en est à 94 % ! ». En effet, même si c'est bien par rapport à là d'où l'on vient, mais pour les 6 % qui restent – et même si, vous l'avez dit, madame la rapporteure spéciale, ce sont les dossiers les plus compliqués, voire qui n'arriveront peut-être pas au bout –, je ne peux pas me contenter de dire aux intéressés, qui attendent des aides : « Youpi, nous en avons fait 94 % ! ». J'essaie d'être aussi transparent que possible.
En ce qui concerne l'ONF, plusieurs mesures ont été prises : le directeur général a été remplacé et un directeur général intérimaire a pris ses fonctions, le rapport des inspecteurs généraux vient d'être remis et nous allons procéder à des arbitrages dans les jours et les semaines qui viennent, après avoir discuté avec les organisations syndicales. Une nouvelle direction sera mise en place. Nous avons bon espoir de réussir à repartir sur de nouvelles bases, parce que l'ONF est en souffrance alors qu'il s'agit – je tiens à le réaffirmer devant vous – d'un magnifique opérateur public pour la forêt, que ses agents sont hypermobilisés et très compétents. Je veux absolument soutenir l'ONF et continuer à le développer. Mon objectif est de faire en sorte que nous continuions à avoir un Office national des forêts public, qui soit un établissement public à caractère industriel et commercial et qui soit en mesure d'exercer sa mission le mieux possible.
Autre thème important, parmi ceux qui ont été abordés, celui de la fiscalité. Monsieur Pellois, vous avez évoqué la TICPE sur le gazole et le fait qu'elle soit rattachée au ministère de l'agriculture. Ce sont les aléas de l'administration : il se trouve que le gazole pour les pêcheurs est rattaché au ministère des transports, alors que les pêcheurs dépendent du ministère de l'agriculture, et que la TICPE est globalement rattachée au budget du ministère de l'agriculture, alors que 50 % proviennent du bâtiment et des travaux publics (BTP). À mon sens, cela n'a aucune espèce d'importance. Les choses pourraient être différentes, mais il faut bien que la TICPE soit rattachée à un ministère ; il se trouve que c'est le mien. Je n'ai pas d'autre réponse à vous apporter sur ce point. Cela dit, les choses peuvent bouger dans l'organisation des services de l'État.
Vous avez évoqué les agences de l'eau : effectivement, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation est concerné à hauteur de 0,5 équivalent temps plein... Je pense qu'il pourrait être associé différemment – pour employer un langage diplomatique – au travail des agences de l'eau. Nous travaillons avec mes collègues du ministère de la transition écologique et solidaire aux moyens de faire avancer les choses : je pense à l'irrigation, avec la possibilité de mettre en place des retenues cofinancées, afin d'accentuer la présence du ministère de l'agriculture dans le cadre des agences de l'eau. Nous avons une longue histoire derrière nous, et une longue histoire nous reste également à écrire.
L'augmentation de la RPD a été mise en place l'année dernière. Le rendement initial était de 140 millions d'euros et il est possible qu'il augmente, du fait du taux fixé. Je précise une fois encore – les choses sont absolument claires de ce point de vue – que 100 % du produit de base est reversé à l'agriculture biologique. En revanche, chaque euro collecté en plus du fait de l'augmentation financera la transition agroécologique dans son ensemble, et pas seulement le bio. C'est ce que je souhaitais et j'ai obtenu satisfaction dans le cadre d'un arbitrage.
C'est d'ailleurs aujourd'hui une grande journée pour le bio, puisque nous avons annoncé, avec l'Agence bio, l'augmentation des surfaces. En disant cela, je réponds en partie à M. Moreau : nous en sommes à plus de 7 % de la SAU en bio. C'est une grande réussite du plan « ambition bio », lequel est doté de 1,1 milliard. M. Moreau a raison : entre le plan « ambition bio », les PCAE et le fonds « avenir bio », on pourrait avoir tendance à se mélanger les pinceaux... Or je ne pense pas que ce soit le cas, car chacun joue bien son rôle. Cela dit, il faut un pilotage encore plus clair et une volonté affichée de faire en sorte que la transition agroécologique soit la ligne directrice de ce ministère et de l'agriculture française – et, pour ce faire, que les conversions en bio soient de plus en plus nombreuses. Du reste, on voit bien que cela répond à une demande sociétale : de plus en plus de nos concitoyens veulent avoir des produits bio.
Je veux répéter, à ce propos, que l'alimentation, dans notre pays, est la plus saine et la plus durable que l'on puisse avoir sur la planète. L'alimentation issue de l'agriculture française, qu'elle soit bio ou pas, transformée industriellement ou pas, est de grande qualité. Je tiens à le souligner car, tout en étant un fervent défenseur et promoteur du bio et de la transition agroécologique, je ne veux pas laisser dire – mais personne ne l'a fait ce soir – que tout ce qui ne serait pas bio ne serait pas de la bonne qualité, car n'est pas vrai ! En Europe, et ailleurs dans le monde, beaucoup de pays nous envient la qualité de notre alimentation.
Monsieur Moreau, vous avez évoqué le transfert de 4,2 % du premier pilier vers le second pilier. Je souhaite que, dans la négociation que nous menons concernant la PAC, nous n'allions pas plus loin : certains équilibres doivent être respectés. Il faut absolument que le premier pilier – les aides directes – soit préservé. Il y va de la résilience de nos exploitations. Nous travaillons en outre sur l'eco scheme : la position de la France, et de beaucoup de pays, consiste à dire que l'eco scheme doit être obligatoire dans le premier pilier – aux alentours de 20 %. Le mieux étant l'ennemi du bien, il vaut mieux s'assurer que nous fixons un niveau raisonnable plutôt que de vouloir aller trop loin. Nous devons avancer dans cette direction.
En ce qui concerne les produits phytosanitaires, je suppose que M. Potier aura des questions à poser : j'y reviendrai donc tout à l'heure...
Je me suis exprimé dès ma nomination, en octobre dernier, au sujet des TO-DE. Je souhaite que le dispositif soit pérennisé.
Je proposerai donc qu'il soit inscrit au budget. Ce n'était pas une bonne chose de le supprimer, parce que nous avons beaucoup d'entreprises qui emploient de la main-d'oeuvre saisonnière, dans les Hautes-Alpes comme ailleurs.
Il y en a encore plus dans les Hautes-Alpes et dans le Vaucluse que dans la Drôme ! Dans toutes les régions où le maraîchage et l'arboriculture sont importants, le phénomène est particulièrement prégnant – sans oublier, évidemment, les régions viticoles.
Nous vous proposerons donc, mesdames et messieurs les députés – je ne sais pas si vous le voterez –, de pérenniser du dispositif TO-DE.
Vous avez parlé des vendanges abondantes, monsieur le rapporteur général : c'est effectivement ce qui s'est passé. Nous avons été, en quelque sorte, dépassés par notre succès. Nous verrons ce que l'analyse fine nous révélera, mais la principale explication de l'augmentation des TO-DE est bien celle que vous avez donnée : l'année dernière, nous avons eu la chance – car c'est bel et bien une chance pour notre pays – que les vendanges se soient très bien passées, ce qui a nécessité beaucoup de main-d'oeuvre.
Je ne suis pas en mesure de vous répondre immédiatement concernant le PIF. Je vous propose de vous faire passer une note un peu plus tard.
Tout le monde est d'accord pour supprimer les niches fiscales...
Sauf la sienne, ou celle qu'un membre de votre groupe aurait un bon argument pour ne pas supprimer... J'ai connu cela pendant des années. Au bout du compte, il y a toujours une bonne raison pour ne pas supprimer une niche fiscale. Ce n'est sûrement pas une bonne chose. Il y en a certaines dont on ne sait plus pourquoi elles ont été mises en place ni à quoi elles servent. C'est plutôt à celles-là qu'il faudrait s'attaquer. De toute façon, pour l'établissement du budget de l'année 2020 – au ministère de l'agriculture comme dans d'autres –, compte tenu des engagements du Président de la République, notamment la baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, nous devons chercher des sources d'économie. Nous sommes en train de travailler dans tous les domaines, aussi bien en ce qui concerne le budget du ministère que les niches fiscales, pour essayer d'être dans l'épure au mois de juillet, au moment où le Premier ministre nous fera ses propositions.
Elles le seront. Quoi qu'il en soit, je veux le redire ici : lorsqu'on s'attaque aux niches fiscales, on s'attaque à la fois à tout le monde et à personne.

Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir fait preuve de transparence au sujet de l'ASP. C'est important et nous comptons vraiment sur vous pour que le retour à la normale se poursuive effectivement. Quand on est sur le terrain, avec nos agriculteurs, on voit bien qu'il s'agit d'un problème prégnant et qui devient pour ainsi dire intolérable. Nous comptons donc sur vous pour faire en sorte que nous puissions enfin dire, un jour, que nous sommes à jour pour ce qui est de nos paiements aux agriculteurs.

Rapidement, je l'espère !
Ensuite, j'ai bien entendu ce que vous avez dit au sujet des TO-DE. Personnellement, je serais ravie si vous proposiez effectivement à la fin de l'année, dans le cadre du budget, de les pérenniser. Il faut sortir de cette histoire par le haut ; la pérennisation sera certainement bienvenue. Ensuite, nous en étudierons ensemble les modalités, bien entendu.
Enfin, s'agissant des niches fiscales, chaque rapporteur spécial de la commission des finances met un point d'honneur à regarder, dans la mission dont il est chargé, quelles sont les niches fiscales qui peuvent être réduites. Il s'agit là véritablement d'un objectif de notre commission. Nous vous remercions donc aussi de faire ce travail au niveau de votre ministère.

Le programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation a pour objet de garantir la qualité et l'état de salubrité des végétaux, des animaux et des aliments destinés à la consommation humaine.
L'exécution de ce programme est confiée à la direction générale de l'alimentation ainsi qu'à un opérateur, l'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Celle-ci s'est d'ailleurs vu confier, en 2018, de nouvelles expertises. La politique de la sécurité alimentaire en France relève notamment d'un protocole de coopération entre la direction générale de l'alimentation, sous tutelle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui relève du ministère des finances, et la direction générale de la santé, qui agit pour le compte du ministère des solidarités et de la santé.
Le contexte budgétaire du programme 206 est particulier, car ses crédits sont largement dédiés à l'intervention publique lors des crises sanitaires – c'est un sujet qui est commun avec l'un des programmes dont il a été question précédemment. Ces dernières années, notamment en 2016 et 2017, les dépenses ont fortement varié à la hausse à cause de plusieurs crises majeures, comme celle du virus de l'influenza aviaire, hautement contagieux, qui a provoqué une augmentation des dépenses pour l'indemnisation des éleveurs à la suite de l'abattage des animaux atteints.
Par ailleurs, la crise des laits infantiles produits par l'entreprise Lactalis a conduit à la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale ; celle-ci a conclu à la nécessité d'un réaménagement des responsabilités administratives concernant la sécurité alimentaire au profit de l'opérateur principal.
Depuis, des dispositifs ont été mis en place pour couvrir les dépenses supplémentaires en anticipant les conséquences de ces crises alimentaires.
Le programme 206 a vu ses crédits portés à 554,1 millions d'euros en autorisations d'engagement et 552,4 millions d'euros en crédits de paiement, soit une augmentation de 9 % par rapport à la LFI 2017. Nous avions déjà signalé l'an passé l'effort important de sincérité de ce budget, jusqu'alors systématiquement sous-doté. Cette hausse des crédits porte en particulier sur les actions de prévention et de gestion des risques liés à la production végétale, aux denrées alimentaires et aux maladies animales. Contrairement aux précédents exercices, l'exécution de la mission est proche des montants figurant en LFI qu'elle ne dépasse que de façon limitée ; la Cour des comptes souligne d'ailleurs un retour à la normale du budget consacré à la sécurité alimentaire. Le programme 206 voit donc son exécution diminuer de 105,8 millions – 28 % – par rapport à 2017, en raison de la baisse du nombre de crises animales.
Des dépenses supplémentaires sont induites par les épidémies passées qui ont été couvertes en exécution 2018 : la mission a bénéficié de 99,6 millions d'euros en crédits de paiement de report de crédits généraux destinés à couvrir la gestion des épidémies survenues en 2016 et 2017, principalement l'épidémie d'influenza H5N8, pour 29 millions d'euros. En 2018, le programme 206 a bénéficié de fonds de concours tardifs à hauteur de 13,6 millions d'euros, correspondant au remboursement des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de l'épidémie d'influenza aviaire.
En 2018, l'action n° 2 Lutte contre les maladies animales et protection des animaux a surconsommé ses crédits de 13 millions d'euros, en raison de la recrudescence de la tuberculose ovine et de la gestion des maladies liées au virus influenza ou à la fièvre catarrhale ovine (FCO). Les dépenses d'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus se sont élevées à 18 millions d'euros.
Malgré les bons résultats liés à la baisse relative de la crise sanitaire et au recouvrement des dépenses de gestion d'épidémies des années précédentes, des sous-exécutions sont à relever : ainsi, on rencontre des difficultés récurrentes à recruter des effectifs de vétérinaires à hauteur des besoins sur certaines missions, par exemple pour le contrôle sanitaire en abattoir. C'est une source d'interrogations. Bien sûr, les associations de défense du bien-être animal y sont attentives.
En 2018, le budget consacré à la lutte contre la pyrale du buis n'aura atteint que 100 millions d'euros, alors que c'est une menace extrêmement forte pour le buis en France, si bien que l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) tire la sonnette d'alarme en appelant l'attention sur le temps nécessaire pour mettre en application les solutions de biocontrôle. L'entreprise M2i a obtenu l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de son produit de confusion sexuelle pour lutter contre la pyrale du buis. Cet exemple me conduit au sujet de mon thème d'évaluation, à savoir la montée progressive du biocontrôle.
Les techniques émergentes du biocontrôle offrent de belles perspectives, mais de nombreux freins subsistent. Il est tout d'abord difficile de remplacer les produits phytosanitaires qui sont très efficaces et bon marché. Malgré la forte demande des citoyens français et les efforts du Gouvernement pour faire émerger une agriculture différente, il est compliqué pour les agriculteurs de changer rapidement leur modèle agricole. De ce fait, les différents plans Écophyto se sont soldés par un échec.
Ce développement trop lent s'explique également par les freins institutionnels et législatifs au niveau national et européen : par exemple, il n'y a pas encore de définition partagée du biocontrôle au niveau européen.
La législation à laquelle nos entreprises sont soumises ne leur permet pas de développer et propager les techniques de biocontrôle. Ainsi, l'entreprise M2i nous a affirmé, lors d'une audition, qu'aux États-Unis il suffisait de 150 000 dollars pour placer un produit de biocontrôle sur le marché, alors qu'il faudrait près de 3 millions d'euros en Europe en raison des contrôles successifs et des autorisations sanitaires nécessaires.
Enfin, le biocontrôle ne répond pas nécessairement aux attentes à court terme des agriculteurs. Dès lors, il est difficile d'attendre qu'ils abandonnent leurs techniques actuelles en sacrifiant une part de leurs rendements. Le biocontrôle n'offre pas toujours un produit de substitution ad hoc ; il suit surtout une logique de long terme qui peut être contraire aux logiques du marché et des besoins actuels des agriculteurs.
Pour réussir, une volonté politique doit accompagner les agriculteurs, les doter des outils nécessaires pour embrayer la transition et répondre pleinement aux demandes de nos concitoyens, inquiets des questions sanitaires et alimentaires.
Le budget du programme 206 est revenu à l'orthodoxie budgétaire, mais il faut appuyer son orientation pour satisfaire nos objectifs.
J'en viens maintenant à quelques questions.
La programmation de la LFI 2018 est davantage en phase avec son exécution que les années précédentes, mais ce n'est pas le fait d'économies du programme 206. Peut-on prévoir des économies sur ce budget, qui concerne surtout une gestion de crises ?
Quelles sont les pistes concrètes dont dispose le Gouvernement pour encourager le biocontrôle ? Lors des auditions et dans les différents rapports portant sur le biocontrôle, la lourdeur de la réglementation relative à la mise sur le marché de nouveaux produits a été critiquée. Le Gouvernement va-t-il encourager le processus de diffusion du biocontrôle et par quels moyens ?
La crise de Lactalis a mis en évidence l'intérêt d'un opérateur étatique principal, chef de file en quelque sorte pour contrôler la chaîne complexe de la sécurité alimentaire. Où en sont les réflexions du ministère à ce sujet ? J'avais déjà posé la question l'an dernier.
Le plan Écophyto a été aménagé à plusieurs reprises pour que ses objectifs soient remplis. Comment faire pour en améliorer les résultats ?
Enfin, les associations et certains rapports déplorent le manque de personnel dans les abattoirs, notamment vétérinaires qui doivent être présents en vertu de la réglementation européenne. L'année 2018 voit une sous-exécution du budget dans ce domaine. Comment faire pour augmenter le nombre de vétérinaires dans les abattoirs ?
En matière sanitaire, il y a toujours une part d'aléas : la somme prévue dans le budget peut ne pas être utilisée ou au contraire se révéler insuffisante, comme ce fut le cas avec l'influenza aviaire et la FCO. Le vide sanitaire qui a été nécessaire pendant deux saisons dans le sud-ouest, ce qui n'était pas prévu, a coûté très cher aux éleveurs, aux accouveurs ainsi qu'à l'État. La peste porcine africaine n'était pas non plus prévue ; il a fallu trouver un peu plus de 5 millions d'euros. Les mesures de biosécurité ont été prises pour tous les élevages de France, et notamment pour ceux de votre région, Mme Cariou. Un dicton français dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir : l'État l'a repris à son compte en ayant toujours été présent lorsqu'il a fallu faire face à des crises sanitaires.
La question de la présence des vétérinaires dans les abattoirs est très ardue, très compliquée. Je le réaffirme ici, même si ce n'est pas l'objet de la présente audition : il y en a marre des intrusions dans les abattoirs et les élevages, il y en a marre de ces films !
C'est compliqué, un abattoir, parce qu'on y met à mort des bêtes. Toute la difficulté est de trouver des gens qui veulent y travailler, aussi bien des salariés que des vétérinaires. Je me suis engagé, abattoir par abattoir, département par département, à augmenter le nombre de vétérinaires dans certains abattoirs que nous avions identifiés. Quant à la mission sur les abattoirs, elle va bientôt rendre son rapport.
Près de 2 000 agents sont mobilisés dans les abattoirs ; l'ensemble du plafond d'emplois du programme 206 a été consommé en 2018. Mais il en faudrait davantage. Le travail réalisé par les vétérinaires dans les abattoirs est absolument indispensable. Autant je trouve inacceptables les intrusions, les attaques et l'incendie qui a eu lieu dans un abattoir de l'Ain, que le Gouvernement condamne totalement, autant je ne transige pas sur le bien-être animal, la lutte contre la maltraitance et le travail qui doit être fait dans les abattoirs. C'est pourquoi j'y consacrerai le plus de moyens possibles.
Beaucoup d'associations critiquent le manque d'effectifs dans les abattoirs, mais il n'y a pas un seul abattoir en France où il n'y a pas de vétérinaire pour contrôler. Certes, ils ne sont pas présents du début à la fin de la chaîne, ni du matin au soir, mais les contrôles sont faits et bien faits. Malgré le respect des règles de la protection animale lors de l'arrivée et de la mise à mort des animaux, les actes pratiqués sont tout de même violents. C'est pourquoi ils doivent être contrôlés.
J'ai rencontré l'ensemble des associations wellfaristes avec lesquelles nous allons continuer à travailler. Je souhaite vraiment renforcer nos relations avec les organisations non gouvernementales, notamment avec celles qui travaillent de façon positive, mais pas avec celles qui commettent les actes dont je viens de parler. Le 24 mai dernier, avec M. Guillaume Garot, le président du Conseil national de l'alimentation, nous avons pérennisé le Comité national d'éthique des abattoirs. C'est sur cette base que le Gouvernement décidera des actions très fortes en faveur du bien-être animal, à la rentrée de septembre. Mais sachez, monsieur le rapporteur Lauzzana, que nous rencontrons des difficultés pour trouver des vétérinaires.
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a vraiment la volonté de développer le biocontrôle. J'ai eu l'occasion de rencontrer les associations, les instituts, et notamment l'INRA qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Les solutions de biocontrôle représentent aujourd'hui environ 5 % du marché de la protection des plantes. Ce n'est pas suffisant, mais c'est une avancée. Vous avez relevé la complexité du dossier et la lourdeur de la réglementation, et vous avez raison. C'est pour cette raison qu'une stratégie nationale de biocontrôle sera soumise au débat public cet été, car nous devons aller beaucoup plus loin, notamment en mobilisant plusieurs leviers.
Premièrement, il faut réduire de moitié les délais d'évaluation de l'octroi des AMM par l'ANSES, qui sont aujourd'hui de douze mois. Deuxièmement, il faut fixer une taxe réduite pour les fabricants, en la ramenant de 50 000 euros à 25 000 euros. Troisièmement, il faut alléger la réglementation. S'il est normal que des contrôles soient effectués et que les AMM soient structurées et contrôlées, il faut aussi donner la possibilité aux entreprises de faire de la recherche. On a parfois le sentiment qu'il est très compliqué d'avancer dans cette direction. C'est pourquoi j'appelle à la définition d'un cadre réglementaire clair et allégé au niveau européen.
Vous avez évoqué la sécurité sanitaire et l'affaire Lactalis. Comme vous l'avez dit, une mission interministérielle vient d'être lancée. Il faut évidemment un contrôle unique : c'est ce que nous faisons et nous ferons en sorte que les choses se passent le mieux possible.
Vous avez parlé de l'échec des plans Écophyto.
Non, il y a eu le plan Écophyto 1, le plan Écophyto 2 et le plan Écophyto 2+. Mais peu importe.
C'est un échec si l'on considère que l'on a acheté davantage de produits phytopharmaceutiques ces trois dernières années que les trois années précédentes, mais ce n'en est pas un dans la mesure où toutes les filières agricoles sans exception ont désormais la volonté de sortir de la dépendance à tous les produits phytosanitaires et pas seulement au glyphosate, qui est la face émergée de l'iceberg. Nous avons mis en place le comité d'orientation stratégique et de suivi du plan Écophyto, coordonné par le délégué interministériel, le préfet Pierre-Étienne Bisch, dans lequel les quatre ministères sont présents. Il y a à la fois une volonté politique, une volonté associative et une volonté du monde agricole. Mais si les choses ne vont pas aussi vite que le voudraient les citoyens, je veux rappeler qu'aucune autre filière économique n'a autant muté et n'a autant avancé que l'agriculture.
Au siècle dernier, on lui a demandé de produire, toujours produire, de s'endetter, d'acheter toujours plus de grosses machines et d'utiliser des produits, et c'était normal, il n'y a rien à dire à cela car il fallait nourrir la France et l'Europe. Je ne montrerai jamais du doigt les agriculteurs sur ce sujet, car ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, et qu'elle soit bio, raisonnée ou conventionnelle, l'alimentation française est de qualité. Mais dorénavant il faut passer du quantitatif au qualitatif, ce qui nécessite des investissements et de la formation. C'est la raison pour laquelle nous changeons la base des formations de nos 800 établissements agricoles pour faire différemment. De grâce, finissons-en avec la théorie du bouc émissaire, cessons de montrer du doigt le paysan et de le traiter d'empoisonneur, de pollueur ou de je ne sais trop quoi : lui aussi est dans les champs, lui aussi vit dans l'air qu'on respire, il n'a pas envie de polluer ni de s'intoxiquer. Personne ne nie les difficultés qui ont été rencontrées, mais nous sommes désormais dans la transition agroécologique.

Vous avez eu raison de rappeler l'histoire que beaucoup de nos concitoyens oublient et condamnent immédiatement. Quand on veut changer les comportements, il faut de l'accompagnement, non de la contrainte ou de l'interdiction, car la loi ne règle pas tout. C'est ce que nous essayons tous de faire pour réussir la transition agroécologique.

J'avais préparé une question au nom du groupe La République en Marche, mais comme elle vient d'être largement abordée, je ne la poserai pas ; je m'en voudrais de faire répéter au ministre ce qu'il vient de répondre.

Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre plaidoyer pro domo en faveur de l'agriculture française. Ça fait du bien d'entendre de tels propos !
Les établissements techniques agricoles, privés ou publics, sont un atout pour nos territoires. Toutefois, certains établissements rencontrent des difficultés budgétaires du fait d'une baisse de leurs effectifs, notamment dans les maisons familiales rurales (MFR), ce qui entraîne une baisse de leurs subventions. Ces difficultés peuvent être aggravées en cas de retard dans le versement des subventions, comme c'est le cas d'une MFR de ma circonscription.
Existe-t-il, au sein du ministère de l'agriculture, des mécanismes de soutien des établissements en difficulté financière ? Avez-vous pu récupérer le retard dans le versement des subventions, notamment à destination des MFR ? D'une façon plus générale, quelle est, selon vous, la place qu'occupe l'enseignement agricole dans le secteur public de l'éducation ? Que pouvez-vous répondre à des enseignants des établissements agricoles qui expriment des craintes quant à la pérennité de leur activité en milieu rural ?

Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos propos.
Ma première question concerne les retards de paiement des aides agricoles qui se sont accumulés depuis 2016, en particulier s'agissant des aides bio. Qu'en est-il de ces retards et des contentieux qui ont été engagés, certains agriculteurs ayant assigné en justice l'État pour obtenir réparation à la suite du préjudice subi par sa défaillance ? Quel indicateur vous permet de mesurer les performances de l'organisme de paiement ?
Ma seconde question a trait aux projets de méthanisation qui se développent dans l'agriculture, qui permettent de valoriser des produits agricoles et de collecte et entraînent une diversification importante des activités de nos agriculteurs dans le cadre du changement climatique. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux des projets réalisés et des projets en cours ? Quels moyens de contrôle sont opérés au regard de la manière dont fonctionnent ces unités de méthanisation ?

Ma question concerne la filière sucrière, non pour évoquer la situation de quelques sucreries qui vont malheureusement fermer, mais pour connaître votre vision de ce secteur.
Un rapport de 2015 expliquait que la filière sucrière française était très bien armée pour tirer profit des changements de paradigme économiques et commerciaux à venir. En réalité, on se rend bien compte aujourd'hui que la situation a fondamentalement changé avec l'émergence de l'Inde et de la Thaïlande comme acteurs majeurs, le Brésil demeurant l'un des acteurs traditionnels de ce secteur.
Quelle est votre analyse de la situation du secteur sucrier, à la fois au niveau mondial et européen ? Que pensez-vous du plan de compétitivité proposé par les acteurs de la filière betteravière ? Pensez-vous alerter la Commission européenne pour qu'elle réfléchisse à un plan de sauvegarde du secteur sucrier face à la crise actuelle ?
L'attitude actuelle du Brésil, qui transforme une bonne part de son sucre en éthanol, montre qu'il y a une belle complémentarité entre les deux secteurs. Que pouvez-vous nous dire du débouché que constitue l'éthanol en France ?

Je tiens à rappeler que nous sommes dans le cadre du Printemps de l'évaluation : le but de l'exercice est d'évaluer les politiques publiques et non de poser des questions qui ouvrent des débats.

Je suis terrifié à l'idée de ne pas être dans le cadre du Printemps de l'évaluation... Je rappelle que l'on n'évalue pas uniquement les finances, mais une politique dans son ensemble. En tout cas, c'est comme cela que je l'avais compris...
J'aurais souhaité évoquer avec vous différentes questions, comme le piètre résultat de la loi ÉGALIM, les négociations commerciales, l'alerte des communes qui seraient abandonnées potentiellement par l'ONF, la menace que constituent les négociations du Mercosur sur le secteur de la viande, les inquiétudes qui naissent sur nos territoires par rapport à une méthanisation trop mal encadrée, le besoin urgent, à la veille d'aborder un texte de loi sur le foncier, de prendre des mesures d'urgence pour cesser l'inflation de dérives que signale l'observatoire du foncier réuni par la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) la semaine passée.
J'aimerais rétablir une vérité : il n'y a pas eu deux plans Écophyto, mais un plan Écophyto 1 révisé. Le plan Écophyto 2, il n'a jamais été mis en oeuvre, et le plan Écophyto + est simplement un ajout assez cosmétique du plan Écophyto 2, qui a été enlisé pendant trois ans. Le Gouvernement alors au pouvoir en a une responsabilité, tout comme celui qui a suivi.
Monsieur le ministre, je tiens à saluer votre ligne sur le glyphosate. Vous vous affranchissez de d'hystérie générale en proposant une démarche globale de moindre dépendance à la phytopharmacie, de désarmement des solutions chimiques vers d'autres solutions. Cette position est salutaire, tout comme l'est votre enthousiasme pour la haute valeur environnementale. Nous sommes fiers d'avoir porté cet amendement dans la loi ÉGALIM. À côté du bio qui ne pourra pas supporter l'ensemble des transformations agroécologiques, la haute valeur environnementale est un élément très précieux.
Je souhaite vous interpeller vivement sur la seule mesure contraignante du plan Écophyto 2, que vous avez supprimée par ordonnance. J'avoue, après trois pages d'écriture et de multiples relances qui n'ont pas obtenu de réponses, avoir eu la chance d'entrer dans une discussion avec vous sur cette ordonnance. J'ai dû, avec le soutien du groupe Socialistes et apparentés, déposer un recours devant le Conseil d'État pour dénoncer ce que nous considérons comme un excès de pouvoir. Nous connaissons notre controverse politique sur ce sujet ; vous avez vous-même à subir l'exercice d'une promesse présidentielle qui sera certainement peu efficiente en la matière, mais j'aurais souhaité au moins que les droits du Parlement en la matière soient respectés. C'est le sens de la démarche que je tenais à rappeler dans le cadre de cette semaine de l'évaluation.

Les ministres de l'agriculture successifs ont beau clamer que leur objectif est de libérer la capacité d'entreprendre des agriculteurs, protéger les consommateurs et retrouver de la cohérence et de l'éthique dans les relations commerciales entre les fournisseurs de matières premières que sont les paysans, les transformateurs de l'industrie agroalimentaire et les distributeurs, la réalité est tout autre : nous en avons l'illustration avec la loi ÉGALIM, qui promettait d'inverser la construction des prix en partant des coûts de production. Nous avions alerté sur le fait que ce texte risquait d'accroître le déséquilibre du rapport de force commercial au détriment des agriculteurs, et le fait est qu'on observe que les premiers effets de cette loi se soldent par une déflation des prix de 1,5 à 4 % par rapport à 2018, des contournements de la loi, des pressions et menaces de sortie des produits.
Selon l'observatoire des négociations commerciales, 96 % des entreprises alimentaires interrogées à partir d'un panel de plus de 450 entreprises de toutes tailles et tous secteurs estiment que la situation avec la grande distribution n'est pas meilleure, voire qu'elle s'est dégradée par rapport à l'an passé. 71 % des entreprises de l'agroalimentaire ont aussi formulé des demandes de hausses de prix qu'elles justifient par la hausse des coûts des matières premières agricoles, demandes qui n'ont pas été prises en compte. S'appuyant sur ces données, l'Association nationale des industries alimentaires s'indigne de la situation, pointant des demandes de baisse de prix systématiques de la grande distribution à l'encontre des entreprises alimentaires, des pressions, du chantage, des menaces de sortie de rayons pour les produits si les entreprises n'acceptent pas les conditions imposées.
Acheter au prix toujours le plus bas reste le seul leitmotiv des distributeurs, aidés en cela par le dumping social et environnemental qui sévit en Europe. Même si vous reconnaissez, monsieur le ministre, que la guerre des prix continue, par exemple dans le secteur du lait, et qu'en dépit des accords passés par plusieurs industriels avec la grande distribution, rien n'est entrepris pour enrayer cette logique destructrice pour nos paysans, pour la qualité de notre alimentation et pour l'environnement, comme en témoigne la gestion des accords de libre-échange que sont le Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ou l'accord avec le Mercosur que le Gouvernement continue de soutenir contre toute logique économique et environnementale.

Ma première question porte sur l'efficacité du dispositif d'exonération de cotisations sociales pour les TO-DE. Vous souhaitez vous battre pour le maintenir, tandis que d'autres veulent le supprimer. Mais est-il compatible avec le droit de l'Union européenne ? Le TO-DE avait pour objectif de compenser le coût de la main-d'oeuvre par rapport à nos concurrents européens. Or votre rapport annuel de performances (RAP) montre que l'on continue à perdre des parts de marché à l'international, notamment dans le secteur des fruits et légumes, ce qui peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui vient de la Drôme. Ne conviendrait-il pas au contraire d'accentuer le dispositif au lieu de seulement le maintenir ?
Ma deuxième question concerne un problème budgétaire. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'on avait dépensé 540 millions d'euros alors que 482 millions d'euros avaient été inscrits, ce qui fait une différence de 58 millions. Si on les ajoute aux 64 millions de dettes constatées à la fin de l'année 2017, votre ministère doit 122 millions à la CCMSA. Allez-vous enfin régler les dettes ? Je ne sais pas si la dette ne continue pas à s'aggraver en 2019.
Ma troisième question porte sur l'incapacité à régler dans des délais raisonnables les subventions sur les MAEC et les aides à l'agriculture biologique. Comme vous l'avez rappelé, on vient juste de liquider les paiements de 2016. Comment a-t-on pu aboutir à une telle situation ?
S'agissant des refus d'apurement, et c'est ma quatrième question, il ne s'agit pas simplement de constater que cela nous a coûté 313 millions en 2017 et 91 millions en 2018, et 168 millions selon l'estimation de la Cour des comptes – vous avez parlé de 170 millions, ce qui est du même ordre de grandeur. Pourquoi en est-on arrivé là ? Quelles sont les causes du dysfonctionnement de votre ministère ? Beaucoup considèrent que c'est parce qu'on paye trop tardivement.
Cinquième question : il est tout à fait anormal que le RAP fasse état de la totalité du taux réduit de TICPE, qui est de 2,23 milliards, alors que la Cour des comptes parle, dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire qui relève de l'agriculture, de 850 millions d'euros. Puisqu'il y a une partie BTP, une partie transport, etc., il serait plus logique d'éclater la dépense fiscale plutôt que de l'inscrire en totalité dans une mission. Pourquoi ne vous battez-vous pas là-dessus ? Ne pensez-vous pas, au vu du climat actuel, qu'il faudrait plutôt essayer d'utiliser cette dépense fiscale pour encourager les économies d'énergie, notamment dans les matériels agricoles ?

Le RAP fait état d'une sous-exécution des crédits de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) de 455 000 euros. Y a-t-il une cause spécifique à cette sous-exécution ?
S'agissant de l'appui aux SAFER, la sous-exécution s'élève à 2 millions d'euros. On parle de redéploiement vers d'autres dispositifs. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ?

Il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu un ministre aussi convaincu et habité par sa fonction !

Tout à fait ! De temps en temps, cela ne fait pas de mal !
Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il est normal qu'il y ait des contrôles, ce que personne ne conteste. Mais comment peut-on faire pour desserrer l'étau ottoman du cadre réglementaire et de l'inflation normative en agriculture ? Nos paysans n'en peuvent plus de la paperasse. Essayez seulement de créer une retenue collinaire de 15 000 ou 20 000 mètres cubes, ce qui n'est pas pharaonique, pour stocker l'eau l'hiver qui, de toute façon dévalera la pente et finira dans la mer. Les années 1980 sont bien terminées : on n'est pas dans une logique d'intensification, mais bien de sécurisation du revenu des agriculteurs dans une période de dérégulation climatique.
Ma seconde question concerne l'avenir du TO-DE. C'est un dispositif qu'on a gagné dans l'hémicycle d'une voix, au mois de novembre dernier, contre l'avis du Gouvernement.

Tout à fait !
Que va-t-il se passer au-delà de 2019 ? Comment accompagner nos agriculteurs français qui subissent des distorsions de concurrence importantes en matière sociale et environnementale ? Il faut sans cesse rappeler que l'Allemagne n'a pas de SMIC agricole, et que les salariés y sont payés 6 euros de l'heure contre 12 en France. Moi qui ai suivi un enseignement agricole, je peux vous dire qu'il y a trente ans on ne parlait pas de l'Allemagne. Aujourd'hui, elle nous taille des croupières, y compris dans le secteur des fruits et légumes.
Tous les députés ont été saisis, dans leur circonscription, par des agents de l'ONF totalement déboussolés. Alors que la forêt française a besoin de cet office qui ne s'est peut-être pas encore remis de la tempête de 1999, entendez-vous l'appel au secours des agents de l'ONF de la Drôme et de l'Ardèche, mais aussi d'ailleurs ?

Il existe un vrai consensus en ce qui concerne l'équipement de panneaux solaires sur les toitures des exploitations agricoles. Une ligne spécifique est-elle prévue dans le budget de votre ministère, ou bien faut-il aller la chercher dans le budget du ministère de la transition écologique et solidaire ?
Le Premier ministre a annoncé sa volonté de favoriser la déconcentration des services des différents ministères de Paris vers la province et de la province vers les villes moyennes. On peut imaginer que, par définition, le ministère de l'agriculture se prête particulièrement bien à l'exercice. Sans rêver à une délocalisation du ministère dans la Drôme ou le Gers, une telle démarche a-t-elle été engagée dans votre ministère, et à quelle échéance ?

Ma question porte sur la gestion du domaine forestier de l'État en Guyane, et en particulier sur la non-application des dispositions de la loi de février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Voilà des années que, sur ces bancs, nous ne cessons de dénoncer la gestion du foncier guyanais par l'État, source de fortes frustrations localement, au point que cette question s'est retrouvée au coeur des revendications des mouvements sociaux de mars-avril 2017 qui ont vu des milliers de Guyanais crier leur ras-le-bol. Aujourd'hui, nous en arrivons à une situation extrêmement tendue qui pourrait dégénérer très rapidement si nous ne trouvons pas les moyens d'apaiser les relations entre administrés, élus locaux et l'ONF, gestionnaire de la forêt guyanaise pour le compte de l'État. En effet, lors de l'adoption de ladite loi, nous avons voté le principe selon lequel l'ONF serait désormais redevable de la taxe sur le foncier non bâti sur les forêts qu'elle exploite. En réalité et dans les faits, à ce jour nos collectivités n'ont encore rien perçu. Bercy se retranche derrière la supposée complexité du dossier, alors que de l'aveu même des services fiscaux locaux et de l'ONF, ce n'est pas le cadastrage de la forêt guyanaise qui pose problème, mais bien la capacité de l'ONF à supporter cette nouvelle charge.
Monsieur le ministre, je vous saurais gré de bien vouloir m'informer de l'état d'avancement de ce dossier, alors même que nos collectivités ont littéralement la corde au cou face aux conséquences qui découlent de l'explosion démographique à laquelle elles doivent faire face.

Sans vouloir défendre la loi ÉGALIM à la place du ministre, je rappelle qu'elle n'a été adoptée qu'au mois de novembre dernier... Certes, tout n'est pas parfait, et j'invite d'ailleurs mes collègues à assister aux auditions de la commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, au cours desquelles ils pourront constater que le bilan est bien plus contrasté que ce qu'ils veulent bien en dire. Certaines industries agroalimentaires ont d'ores et déjà constaté un changement de mentalité.
Quant à la contractualisation sur les indicateurs de coûts de production, qu'on ne vienne pas nous dire qu'elle est inefficace alors qu'elle n'est pas encore pas mise en place, la profession ne s'en étant pas emparée. Tout cela ne va se faire par l'opération du Saint-Esprit... Les derniers indicateurs ont été arrêtés au 31 janvier, notamment sur les bovins à viande ; il est bien évident que les mesures n'ont pas encore eu le temps de se répercuter dans les cours de ferme, et je suis le premier à le regretter, parce qu'il y a urgence dans de nombreux domaines. On ne peut pas critiquer une loi si on ne s'est pas emparé de l'ensemble des outils qui la contiennent, notamment à l'article 1er du titre premier.
Le FNGRA a été sollicité en 2017 et 2018 à cause des sécheresses qui se sont multipliées ces dernières années. Or on voit que ses capacités de financement sont limitées. Ne faudrait-il pas s'interroger sur d'autres sources de financement ou d'autres mécanismes susceptibles de le remplacer ? Ne faudrait-il pas rechercher d'autres sources de financement pour le FNGRA, ou des mécanismes pour le remplacer ? Nous atteignons les limites de ce qu'il est possible de faire actuellement, et nous sommes obligés d'arbitrer entre les moins mauvaises solutions, car il est impossible de compenser la totalité des pertes annuelles sur l'ensemble du territoire.
Vos questions sortent un peu du domaine financier, mais après tout, l'évaluation peut porter sur tous les sujets, notamment les questions sociales et économiques.
L'enseignement agricole est une pépite. J'en ai fait une priorité dès mon arrivée à ce poste, mais d'année en année, de moins en moins de jeunes s'y inscrivent. Pendant dix ans, nous avons regardé nos lycées agricoles se vider de leurs élèves sans réagir. Heureusement que ces établissements comprennent des classes de seconde, première et terminale générale : sans elles, nous aurions dû fermer nombre d'entre eux.
Vous relayez à raison les craintes des enseignants et des parents d'élèves. J'essaie de les rassurer depuis que je suis arrivé, mais la situation est très compliquée. Nous avons décidé de ne fermer aucun établissement, aucune classe, mais il a fallu jouer sur les seuils car il y a moins d'élèves. Avec Muriel Pénicaud et Jean-Michel Blanquer, nous avons lancé une grande campagne de communication appelée : « l'aventure du vivant ». Ce fut un succès sur les réseaux sociaux, avec 12 millions de clics et de vues. Notre souhait est d'avoir 20 000 élèves supplémentaires dans les deux ans ; si nous n'y parvenons pas, nous serons obligés de prendre des mesures très difficiles.
Pourtant, l'enseignement agricole est le seul réseau présent dans toute la ruralité, avec des établissements publics, des établissements privés, et les MFR. Je ne fais aucune différence entre les lycées d'enseignement technique agricole publics, privés et les MFR, les trois forment la famille de la formation agricole, ils sont tout aussi importants les uns que les autres et jouent des rôles totalement différents. Je soutiens beaucoup les MFR car elles travaillent en zone rurale, et elles récupèrent des enfants qui n'iraient pas ailleurs. Le système d'internat obligatoire m'est particulièrement cher : sans ces MFR, beaucoup de ces enfants ne trouveraient aucun autre établissement d'enseignement. Où iraient-ils ?
En dehors d'un cas précis, que vous me spécifierez, il n'y a pas de problème de financement des MFR car je n'ai pas réduit leur dotation tandis que le nombre d'élèves diminuait. S'il y a un problème dans l'une de ces maisons, nous l'étudierons et nous le réglerons.
En revanche, nos lycées agricoles doivent être totalement réorganisés. Leur force tient aux fermes pédagogiques qui y sont rattachées, mais la plupart d'entre elles ont un problème d'équilibre économique – il faut appeler un chat un chat. Je travaille pour maintenir la viabilité et la résilience de ces lycées agricoles. Si un jour nous n'avons plus d'enseignement technique agricole, la France aura beaucoup perdu dans son offre de formation. Je rappelle que globalement, tous les mômes qui y entrent en sortent avec un emploi.
Le rapporteur spécial parlait tout à l'heure du manque de vétérinaires dans les abattoirs. Beaucoup de jeunes viennent dans l'enseignement agricole pour devenir vétérinaires, mais ils veulent faire vétos de ville, pas travailler en zone rurale. Je n'oppose pas les uns aux autres, mais cela pose un vrai problème.
Par ailleurs, n'oublions jamais l'enseignement supérieur et la recherche : la fusion en cours de l'INRA et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture va créer un grand centre de recherche qui sera leader en Europe, et l'un des premiers au monde.
On ne parlera jamais assez de la place de l'enseignement agricole dans notre dispositif, et je vous remercie de l'avoir évoquée.
Mme Louwagie, M. de Courson et plusieurs d'entre vous ont soulevé la question des retards de paiement. Je ne me réjouis pas qu'en 2019, nous ayons fini de payer les sommes dues au titre de l'année 2016, et 94 % de celles pour 2017, parce que les 6 % de bénéficiaires qui attendent toujours d'être payés, eux, ne se réjouissent pas du tout. Ce délai est dû à une défaillance informatique, mais je ne veux charger personne, ce n'est pas notre propos aujourd'hui.
J'ai eu l'occasion de le dire devant le Parlement, il faudra simplifier la prochaine PAC. Il y a 920 critères différents, ce n'est pas acceptable, ce n'est plus possible. Et qui dit 920 critères différents dit 920 dossiers... Dans les services de l'économie agricole des départements, les agents doivent détailler la saisie des dossiers au mètre carré près, territoire par territoire, en distinguant les zones de montagne, les zones urbaines, les zones humides, les zones à élevage, les élevages allaitants, etc. Il y a toujours une bonne raison d'ajouter un critère, et très objectivement, le Parlement n'est pas le seul à y avoir contribué. Il a beaucoup joué, car les parlementaires font remonter les demandes du terrain, et c'est bien normal. Mais les organisations professionnelles agricoles ont aussi bien alimenté la hausse du nombre de critères. Maintenant, il faut en réduire le nombre, sinon nous ne rattraperons pas le retard.
Je n'ai aucune nouvelle sur les contentieux en cours, nous verrons ce qu'il adviendra.
S'agissant de la méthanisation, un grand plan va être lancé. Lors du salon de l'agriculture, nous avons signé un document avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie. Il faut avancer sur les questions de viabilité, sur la taille du méthaniseur, l'injection dans le réseau et bien entendu l'aspect fiscal. Nous y travaillons et nous pourrons peut-être faire changer un peu la programmation pluriannuelle de l'énergie à ce sujet. La méthanisation et les biocarburants seront indispensables.
Monsieur Herth, vous avez parlé de la filière sucre. L'entreprise Südzucker a fait un choix de réorganisation économique terrible ; c'est sa responsabilité. Nous avons tous été contraints à des choix économiques difficiles ; mais ce qui est inacceptable de la part de cette entreprise, c'est qu'elle contourne les règles du plan de sauvegarde de l'emploi : elle ne ferme pas les entreprises, elle laisse quatre ou cinq salariés dans les sites, ce qui bloque tout. Et elle répond « niet » à la proposition de rachat à hauteur de 30 millions d'euros que lui a faite Franck Sander, le nouveau président de la Confédération générale des planteurs de betteraves !
Le sucre a un avenir, mais pas comme par le passé. Il y a une surproduction mondiale avec le Brésil et l'Indonésie, le cours du sucre est bas depuis plusieurs années et son évolution reste incertaine – je ne suis pas devin. Mais les économistes et les experts du secteur nous disent qu'en se réorientant, en faisant des sucres spéciaux, il existe encore des possibilités.
On oublie trop que dans les sucreries, il y a beaucoup de salariés, et des saisonniers. Je me suis rendu dans la sucrerie de Cagny il y a quelques semaines et j'irai bientôt à celle d'Eppeville. Quant à Südzucker, je le dis clairement, il va falloir qu'ils payent, et nous les ferons payer. Nous travaillons aussi avec Cristal Union, qui est en train de se restructurer. La filière sucre est en difficulté, mais ce n'est pas une filière du passé. Elle peut avoir de l'avenir si nous sommes capables de regarder ensemble comment la restructurer. La Commission européenne nous soutient, il n'y a aucun problème à ce niveau.
Monsieur Potier, Jean-Baptiste Moreau vous a partiellement répondu. Je m'inquiète de voir certains – je ne parle pas de députés – sembler se réjouir qu'ÉGALIM ne soit pas une réussite car l'argent n'est pas revenu dans les cours de ferme. L'intérêt supérieur de la nation et de l'agriculture ne suit pas l'intérêt politicien. Les ordonnances ont été signées en février, en mars et en avril ; certaines mesures ne sont pas encore en place, il est trop tôt pour dire qu'elles ne fonctionnent pas. Tout n'est pas négatif : il y a eu des avancées sur le lait et d'autres secteurs. La première année est-elle une réussite ? Non, car les négociations ont commencé le 1er décembre et les ordonnances ont pris effet au 1er février. On a toutefois senti un changement, une évolution est sensible. Mais cela ne va pas assez loin. J'ai rencontré le rapporteur de la commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, M. Grégory Besson-Moreau ; j'attends beaucoup des travaux de cette commission d'enquête. Il faut tout mettre sur la table. Il n'est pas possible qu'au départ des négociations commerciales, la grande distribution réclame des baisses de prix de 4 % tandis que les conditions générales de vente des industries sont de + 9 %, c'est ridicule. Nous sommes le seul pays en Europe et dans le monde à connaître cela, les choses vont évoluer.
Messieurs Dufrègne et Potier, vous avez évoqué les accords commerciaux avec le Mercosur, et le CETA. Mais dans quel monde vivez-vous ? Nous vivons dans un monde ouvert, un monde d'échanges économiques ; personne ne peut être contre les accords commerciaux.
La position de la France à l'égard du projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur est très claire : nous ne sommes pas opposés aux accords commerciaux internationaux, mais nous nous opposerons à celui-ci s'il met en cause les standards de notre agriculture, notamment notre filière bovine et notre filière sucre. À ce stade, les discussions sont menées par la commissaire européenne ; les États membres n'ont pas leur mot à dire.
Bien sûr. D'ailleurs la France a voté contre le mandat de négociation avec les États-Unis, car ce pays ne respecte pas les accords de Paris sur le climat. Nous avons d'ores et déjà annoncé que nous ne ratifierions pas un accord de libre-échange avec le Mercosur s'il mettait en cause les standards agricoles français, c'est aussi simple que cela. Mais on ne peut pas se dire contre les accords commerciaux : nous sommes contents de vendre de plus en plus de boeuf et de porc aux Chinois, et de vendre des produits transformés sur le marché mondial.
Je ne reviens pas sur la question du foncier ; vous serez saisis d'une proposition du Gouvernement dans les jours qui viennent.
Vous avez décidé d'aller en justice sur la question des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques ; nous verrons ce qu'il adviendra. Le Gouvernement a choisi de ne pas ajouter d'argent au détriment des agriculteurs.
Monsieur Dufrègne, vous ne pouvez pas dire que rien n'a été entrepris s'agissant des relations avec la grande distribution. Vous avez tous participé aux États généraux de l'alimentation ; tout le monde a trouvé que c'était une grande réussite. Ce n'est d'ailleurs pas cette partie de la loi ÉGALIM qui a été critiquée lors des débats à l'Assemblée nationale, mais plutôt la seconde : tout le monde était d'accord pour une meilleure répartition de la valeur, pour l'inversion des mécanismes de construction du prix, pour un meilleur équilibre commercial. Maintenant, battons-nous ensemble et faisons pression.
Reste un sujet très compliqué, que nous devons étudier de manière très poussée. On craignait, en portant le seuil de revente à perte à 10 %, de déclencher une inflation exorbitante sur les produits d'appel ; cela n'a pas été le cas, l'inflation est restée assez faible. Mais il faut avoir conscience qu'une hausse des prix pour le producteur peut entraîner une hausse des prix pour le consommateur, et l'assumer, sans chercher à jouer les uns contre les autres. Je refuse pour ma part de prendre le consommateur en otage face au paysan.
Le dispositif TO-DE, que plusieurs d'entre vous ont évoqué, est lié au problème de dumping social et fiscal des autres pays de l'Union. Comme l'a dit M. Brun, c'est tout de même dingue que les maraîchers allemands parviennent à fournir en France des produits moins chers que les maraîchers français, tout simplement parce qu'ils utilisent des travailleurs détachés de Pologne et d'ailleurs ! Même s'il ne durera pas autant que les impôts, le dispositif TO-DE est prévu pour durer un moment, il faut une harmonisation sociale dans les autres pays européens. J'ai expliqué à mon homologue espagnol qu'il n'était pas possible de continuer de la sorte. La France s'impose des mesures vertueuses pour éliminer le glyphosate et les pesticides, nous appliquons un salaire minimum et le dispositif TO-DE, pendant que d'autres font entrer en France des produits traités aux pesticides en employant de la main-d'oeuvre beaucoup moins chère. Tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation sociale et fiscale au niveau de l'Union européenne, on ne s'en sortira pas et nous aurons besoin du TO-DE. Je me suis exprimé là-dessus dès ma nomination au Gouvernement, l'Assemblée est allée au-delà du compromis que j'avais proposé, je l'accepte. Dans le PLF 2020, je vais proposer le maintien du TO-DE, mais pour les années suivantes, je ne serai peut-être plus là et vous non plus... On verra. En tout cas, il ne sera pas pérennisé de manière définitive.
Monsieur de Courson, vous avez raison au sujet des dépenses fiscales, et cela me fournit un bon argument pour les réunions d'arbitrages budgétaires qui se tiennent en ce moment. Je disais qu'il importait peu que les sommes soient rattachées à notre budget, mais je vais creuser la piste que vous évoquez, qui me semble intéressante. Le gazole pour les bateaux de pêche, ce n'est pas au ministère de l'agriculture, et pourtant, c'est nous qui gérons la pêche...
S'agissant de l'éco-énergie sur le matériel agricole, je regrette que la France ne dispose pas de filière d'agroéquipement ; j'en ai parlé à Bruno Le Maire. Je me suis rendu au SIMA, le salon mondial des fournisseurs de l'agriculture et de l'élevage, et je pense que nous avons un boulevard devant nous. Cela renvoie à ce que disait Dominique Potier : ces nouveaux matériels permettent de réduire de 70 ou 80 % l'utilisation des produits phytosanitaires.
Bref, qu'attendons-nous ? Le biocontrôle est indispensable, les agroéquipements aussi. Mais ils doivent être dimensionnés à l'échelle des entreprises agricoles françaises ; et pour l'instant, ce n'est pas encore gagné. Mais nous avons de la R&D et des acteurs privés qui font un travail remarquable, il faut les encourager. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères sur ce marché, mais beaucoup d'entreprises françaises ou autres peuvent faire ce travail.
Monsieur Jerretie, je répondrai par écrit à votre question sur les SAFER.
La filière équine est en pleine réflexion, nous avons signé le contrat d'objectifs et de performance de l'IFCE – le maire de Pompadour était d'ailleurs présent – et nous essayons de relancer la dynamique.
Monsieur Brun, le Gouvernement a accepté de relancer l'irrigation, et donc les retenues collinaires. La nouvelle instruction a été publiée, le financement par les agences de l'eau est possible, avec les collectivités locales. Il faudra peut-être encore un peu de temps, mais il a été demandé aux préfets, aux directions régionales de l'agriculture et de la forêt et aux agences de l'eau d'aller dans cette direction. On ne peut pas regarder tomber l'eau du ciel pendant six mois et la chercher les six autres mois de l'année. Mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi : nous travaillons sur la substitution, et vous rappelez à juste titre qu'en quinze ans, l'agriculture française a utilisé 15 % d'eau en moins. Cela montre que nous pouvons faire des progrès.
L'ONF est une entreprise publique formidable, et je souhaite qu'elle le reste. Nous allons travailler avec la Fédération nationale des communes forestières, qui critique beaucoup les décisions qui ont été prises, ainsi qu'avec l'ONF, ses salariés, ses délégués du personnel, et sa nouvelle direction. Nous nommerons un nouveau responsable de l'ONF dans les semaines à venir.
Monsieur Serville, la situation des bases cadastrales en Guyane est compliquée. Le montant dont l'ONF devra s'acquitter est en cours de stabilisation. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui est une obligation légale, pourrait – je parle au conditionnel – être acquittée en 2019 au titre de 2018.
Monsieur Cazeneuve, la question des panneaux solaires relève du ministère de la transition écologique et solidaire, mais je ne me désintéresse pas des économies d'énergie dans les bâtiments agricoles. Le budget de l'agriculture ne prévoit pas de ligne budgétaire à cette fin, mais il sera peut-être possible d'avoir recours GPI 2018-2022.
La déconcentration des services répond à une volonté forte du Président de la République. S'il est un département qui est en contact avec le monde rural, dans tous les territoires, c'est le ministère de l'agriculture. Nous n'allons pas déménager les ministères en province, mais déplacer des missions et des agents pour qu'ils travaillent au plus près du terrain, c'est une piste intelligente et nous y travaillons.
Monsieur Moreau, vous avez raison, les aléas climatiques et les crises agricoles vont être de plus en plus sévères. Le FNGRA ne pourra pas continuer à tout supporter, par manque de moyens, c'est la raison pour laquelle nous devons travailler dans la PAC 2021-2027 pour placer l'assurantiel au coeur du dispositif. Aujourd'hui, les assurances fonctionnent dans certaines filières, mais leur coût est beaucoup trop élevé. L'agriculture est le seul secteur où il n'existe pas d'assurance obligatoire. Nous devons prévoir une vraie assurance et réassurance obligatoire et interfilière, nous y travaillons. Et dans le cadre du second pilier de la PAC, il faut absolument faire en sorte que les aides puissent être employées à cette fin.

Merci, monsieur le ministre, de ces réponses fournies, riches et constructives, et pour votre force de conviction et votre engagement. Le monde agricole a beaucoup de chance de vous avoir comme ministre...
La commission, réunie en commission d'évaluation des politiques publiques, entend ensuite Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et M. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales.

La mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT), qui regroupe les programmes 119 et 122, ne représente que 3,4 % des flux financiers de l'État vers les collectivités territoriales. Mais cette mission demeure très importante localement pour le soutien à l'investissement. Ce soutien à l'investissement constitue-t-il une vraie politique nationale déconcentrée ?
Un point rapide sur l'exécution budgétaire montre que les crédits sont stables : 3,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE) et 3,5 milliards en crédits de paiement (CP) ont été consommés en 2018.
Je concentrerai mon propos sur le programme 119, qui retrace les dotations de soutien à l'investissement.
Une évolution est notable : la hausse de 5,39 % de la consommation de CP par rapport à 2017. Cette augmentation résulte de la montée en puissance des dotations de soutien à l'investissement, notamment de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Ces dotations impliquent par construction une consommation différenciée en AE et en CP ; la consommation des CP s'ajuste progressivement à la prévision, avec la couverture des AE engagées dans les années antérieures sur les projets d'investissement sélectionnés.
Il n'y a donc pas de problème de soutenabilité budgétaire. Mais j'appelle l'attention sur les restes à payer, comme l'a fait la Cour des comptes : le rapport annuel de performances montre que 3,7 milliards d'euros d'AE restent consommés mais non couverts par des paiements au 31 décembre 2018. Cela correspond presque à une année de CP sur la mission complète.
Ma première question est la suivante : avons-nous le détail territorial ou thématique de ces restes à payer ? Un délai raisonnable est-il prévu pour les apurer ?
Mon second point porte sur la mission des dotations de soutien à l'investissement. Nous nous sommes spécialement attachés à la DSIL, dont nous nous sommes engagés à assurer un suivi annuel, et à la dotation pour la politique de la ville (DPV).
La hausse des AE – 615 millions d'euros dont 521,8 d'AE consommées – conforte la DSIL, et atteste que les engagements ont été pris cette année. Il en va de même pour les CP : 456,3 millions d'euros étaient engagés, dont 389,5 millions ont été consommés, soit plus du double de l'année précédente. Ce suivi nous permet de constater que l'effectivité de la consommation des crédits de paiement est conforme à la montée en puissance de la DSIL, ce qui valide cette solution pour les années à venir.
Nous proposons de faire un état thématique des crédits restants et des crédits engagés dans la DSIL. Celle-ci entrant dans sa quatrième année, nous pouvons faire une évaluation mieux consolidée de cette DSIL et des CP engagés, par thématiques des politiques nationales.
Seconde dotation sur laquelle je souhaite m'attarder, la DPV a été créée en 2015 pour soutenir l'investissement dans les communes urbaines en difficulté. Elle a une dimension péréquatrice et a été pensée en lien avec la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et les coeurs de ville ou les quartiers des politiques de la ville qui nécessitent un rattrapage en matière d'investissements.
L'investissement est le motif à l'origine de la création de la DPV, mais en 2018, 11 % de ses crédits financent des dépenses de fonctionnement et non l'investissement. Cette évolution fait suite à une modification législative de 2016, la mise en place de la contribution au redressement des finances publiques et la baisse des dotations ayant imposé de compenser les dépenses de fonctionnement de certaines communes.
L'analyse que nous avons menée avec les services préfectoraux et ceux du ministère fait apparaître que l'utilisation de ces fonds pour des dépenses de fonctionnement est concentrée dans quelques communes. Nous souhaitons clarifier cet élément et consolider le régime juridique de la DSIL, de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), de la DPV et de la future dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) pour les orienter vers l'investissement, dont l'effet multiplicateur est très important.
Je conclurai sur l'importance de la démarche de performance. Si les résultats sont satisfaisants, les indicateurs ne concernent que la DETR. Nous proposons donc d'élargir ces indicateurs aux quatre dotations d'investissement : la DSIL, la DPV, la DETR et la DSID. Il faudrait également enrichir les indicateurs existants, par exemple en présentant clairement l'effet de levier qui résulte des subventions pour voir leur effet multiplicateur sur les territoires.
Enfin, il serait utile de trouver un nouvel indicateur qui intégrerait les économies de fonctionnement dégagées grâce des investissements financés dans le contexte de la transition énergétique.
Nous avons aujourd'hui une vraie politique nationale déconcentrée : la politique de l'investissement local en application des politiques nationales. Les relations avec les collectivités territoriales étant très orientées vers l'investissement, ne serait-il pas opportun d'y incorporer le volet du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) géré par les préfets pour aider l'investissement local, suivant la logique qui a présidé à la création de la DSIL, de la DETR, de la DPV et de la future DSID ?

Le thème d'évaluation retenu cette année est la solidarité financière dans les dotations de l'État au bloc communal.
Il nous a conduits à nous intéresser à la dotation globale de fonctionnement (DGF). Celle-ci n'est pas incluse dans les crédits de la mission RCT, puisque c'est un prélèvement sur recettes. Mais c'est le plus important concours financier de l'État : en 2018, la DGF totale – bloc communal et départements – a été fixée à près de 27 milliards d'euros, dont 11,8 milliards d'euros pour les seules communes.
Je voudrais tout d'abord saluer les initiatives prises par le Gouvernement, à l'issue du travail avec les parlementaires, pour améliorer la transparence sur la répartition de la DGF. Les données et la carte interactive de la DGF sont publiées sur le site de la direction générale des collectivités locales (DGCL) et du ministère de la cohésion des territoires, les montants individuels et les composantes de la DGF seront publiés en une seule fois, et les préfets ont affirmé leur volonté de fournir des informations aux élus sur les motifs des variations substantielles. Il est toujours possible de faire mieux, en particulier sur les délais, mais ces progrès ont été reconnus par la majorité des élus.
Je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur l'évaluation de la DGF. Cette dotation porte l'essentiel de l'effort de péréquation de l'État, avec la DSU – 2,2 milliards en 2018 –, la dotation de solidarité rurale (DSR) – 1,5 milliard –, et la dotation nationale de péréquation (DNP) – 800 millions.
La péréquation verticale est en hausse chaque année et atteint 180 millions d'euros cette année. C'est une dynamique plutôt positive : en 2014, elle représentait 25,5 % de la DGF, contre un tiers aujourd'hui. Mais la loi organique relative aux lois de finances n'impose aucun indicateur de performance sur cette péréquation. Comme le relève la Cour des comptes, le seul indicateur prévu est purement mécanique et se borne à constater les décisions du législateur : c'est le ratio péréquation sur dotation, qui ne signifie pratiquement rien.
Certes, l'effet péréquateur existe, il est reconnu par tous et nous disposons de quelques données. Nous savons ainsi que la péréquation, et notamment la DSR cible et la part majoration de la DNP ont permis de réduire de 6 000 à 3 200 le nombre de communes pauvres, définies comme celles dont le potentiel financier est inférieur aux trois quarts du potentiel financier moyen. Mais c'est un peu maigre pour évaluer l'effet péréquateur.
Il devient impératif de pouvoir véritablement évaluer la DGF, avec des indicateurs précis fondés sur la mesure des écarts de richesse avant et après péréquation. Un suivi dans la durée des potentiels financiers, de la richesse par habitant ou de la richesse agrégée des ensembles intercommunaux est nécessaire. Il faut également souligner que le potentiel fiscal, facteur déterminant pour le calcul des dotations de péréquation, peut sembler obsolète du fait de l'absence de révision des valeurs locatives cadastrales depuis plus de quarante ans, sans parler de l'impact que pourrait avoir la suppression totale de la taxe d'habitation.
Des indicateurs plus fins et une actualisation des outils mesurant la richesse des collectivités sont nécessaires pour que le législateur puisse faire un choix politique éclairé sur l'opportunité d'accélérer la péréquation. Celle-ci augmente chaque année, nous savons qu'elle produit des effets, mais nous manquons d'outils suffisamment précis pour décider en connaissance de cause de l'accélérer. De telles évolutions sont-elles à l'étude ? En la matière, l'intuition ne peut se substituer à l'analyse.
J'en viens à mon second point : la simplification de la DGF. Nous connaissons tous la nécessité, mais aussi la difficulté de réformer la DGF.
Toutes les dotations de péréquation ont été créées dans les années 1990. La DSU a pu être recentrée en 2016 et la dotation d'intercommunalité a été modernisée et simplifiée, avec une enveloppe unique, dans la loi de finances pour 2019 ; mais les réformes de la DSR et de la DNP se sont jusqu'à présent soldées par des échecs.
Il doit être possible de réformer la DGF par une démarche progressive ; nous avons identifié trois pistes à cette fin.
On constate tout d'abord que la DSR est perçue aujourd'hui par 33 192 communes en 2019 : sa dilution est donc trop forte et il nous semble nécessaire de recentrer cette dotation et de diminuer le saupoudrage.
Par ailleurs, si la distinction DSU-DSR semble pertinente et permet de soutenir les charges des territoires urbains et ruraux, en 2019, deux cent vingt communes perçoivent à la fois la DSU et la DSR. On peut donc imaginer de les articuler plus finement de manière à éviter ce chevauchement.
La troisième piste pour simplifier le paysage des dotations serait le reversement de la DNP dans la DSU et la DSR. En effet, la DNP – qui a l'avantage d'équilibrer les différences de potentiel de fiscalité – est peu comprise par les élus locaux, tandis que la DSU et la DSR, qui augmentent chaque année, sont mieux identifiées et semblent avoir davantage d'avenir. Une insertion progressive de la DNP dans la DSU et la DSR, sur une période qui pourrait être de dix ans, nous paraît une possibilité intéressante. Est-elle envisagée par vos équipes ?
Enfin, il faudra trouver un véhicule législatif adéquat pour une telle réforme. Un texte spécifique, permettant le jeu de la navette parlementaire, a un intérêt pour mûrir la réflexion politique entre les deux assemblées par l'effet des lectures successives. Mais la loi de finances a démontré son efficacité, notamment pour la réforme de la dotation d'intercommunalité. Et tout projet de réforme devra nécessairement être articulé avec celle de la fiscalité locale.
J'insiste donc sur l'importance de développer les outils d'évaluation de la DGF et d'actualiser les outils mesurant la richesse des collectivités, les uns permettant d'alimenter les autres. Ce sont les conditions indispensables à la modernisation de la DGF, à son équité et à sa simplification.
En conclusion, le nécessaire effort de péréquation n'est pas assis, aujourd'hui, sur des bases assez fiables et solides, et la DGF est trop complexe pour rétablir un véritable climat de confiance avec les élus.

Nous avons évoqué les dotations qui revêtent une importance particulière pour les élus locaux, notamment la DSIL et la DETR. Depuis que des parlementaires siègent au sein des commissions de la DETR, nous sommes sans doute en mesure de porter un regard un peu plus précis sur les dépenses réalisées, du moins pour les projets de plus de 100 000 euros.
Pour ce qui est de la DGF, je salue l'effort de clarté accompli avec la publication sur internet de tous les critères pris en compte pour son calcul. Dans ma propre intercommunalité, la modification de son périmètre avait entraîné bon nombre de changements dans la DGF et mes administrés m'avaient beaucoup interpellé à ce sujet : depuis quelque temps, ce n'est plus le cas, ce qui signifie sans doute qu'ils trouvent désormais en ligne les réponses aux questions qu'ils se posent.
L'un des points sur lesquels je continue moi-même à m'interroger est celui du rapport entre la DGF et la population. Je pense à la population en valeur absolue, mais aussi au fait que les Français ne sont pas forcément égaux devant la DGF. J'ai pris connaissance des éléments que vous nous avez fait parvenir, notamment de l'exemple établi entre Cahors et une petite commune ; mais j'avoue que cela ne m'a pas forcément convaincu, car un exemple ne fait pas une généralité, et il aurait été intéressant de pouvoir disposer d'une vision plus large.
Par ailleurs, il me semble que la contractualisation peut avoir des effets un peu pervers. Je m'explique : selon ce qui m'a été rapporté, le fait de limiter les dépenses de fonctionnement aurait conduit certaines collectivités à différer un certain nombre d'investissements, en raison du fait que, pour une collectivité, la réalisation d'investissements se traduit souvent par une augmentation de ses dépenses de fonctionnement. Ainsi, certaines collectivités révéleraient d'excellentes capacités à dégager des fonds propres, puisqu'elles iraient jusqu'à thésauriser des crédits ! Il me semble cependant que les collectivités n'ont pas pour objet de thésauriser, mais bien de rendre des services à nos concitoyens ; j'aimerais connaître votre position sur ce point. Je pense que, si nous voulons que les collectivités se comportent comme de bons élèves en ne dépensant pas trop, leur souci d'économie ne doit quand même pas les conduire à placer de l'argent à la banque...
Enfin, puisque la réforme des impôts locaux est reportée à 2020, il me semble que, si j'étais maire à l'heure actuelle, je chercherais à créer de l'habitat : plus ma commune comptera d'habitants et plus le montant de DGF qu'elle pourra récupérer sera élevé – même si l'augmentation de la population nécessite aussi de faire plus d'investissements. Pour une commune rurale, la préservation des terres agricoles ou du milieu naturel ne rapporte strictement rien ! La future DGF va-t-elle prendre en compte tous les services environnementaux rendus par un certain nombre de communes, dont celles-ci ne tirent aucun avantage financier qui les aiderait à se développer ou à se doter de services utiles pour leurs habitants ? Je sais que cette question préoccupe de nombreux députés de milieux ruraux, agricoles et comprenant des zones naturelles, qui ne peuvent s'empêcher de penser que quelques habitants supplémentaires pourraient leur procurer des ressources supplémentaires qui leur faciliteraient la vie.

Je veux d'abord dire à M. le rapporteur pour avis, que j'ai écouté avec attention, que les politiques eugénistes ne doivent pas prendre le pas sur celles relatives à l'habitat !
Plus sérieusement, je voudrais revenir sur certains sujets abordés par les rapporteurs spéciaux, à commencer par la problématique des indicateurs de performance. Les rapporteurs spéciaux ont tout à fait raison de souhaiter que, dans le cadre d'une politique de l'évaluation qui a vocation à prendre encore davantage d'ampleur dans les années à venir, les indicateurs se voient élargis à toutes les dotations de soutien à l'investissement de la mission, mais également à la DGF : cela correspond également à une demande de la Cour des comptes, que j'aimerais voir suivie d'effet.
Même si la présente audition a pour objet l'évaluation portant sur l'année 2018, j'aimerais savoir si les progrès constatés durant cette année en matière de programmation des crédits de paiement de la DSIL vont se confirmer, et si on peut donc s'attendre à ce que celle-ci soit pleinement ajustée à la consommation en 2019.
Par ailleurs, madame la ministre, monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner quelques éléments d'information au sujet de la nouvelle DSID ? Je souhaiterais savoir, en particulier, si les préfectures et les départements s'en sont bien emparés.
Je veux également appeler votre attention sur un point spécifique que nous avons découvert et dont je vous ai déjà un peu parlé, madame la ministre, à savoir la problématique de la variation des enveloppes départementales de DETR. Jusqu'en 2018, nous n'avions connu qu'un long fleuve tranquille, mais des modifications ont été apportées à la loi de finances pour 2018 sur les critères de sous-densité ; il est désormais possible que la sous-densité de certains départements ait des conséquences sur les départements « hyper-sous-denses », jusqu'alors les mieux dotés à cet égard. Par ailleurs, certaines modifications étaient déjà intervenues sur les critères d'éligibilité au cours des années précédentes.
Dans un contexte de stabilité budgétaire de la DETR, j'ai quelques inquiétudes sur la tendance que pourraient prendre ces dotations. Quand on prend une carte et que l'on constate qu'en matière de DETR, l'Ariège est plus perdante en pourcentage que la Haute-Garonne, ou que les Hautes-Alpes sont plus perdantes que les Alpes-Maritimes, le Var ou les Bouches-du-Rhône, cela peut sembler choquant, d'autant que l'Ariège et les Hautes-Alpes font partie des cinq départements les plus sous-denses de France...
Enfin, je vais abonder dans le sens des rapporteurs spéciaux, et notamment de ce qu'a dit Jean-René Cazeneuve au sujet des modifications en matière de transparence sur la DGF. Si 2018 a vu se reproduire les mêmes effets que ceux des années précédentes, en 2019, pour la première fois, l'ensemble des montants individuels ont été publiés en une seule fois, le ministère a mis en ligne une carte interactive ; quant à la fiche départementale préparée par la DGCL et relayée par les parlementaires et les préfets, elle a constitué un support extrêmement utile pour apporter des explications aux élus locaux au sujet des variations, qui constituent toujours un sujet délicat. Avant que vous ne défloriez définitivement le sujet devant le Comité des finances locales (CFL), vous serait-il possible de livrer devant notre commission quelques éléments de bilan ? Ce disant, j'ai bien conscience d'étendre notre commission d'évaluation des politiques publiques un peu au-delà de ce qu'elle devrait être, mais puisque tout le monde le fait, je me permets d'en faire autant !
Pour ce qui est des restes à payer évoqués par M. Jerretie, les échéanciers pluriannuels permettent d'ouvrir les CP nécessaires chaque année : on ne refuse pas de paiements au motif d'une sous-budgétisation des CP, que ce soit pour la DSIL, pour la DETR ou pour la DPV. Évidemment, tout cela est suivi, et il ne faut pas qu'il y ait de malentendu à ce sujet : les restes à payer des départements ne sont ni des impayés ni des retards de paiement, mais simplement des opérations susceptibles de prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui, de ce fait, n'étaient pas terminées à la fin de l'année ; dans ce cas, on décaisse au fur et à mesure.
M. Jerretie nous a également interrogés au sujet de la DPV. Pour ma part, je suis d'accord pour affiner l'analyse sur les dépenses de fonctionnement. Effectivement, la DPV a été créée dans un esprit d'investissement ; la transparence doit être garantie pour cette dotation comme elle l'est pour la DETR et la DSIL. Je suis donc plutôt favorable à ce qu'une réflexion soit entreprise en ce sens.
Faut-il supprimer la DNP et redéployer ses crédits comme c'est le cas pour la DSU et la DSR ? La DNP, dont le montant, stable, s'établit à environ 800 millions d'euros depuis 2015, bénéficie à 21 000 communes pour sa part principale et à 13 000 communes pour sa part dite « majoration ». À la différence de la DSU et de la DSR, la DNP est destinée à tous les profils de communes, pour peu qu'elles puissent faire état d'un potentiel financier relativement faible par rapport aux communes comparables. La part « majoration » est destinée aux communes ayant de faibles bases de fiscalité économique.
La DNP étant répartie uniquement en fonction de critères de ressources, son action est relativement efficace en matière de réduction des écarts de potentiel financier entre les communes. Aujourd'hui, cette dotation fait peu débat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF), que ce soit sur son montant ou sur sa répartition : elle est plus anonyme que les autres dotations, et sûrement moins lisible par le fait qu'elle est répartie selon des calculs qui lui sont propres. La réforme de la DGF, votée en 2016 et abrogée avant son entrée en vigueur, supprimait la DNP et basculait les sommes correspondantes vers la DSR. La suppression de la DNP aurait l'avantage de simplifier le paysage des concours financiers, mais l'inconvénient de priver l'État d'un mécanisme de correction des inégalités fiscales, alors que 92 communes bénéficiaires de la péréquation ne perçoivent que de la DNP, pour des montants parfois élevés – il s'agit souvent de communes littorales de taille moyenne, dont la situation devrait alors être prise en compte.
Pour ce qui est de la DETR et de sa répartition, vous avez voté l'année dernière un amendement de Mme Stella Dupont qui a permis à de nouvelles communes d'entrer dans le champ d'application de la DETR en introduisant un critère de densité. Cet amendement a ainsi rendu éligibles à la DETR vingt-sept établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et permis d'augmenter la DETR de neuf départements, qui auraient sans cela vu leur dotation baisser. Par ailleurs, cinquante-sept départements ont vu leur enveloppe DETR augmenter, dont quarante-quatre de plus de 5 % en 2019. Ce nouveau critère de sous-densité des EPCI nous semble avoir eu peu de conséquences sur la répartition de la DETR sur l'ensemble du territoire. Je pourrai vous donner plus de précisions sur ce point si vous le souhaitez.
En tout état de cause, j'estime pour ma part que ces conséquences ne doivent pas s'apprécier seulement sur l'année 2019, mais sur de plus longues périodes. Ainsi, entre 2014 et 2019, les Alpes-Maritimes ont vu leur DETR augmenter de 27 %, tandis qu'elle faisait un bond de 106 % pour les Hautes-Alpes – j'ai pris ces départements au hasard...
Absolument.
Monsieur le rapporteur spécial Jerretie, vous avez raison de dire que le modèle de fonctionnement de la DSIL est à conforter. Globalement, il répond aux grandes orientations nationales de l'État, telles que les parlementaires les définissent dans le cadre du PLF : ceux qui se demandent pourquoi le préfet brandit parfois telle ou telle priorité oublient que c'est vous, parlementaires, qui inscrivez ces priorités dans la loi en les votant. Je pourrai d'ailleurs communiquer à ceux qui le souhaitent un document comprenant la liste des différentes répartitions par thèmes.
La question se pose actuellement de savoir s'il faudrait assortir la DSIL d'indicateurs de performance similaires à ceux s'appliquant à la DETR : en fait, peut-être faudrait-il le faire pour chacune des dotations d'investissement. Il convient de prendre des précautions particulières avec la DSID qui, nouvellement créée, ne permet pas de disposer d'autant de recul. On pourrait envisager qu'un travail d'approfondissement soit effectué avec les députés et les sénateurs afin d'apprécier l'intérêt et le caractère viable de ces indicateurs. Typiquement, le délai entre le moment où on notifie une subvention et celui où elle est consommée par la collectivité ou le maître d'ouvrage constitue un renseignement intéressant.
De ce point de vue, on voit d'ailleurs qu'on a obtenu avec la DSIL des effets différents de ceux de la DETR, la DSIL correspondant davantage à des projets plus gros, qui prennent plus de temps pour consommer les crédits qui leur sont affectés. Je dois bien avouer qu'en tant qu'élu local, cela m'intéresserait de pouvoir disposer d'indicateurs sur le fond. L'indicateur vert qui vient de faire de son apparition, ayant pour objet d'indiquer la part de DSIL mobilisable dans le cadre de la transition écologique, est un élément concret, qui vient apporter de vraies réponses à nos concitoyens ; à mon sens, il aurait vocation à se décliner en fonction d'autres objectifs de nos politiques publiques, par exemple l'accessibilité. D'une manière générale, nous aurions intérêt à faire progresser notre réflexion sur ce thème.
Monsieur le rapporteur spécial Cazeneuve, vous avez évoqué la nécessité de la transparence. En la matière, je veux remercier la DGCL et les agents de l'État, qui ont remué ciel et terre pour que ce soit possible ; je remercie également le corps préfectoral, qui s'est montré performant et résilient, ne serait-ce que dans sa capacité à communiquer avec les associations et à leur expliquer pourquoi les dotations diminuent – je n'évoque pas le cas inverse, car il est extrêmement rare qu'un maire qui voit sa DGF augmenter vienne demander des comptes à ce sujet...
Je me félicite de la mise en place de bonnes mesures de péréquation et je note que la mission RCT a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Quand on se rend sur le terrain, on se rend compte que personne ne comprend pourquoi la DGF diminue à certains endroits et augmente à d'autres... C'est un fait, le principe d'une péréquation mise en oeuvre sur des critères de population n'a pas été remis en question par les parlementaires.
M. le rapporteur général a évoqué la possibilité de mettre en place des indicateurs de performance, d'une part sur la DGF en général, d'autre part sur la péréquation. Pour ce qui est de la DGF, nous disposons déjà d'un indicateur : quand le gouvernement précédent diminue la DGF pendant tout le quinquennat et que tous les élus râlent, on peut à juste titre estimer que la performance de cette dotation est plus forte que lorsqu'on la diminue de manière globale...
La DGF est une ressource importante, qui participe à l'autonomie financière des collectivités territoriales dont le principe est posé par la Constitution.
Mon bon sens normand me fait dire qu'il est logique de donner un peu plus de moyens à des gens un peu plus fragiles que la moyenne chez les ruraux et chez les urbains ; c'est déjà un début de réponse. Mais la vraie question est celle de l'indicateur de l'efficacité de la péréquation : en d'autres termes, la péréquation permet-elle de réduire les écarts ? Parvient-on à rattraper certaines collectivités territoriales, à les sortir de leur pauvreté en faisant jouer la péréquation ? À cette question, j'ai envie de répondre « Oui, mais... », le « mais » correspondant aux charges. C'est un très beau sujet que celui de la mesure de la péréquation, mais en face des recettes, il y a toujours les charges, il y a aussi l'évolution d'un modèle d'économie locale ; tout cela nécessite d'être évalué avec précision, ce qu'il est toujours difficile de faire, surtout à distance et de manière globale, alors que l'attribution d'une dotation se fait plutôt au cas par cas. Je le répète, c'est un beau sujet, et vous aurez à vous demander, dans le cadre du prochain PLF, jusqu'où il faut aller en termes de péréquation, notamment pour ce qui est de la DSU et de la DSR que le Gouvernement a décidé – à l'unanimité, avec le CFL et l'ensemble des groupes politiques – d'augmenter encore cette année.
Nous avons eu dans l'hémicycle un échange avec Mme Pires Beaune au sujet de la DNP dans la DSR et la DSU, qui renvoyait à des travaux précédents portant notamment sur une hypothèse de réforme plus globale de la DGF. Le Président de la République a eu l'occasion, dans le cadre du grand débat national, d'y revenir à de nombreuses reprises au cours des 96 heures de débats qui ont eu lieu avec les maires. Lorsque vous avez voté les crédits de la mission RCT à l'automne dernier, j'ai cru comprendre que la stabilité constituait un maître mot de l'action que nous souhaitions mener collectivement, car c'est alors toute une génération d'élus qui était convalescente de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (« NOTRe »), des nouveaux schémas de coopération intercommunale, de la baisse de la DGF, et j'en passe.
Hormis la péréquation, tout ce que nous avons mis dans la loi de finances tendait à stabiliser l'édifice en attendant une réforme plus globale. Ce que vous proposez est intelligent et intéressant, mais cela va un peu à l'encontre de cette stabilité que nous cherchons à favoriser. Certains ne manqueront pas de m'opposer que le Gouvernement, quand il a réformé les dotations des intercommunalités dans le cadre de la loi de finances pour 2019, n'a pas craint de provoquer les à-coups que je préconise aujourd'hui d'éviter... C'est vrai, mais nous ne l'avons fait que parce que la réforme était toute prête et déjà dans les tuyaux ! Au demeurant, un certain nombre d'intercommunalités n'ont pas été perdantes dans l'affaire. Mais je me tiens à la disposition des parlementaires pour leur apporter sur ce point toutes les précisions qu'ils souhaiteraient.
Monsieur le député Molac, avec la présence de parlementaires au sein des commissions de la DETR, nous commençons à avoir quelque chose qui fonctionne bien. Cela étant, je vais vous le dire comme je le pense, tout cela est une affaire d'hommes et de femmes : comme on peut le voir en se référant aux prises de parole des uns et des autres, c'est avant tout en fonction de la personnalité des préfets et des représentants des associations d'élus locaux que les choses se passent remarquablement bien dans un département et moins bien dans un autre. À mon avis, il serait donc vain de vouloir légiférer pour chercher à régler des difficultés qui sont plutôt d'ordre territorial.
Les Français ne sont pas égaux devant la DGF, dites-vous. Cela pourrait donner lieu à un long débat. J'ai moi-même souvent été amené à dire devant l'Association des maires ruraux de France que les maires ne pouvaient pas souhaiter voir appliquer la dotation forfaitaire quand elle leur bénéficie, et la péréquation quand ce n'est plus le cas ! En tant que maire, j'ai un raisonnement un peu simple, consistant à regarder ma recette de fonctionnement et mes recettes d'investissement : le fait qu'un morceau de dotation forfaitaire – qui peut, par ailleurs, être écrêté parce que je récupère d'autres formes de péréquation – se retrouve dans mes recettes de fonctionnement n'a pas grande importance : ce qui compte, c'est la somme dont je dispose pour faire fonctionner ma commune, et ce que je peux virer en section d'investissement. Souvent, les prises de parole relatives à l'inégalité des Français face à la DGF – que je suis disposé à entendre, à certains égards – visent la dotation forfaitaire sans tenir compte de la péréquation. Tout le monde se dit favorable à la péréquation tant qu'on reste dans les murs de l'Assemblée et du Sénat ; mais sitôt qu'on rentre dans sa circonscription, il y a beaucoup moins de monde pour la défendre...
Avec M. le ministre de l'action et des comptes publics, nous sommes en train d'examiner le retraitement des contrats de Cahors. Bien que la parole du Gouvernement ait été mise en doute par certains – je pense notamment au vice-président de l'Association des maires de France (AMF), André Laignel –, qui estimaient que ces contrats n'en étaient pas vraiment, qu'ils n'avaient pas de caractère synallagmatique, nous nous étions engagés à faire preuve de souplesse sur ces contrats et c'est ce que nous avons fait, notamment au niveau des conseils départementaux, avec le retraitement de la question des mineurs non accompagnés (MNA). Nous sommes en train d'établir une typologie des collectivités qui ne respectent pas l'objectif de limitation des dépenses à 1,2 % – certaines sont sous contrat, d'autres ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral – mais, comme le dit Jacqueline Gourault, il faut tout de même reconnaître que le dispositif mis en place est un succès, et qu'il fonctionne bien. C'est d'autant plus vrai qu'il ne concerne que quelques communes, et que l'ensemble des autres collectivités ne voient plus de baisse de la DGF, pour des raisons liées à une décision politique.
La contractualisation pourrait-elle inciter à la thésaurisation ? Je ne le crois pas. Le respect de l'objectif de 1,2 % exige déjà une réelle volonté politique de la part de l'élu local concerné. À supposer que de tels phénomènes puissent se produire, les chambres régionales des comptes et leurs magistrats ne manqueront pas de les détecter.
Enfin, monsieur Molac, vous avez évoqué le lien entre DGF et préservation de l'environnement, au risque de mettre en colère votre rapporteur général, qui a défendu avec beaucoup de force, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, un amendement relatif aux zones peu denses en raison de leur classement en zone Natura 2000. Jusqu'alors, un maire du Loir-et-Cher, par exemple, dont la commune était située dans une zone Natura 2000, pouvait de ce fait se voir interdire de construire sur le territoire de sa commune – ce qui empêchait celle-ci de se développer – sans aucune compensation. Grâce à la disposition adoptée fin 2018, les communes concernées pourront désormais percevoir une compensation symbolique, de 2 % à 5 %...
Effectivement, mais c'est mieux quand c'est vous qui le dites, monsieur Giraud !
Ce dispositif permet également de commencer à changer la culture de la DGF, qui ne s'inscrit plus uniquement dans des logiques de développement « à l'ancienne » : elle englobe désormais également des problématiques de protection. Certes, ce que perçoivent certains est toujours pris à d'autres : il y aura toujours des communes qui verront leur DGF diminuer pour que d'autres la voient augmenter. Mais j'estime que vous pouvez être fiers de ce dispositif nouveau, voté à l'unanimité, si j'ai bonne mémoire, et qui contribue à la transition écologique.
L'adoption de ce dispositif a été très appréciée sur les territoires.
Je crois que 1 300 communes en tout sont concernées.
Pourriez-vous me rappeler votre question sur le FNADT, monsieur Jerretie ?

Dans la mesure où une vraie politique d'investissement se développe au travers des quatre dotations actuelles, il nous semble que le FNADT constitue également un outil pour les équipements structurants mis en oeuvre dans le cadre de l'action des préfets. Ne serait-il pas judicieux de l'intégrer dans la mission RCT ? Cela permettrait au ministère d'être plus clair et plus efficace dans son action et à nous, parlementaires, de disposer d'une vision globale des politiques publiques d'investissement local et de pouvoir ainsi procéder à une véritable évaluation de la politique structurelle de déconcentration en matière d'investissement.
Pour la première fois cette année, nous avons adressé une circulaire unique aux préfets, regroupant toutes les dotations – DETR, DSIL et FNADT – afin de permettre à chacun d'avoir une vision globale des choses. Ce qui va dans votre sens...

Monsieur le ministre, j'aimerais revenir un instant sur ce point essentiel qu'est la péréquation. Si tout le monde s'accorde à considérer que la péréquation est une bonne chose, il est permis de se demander aujourd'hui s'il faut accélérer le mouvement en ce sens ou le ralentir ; et tant que nous n'aurons pas répondu à cette question, elle va continuer à se poser, PLF après PLF, faute de disposer d'indicateurs qui nous permettraient de nous déterminer sans états d'âme.
Comment pourrait-on faire pour mesurer concrètement la valeur absolue obtenue après péréquation ? En d'autres termes, sur quels critères – richesse de la population, richesse de la commune, potentiel fiscal et financier – pourrait-on se fonder pour estimer que l'objectif poursuivi est atteint ?
Votre interrogation est tout à fait pertinente sur le plan intellectuel, et je la partage. Cela me conduit à souligner un point qui me paraît essentiel : si la péréquation est une chose formidable, elle n'est efficace que si elle est défendue collectivement. Mme la ministre et moi-même nous sentons parfois un peu seuls quand, invités à prendre part à un congrès des maires, nous nous retrouvons encore à devoir défendre le principe de la péréquation auprès de parlementaires qui, sur le territoire, expriment leur scepticisme – il s'agit plus souvent de sénateurs que de députés, je le précise. Prélever de l'argent à une intercommunalité pour en faire bénéficier une autre qui a plus de difficultés, c'est bien d'en assumer le principe à Paris, mais c'est encore mieux de l'assumer également sur le terrain. Pour ma part, j'estime être un militant de cette cause, je la défends avec force sur les territoires, mais je me sens parfois un peu seul dans mon combat. Quant aux questions relatives au financement, nous aurons l'occasion d'y revenir.
Je reviens à la DSID, cette nouvelle dotation destinée aux départements et qui vient se substituer à la dotation globale d'équipement (DGE). De nombreux conseillers départementaux réclamaient cette évolution depuis des années. La DGE était en effet une espèce de guichet validant des opérations foncières très précises, dont il fallait fournir les factures pour obtenir un remboursement de la part de l'État. Il a été décidé de créer une nouvelle dotation sur le modèle de la DSIL, afin de disposer d'un outil beaucoup plus facile à piloter à l'échelle régionale, et portant sur tout type de dépenses : là où un foyer départemental de l'enfance, un centre d'accueil pour MNA ou un collège n'étaient pas forcément éligibles à la DGE, ils le seront avec la DSID.
Je vous rappelle que l'outil dont vous avez voté la création comprend une part de péréquation s'élevant, si j'ai bonne mémoire, à 23 % de la DSID, et due sur des critères de pauvreté, tandis que le reste de l'enveloppe correspond à une logique de projets. C'est cette enveloppe qui commence à être distribuée dans les différents conseils départementaux sous l'autorité des préfets de région et des préfets de département. Au 31 mai dernier, les préfets avaient pour instruction de commencer à nous faire remonter les projets tels qu'ils existaient au niveau des territoires. Je dois vous avouer qu'à ce jour, nous ne disposons pas encore du tableau global de ces remontées, mais je sais que les projets sont très divers : foyers départementaux de l'enfance, travaux de voirie, etc. Je vous tiendrai informés dès que possible.

Au-delà de la satisfaction que nous pouvons éprouver à voir que, depuis deux ans, les dotations sont maintenues, le travail réalisé en début d'année afin de diffuser l'information et d'améliorer ainsi la transparence et la lisibilité a été unanimement apprécié.
Par ailleurs, je tiens à vous rassurer, monsieur le ministre : à chaque fois nous prenons part à des événements organisés dans nos circonscriptions, nous ne manquons pas de rappeler aux maires concernés que la dotation de leur commune a augmenté lorsque c'est le cas. Ils oublient souvent d'en faire état...

En 2018, nous avons maintenu l'enveloppe DETR et la DSIL, ce qui s'est traduit par une hausse des dépenses d'investissement à tous les niveaux des collectivités, comme le montre le rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales. Dans les territoires touristiques et en particulier dans les zones de montagne, l'investissement est nécessaire afin de maintenir le niveau des équipements et de répondre aux attentes de la clientèle. Cependant, bien qu'une hausse des investissements soit relevée, il est nécessaire d'évaluer la performance des dotations afin de déterminer si elle constitue le meilleur outil pour dynamiser l'investissement local.
Comme l'ont relevé les rapporteurs spéciaux et la Cour des comptes, les critères de performance ne concernent actuellement que la DETR, alors même que les dotations en matière d'investissement sont diverses et nombreuses. La note d'exécution budgétaire de 2018 relève que le projet annuel de performances pour l'année 2019 marque une amélioration, puisque celle-ci inclut dans la DSIL un des trois critères d'évaluation, mais l'effet de levier et le délai de réalisation des investissements ne sont toujours pas pris en compte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Cour des comptes préconise d'individualiser les critères de performance à chaque type de dotation.
Dès lors, madame la ministre, monsieur le ministre, le groupe La République en Marche souhaite savoir si vous envisagez de suivre cette recommandation afin que les parlementaires puissent évaluer les effets induits par ces dotations en matière d'investissement.

Au nom du groupe Les Républicains, je souhaite formuler une remarque et deux questions.
Je souhaite tout d'abord m'associer aux propos de mes collègues concernant la DGF et la nécessité de disposer sur ce point d'une meilleure visibilité, compte tenu du caractère complexe du mécanisme de calcul de cette dotation.
Existe-t-il un indicateur permettant de mesurer la quote-part de DETR allouée aux collectivités mais finalement non utilisée par celles-ci – pour des raisons diverses, il peut arriver que certains projets n'aboutissent pas –, et qui est retournée au département, devenant une somme perdue pour les territoires concernés ?
Par ailleurs, en ce qui concerne les communes nouvelles – on en compte un certain nombre dans l'Orne –, disposez-vous d'un indicateur qui vous permette de mesurer l'impact des dotations sur les communes nouvelles, en tenant compte notamment des majorations qui ont pu être accordées ?

J'aurai deux questions à poser au nom du groupe UDI, Agir et Indépendants.
La première porte sur l'usage de la réserve de précaution qui nécessiterait, conformément à la recommandation n° 2 de la Cour des comptes, d'être répartie sur un périmètre pertinent au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales, afin de ne pas avoir chaque année à décider de son dégel sur des dotations qui sont juridiquement dues. En effet, en 2018, le dégel des crédits dus est intervenu très rapidement, au moment de la clôture de l'exercice budgétaire, alors même que les collectivités bénéficiaires pouvaient en avoir besoin plus tôt. Ma question est donc simple : que comptez-vous faire lors des années à venir, afin de mettre en oeuvre cette recommandation réitérée de la Cour des comptes ?
Ma seconde question porte sur le gel de la dotation générale de décentralisation (DGD). Depuis 2009, le gel de cette dotation lui a fait perdre 11 % de sa valeur réelle, alors que le Conseil constitutionnel estime que les collectivités bénéficiaires de la DGD doivent se voir attribuer des ressources équivalentes à celles qui étaient auparavant consacrées à l'exercice des compétences transférées. Ainsi, le montant doit s'apprécier en euros constants, ce qui implique une règle d'indexation sur l'érosion monétaire des compensations financières. Comptez-vous réindexer la DGD afin de restituer les ressources normalement dues aux collectivités bénéficiaires et éviter un risque constitutionnel ?

Sur la DGF, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Malheureusement, il n'y a là rien de nouveau. Elle pâtit toujours d'une architecture illisible et complexe, que personne ne comprend et que je persiste à juger inéquitable. Je pourrais citer le cas d'une petite commune éligible à la DSR bourg-centre, à la DSR cible, à la DSR péréquation et à la DNP mais qui voit malgré tout sa DGF baisser. Des exemples similaires sont légion : dans le département du Puy-de-Dôme, 233 communes ont vu leur DGF globale, base et péréquation, baisser. Pour certaines, c'est assez logique, mais pour d'autres, cela ne l'est pas. La réforme de la DGF est toujours aussi nécessaire. Le gouvernement Valls n'a pas eu le courage de la mener ; j'attends que le vôtre l'ait, et je l'accompagnerai bien volontiers.
S'agissant de la DETR, je partage l'opinion du rapporteur général. Quarante-quatre départements ont subi une baisse de cette dotation. Le Puy-de-Dôme a perdu 800 000 euros cette année et 600 000 euros l'année dernière. Ce ne sont pas des petites sommes. Élargir le périmètre des départements éligibles sans augmenter l'enveloppe aboutit forcément à faire des perdants. Serait-il possible l'année prochaine de revoir les critères d'éligibilité ? Sont-ils vraiment tous pertinents ?
Pourriez-vous nous en dire plus au sujet des irritants de la loi NOTRe ? Le Président de la République lui-même les a évoqués encore récemment. Quels sont ceux que vous envisagez de gommer ? Avez-vous fixé un calendrier ?
Nous le savons, un problème se pose avec les réseaux d'eau et d'assainissement. Les critères pour accéder aux aides des agences de l'eau ont été modifiés : on me rapporte le cas de communes, de petite taille notamment, qui ne sont pas éligibles pour le financement de travaux sur leur réseau d'eau. Si l'on veut favoriser la transition écologique, pourquoi leur opposer qu'elles ont un rendement tellement médiocre qu'on ne peut pas les aider ? C'est le serpent qui se mord la queue ! Celles qui ont vraiment besoin d'aide sont justement celles qui ont les réseaux les plus mauvais. Seriez-vous favorables à recourir à la DSIL pour les accompagner ?
Enfin, que diriez-vous d'étudier la possibilité pour les collectivités territoriales de constituer un fonds de réserve utilisable en cas de catastrophe, par exemple une tempête qui mettrait à terre des mètres cubes de bois ? Cette réserve ne serait pas destinée à financer des dépenses de fonctionnement ni des dépenses d'investissement récurrentes, mais seulement à réagir en cas de coup dur. N'oublions pas que la trésorerie des collectivités n'a jamais été aussi élevée : elle atteint aujourd'hui 57 milliards d'euros, soit plus d'une année d'investissement public local.
Je termine en m'étonnant que les critères de répartition de la DGF pour 2019 n'aient pas encore été publiés sur le site. Il est impossible de calculer la DGF par commune.

Aucune dépense n'a été réalisée en 2018 sur le programme 832 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie qui permet à l'État d'aider diverses collectivités faisant face à des problèmes de trésorerie. Faut-il s'en réjouir ? Est-ce à dire que tout va très bien pour les collectivités ?
M. le ministre de l'action et des comptes publics a déclaré il y a quelques jours devant la commission des finances du Sénat : « Les collectivités territoriales tiennent majoritairement leurs dépenses et ont enregistré l'année dernière une diminution de leurs dépenses de fonctionnement de 0,2 % en moyenne. » Ce constat peut surprendre quand on sait que plus de 1 500 communes sont en grandes difficultés financières selon l'AMF.
Les collectivités territoriales continuent de participer grandement au redressement des comptes publics. Elles contribuent à l'essentiel de l'amélioration du déficit public alors qu'elles ne représentent que 20 % du total de la dépense publique. Elles font face depuis quelques années à une baisse des dotations de l'État, mais limitent tant qu'elles le peuvent les hausses d'imposition. Face à ce désengagement, elles doivent mettre en place des systèmes alternatifs ; elles cherchent d'autres solutions, organisent des cagnottes en ligne, mettent à contribution leurs administrés pour réaliser des travaux, vendent leur patrimoine, réduisent les émoluments des élus, parfois même enfreignent la loi en votant un budget en déséquilibre. Ces exemples concrets sont malheureusement de plus en plus courants quand l'État ne répond plus présent depuis plusieurs années.

Vous avez déjà répondu à ma première question qui portait sur la mise en place d'indicateurs de performance pour l'ensemble des dotations. Cela permettra de disposer d'une véritable traçabilité et d'analyser les conséquences des variations – Mme Pires Beaune évoquait le fait qu'il y avait des baisses de DETR dans certains départements et des hausses dans d'autres. Nous pourrons ainsi procéder à de meilleurs ajustements d'une année sur l'autre.
Ma deuxième question concerne la répartition de la DSIL. Le ministre soulignait que l'Assemblée nationale votait sur les priorités, certes, mais la répartition de cette dotation est dans les mains des préfets de région. Autant pour la DETR, il existe des commissions d'élus composées de deux collèges, autant pour la DSIL, les élus sont absents. Or, la répartition de cette dotation a tout de même un côté un peu discrétionnaire ; nous aimerions comprendre de quelle manière elle est distribuée dans certains territoires. Dans ma circonscription, que connaît bien Mme la ministre, cela suscite parfois des interrogations.
Ma troisième question renvoie au plan d'action « Coeur de ville » et aux contrats de ruralité, qui sont des politiques très intéressantes. Il serait bon de savoir quelles conséquences positives elles ont eues pour les territoires et comment les améliorer. Il serait aussi intéressant de comparer ces politiques avec le dispositif « Opération de revitalisation de territoire » (ORT) que vous venez de lancer.

J'aimerais revenir sur la DPV, créée à la suite d'un rapport dont je suis l'auteur. Comme son nom l'indique, elle est destinée à la politique de la ville, ce qui n'est pas le cas de la DSU, qui s'adresse aux territoires urbains en général. C'est un grand débat que nous avons avec la DGCL.
La DPV a été mise en place pour répondre aux besoins de communes spécifiques et financer des projets relevant à la fois de l'investissement et du fonctionnement. Si vous supprimez le fonctionnement, nous aboutirons à l'absurdité suivante : l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) financera des investissements mais les communes n'auront plus les moyens de faire fonctionner les équipements. Prenons un exemple : la DPV a permis à Sarcelles de financer l'informatisation des écoles publiques, dépenses qui relevaient non pas de l'investissement, mais du fonctionnement.
Rappelons que la DPV est notifiée par le préfet : c'est l'État qui vérifie que les projets à financer correspondent bien aux critères établis. La mairie ne peut pas faire ce qu'elle veut. Les premiers textes concernant la DPV excluaient les salaires, mais autorisaient le financement des projets de fonctionnement. Pourquoi changer les choses ? Ces communes ont aussi besoin de faire fonctionner leurs équipements.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré que nous devions être à vos côtés sur les territoires pour défendre la péréquation. Je suis totalement d'accord avec vous mais pour bien la défendre, il faut bien la comprendre ; or certains cas posent question.
Il faudrait notamment s'interroger sur les possibilités d'appliquer la péréquation au-delà des limites départementales. Ma circonscription partage ses frontières avec trois départements avec une grande métropole de l'autre côté, Lyon, qui pratique la péréquation sur son territoire dans le département du Rhône, mais pas dans l'Isère, juste à côté. Pourquoi ne pas réfléchir à la mise en place de modes de péréquation plus locaux qui prennent en compte le phénomène de la métropolisation ?
Monsieur Roseren, s'agissant de la DETR et de la DSIL, j'ai déjà commencé de répondre en évoquant les indicateurs de performance. La transparence reste l'un des meilleurs indicateurs. Nous nous assurons que tout soit mis en ligne et que chacun puisse accéder à la liste des projets financés.
Monsieur Vigier, il ne me choque pas que l'État ait lui aussi ses priorités. Certains nous demandent comment nous finançons nos priorités dans le Grand plan d'investissement pour ensuite nous reprocher de mettre la DSIL à toutes les sauces et pour pointer son caractère discrétionnaire, à la main des préfets. Si les parlementaires estiment qu'il y a des abus ou des anomalies, ils peuvent nous en faire part par l'intermédiaire de questions écrites ou orales. Nous avons autorité sur le corps préfectoral et nous pourrons apporter les correctifs nécessaires. Mais pourquoi tout le monde pourrait-il mettre en avant ses priorités, ses logiques et ses critères de subvention, sauf l'État ?
La DETR répond à une logique transversale très intelligente. Elle repose sur un mode de fonctionnement spécifique à la France qui consiste à mettre tout le monde autour de la table pour créer du consensus local. C'est un outil plus souple, largement délégué à l'échelle départementale dans les faits même si sur le papier il relève de la région. Je n'ignore pas que les pratiques peuvent être différentes selon les préfets de région mais là encore, s'il y a des problèmes, plutôt que de les régler par un énième changement de règles, mieux vaut examiner les cas un par un.
Madame Louwagie, vous m'interrogez sur la part non utilisée de la DETR. Dans tout mandat municipal, il y a un faux plat au début, une joyeuse bosse au milieu et une augmentation importante à la fin. Pour faire écho à la juste interpellation de M. Jerretie qui s'inquiétait d'une sous-budgétisation des crédits de paiement, il n'y a pas de factures impayées : n'importe quel élu local, maître d'ouvrage d'un projet, présentant sa facture au préfet, la verra honorée, avec des crédits de paiement à la hauteur. C'est d'autant plus vrai que grâce aux séries statistiques, il est possible de prévoir les besoins pour les années qui suivent. Et je trouve légitime la demande d'indicateurs de performance portant sur le degré de maturité des projets. Il n'y a rien de plus rageant pour une région ou un département que d'engager des crédits pour des collectivités qui ne parviennent pas, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, à faire avancer leur projet. C'est de l'argent public bloqué, qui aurait pu profiter à un autre projet plus abouti. En clair, il n'y a pas de bas de laine dans un coin, hormis les 3 % correspondant au gel de la réserve de précaution.
S'agissant des communes nouvelles, nous pourrons faire un premier bilan rapidement. Pour la DGF, c'est vite vu : le bilan est positif puisque ces communes ont bénéficié d'une dotation bonifiée. C'est plutôt aux effets de seuil qu'il faudra être attentif. Certaines communes, du fait de leur agrandissement, sont désormais soumises aux dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Des travaux au Sénat ont déjà été consacrés à ce sujet.
Madame Pires Beaune, nous savons le travail titanesque que vous avez réalisé pour nourrir le débat sur la réforme de la DGF de propositions d'intérêt général. Comme le Président de la République l'a dit à M. Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, et à M. Morin, président de Régions de France, mais surtout à M. Baroin, président de l'AMF, et à son vice-président M. Laignel, si les associations d'élus souhaitaient se lancer dans une telle réforme, le Gouvernement se tiendrait à leur disposition pour le faire. Avec Jacqueline Gourault, nous savons toutefois d'expérience qu'on ne peut ouvrir un tel chantier sans une volonté de coproduction loyale, équilibrée, saine : il s'agit d'un dossier techniquement très complexe, aux enjeux considérables, puisque la DGF joue sur des logiques d'équité particulièrement puissantes, au coeur de la République. Encore faudrait-il laisser s'instaurer un climat dans lequel on ferait un peu moins de politique, en privilégiant la technique.
Je redis, à la suite du Président de la République, que la question de la DGF est ouverte tout comme celle de la fiscalité locale, qui est l'autre pilier des ressources des collectivités.
Vous demandez que les critères de la DETR soient revus. Aujourd'hui, il existe deux grosses enveloppes – une pour les EPCI, l'autre pour les communes – et deux grandes variables, la richesse ou la pauvreté, et la population : il est normal de donner plus à des collectivités dont la démographie est dynamique pour financer des projets structurants. La combinaison de ces critères aboutit à une DETR dite « spontanée », qui donne une photo de la situation de chaque département. Pour éviter des évolutions trop violentes d'année en année, on a mis en place des filets de sécurité qui limitent les diminutions à 5 % et les augmentations à 10 %. Faut-il jouer à chat perché en gelant les montants constatés à l'instant t pour être sûr que cela ne bougera plus ? Cela ne me paraît pas une bonne idée. Quand on est un peu girondin, il paraît normal de vouloir adapter les dotations à l'évolution des territoires. Je vois bien ce qu'il y a de séduisant à une révision, mais je vous invite à la plus grande prudence.
S'agissant de la loi NOTRe, un projet de loi portant sur l'engagement des élus locaux sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet prochain. Nous apporterons des correctifs à tous ces irritants auxquels ils sont confrontés au quotidien, notamment en matière de relations entre les communes et les intercommunalités, de gouvernance, de périmètres et de compétences. Il faut faire confiance aux élus sur la manière de s'organiser. Nous aurons l'occasion de coproduire tout cela avec le Parlement.
S'agissant des agences de l'eau, vous avez raison, madame Pires Beaune. Nous avons toutefois déjà pris des mesures mais elles restent méconnues. Le premier cycle des Assises de l'eau, dont j'ai eu la charge lorsque j'étais secrétaire d'État, a permis de mobiliser la Caisse des dépôts et consignations, qui propose une enveloppe de 2 milliards de prêts à des taux défiant toute concurrence sur des durées allant de soixante à soixante-dix ans, particulièrement propices à l'amortissement des investissements : ce n'est pas rien. Il faudra peut-être faire plus de publicité sur le terrain autour de ces « Aqua Prêts » comme la Banque des territoires les a nommés. Ils constituent des outils nouveaux pour boucler des tours de table financiers. À cela s'ajoute la difficile question du prix de l'eau : dans beaucoup de communes, s'il y a des fuites, c'est parce qu'il y a un défaut d'entretien mais aussi parce que l'eau n'a pas toujours été payée au prix où elle devrait l'être, il faut le dire aussi. La tarification dans certains territoires n'est pas celle qui conviendrait.
Je ne comprends pas votre idée d'obliger les collectivités territoriales à réserver une part de leur trésorerie aux catastrophes naturelles : par définition, la trésorerie est là pour faire face aux coups durs dans la logique de bon père de famille du code civil. L'idée d'une trésorerie forcée, imposée par le législateur me paraît poser problème. Mais nous pourrons en discuter si vous le souhaitez.
Quant aux critères de répartition de la DGF, ils seront mis en ligne à la mi-juin comme l'année dernière. Nous avons beaucoup mis la pression sur nos équipes pour parfaire la qualité des réponses aux situations individuelles.
Monsieur Dufrègne, je dois bien avouer que je n'ai pas compris votre question. Vous tenez toujours le même discours, que la DGF diminue ou qu'elle soit stable. Vous vous plaignez des mêmes choses alors que les dotations d'investissement sont portées à 2 milliards d'euros, soit un niveau beaucoup plus élevé qu'il y a cinq ans. Vous ne pouvez pas dire que l'État manque à tous ses devoirs à l'égard des collectivités territoriales alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent public mis sur la table pour leurs investissements. Cela finit par nuire à l'image de la République.
L'enveloppe de 28 milliards d'euros est stable depuis 2017, ne vous en déplaise. S'il y a des variations entre les communes, c'est pour des raisons qui ne peuvent être imputées à l'État et qui tiennent à des situations locales. Le désengagement de l'État n'est nullement en cause. Y a-t-il eu un euro en moins sur la mission Relations avec les collectivités territoriales ? Non, et j'aimerais que l'on dise la vérité.
Vous êtes en droit de nous dire qu'il faudrait faire plus et augmenter la DGF, quitte à creuser les déficits publics : ce serait cohérent. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a moins d'argent qu'auparavant, car ce n'est pas vrai.
Les communes confrontées à des difficultés financières – pour la plupart situées outre-mer – sont inscrites dans le réseau d'alerte et font l'objet d'un accompagnement de l'État.
Permettez-moi de vous répondre sans faire du copier-coller : globalement, on ne peut pas dire que l'État ne se tient pas aux côtés des collectivités territoriales dans ce pays.
Dans les moments que nous vivons, il faut faire preuve de prudence dans ce que l'on affirme si nous voulons réconcilier nos concitoyens avec la puissance publique et leur faire comprendre ce que recouvre le consentement à l'impôt. Car c'est le même contribuable qui est au milieu de tout cela...
Je préciserai d'abord que nous avons accepté que la DSIL, qui est à l'origine destinée aux investissements, soit pour partie consacrée au fonctionnement, dans la limite de 10 %.
M. Jerretie s'est interrogé sur la part des dotations allant au fonctionnement et à l'investissement. Nous n'avons jamais dit qu'il fallait interdire d'utiliser telle dotation de telle manière. Il faudra peut-être analyser les pratiques.
Tout le monde demande des indicateurs de performance ; il sera intéressant aussi de disposer de données sur l'utilisation des dotations.
Monsieur Vigier, vous avez souligné que la répartition de la DETR était examinée par des commissions départementales et que les élus décidaient à cette occasion d'orientations. Ce n'est effectivement pas le cas pour la DSIL, qui est aux mains des préfets de région. Toutefois, ceux-ci devront dorénavant fournir à ces commissions des indications sur les orientations prises en fonction des priorités décidées par le Gouvernement.
Pour 2018, la répartition de la DSIL s'est faite de la manière suivante : 31 % pour les contrats de ruralité, 17 % pour la rénovation thermique et la transition énergétique, 15 % pour la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics – politiques qu'il fallait soutenir, compte tenu des nouvelles obligations instaurées –, 15 % pour le développement des infrastructures de mobilité, 15 % pour le numérique et la téléphonie mobile, et une part pour les bâtiments scolaires pour accompagner la politique de dédoublement des classes. Tous ces chiffres concernant la DSIL seront publiés dans un souci de transparence totale.
Notons que la DSIL, créée par l'ancien gouvernement dans le but de compenser la baisse de la DGF, a été maintenue alors même que la DGF est restée stable.
Le plan « Coeur de ville » et les ORT font également partie de nos priorités et j'espère pouvoir développer cette politique dans des villes plus petites que les villes moyennes. Nous travaillons pour ce faire autour de l'agenda rural.
Madame Lemoine, la mise en réserve d'une partie des crédits de chaque programme est justifiée par la nécessité d'absorber en cours d'année des imprévus de gestion. Le taux de mise en réserve fixé par le ministère de l'action et des comptes publics est de 3 % des crédits ouverts en loi de finances, soit, pour la mission RCT, 111 millions sur 3,9 milliards d'euros d'autorisations d'engagement en 2019. Le ministère de l'action et des comptes publics souhaite que la ventilation de cette réserve garantisse son caractère pleinement mobilisable.
Il faut préciser que la mission RCT comporte plusieurs dispositifs qui font l'objet d'obligations de versement constitutionnelles ou organiques, qui ne sont donc pas mobilisables, par exemple les DGD, qui compensent les transferts de compétences, ou encore les dotations de compensation au profit des collectivités d'outre-mer. Chaque année, le ministère de l'action et des comptes publics demande donc d'exonérer les dotations constitutionnellement dues de gel et d'en consacrer l'intégralité aux investissements et aux dispositions d'intervention. Autrement dit, l'effort ne serait pas calculé sur la base d'une assiette comprenant la totalité des crédits de la mission RCT mais devrait être concentré sur un peu plus de la moitié des crédits.
Si ce raisonnement avait été suivi pour 2019, la DETR, la DSIL, la DPV ou encore la nouvelle DSID auraient été gelées à hauteur de 6 % et non de 3 %. Il n'y a aucune justification à ce que les dotations générales de décentralisation et les dotations destinées à l'outre-mer constituent un poids mort pour la mission RCT. La solution la plus logique consisterait à calculer le montant total du gel sur un périmètre restreint, excluant les dispositifs sur lesquels l'administration n'a aucune marge de manoeuvre. En 2018, une solution de compromis a été trouvée, consistant à appliquer le gel proportionnellement à chaque budget opérationnel de programme, DGD et dotation outre-mer comprises. Cela implique de financer ces dispositifs par fongibilité ou par un dégel en fin d'année. Cet arbitrage a été confirmé en 2019.
Par ailleurs, madame Lemoine, la DGD est bien en euros courants et il n'est pas prévu que cela change.
Oui, monsieur Jerretie.

J'aimerais revenir sur ma proposition d'un fonds de réserve. Il ne s'agit nullement d'obliger les collectivités à en constituer un, mais de permettre à celles qui le souhaiteraient d'en créer un pour faire face aux coups durs. Elles peuvent inscrire dans leur budget des dépenses imprévues à hauteur de 7,5 % des dépenses réalisées, mais pas des dépenses provisionnées pour risque de tempête. La loi encadrerait simplement cette possibilité en fixant par exemple un taux. Êtes-vous favorable à ce que nous étudiions cette piste ?
Je ne mesure pas tous les impacts de cette mesure mais elle m'apparaît pleine de bon sens ; je dirai donc que j'y suis favorable. Nous pourrons l'étudier dans le cadre du projet de loi que j'ai évoqué.

Nous avons eu ce soir une vue précise de la politique publique suivie par votre ministère : vous avez donné des éclaircissements, fait des ouvertures et rétabli certaines vérités, nécessaires pour la bonne diffusion des informations. Comme vous l'avez dit, rétablir la confiance des élus locaux est primordial. Le Printemps de l'évaluation y contribue et je vous remercie, madame la ministre, monsieur le ministre, pour votre implication et pour vos réponses.
Membres présents ou excusés
Réunion du mardi 4 juin 2019 à 21 heures
Présents. - Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Charles de Courson, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Olivier Gaillard, M. Joël Giraud, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Michel Lauzzana, Mme Patricia Lemoine, Mme Véronique Louwagie, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Philippe Vigier
Excusés. - M. M'jid El Guerrab, M. Daniel Labaronne, M. Marc Le Fur, Mme Valérie Rabault, M. Olivier Serva, M. Éric Woerth
Assistaient également à la réunion. - Mme Barbara Bessot Ballot, M. Antoine Herth, M. Sébastien Jumel, Mme Catherine Kamowski, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Dominique Potier, M. Gabriel Serville
———–——