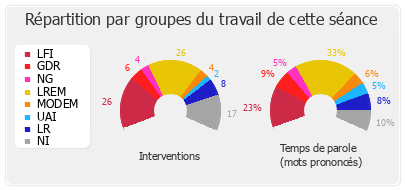Séance en hémicycle du jeudi 1er février 2018 à 21h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.


Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.
La parole est à Mme Elsa Faucillon.

Monsieur le président, madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, monsieur le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, chers collègues, dans le contexte actuel de discrimination connu et avéré, particulièrement marqué dans les quartiers populaires, la proposition de loi relative à la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité résonne pour nous comme une évidence, mais surtout comme une nécessité.
Mes collègues l'ont rappelé : la Cour de cassation a attesté de la réalité des contrôles au faciès, alors même que ceux-ci ne font l'objet d'aucun chiffrage officiel. L'enquête, qui confirme que les jeunes hommes entre dix-huit et vingt-cinq ans perçus comme noirs ou arabes connaissent une probabilité vingt fois plus élevée que le reste de la population de subir un contrôle d'identité, nous invite à légiférer et à mener un combat effréné contre les discriminations.
De trop nombreux contrôles d'identité sont des contrôles au faciès, le fait est établi, mais j'ai entendu des collègues nier cette réalité. Ne pas légiférer serait nier, en ne la prenant pas en compte, en ne la combattant pas, une injustice constituée aussi par l'impossibilité, pour les citoyens victimes de discrimination, d'obtenir gain de cause devant la justice.
L'omertà nuit à tous : aux victimes, qui se sentent trop souvent méprisées, mais aussi aux forces de l'ordre, accusées de bénéficier d'une impunité manifeste. Nous ne pouvons nous résigner à voir aujourd'hui, dans notre pays, de telles inégalités liées à la couleur de peau. Il y va de l'avenir de notre jeunesse, de sa confiance en une République juste, solidaire et protectrice.
Tous les arguments qui mettent en avant la complexité de la procédure proposée, sa lourdeur administrative, constituent une humiliation supplémentaire pour ceux qui sont humiliés. Quant aux arguments fondés sur la confiance de principe que l'on doit témoigner à l'institution policière, ceux qui les avancent ne comprennent pas le problème auquel nous sommes confrontés.
Nous parlons bien de discrimination, ce qui signifie qu'une telle situation ne concerne évidemment pas toute la société. En revanche, dans les quartiers populaires, le taux de méfiance est identique dans la population et dans la police : les policiers se méfient autant de la population que celle-ci se méfie d'eux, ce qui doit nous alerter.
Les dispositifs de contrôle actuels contiennent, nous le constatons, de trop nombreuses faiblesses. Ainsi, les caméras individuelles portées par les agents sont des dispositifs d'enregistrement actionnés manuellement par le policier, quand celui-ci le juge nécessaire, ce qui introduit dans le dispositif une part d'arbitraire. J'ajoute que la demande du numéro de matricule de l'agent de police par la personne contrôlée reste encore sujette à une trop grande part d'aléa ; parfois, les agents refusent tout simplement de porter leur matricule, ce qui est pourtant devenu obligatoire.
A contrario, le récépissé de contrôle d'identité, déjà testé, a fait ses preuves et démontré son efficacité dans de nombreux pays. De l'avis même des policiers qui l'ont expérimenté, il leur permet de se concentrer sur des missions essentielles, utiles à toutes et tous : filatures, investigations ou régulation de la circulation.
Avancer vers cette mesure de justice – promesse qui, à force d'être trahie, finit par ressembler à une insulte – , c'est aussi s'engager dans la voie d'un rapport renouvelé entre la police et les citoyens. Nous y aspirons toutes et tous. Pour cela, il faut évidemment des moyens, mais pas seulement. Il s'agit aussi de décider de quelle police nous voulons. Le groupe communiste, pour sa part, fait résolument le choix d'une police qui sera respectée parce qu'elle respecte tout le monde, parce qu'elle sert de manière universelle et impartiale. C'est un enjeu crucial tant pour la paix publique que pour la cohésion sociale. Je crois que cela fait partie du rôle que doivent se fixer notre police et notre République.
Restaurer la confiance est notre seule voie, car l'escalade de la méfiance ne fera naître que de nouvelles humiliations mais aussi de nouveaux drames plongeant des familles dans l'horreur et l'injustice. S'ouvrir sur la société, opter pour une évaluation indépendante, voilà un débat de société que peut engager l'expérimentation du récépissé. Voter cette proposition de loi, c'est donc agir pour l'égalité, et c'est aussi avoir l'ambition d'une police assez efficace pour protéger toutes et tous. Restaurer la confiance prendra du temps, il faut être lucide sur ce point. Alors, n'en perdons pas, et commençons dès à présent !
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et FI.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, nos collègues de la France insoumise nous proposent de discuter sur une proposition de loi visant à mettre en place à titre expérimental un récépissé de contrôle d'identité pour lutter contre les contrôles répétés dont certains de nos concitoyens feraient systématiquement l'objet. Dans l'exposé des motifs, nos collègues expliquent que ce récépissé répondrait au besoin d'établir une traçabilité des contrôles. Une telle proposition a déjà été faite, et à plusieurs reprises, mais cette mesure a toujours été repoussée ou abandonnée, à juste titre.
En effet, la crainte que ce récépissé, constituant un totem d'immunité que les individus pourraient brandir pour éviter des contrôles ultérieurs justifiés, ne soit un dispositif de défiance envers nos forces de l'ordre, justifiait et justifie aujourd'hui encore que nous refusions sa mise en oeuvre. Qu'il y ait eu et que persistent des contrôles d'identité irrégulièrement effectués etou motivés, nous ne le contestons pas, loin de là. Mais gardons-nous de vouloir, avec cette proposition, les généraliser, et surtout, à l'inverse, évitons le piège de la stigmatisation !
Au contraire, il nous faut à tous adresser un message positif. J'ose faire aujourd'hui le pari de la confiance et croire que, depuis plusieurs mois, le rapport de confiance entre citoyens et forces de l'ordre s'est restauré. Et c'est en cela que nous échouerons si nous devions, nous, représentants de la nation, par nos mots, renouer avec des maux que nous condamnons tous. Gardons-nous de laisser penser, en autorisant le contrôlé à contrôler le contrôleur, que nous doutons, que nous nous défions de celles et ceux qui ont pour mission essentielle et primordiale de nous protéger et d'assurer notre sécurité !
Je tiens à rappeler que le cadre juridique des contrôles d'identité est défini et encadré par le code de procédure pénale, et précisé et réitéré par la jurisprudence. Aussi, affirmer que le récépissé doit permettre aux citoyens qui s'estiment discriminés de disposer de bases matérielles pour prouver qu'ils sont contrôlés de manière trop répétitive, c'est nier les décisions jurisprudentielles récentes. Bien plus, c'est omettre sciemment de dire que nos concitoyens ont déjà le droit et les moyens d'ester, et c'est aussi feindre d'entretenir des tensions que nous nous souhaitons apaiser. Je vous le rappelle en effet, chez collègues : ces dispositifs juridiques préexistent à votre proposition.
D'abord, le cadre du contrôle d'identité de police administrative ou de police judiciaire est parfaitement délimité par l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui exige, pour justifier le contrôle, des « raisons plausibles de soupçonner » ou laissant penser que le contrôlé a commis ou va commettre une infraction, ou y a participé ou va y participer. Ce contrôle a vocation à prévenir les atteintes. Dès lors, les fonctionnaires sont obligés d'indiquer le motif du contrôle quand celui-ci donne lieu à une procédure.
Ensuite, la jurisprudence a pris la mesure du problème et, à ce titre, a déjà réagi, notamment le 9 novembre 2016, lorsque la Cour de cassation a jugé que les contrôles discriminatoires constituent une faute lourde commise par l'État, auquel incombe alors la charge de prouver qu'il n'y a pas discrimination lors d'un contrôle. Le récépissé constituerait donc un renversement de la charge de la preuve, sans pertinence probante au sens de la jurisprudence.
Cela ne veut pas dire a contrario que les policiers ou les gendarmes ont champ libre. Déjà, en 1993, le Conseil constitutionnel estimait que tout contrôle d'identité doit être motivé, les policiers devant justifier « de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public », ajoutant à cela en 2017 qu'« il incombe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ».
Dès lors, comment ne pas penser que ce récépissé participera d'une spirale qui exacerbera les tensions en détournant le contrôle de ses intérêts et du bien-fondé de ses objectifs, en autorisant, je le répète, le contrôlé à contrôler le contrôleur ? Vous voudriez prendre le risque d'inverser la responsabilité, les forces de l'ordre devant alors justifier qu'elles opèrent le contrôle pour prévenir le trouble à l'ordre public.
Plus préjudiciable et invraisemblable encore serait la situation qui naîtrait assurément de ce récépissé dans le cadre d'une enquête judiciaire. Imaginez-vous cette situation incongrue, pour ne pas dire parfaitement ubuesque : les forces de police ou de gendarmerie devront, pour délivrer un récépissé recevable, indiquer comme motivation de celui-ci certains des éléments d'enquête, des éléments de suspicion qui, en l'occurrence, sont bien sûr ces mêmes motifs qui justifient l'ouverture d'une procédure et bien entendu le contrôle d'identité ! Irréaliste et dangereux !
Permettez-moi donc de douter de la pertinence et de l'intérêt d'un tel formulaire, à moins que vous ne vouliez doter les fauteurs de troubles de moyens procéduraux et de dispositifs d'entrave à la justice. Ce récépissé pourrait le devenir, car rien ne nous est confirmé quant à sa portée réelle. L'absence de motivation, ce serait un contrôle annulé ; un contrôle annulé, c'est un acte de procédure vicié. Or un acte de procédure vicié, c'est trop de risques quand le fauteur est un fauteur.
Par contre, bien sûr, il nous faut travailler à rendre les contrôles d'identité plus lisibles. Assurément, nous devons nous assurer de sanctionner les agissements pervertis, quel qu'en soit l'auteur, quand ils existent et persistent. Mais prenons garde qu'en imposant un formalisme administratif supplémentaire et une forme de récépissé trophée, nous ne donnions une caution aux fauteurs et nous n'obligions l'autorité à passer la main en matière de sécurité !

Nous devons faire oeuvre de continuité – car il serait plus sage de nous laisser le temps d'apprécier l'expérimentation des contrôles et de l'évaluer avant d'en préjuger – et surtout, mes chers collègues, conserver toute la confiance envers nos forces de l'ordre, dans le respect de nos principes républicains.
Applaudissements sur les bancs du groupe REM.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, il y a des moments où, comme diraient certains, il faut choisir son camp. Et manifestement, nous ne sommes pas tous, ici, du même camp. Le mien, c'est celui de la sécurité, des forces de sécurité et des braves gens, des honnêtes gens.
Or que nous propose cette proposition de loi, derrière une rhétorique qu'on connaît par coeur, consistant à toujours trouver des excuses à ceux qui ne s'excusent jamais, et à chercher des poux dans la tête à ceux qui sont là pour nous porter secours et nous protéger ? Ce texte propose la mise en place d'un récépissé lors des contrôles d'identité, au moment même, permettez-moi de le relever, où les forces de l'ordre doivent faire face à une recrudescence des agressions qui ont bouleversé non seulement les policiers, mais la France, celle des honnêtes gens, justement. Un récépissé en deux volets, pour éviter qu'on ne fiche les personnes contrôlées, pour permettre les recours devant l'inspection générale de la police nationale et pour ne pas violer les sacro-saintes règles de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Bref, soyons clairs, un récépissé qui sonne comme une présomption de culpabilité à l'égard de nos policiers, soupçonnés d'être des délinquants en puissance, puisque présumés toujours tentés par ces contrôles au faciès dont seraient victimes des contrôlés toujours blancs comme neige, cela va de soi.
La semaine dernière, j'ai accompagné des policiers dans leur ronde de nuit. Ils ont procédé à des contrôles d'identité, bien sûr, envers des personnes de toutes couleurs de peau, je vous rassure, et bingo : il y a eu 100 % de réussite ! tous ceux qui ont été contrôlés avaient quelque chose à se reprocher, de la conduite sans permis ni assurance à la possession de stupéfiants ! De petits délits, me direz-vous ; mais des délits quand même !
Les récépissés que vous réclamez ne constitueraient ni plus ni moins qu'un peu plus de bureaucratie, à l'heure où tous, citoyens comme policiers, aspirent à voir nos forces de l'ordre débarrassées de cette paperasse qui les tient beaucoup trop éloignées du terrain.
Si je ne m'inquiète pas du résultat du vote de la proposition de loi, je m'inquiète en revanche de ce qu'elle véhicule : d'abord, je l'ai dit et je le redis, une véritable suspicion, une défiance à peine voilée à l'égard de nos policiers, mais aussi un mensonge. Comme si les policiers pouvaient agir à leur guise, comme s'ils n'étaient pas encadrés par la loi. Mais, vous le savez – ou plutôt, vous faites semblant de ne pas le savoir – , le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l'homme se sont penchés sur ce dossier. Et, lorsqu'il y a des abus, ils sont réprimés, Mme la ministre l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure.
Quant au code de la sécurité intérieure, il dispose déjà que « le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler » : difficile de faire plus clair ! Mais, manifestement, ce n'est pas encore assez pour les auteurs de ce texte. Entraver le travail des forces de l'ordre ne les dérange pas ; jeter l'opprobre sur les forces de l'ordre ne les trouble pas. Ils n'ont qu'un mot à la bouche : il ne faudrait pas « humilier », disent-ils, l'éventuelle victime innocente d'un abominable contrôle au faciès ! Mais humilier des gardiens de la paix…

Certes ! Humilier des gardiens de la paix et des gendarmes en doutant toujours de leur probité, de leur professionnalisme, ça ne leur pose aucun problème.

De ce côté-là, pas d'état d'âme ! Alors, quitte à m'attirer les foudres de nos « droits-de-l'hommistes » de salon – ou plutôt d'Assemblée – , je leur répondrai qu'être contrôlé quand on n'a rien fait, quand on n'a rien à se reprocher, ne me semble pas attentatoire aux libertés, mais est en revanche bien utile pour assurer notre sécurité. Oui, décidément, nous ne sommes pas dans le même camp !

Nos policiers ont besoin de liberté, d'efficacité, non de contraintes. Ils ont besoin qu'on leur fasse confiance ; ils ont besoin qu'on soit à leurs côtés. Dois-je aussi vous rappeler le nombre de suicides dans leurs rangs ?
La semaine dernière, je vous l'ai dit, j'étais avec des policiers de Béziers. Ils s'appellent Philippe, Bruno, Mohamed, Jean-Michel – les prénoms sont vrais, vous pouvez vérifier. Sur les murs de certains quartiers, on peut lire leurs noms, assortis de menaces de mort. Il y a quinze jours, Guillaume, un policier municipal, s'est fait foncer dessus par un voyou en voiture et a été grièvement blessé.

Les risques du métier, me direz-vous ? Tous sont d'honnêtes hommes, respectueux des lois, au service de leurs concitoyens, véritables soutiers de la République et de notre sécurité. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis absolument de leur côté !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi repose sur un argument central avec l'esprit duquel nous sommes tous – ou plutôt presque tous – d'accord ici : toute discrimination opérée dans le cadre des contrôles d'identité est inacceptable. En effet, il est de notre responsabilité, en notre qualité de représentants de la nation, de prévenir les situations d'abus et de discrimination envers nos concitoyens. Il est au coeur de notre mission de contrôle de la loi de veiller au respect des valeurs de notre République et, au-delà, d'assurer une vigilance citoyenne concernant la protection des droits fondamentaux.
À cet égard, il a été constaté que la police française réalisait proportionnellement plus de contrôles d'identité que d'autres polices dans des pays comparables et que cet état de fait était à l'origine de tensions suscitant, chez une partie de la population, un sentiment de discrimination. Toutefois, chers collègues, ne nous trompons pas d'outils en cherchant à apporter une réponse volontariste et efficace à ceux qui souffrent de ces discriminations. S'il est de notre responsabilité de veiller scrupuleusement au respect des droits fondamentaux, tout comme d'affecter à cette mission des moyens de contrôle efficaces et pertinents, ces moyens existent déjà et seront même renforcés.
Nous vivons, rappelons-le, dans un État de droit, et notre police est une police républicaine.

Ce point de départ fondamental doit être le postulat de notre réflexion. Dire que notre police est républicaine, c'est affirmer que, par principe, elle ne discrimine pas, qu'elle est là pour protéger les citoyens et assurer la sécurité publique. Cela signifie, en d'autres termes, que la non-discrimination est la règle et que la discrimination est l'exception.
Lorsque l'exception se produit, notre État de droit offre toutes les possibilités de recours et de sanctions à même de répondre fermement à ces abus. En ma qualité de commissaire aux finances et de co-rapporteure spéciale pour le budget de la police et de la gendarmerie, je vous rappelle que des investissements importants ont été consentis en faveur des dispositifs de contrôle des vérifications d'identité. La présente proposition de loi vise à instaurer, par le récépissé, une nouvelle modalité de contrôle, qui viendra s'ajouter aux nombreux dispositifs existants, voire faire double emploi avec ces derniers, en poursuivant le même objectif.
En effet, si l'objectif est d'assurer une traçabilité des contrôles et de les quantifier, il est déjà rempli par la mise en service auprès des forces de l'ordre de 67 000 tablettes numériques NeoGend et de 28 000 tablettes NeoPol, dont le déploiement est appelé à s'accroître au cours des prochaines années, avec notamment un budget de 6 millions d'euros prévu dans la loi de finances pour 2018. Une garantie supplémentaire est apportée par le dispositif des caméras-piétons, en cours d'expérimentation, qui seront déployées dans les zones où les situations conflictuelles ont plus de risques de se produire. D'ores et déjà, 2 800 caméras-piétons sont utilisées, et 5 000 appareils supplémentaires seront progressivement mis en service. Cet effort se traduit également dans la philosophie même de la police de sécurité du quotidien, qui a pour essence de rebâtir le lien de confiance entre la police et la population.
Notre politique a pour ambition de traiter la lutte contre les discriminations dans une approche d'ensemble, pour plus d'efficience. Cela sera permis par deux types de mesures : premièrement, par des mesures budgétaires et des moyens supplémentaires pour les forces de l'ordre, afin de faciliter leur mission de sécurisation, dans un climat de forte menace et de grande tension ; deuxièmement, en proposant un nouveau paradigme pour retisser le lien entre police et population, dans lequel l'enjeu est de reconsidérer la police dans sa vocation première, à savoir celle de la proximité avec la population.
Chers collègues, le dessein de cette proposition de loi est certes noble, en ce qu'elle s'attache à mettre en lumière l'impérative lutte contre les discriminations. Néanmoins, les moyens que ce texte propose sont, hélas, superfétatoires : l'ajout d'un nouveau dispositif, sans même évoquer les lourdeurs administratives qu'il induira, n'aura aucune valeur ajoutée. Pire, le dispositif proposé n'aura aucune efficacité dans la lutte contre les discriminations. Au contraire, il contribuera à nourrir la suspicion entre les citoyens et les forces de l'ordre, alors que l'enjeu de notre action collective est précisément l'inverse : créer les conditions de l'apaisement et de la sérénité pour assurer la sécurité de tous.

Ça marche drôlement bien ! On l'a vu le week-end dernier à Villeneuve-la-Garenne !

Pour l'ensemble de ces raisons, j'invite les députés à voter cette motion de rejet et à unir leurs efforts pour lutter contre les discriminations et rebâtir le lien de confiance entre la police et la population.
Applaudissements sur les bancs du groupe REM.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, entre une mesure juste et une disposition démagogique, il n'y a qu'un pas, que la mise en place d'un récépissé fait franchir certains. Elle vient mettre de l'huile sur le feu, dans un contexte déjà tendu.
Nos forces de l'ordre font face à des individus qui se sont professionnalisés dans le recours à la violence et qui attentent intentionnellement à la vie des policiers et des gendarmes. Ce sont tantôt des terroristes, comme à Montrouge en 2015, à Magnanville en 2016 ou sur l'avenue des Champs-Élysées en avril dernier, tantôt des « black blocs » et autres militants des mouvances de l'ultragauche dans les manifestations, tantôt les membres des bandes organisées en milieu urbain, dont l'économie souterraine permet de financer l'achat d'équipements de plus en plus sophistiqués et dangereux. Si ces violences visent directement l'intégrité physique des policiers et des gendarmes, elles se dirigent désormais aussi sur leur famille ; de facto, la mise en oeuvre d'un récépissé serait susceptible d'accroître le danger qui pèse sur ces dernières.

L'épuisement psychologique et physique généré par cette tension permanente pousse à bout certains membres de nos forces de l'ordre, et se traduit parfois par des dérapages.
Croire qu'un récépissé serait l'outil de prévention adéquat de ces situations est une erreur, car ces phénomènes ne sont que l'expression d'un mal-être bien plus profond.
Votre proposition de loi, chers collègues, méconnaît profondément les besoins de nos forces de l'ordre. Elle méconnaît les trois conditions d'une relation apaisée entre population et forces de l'ordre : confiance, légitimité et reconnaissance. Les Français le savent bien : la police est la quatrième institution en laquelle ils ont le plus confiance, d'après la dernière enquête du CEVIPOF – Centre de recherches politiques de Sciences Po – , publiée en janvier. Assermentées, formées, nos forces de l'ordre ont une totale légitimité pour agir afin de protéger nos concitoyens et veiller au respect de l'ordre public. Quelle est l'utilité de conserver cette assermentation si l'on met en place un récépissé pour chaque contrôle d'identité, si l'on part du postulat que nos forces de l'ordre n'honorent pas leur serment, que leurs années de formation ne leur permettent pas d'exercer leurs missions avec compétence, qu'elles sont incapables d'avoir un jugement adapté sur la réaction à adopter selon la diversité des situations auxquelles elles font face ? Mettre en place un récépissé, c'est adouber l'idée que toute action d'un membre de nos forces de l'ordre est suspecte ; c'est douter de la capacité de discernement de nos forces de l'ordre ; c'est faire le procès en incompétence de nos gardiens de la paix.

Tandis que vous les stigmatisez sans jamais connaître la réalité de leur travail, j'entends, pour ma part, leur exprimer ma profonde reconnaissance. La semaine dernière encore, j'ai eu l'occasion de passer une nuit avec la BAC – brigade anticriminalité – de Roubaix. Les membres de ces équipes quittent conjoint et enfants tard le soir pour passer une nuit à protéger la population civile. Leur professionnalisme et leur dévouement, au regard des risques encourus et des maigres primes attachées à ces astreintes, doivent être salués et honorés.

Ainsi, à rebours de ces trois impératifs – confiance, légitimité et reconnaissance – , votre proposition de loi, chers collègues de La France insoumise, entend institutionnaliser la défiance et saper la légitimité de nos forces de l'ordre. Elle n'apporte in fine aucune solution à l'apaisement souhaité tant par les policiers que par la population.

Dès lors, nous ne pouvons que nous opposer à ce texte et vous inviter à travailler à nos côtés à l'institution d'une police de sécurité du quotidien, proche des citoyens, permettant le plein accomplissement des devoirs et des missions pour lesquels chaque policier, chaque gendarme, est assermenté.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe REM.

La discussion générale est close.
La parole est à M. Éric Coquerel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Chers collègues, les propos qui viennent d'être tenus avaient des tonalités différentes – heureusement, dirai-je. Un premier groupe d'orateurs a nié toute discrimination : M. Masson, Mme Ménard, Mme Osson ainsi que – cela m'a un peu déçu – Mme Vichnievsky. Ces collègues ont essayé, de surcroît, de nous présenter, de manière démagogique, comme sujets à un réflexe anti-flics.
Monsieur Masson, je vous le répète, vous êtes issu d'un parti qui a soutenu M. Sarkozy, lequel a supprimé 13 000 postes de policiers, la police de proximité et des crédits pour la police.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et GDR.

Je trouve donc vos propos un peu fort de café et insultants vis-à-vis des forces de police, dont vous prétendez vous faire le porte-parole. Vous jouez un jeu démagogique en essayant de convaincre la police qu'elle serait une force assiégée, incapable d'évolution. Avec des gens comme vous, le grand plan de formation de Joxe, en 1983, ne serait jamais passé, parce que vous auriez jugé insultant que l'on considère nécessaires de telles mesures pour la police.
Mêmes mouvements.

Je veux dire à Mme Vichnievsky – mais elle n'est plus là – qu'il est également fort de café qu'une ancienne magistrate estime normal qu'un jeune de dix-huit ans, surtout quand il a un profil de noir ou de Maghrébin, soit plus contrôlé qu'une mère de famille de cinquante ans ou un retraité, au motif de la lutte contre le trafic de drogue, alors que 95 % de ces vérifications, quoiqu'en dise Mme Ménard dans ses affabulations, ne donnent aucun résultat. Je suis très déçu que Mme Vichnievsky ait recouru à cet argument discriminatoire.
Je remercie nos collègues des groupes NG et GDR de leur soutien. Par ailleurs, d'autres collègues n'ont pas nié l'existence des discriminations – Mme la ministre elle-même ne l'a pas fait non plus. Certains, il est vrai, les ont sous-estimées, mais j'explique cela par le fait que nous – je dis bien nous – ne vivons pas dans le même monde que les victimes des contrôles au faciès.
Madame la ministre, vous reconnaissez qu'il existe toujours des discriminations et vous énumérez les dispositifs mis en place pour y remédier. Mais je m'étonne que vous citiez des mesures décidées antérieurement aux déclarations de M. Macron pendant la campagne présidentielle. Si ces dispositifs fonctionnaient, pourquoi a-t-il soudainement affirmé qu'il y avait trop de contrôles et que ceux-ci étaient discriminatoires ? Cela traduit l'insuffisance des dispositifs décidés en compensation – je le rappelle – des promesses de M. Hollande sur l'instauration du récépissé.
Si j'étais méchant, madame la ministre, je dirais que vous poursuivez avec une contre-vérité – comme je ne le suis pas, je parlerai d'erreur – s'agissant de votre analyse des arrêts de la Cour de cassation de novembre 2016. Ceux-ci ne se terminent pas en affirmant que c'est à la personne contrôlée de justifier qu'elle a subi un acte discriminatoire. C'est exactement l'inverse : la Cour de cassation estime qu'il est extrêmement compliqué, pour une personne contrôlée, de prouver qu'elle a été discriminée, ne serait-ce que parce que, ne pouvant se référer à des statistiques globales – le contrôle étant évidemment individualisé – , il lui est difficile de montrer qu'elle n'est pas la seule dans ce cas et que c'est parce qu'elle appartient à la catégorie de ceux qui ont vingt fois plus de chances, ou plutôt de malchances, d'être contrôlés dans notre pays, faute d'être blancs de peau.
Comme M. Morel-À-L'Huissier, vous considérez également que les « raisons plausibles » incluent les « raisons objectives et individualisées ». Là encore, vous invoquez la jurisprudence mais, je suis désolé, celle-ci n'est pas aussi précise. Je vous renvoie au rapport : « La jurisprudence a ainsi admis que constitue une raison plausible désignant une personne à la force publique le fait, pour une personne, de changer de direction ou de trottoir à la vue des agents de police, de marquer un temps d'arrêt et une gêne manifeste au passage d'un véhicule de police ou enfin de tenter de se dissimuler au passage des policiers. En revanche, n'a pas été analysé comme désignant une personne à la force publique le comportement qui consiste à marquer un temps d'hésitation à la vue de la police et à brusquement accélérer le pas ou le fait d'exécuter un brusque demi-tour à la vue de la police ». On voit bien que tout cela est très vague, très flou. Si vous pensez que les raisons plausibles incluent les raisons objectives et individualisées, pourquoi ne pas l'écrire dans la loi ? Au moins, les choses seraient claires.
On nous dit que cela prendrait beaucoup de temps. Je ne comprends pas bien.

Nous l'avons prouvé, et nul ne le conteste ici : la plupart de ces contrôles ne débouchent sur aucune élucidation. Quel temps gâché !
Je ne comprends pas non plus que l'on parle de complexité. Mais enfin, chers collègues, vous venez de voter une loi qui complexifie encore le travail de tous les autres fonctionnaires en leur demandant toujours plus d'arguments pour prouver que le contrevenant est de mauvaise foi. Mais là, puisqu'il est question de la police, il serait impossible de demander non pas plus de complexité mais un papier, un seul papier, parce que c'est la seule procédure qui n'en requiert pas aujourd'hui ! De surcroît, j'ai expliqué tout à l'heure que celle-ci pouvait parfois donner lieu également à des palpations et des fouilles.
Vous évoquez le code de déontologie. D'abord, ce sont surtout des principes qui y sont énoncés. En outre, il ne tient pas compte des recommandations orales.
Vous évoquez aussi les plateformes de signalement de l'IGGN et de l'IGPN – les inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale – , censées permettre aux citoyens de porter plainte. Là, franchement, c'est ne rien comprendre à la réalité du terrain.

En cas de violences extrêmes, les actualités s'en font l'écho et des procès sont très souvent enclenchés. En revanche, la plupart des temps, que se passe-t-il pour les jeunes qui sont humiliés ? Tout à l'heure, un lycéen d'Épinay-sur-Seine prénommé Mammadou était ici. Lorsqu'il est sorti de la gare du Nord avec sa classe et ses professeurs, madame la ministre, il s'est fait contrôler et a été palpé, fouillé et tutoyé. D'habitude, lorsqu'il est contrôlé, il ne dit rien. Là, il a jugé que ce n'était tout de même pas possible de se faire ainsi contrôler, palper et fouiller devant ses copains ; il a donc demandé des explications et le climat a commencé à se dégrader. Heureusement, l'enseignante s'est interposée. Pourquoi vous dis-je cela ? Les enseignants ont conseillé au jeune de porter plainte et il y aura enquête. Mais si ces jeunes avaient été seuls, aucune plainte n'aurait été déposée. En effet, des jeunes sont humiliés en permanence dans les quartiers – non à cause de tel ou tel policier mais à cause du système que vous persistez à maintenir faute d'accepter le récépissé – et ils n'imaginent pas se rendre dans un commissariat où, peut-être, travaille un policier avec qui ils ont des problèmes et contre lequel ils auraient matière à porter plainte. C'est tellement la règle, pour eux, qu'ils n'ont même plus confiance en la justice.
Quant à la plateforme IGPN, vous savez très bien qu'elle n'a été utilisée que 294 fois seulement en 2014, tant elle est d'un usage compliqué.
Oui, il faut autre chose ! Un policier doit normalement être obligé d'écrire le motif du contrôle. Cela aurait été utile, madame la ministre, avec le jeune Mammadou. Des avocats se sont mêlés de l'affaire. Savez-vous ce que vos services ont répondu ? Il a été arrêté à la sortie de la gare du Nord parce que des risques terroristes ou de trafic de drogue existent à la sortie du Thalys. Pardon, mais c'est là toute autre chose qu'une « raison objective et individualisée » ! Si un lycéen sort avec sa classe, on peut penser qu'il n'a pas grand-chose à voir avec un terroriste. En l'occurrence, le contrôle était absolument dépourvu de motif, et il y en a ainsi, malheureusement, de dizaines de milliers d'autres dans notre pays.
Un problème se pose donc bien, et vous me répondez : tablettes et caméras. Si j'ai bien compris l'un de vos arguments, le papier n'est pas moderne. J'en tombe à la renverse ! Si tel est l'argument pour expliquer votre refus de mettre en place quelque chose de simple, supprimons donc toutes les contraventions et autres procès-verbaux !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Vous proposez donc tablettes et caméras. Pas de problème, une expérimentation est en cours, mais c'est le policier qui enclenche la caméra, laquelle filme uniquement la personne contrôlée. Contrairement au récépissé, elle ne permet donc pas à cette dernière, éventuellement, de réagir face à un contrôle qu'elle estime injustifié. Vous faites l'expérience des GoPro ; pourquoi pas ! Mais en quoi cela vous gêne-t-il que quelques villes expérimentent le récépissé, avant que nous ne nous réunissions tous, tous ceux – et j'ai entendu que c'était votre cas – qui pensons qu'un problème se pose ? Nous établirions ainsi la meilleure façon de faire. Ce n'est pas très compliqué et cela ne coûte pas cher.

J'entends les arguments de chacun. Certains disent que cette idée a été proposée de nombreuses fois, que c'est un vieux débat – pas tant que cela, d'ailleurs, et c'est même la première fois qu'une expérimentation est proposée. Mais alors, tranchons-le par une expérimentation ! Sans arrêt, chers collègues, vous faites état de missions, d'expérimentations dont il faut attendre les résultats. Eh bien, faisons une expérimentation dont les résultats sont attendus par beaucoup de monde ! Je vous assure que des centaines de milliers de jeunes des quartiers populaires l'attendent.

Ce n'est pas là remettre en question la police ou les policiers ; c'est simplement reconnaître qu'un système ne fonctionne pas. On a le droit de le dire à l'administration policière, et je pense même que ce serait bénéfique pour elle.
J'espère qu'après mon intervention, vous rejetterez la motion de rejet préalable, de façon à ce que nous puissions continuer le débat.
Enfin, madame la ministre, vous avez affirmé que la méthode d'expérimentation proposée, dans les villes volontaires, n'est pas satisfaisante. Pas de problème ! Nous voulons bien l'entendre, mais amendez le texte !

Nous sommes prêts à le faire avec vous, à vous écouter, à avancer ensemble. Croyez-moi, beaucoup de gens attendent une telle mesure, y compris dans la police, contrairement à ce que certains nous disent ici.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et GDR.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés du groupe La France insoumise, vous êtes persuadés que votre système réglera le problème de la discrimination.
Protestations sur les bancs du groupe FI.
Pour ma part, je n'en suis absolument pas persuadée.
Protestations sur les bancs du groupe FI.
Je peux parler ? J'ai écouté le rapporteur ! Calmez-vous !
Si ce système était aussi efficace que vous le dites, il serait utilisé dans de nombreux pays.
Or un seul pays a mis ce système de récépissé en place : l'Angleterre.
En Espagne, une seule ville l'a adopté. Contrairement à ce que vous indiquez, rien n'en démontre l'efficacité pour lutter contre le délit de faciès, que tout le monde condamne. Vous vous livrez à des interprétations, en prétendant que l'on vous reproche, par exemple, de ne pas défendre la police.
Mais ne nous accusez pas d'être favorables au contrôle au faciès !
Très bien ! J'apprécie que vous l'admettiez !
Applaudissements sur les bancs du groupe REM.
Nous reconnaissons tous ici le rôle de la police et de la gendarmerie, et nous sommes contre le délit de faciès.
Dans mon propos liminaire, j'ai expliqué combien l'action de la police était encadrée par la loi, par la déontologie, etc.
D'ailleurs, la police est contrôlée sans arrêt : par la hiérarchie, par l'IGGN et l'IGPN, par les magistrats ! En France, il existe un cadre légal ; nous sommes dans un État de droit, il faut le rappeler.
Par ailleurs, vous mettez en cause l'analyse juridique de l'arrêt de la Cour de cassation. Contrairement à ce que vous avez dit, je suis désolée : « il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Nous sommes donc d'accord. Il est très bien de reconnaître que je ne me suis pas trompée dans mon analyse.
Reconnaissez tout de même la première partie de la proposition.
Exclamations sur les bancs du groupe FI.
L'essentiel, monsieur Coquerel, c'est que nous soyons d'accord.
Enfin, vous prétendez que nous ne tranchons pas. Mais si ! Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas de votre avis que nous ne tranchons pas !
Applaudissements sur les bancs du groupe REM.
Nous tranchons dans le sens qui nous semble légitime, qui nous semble le meilleur, et ce n'est pas la première fois. Vous avez le droit de défendre votre position mais laissez à d'autres la liberté d'en avoir une autre. Je vous remercie de m'avoir écoutée.
Mêmes mouvements.

J'ai reçu de M. Richard Ferrand et des membres du groupe La République en marche une motion de rejet préalable, déposée en application de l'article 91, alinéa 10, du règlement.
La parole est à M. Éric Poulliat.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, l'une des missions prioritaires de l'État est d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
Le paysage de la sécurité nationale a sensiblement évolué ces dernières années et la nature de la menace terroriste a opéré des mutations profondes. Il y a dix ans, l'écosystème terroriste était composé de groupes organisés et complexes. Aujourd'hui, alors que le niveau de cette menace reste très élevé, on constate une évolution de celle-ci, prenant la forme d'individus ou de petits groupes isolés menant des attaques de manière solitaire. Comme François Molins le rappelait la semaine dernière : « La menace terroriste est plus diffuse, plus difficile à cerner, étant donné qu'elle se produit chez nous et qu'elle peut être le fait de gens qui ne sont pas toujours connus des services de renseignement. Elle est donc endogène et souvent liée à d'autres formes de délinquance. » Nous pouvons aussi déplorer les liens existants entre la criminalité et le terrorisme manifestés à travers un certain nombre de cas, comme celui de Mohamed Lamsalak, soupçonné pour ses liens avec les attentats de Bruxelles en 2016 et impliqué dans des affaires de stupéfiants.
À cela s'ajoute une délinquance de plus en plus présente dans notre quotidien : trafic de stupéfiants, vols, cambriolages, occupations des halls d'immeubles, incivilités dans les rues et, plus récemment, harcèlement de rue pour les femmes. Alors que la voie publique devrait être un espace partagé dans lequel chacun respecte les règles de vie en société, elle devient un espace dans lequel la coexistence est de moins en moins facile. Les missions de nos forces de l'ordre, parce qu'elles s'exercent en partie sur la voie publique, sont par conséquent de plus en plus complexes, et l'autorité des policiers et des gendarmes peine à s'affirmer dans certains de nos quartiers. Cela fait naître chez nos concitoyens un sentiment d'insécurité et donne l'image d'une impuissance publique.
Replacer les relations entre les forces de l'ordre et la population au coeur du débat parlementaire relève non seulement d'une nécessité mais aussi d'un besoin eu égard au contexte sécuritaire particulièrement difficile que je viens de rappeler. Notre majorité et notre Gouvernement n'ont pas caché leur volonté de mener une réflexion approfondie en ce sens.
Je me réjouis que le Gouvernement ait engagé une évolution des missions de la police et de la gendarmerie pour répondre à la priorité des Français, la sécurité. En ce sens, la loi de finances que nous avons adoptée en décembre dernier renforce les moyens humains des forces de sécurité intérieure, à hauteur de 2 000 emplois supplémentaires sur le terrain. De nouveaux modules de formation seront par ailleurs mis en oeuvre. Le budget, qui est en augmentation, sera préservé pour les années à venir.
Certes, le contexte sécuritaire est difficile, et un sentiment de défiance s'est instauré dans certains quartiers sensibles entre les forces de l'ordre et les habitants. Il faut néanmoins souligner que ce sentiment n'est pas la norme, loin de là, contrairement à ce que l'exposé des motifs de la proposition de loi laisse entendre. Comme cela a déjà été rappelé, le CEVIPOF relève en effet que 78 % des Français font confiance à la police, et je souligne que ce pourcentage a augmenté de 3 points par rapport à l'année 2016.
Cependant, ce n'est pas parce que seuls 9 % des Français ne font pas du tout confiance à la police qu'il faut occulter certaines réalités. Les contrôles d'identité sont un sujet polémique depuis plusieurs années, en particulier dans les quartiers sensibles, où les contrôles peuvent parfois susciter des crispations, voire des abus. Le groupe La République en marche est très attaché à ce que de telles pratiques discriminatoires, inacceptables, ne viennent pas ternir l'image de nos forces de l'ordre et porter atteinte à la liberté de nos concitoyens. Les discriminations, qu'elles soient liées à l'orientation ou à l'identité sexuelles, aux convictions religieuses, au sexe, à l'âge, à la couleur de peau, n'ont pas leur place dans notre société, et d'autant moins au sein des institutions représentant les valeurs républicaines et laïques.
Je veux néanmoins garder à l'esprit que notre police est et demeure républicaine. Par principe, elle agit sans discriminer, et tout un arsenal juridique existe pour empêcher que d'éventuelles discriminations aient lieu. Même si vous les jugez insuffisantes, permettez-moi de rappeler ces dispositions juridiques.
Le code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales, entré en vigueur le 1er janvier 2014, encadre le déroulement concret des contrôles d'identité. L'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure dispose : « Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. » De même, l'article R. 434-15 du même code prévoit l'identification individuelle des agents par leur matricule. Enfin, l'article 211 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoit l'usage des caméras mobiles lorsqu'un contrôle d'identité est effectué. En outre, je le rappelle, des plateformes internet de l'IGPN et de l'IGGN permettent aux particuliers de signaler tout manquement déontologique des forces de l'ordre, et, si quelqu'un estime avoir fait l'objet d'un contrôle discriminatoire, il peut évidemment saisir le juge.
La jurisprudence est claire à ce sujet et elle encadre ces contrôles. Le Conseil constitutionnel, saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, a établi, dans sa décision du 24 janvier 2017 : « La mise en oeuvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. » De même, lorsque des discriminations sont constatées, les juridictions n'hésitent pas à prononcer des sanctions.
Le débat que nous entamons aujourd'hui autour de la proposition de loi déposée par nos collègues de La France insoumise n'est pas nouveau. En effet, en 2016, des propositions similaires ont été formalisées dans des amendements déposés sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, ainsi que sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. De même, plusieurs propositions de loi visant à lutter contre les contrôles abusifs ont été déposées. Mais l'ancienneté d'un problème ne rend pas forcément pertinente la solution de celui qui a la volonté de le résoudre, aussi sincère soit-il – et je ne ferai pas au rapporteur et aux membres de son groupe l'offense de remettre en cause leur sincérité.
Au-delà de son caractère inopportun, cette proposition de loi, notamment dans ses deux premiers articles, présente, à mes yeux, des problèmes opérationnels.
L'article 1er vise à modifier l'article 78-2 du code de procédure pénale, en précisant qu'un contrôle d'identité ne doit plus être effectué pour des « raisons plausibles », mais pour des « raisons objectives et individualisées ». Pourtant, la rédaction de l'article 78-2 ne souffre d'aucune imprécision : il définit de manière précise les circonstances dans lesquelles un contrôle d'identité peut être effectué. Il dispose ainsi : « Les officiers de police judiciaire [… ] peuvent inviter à justifier [… ] de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu'elle se prépare à commettre un crime [… ] ; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles [… ] ; ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ». Le contrôle d'identité doit donc d'ores et déjà être fondé sur des éléments objectifs liés à la prévention d'atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens ou à la recherche d'infractions et à la découverte de leurs auteurs. Par ailleurs, la notion de « raisons plausibles de soupçonner » est bien ancrée dans notre droit. Le droit pénal y fait expressément référence, à propos de la garde à vue et de la mise en examen. De même, le droit administratif emploie une formule similaire : « des raisons sérieuses de penser ». Il n'y a donc aucun besoin de changer la rédaction actuelle de l'article du code.
L'article 2 entend mettre en place, à titre expérimental pour une durée d'un an au plus, l'établissement des récépissés de contrôle d'identité dans les communes qui en formulent la demande. Il définit par ailleurs la procédure de contrôle. Plus précisément, il prévoit qu'à chaque contrôle, les agents des forces de l'ordre rempliront un formulaire, dont un volet sera remis à la personne et un autre sera conservé par le service de police. Pour des raisons de protection de données, seul le volet remis à la personne permettra son identification. L'objectif mis en avant par nos collègues est de limiter les contrôles abusifs et répétés, mais la procédure qu'ils proposent ne permettra pas de l'atteindre, pour plusieurs raisons.
Premièrement, même si les contrôles peuvent être tracés par le récépissé, cela ne suffit pas à démontrer le caractère discriminatoire du contrôle, la répétition n'étant pas synonyme de discrimination.
Deuxièmement, l'absence d'identification précise de la personne contrôlée peut donner lieu, dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile ou dans un contexte de défiance entre la police et les citoyens, à de possibles falsifications.
Troisièmement, l'établissement obligatoire d'un récépissé spécifiant le motif de chaque contrôle entraînerait une surcharge considérable de procédure, allongerait substantiellement la durée des contrôles et alourdirait la tâche des fonctionnaires. Or cela va à l'encontre de notre volonté et de celle du Gouvernement, puisque nous souhaitons numériser et alléger le plus possible les procédures auxquelles sont soumises les forces de l'ordre, afin qu'elles se concentrent sur leurs tâches essentielles. Votre proposition va à rebours de l'évolution des procédures, faite d'allégements, de simplification et de dématérialisation.
Une partie des difficultés opérationnelles et de principe que je viens d'invoquer a conduit la précédente majorité à écarter la mise en place d'un récépissé pour lutter contre le délit de faciès lors des contrôles d'identité. Le groupe La République en marche partage ces réserves, et l'on peut s'étonner que certains collègues du groupe Nouvelle Gauche, qui siégeaient dans l'ancienne majorité, semblent avoir changé d'avis.
Une solution alternative a d'ailleurs été mise en oeuvre : les caméras-piétons. En effet, depuis le 23 décembre 2016, la loi donne aux policiers équipés d'une caméra-piéton la possibilité de filmer certaines de leurs interventions. L'article 211 de la loi du 27 janvier 2017 prévoit d'expérimenter l'enregistrement systématique des contrôles d'identité réalisés en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans certaines zones définies par arrêté ministériel et pour les policiers équipés de caméras. L'usage par les forces de l'ordre des caméras mobiles dans l'exercice de leurs missions a pour but de prévenir des incidents au cours des procédures, de constater des infractions et de poursuivre leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que de vérifier que les agents respectent leurs obligations. Ces enregistrements sont donc de nature à dissuader d'éventuels contrôles abusifs, d'autant que, si plusieurs caméras filment la même scène, on peut disposer de plusieurs points de vue.
L'expérimentation des caméras-piétons a été programmée pour un an, à compter du 1er mars 2017, et 2 000 d'entre elles sont actuellement en dotation, essentiellement auprès des policiers affectés dans les zones de sécurité prioritaire. Le bilan de cette expérimentation n'est prévu, par décret, que dans un délai de trois mois suivant la fin de l'expérimentation, c'est-à-dire en mai ou juin 2018. Faute de bilan intermédiaire, il est prématuré de prévoir l'expérimentation d'un nouveau dispositif avant d'avoir dressé le bilan du précédent. L'expérimentation est une pratique que nous apprécions.

Il faut cependant leur donner une chance avant de prendre toute autre initiative.
Vous évoquez, à propos d'expérimentations, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Or il semble que le nombre de contrôles ait doublé en Grande-Bretagne depuis 2001. Je vous accorde qu'ils sont devenus beaucoup plus efficaces, mais cela n'a aucun effet sur le profilage racial : à Londres, un noir a toujours 4,5 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc – c'est Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui le déclarait sur Europe 1 il y a quelques mois. En Espagne, les retours d'expérimentation montrent également que le temps consacré par les policiers à cette procédure est un véritable frein à son élargissement. Le bilan, on le voit, est donc très mitigé.
En conclusion, cette proposition de loi remet sur la table un problème récurrent mais lui apporte une ancienne fausse bonne réponse, une vielle réponse à un vieux débat, à un moment inopportun, avec des arguments discutables.
Ce n'est pas en contrôlant les contrôleurs que nous allons sortir de la logique de défiance entre les forces de l'ordre et les citoyens. L'introduction du récépissé ne permettra pas de changer cette situation car elle ne fait que changer la cible de la suspicion. Le groupe La France insoumise souhaite que la suspicion change de camp : ce n'est plus la personne contrôlée qui est suspecte, mais c'est le policier qui le devient. Il est évident que l'introduction d'un récépissé, surtout dans cet esprit, ne peut pas être bien reçue par nos forces de l'ordre, qui y voient une remise en cause de leur travail. Vous comprendrez qu'au lieu de rétablir la confiance là où elle a été brisée, vous ne faites là qu'accroître la défiance.
Nous devons sortir de la logique de contrôle et donner une réponse plus profonde. Nous devons sortir de la culture du contrôle d'identité comme moyen d'affirmation de l'autorité policière. Il vaut mieux miser sur le recrutement et la formation, d'une part, et sur des modes d'action plus adaptés et plus mobiles, d'autre part, que sur l'introduction d'une énième procédure administrative qui ne fait qu'alourdir le travail de nos forces de l'ordre.
La police de sécurité du quotidien permettra de sortir de la logique des contrôles d'identité systématiques et de retisser le lien avec la population, notamment dans les quartiers sensibles. Notre défi commun, pour les années à venir, est de retisser la confiance, d'apaiser les relations et de continuer à garantir les libertés individuelles. C'est parce qu'on se sent protégé qu'on se sent libre. Or l'introduction d'un récépissé ne va pas dans ce sens.
Pour toutes ces raisons, je vous appelle, mes chers collègues, à voter la motion de rejet préalable de la proposition de loi présentée par le groupe La France insoumise relative à la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité.
Applaudissements sur les bancs du groupe REM.

Je répète que, en qualité de rapporteur, je ne comprends pas pourquoi vous avez déposé une motion de rejet préalable. Si vous êtes contre notre proposition, allez jusqu'au bout, discutez, amendez le texte ! La motion de rejet préalable, franchement, c'est une manière de clore le débat qui n'honore pas le groupe La République en marche.

Il n'est utile de débattre que sur des mesures qui le méritent ! Celle-là serait inefficace !
Exclamations sur les bancs du groupe FI.

Je vais essayer de terminer mon propos…
Si j'ai bien compris, vous ne niez pas le problème, mais nous sommes en désaccord sur les moyens de le régler. Il me semble que nous aurions dû aller jusqu'au bout de ce débat. Mais je crois que je me suis déjà exprimé assez longuement tout à l'heure et que j'ai dit pourquoi j'étais en désaccord avec vos arguments.

Sur la motion de rejet préalable, je suis saisi par le groupe La France insoumise d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Dans les explications de vote sur la motion de rejet préalable, la parole est à M. Jean-Luc Mélenchon.

L'adoption de la motion de rejet préalable sera un mauvais signal adressé aux jeunes gens et aux dirigeants d'associations qui sont venus nous trouver et nous ont convaincus de la justesse de cette idée, défendue par mon camarade Éric Coquerel avec tant de conviction.
Je voudrais rappeler une nouvelle fois que nous ne parlons pas de délinquants ni de bandes organisées, mais de gens qui, du fait de leur couleur de peau ou de leur apparence, sont contrôlés indûment ! Dans plus de 97 % des cas, ils retournent ensuite vaquer à leurs activités, après avoir perdu du temps, marqués par le sentiment d'avoir subi une discrimination, non pas parce qu'ils ont été contrôlés, mais parce qu'ils le sont plusieurs fois par jour – quatre à cinq fois par jour pour certains. Prenez-le par le bout que vous voulez, ces procédés restent offensants !
Permettez-moi de vous le dire, vous enverrez là également un mauvais signal aux policiers et aux gendarmes, qui pourraient s'intéresser à notre débat, car ils ont été opposés les uns aux autres de manière très fallacieuse ! Comme il est faible, l'État qui mène des politiques pusillanimes et dont la main tremble au moment de donner des ordres ! Les policiers et les gendarmes sont confrontés à des injonctions paradoxales : d'un côté, on multiplie les contrôles et les injonctions de toutes sortes ; de l'autre on leur présente des demandes non moins comminatoires de résultats, de chiffres, de contrôles et d'enregistrements de délits dont on connaît les auteurs. Vous le savez aussi bien que moi.
Je m'adresse à présent à ceux d'entre nous qui sont parents. On a tous eu à la maison un adolescent un peu turbulent. S'il n'est pas de la bonne couleur, ses parents craignent chaque jour qu'il réagisse mal à la demande d'un policier, souvent à peine plus âgé que lui. Tout cela n'est pas bon. L'ordre doit consister à donner des consignes claires ; c'est à cette condition qu'elles seront exécutées. Notre collègue ancien gendarme m'approuvera sans doute. Le devoir et l'honneur des fonctionnaires d'autorité est de servir et d'obéir, à condition que les consignes soient claires.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et GDR.

La parole est à Mme Elsa Faucillon, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Nous regrettons en effet cette motion de rejet préalable. L'un de nos collègues a rétorqué que nous usions, nous aussi, de cette procédure. C'est vrai, mais nous sommes dans l'opposition, et la motion de rejet préalable est plutôt un outil d'opposition, à la disposition de ceux qui sont faibles en nombre. En revanche, entre les mains d'une majorité aussi nombreuse, elle trahit une faiblesse, la volonté, en tout cas, de nier tout débat démocratique, ce qui m'inquiète quant à votre capacité à discuter et à avancer des arguments.
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et FI.

Je trouve particulièrement regrettable que vous nous empêchiez de débattre et d'opposer nos arguments, le seul jour où nous pouvons inscrire nos propositions à l'ordre du jour.
Exclamations sur les bancs du groupe REM.

Au contraire, vous vous attachez systématiquement, de façon démagogique, à déposer des motions de rejet préalable.
J'en viens à la question de l'efficacité de cette mesure. Il est ici proposé assez judicieusement de mener une expérimentation. Nous avons beau avoir des têtes dures – nous le revendiquons – , une expérimentation, une fois évaluée, nous permettra de reconnaître nos torts, ou pas. En l'espèce, je pense que cette expérimentation nous donnerait raison car, dans les villes, les quartiers où nous vivons, les gares et les lignes de métros que nous fréquentons, nous constatons bien les faits que nous dénonçons, sans qu'il soit nécessaire de nous appuyer sur des rapports – dont je ne conteste pas l'utilité, au demeurant.
Nous ne jetons la suspicion ni sur la police ni sur les jeunes qui nous rapportent quotidiennement les humiliations subies. Mais, ce soir, nous n'enverrons à ces derniers aucun signal de reconnaissance d'égalité. Expérimentons cette mesure, d'autant plus que des villes y sont prêtes. Il suffirait de le décider. Le cas échéant, nous reconnaîtrons nos erreurs, même si je pense que les résultats seront probants.
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et FI.

La parole est à M. Jean Terlier, pour le groupe La République en marche.

Avant d'expliquer longuement pourquoi notre groupe votera la motion de rejet préalable, nous avons écouté les arguments des uns et des autres.
La réalité des discriminations et des contrôles discriminatoires ne se discute pas, nous en sommes tous conscients. Cela étant, le droit actuel nous permet d'y répondre, Mme la ministre l'a rappelé. La mesure de récépissé que vous voulez instaurer n'est pas la bonne solution. Juridiquement, nous détenons les réponses. Surtout, ce serait un très mauvais message, un très mauvais signal envoyé aux forces de l'ordre, en ce que vous permettriez au contrôlé de contrôler ensuite le contrôleur. Les forces de l'ordre ne souhaitent absolument pas une telle disposition, qui complexifierait encore davantage la procédure. Une expérimentation est en cours, avec des caméras mobiles ; il nous faut aller à son terme.

La proposition d'un récépissé n'est donc pas la bonne solution. Le groupe La République en marche votera la motion de rejet préalable.
Applaudissements sur les bancs du groupe REM.

Mes chers collègues, plus de 18 000 policiers et gendarmes ont été agressés et blessés l'an passé. C'est à eux que nous pensons. C'est à ces policiers et ces gendarmes agressés dans l'exercice de leurs missions républicaines que nous devons d'abord songer.

Les 150 000 policiers et les 100 000 gendarmes de France ne méritent pas les leçons, les suspicions de M. Mélenchon et de ses camarades. Les policiers et les gendarmes de France méritent d'abord le respect de la représentation nationale, la reconnaissance de la nation.
Vives exclamations sur les bancs du groupe FI.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention les arguments spécieux développés par l'extrême gauche. En vérité, le procès que vous instruisez vient de très loin, de la très vieille méfiance de l'ultra-gauche française à l'endroit de la police et de la gendarmerie.

Sur les bancs des Républicains comme sur ceux de tous les autres partis de gouvernement, nous n'avons pas à nous excuser de soutenir la police et la gendarmerie de la République. Nous n'avons pas davantage à nous excuser de l'exemplarité de notre système juridique de contrôle, un système juridictionnel, hiérarchique et parfaitement transparent.
Bien sûr, nous rejetterons cette proposition de loi, tout en appelant le Gouvernement à prendre la mesure du désarroi des policiers et des gendarmes, madame la ministre.

Ils ont besoin d'être plus soutenus, mais surtout que l'autorité judiciaire – le parquet comme le siège – comprenne que notre devoir collectif est de manifester notre reconnaissance et notre confiance à l'égard de ceux qui protègent les Français.

La parole est à Mme Michèle de Vaucouleurs, pour le groupe du Mouvement démocrate et apparentés.

Ce texte procède certainement d'un objectif louable mais c'est une fausse bonne idée. Le contrôle d'identité est strictement encadré, et les conditions dans lesquelles il est réalisé sont rigoureusement vérifiées par les juridictions judiciaires. Par ailleurs, ce texte jette la suspicion sur les forces de l'ordre et présente des inconvénients majeurs, que nous avons évoqués. Nous le savons, il existe des moyens plus adaptés pour éviter les dérapages, que nous ne sous-estimons pas – nous les avons également évoquées.

Pour toutes ces raisons, le groupe du Mouvement démocrate et apparentés votera la motion de rejet préalable.

Je suis membre d'un groupe qui, au cours de la campagne de 2012, avait projeté d'instaurer le dispositif du récépissé. Je dois vous confier qu'à titre personnel, je n'ai aucune certitude ; je ne sais pas si la solution est bonne ou mauvaise, mais je pense qu'il faut l'expérimenter.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Je connais notre situation. Il ne s'agit pas de stigmatiser les policiers, que je connais bien pour avoir travaillé de longues années à leurs côtés, peut-être plus que beaucoup ici. Je connais leur charge de travail, leur dévouement, les risques de leur métier, le sentiment qu'ils peuvent éprouver d'être harcelés, parfois acculés, mais j'ai pu mesurer à bien des reprises, en les rencontrant, la blessure qu'a pu causer le fait de ne pas avoir mis en place le récépissé.

J'en comprends les circonstances : la menace terroriste, une charge de travail qui ne faiblit pas, et des congés non pris. Je crois cependant qu'il est désormais possible de travailler en bonne intelligence avec les syndicats de policiers pour mener cette expérimentation et en tirer des conclusions définitives.
J'ai entendu, y compris de la part de la majorité, des formes de déni face à la réalité de la discrimination. C'est grave. Et cette motion de rejet préalable traduit, une fois de plus, un déni de débat parlementaire. Vous affirmez que vous n'êtes pas d'accord, alors que le débat vous offre le loisir d'amender, de commenter, de supprimer, d'améliorer les propositions formulées sur d'autres bancs. Malheureusement, vous avez pris l'habitude de vous engoncer dans vos certitudes et de n'écouter que vous-mêmes.
Nous ne voterons donc pas la motion de rejet préalable.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et GDR.

Ce débat mérite mieux ! Vous avez laissé les inégalités s'accroître, c'est honteux !
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 72 |
| Nombre de suffrages exprimés | 70 |
| Majorité absolue | 36 |
| Pour l'adoption | 53 |
| contre | 17 |
La motion de rejet préalable est adoptée.

En conséquence, la proposition de loi est rejetée. Il n'y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la conférence des présidents.
Suspension et reprise de la séance
La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante, est reprise à vingt-deux heures quarante-cinq.


La parole est à Mme Caroline Fiat, rapporteure de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, madame la ministre des solidarités et de la santé, mes chers collègues, le groupe La France insoumise vous propose une loi qui vise à légaliser, sous conditions, l'euthanasie et le suicide assisté. Afin de prévenir les amalgames et les confusions, je tiens d'emblée à préciser que les besoins et les attentes auxquels ce texte entend apporter une réponse ne sont pas du tout de même nature que ceux que la loi dite « Claeys-Leonetti » et la politique de développement des soins palliatifs visent à satisfaire.
Je suis en effet de ceux qui refusent d'inscrire dans des logiques contradictoires les soins palliatifs, la sédation profonde et continue, l'euthanasie et l'assistance au suicide. Ces divers moyens d'apaiser les souffrances physiques ou psychiques des personnes en fin de vie sont complémentaires. Je suis la première à appeler au déploiement et au renforcement massif des moyens des soins palliatifs dans notre pays, à l'heure où le risque d'une absence ou d'une insuffisance de soins palliatifs existe pour plus de 75 % des personnes qui en ont besoin, selon un rapport de l'IGAS – l'inspection générale des affaires sociales – publié en 2017.
D'éventuels malentendus étant ainsi dissipés, il faut prendre conscience que si, dans nombre de situations, les soins palliatifs peuvent être une solution pour assurer une fin de vie digne, ce n'est cependant pas toujours le cas. Certaines personnes peuvent juger insupportable ce qui peut leur apparaître comme un acharnement palliatif. D'après les données fournies lors de son audition par le président de l'ADMD – l'Association pour le droit de mourir dans la dignité – , plus de la moitié des personnes admises en unité de soins palliatifs maintiennent leur demande de mourir, malgré les soins prodigués.
De la même façon, si la sédation profonde et continue consacrée par la loi Claeys-Leonetti peut être une solution envisageable pour certaines personnes, ce n'est pas le cas pour toutes. Une telle sédation peut faire peur à certaines personnes en fin de vie ainsi qu'à leurs proches. En effet, aucune étude scientifique n'a, à ce jour, établi l'absence totale de souffrance chez la personne sous sédation, qui met parfois plusieurs semaines à succomber à un défaut d'hydratation.
Du reste, alors que les unités de soins palliatifs sont les premières concernées par des demandes de sédation, elles rechigneraient parfois à y donner droit. Certes, cela peut se comprendre de la part de personnes qui ont fait le choix de s'engager professionnellement dans le secteur des soins palliatifs pour accompagner des malades la main dans la main et les yeux dans les yeux, et non des malades sous sédation. Mais il n'en demeure pas moins qu'en définitive, notre arsenal législatif ne propose aucune solution aux personnes atteintes d'une affection grave ou incurable leur causant des souffrances physiques ou psychiques insupportables, et qui, comme l'écrivaine Anne Bert, ont une conception de leur dignité qui les amène à préférer mettre fin à leurs jours en toute lucidité, alors qu'elles ne sont pas encore en fin de vie.
Déjà, en 2012, la Commission de réflexion sur la fin de vie en France expliquait qu'à défaut de légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, le droit français ne répondait pas à la situation de souffrance existentielle d'une personne craignant l'évolution tragique d'une tumeur cérébrale, alors même qu'elle est encore parfaitement consciente et capable, et souhaitant anticiper la fin de sa vie. Le résultat est que ceux de nos concitoyens qui sont dans cette situation se retrouvent aujourd'hui au regard de l'euthanasie et de l'assistance au suicide dans une position assez comparable à celle que d'autres ont pu connaître jusqu'en 1975 au regard de l'interruption volontaire de grossesse : soit ils ont les moyens de trouver refuge chez nos voisins européens pour pouvoir y mourir dignement ; soit ils n'ont pas les moyens de traverser nos frontières et ils trouvent alors d'autres façons d'abréger leurs souffrances, par exemple en se suicidant de manière violente, ou ils subissent sur notre territoire ce que le professeur Didier Sicard a appelé le « mal mourir ».
Le comble du paradoxe est qu'ils se retrouvent parfois euthanasiés contre leur gré, en catimini, dans nos hôpitaux. Je vous rappelle en effet qu'une étude publiée en 2012 par l'INED – l'Institut national d'études démographiques – a révélé que les décisions médicales avec intention de mettre fin à la vie des patients représentaient 3,1 % des décès enregistrés dans notre pays en décembre 2009. D'après les dernières précisions apportées hier au journal Libération par les chercheurs de l'INED, 0,2 % de ces décès, soit 1 200 décès, correspondraient à de véritables euthanasies. Or près de 80 % des actes ainsi considérés comme des euthanasies seraient pratiqués sans même que les patients en aient fait explicitement la demande.
Mes chers collègues, trouvez-vous normal que, chaque année, près de 1 000 euthanasies clandestines soient pratiquées sur notre territoire sur des personnes qui ne les ont pas demandées et que, dans le même temps, les personnes demandant qu'il soit mis fin à leurs jours de façon anticipée soient contraintes de fuir à l'étranger pour y trouver les conditions d'une mort digne ? Pour ma part, je réponds non ! C'est la raison pour laquelle l'article 1er de la présente proposition de loi vise à légaliser, sous conditions, l'euthanasie et le suicide assisté. Plutôt que de recourir à la formule d'« assistance médicalisée active à mourir » ou à d'autres circonvolutions, cet article n'hésite pas à employer les termes d'« euthanasie » et d'« assistance au suicide ». En effet, comme l'a montré le récent sondage de l'IFOP pour le journal La Croix, ces notions sont parfaitement claires pour nos concitoyens et ne leur font plus peur. D'après cette enquête, 89 % des Français sont favorables à ce que l'on aille plus loin que la législation actuelle sur la fin de vie, et 71 % d'entre eux se prononcent en faveur de la légalisation de l'euthanasie.
Assumant donc la revendication d'un « droit de mourir », que Vincent Humbert et Chantal Sébire ont jadis réclamé en vain à la justice française et aux présidents de la République successifs, l'article 1er subordonne la légalité des actes d'euthanasie et d'assistance au suicide à plusieurs conditions, inspirées des lois belge et luxembourgeoise. D'abord, la demande doit émaner d'une personne capable, l'hypothèse où la personne serait hors d'état d'exprimer sa volonté étant envisagée. Ensuite, cette personne doit être atteinte d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, qui lui inflige une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable et qui ne peut être apaisée, ou qui la place dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité. Enfin, l'acte létal ne peut être accompli que par un médecin ou en présence et sous la responsabilité d'un médecin, étant précisé que l'article 4 garantit aux professionnels de santé la possibilité d'invoquer la clause de conscience pour refuser d'accompagner un patient dans ses démarches, à condition cependant de l'orienter immédiatement vers un praticien susceptible de l'accepter.
Ce n'est qu'aux conditions précédemment énoncées que les personnes prêtant leur concours à un acte d'euthanasie ou d'assistance au suicide pourront bénéficier de l'exonération de poursuites et de sanctions pénales prévue à l'article 5. Cette absence d'incrimination ne vaut toutefois que pour autant qu'aura également été respectée la procédure collégiale, extrêmement précise, prévue à l'article 3. Cet article encadre de façon très stricte le traitement des demandes d'euthanasie et d'assistance au suicide.
Je ne vais pas revenir ce soir sur le détail de la procédure, que j'ai eu l'occasion de décrire la semaine dernière en commission. Je tiens toutefois à souligner que l'article 3 prévoit les différents cas de figure susceptibles d'être rencontrés en pratique : conscience ou non du patient ; capacité ou non du patient à formuler une volonté libre, éclairée, réfléchie et explicite ; acceptation ou non du médecin traitant d'accompagner son patient dans sa démarche ; existence ou non de directives anticipées.
Je ne peux que m'étonner que certains députés de la majorité reprochent au groupe La France insoumise de légiférer de façon prématurée et de préempter l'issue du débat ouvert par les États généraux de la bioéthique, il y a deux semaines, alors que d'autres députés, appartenant à la même majorité, dès le 27 septembre dernier, soit près de trois mois avant le dépôt de la nôtre, se sont empressés de déposer une proposition de loi tendant peu ou prou à légaliser l'euthanasie sous le nom pudique d'« assistance médicalisée active à mourir ».
Comprenez donc que l'on peine à trouver la cohérence du positionnement de la majorité et que l'on admette difficilement l'argument consistant à remettre ad vitam aeternam, à l'issue de nouveaux débats et de nouvelles évaluations, une avancée fortement attendue et même plébiscitée par nos concitoyens. Missions parlementaires successives, débats organisés par la Commission de réflexion sur la fin de vie en France et par le Comité consultatif national d'éthique : rarement un sujet aura été aussi débattu et évalué au cours des vingt dernières années. De mon point de vue, la logique consistant à évaluer, de manière régulière, les dispositifs législatifs existants ne doit pas porter atteinte à la responsabilité du législateur, qui est celle de combler au plus vite les lacunes les plus manifestement béantes de nos politiques publiques.
J'espère donc que la représentation nationale ne tergiversera pas encore pendant des mois, voire des années, et qu'elle adoptera la présente proposition de loi, qui, dans le respect de la liberté de toutes les consciences, offre enfin à nos concitoyens la possibilité de choisir, en consacrant le droit de mourir.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie d'aborder ce sujet aux enjeux médicaux et éthiques difficiles : l'euthanasie. Vous le dites très justement : « "Face à la mort, nous sommes tous égaux. " En revanche, nous sommes loin d'être égaux quant aux conditions dans lesquelles nous mourrons. »
C'est en partant de cette considération forte que la loi Claeys-Leonetti a été adoptée au début de 2016, après près d'un an de débats parlementaires et des travaux participatifs organisés pendant deux ans. Chacun a pu faire entendre sa voix : associations, professionnels de santé, grandes familles religieuses. Sur un tel sujet, intime, complexe, les avis sont toujours divers ; légiférer sur la fin de vie est une responsabilité d'autant plus grande.
La loi Claeys-Leonetti renforce incontestablement les droits des patients. De l'avis de tous, elle clarifie les conditions de l'arrêt des traitements, au titre du refus de l'obstination déraisonnable. C'est une avancée permettant de ne pas s'acharner à soigner et d'accompagner de manière apaisée la fin de vie. La loi affirme un nouveau droit du patient, afin de lui éviter toute souffrance et de préserver sa dignité : celui de bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme et qu'il n'y a plus d'espoir. Surtout, elle renverse la logique de décision et place le patient au coeur du processus décisionnel, pour qu'il soit pleinement acteur des décisions qui le concernent, en rendant ses directives anticipées contraignantes pour le médecin.
Néanmoins, cette loi, en tant que telle, ne suffit évidemment pas. C'est pourquoi la mise en oeuvre d'un plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie vient la renforcer. Ce plan doit contribuer à mieux informer le patient, afin qu'il soit au coeur des décisions qui le concernent, et à renforcer la formation des professionnels, la recherche et la diffusion des connaissances sur les soins palliatifs. Il doit aussi développer les prises en charge en proximité, en favorisant les soins palliatifs à domicile, y compris pour les résidents en établissements sociaux et médico-sociaux. Enfin, ce plan doit garantir l'accès aux soins palliatifs pour tous, pour en réduire l'inégalité d'accès. J'ai à coeur, comme vous, que santé rime avec solidarité.
Cette loi a fait le choix d'un certain équilibre et, je le sais, ne va pas assez loin pour certains, mais votre proposition de loi m'interpelle. Vous souhaitez ouvrir la possibilité de l'euthanasie ou du suicide assisté en cas d'affection grave ou incurable. Vous faites donc un choix : celui de l'euthanasie ou du suicide assisté, y compris lorsque la maladie est grave, même si elle est curable. À mes yeux, rompre avec le critère d'incurabilité, c'est prendre le risque d'ouvrir la voie à une euthanasie arbitraire. Or les débats parfois virulents entre pro-euthanasie et pro-vie m'obligent, en tant que ministre, à souscrire à l'exigence, à « l'intransigeance exténuante de la mesure » dont parlait Camus.
Plus largement, je ne souhaite pas insulter l'avenir : le débat sur le sujet des droits des malades et des personnes en fin de vie est toujours légitime et utile. Vous le savez, à l'évidence, notre recul vis-à-vis de la loi Claeys-Leonetti est insuffisant. Pour nous donner le recul nécessaire, je ne souhaite pas qu'une nouvelle loi interfère avec la mission d'évaluation de la mise en oeuvre de la loi Claeys-Leonetti de 2016, conduite actuellement par l'inspection générale des affaires sociale. Cette évaluation concerne en particulier la formation des professionnels de santé, la mise en oeuvre des directives anticipées, la désignation des personnes de confiance, l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire et l'encadrement de la mise en place de la sédation profonde en établissements sanitaires, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD – ou à domicile. Les résultats de cette évaluation me seront utiles pour préparer l'adoption d'un nouvel ensemble de mesures visant à développer les soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie, à l'issue de l'actuel plan et pour les trois prochaines années. L'État devra garder intacte sa mobilisation pour créer les conditions d'un accès effectif, quelles que soient les circonstances, à l'ensemble des soins palliatifs.
Par ailleurs, vous le savez aussi, les travaux de révision de la loi relative à la bioéthique en vigueur, celle du 7 juillet 2011, viennent d'être lancés. Conformément aux dispositions prévues, ces travaux s'ouvrent avec la tenue d'états généraux, à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique. À cette occasion, je le sais, le sujet de la fin de vie sera de nouveau débattu. Certains voudront aller plus loin ; d'autres aussi, probablement, revenir en arrière ; d'autres encore, prendre le temps de faire vivre la loi de 2016.
Mesdames et messieurs les députés, le rapport Sicard de 2012, votre proposition de loi le rappelle, souligne les sentiments d'abandon, de solitude ou d'indifférence ressentis par de nombreux patients et leur peur de l'acharnement thérapeutique. C'est, par-là même, reconnaître le droit des patients à faire un libre choix. Le serment d'Hippocrate, que certains d'entre nous, ici, ont prêté, l'affirme bien : « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. » Les Français partagent cette exigence éthique, le rapport Sicard le souligne.
En tant que ministre et en tant que médecin, je me dois d'éviter deux écueils : l'irrésolution et l'impréparation. Pour nous préparer, prenons le temps de la réflexion, d'autant que le sujet de la mort est un sujet politiquement grave, qui engage la société tout entière. Comme le philosophe de la mort, Jankélévitch, le disait magistralement : « La mort n'est pas un objet comme les autres : c'est un objet qui, étranglant l'être pensant, met fin et coupe court à l'exercice de la pensée. La mort se retourne contre la conscience de mourir ! » Veillons tous ensemble, quelles que soient nos divergences politiques, à laisser vivre, avec la patience de la réflexion, l'exercice démocratique de la pensée !
Applaudissements sur les bancs des groupes REM et MODEM.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, dans notre pays, la France, où les droits de l'homme ont été proclamés le 26 août 1789, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, si nous le décidions, pourraient représenter, je le crois, 229 ans plus tard, une nouvelle étape de l'émancipation humaine, un nouveau droit pour chaque citoyen. Nous pourrions, si nous en décidions, forger le nouveau maillon d'une longue chaîne d'émancipation qui n'est pas achevée. C'est cela que nous vous proposons et dont nous voulons débattre.
Un long fil symbolique relie les grands actes de la Révolution à notre proposition, je vais m'en expliquer. Je pense notamment au droit au mariage civil et au droit au divorce, rendus possibles par la loi du 20 septembre 1792. Je ne m'écarte guère de notre sujet en rappelant qu'à un moment parmi les plus difficiles de l'histoire de notre pays, le jour même de la victoire de Valmy, l'Assemblée nationale adopte un décret « qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens ». Vous le voyez, il y a toujours eu la volonté, même dans les moments difficiles, de s'interroger sur les grandes étapes de l'existence humaine. En 1792, la naissance, le mariage et le droit à la séparation étaient soustraits aux mains des institutions religieuses, laïcisés, si vous me permettez le mot ; c'est par le prisme de la liberté de conscience, en permettant à chacun de juger de sa propre existence, que ces grands moments intimes de l'existence étaient abordés, codifiés, introduits dans la loi. Nous devons continuer cette conquête de droits nouveaux dans ces grands moments que sont non seulement la naissance et le mariage, mais aussi la mort. La légalisation du droit à l'avortement, en 1975, s'est également inscrite dans cette logique de liberté à disposer de soi-même, en rendant les femmes entièrement maîtresses de leur corps. Enfin, en 2013, la loi du mariage pour tous a permis à chacun de se marier.
Pourquoi évoquer toutes ces lois ? Parce que tous ces moments forts ont évidemment été l'occasion de débats, parfois de confrontation avec ceux de nos concitoyens qui ont des convictions spirituelles et religieuses. J'affirme à cette tribune que je les respecte profondément. Je ne reproche en raison à certains de nos concitoyens d'aborder ces questions graves, notamment le rapport à la mort, en fonction de leurs convictions intimes, notamment religieuses. Face à la mort, les croyants savent quoi faire, et c'est une force – la foi est une énergie, sans aucun doute, pour traverser les moments les plus difficiles de l'existence. Mais, dans notre pays, il y a aussi un grand nombre de nos concitoyens qui ne sont pas croyants et souhaitent aborder ces moments difficiles sans la boussole des grandes religions monothéistes qui considèrent que nous devons en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, défendre la vie. Il y donc, dans notre pays, des citoyens qui ne sont pas croyants et n'abordent pas ces moments importants, intimes, avec le regard des grandes religions. C'est pourquoi nous vous proposons une grande loi de liberté, qui est aussi un grand acte de fraternité. Nous voulons désormais envisager cette question à la lumière de cette ultime liberté : celle de pouvoir décider soi-même d'éteindre la lumière.
Si je parle à la tribune, ce soir, pour défendre devant vous la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est parce que de nombreux citoyens sont désormais favorables dans notre pays à cette proposition. Des études existent, des sondages ont été réalisés : 89 % des Français interrogés y étaient favorables, nous annonçait Le quotidien La Croix au mois de janvier ; un autre sondage a évoqué le chiffre de 78 %. De nombreuses associations se sont emparées de cette question, dont l'ADMD, présidée par Jean-Luc Romero, très engagé sur le sujet – il n'est pas le seul. Plusieurs propositions de loi allant dans ce sens ont été déposées, dont une, en 2009, présentée par Yves Cochet, Martine Billard, Noël Mamère et François de Rugy, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Enfin, plusieurs pays à travers le monde, notamment la Belgique et le Canada, ont déjà entériné ce droit.
Il s'agit avant tout d'une grande question philosophique – vous avez employé le mot « éthique », madame la ministre, et vous avez eu raison, car c'est presque la même chose. Il ne s'agit pas d'un débat de médecins, même s'ils doivent être entendus. De la même façon que l'école n'appartient pas aux enseignants, cette affaire n'appartient pas au corps médical. Celui-ci doit évidemment nous éclairer de ses connaissances mais c'est avant tout à chaque citoyen, en fonction du regard philosophique qu'il porte sur l'existence en général et sur la sienne propre qu'il convient d'aborder cette question.
Je reconnais que le débat n'est pas simple, y compris entre nous. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions l'aborder, au sein de nos groupes. Il touche en effet à des sujets très forts, qui soulèvent de nombreuses interrogations. Si nous souhaitons que ce débat s'engage, c'est, je le répète, parce qu'il s'agit d'une grande question philosophique. L'État, en refusant, dans le cadre législatif actuel, à un patient le droit de mourir dignement, bafoue le libre arbitre de celui-ci. Le respect de la liberté de chacun exige que l'État entérine ce droit nouveau, tout en l'encadrant dans ses modalités afin de permettre au patient de choisir et d'accomplir sa fin dans des conditions optimales.
Cette proposition est une loi de liberté. Elle prévoit des dispositions pour hiérarchiser les modes d'expression de la volonté du patient, directement tout d'abord, puis par des directives anticipées, enfin par l'intermédiaire d'une personne de confiance. La possibilité de décider de ce que l'on veut pour soi-même, si l'on tombe gravement malade et que l'on souffre sans espoir de guérison, grandit l'homme. Elle n'est d'ailleurs en rien une obligation. Moi-même, qui défends cette proposition de loi, j'ignore ce que je ferais si j'étais confronté à ce choix. Peut-être, voulant profiter de mes proches durant les derniers souffles de ma vie, irais-je jusqu'au bout, en dépit de la souffrance.

Peut-être voudrais-je, au contraire, bénéficier du droit de décider moi-même. Je le répète, c'est d'abord une grande loi de liberté que nous vous proposons.
Je le rappelle au pied de cette belle oeuvre qui représente l'École d'Athènes – temple idéal rassemblant tant de philosophes mais où il manque Sénèque – , pour les stoïciens de l'Antiquité, la possibilité du suicide est l'argument ultime qui permet de savoir si l'on est libre, puisqu'on doit toujours garder la liberté de se soustraire aux situations contre lesquelles on ne peut rien. Comme le disait Sénèque : « Méditer la mort, c'est méditer la liberté ; celui qui sait mourir, ne sait plus être esclave. »

C'est pourquoi je qualifierai la loi de 2016 de mauvaise loi. Nous la désapprouvons car nous estimons qu'elle ne crée pas les conditions d'une fin de vie digne. La sédation profonde, que vous avez évoquée, madame la ministre, signifie concrètement que le patient est tué par l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation.
Non, ce n'est pas cela.

Elle illustre la peur naturelle, légitime, de regarder la mort en face. Or ce refus d'envisager la mort a des conséquences douloureuses sur les patients qui sont concernés, qui, au lieu de partir de manière décidée et instantanée, s'éteignent lentement, parfois dans une agonie incertaine.

Le choix de mourir, l'homme doit pouvoir l'obtenir dans certains cas. En effet, lorsqu'on est atteint de certaines afflictions, lorsqu'aucun espoir de rémission ou de guérison n'est possible et que le seul horizon de vie pour le patient est la mort dans la souffrance, on peut dire, d'une certaine manière, que la vie s'est arrêtée, bien que le coeur n'ait pas cessé de battre. Cette perception d'une vie à l'arrêt, seul le patient peut la ressentir, à l'intérieur de son corps et dans son esprit.
C'est pourquoi le choix de mourir est entièrement subjectif et personnel. Le médecin n'est pas apte à en juger ; il peut seulement s'assurer que le patient est capable de prendre une décision éclairée. Nous sommes d'accord sur l'idée que, bien que le corps puisse fonctionner encore parfaitement, l'état mental de la personne peut justifier le droit de mourir. C'est pour cette raison qu'on arrête l'assistance respiratoire de patients en état de mort cérébrale.
Vous devez considérer que cette loi n'instaure pas seulement un droit à mourir dans la dignité, mais aussi un droit à cesser de souffrir. Les situations médicales évoquées se caractérisent par de grandes souffrances psychiques et psychologiques, auxquelles peuvent s'ajouter parfois d'intolérables souffrances physiques. Il est inhumain et immoral de refuser aux personnes concernées le droit et les moyens de faire cesser cette souffrance, lorsqu'elles le demandent.
En considération de cette souffrance, j'estime que ce n'est pas seulement une proposition de loi qui est examinée ce soir, mais une liberté fondamentale de la personne humaine, s'inscrivant – je l'ai souligné en commençant – dans la continuité des droits de l'homme et du citoyen. C'est la conquête d'une ultime liberté.
Madame la ministre, je vous remercie de la dignité de votre intervention, dans laquelle vous avez mesuré toute la difficulté de la question abordée avec précision par Caroline Fiat. Chacun peut être d'accord ou pas avec les arguments qui ont été évoqués, mais nous sommes heureux, fiers même, d'avoir pu, après d'autres, porter ce débat à la tribune de l'Assemblée nationale. Le simple fait de nous poser cette question, sans recourir à l'euphémisme, nous grandit collectivement et élève le débat politique.
Comme le disait le grand Jaurès, dans son Discours à la jeunesse, très célèbre mais trop souvent réduit à une seule phrase : « Le courage, c'est de comprendre sa propre vie. [… ] Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. » Chaque citoyen doit avoir droit à ce regard tranquille. Tel est le sens de notre proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, si le débat sur la fin de vie est ancien, le sujet qui nous est soumis ici ouvre de vastes champs de questionnements. Il a une portée anthropologique et civilisationnelle, qui appelle l'humilité. Je m'y efforcerai d'autant plus qu'il renvoie chacun à des expériences intimes, à la part dramatique de l'existence humaine. Il revêt toutefois aussi un enjeu politique qui renvoie à cette interrogation : quelle humanité voulons-nous former ? Ni nos débats ni notre décision de ce jour n'épuiseront le sujet. C'est donc avec le parti pris délibéré de la dignité humaine que je l'aborderai, à l'instar de tous les autres.
Comment, tout d'abord, ne pas être révolté par la souffrance lorsqu'elle vient tenailler un de nos semblables en menaçant de ne plus le lâcher ? Il faut le dire, quoique avec précaution : la prise en compte de la douleur et, plus largement, des souffrances a progressé sur le plan des possibilités techniques comme sur celui des exigences en matière de pratiques de soins. On en a désormais fini avec l'acharnement thérapeutique et l'obstination déraisonnable ; le soulagement des souffrances est en tête des priorités.
Il demeure cependant des souffrances réfractaires, face auxquelles nous sommes réduits à l'impuissance. C'est ce qui a présidé au vote de la loi Leonetti, puis de la loi Claeys-Leonetti. Michel Vaxès, qui m'a précédé sur ces bancs, déclarait en 2004, à propos de ces souffrances : « Rien n'est donc plus important que de les combattre tout au long de la vie, jusqu'au bout de la vie, y compris lorsque les actes qui tendent à les supprimer peuvent avoir pour conséquence de précipiter l'ultime instant d'une vie qui s'en va ». C'est sous ce régime que nous sommes aujourd'hui, avec la possibilité ultime de la sédation profonde, qui est de l'ordre du soin.
Je tiens à rendre hommage aux femmes et aux hommes dont le quotidien est d'accompagner la fin de vie, à leur force et à leur humanité, mais il faut immédiatement dire que, sans les moyens afférents pour développer les soins palliatifs, le combat contre la souffrance ne peut être mené comme il se doit. Cela vient ajouter à la révolte et c'est une question politique qui n'est pas périphérique dans notre débat : accorder à chacune et chacun des conditions de fin de vie respectueuses est une exigence centrale qui fait consensus dans la société. Jamais l'abrègement de vies ne saurait constituer une réponse acceptable face au manque de moyens. La mort n'est pas une thérapeutique.
Pourtant, des femmes et des hommes, avant même d'être confrontés à la douleur et avant même d'être entrés dans cette phase de fin de vie, manifestent la volonté d'en finir avec la vie et demandent qu'on leur accorde le droit à mourir.
Devant le suicide, notre société a évolué. Elle en a fini avec l'opprobre et la condamnation, adoptant une attitude fraternelle qui consiste à ne pas se résoudre à la mort provoquée, à en dissuader si elle le peut. Car vivre est parfois difficile, douloureux. Il faut en affronter, des tempêtes – cent fois tomber et se relever.
La question est de savoir si l'on pourrait, dans certaines conditions, imaginer que l'on puisse accompagner et faciliter de tels actes, et donc admettre l'idée que la vie ne vaut pas toujours d'être vécue jusqu'à son terme.
« Si vous m'aviez demandé lors de mes quarante-deux ans de splendeur, avant mon accident, si j'accepterais de vivre la vie qui est la mienne depuis vingt ans », écrit Philippe Pozzo di Borgo, dont l'autobiographie a donné le film Intouchables, « j'aurais répondu sans hésiter », comme 92 % des Français aujourd'hui : « non, plutôt la mort ! [… ] Mais quelle violence faite aux humiliés, à la vie aux extrémités, comme s'il n'y avait de dignité que dans l'apparence et la performance. »
Le philosophe Jacques Ricot pose, en prolongement, la question de savoir si cela ne reviendrait pas à distiller, pour tous ceux et celles « dont la vie est diminuée », « dont l'horizon est obstrué » l'idée que « la société dans sa bienveillance vous propose une issue : la mise à disposition d'un poison mortel ».
Quand bien même, ne faudrait-il pas accorder cette assistance pour respecter la liberté, la volonté de celui ou de celle qui demande à devancer la fin ? Qui est-on pour la lui refuser ? Question délicate ! Faut-il instaurer ce droit-créance qui oblige la société à être partie prenante d'un suicide ou à donner la mort ? Et de qui cela sera-t-il le métier quand il ne s'agira plus de soigner ? Que se passerait-il si ce droit existait, si cette possibilité était ouverte, si chacune et chacun, se voyant décliner, était mis devant cette lourde responsabilité individuelle, sans la garantie de pouvoir s'abstraire ni des considérants de sa propre vie et de son entourage, ni des déterminants sociaux ? Jusqu'à quand, jusqu'où nos choix sont-ils libres, et comment le codifier ? Jusqu'où accorder ce droit, tout droit fondamental étant par nature universalisable ? Est-il si certain que cela représente un progrès social et des libertés ? N'y a-t-il pas, en la matière, une responsabilité collective, sociale, qui n'est pas du même ordre que la volonté de l'individu ? Autre question : perd-on sa dignité lorsque la vie se retire ou lorsqu'elle n'est plus si éclatante ? Ne continue-t-on pas à être humain ? Au fond, comment juger de la qualité de vie ?
La vie est fragile et ses manifestations parfois ténues, mais nul ne saurait être réduit à l'état qui est le sien à l'article de la mort. Donner du sens à sa vie jusqu'à la fin n'a rien de simple et cela n'est pas plus facile pour les proches, qui doivent aussi affronter l'épreuve, parfois dans la durée, même si c'est aussi là parfois que se dénouent des histoires difficiles et que s'installe une tendresse dont la vie tourbillonnante empêche l'expression.
Ainsi, la société se trouve devant un enjeu qui n'est pas anodin. La personne humaine est plus qu'un corps, plus qu'une conscience, plus qu'un statut social : elle résulte d'une construction historique et sociale appelée à s'élever et à s'étendre. La personne humaine, c'est le monde de l'humain, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Selon le philosophe Lucien Sève, qui a longtemps siégé au Comité national consultatif d'éthique, « la personne est la forme-valeur inhérente à tout humain, quel que soit son état, du seul fait qu'il est en tant qu'humain à considérer comme sociétaire de l'ordre civilisé de la personne ». C'est sur cette base que se construisent la dignité humaine et l'exigence de respecter à égalité, de façon inconditionnelle et universelle, tout humain et de respecter tout l'humain.
Inutile de préciser qu'à mes yeux, cette exigence appelle une volonté politique majuscule en tous domaines, face aux atteintes démultipliées, pour garantir le droit à vivre dans la dignité. Vaste programme !
Enfin, la loi actuelle, échappant aux écueils du manichéisme, ne permet-elle pas de faire face – en théorie, et en pratique si les moyens étaient déployés – à une variété de situations et d'appréhensions ? Notre groupe l'avait votée, à l'époque, avec la conviction qu'elle était bien la loi de dignité et d'humanité dont nous avions besoin, donnant des droits aux patients et apportant une réponse aux questionnements. Si elle n'est pas satisfaisante, nous devons prendre le temps de l'évaluer.
Confrontés à ce qui nous échappe, décidément humains, nous voudrions pouvoir rester en maîtrise. Cela n'est-il pas déjà en grande partie possible ? En grande partie, car aucune loi n'abolira la confrontation de chacune et chacun avec la mort.
« Le pouvoir humain, qui est immense, s'arrête à celui d'interrompre la vie des autres », a écrit Axel Kahn. « Rien ne peut le justifier. » Alors, faut-il ouvrir une brèche dans cette règle ? C'est la question posée.
Mais sur la fin de vie, assurément, nous pouvons agir, et nous le devons. La culture des soins palliatifs a fait des progrès, mais elle doit encore être portée bien au-delà et les moyens afférents doivent lui être accordés dans tous les lieux où c'est utile et nécessaire. La situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes – les EHPAD – réclame à cet égard un traitement particulier.
Nous devons décidément, quoi qu'il en soit, regarder autrement la fin de vie, la regarder tout court et ne pas laisser cet enjeu dans l'ombre au motif que l'on préfère ne pas trop y penser ou que l'on sait l'importance des investissements à y engager. La persistance de ces questionnements doit encore renforcer l'urgence d'entendre cet appel à mieux traiter chaque humain jusqu'au bout de sa vie.
Voilà où nous en sommes de notre réflexion à ce stade de la discussion, mais ce débat est important et doit être mené dans notre assemblée.
Applaudissements sur les bancs du groupe GDR ainsi que sur certains bancs des groupes REM, UDI-Agir et FI.

Le débat que nous avons ce soir est important et je remercie Mme Fiat, la rapporteure, de nous en offrir l'occasion. Il est au coeur de la société française depuis de nombreuses années et ce n'est pas un hasard si trois propositions de loi ont été déposées sur ce sujet depuis l'été dernier.
Plus que d'un problème de bioéthique stricto sensu, puisqu'il ne résulte pas vraiment de progrès scientifiques, il s'agit d'une question de société et du choix du mode de solidarité qui s'applique au moment de la fin de vie.
Tous ici, nous connaissons les insuffisances de notre système. Tous, nous insistons pour que les soins palliatifs soient développés à un niveau beaucoup plus élevé. En effet, seuls un tiers des malades qui le devraient peuvent, dans les faits, en bénéficier. D'autres dispositifs précédemment votés sont eux aussi insuffisamment développés.
Même amélioré, notre arsenal est-il suffisant ? Apparemment non, d'après un grand nombre de nos collègues ici présents ou d'après des sondages d'opinion qui montrent que 89 % des Français aspirent à une légalisation de l'euthanasie etou du suicide assisté.
Il n'y a dans l'esprit de nos concitoyens aucune opposition entre le déploiement de l'aide active à mourir et le renforcement d'un accès généralisé aux soins palliatifs. C'est d'ailleurs chez les malades en soins palliatifs que se pose la question du choix entre euthanasie et agonie. Comme l'exprime Anne Bert, dans de telles circonstances, il ne s'agit pas de donner la mort – c'est la maladie qui tue, le malade n'ayant alors le choix qu'entre deux types de mort, plus ou moins paisibles.
Offrir une option aux malades en situation d'impasse thérapeutique peut être perçu comme une avancée, une liberté, un droit nouveau. Cela peut aussi donner du sens aux directives anticipées, car le choix de fin de vie sera alors respecté, même s'il implique une dispense de d'agonie.
Faut-il voter de telles mesures ce soir ? Légiférer dans ce domaine n'est plus possible avant quelques mois car les Français sont, depuis quelques jours jours, appelés à des concertations multiples, amples et ambitieuses sur le sujet. Le Comité consultatif national d'éthique organise, avec les espaces éthiques régionaux, des débats dans toutes les régions françaises. Le Conseil économique, social et environnemental procède à de larges auditions, comme notre commission des affaires sociales, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques – l'OPECST – et plusieurs autres organismes. L'inspection générale des affaires sociales et diverses missions évaluent l'état actuel de la prise en charge de la fin de vie en France.
Quelle insulte ce serait pour les centaines de milliers de Français mobilisés dans la réflexion participative si nous leur disions que la loi est votée et qu'ils n'ont plus qu'à passer leur chemin ! Quel mépris pour la démocratie si l'on n'attendait pas la conclusion de toutes ces concertations !
Le temps du débat s'achèvera au début de l'été. Nous pourrons alors reprendre le cours de nos travaux, que nous jugeons autant que vous, madame Fiat, importants et urgents. Nous aurons entendu beaucoup plus précisément les divers points de vue – les uns favorables, les autres réticents à l'euthanasie. Le respect mutuel aura le temps de s'instaurer.
On me dira que des débats ont eu lieu pendant des années, ad nauseam, et qu'il faut maintenant agir. Non : nous ne pouvons pas agir quand nombre de Français, prenant en main leur destin, nous préparent une feuille de route, une inspiration, un sens. Ce sont eux qui nous diront plus précisément où mettre le curseur. Soyons prudents sur ces points, qui ne sont pas des détails.
Lorsque vous suggérez, madame la rapporteure, d'étendre l'euthanasie à des personnes souffrant d'une maladie grave et qui le désirent, vous sortez du cadre de la fin de vie. Les cancers sont ainsi des maladies graves, mais la moitié d'entre eux sont curables et la majorité des médecins seraient vraisemblablement opposés à l'euthanasie dans le cas d'un malade susceptible de guérir de sa maladie.
Vous le voyez, mes chers collègues : il convient d'attendre la fin de la concertation pour choisir les termes les plus appropriés de la loi future sur la fin de vie. Madame la rapporteure, nous nous retrouverons très prochainement et aboutirons ensemble aux compléments législatifs que les Français espèrent.
Applaudissements sur les bancs des groupes REM et MODEM.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, avec cette proposition de loi « pour une fin de vie digne » qu'il nous est donné d'examiner ce soir, c'est notre conception de la société et de la dignité de l'homme qui se joue. C'est aussi la réponse que la représentation nationale entend donner à cette question de fond : dans quelle société voulons-nous vivre ?
La question est d'autant plus fondamentale que les problématiques dites « sociétales » souffrent trop souvent de n'être traitées que de façon partielle, comme si l'histoire avait un sens qu'il suffirait d'épouser pour être dans le vrai, poussé par les vents de la modernité.
Mes chers collègues, l'avenir n'est pas écrit d'avance. Il n'obéit à aucune loi sous-jacente qu'il nous faudrait simplement découvrir, puis accompagner aveuglement. L'avenir est ce que nous en faisons. Et c'est parce qu'il ne tient qu'à nous de le bâtir que les représentants de la nation doivent légiférer la main tremblante, conscients des conséquences que portent en elles toutes décisions.

La présente proposition de loi répond-elle à cette exigence de prudence ? Il nous est malheureusement permis d'en douter, pour deux raisons principales, l'une entraînant l'autre : le diagnostic partiel que pose ce texte sur la fin de vie en France et la nature même des réponses qu'il préconise.
Le diagnostic, tout d'abord. Comme l'explique Frédéric, aide-soignant de l'hôpital d'Argenteuil : « Dans les services de soins palliatifs, on ne soigne pas des mourants. On soigne des vivants. » Puissions-nous entendre ces mots. Pour Frédéric, comme pour les équipes de soins palliatifs que j'ai pu rencontrer dans mon département de Seine-Saint-Denis, les choses sont claires : les demandes d'euthanasie sont rares, pour ne pas dire inexistantes. Quand il y en a, elles sont très vite retirées lorsque leur est opposé l'accompagnement global – scientifique, social, psychologique et spirituel – prôné par les soins palliatifs.
Un obstacle au développement de cet accompagnement tient au fait – cela est souligné dans l'exposé des motifs de ce texte – que la mort est devenue « un sujet tabou » en France ; plus encore que la mort, c'est la vulnérabilité de la personne, la prise en compte de la fragilité intrinsèque de notre humanité qui est aujourd'hui évacuée de notre réflexion.
De plus en plus maîtres de nos choix, nous oublions qu'avant de devenir autonomes, nous avons dû acquérir cette autonomie, qu'elle nous a été transmise. Nous sommes donc, de ce fait, des êtres fondamentalement sociaux, dépendants d'autrui ; à ce titre, prétendre être, jusqu'au soir de sa vie, totalement souverain de ses choix relève plus de la peur – peur de perdre l'image que l'on s'est faite de soi-même – que d'une demande thérapeutique.
Oui, la condition humaine fait qu'à un moment, on s'affaiblit. Devient-on pour autant moins digne ? C'est parce que l'homme est par nature digne, de sa naissance à sa mort, que notre devoir est de lui porter assistance et de tout faire pour que les solutions existantes lui soient enfin proposées. En effet, les experts s'accordent aujourd'hui pour dire que toute douleur peut être soulagée par une gamme de solutions pouvant aller jusqu'à l'utilisation de techniques anesthésiques ou à une chirurgie de la douleur. Les souffrances dont l'origine est une dépression trouvent, elles aussi, très majoritairement, des réponses médicales. Nos concitoyens ont tout simplement besoin de le savoir, ont un fort besoin de réassurance.
Or, loin de les rassurer, ce texte, en proposant de légaliser l'euthanasie, prend acte de leur peur, comme si elle était sans issue. Ainsi s'appuie-t-il sur un sondage commandé à l'IFOP par l'ADMD, dont nous connaissons tous le point de vue très partisan sur ce sujet, qui révélerait que 92 % des Français soutiennent la légalisation de l'euthanasie. On ne peut que s'étonner que, sur un sujet aussi lourd de sens, vous puissiez sérieusement vous référer à un tel sondage, dont le caractère biaisé a été parfaitement démontré par les journalistes de l'émission Envoyé spécial.
En effet, comment s'étonner que les Français répondent oui à la question suivante : « Selon vous, la loi française devrait-elle autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie de ces personnes souffrant de maladies insupportables et incurables si elles le demandent ? » Comme l'explique Alain Garrigou, directeur de l'Observatoire des sondages, ce n'est pas une question neutre ; « souffrance », « insupportable », « incurable » : ces termes, loin d'être neutres – chacun pourra en convenir – , incitent à la compassion, pas au discernement. Pourquoi ne pas parler de cet autre sondage, réalisé également par l'IFOP, deux ans plus tôt, cette fois-ci pour une association contre l'euthanasie, selon lequel seuls 34 % des sondés plébiscitaient l'euthanasie ?
Au fond, quel que soit le sondage que l'on retienne, des conclusions convergentes peuvent être tirées : il est urgent, en France, de se pencher sur la qualité de la fin de vie. Trop de gens perçoivent la fin de vie comme une somme de douleurs qu'il est inutile de prolonger. Ces sondages doivent donc être vus comme un appel à nous ressaisir, pas à recourir à la facilité ou à démissionner face à des situations de détresse auxquelles notre société pourrait répondre si elle s'en donnait les moyens et se concentrait, avant toute chose, sur la bonne application du droit existant.
La loi Claeys-Leonetti, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, comme le droit à la sédation profonde et continue et, à cette fin, la mise en oeuvre de directives anticipées, a été votée il y a à peine plus d'un an : donnons-nous le temps de l'évaluation.
Les premières remontées de terrain font en tout cas état, chez nos médecins, de difficultés pratiques et éthiques à faire appliquer les nouveaux droits prévus par la loi Claeys-Leonetti. Un acte comme la sédation est en effet lourd de conséquences pour un seul homme, qui plus est lorsque celui-ci est animé du devoir d'assistance, comme le rappelle l'avis du Comité consultatif national d'éthique de 2013 sur la fin de vie.
Cet acte est d'autant plus lourd que la culture des soins palliatifs est faible dans notre pays : selon la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, seuls 30 % des personnes qui en auraient besoin bénéficient aujourd'hui de soins palliatifs. Autrement dit, sept Français sur dix en fin de vie ne bénéficieraient pas de soins palliatifs.
Face à ce constat, que proposez-vous concrètement à travers la présente proposition de loi ? L'article 1er dispose : « Toute personne [… ] atteinte d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable et qui ne peut être apaisée, ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander [… ] à bénéficier d'une euthanasie ou d'une assistance au suicide. »
Autrement dit, le fait que la souffrance soit issue d'une maladie et que le pronostic vital soit engagé ne sont plus des conditions nécessaires. La France est donc sommée d'adopter le modèle belge, érigé curieusement en référence, à l'heure où d'importantes dérives se font jour. La loi belge n'exige en effet pas que la personne soit en phase terminale d'une maladie grave et incurable, objectivement évaluée par le corps médical. Dans une tribune publiée dans la presse locale, à la fin de l'année 2016, un collectif d'éthiciens et de médecins belges s'en est ému, rappelant que la perception subjective de la souffrance dans leur pays devenait progressivement le seul critère – je dis bien le seul – pris en compte.
Ce n'est pas tout : le texte s'inspire aussi du droit belge en prévoyant qu'en cas de refus de pratiquer une euthanasie, le médecin puisse faire valoir une clause de conscience, à condition d'être tenu de transmettre le dossier médical du patient à un autre médecin qui accédera à sa demande d'euthanasie.
Concrètement, cela revient à contraindre le médecin objecteur à coopérer indirectement à un acte qui répugne à sa conscience. Il est donc contraint à une forme d'hypocrisie : « Je ne le fais pas moi-même mais je vous dirige vers un confrère qui répondra à votre demande ». N'y a-t-il pas ici, comme en d'autres points, quelque contradiction à revendiquer, d'un côté, une autonomie morale complète et à exiger, de l'autre, que, dans l'exercice des activités publiques et professionnelles, chacun mette entre parenthèses ses propres convictions pour satisfaire les requêtes individuelles ?
Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce texte, présenté dans la précipitation, ne répond ni aux enjeux de notre temps, ni aux véritables besoins des personnes en fin de vie. Comme l'a précisé mon collègue Stéphane Viry, les députés du groupe Les Républicains sont libres de leur vote ; pour ma part, je voterai contre ce texte.
Applaudissements sur les bancs du groupe LR et sur quelques bancs du groupe REM.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, le groupe La France insoumise, avec cette proposition de loi, entend légaliser l'euthanasie et le suicide assisté.
Si la question était de savoir si, à titre personnel, je suis favorable à l'euthanasie ou au suicide assisté, je répondrais probablement oui, comme un grand nombre de Français lorsqu'on leur pose cette question, parce que, comme la plupart d'entre nous, je ne veux pas imaginer une mort ou une existence avec des souffrances physiques ou psychologiques insupportables.
Mais la question n'est pas celle-là. Il s'agit ici de savoir s'il convient de légiférer pour permettre à des personnes souffrant d'une maladie grave ou incurable de recourir légalement à des dispositifs médicaux visant à mettre fin à leur vie.
La façon dont notre société aborde la souffrance et la mort nous préoccupe tous car elle interroge notre humanité. Cette assemblée a ainsi largement débattu, à juste titre, de la question de la fin de vie et de l'euthanasie ces dernières années. La loi Claeys-Leonetti de 2016 a renforcé la loi Leonetti de 2005, en rappelant que toute personne a droit à une fin de vie digne, en inscrivant notamment le droit d'opposabilité des directives anticipées, ainsi que le droit à un réel apaisement des souffrances. Elle constitue une avancée majeure en termes de reconnaissance des droits des malades en fin de vie.
Outre la bienveillance vis-à-vis des patients, il est possible de recourir en cours de traitement, lorsque ceux-ci s'avèrent trop durs à supporter, à des périodes de sédation temporaires dans le but de soulager efficacement la douleur et d'avoir de réels moments de répit. Dans le cas de traitements n'ayant plus d'efficacité, une sédation profonde et continue peut-être envisagée.
Cette loi a également consacré l'accès aux soins palliatifs et le droit pour toute personne à une fin de vie digne et apaisée, les professionnels mettant tout en oeuvre pour que ce droit soit respecté. Cependant, à ce jour, 80 % des patients n'ont pas accès aux soins palliatifs et un tiers seulement des médecins sont formés à la démarche palliative.
L'objectif des soins palliatifs est de prévenir et soulager les douleurs et syndromes dont souffre une personne atteinte d'une maladie grave ou incurable. Il s'agit d'une approche globale, qui doit prendre en compte tous les types de souffrances : physiques, psychiques, sociales. Les soins palliatifs ne se limitent théoriquement pas aux dernières semaines de vie : ils devraient pouvoir bénéficier aussi bien à des patients pour lesquels les soins curatifs n'apportent plus de perspective d'évolution favorable – quel que soit le stade de la maladie – qu'aux patients vivant des étapes difficiles au cours de leur traitement, afin d'atténuer par tous les moyens leurs symptômes ou leur souffrance psychique dans les moments où il n'est pas possible d'avoir une action sur la cause de ces souffrances.
En cela, les soins palliatifs relèvent de la bientraitance et, dans une société qui se voudrait très évoluée et qui se donnerait les moyens de cet humanisme, la question du soin palliatif devrait s'imposer comme une évidence au soignant. Or les personnels des unités de soins palliatifs déplorent un manque de moyens criant. La légalisation de l'euthanasie ne viendrait pas résoudre le problème majeur qui fait qu'en France un nombre beaucoup trop important de personnes meurent mal. L'offre en soins palliatifs n'est pas assez diversifiée, le nombre de demandes est supérieur à celui des places disponibles et le manque de moyens, à la fois financiers et humains, crée des disparités entre unités et entre patients.
Nous souffrons, dans notre pays, d'un manque de culture en matière de soins palliatifs. Si l'on peut citer en exemple la Belgique et la Suisse pour leur ouverture à une demande d'euthanasie et de suicide assisté, nous nous devons de préciser que ces possibilités trouvent leur sens dans un continuum de soins, dans lequel les soins palliatifs ont une place privilégiée – ce n'est pas encore le cas en France.
Il est vrai que, ces dernières années, un certain nombre de situations complexes nous ont interpellés, telles que celles de Vincent Lambert ou d'Anne Bert. Le cas de cette dernière, qui a souhaité raccourcir sa vie en raison du caractère insupportable pour elle de l'évolution de sa maladie, est sans nul doute l'une des situations exceptionnelles pour lesquelles nous pourrions être amenés à faire évoluer la législation au cours des prochaines années.
Toutefois, les témoignages des soignants et des bénévoles en soins palliatifs sont unanimes : nombreux sont les patients qui entrent en soins palliatifs en demandant d'en finir au plus vite – si cela était possible grâce à une « petite piqûre » – et qui vivent en étant bien accompagnés de précieuses dernières heures, derniers jours ou dernières semaines, en ayant encore pu prendre ou donner de belles choses à la vie.
Le cas de Vincent Lambert, dont la famille s'est déchirée pour savoir s'il fallait arrêter les soins ou les poursuivre, pose la question des directives anticipées. Si aujourd'hui toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée « directives anticipées » pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie, un grand nombre de personnes ignore l'existence de cette possibilité.
Ce droit existe depuis la loi Leonetti de 2005 mais, en 2012, seuls 2,5 % des patients en fin de vie avaient rédigé leurs directives anticipées. La loi de 2016 prévoit que les directives anticipées s'imposent au médecin, sauf en cas d'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, et lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
La désignation d'une personne de confiance est également essentielle. Le choix de plusieurs tiers, comme on le propose dans l'article 2 de cette proposition de loi, pourrait avoir du sens, mais il conviendrait de limiter leur nombre à deux car la multiplication des parties prenantes pourrait complexifier de manière significative la relation avec l'équipe médicale.
À l'examen de cette proposition de loi, d'autres questions se posent. L'article 3 dispose qu'une personne peut exprimer sa volonté d'être euthanasiée ou de bénéficier d'une assistance au suicide lorsqu'elle « est atteinte d'une affection grave ou incurable ». La question du curseur à placer est ici capitale : à partir de quand juge-t-on qu'une maladie est suffisamment grave pour que la vie du patient soit abrégée ? À partir de quel degré de souffrance peut-on estimer que celle-ci n'est plus supportable ? Si les souffrances psychiques peuvent être absolument intolérables, un médecin doit-il abréger la vie d'un patient souffrant d'une dépression grave ? Ces questions sont extrêmement délicates et doivent être traitées avec la plus grande précaution.
Il faut définir un cadre clair et les médecins ne doivent pas être laissés seuls, ni même à deux, pour prendre une décision pouvant se révéler extrêmement difficile. Au même titre que pour la sédation profonde, c'est la collégialité entre les soignants qui peut permettre à des médecins, dont la fonction est de soigner, d'admettre qu'un acte de mort soit la seule réponse qu'ils puissent apporter à un patient.
Par ailleurs, l'article 4 prévoit la mise en place d'une clause de conscience autorisant les médecins qui le souhaitent à ne pas participer à un acte d'euthanasie ou à un suicide assisté. En effet, ces actes, qui sont loin d'être anodins, ne peuvent être imposés aux médecins. Nous souhaiterions cependant aller plus loin en précisant que, d'une façon générale, aucun médecin ne serait tenu de participer à une euthanasie ou à une assistance au suicide, ces actes devant faire l'objet d'une démarche réellement volontaire de la part des médecins.
De plus, il paraît essentiel, si nous venions à légaliser l'euthanasie, que les médecins y soient correctement formés, pour accompagner au mieux le patient dans son parcours. Nous estimons que, sans davantage de formation des équipes médicales et sans une réelle démarche volontaire, l'euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être réalisés dans des conditions acceptables.
Il convient donc avant toute nouvelle loi en la matière d'évaluer la loi Claeys-Leonetti, d'en faire connaître les dispositions au grand public et au personnel médical en réalisant des campagnes d'information régulières sur les droits qu'elle a créés, et de favoriser une égalité territoriale d'accès aux soins palliatifs, afin de donner au plus grand nombre la possibilité de mieux vivre la fin de leur vie.
Pour les raisons évoquées, le groupe MODEM votera contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs des groupes MODEM et LR.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, si l'on adopte le point de vue de Sirius et que l'on observe d'un oeil distancié les évolutions de nos sociétés démocratiques depuis plus de deux siècles, nous ne pouvons qu'être frappés par la rapidité et l'ampleur des mutations à l'oeuvre. Grâce aux progrès de la médecine, grâce à la découverte de l'infiniment petit et des microbes, à l'invention des vaccins et au développement de l'État-providence et de la protection sociale, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé.
La démocratie libérale s'impose peu à peu, dans l'esprit des gouvernants et dans celui des gouvernés, comme le modèle de gouvernement le plus adapté à nos sociétés contemporaines. Les droits fondamentaux des individus sont ainsi mieux reconnus et irriguent davantage les rapports des individus avec la société dans son ensemble. Les protections dont bénéficient les individus, qu'il s'agisse de la protection face aux aléas de la vie, face à l'arbitraire de l'État, face à la nature, n'ont jamais été aussi importantes. En d'autres termes, la qualité de la vie s'est améliorée.
Dans le même temps, notre rapport à la mort a évolué. Jadis familière et présente au quotidien – une mort « apprivoisée » pour reprendre l'expression de l'historien Philippe Ariès – , la mort est désormais médicalisée et reléguée hors de la société. Les progrès de la médecine et des nouvelles technologies, conjugués à l'augmentation de la durée de la vie, posent aujourd'hui des questions inédites, que les précédentes générations ne pouvaient envisager.
Dans ce contexte, il est évidemment compréhensible qu'émergent chez nos concitoyens des demandes visant à améliorer la qualité de la mort.
Sur un sujet aussi délicat et sensible, voire intime – comme vous l'avez dit, madame la ministre – , ma conviction profonde est qu'il ne faut légiférer qu'avec prudence et pour ainsi dire « d'une main tremblante », pour reprendre la formule de Montesquieu.
Il s'agit en effet d'une question qui dépasse et transcende très largement les clivages partisans. Sur ce sujet qui renvoie à l'expérience personnelle de chacun, il est infiniment malaisé de déterminer ce qui pourrait être la bonne position ou la bonne approche. Faut-il en effet inscrire la reconnaissance du droit à mourir dans le mouvement plus général d'extension des droits fondamentaux, comme le demandent certaines associations et une partie non négligeable de nos concitoyens ? Faut-il au contraire se ranger à la conviction d'un Robert Badinter, qui voyait dans le droit à la vie « le premier des droits de l'homme » et considérait en conséquence que personne ne pouvait disposer de la vie d'autrui ?
Par ailleurs, comment s'accorder sur une définition commune de la dignité ? Comment également concilier, s'agissant des professionnels de santé, le devoir d'éviter des souffrances inutiles et l'interdiction de provoquer la mort délibérément, inscrits dans le serment d'Hippocrate ?
Face à ces questions cruciales, le Parlement a cherché à améliorer le cadre législatif de la fin de vie en adoptant en 1999 la loi visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, qui a posé comme principes le droit pour tout malade de refuser un traitement et le droit aux soins palliatifs et à un accompagnement pour toute personne dont l'état le requiert.
Le cadre législatif actuel concernant la fin de vie a été défini par les lois Leonetti du 22 avril 2005 et Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Elles ont introduit la notion d'acharnement thérapeutique et ouvert la possibilité d'arrêter les soins lorsque ceux-ci résultent d'une « obstination déraisonnable ». Ces lois constituent indéniablement des avancées vers une meilleure prise en compte de la volonté du patient, avec l'introduction des directives anticipées, qui sont désormais opposables, ou le renforcement de la place de la personne de confiance, dont « le témoignage prévaut sur tout autre témoignage ».
Elles ne permettent pas, cependant, de répondre à l'ensemble des situations et ne constituent pas une réponse pleinement satisfaisante à la question du droit à mourir pour un nombre croissant de nos concitoyens. Selon les données de l'Institut national d'études démographiques, chaque année, en France, entre 2 000 et 4 000 personnes terminent leur vie avec une aide active à mourir de la part des médecins. La justice est en conséquence souvent désarçonnée par le décalage entre les pratiques et la loi. Nous avons tous à l'esprit les nombreux cas qui ont défrayé les médias et dont on peut regretter qu'ils aient parfois conduit à hystériser le débat, au détriment souvent des patients eux-mêmes et de leur entourage.
Je suis, à titre personnel, en faveur d'une évolution de la législation en ce sens et pour une reconnaissance du droit à mourir dans la dignité. Je crois qu'il convient de laisser le libre choix à la personne lorsqu'elle est capable de l'exprimer ou a laissé des directives claires en ce sens et lorsqu'il n'y a plus d'espoir de rémission.
J'émets d'ailleurs à ce titre une réserve concernant la proposition de loi que vous défendez, madame la rapporteure. Vous évoquez à l'article 1er la possibilité donnée au patient atteint d'une « affection grave ou incurable » de demander à bénéficier d'une euthanasie ou d'une assistance au suicide. Ce faisant, vous élargissez grandement le champ d'application et ouvrez la porte à de possibles dérives : comment définir en effet le champ des maladies graves permettant de bénéficier d'une euthanasie ? Monsieur Touraine le faisait justement remarquer, en commission des affaires sociales et ce soir encore : un cancer est une maladie grave dont il est heureusement possible de guérir. Il s'agit là d'une différence significative avec d'autres propositions de loi sur le même sujet émanant d'autres bancs de cet hémicycle ; je ne peux vous rejoindre.
Il me semble plus opportun, alors que les décrets d'application de la loi Claeys-Leonetti ne datent que du mois d'août 2016, de nous attacher en priorité à l'évaluation et au suivi de l'application de cette loi. Les orientations présentées par le plan national triennal 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie mettaient en effet en lumière la faible culture des soins palliatifs en France. Elles faisaient notamment état d'importantes inégalités dans l'accès à ces soins et insistaient sur la nécessité de réduire ces dernières en investissant d'abord dans la connaissance et l'implication des patients eux-mêmes.
Il s'agit là d'une orientation d'autant plus nécessaire que les lois Leonetti mettent avant tout l'accent sur la possibilité donnée au patient de conserver la maîtrise des décisions qui le concernent jusqu'à la fin de ses jours. Ainsi, seulement 2,5 % environ de nos concitoyens rédigent des directives anticipées, alors qu'elles sont le moyen le plus sûr de se faire entendre lorsqu'on n'est plus en mesure de s'exprimer directement et permettent de résoudre nombre de situations difficiles.
La situation au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes l'illustre. Selon l'étude intitulée « Fin de vie en EHPAD » menée par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, seuls 23,4 % des résidents décédés en EHPAD sont en mesure, au cours de leurs dernières vingt-quatre heures, de s'exprimer de façon lucide. Autrement dit, dans plus des trois quarts des situations, le recueil anticipé des souhaits de fin de vie des résidents est indispensable.
Nous avons tous en tête les projections démographiques pour les prochaines années, qui annoncent une augmentation conséquente de la proportion de personnes âgées dans la population. Lors de la remise du rapport d'évaluation sur la loi d'adaptation de la société au vieillissement, aux côtés de Charlotte Lecocq, nous avions alerté sur les manques de la loi et les insuffisances dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes au sein des EHPAD. Nous avions notamment appelé à une réflexion en vue de créer les conditions du « bien vieillir », qui est intimement liée à la question du « bien mourir ». Dans le cadre de la réflexion que nous devons avoir sur une meilleure prise en charge de la dépendance, l'enjeu du développement des soins palliatifs doit avoir toute sa place, afin d'accompagner dignement la fin de vie de nos aînés.
En parallèle d'une réflexion sur le droit à mourir, il convient donc de s'assurer de la bonne application du cadre législatif existant. Par ailleurs, sur un sujet aussi engageant et qui renvoie à l'expérience personnelle de chacun, notre groupe ne porte pas une voix univoque. Nous sommes cependant convaincus que la discussion sur ce sujet doit se dérouler dans un cadre apaisé et serein. Les états généraux de la bioéthique, organisés sous l'égide du Comité national consultatif d'éthique, viennent de débuter et s'achèveront à la fin du printemps. Nous souhaitons qu'ils permettent l'expression de l'ensemble des sensibilités de nos concitoyens sur cette question difficile, afin que la représentation nationale soit ensuite en mesure de se déterminer, le cas échéant, avec clarté et mesure.
Pour toutes ces raisons, madame la rapporteure, nous nous abstiendrons sur cette proposition de loi. Certes, vous avez remis le sujet sur la table, mais nous pensons qu'il faut encore discuter avant de décider.

Monsieur le président, madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, chaque drame médiatisé est l'occasion d'un débat public passionné, mais ce n'est là que la partie émergée d'un iceberg de détresse plaçant quotidiennement familles, personnels soignants et malades eux-mêmes devant des décisions difficiles, parfois équivoques et le plus souvent tragiques, qu'il s'agisse de franchir, dans la clandestinité et le silence d'un service, le pas de l'euthanasie, ou de faire le choix inverse alors que le patient demande avec insistance un geste libérateur.
Ces difficiles et douloureux débats ne se résument pas à dire le bien et le mal, le juste et l'injuste. Rien n'y est d'une rationalité évidente – ni d'ailleurs radicalement neuf : Francis Bacon déjà, en 1605, suggérait que l'office du médecin n'était « pas seulement de rétablir la santé mais aussi d'adoucir les douleurs et les souffrances attachées aux maladies ; et cela non seulement en tant que cet adoucissement de la douleur, considérée comme un symptôme périlleux, contribue et conduit à la convalescence, mais encore afin de procurer au malade, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort douce et paisible ».
Cette définition de ce que l'on appelait alors la « bonne mort » précède le terme d'euthanasie et désigne à l'époque, au regard de la définition qu'on leur donne aujourd'hui, les soins palliatifs. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le terme prend son acception moderne et livre ses deux pendants : l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Entre les deux, il y a bien souvent la conscience des familles, des médecins, des juges aussi dont la jurisprudence tantôt condamne, tantôt relaxe. Et puis il y a l'opinion publique, partagée sur cette question, chacun d'entre nous se demandant : « Et si c'était moi ? »
La question n'est pas simple et il serait hasardeux de la réduire à un combat entre progressistes et conservateurs. Nous aurions tort de tomber dans la caricature et la facilité consistant à politiser à l'excès ce débat. Les extraordinaires progrès de la médecine, l'emprise des sciences et des techniques placent chaque jour les médecins, les patients et les familles devant des choix difficiles et nouveaux.
Depuis plusieurs années le législateur a engagé un travail important d'adaptation de notre droit. La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie a légalisé la possibilité d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Sous la XIVe législature, la loi du 2 février 2016 a créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. La loi Claeys-Leonetti pose le principe selon lequel toute personne a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Cette loi de progrès tend au développement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Elle ouvre un droit à la sédation profonde et continue. Elle renforce le statut des directives anticipées et précise la mission de la personne de confiance.
Nous le voyons, la société et le législateur travaillent depuis des années sur cette question d'un droit, le droit de choisir, qui suppose lucidité, connaissance et demandes réitérées. Tous les choix, s'ils peuvent être faits de cette manière, sont dignes, que l'on choisisse d'avoir recours – ou pas – à ces pratiques. La dignité n'est pas dans telles ou telles conditions de décès ; elle est dans la possibilité offerte à chacune et chacun de choisir. Ce qui est indigne, c'est de ne pas pouvoir choisir.
C'est la raison pour laquelle cette question est intrinsèquement liée au devoir de la société d'accompagner le malade au moyen des soins palliatifs. Il existe incontestablement, et avant toute autre chose, un droit à vivre dans la dignité, engageant notre responsabilité sociale et morale. On ne saurait traiter de la question de l'euthanasie sans la lier indéfectiblement à celle des soins palliatifs. Or la mise en oeuvre effective de ces soins souffre d'inégalités géographiques et entre services, et d'une culture, en la matière, encore insuffisamment partagée, conduisant à des prises en charge défaillantes.
Un rapport récent de l'inspection générale des affaires sociales – l'IGAS – , publié en janvier 2017, a mis en évidence que le risque « d'une absence ou d'une insuffisance de soins palliatifs existe [… ] pour plus de 75 % des personnes » en ayant besoin, soit environ 300 000 personnes par an. C'est considérable et c'est inacceptable. Lors de son audition par Mme la rapporteure, Jean-Luc Romero a indiqué que 48 % des lits en unités de soins palliatifs étaient concentrés dans la région Île-de-France, où vit 18 % de la population française.
Le développement des soins palliatifs doit être une priorité de santé publique, parce qu'ils sont la condition sine qua non pour que les malades puissent bien vivre. La possibilité de recevoir, mais aussi de refuser des soins palliatifs, c'est la possibilité d'un exercice complet par le malade de ses droits et de sa liberté de choisir. Lier euthanasie et soins palliatifs, c'est aussi évacuer l'argument consistant à réduire l'euthanasie à un contournement des soins palliatifs.
Par ailleurs, la nécessité de légiférer en matière d'euthanasie et de suicide assisté doit également être examinée au regard des pratiques existant dans notre pays. D'après une étude de l'Institut national d'études démographiques – l'INED – de 2012, entre 2 000 et 4 000 personnes en phase terminale reçoivent une aide active à mourir chaque année en France. Vous indiquez, madame la rapporteure, que « Jean-Luc Romero a rappelé, lors de son audition, qu'on estime aujourd'hui à environ 4 000 le nombre d'euthanasies clandestines pratiquées chaque année en catimini dans les hôpitaux français, et que les quatre cinquièmes d'entre elles n'étaient pas demandées par les personnes concernées ».
L'absence d'encadrement légal, on le voit bien, expose à toutes les dérives. Nous savons aussi que de nombreuses Françaises et de nombreux Français se rendent dans les pays dans lesquels l'euthanasie ou le suicide assisté sont autorisés.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est inspirée des lois belges et luxembourgeoises. Elle légalise l'euthanasie et le suicide assisté, à condition d'en respecter les procédures, pour les personnes atteintes d'une affection grave ou incurable, et dépénalise la participation des médecins à une euthanasie ou à un suicide assisté. Ce débat mérite d'être conduit – et je remercie ceux qui en ont été à l'origine de nous permettre de l'avoir ce soir – pour que puissent advenir un nouveau droit et une nouvelle liberté – car il y a, derrière la question de l'euthanasie, c'est-à-dire de la volonté individuelle la plus pure, une autre question, tout aussi fondamentale : celle du sens que nous voulons donner à la liberté. Oui, cette liberté ultime mérite la considération, le respect et la protection de la société. « Le désir d'avoir sa mort à soi devient de plus en plus rare. Quelque temps encore, et il deviendra aussi rare qu'une vie personnelle », écrivait Rainer Maria Rilke. Votre proposition de loi, d'une certaine manière, vise à créer un droit nouveau : celui d'avoir une mort à soi.
Sur les questions touchant à la vie et à la mort, le groupe Nouvelle Gauche pratique la liberté de vote, ces choix relevant de la conscience de chacun. Cependant, une majorité de notre groupe est favorable à la création d'un nouveau droit de choisir sa fin de vie. Cette liberté doit bien sûr être encadrée par des conditions strictes pour éviter des dérives. Le choix personnel de sa mort doit pouvoir se faire dans le respect de toutes les consciences. Pour ma part et au nom du groupe Nouvelle Gauche, je voterai, si j'en ai la possibilité, pour l'adoption de cette proposition de loi.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe FI.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, le débat sur une proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie et l'assistance au suicide pour les personnes atteintes de maladies graves ou incurables nous oblige, en tant que législateurs, à nous interroger sur la nécessité de légiférer et sur les contours et les conséquences d'un tel texte.
L'offre proposée par notre système de santé en matière de soins palliatifs a considérablement évolué au cours des dernières années. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. Une maison de santé canadienne, nommée Victor-Gadbois et située à Montréal, affiche que : « Soigner les gens, ce n'est pas seulement rechercher les causes de leur souffrance, c'est leur donner l'espoir que demain sera mieux qu'hier ». Je rejoins ces principes. Notre société et notre République doivent permettre à tout un chacun d'être soigné dans la dignité.
Cependant, je dois aussi constater que, dans certaines situations complexes, l'espoir que demain soit mieux qu'hier n'existe plus, et plus rien n'est envisageable. Alors, l'éthique du dernier soin, l'éthique du juste soin doit être posée avec tempérance et lucidité. Nous devons entendre les attentes de nos concitoyens. Nous devons également entendre les professionnels de santé, les médecins, les infirmières et aides-soignants ; nous devons entendre les bénévoles qui, investis au quotidien dans les structures de santé ou au domicile des patients, accompagnent les personnes confrontées à la maladie.
Je ne saurais, à ce jour, en tant que législateur, prendre position sur ce sujet de société qui requiert la plus grande prudence de notre part. Molière disait : « On ne meurt qu'une fois ; et c'est pour si longtemps ! ». Alors, prenons simplement le temps, pendant quelques mois, de mener un débat de bioéthique – un débat qui nous éclairera sur les attentes de nos concitoyens, lesquels semblent souhaiter que l'accompagnement de la fin de vie soit mieux encadré, un débat qui nous éclairera sur d'autres offres et d'autres possibilités que ce qui est autorisé aujourd'hui.
Une loi de bioéthique doit être la plus juste possible ; ce doit être un texte idoine, réaliste et concret. En la matière, la loi ne saurait l'être sans prendre connaissance du rapport de l'inspection générale des affaires sociales ou du Comité consultatif national d'éthique, ou sans une évaluation de l'application et de l'appropriation des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016. Lorsque nous légiférons, lorsque nous rédigeons des textes, des articles de loi, des amendements, nous devons avoir un objectif d'efficacité et l'assurance que la traduction et l'appropriation de la loi sur le terrain seront optimales et partagées par tous les acteurs.
Nous ne saurions légiférer sur l'euthanasie sans nous assurer que la genèse des motivations de la loi ne provient pas d'un déficit d'offre ou d'accès aux soins palliatifs. La formation de nos soignants en soins palliatifs est-elle identique dans chaque établissement, dans chaque service, dans chaque école de formation des professionnels du secteur paramédical ? Le nombre d'équipes mobiles en soins palliatifs est-il suffisant pour garantir une prise en charge adaptée ? Nous devons pour cela évaluer le plan national pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, couvrant les années 2015 à 2018.
Alors, identifier en amont d'un texte les freins au déploiement d'une précédente loi sur la fin de vie permettrait d'élaborer une meilleure loi, si les débats de bioéthique à venir concluaient au besoin d'un nouveau texte. Une loi sur la fin de vie et sur une assistance à mourir ne peut se concevoir sans une partie réservée au développement des soins palliatifs dans notre système de soins. Cela doit être complémentaire et aucun aspect ne doit prévaloir sur l'autre. Seules les volontés des personnes souffrantes doivent être entendues, ce qui nécessite une équité d'accès aux différentes offres de soins. Le docteur Thérèse Vanier disait que les soins palliatifs étaient « tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire ». Alors, ce soir, mes chers collègues, dans cet hémicycle, je vous dirai que tout ce qu'il reste à faire, c'est justement de reconnaître que tout reste à faire.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes REM et MODEM.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la fin de vie est un sujet complexe et délicat, parce qu'il renvoie chacun d'entre nous à son expérience intime de l'accompagnement d'un proche, et je suis persuadé que nous souhaitons tous un débat apaisé et serein, qui respecte chaque parcours ; je crois que c'est le cas ce soir.
Le sujet fait aussi appel à nos convictions et à notre manière de concevoir la vie en société et la vie de chaque personne. Le débat de ce soir permet à nos collègues de La France insoumise d'afficher avec clarté leur objectif de voir notre pays reconnaître l'euthanasie et le suicide assisté. À l'image de Mme la rapporteure, Caroline Fiat, ils défendent leurs convictions avec détermination et cohérence.
C'est avec la même détermination et la même cohérence que ceux qui, comme moi, sont opposés à l'euthanasie et au suicide assisté interviennent dans ce débat pour exprimer et motiver leur opposition. Nous aimerions d'ailleurs que la majorité parlementaire fasse preuve de la même clarté. Les groupes majoritaires sont-ils pour ou contre le texte qui nous est proposé aujourd'hui ? Certes, le débat n'est sans doute pas aussi manichéen, et l'on peut être en faveur du texte sous certaines conditions ou y être opposé sauf exceptions. Mais, sur un sujet aussi crucial, nous sommes en droit de connaître les intentions claires de la majorité, ces intentions ne devant pas se cacher derrière des prétextes ambigus de calendrier.
En attendant, ces débats vont nous permettre d'exprimer des conceptions différentes, ce qui est normal car ces différences parcourent aussi notre société. Je voudrais exprimer trois convictions, qui sont autant de divergences avec le texte qui nous est proposé.
La première divergence a trait au calendrier. Une loi a été votée il y a moins de deux ans. Il faut, avant toute autre initiative, la mettre en oeuvre, mieux la faire connaître et l'évaluer. Aujourd'hui, il est beaucoup plus urgent de développer les soins palliatifs ; certes, des plans sont régulièrement annoncés en la matière mais, comme vous l'avez indiqué, madame la ministre, il reste beaucoup à faire sur le terrain pour répondre aux attentes et aux besoins, et pour combler les inégalités territoriales. Dans cet esprit, nous pourrions nous retrouver dans la proposition de loi qui soutient le projet de faire des soins palliatifs la grande cause nationale de 2018. Nous pouvons reprendre cette proposition soutenue par des associations. Nous sommes déjà plus de soixante-dix, issus de cinq groupes, à avoir cosigné cette proposition de loi. Je tiens d'ailleurs à souligner que l'ensemble du groupe La France insoumise s'est joint à cette démarche. En sens inverse, nous ne pouvons que déplorer l'absence de soutien des groupes majoritaires. Notons d'ailleurs que les groupes de la majorité ont même voté en commission contre deux amendements à travers lesquels nous proposions un rapport visant au développement des soins palliatifs.
La deuxième divergence touche aux arguments invoqués. S'agissant des sondages, méfions-nous de la manière dont sont posées les questions, comme l'indiquait tout à l'heure notre collègue Alain Ramadier. Les méthodes employées peuvent effectivement orienter les réponses. Prenons également garde aux sondages concernant les questions de société ; ainsi, allons-nous déposer une proposition de loi pour rétablir la peine de mort, au prétexte qu'une majorité de nos concitoyens y serait favorable ? Il faut employer ces arguments avec une extrême prudence. Il en va de même lorsque l'on cite d'autres pays en exemple : méfions-nous du moins-disant, du dumping éthique qui nous conduirait à nous aligner sur des pays qui n'ont ni notre histoire ni notre conception de la bioéthique. Soyons, au contraire, fiers de l'exception française en matière de bioéthique ; défendons cette exception éthique et refusons les logiques américaine et anglo-saxonne, imprégnées par l'individualisme, l'ultralibéralisme et l'utilitarisme.
La troisième divergence concerne nos conceptions de la personne et de la société. Oui, nous avons des conceptions divergentes sur la notion de dignité, par exemple. Pour nous, la dignité est intrinsèque à la personne humaine et indissociable de celle-ci. Pour vous, elle est variable en fonction des situations, elle est aléatoire, elle est contingente. À partir de là, deux conceptions de l'éthique se déploient : d'un côté, une éthique de l'autonomie, fondée sur une liberté individuelle absolue, et de l'autre, une conception de l'éthique fondée sur la vulnérabilité, qui prend en compte la fragilité et la dépendance. Vous l'avez compris, mes chers collègues, nous défendons cette éthique de la vulnérabilité pour nous opposer à ce texte, mais nous la défendrons aussi tout au long des débats qui nous attendent sur les sujets de bioéthique.
Applaudissements sur les bancs du groupe LR.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, la prise en charge de la fin de vie a beaucoup évolué ces dernières années dans notre pays, et c'est heureux. C'est un sujet qui concerne notre société tout entière, qui est lié à notre histoire, à notre culture philosophique commune de la mort et à la représentation que l'on en a. En même temps, c'est un sujet très intime, car il touche au plus profond de notre être, à la souffrance tant physique que psychologique et à l'essence même de notre existence.
Sur le plan technique, il convient de rappeler le développement des structures d'hospitalisation à domicile, des équipes mobiles de soins palliatifs, de la banalisation de l'usage des morphiniques à l'hôpital comme à domicile ou dans les EHPAD, grâce à plusieurs plans de lutte contre la douleur, sans nier pour autant les difficultés réelles qui persistent, en raison notamment du manque criant de personnels. Évoquons également la banalisation de l'usage du midazolam, des pompes à débit continu et des échelles de la douleur ainsi que la prévention des escarres et l'amélioration de la formation des praticiens, toujours plus exigeante, dans le cadre d'une filière gériatrique désormais bien structurée délivrant des diplômes universitaires de soins palliatifs.
Sur le plan juridique, la loi Leonetti, adoptée en 2005, a introduit un encadrement de la fin de vie grâce aux directives anticipées et permis la reconnaissance du concept d'« obstination déraisonnable », plus fin et plus précis que celui d'acharnement thérapeutique. Inspiré de l'evidence based medicine, le concept se fonde sur le point de vue du malade et prend en compte le patient, les données de la science et le contexte. L'adoption de la proposition de loi d'Alain Claeys et Jean Leonetti le 27 janvier 2016, à l'issue d'une commission mixte paritaire conclusive – je tiens à le souligner – , a permis de franchir une nouvelle étape en rendant désormais possible la sédation profonde et continue.
Sur le plan sociétal, l'approche philosophique, morale ou culturelle du sujet dont font preuve nos concitoyens a beaucoup évolué. Comme le démontrent toutes les enquêtes d'opinion, près de neuf Français sur dix sont favorables à l'euthanasie. Toutefois, le caractère générique du terme recouvre la réalité de chaque situation, qui est infiniment plus complexe. Il soulève de nombreuses autres questions : pour qui – est-ce pour soi ou pour ses proches – et de quelle façon ? Toutes ces questions doivent être débattues si nous voulons parvenir à un texte apaisé et consensuel. S'il est un sujet présentant une dimension profondément humaniste susceptible de faire consensus dans notre République, c'est bien celui-là.
Une société éclairée peut-elle accepter de prendre le risque d'une forme de marchandisation du suicide ? La sédation profonde et continue est-elle une réponse satisfaisante à toutes les situations de grande souffrance ? La loi qui l'autorise, finalement très récente, est-elle suffisamment connue ? A-t-elle fait l'objet d'une évaluation sérieuse ? N'ignorons pas non plus les malades souffrant d'une maladie incurable à un stade avancé, bloqués dans une sorte d'impasse thérapeutique et parfois contraints de chercher des solutions dans d'autres pays à la législation plus permissive en la matière.
Le sujet qu'aborde la proposition de loi que nous examinons ce soir mérite infiniment mieux qu'un exposé des motifs lapidaire ou qu'un vote à la sauvette.

Je suggère donc, au nom du groupe La République en marche, le renvoi du texte en commission. J'ajouterai aux arguments que j'ai développés une donnée cardinale en matière de décision relative aux soins palliatifs : l'absolue nécessité de son caractère collectif et partagé. Dans ce domaine, chaque décision doit être prise après évaluation et concertation. Chaque partie concernée doit pouvoir donner son avis : le malade – grâce aux directives anticipées – , la personne de confiance, les membres de la famille, les proches ainsi que tous les soignants – médecins, infirmiers et aides-soignants.
La décision, la prise de risque et parfois le sentiment de culpabilité doivent toujours être partagés. À l'heure où s'ouvre le débat sur la révision des lois de bioéthique, alors même que les espaces de réflexion éthiques régionaux compétents sur ce sujet n'ont pas été inaugurés, il est bien trop tôt pour légiférer. Il serait même très préjudiciable, me semble-t-il, de se priver des apports de cette intelligence collective.Quid de l'avis des sociétés savantes et des productions des nombreux ateliers citoyens ? Je crois sincèrement que le renvoi du texte en commission est, à cette heure, l'option la plus sage.
Enfin, s'il faut prendre en compte, dans le cadre de la réflexion sur la fin de vie qui nous occupe, l'un des trois piliers de notre République qu'est la liberté – la liberté de choix, celle d'en finir ou non avec la vie – , j'aimerais y introduire une autre notion, moins abrupte ou définitive que l'euthanasie : l'accompagnement quotidien des malades, si cher à la communauté des soignants, dont je fais partie depuis vingt-cinq ans.

Ceux-ci exercent chaque jour, aux côtés des gens concernés que sont les patients et leurs proches, et tiennent compte du caractère singulier et progressif de chaque situation. Ils permettent de prendre des décisions concertées et transparentes, dans un cadre strictement légal, digne d'une société moderne, éclairée et soucieuse de bien traiter ses membres.

Une fin de vie digne est une fin de vie accompagnée, bénéficiant d'un accompagnement bien fait à tous égards, avec attention, empathie, professionnalisme et considération, dépourvu de précipitation. Sur ce sujet également, ne nous précipitons pas.
Applaudissements sur quelques bancs des groupes REM et MODEM.

Dont le temps de parole devrait être réduit à quatre minutes pour compenser le dépassement précédent !
Exclamations sur les bancs du groupe REM.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, l'objet de la proposition de loi qui nous réunit ce soir est grave. Vous nous proposez, chers collègues du groupe de La France insoumise, de légiférer sur la vie et la mort. Légaliser l'euthanasie et le suicide assisté soulève une question de société essentielle, qui a concerné, concerne ou concernera chacun d'entre nous et ressortit à notre conception même de la liberté – en l'espèce, celle de mourir dans la dignité et d'abréger nos souffrances physiques et psychiques ou celles d'un membre de notre entourage.
Le sujet mérite d'être examiné, car la législation actuelle ne permet pas de traiter de nombreux cas. Au demeurant, l'exposé des motifs de la proposition de loi rappelle juste titre que le silence et l'hypocrisie entourent de nombreux suicides assistés accomplis dans la clandestinité.
La présente proposition de loi soulève des questions qui excèdent le cadre du droit. Notre vie nous appartient-elle vraiment ? Disposons-nous réellement de notre corps au point de pouvoir décider d'abréger notre vie lorsque la souffrance est intolérable et la mort imminente ? Ces questions, qui ressortissent à l'intime, à l'éthique et à la philosophie, devront être débattues dans cet hémicycle en responsabilité.

Notre assemblée y a déjà partiellement répondu à plusieurs reprises, notamment en adoptant la loi Kouchner en 1992, la loi Leonetti en 2005 et la loi Claeys-Leonetti en 2016. Toutes ont placé le malade au centre des décisions qui le concernent. Ainsi, un patient ne peut plus être soumis à un traitement dont il ne voudrait pas et demeure maître des décisions à son sujet. L'instauration des directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance ont pour but de garantir ce droit, indépendamment de l'état de conscience du patient.
Si je suis attachée, à titre personnel, à une évolution législative en ce qui concerne la fin de vie, il me semble toutefois essentiel de ne pas se précipiter quand il s'agit d'une question de société aussi cruciale, qui ressortit à l'essence et à la conception même de la condition humaine. Il me semble donc préférable d'attendre les conclusions du rapport d'étape sur la loi Claeys-Leonetti commandé par Mme la ministre de la santé à l'inspection générale des affaires sociales et celles du rapport sur la fin de vie élaboré par le Conseil économique, social et environnemental, dont la publication est prévue au mois d'avril 2018. Il me semble également primordial d'attendre les conclusions des états généraux de la bioéthique, tout juste engagés, qui ouvrent dans chaque région une période de débat public rassemblant experts et citoyens.
Les résultats attendus de cette concertation inédite devront éclairer cette assemblée lors de la révision de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique qui s'ensuivra. Le sujet crucial de la fin de vie y sera bien entendu abordé.
Nonobstant ce débat de société, il est essentiel de veiller à l'application pleine et entière du cadre actuel de la loi, qui permet déjà à chacun d'exprimer ses dernières volontés. Il importe que le dispositif existant soit pleinement utilisé. D'ailleurs, le comité national de suivi pour le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie travaille à l'application de la loi sur le territoire. La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie est encore récente. Sans doute faut-il encore un peu de temps pour que les professionnels de santé l'intègrent dans leurs pratiques et que nos concitoyens connaissent tous leurs nouveaux droits.
En outre, il ne faut pas éluder la notion d'accompagnement dans les derniers moments de la vie, afin que tout soit fait pour soulager au mieux la souffrance physique et psychologique des patients. Quant aux soins palliatifs, indissociables de la fin de vie, ils doivent nous mobiliser. Là réside tout l'enjeu du plan gouvernemental. Les moyens qui leur sont alloués doivent être à la hauteur des souffrances qu'il faut soulager et de la dignité qu'il faut préserver.
Comme vous, chers collègues du groupe La France insoumise, nous sommes mobilisés sur ces sujets. Nous pensons que la loi peut évoluer afin de permettre à ceux qui sentent que leur mort est imminente de choisir, notamment leur façon de mourir, sans souffrir et dans la dignité. Il y va de la liberté de tout un chacun de disposer de son propre corps, tout en garantissant une décision du patient éclairée et encadrée et en préservant la liberté de conscience du personnel médical.
Mes chers collègues, le sujet est suffisamment grave pour mériter une réflexion plus longue et plus approfondie, dans le cadre d'un débat à la hauteur de l'enjeu, un débat qui ne peut se tenir maintenant et dans un format si réduit. Non, monsieur Corbière, nous n'avons pas peur de regarder la mort en face. Acceptez simplement que certaines décisions méritent le temps de la réflexion, de l'analyse et de la discussion. Il faut faire en sorte que citoyens, patients et médecins soient entendus et respectés.
Soyez certains, chers collègues, que nous serons présents, une fois ce temps écoulé, pour débattre avec vous, ici même, des évolutions législatives nécessaires au respect d'une fin de vie digne, portant sur la mort ce regard tranquille cher à Jaurès. Pour ces raisons, j'appelle au renvoi en commission de la proposition de loi.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe REM.

Je répète, après l'avoir dit en commission et dans mon propos liminaire, qu'il ne faut surtout pas opposer la loi Claeys-Leonetti et la présente proposition de loi, chacune ayant son importance. Les demandes répétées d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti émanant des bancs de la majorité – y compris ceux du groupe MODEM – me laissent perplexe. Nous avons en effet examiné ce matin six amendements, dont la plupart avaient été déposés par des membres du groupe Les Républicains. J'ai émis un avis favorable sur les six.

Ou bien vous ne lisez pas les amendements avant leur examen en commission et vous votez contre en raison de mon avis favorable, ou bien vous ne savez pas lire, chers collègues de la majorité. En effet, il y a un véritable problème : ces six amendements proposaient exactement ce que vous avez appelé de vos voeux à la tribune. Je ne comprends pas.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et GDR.

La loi Claeys-Leonetti est insuffisante. Anne Bert elle-même la qualifiait à l'automne dernier de « poudre aux yeux » pour les malades en fin de vie. En effet, elle n'est guère appliquée. La présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie a même indiqué, lors de son audition, qu'elle place les soignants dans une situation de malaise car les guides qu'elle prévoit n'ont toujours pas été publiés par la Haute Autorité de santé.
J'entends bien que le plan national pluriannuel pour le développement des soins palliatifs est en cours d'application. Il n'en demeure pas moins que j'envisage d'émettre un avis favorable sur de nombreux amendements reprenant certaines dispositions de la proposition de loi, présentée par plusieurs membres du groupe Les Républicains, visant à faire des soins palliatifs une grande cause nationale.
S'agissant de l'euthanasie arbitraire résultant de l'abandon de critères de recevabilité, je note que la loi luxembourgeoise du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide ne comporte pas le terme « incurable ». Pour autant, le nombre d'euthanasies et de suicides assistés n'a pas explosé au Luxembourg ; au contraire, il se maintient à une proportion stable et marginale de 0,2 % du nombre total de décès.
Quant à l'argument selon lequel il est nécessaire d'attendre la publication de divers rapports et les conclusions des états généraux, je constate qu'il est avancé de façon récurrente. Il faut toujours attendre ! Vous avez pourtant pris cette semaine des décisions au sujet des EHPAD, madame la ministre, par ailleurs insatisfaisantes à mes yeux, alors même que le rapport d'information à la rédaction duquel Monique Iborra et moi-même travaillons n'a pas encore été publié. Il arrive donc qu'on ne soit pas obligé d'attendre la publication des rapports.

Permettez-moi aussi, chers collègues, de ne pas généraliser l'avis de Frédéric mentionné tout à l'heure. Si vous aviez assisté à l'audition de M. Romero, cher collègue, vous sauriez que plus de la moitié des personnes admises en unité de soins palliatifs maintiennent leur demande initiale de mourir en dépit des soins qui leur sont prodigués.
Enfin, la définition d'une fin de vie digne relève de chacun. Si je vous demandais, à vous tous qui siégez sur ces bancs, de la coucher sur papier, je puis vous assurer que j'obtiendrais autant de définitions différentes qu'il se trouve de députés dans cet hémicycle, car une telle définition est personnelle. Personne ne peut définir la fin de vie digne à la place de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut accepter qu'elle signifie pour certains l'euthanasie et pour d'autres la mort naturelle.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Ce débat mérite véritablement qu'on lui prête attention. À cet égard, je suis impressionnée par la qualité des présentations que nous avons entendues ce soir. Nous avons tous conscience de l'importance du sujet, qui interdit de le traiter sous un angle idéologique.
Il se trouve que j'ai eu une longue conversation avec Mme Bert, peu de temps avant son décès. Je lui ai fait part de mon expérience professionnelle : en tant qu'hématologue, j'ai traité de nombreux patients en fin de vie. J'ai été frappée du fait que beaucoup de ces patients ne réclament plus l'euthanasie.
Dans nos débats, il faut prendre en considération la complexité du sentiment humain face à la mort.
J'ai également parlé avec Mme Bert de la loi Claeys-Leonetti, qui à mon sens répond – le rapport dont nous attendons la remise nous dira si elle est, ou pas, appliquée partout – à 95 % des demandes : celles de patients atteints de maladies incurables et en fin de vie, c'est-à-dire notamment de patients atteints de cancers en phase terminale.
La loi Claeys-Leonetti ne répond pas aux demandes de patients comme Mme Bert, atteints de maladies neurodégénératives, en l'occurrence la sclérose latérale amyotrophique. Cela représente assez peu de personnes, mais celles-ci peuvent vouloir anticiper la fin de vie telle qu'elle est appréciée par le corps médical. Il ne faut pas perdre de vue que la demande de Mme Bert était précise. Son champ était étroit, et il ne faut pas trop élargir ce débat.
En particulier, dans votre texte, madame la rapporteure, vous parlez de maladie « grave ou incurable ». La conjonction « ou » me semble ici poser problème. C'est la question du curseur : qu'est-ce qu'une maladie grave ? C'est aussi la question de la culpabilité d'une personne atteinte d'une maladie handicapante, comme de la culpabilité de sa famille.
Quand nous sommes bien portants, ma vie professionnelle me l'a montré, ces débats sont plus faciles que quand nous nous approchons de la mort. De plus amples discussions me semblent en tout cas nécessaires, et c'est la raison pour laquelle je soutiens le renvoi en commission de cette proposition de loi.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes REM et MODEM.

J'ai reçu de M. Sébastien Chenu une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 10, du règlement.
La parole est à M. Sébastien Chenu.

Monsieur le président, madame le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, après quelques mois passés à écouter dans cet hémicycle nos collègues de La France insoumise défendre « une autre vision de la société », j'ai été surpris de les voir défendre une proposition de loi destinée à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté.
Comprenez mon étonnement : alors même que je vous croyais encore attachés à l'idée que tout, dans une société, ne pouvait être contrôlé par le marché, mesuré par l'utilité sociale et trié en fonction de la rentabilité économique, je découvre cette proposition de loi. Je la respecte, mais elle bat en brèche cette vision des choses.
Qu'elle est loin, l'époque où l'idée du don et du contre-don, développée par Marcel Mauss, père de l'anthropologie française, faisait chemin ! Qu'elle est loin, l'époque où vous considériez, comme lui, que fonder une société sur l'économisme était un choix civilisationnel inacceptable ! Qu'elle est loin, l'époque où vous ne considériez pas l'homme comme un maillon de la chaîne du tout-économique, et où vous preniez en compte l'idéalisme et la spiritualité politique qui pouvaient mettre en mouvement l'humanité !
En réalité, avec cette proposition de loi, vous vous rangez à la doxa matérialiste défendue par le libéralisme politique que vous feignez pourtant de combattre, selon laquelle tout est matériel et marchand. Dites-moi, dans votre futur idéal, quelle place réservez-vous à l'homme ? Car il faut être bien naïf pour croire que c'est la liberté qui sous-tend ce texte.
Votre proposition de loi sur le suicide assisté participe d'un profond matérialisme. Dans la vision qui guide votre projet, les personnes en souffrance dans notre société, notamment les personnes les plus âgées, ne trouvant plus d'utilité sociale, ne pouvant plus produire, devraient pouvoir être écartées de la société par la mort. Cela est encore plus grave lorsque ce sentiment est imposé par la société elle-même. « Je ne connaissais que des pauvres, c'est-à-dire des gens dont la mort n'intéresse personne », écrivait Céline. Nous y sommes.

Vous accréditez ainsi ce qu'écrivait en 1981 Jacques Attali : « dès qu'il dépasse soixante-soixante-cinq ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure ». Cette idéologie se résume à une maxime : l'homme est interchangeable ; il est avant tout un facteur de production. Votre internationalisme prolétarien était déjà de l'ordre du sans-frontiérisme, vous pliez aujourd'hui philosophiquement devant un autre axiome : celui de l'attalisme, dont vous vous devenez la caution.

J'en veux pour preuve l'article 1er de votre proposition de loi, qui dispose qu'une personne souffrant physiquement ou psychiquement de manière insupportable pourrait choisir d'être euthanasiée par un médecin. Vous pliez le genou face au libéralisme le plus individualiste en permettant à chacun de mettre fin à ses jours, sans aucun droit de regard du reste de la société. Comme si cette décision ne regardait que l'individu, et non l'ensemble des femmes et des hommes qui composent le tissu social.
C'est pourtant la place de l'homme dans la société qui est en jeu : il s'agit donc là d'un choix anthropologiquement grave, qui ne peut être effectuée par chaque personne de façon uniquement individuelle, et peut-être moins encore lorsque cette personne souffre et se trouve dans un terrible état de vulnérabilité. La liberté individuelle ne peut pas être le seul principe d'une société.

Il s'agit ici de la liberté de conscience ! De toute façon, votre projet politique n'est pas républicain.

Chers collègues, je suis député du Nord et je regarde souvent la Belgique, qui nous offre parfois de tristes exemples ; c'est notamment le cas de sa politique d'euthanasie et de suicide assisté, mise en place il y maintenant plusieurs années.
Il se trouve que l'arsenal législatif que vous souhaitez voir adopté par notre assemblée est relativement similaire à celui de notre voisine. Or le bilan de cette politique est certes bon, voire excellent économiquement, mais il est éthiquement et sociétalement catastrophique.
À titre d'exemple, j'aimerais vous faire part de l'histoire de Laura, une jeune femme belge dont la vie a été racontée par Le Figaro. Laura est née dans une famille compliquée : alcool, violences, maltraitance… Elle est recueillie par sa grand-mère alors qu'elle est encore enfant. Dès cet âge, sa souffrance psychique est immense, et les médecins peinent à la soulager. Elle découvre la pratique du théâtre, qui l'apaise et lui permet d'envisager la vie d'une nouvelle manière ; malheureusement, à la suite à une rupture amoureuse, elle tombe plusieurs années plus tard en dépression. Internée dans un hôpital psychiatrique belge, sur proposition d'un médecin, elle y découvre une jeune femme elle-même dépressive qui souhaite être euthanasiée – car cela est possible en Belgique, depuis 2002. Inspirée par cet exemple, après une demande auprès d'un médecin, Laura enclenche le processus pour être elle-même euthanasiée. Aidée, elle y renoncera finalement.
Cet exemple m'a touché et me semble assez effroyable : plutôt que de soulager cette jeune fille et de lui permettre de vivre dignement, on l'encourage à aller vers le suicide.

Au lieu de l'aider à sortir de sa prison psychologique et de la guider vers sa liberté, on ferme la porte de la vie.

Votre proposition de loi ouvre une brèche profonde dans notre conception de l'homme, dans ce que peut être notre société. Vous risquez que d'autres Laura, dévastées par des vies compliquées, puissent en finir, puissent éteindre la lumière, parce qu'elles considèrent elles-mêmes que leur dépression constitue une souffrance psychique insupportable.
Je reconnais qu'il est plus facile de tuer quelqu'un que de le soigner, mais permettez-moi de ne pas choisir cette philosophie de vie.
Exclamations sur les bancs des groupes REM et FI.

En outre, l'exemple belge est révélateur du glissement progressif de la loi : on tue aujourd'hui non pas seulement des personnes incurables, mais aussi des personnes qui sont seulement mal dans leur peau ; il existe un grand nombre de dérives. Une étude belge menée par l'université libre de Bruxelles et l'université de Gand a notamment révélé que 27 % des euthanasies pratiquées en Flandre et 42 % de celles réalisées en Wallonie sont pratiquées sans aucune déclaration aux autorités. Cette même étude précise que, souvent, un second médecin n'est pas même consulté pour autoriser la pratique de l'euthanasie, quand bien même cela est normalement obligatoire selon la loi belge.
L'ouverture de ce droit à l'euthanasie et au suicide assisté ouvre une véritable boîte de Pandore. On commence par proposer le strict minimum, mais peu à peu on prend des mesures toujours plus difficiles à encadrer, avec des conséquences toujours plus importantes – et bien plus graves que les auteurs de ces propositions ne l'imaginent eux-mêmes. C'est exactement ce qui s'est produit en Belgique : alors que la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté concernait exclusivement les adultes en 2002, lors de l'adoption du texte, elle a été élargie aux enfants en 2014.
Cette politique des petits pas nous fait changer de monde ; notre équilibre est bouleversé, comme notre idée du respect des libertés individuelles. Nous allons vers un monde qui n'est plus régulé que par des contingences financières et économiques.

Gouverner, c'est prévoir ; légiférer, c'est aussi prévoir. Sachez donc ce que pourrait être un futur où vos propositions de loi seraient votées et appliquées – même si elles font appel à la réflexion de chacun et ouvrent un débat sensible et transpartisan, et au sein duquel chaque expression est respectable.
La représentation nationale a déjà adopté la loi Leonetti II qui, pourtant, ouvrait une première brèche. En effet, la sédation profonde servait non plus à soulager les patients dans la douleur, mais à donner la mort. Il s'agissait d'une euthanasie déguisée, et la loi ne prévoyait aucune clause de conscience pour les médecins. C'est cette loi qui nous amène aujourd'hui à débattre du suicide assisté.
Il faut du courage pour refuser ces dérives ; il faut des législateurs mobilisés pour défendre un message de vie, pour proclamer la dignité des personnes, quels que soient leur situation et leur âge. Je ne vois pas en quoi il est digne d'abandonner une personne en la poussant vers une demande d'euthanasie.
La dignité de l'homme, c'est avant tout s'occuper des plus faibles d'entre nous, …

… et c'est dans le même temps reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants et accepter d'être aidé par d'autres. La vie humaine a une fin ; celle-ci doit être digne. Mais comment rester humain si nous ne pouvons exercer notre humanité ?
Oui, la personne âgée en fin de vie, le malade en phase terminale ou le jeune dépressif mal dans sa peau ont bien une place dans notre société – place ô combien importante, car tous ils permettent aux autres membres de la société d'exercer pleinement leur humanité. La souffrance doit être prise en considération, et tous les moyens mis en oeuvre pour la soulager. Non, je ne considère pas qu'être une charge pour ses enfants ou la société soit indigne.

En réalité, cette initiative parlementaire est symptomatique de la réaction de notre société face aux grands enjeux qui nous assaillent. On cache les problèmes : plutôt que de soigner le patient, on préfère le tuer, voire – c'est plus grave – on préfère le pousser à demander à être tué.
Vives exclamations sur les bancs des groupes REM et FI.

Je le reconnais : pour gérer la fin de vie, l'euthanasie est plus simple et moins coûteuse. Mais promouvoir cette solution de facilité, est-ce là ce qui donne un sens à notre société ?
Mêmes mouvements.

Mes chers collègues, notre débat sur ce sujet particulièrement humain et sensible a été très digne jusqu'à maintenant. Je vous en prie, conservons la même tonalité, évitons les invectives. Respectons les avis de chacun, et écoutons l'orateur.
Applaudissements sur les bancs des groupes REM, LR, MODEM et UDI-Agir.

Je respecte les avis de tous. Respectez le mien, car je le crois respectable. Je représente une partie des Français.
Nous devons chercher des alternatives, sans doute plus compliquées à mettre en oeuvre, sans doute plus coûteuses aussi, mais surtout plus humaines. En tant que parlementaires, nous nous devons d'être ambitieux.
Il aurait fallu proposer une augmentation des crédits alloués aux soins palliatifs, c'est-à-dire à ces soins qui ont pour objet de soulager la douleur et les souffrances des personnes malades ou en fin de vie. Les médecins sont insuffisamment formés à ces soins ; les moyens sont réduits et l'accès aux unités de soins palliatifs, les USP, est très difficile.
Selon un rapport publié par le Comité consultatif national d'éthique en 2014, il existe même en France un « non-respect du droit d'accéder à des soins palliatifs pour l'immense majorité des personnes en fin de vie ». En effet, près de 80 % des personnes qui souhaiteraient en bénéficier n'auraient pas de place en USP. Non seulement les structures sont insuffisantes, mais elles sont aussi inégalement réparties sur le territoire, puisque 70 % des lits sont concentrées dans cinq régions. En matière de santé, la fracture territoriale est terrible.
Il faut aussi entendre certains spécialistes expliquer que, si l'on s'occupe correctement d'une personne en fin de vie, elle ne demande plus automatiquement l'euthanasie. Souvenons-nous d'Andromaque et de son « rire en pleurs » : la force de vie est souvent si forte.
Quant aux sondages que vous évoquez, je ne les considère pas comme sincères, puisque l'alternative qu'ils proposent est le choix entre d'atroces souffrances et l'euthanasie. Or d'autres solutions existent, même si, il est vrai, elles coûtent plus cher.
Au-delà, nous devons mieux reconnaître la détresse de toutes les personnes souffrant de troubles psychiques ou psychologiques. Nous devons surtout être capables de former plus de psychiatres – nous faisons face aujourd'hui à une pénurie. Or les médecins généralistes sont de bonne volonté, mais ils ne sont pas formés à prendre en charge ces souffrances-là.
Il nous faut encore augmenter les moyens des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont tout à fait insuffisants. Je vous le dis franchement : deux jours après la grève des personnels des EHPAD dénonçant un manque de moyens, proposer un tel texte me semble d'un parfait mauvais goût. Même le député plus libéral de la droite de cet hémicycle n'aurait osé !
Il existe aujourd'hui des solutions pour accompagner vers la mort les personnes en fin de vie. On sait aujourd'hui soulager techniquement la douleur, mais il est surtout primordial de changer les mentalités, de changer les regards sur nos aînés ou nos malades. Non seulement la vie est dure, mais de surcroît elle est courte.
Il est urgent – et, pour en revenir à mes propos du début, je m'étonne que ce soient nos collègues de La France insoumise qui proposent ce texte – d'abandonner cette vision utilitariste de l'homme.
Mes chers collègues, je vous propose de voter cette motion de rejet préalable car ce texte est non seulement inopportun mais probablement dangereux pour notre société, pour la vision de l'homme qu'il défend.
Nous ne devons pas faire l'économie de toutes les solutions d'accompagnement que j'ai évoquées. Oui, il y a des choses à faire pour aider les plus fragiles d'entre nous à franchir le plus paisiblement possible l'étape de la mort. L'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des solutions, sauf si votre vision de la société se résume à des contingences économiques.
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse », disait Albert Camus. Pour que le monde des hommes ne se défasse pas au profit du monde du fric, je vous propose de voter cette motion de rejet préalable.

Je serai brève car M. Chenu n'a manifestement pas lu mon rapport. J'y déplore, comme le professeur Didier Sicard, une « évolution des représentations sociales conduisant à ce qu'une vie ne soit considérée comme valable que lorsqu'elle est "utile", quand la personne fait, agit, produit, voire est rentable ». À la page 19, il est écrit : « La rapporteure tient à ce que nos regards se portent davantage sur la fin de vie pour que cesse le désintérêt croissant à l'égard des personnes qui en sont rendues au stade ultime de leur existence. Elle tient à ce que leurs choix soient entendus et pris en compte. »
Pour le reste, je n'ai aucune leçon d'humanisme à recevoir, surtout venant de vous.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Sur la motion de rejet préalable, je suis saisi par le groupe La France insoumise d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Dans les explications de vote sur cette motion, la parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour le groupe La France insoumise.

Je remercie tous les collègues qui ont accepté d'assez bonne grâce – je crois – l'idée que, dans ce débat, les lignes de fracture ne correspondent pas aux groupes politiques.
Je félicite ma collègue Caroline Fiat d'avoir permis que le débat se tienne dans ces termes, de manière réaliste et mesurée. Nous ne pouvons qu'opposer nos pauvres raisonnements à l'énigme absolue et constante de l'identité humaine, qui veut qu'un jour la vie s'arrête. En réponse à cette détermination, se présentent tous les principes philosophiques dont nous nous réclamons les uns et les autres.
Je regrette que l'auteur de la motion de rejet préalable se soit senti obligé de faire une telle caricature. Ceux qui parlent d'euthanasie ou de suicide assisté n'ont naturellement jamais souhaité imposer une telle option à qui que ce soit.
Au demeurant, la liberté individuelle s'est toujours présentée comme un refus de la nature. Pour refuser aux femmes le droit de disposer de leur corps, on arguait soit de la nature soit de ce que leurs enfants appartenaient aussi à leur époux ou à leur famille, jusqu'à ce que s'impose l'idée qu'elles s'appartenaient à elles-mêmes.
Pour s'appartenir, il faut que le principe d'individuation puisse valoir jusqu'au bout. Nous prétendons non pas imposer nos principes mais ouvrir la liberté à ceux qui se réclament du principe de la libre disposition de soi devant ce que les stoïciens appelaient les événements contre lesquels on ne peut rien.
La dignité humaine signifie, lorsque vous ne pouvez plus rien contre quelque chose, que vous restez libre parce que vous pouvez y mettre un terme par votre mort. Oui, nous réclamons le droit au suicide assisté et à l'euthanasie.
Je conclurai en faisant référence à Spinoza. La pensée, ce sera toujours plus que le corps pensant, mais ce ne sera jamais sans le corps pensant. Quand le corps ne peut plus penser autrement que dans la douleur, c'est lui qui vous domine et non plus vous qui le dominez.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

La parole est à M. Pierre Dharréville, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

L'exercice auquel nous venons hélas d'assister recourait beaucoup à la confusion et aux amalgames, parfois surprenants et pas toujours intelligibles pour moi.
Évidemment, nous ne nous joindrons pas à la motion de rejet car nous pensons que le débat que nous avons commencé ce soir est nécessaire. Ce débat a lieu dans la société. Nous devons lui donner un prolongement ici et prendre les meilleures décisions, éclairées, instruites et argumentées pour faire face au questionnement qui traverse notre peuple.
Je salue la tenue de cette discussion qui appelle, selon moi, des développements.
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et FI.

La parole est à M. Jean-Louis Touraine, pour le groupe La République en marche.

Nous ne sommes pas favorables à cette motion de rejet. Il nous apparaît en effet souhaitable que cette question soit reprise et analysée dans cet hémicycle à l'issue de la concertation qui est organisée. Nous proposons donc un renvoi en commission et non un rejet préalable de ce texte. Le renvoi en commission nous permettrait dans le futur, une fois enrichis par la réflexion citoyenne, d'analyser les points de vue et les différentes propositions de loi qui ont été déposées sur le même thème afin de déterminer où placer le curseur.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe REM.

La parole est à M. Brahim Hammouche, pour le groupe du Mouvement démocrate et apparentés.

Le groupe MODEM votera contre cette motion de rejet préalable. Il s'agit, en effet, de tenter de répondre – et les débats ont été à la hauteur – à la question si intime et personnelle de la mort. L'extraordinaire complexité de la fin de vie exige d'adopter une attitude profondément humble et de faire preuve de prudence.
Pour légiférer sur ce sujet, il faut avoir en tête cette maxime de Montaigne : « Si nous avons besoin de sage femme à nous mettre au monde, nous avons bien besoin d'un homme encore plus sage à nous en sortir. » La loi Leonetti du 22 avril 2005 puis, plus récemment, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 ont tenté de répondre aux questions essentielles posées par la fin de vie. Elles ont été adoptées de manière consensuelle. Cependant, 89 % des Français aspirent aujourd'hui à voir le dispositif législatif actuel complété.
Le groupe MODEM est convaincu que ce débat si important doit avoir lieu. Nous y prendrons toute notre part. Nous sommes également persuadés que nous devons prendre le temps d'écouter les soignants mais aussi nos concitoyens, tous nos concitoyens, quelles que soient leurs croyances religieuses ou philosophiques. Le débat ne doit pas être confisqué.
C'est pourquoi nous souhaitons qu'une véritable concertation ait lieu. Il s'agit non pas de demander le retrait définitif de la proposition de loi du groupe La France insoumise mais de s'entendre sur son report afin de débattre sur ce sujet majeur dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Le groupe MODEM votera donc contre cette motion de rejet préalable.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe REM.

La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo, pour le groupe UDI, Agir et indépendants.

Je voterai contre cette motion de rejet préalable par principe, parce que le Parlement est et doit rester le lieu privilégié du débat démocratique.
Sur le fond, si je suis en désaccord avec certaines dispositions de ce texte, je salue la démarche : il a le mérite de soulever des enjeux essentiels dont nous avons encore besoin de débattre, dans un climat aussi serein et apaisé que celui de ce soir.

Le groupe Nouvelle Gauche ne votera pas cette motion de rejet préalable.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 57 |
| Nombre de suffrages exprimés | 57 |
| Majorité absolue | 29 |
| Pour l'adoption | 5 |
| contre | 52 |
La motion de rejet préalable n'est pas adoptée.

J'ai reçu de M. Richard Ferrand et des membres du groupe La République en marche une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 10, du règlement.
La parole est à M. Jean-Louis Touraine.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, le constat, les arguments et les diverses propositions ont été énoncés.
Effectivement, on ne peut se satisfaire du « mal mourir » en France. Effectivement, les soins palliatifs et les autres accompagnements à la mort doivent être développés. Faut-il en rester là ? Non. D'ailleurs, seulement 11 % des Français se satisfont de la législation actuelle, d'après le sondage IFOP paru dans La Croix. Ce sont 2 000 à 4 000 Français qui, chaque année, reçoivent une aide active à mourir dans nos hôpitaux, en toute illégalité, sans transparence aucune et sans que l'on sache combien d'entre eux ont donné leur accord. C'est encore un nombre important de nos concitoyens qui vont solliciter le soulagement ultime, la délivrance, dans l'un ou l'autre des pays voisins de la France, pays qui nous ont précédés dans cette avancée législative.
Des personnes, des médecins sont, aujourd'hui encore, réticents à l'euthanasie et au suicide assisté.

Leur conviction doit être respectée. Aucun d'entre eux ne sera associé à ces pratiques nouvelles.

La clause de conscience les libère de toute obligation. Peuvent-ils pour autant interdire durablement à la majorité des Français d'accéder au libre choix ? N'ont-ils pas la même obligation éthique de respecter le libre choix des autres ?
Sur ce sujet de l'accès à l'euthanasie, mes chers collègues, nous ne sommes pas totalement unanimes. Dès lors, proposons de faire coexister les principales possibilités dans un cadre rigoureux et laissons chaque Français choisir son destin.
Quelle brutalité, quelle humiliation est imposée à un malade lorsqu'on refuse d'entendre ses implorations, lorsqu'on lui fait comprendre que sa liberté lui a été retirée à l'entrée de l'hôpital !
La société française de 1975 a enfin entendu la nécessité de laisser aux femmes la libre disposition de leur corps. L'interruption volontaire de grossesse a été légalisée et nous sommes sortis de l'hypocrisie caractérisée par une pratique répandue mais une prohibition affichée. Tous n'étaient pas d'accord avec cette évolution, mais le respect mutuel entre les partisans et les adversaires s'est instauré.
Pour la fin de vie, la sortie de l'hypocrisie est encore plus attendue, l'affrontement entre les partisans et les opposants est moins violent, le caractère inéluctable du droit au choix est perçu même par ceux qui ne veulent pas y recourir.
Nous pouvons donc être confiants dans une avancée prochaine, laquelle rendra hommage à tous les militants de cette cause humaniste, connus ou anonymes, isolés ou réunis en association – comme l'ADMD – , religieux ou athées, cherchant une issue en France ou à l'étranger – Vincent Humbert, Chantal Sébire, Marie Deroubaix, Anne Bert et beaucoup d'autres.
Faut-il légiférer ce soir ? Vous avez été nombreux à répondre non à cette question. Que vous soyez ou non favorables à l'aide active à mourir, vous avez remarqué l'immense élan, la forte mobilisation, l'appétit de nos concitoyens pour débattre de ces sujets.
À l'heure où nos concitoyens se pressent dans les espaces de réflexion éthique régionaux pour participer à une concertation d'une ampleur inégalée à l'invitation du Comité consultatif national d'éthique ; à l'heure où des auditions multiples et approfondies sont organisées par le Conseil économique, social et environnemental, par les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et par divers organismes ; à l'heure où une évaluation précise est conduite par l'inspection générale des affaires sociales, et où des pétitions et concertations citoyennes sont organisées, se pourrait-il que nous assénions une gifle insultante à tous, méprisant leur travail et prétendant avec arrogance que, sur une question de société, nous pèserions plus que des millions de Français ? Non, nous avons le devoir d'écouter les réflexions, les interrogations, et les aspirations des Français.
Nous savons que nos concitoyens désirent une fin de vie paisible, sans douleur, si possible à domicile et surtout entourée de leurs proches. Beaucoup veulent aussi décider, le moment venu, les modalités de leur mort, mais où le curseur doit-il être placé ? Lorsque l'on est en fin véritable de vie, dans une totale impasse thérapeutique, comme je le crois ? Ou, potentiellement, dans une phase plus précoce, dès qu'une maladie grave s'est déclarée, comme vous le suggérez, madame la rapporteure ?
Les cancers, je l'ai dit tout à l'heure, sont des maladies graves, mais dont la moitié sont susceptibles de guérir. J'ajoute que, si votre proposition s'était appliquée, par exemple, aux malades souffrant d'un sida avéré en 1994 ou 1995, certains d'entre eux auraient mis un terme à leur vie, alors que beaucoup sont aujourd'hui bien vivants, grâce à l'apparition de la trithérapie dès le début de l'année 1996.
Comme vous, madame la rapporteure, je suis impatient de légiférer sur ces questions, mais leur importance ne permet aucune erreur, aucun amateurisme : des vies ou des modalités de mort pacifiée sont en cause. Nous ne pouvons pas improviser. Prenons le temps – quelques mois tout au plus – d'entendre l'ensemble de nos concitoyens.
J'ajoute qu'une raison supplémentaire plaide pour un minime délai : aujourd'hui, quelques réticences ou inerties existent encore parmi les professionnels de santé. Or leur rôle dans le dispositif est important, même si la décision devra incomber au malade. Un peu de temps de préparation psychologique, à la faveur des débats de ces mois-ci, permettra une meilleure appropriation des mesures que nous choisirons.

Le renvoi de votre texte en commission, madame la rapporteure, n'est nullement un désaveu : c'est une incitation à une réflexion conjointe avec les différents groupes de Français, à la recherche d'une solution apaisée, sans affrontement polémique, à une amélioration des mesures offertes au choix. Ce n'est pas un refus, mais un minime délai, le temps de recueillir l'expression des Français. La loi qui en résultera sera d'autant meilleure et mieux comprise qu'elle procédera d'un tel effort collectif. Notre pays pourra alors proposer un texte tenant compte des diverses expériences étrangères et de l'avis, riche et divers, du peuple français.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes REM et MODEM.

En application de l'article 50, alinéa 4, du règlement, qui prévoit que la dernière séance de la journée doit être levée à une heure du matin, je vais lever la séance.
Exclamations sur les bancs des groupes FI et NG.

Il appartiendra à la Conférence des présidents de fixer les conditions de la poursuite de la discussion de la présente proposition de loi.
Je vous remercie, mes chers collègues, pour la qualité de ce débat.

Prochaine séance, mardi 6 février, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi no 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Discussion du projet de loi relatif à la protection des données personnelles.
La séance est levée.
La séance est levée, le vendredi 2 février, à une heure.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l'Assemblée nationale
Catherine Joly