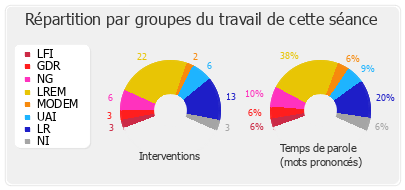Séance en hémicycle du mardi 17 avril 2018 à 9h30
Sommaire
- Questions orales sans débat (voir le dossier)
- Intégration du centre de grosbois dans les jeux olympiques et paralympiques de 2024 (voir le dossier)
- Parcours emploi compétences et accompagnement des enfants en situation de handicap (voir le dossier)
- Proclamation d'un député
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

La parole est à M. Laurent Saint-Martin, pour exposer sa question, no 271, relative à l'intégration du centre de Grosbois dans les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Madame la ministre des sports, la France aura l'honneur d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La force du dossier de candidature de Paris était que, selon les estimations, 95 % des infrastructures nécessaires existent déjà. C'est un cas de figure exceptionnel, car les événements internationaux de cette envergure s'accompagnent généralement de dépenses publiques considérables pour construire les infrastructures nécessaires. Les coûts de construction des infrastructures restantes pour Paris sont tout de même estimés à environ 6,6 milliards d'euros. En comparaison, Londres 2012 et Rio 2016 ont coûté quasiment le double. Une des principales raisons à ce budget contenu est que de nombreux équipements, comme le Stade de France, le Palais omnisports de Bercy, le stade Roland Garros, le Zénith et la U Arena existent déjà.
Aujourd'hui, il est prévu que les épreuves équestres – dressage, concours hippique, concours complet, para-dressage et épreuve du pentathlon moderne – aient lieu à Versailles, et je m'en félicite. L'Île-de-France dispose d'installations équestres de renommée internationale pouvant être mobilisées à l'occasion des Jeux olympiques et paralympique de 2024 pour l'accueil et l'entraînement des cavaliers et de leurs chevaux.
Madame la ministre, je suis élu de la troisième circonscription du Val-de-Marne, qui comprend le centre d'entraînement de Grosbois. Comptez-vous intégrer ce centre, fleuron du trot, situé aux portes de Paris, dans le dispositif équestre de ces Jeux olympiques ?
Monsieur le député, je tiens tout d'abord à vous assurer de mon souhait que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 profite à tous les territoires. Nos jeux doivent être ceux de toutes les Françaises et tous les Français : c'est une priorité du Gouvernement.
Concernant les sites d'entraînement que vous avez évoqués, il convient de distinguer les cinquante et un sites d'entraînement officiels d'une part, identifiés par le comité Paris 2024 dès la phase de candidature et ouverts aux athlètes douze jours avant le début des jeux, et d'autre part les camps d'entraînement préolympiques et paralympiques, dénommés « base avancée ». Ces derniers seront sélectionnés par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques – COJO – dans le cadre d'une procédure associant les services déconcentrés de l'État, qui veilleront évidemment à assurer un maillage territorial équilibré et à la bonne représentation des territoires. Ces sites seront, par la suite, proposés à des délégations étrangères, dès 2020.
Pour ce faire, un appel à projet sera lancé par le COJO via une plateforme dématérialisée, à l'automne 2018, afin de recenser l'ensemble des offres destinées aux territoires, dans le cadre d'une approche globale, après labellisation des sites par le COJO. Ce catalogue des sites sera diffusé auprès des comités nationaux olympiques étrangers et des fédérations sportives du monde entier, en 2020.
Dès la fin des jeux de Tokyo de 2020, la France deviendra alors un immense centre d'entraînement et de préparation, une base avancée pour tous les sportifs du monde. Je vous confirme que l'ensemble des collectivités territoriales seront sollicitées, pour que chaque territoire puisse présenter des sites dans le cadre de la labellisation et fasse valoir ses meilleurs atouts en matière d'équipements sportifs ou de lieux d'accueil nécessaires à l'acclimatation des olympiens et paralympiens.
Comme vous le souligniez, les compétitions olympiques et paralympiques d'équitation se dérouleront dans le parc du château de Versailles. Le centre d'entraînement de Grosbois, s'il est sélectionné par le COJO, pourra néanmoins faire valoir tous ses atouts, afin d'être retenu comme site de préparation pouvant être proposé aux fédérations d'équitation du monde entier.

La parole est à M. Pierre Henriet, pour exposer sa question, no 279, relative à la structure d'insertion Atout-Linge.

Madame la ministre du travail, ma question porte sur les difficultés financières d'Atout-Linge. Cet acteur en insertion économique, spécialisé dans la blanchisserie et la confection, accueille des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu de solidarité active – RSA – et des personnes handicapées, dans le bassin sud vendéen.
Depuis le 1er janvier 2017, la convention signée avec l'administration décentralisée et le conseil départemental comporte une restriction qui lie le versement du montant de l'aide à la nature du public accueilli, demandeurs d'emploi de longue durée – DELD – ou bénéficiaires du RSA. Cette structure n'est pas la seule en France ni en Vendée à ne pas avoir été informée d'une application restrictive des conventions, qui entraîne une baisse drastique de ses ressources. En outre, cette baisse intervient après l'application, à partir du 1er janvier 2015, de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui a réduit les fonds consacrés aux structures d'insertion par l'activité économique en raison du double statut du public considéré : salariés en insertion et demandeurs d'emploi.
La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a été saisie des risques qui pèsent sur la survie de ces structures : partout en France, elles commencent l'année avec un déficit en trésorerie important. Quand bien même la question de la trésorerie serait ponctuellement résolue, le choix reste cornélien : pour obtenir le maximum d'aides, contribuant au financement des charges fixes, elles doivent se limiter à accueillir un public susceptible de leur assurer le montant maximum octroyé par la convention tripartite, ce qui exclut principalement les demandeurs d'emploi de longue durée, qui devraient pourtant être les premiers bénéficiaires.
Je vous demande, madame la ministre, d'apporter une réponse urgente aux problèmes de trésorerie de ces structures, et une réponse sur le long terme, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle.
Monsieur le député, nous nous rejoignons sur l'importance de l'insertion par l'activité économique – IAE. Si, et c'est ma conviction, nul n'est inemployable, les personnes les plus en difficultés, les plus éloignées du marché du travail ont néanmoins besoin d'un marchepied, d'une étape avant de suivre une formation qualifiante ou d'occuper un emploi. L'insertion par l'activité économique permet à des demandeurs d'emploi de longue durée, à des bénéficiaires du RSA, à des personnes qui ont des difficultés professionnelles et sociales souvent multiples d'avoir une première expérience professionnelle ou de redécouvrir la vie professionnelle, avant de s'inscrire dans un parcours vers l'emploi de type ordinaire.
Dans ce contexte, le Gouvernement a choisi de consolider, dès 2018, les crédits dédiés à l'insertion par l'activité économique, qui avaient subi, dans le passé, des fluctuations à la baisse. Je m'engage à les maintenir. Ce sont ainsi 840 millions d'euros de crédits qui ont été ouverts en loi de finances pour 2018 afin de développer davantage le secteur de l'insertion par l'activité économique. Pour la première fois, en 2018, nous avons globalisé ces crédits avec ceux dévolus aux parcours emploi compétences au sein du fonds d'inclusion dans l'emploi. Ce fonds, doté de l, 4 milliards d'euros, donne aux préfets de région de nouvelles marges de manoeuvre pour adapter les moyens aux problématiques territoriales, qui ne sont pas toutes les mêmes. Il faut pouvoir évaluer la pertinence des éléments de soutien en fonction des structures et des territoires. Cette approche plus fongible et plus déconcentrée permettra aussi de mieux prendre en compte les situations des différents chantiers ou entreprises d'insertion par l'activité économique.
Oui, l'IAE est essentielle pour l'inclusion dans l'emploi. Vous avez raison, le ciblage des publics est fondamental. Vous m'avez alertée sur les difficultés d'une structure, qui seraient liées à des règles de cofinancement. Les conseils départementaux, qui sont cofinanceurs, définissent parfois des critères qui s'ajoutent à ceux établis au niveau national, et qui sont plus restrictifs. Pour autant, il est intéressant d'analyser le problème avec eux, car les situations des personnes en difficultés, notamment les bénéficiaires du RSA, diffèrent d'un département à l'autre. On peut comprendre que les conseils départementaux veuillent « surcibler » le dispositif, s'ils sont confrontés à des personnes particulièrement éloignées de l'emploi.
Néanmoins, j'ai demandé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi – DIRECCTE – d'être particulièrement attentive à cette situation particulière et de trouver avec le conseil départemental un accord sur le ciblage. Nous convenons tous qu'il faut cibler les personnes les plus en difficultés, mais encore faut-il adapter le dispositif au terrain.
Je le répète, l'IAE constitue une réponse pertinente, car elle met en situation de travail et apporte un accompagnement social et professionnel très important : la plupart des bénéficiaires de l'insertion par l'activité économique ont aussi des problèmes de santé ou de logement, qu'on appelle des problèmes périphériques mais qui sont centraux dans la vie des gens, et qui contribuent à les mettre en échec. Il est donc important que tout soit pris en compte.
En revanche, l'accès à la formation demeure encore insuffisant, pour les raisons que vous avez évoquées. C'est pourquoi j'ai souhaité que l'IAE soit identifiée comme un secteur prioritaire du plan d'investissement dans les compétences. Une enveloppe de 20 millions d'euros sera réservée en 2018 à l'accompagnement des structures d'insertion par l'activité économique en matière de formation.

Je vous remercie, madame la ministre, pour votre réponse. La formation professionnelle, bientôt réformée, devra renforcer les dispositifs de l'insertion par l'activité économique, en révisant notamment ce cadre conventionnel.

La parole est à Mme Isabelle Valentin, pour exposer sa question, no 281, relative à la réforme de l'apprentissage.

Madame la ministre du travail, vous avez annoncé, le 16 novembre dernier, la tenue d'une concertation sur la réforme de l'apprentissage. Alors que près de 20 % des jeunes de 15 à 24 ans sont demandeurs d'emploi, il y aurait 300 000 postes non pourvus sur le marché du travail, ce qui est consternant. Un lycéen sur trois est aujourd'hui scolarisé dans la voie professionnelle scolaire, soit 700 000 élèves. Cette voie, c'est celle de l'excellence, et nous nous devons de la développer. Aujourd'hui, l'alternance constitue un atout majeur pour former des jeunes qualifiés, qui seront, demain, les piliers de nos entreprises.
Si nous partageons le constat que les entreprises méritent d'être beaucoup plus consultées et au coeur des politiques d'apprentissage, l'orientation de cette réforme nous semble contraire à l'intérêt même des apprentis. Cette réforme, c'est une recentralisation de l'une des premières politiques décentralisées ; c'est simplement la privatisation de l'apprentissage, confié aux branches professionnelles. Le financement au contrat présente un risque majeur, particulièrement en matière d'aménagement du territoire, puisqu'il ne tient pas comptes des disparités locales. Ce nouveau dispositif engendre une grande complexité, puisque près de 700 branches se substitueront à l'interlocuteur unique qu'était la région. Seules les formations suivies par un nombre important d'apprentis seront pérennes.
Dans le même sens, la gouvernance proposée est éloignée des réalités des territoires et des entreprises, alors que la région est la mieux placée pour adapter l'offre de formations professionnelles aux besoins des entreprises du territoire. Pour les régions, la réforme de l'orientation est aussi la clé principale pour réussir à revaloriser et développer l'apprentissage en France. C'est aussi une attente forte des jeunes et des familles. La faiblesse actuelle du système a été unanimement dénoncée par les Français.
Madame la ministre, quel financement prévoyez-vous pour les écoles de production, les centres de formation d'apprentis – CFA – , les transports, la restauration et l'hébergement des apprentis, et l'acquisition de leur premier matériel ? Comment envisagez-vous la mutualisation des plateaux techniques entre lycées professionnels et CFA ?
Madame la députée, nous sommes d'accord sur le premier des deux points que vous avez abordés : l'importance de développer massivement l'apprentissage, alors qu'1,3 millions de jeunes, en France, ne se projettent pas dans l'avenir, n'ayant ni emploi ni formation. Dans quelques semaines, j'aurai le plaisir et l'honneur de présenter le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous aurons beaucoup de temps pour discuter de ces sujets, et j'espère pouvoir vous convaincre.
En la matière, il existe beaucoup de freins : orientation, code du travail, rigidité de la formation… Je n'entrerai pas dans tous les détails de la réforme. Un de ces freins donc, aujourd'hui, est bien le financement. Aujourd'hui en effet, tout l'argent de l'apprentissage ne va pas à l'apprentissage. Ainsi, sur les 235 millions d'euros transférés en 2016 par l'État à la région Auvergne-Rhône-Alpes, que vous connaissez bien, la région n'en a dépensé que 195 millions. La situation est similaire dans d'autres régions.
Le financement actuel ne permet pas, donc, que tout l'argent de l'apprentissage lui soit dévolu. Afin d'y remédier, il faut bâtir quelque chose de plus simple, garantissant surtout qu'à chaque fois qu'un jeune signe un contrat d'apprentissage avec une entreprise, le financement de la formation soit assuré. Tel est l'objet de la réforme.
Nous voulons donc passer d'un système de financement à la subvention d'équilibre à un financement au coût du contrat afin de permettre aux centres de formation d'apprentis de se développer sans entraves et d'être encouragés à aller chercher des jeunes et des entreprises. Ils seront en effet certains de bénéficier d'un financement supplémentaire pour chaque jeune alors qu'aujourd'hui, quel que soit le nombre de jeunes, la subvention ne peut pas augmenter.
Vous l'avez dit : il convient également de traiter les questions de l'investissement et de l'aménagement du territoire.
En matière d'investissement, ce sont les régions qui sont compétentes et elles le resteront dans le projet de loi que je défendrai. Aujourd'hui, près de 200 millions proviennent de la TICPE – taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Ils seront maintenus dans le nouveau système. Ce sont les régions qui sont compétentes, aussi bien en ce qui concerne les lycées professionnels que les CFA. C'est une bonne chose, vous l'avez souligné, car cela permet de créer des campus, des plateaux techniques communs, afin de favoriser la mutualisation et donc de bien user de l'argent public. En outre, cela rapproche les CFA des lycées, ce qui est une bonne chose puisque nous voulons aussi créer des passerelles entre le statut scolaire et celui d'apprentissage. De ce point de vue-là, il n'y aura pas de changement. Le financement de l'hébergement, la restauration des apprentis ne changeront pas.
En revanche, et c'est une nouveauté, une dotation de 250 millions sera transférée de l'État aux régions afin que, en plus du coût au contrat garantissant l'essentiel pour tous les CFA, 20 % de financements supplémentaires soient attribués à des CFA, notamment en zones rurales ou en quartier prioritaire de la ville, qui auraient des besoins complémentaires, et cela en tenant compte de l'importance de l'équilibre en matière d'aménagement du territoire. Nous sommes en effet d'accord sur un point : il importe de disposer d'une offre de proximité partout sur le territoire.
Au total, il y aura plus d'argent pour l'apprentissage, le financement sera plus fluide, plus direct pour les CFA. Je compte sur les régions pour poursuivre leurs efforts d'investissements structurants. Il n'y a ni centralisation – l'État ne récupère aucune compétence – ni privatisation : l'apprentissage relève des pouvoirs publics, notamment des régions, mais aussi des entreprises s'agissant du contrat.

Il est vrai que la mobilité de nos apprentis est l'un des freins principaux. Nous tenons donc à ce qu'il y ait des CFA un peu partout. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons mis beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que nous recevons…

… à la fois dans l'investissement et le fonctionnement. Nous en rediscuterons lors des débats, puisque je dispose des chiffres.

Merci. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Je rappelle simplement, madame la ministre, que le délai global de six minutes intègre une éventuelle réponse du parlementaire au ministre.

La parole est à M. Benoit Potterie, pour exposer sa question, no 278, relative au financement des projets du Fonds social européen.

Madame la ministre, je tiens à vous alerter sur la lenteur et la complexité de l'accès aux financements européens pour les entreprises et les associations, sujet qui préoccupe de nombreuses structures de ma circonscription. Je pense en particulier au Fonds social européen – FSE.
Le FSE finance des projets dans le but de réduire les écarts de développement entre les régions de l'Union européenne. C'est un beau projet, mais la lenteur et la complexité des démarches entravent son efficacité. J'en ai récemment parlé avec les responsables du plan local pour l'insertion et l'emploi – PLIE – de l'Audomarois.
Les PLIE sont des éléments incontournables de la politique de l'emploi. Ils proposent un accompagnement personnalisé au service des personnes qui en sont les plus éloignées et leur apport est important pour les publics les plus fragiles.
Le PLIE audomarois dépend fortement des fonds européens puisque 60 % de ses subventions proviennent du FSE, mais les procédures d'instruction sont très complexes et de nombreux dossiers sont refusés pour de simples erreurs de forme. Par ailleurs, les délais de versement des fonds peuvent être très longs. En ce qui concerne le PLIE audomarois, le délai minimum est de 24 mois après les premières dépenses engagées !
Dans ces conditions, les structures qui font appel au FSE sont parfois obligées de recourir à des cessions de créance avec les banques, ce qui génère d'importantes charges financières pour elles. Certaines structures s'en trouvent d'ailleurs menacées de redressement.
Je salue l'engagement du gouvernement français en faveur de la modernisation des institutions européennes. Beaucoup a déjà été fait, et je mesure les difficultés auxquelles il est confronté. Connaissant votre engagement, madame la ministre, je souhaite donc vous alerter sur cette situation, et vous demander si cette question est à l'ordre du jour de vos discussions avec vos homologues européens.
Le FSE, créé en 1957 par le Traité de Rome, représente quelque chose d'important en France puisque 6 milliards d'euros de crédits en proviennent pour la période 2014-2020. Cela étant, vous avez raison, il faut simplifier ses modalités d'action. Il s'agit là d'une priorité partagée à la fois par la Commission européenne et le gouvernement français, en particulier dans le cadre de la préparation de l'avenir des fonds européens structurels et d'investissement. Le FSE illustre très bien l'apport de l'Europe à la France mais s'il nous faut « plus d'Europe », il nous faut surtout « mieux d'Europe », ce qui implique des procédures beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides, vous l'avez dit.
La gestion du FSE passe aussi souvent par des intermédiaires. Le Plan local pour l'insertion et l'emploi dans l'Audomarois est porté juridiquement par l'association PLIE de l'Audomarois et fait ainsi partie d'un des six PLIE membres de l'organisme intermédiaire OCAPLIE. La subvention globale est accordée à ce dernier qui, ensuite, la redistribue aux PLIE.
Le PLIE de l'Audomarois connaît des difficultés financières mais aussi institutionnelles depuis 2017. Elles proviennent à la fois des collectivités territoriales, dont les engagements doivent venir en contrepartie du FSE, et des rythmes de gestion, souvent lents, du FSE lui-même. De nombreux échanges ont eu lieu, mais une telle situation ne dépend pas directement des services du ministère puisque c'est OCAPLIE qui reçoit l'argent. Nous ne pouvons donc pas intervenir directement, mais nous avons pris en compte les difficultés éventuelles de trésorerie que ces dysfonctionnements ou ces lenteurs peuvent susciter. Au niveau régional, mon ministère a accordé une avance de trésorerie pour pallier d'éventuelles difficultés pendant la période 2018-2020, le temps que nous contribuions à réformer le FSE.
S'agissant des montants attendus en remboursement d'appel de fonds, les services du ministère ont d'ores et déjà procédé à titre exceptionnel au remboursement de ces dépenses avant le paiement par la Commission des crédits FSE correspondants. Nous veillerons et travaillerons à ce que les choses soient plus simples à l'avenir et qu'il ne soit plus nécessaire de procéder à des avances de trésorerie.

La parole est à Mme Huguette Bello, pour exposer sa question, no 266, relative au recyclage des véhicules hors d'usage à La Réunion.

Alors que la dengue est en phase épidémique à La Réunion et que l'élimination des gîtes larvaires devient impérative, la question du traitement des véhicules hors d'usage se pose avec une acuité renouvelée. Ces épaves sont en effet propices au développement des larves de moustiques, vecteurs de la dengue et, on s'en souvient, du chikungunya.
Depuis la transposition dans le droit français de la directive européenne en 2011, l'exportation et les opérations de gestion des véhicules hors d'usage ne peuvent pas être réalisées en dehors de l'Union européenne. Cette législation est néanmoins vite apparue comme inadaptée aux régions d'outre-mer en raison de l'absence d'outils de broyage adaptés et, bien sûr, de l'éloignement géographique.
C'est ainsi, que dès 2011, la Direction générale de la prévention des risques a accordé une tolérance à La Réunion afin de permettre aux opérateurs d'exporter leurs véhicules hors d'usage en Inde, en Indonésie et plus largement dans la zone de l'Océan indien. Matérialisée par un courrier électronique, cette dérogation au code de l'environnement a été reconduite chaque année mais sans jamais bénéficier d'un fondement légal.
Cette situation n'étant pas appelée à se prolonger, des investissements importants ont été réalisés avec le soutien financier de l'Europe, de l'État et de la Région Réunion. Par la suite, un arrêté préfectoral et un agrément ont autorisé ces activités de broyage, qui démarrèrent en 2016.
La Réunion est donc désormais capable de traiter et de valoriser sur place l'ensemble des déchets métalliques, mais aussi de produire une matière première de seconde génération de très haute qualité. Contre toute logique, la dérogation est cependant maintenue. Sollicité à plusieurs reprises à ce sujet, le ministère de l'environnement n'a jamais donné suite.
En plus d'ignorer l'existence de nouveaux outils de transformation performants, ce statu quo compromet d'une part la production à La Réunion de l'acier recyclé – le E40, pour les spécialistes – et d'autre part, bien sûr, la création d'emplois. Cette tolérance va à l'encontre de la nécessaire relocalisation de la valeur ajoutée et du développement de l'économie circulaire. Elle aggrave aussi la pollution maritime puisque les déchets doivent parcourir de longues distances.
Ma question est donc la suivante : le Gouvernement permettra-t-il l'application à La Réunion de l'article R. 543-161 du code de l'environnement ?
Madame la députée, vous avez interrogé M. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargée de vous répondre.
L'activité de la filière de déconstruction automobile répond à des enjeux importants, en particulier dans les territoires d'outre-mer.
Elle répond en premier lieu à des enjeux environnementaux, car cette filière assure la dépollution des véhicules en fin de vie, et permet la réutilisation des pièces détachées et le recyclage des matériaux qui en sont issus. Elle participe en outre à l'activité économique par les emplois de proximité qu'elle génère. La Réunion compte ainsi sept centres agréés de déconstruction des véhicules hors d'usage et deux broyeurs agréés qui permettent la prise en charge de l'ensemble des véhicules hors d'usage de l'île. Enfin, elle permet de prévenir les risques sanitaires, comme vous l'avez souligné, car les véhicules hors d'usage abandonnés constituent des gîtes privilégiés de développement des moustiques et ceux-ci sont vecteurs de maladies qui peuvent être graves.
À La Réunion, environ 5 000 véhicules sont ainsi pris en charge gratuitement chaque année par les réseaux agréés, avec des performances de recyclage et de valorisation satisfaisants qui sont de l'ordre de 85 % de la masse des véhicules.
Cependant, à La Réunion comme dans d'autres territoires d'outremer, un certain nombre de véhicules sont abandonnés sur la voie publique et sur des terrains privés, souvent par des personnes qui les déconstruisent en toute illégalité pour récupérer uniquement les pièces détachées qui ont de la valeur. Sur le territoire de La Réunion, le nombre de ces véhicules abandonnés est estimé à une dizaine de milliers.
Sur la base des recommandations formulées sur cette problématique par le rapport du député Letchimy en 2015, un décret pris en avril 2017 demande aux constructeurs automobiles de mettre en oeuvre un plan d'actions ciblé sur les collectivités d'outre-mer, visant à collecter et traiter ces véhicules abandonnés, en lien avec les collectivités locales.
Des actions de sensibilisation des habitants sont par ailleurs prévues afin de prévenir l'abandon de ces véhicules ou leur récupération par la filière illégale.
En application de ce plan, les constructeurs automobiles ont engagé fin mars 2018 les premières opérations de collecte de véhicules abandonnés en Guadeloupe et en Martinique, dans le cadre d'une phase expérimentale qui porte sur 3 000 véhicules. Sur la base de cette expérimentation, les constructeurs automobiles élargiront cette action à La Réunion dans les prochains mois.
Parallèlement, les services de l'inspection des installations classées de mon ministère renforcent leur lutte contre la filière illégale de déconstruction des véhicules.
Les questions relatives à la collecte des véhicules hors d'usage s'inscrivent par ailleurs dans le cadre d'un enjeu national tout particulier et feront l'objet d'annonces spécifiques lors de la publication prochaine de la feuille de route sur l'économie circulaire.

La parole est à Mme Aurore Bergé, pour exposer sa question, no 273, relative à la gratuité de la portion francilienne de l'autoroute A10.

J'associe à ma question mes collègues des Yvelines et de l'Essonne Béatrice Piron, Jean-Noël Barrot, Bruno Millienne, Amélie de Montchalin, Marie-Pierre Rixain et Laëtitia Romeiro Dias.
Vous le savez, madame la ministre, les Français ne sont pas égaux en matière de mobilité, y compris au coeur de la région Île-de-France. La situation est problématique notamment pour les habitants du Sud Yvelines et de l'Essonne quand ils doivent rejoindre la capitale en empruntant l'autoroute A10, sur laquelle est implantée une barrière de péage à hauteur de Dourdan.
L'A10 est ainsi payante, en plein coeur de la région Île-de-France, à seulement 23 kilomètres de Paris. La présence d'un péage sur une autoroute francilienne si proche de la capitale constitue selon nous une rupture d'égalité entre les citoyens et entre les territoires : en Île-de-France, la plupart des autoroutes sont en effet payantes à partir d'environ 45 kilomètres de Paris.
Même en 2018, de nombreux territoires périurbains sont encore mal desservis par les transports en commun. L'utilisation de la voiture est donc nécessaire aux habitants dans le cadre de leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Pour aller travailler et emprunter l'autoroute, les Franciliens peuvent ainsi dépenser jusqu'à 1 300 euros par an et par véhicule.
À défaut, les automobilistes mais aussi les poids lourds sont contraints de se reporter sur le réseau secondaire. La dispersion du flux de véhicules sur ce réseau, notamment sur la RN20, provoque une saturation. Il en résulte une augmentation du temps de trajet, des émissions de CO2 plus importantes, des nuisances pour les riverains et une dangerosité renforcée de ces axes de circulation.
Depuis des années, des élus et des associations des Yvelines et de l'Essonne se battent pour obtenir la gratuité de cette autoroute empruntée quotidiennement par les habitants de nos territoires. Selon les associations, la gratuité de la portion francilienne de l'A10 ne représenterait pour le concessionnaire Cofiroute que 8 à 10 millions d'euros de manque à gagner, pour un bénéfice net de 330 millions d'euros pour l'année 2016, encore en augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.
Madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement est-il prêt à prendre pour soutenir la mobilité et faciliter les déplacements des Franciliens qui dépendent de cet axe autoroutier ?
Madame la députée, vous appelez mon attention sur la portion de l'autoroute A10 qui traverse l'Île-de-France et je voudrais vous assurer que je suis très attentive à la situation des usagers qui empruntent quotidiennement la section francilienne de l'autoroute A10. Cette autoroute est concédée à la société Cofiroute jusqu'en 2034 et les liens contractuels entre l'État et ladite société prévoient l'application d'un péage sur le tronçon de l'A10 entre Allainville et La Folie-Bessin, c'est-à-dire au niveau du raccordement de la RN 118 proche des Ulis.
Le tronçon reliant Dourdan à La Folie-Bessin regroupe des usagers qui effectuent des déplacements locaux et des usagers en transit qui empruntent l'A11 et l'A10. Or une jurisprudence constante du Conseil d'État impose de respecter le principe d'égalité dans la tarification des usagers, ce qui écarte la possibilité d'établir la gratuité au bénéfice des seuls Franciliens.
Il conviendrait dès lors de procéder au rachat du péage pour l'intégralité des trajets réalisés sur cette section sur une durée calculée jusqu'à la fin du contrat de concession de Cofiroute. Le montant estimé d'un tel rachat est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui n'apparaît envisageable ni pour l'État, ni pour les collectivités.
Dans ce contexte, des efforts importants ont été consentis par l'État et le concessionnaire pour améliorer les conditions d'utilisation de l'autoroute A10. Des formules d'abonnement préférentielles à destination des usagers réguliers empruntant le diffuseur de Dourdan ont par exemple été mises en place. Des tarifs préférentiels destinés à favoriser le covoiturage sont également proposés, en accompagnement des aires de covoiturage réalisées à Ablis, Allainville et Dourdan. Le réaménagement du site de co-modalité de l'échangeur de Dourdan- Longvilliers prévoit notamment, quant à lui, la création de cent places de stationnement supplémentaires et la réalisation d'une gare routière.
Enfin, l'État oeuvre à l'amélioration de l'offre de transport collectif sur l'autoroute A10, en expérimentant, par exemple, une voie réservée aux lignes régulières de bus circulant entre Les Ulis et Massy.

Je vous remercie, madame la ministre, pour ces précisions. Il me semblerait utile que les associations et les élus de ces territoires soient reçus, afin que nous réfléchissions ensemble à des solutions encore plus innovantes.

La parole est à Mme Émilie Bonnivard, pour exposer sa question, no 284, relative à la fermeture de gares en Maurienne.

Madame la ministre des transports, il y a quelques semaines, la SNCF annonçait unilatéralement la fermeture des guichets et bâtiments de plusieurs gares de Savoie, dont deux dans la vallée de la Maurienne, celle de Saint-Avre-La Chambre et Saint-Michel-de-Maurienne. Elle annonçait également une réduction drastique de l'amplitude horaire des deux dernières gares encore ouvertes sur les six que comptait autrefois cette vallée transfrontalière, la plus longue des Alpes : Saint-Jean-de Maurienne et Modane. Bilan : la suppression de quinze postes sur le territoire, d'ici le 1er septembre.
Les gares qui seront fermées sont pourtant utilisées quotidiennement par des usagers travaillant sur le bassin chambérien, voire au-delà, et par des lycéens. Savez-vous ce que c'est que de rester debout sur le quai à sept heures du matin dans une vallée alpine, quand il fait dix degrés en dessous de zéro et que votre train est en retard ? En outre, la gare de Saint-Avre est quotidiennement utilisée par une quarantaine de travailleurs handicapés, population fragile qui restera désormais dehors et sans aucune surveillance.
La Savoie est l'un des principaux départements touristiques de France, avec 731 000 lits touristiques. La population touristique mérite un accueil correct, même en dehors des week-ends. Les Savoies sont l'un des territoires les plus dynamiques en matière démographique. Ce sont aussi des territoires sur lesquels on fait de plus en plus de déclarations sur la qualité de l'air, et de moins en moins d'efforts en faveur du train. Ces décisions sont l'exact contraire de ce qu'il faudrait faire pour promouvoir les transports propres et un service de qualité dans ces territoires à la fois dynamiques et fragiles.
Enfin, madame la ministre, depuis trente ans, qu'il s'agisse du fret ou du service voyageurs, la SNCF n'a cessé de réduire le service en Maurienne, qui est pourtant une vallée transfrontalière. Et les postes actuellement proposés aux personnes touchées par cette restructuration se trouvent à Annemasse. De qui se moque-t-on ? Les gens ont construit leur vie dans notre vallée et y sont attachés. Savez-vous combien de temps il faut pour aller de Saint-Jean-de-Maurienne à Annemasse ?
Aussi, madame la ministre, pouvez-vous me faire connaître votre volonté réelle de préserver ce service public dans la vallée de la Maurienne et plus généralement dans les vallées alpines, en maintenant des gares ouvertes, afin de répondre aux besoins minimums des usagers ?
Êtes-vous d'accord pour nous aider à sauver les deux gares menacées de fermeture ? Pourquoi ne pas envisager que ces territoires, qui ont été sacrifiés au cours des dernières années, assurent un certain nombre de services déconcentrés pour la SNCF, à l'heure du tout numérique ? Ne serait-il pas possible de décloisonner les différents services, afin de faciliter le maintien des personnels sur le territoire, sur d'autres postes ?
Je veux souligner, pour finir, que l'activité de ces gares est restée stable au cours des dernières années. Madame la ministre, nous ne sommes pas d'accord avec ces fermetures : il nous semble que ces décisions ne sont pas pertinentes et nous souhaiterions savoir comment vous pouvez nous aider à revenir dessus.
Madame la députée, vous m'interrogez sur la fermeture totale ou partielle des guichets et bâtiments voyageurs dans certaines gares de la Maurienne.
Permettez-moi d'abord de rappeler qu'en tout état de cause, la fermeture d'un guichet ou d'un bâtiment de gare n'est pas synonyme de suppression de la desserte. En l'occurrence, il n'y a pas de modification de la desserte des gares que vous mentionnez.
La politique d'ouverture des guichets et des bâtiments des gares régionales relève de la contractualisation entre l'opérateur et la région, en tant qu'autorité organisatrice des services ferroviaires régionaux, dans la mesure où c'est elle qui en supporte le coût. Dans le contexte actuel de maîtrise de la dépense publique, il apparaît compréhensible que la région veille à un équilibre satisfaisant entre l'intérêt du service offert aux voyageurs et son coût pour le contribuable. L'État, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, n'intervient pas dans ce choix.
Cela étant, je suis attachée à ce que la SNCF, en lien avec la région, examine les moyens de substitution pour amoindrir l'impact sur les usagers de la fermeture des guichets, par exemple en confiant la distribution des titres de transport régional à des établissements implantés à proximité de la gare, tel qu'un office de tourisme ou un marchand de journaux par exemple. Les titres peuvent parfois aussi être vendus à bord des TER. S'agissant de la gare de Saint-Avre-La Chambre, l'ouverture du point de vente sera maintenue en période de pic hivernal, en l'occurrence les samedis et dimanches du 15 décembre au 15 avril.

Madame la ministre, je vous demande, si vous le voulez bien, de nous aider à trouver des solutions avec la SNCF pour éviter que les gens soient obligés d'attendre leur train dehors, en particulier l'hiver.

La parole est à M. Christophe Arend, pour exposer sa question, no 274, relative aux Dégâts miniers à Rosbruck.

Ma question est adressée au ministre de l'économie et des finances. Au début des années 1980, des permis de construire ont été délivrés à Rosbruck, dans le quartier du Weihergraben, en Moselle-est. La situation topographique d'alors localisait ces constructions six mètres au-dessus du niveau de crue de la Rosselle, la rivière qui irrigue ce territoire. À la même époque, les Houillères du bassin lorrain exploitaient le sous-sol de Rosbruck, à plus de 1 000 mètres de profondeur. Depuis, tout le village a subi des affaissements de terrain qui ont entraîné d'importants désordres du bâti.
Le quartier du Weihergraben est l'illustration paroxystique des dégâts d'origine minière. Aujourd'hui, les constructions penchent dangereusement et se fissurent. Elles se situent désormais neuf mètres en dessous du niveau de crue de la Rosselle, ce qui signifie qu'elles ont subi un affaissement de quinze mètres, équivalent à la hauteur d'un immeuble de quatre étages. Cela inverse le sens naturel d'écoulement des eaux. Une digue de protection a été édifiée, mais si elle se rompt, le Weihergraben se transformera en lac, sans possibilité d'évacuation des eaux. Les trente-neuf habitations du quartier sont désormais classées en zone rouge inondable pour risque naturel.
Or, madame la ministre, l'origine du problème est bien minière, et non naturelle. Les habitants du Weihergraben vivent dans des maisons qui présentent jusqu'à cinq centimètres par mètre de variation à l'horizontale. Ils réclament un Plan de prévention des risques miniers – PPRM. La situation, déjà critique, des habitants du quartier est encore aggravée par l'arrêt de pompage des eaux minières. À terme, le niveau de la nappe phréatique se fixera en effet à trois mètres sous les fondations de leurs maisons. Double peine, pourrions-nous dire ! Comble de la situation, l'établissement public à caractère industriel et commercial qui avait pris la suite de Charbonnages de France a été dissous à la fin de l'année 2017, après avoir interjeté appel d'une décision de justice favorable à Rosbruck.
Le bassin minier de l'Est mosellan a fortement contribué au redressement de la France d'après-guerre, grâce aux gueules noires. Ils ont amplement mérité que l'État ne les abandonne pas. Que compte entreprendre le ministre de l'économie et des finances pour rassurer nos concitoyens de Rosbruck sur la sollicitude de l'État ?
Monsieur le député, vous avez interrogé M. le ministre de l'économie et des finances, mais le risque minier relève du ministère de la transition écologique et solidaire.
M. le ministre de la transition écologique et solidaire est pleinement conscient des responsabilités de l'État dans la gestion des risques miniers après la fin de l'exploitation. Le ministère de la transition écologique et solidaire consacre ainsi, chaque année, près de 40 millions d'euros à la réparation des dommages miniers et à la prévention des risques miniers, qu'il s'agisse de surveillance ou de travaux de mise en sécurité.
Concernant plus particulièrement le bassin houiller lorrain, outre l'arrêt de l'exploitation minière, le secteur connaît depuis le début des années 2000 une baisse significative du taux de prélèvement dans la nappe des industries et des collectivités. La remontée constatée de la nappe, qui tend à retrouver son niveau naturel, n'a donc pas pour seule origine l'ancienne exploitation minière. Cependant, pour faire face à ce phénomène, l'État a, depuis 2009, entrepris et financé des travaux de pompage et de traitement des eaux pour un montant de 7,4 millions d'euros.
L'État effectue également la surveillance, au travers d'un réseau de piézomètres, du secteur ouest du bassin houiller lorrain, qui est le plus immédiatement touché par la remontée de nappe. Par ailleurs, dans ce secteur, les zones affaissées à la suite de l'exploitation minière ne sont pas les seules concernées par le risque d'inondation. C'est pourquoi l'État a prévu de recourir à l'établissement d'un Plan de prévention des risques d'inondation – PPRI – sur l'ensemble du bassin houiller lorrain, qu'il s'agisse de zones affaissées ou non affaissées, et quel que soit le type d'inondation, par débordement ou par remontée de nappe.
La prescription de ce PPRI ne remet pas en cause la responsabilité de l'État en matière d'après-mine. Par conséquent, concernant spécifiquement les zones affaissées à la suite de l'ancienne exploitation minière, et même en l'absence de Plan de prévention des risques miniers, si des mesures de prévention collective s'avèrent nécessaires pour éviter un dégât d'origine minière, elles continueront à être mises en oeuvre et financées par l'État au titre de l'après-mine.
En dehors de ces cas de prévention liée à l'activité minière passée, l'avantage d'établir un PPRI réside dans l'éventuelle intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs – FPRNM – qui ne peut s'envisager que dans le cas d'un risque naturel, défini à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dont les inondations font partie.
Ainsi, l'État assume déjà pleinement sa responsabilité en matière d'après-mine. Il prend et continuera à prendre les mesures nécessaires pour faire face au phénomène d'inondation en zone affaissée, même si celui-ci n'est pas exclusivement d'origine minière. Quant aux mesures qui pourraient être prescrites aux particuliers, notamment aux habitants de Rosbruck, pour faire face au risque naturel d'inondation, il est important de préciser que leur coût ne peut dépasser 10 % de la valeur vénale des biens concernés.
Par ailleurs, l'État, via le FPRNM, pourra participer au financement de ces mesures à hauteur de 40 % pour les biens à usage d'habitation ou à hauteur de 20 % pour les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les entreprises de moins de vingt salariés.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre, et je prends note que l'État prendra bien ses responsabilités en cas d'inondation. Mais, pour rassurer pleinement les habitants de ce bassin minier qui, je le répète, ont lourdement contribué au redressement de la France dans l'après-guerre, il me semblerait utile qu'un membre de vos services se donne la peine de se déplacer sur le terrain. Je vous assure qu'il est impressionnant de se trouver dans une maison où le sol a une dénivellation de cinq centimètres par mètre ! Pour vous donner une idée du problème, ces maisons sont obligées d'avoir quatre écoulements par gouttière, parce que le sens d'écoulement de l'eau varie d'une année à l'autre.
Suspension et reprise de la séance
La séance, suspendue à dix heures quinze, est reprise à dix heures vingt.

La parole est à Mme Valérie Lacroute, pour exposer sa question, no 286, relative au collège Jacques-Prévert à Lorrez-le-Bocage.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, à travers l'exemple du collège Jacques-Prévert situé à Lorrez-le-Bocage, dans ma circonscription du sud Seine-et-Marne, j'aimerais me faire l'écho des inquiétudes des parents d'élèves et des professeurs des zones rurales.
Sur les 510 élèves que compte ce collège, 40 % sont issus de classes sociales professionnelles défavorisées, et l'établissement concentre de nombreuses difficultés : trente-trois élèves bénéficient d'un projet d'accueil individualisé, quarante d'un plan d'accompagnement personnalisé, neuf sont accompagnés d'une assistante de vie scolaire, onze sont suivis par la maison départementale des personnes handicapées et deux sortent d'un institut thérapeutique éducatif et pédagogique.
Qui plus est, les enseignants absents ne sont pas remplacés. Le rectorat a toutes les peines à trouver des professeurs qui acceptent de venir en grande couronne d'Île-de-France. Ainsi, l'année dernière, une classe de cinquième n'a pas eu de cours de français pendant un trimestre entier suite à un congé maladie. Cette année, le professeur d'espagnol est absent depuis deux mois et demi, ce qui pénalise l'ensemble des élèves de quatrième et la moitié des élèves de troisième, soit 167 élèves. Et je ne parle pas du manque de structures spécialisées de type ULIS – unités localisées pour l'inclusion scolaire – ou SEGPA – section d'enseignement général et professionnel adapté.
En 2014, ce collège était classé ZEP – zone d'éducation prioritaire – mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce déclassement a été vécu comme une trahison et un abandon du monde rural. L'année dernière, une classe a été supprimée. Comme si cela ne suffisait pas, les mauvaises nouvelles continuent à tomber. Aujourd'hui, deux classes se retrouvent à nouveau menacées de fermeture à la rentrée prochaine.
Le collège de Lorrez-le-Bocage, établissement caractéristique du monde rural, voit se dégrader année après année les conditions d'accueil des élèves, malgré la bonne volonté du personnel et des enseignants. Monsieur le ministre, quand prendrez-vous la mesure des besoins des établissements scolaires ruraux ? Pourrez-vous lisser ces deux fermetures sur deux années, afin de ne pas pénaliser brutalement ces collégiens qui ont besoin d'un suivi tout particulier ?
Monsieur le président, madame la députée Valérie Lacroute, vous m'interrogez sur les collèges implantés en zone rurale, auxquels j'accorde une attention particulière. Je me suis beaucoup exprimé sur ce sujet ces derniers temps. Vous avez évoqué la situation significative du collège Jacques-Prévert de Lorrez-le-Bocage, que je connais, dans le sud de la Seine-et-Marne, très proche des régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire.
Il est vrai que ce collège connaît une érosion de ses effectifs qui amène à envisager deux fermetures de division à la rentrée 2018, fermetures strictement liées à cette érosion. Si ce collège a été sorti de la carte de l'éducation prioritaire lors de la dernière révision, à la rentrée 2015, c'est que d'autres établissements concentraient plus de difficultés sociales et scolaires. C'est en tout cas ce qui ressort des données. Bien entendu, il faut prévoir des mesures d'accompagnement pour l'établissement dans ce genre de cas.
La rentrée 2017 sera marquée, en effet, par une mixité sociale renforcée dans ce collège : 38 % d'élèves issus de foyers relevant de professions et catégories sociales – PCS – favorisées, 26 % de PCS moyennes et 36 % de PCS défavorisées. C'est presque un archétype de mixité sociale, avec une répartition en trois tiers.
Les conséquences pour le collège de sa sortie de l'éducation prioritaire ont pu être lissées dans le temps. Une attention particulière y a été portée à la rentrée dernière. La direction académique des services départementaux de la Seine-et-Marne applique de longue date une politique d'allocation progressive des moyens, en fonction des caractéristiques sociales des élèves et des spécificités de chaque établissement, ce qui a pour conséquence d'atténuer fortement les effets de seuils induits par la classification ou non en éducation prioritaire.
J'ai engagé par ailleurs une réflexion pour réduire encore ces effets de seuil.
Je signale également que le collège Jacques-Prévert, du fait de la configuration particulière de ses bâtiments, bénéficie d'une dotation plus importante en moyens d'assistance éducative.
Pour répondre aux nécessités de l'accueil des élèves à besoins spécifiques, nous créons chaque année des ULIS dans le premier degré et en collège, au plus près des besoins. C'est ainsi que quatre ULIS et trois SEGPA sont situées entre dix-neuf et vingt-deux kilomètres de Lorrez-le-Bocage. Une cinquième ULIS sera ouverte à la rentrée 2018 à Montereau-Fault-Yonne, à dix-neuf kilomètres de Lorrez-le-Bocage, ainsi qu'une quatrième SEGPA dans le même rayon géographique.
Le collège Jacques-Prévert scolarise, quant à lui, dix élèves reconnus en situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées, ce qui représente moins de 2 % de son effectif total, quand la moyenne départementale s'établit à 3 % par établissement. Le collège ne présente donc pas de spécificité particulière en la matière.
Vous savez toute l'importance que j'attache au remplacement des enseignants absents. C'est un des principaux problèmes du système scolaire. Mais en dépit de l'éloignement géographique du collège Jacques-Prévert, je tiens à souligner que toutes les demandes de suppléance ont été satisfaites depuis la rentrée de septembre, à l'exception d'une suppléance courte en anglais, de deux semaines, et du remplacement dont vous avez parlé en espagnol, discipline dans laquelle la pauvreté du vivier de remplacement retarde la mise en place d'une solution. Nous nous sommes attaqués à ce problème, mais pour le reste, l'amélioration est d'ores et déjà incontestable d'une année scolaire sur l'autre.
Pour finir, rappelons que le collège Jacques-Prévert a intégré un projet artistique et culturel expérimental, en lien avec la direction régionale des affaires culturelles, dans l'esprit de ce que nous avons souhaité avec la ministre de la culture, et en lien avec le conseil départemental, pour développer les résidences d'artistes en milieu rural et diversifier l'offre culturelle faite aux élèves.
Je resterai attentif à ce collègue comme à tous les collèges ruraux.

Monsieur le ministre, merci pour vos réponses. Je constate que vous partagez mes préoccupations. Ce qu'il faut bien comprendre…

Oui. Je rappelle à chacun que le délai de six minutes inclut l'éventuelle réponse du député au ministre.

La parole est à M. Guy Bricout, pour exposer sa question, no 295, relative aux fermetures de classes dans les territoires ruraux.

Monsieur le ministre, dans le département du Nord, environ un quart de la population vit dans des territoires ruraux. À l'initiative du conseil départemental du Nord et de son vice-président en charge de la ruralité, l'association des maires du Nord et les services départementaux de votre ministère ont travaillé, pour aboutir le 8 février 2017, à la signature d'une charte de l'école rurale. Cette charte prévoit des engagements en faveur de 241 communes sur les 648 que compte notre département, pour trois ans à compter de la rentrée dernière. Ce travail devait d'ailleurs être salué par Mme la secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation au Sénat, le 21 février 2017. Le Président de la République avait lui-même déclaré à l'occasion de la conférence des territoires le 17 juillet que les territoires ne peuvent plus être la variable d'ajustement, et que c'est pourquoi il n'y aura plus de fermetures de classes dans les territoires ruraux.
Monsieur le ministre, sur ma circonscription, pour grande partie rurale, pas moins de vingt-trois fermetures sont actées. Les parents d'élèves, ici présents, et les élus se sont fortement mobilisés : pétitions, manifestations, occupations diurnes et nocturnes d'écoles, vente de mobilier scolaire sur Le Bon coin auront rythmé ces dernières semaines. Le maire de Maretz, petite commune de 1 451 habitants, m'a indiqué être prêt à payer le salaire du poste d'enseignant qu'il perdra à la rentrée prochaine !
C'est vous dire combien les écoles en milieu rural nous sont chères. Une fermeture de classe est toujours vécue comme une atteinte à l'intégrité d'une commune. Arrêtez, s'il vous plaît, de faire le yoyo chaque année avec les ouvertures et les fermetures de classes, surtout pour un ou deux enfants en plus ou en moins ! Il arrive même qu'on ferme une classe pour la rouvrir l'année suivante !
Ce qui indigne le plus les parents et les élus, c'est que, dans un rayon géographique restreint, on puisse ouvrir des classes de douze élèves pour les dédoublements de CP ou CE1 et maintenir le dispositif « plus de maîtres que de classes » avec deux maîtres par classe, et, à quelques kilomètres, fermer des classes en regroupement pédagogique intercommunal, à un, deux ou trois élèves près !
J'en conclus que nous devons raisonner par territoire, et non par commune, et nous accorder sur la définition de la ruralité en France et de l'école rurale en particulier. Là où, dans le Nord, le ministère voit 57 communes rurales, la préfecture en compterait plus de 200 et le département du Nord 474 !
Monsieur le ministre, en dehors de celle de l'INSEE, il n'existe pas de définition de la ruralité adaptable à l'éducation nationale. Je vous propose d'y travailler.
J'ai travaillé à la mise en place du SDAASP – schéma départemental d'amélioration des services au public – sur le département du Nord…

Monsieur le ministre, les territoires ruraux doivent bénéficier de la même attention que les écoles des villes classées en réseau d'éducation prioritaire et qui bénéficieront, dès cette année, de classes dédoublées de douze élèves.
Merci pour votre question, monsieur le député, qui me permet de développer ce sujet qui m'est particulièrement cher. Nous serons d'accord sur le fond car nous partageons la même préoccupation de l'école rurale, dont je ne me soucie pas moins que vous. Cette question nous renvoie avant toute chose à des sujets démographiques, qui mériteraient un travail important.
Notre seule divergence portera sur la description que vous faites de la préparation de la rentrée prochaine. Je ne peux pas laisser dire que nous négligeons les écoles rurales. C'est la chose la plus fausse qui émerge du débat public en ce moment. C'est inacceptable, d'autant plus que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous les cite car ils valent aussi pour votre département.
Il y aura 32 000 élèves de moins dans le premier degré à la rentrée prochaine et nous créons 3 881 postes de professeur des écoles. Les taux d'encadrement augmenteront dans chaque département, y compris le vôtre. Nous créons 220 emplois à la rentrée prochaine dans le département du Nord, malgré une baisse prévue des effectifs de 2 496 élèves. Le ratio départemental du nombre de professeurs pour 100 élèves sera de 5,68 à la rentrée 2018 dans le département du Nord, contre 5,52 à la rentrée 2017.
Il est important de poser un diagnostic exact, à partir de la réalité. On parle souvent de bataille de chiffres, mais ceux que je présente ici sont parfaitement vérifiables par tout un chacun : il n'y aura pas d'autre « vrai chiffre » qui dira le contraire ! Bref, l'effort est réel.
Mon autre point de divergence avec vous est mon refus d'opposer le rural à l'urbain. D'une part, il existe des classes REP en zone rurale, notamment dans votre département. Le dispositif des classes de douze élèves bénéficie donc aussi bien aux zones rurales qu'aux zones urbaines et nous ne devons pas opposer les deux, même si ce sont majoritairement les zones urbaines qui bénéficient de ce dispositif. D'autre part, les taux d'encadrement aujourd'hui, en raison précisément de l'attention spécifique que nous portons aux zones rurales, sont plus favorables en milieu rural qu'en milieu urbain.
À condition qu'on accepte de dire la vérité sur le sujet, on me trouvera toujours présent pour travailler au fond sur les questions que vous avez soulignées à juste titre. Vous avez raison : nous devons faire évoluer de manière positive la définition des territoires afin d'en avoir une vision plus large. Nous devons également éviter certaines décisions absurdes liées à une prise en compte trop mécanique des effets de seuil. Je suis très ouvert sur le sujet.
Je suis donc favorable à votre proposition de réfléchir avec la représentation nationale aux enjeux de la définition des territoires ruraux. Nous commençons du reste à le faire dans le cadre des conventions départementales de ruralité, y compris avec le département du Nord. Nous pouvons évidemment, à l'avenir, encore améliorer cette réflexion.
Je tiens à vous assurer de la pleine attention que je porte à cette question, qui nous renvoie également aux remèdes que nous devons trouver, tous ensemble, à une autre question qui, elle, dépasse l'école : celle de la baisse démographique en milieu rural.

La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour exposer sa question, no 290, relative aux conséquences de l'abaissement de l'obligation scolaire.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, le 27 mars dernier, le Président de la République annonçait, à l'occasion du lancement des travaux des assises de la maternelle, que l'âge auquel l'instruction deviendrait obligatoire serait abaissé à trois ans, ce qui est, du reste, déjà entré dans les faits puisque presque la totalité des enfants sont scolarisés à cet âge.
Comme vous le savez, les communes et certaines intercommunalités participent aux frais de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État, au titre du forfait communal. Cette obligation concerne aujourd'hui uniquement l'école primaire, car elle se justifie au nom de l'égalité de traitement entre les enfants dès lors que leur instruction est obligatoire.
Dans le contexte de diminution de leurs dotations, encore prégnant cette année, les collectivités ne sauraient supporter la contrainte financière que ferait peser l'extension de l'obligation de verser un forfait à toutes les classes de maternelle. J'ajoute que la contribution créée serait d'autant plus lourde à supporter que le coût de scolarisation des enfants est plus élevé en maternelle qu'en primaire, en raison de l'important encadrement complémentaire assuré, entre autres, par les ATSEM – agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles – aux côtés des professeurs des écoles.
En dépit des occasions qui vous ont été données ces dernières semaines, vous ne vous êtes pas prononcé clairement sur les intentions du Gouvernement. Les communes devront-elles, oui ou non, verser un forfait communal pour les classes de maternelle des établissements privés ? Si oui, comment l'État compensera-t-il cette charge nouvelle ? Si non, envisagez-vous de revenir sur la loi Debré de 1959 pour clarifier la forme des contrats d'association ?
Madame la députée, votre question tend à minimiser les impacts positifs de la réforme annoncée par le Président de la République et à maximiser les inquiétudes qu'elle pourrait susciter.
Si tel n'est pas le cas, je m'en réjouis.
Dans un premier temps, je tiens à rappeler les raisons de cette décision historique. Le sujet devant être traité dans un futur projet de loi, nous avons de ce fait largement le temps de travailler à ses différentes conséquences.
Bref, regardons le pourquoi avant d'envisager le comment. Cette obligation scolaire nouvelle n'est pas à minimiser. Vous avez dit que la scolarité à trois ans était déjà une réalité, mais ce n'est vrai que pour un peu plus de 95 % des enfants : plus de 20 000 enfants ne sont pas touchés. Je ne considère pas que ce soit quantité négligeable, d'autant plus que ce nombre a tendance à augmenter et qu'il peut être beaucoup plus important dans certains territoires, comme l'outre-mer. En outre, cette tendance peut correspondre à des phénomènes sociétaux assez inquiétants, comme la non-scolarisation des filles. Je suis certain que cette question vous concerne également.
Cette mesure s'inscrit donc dans une stratégie générale de réussite des élèves, avec un accent mis sur l'importance de l'école maternelle, où se jouent beaucoup de choses quant à l'épanouissement et aux capacités langagières des enfants.
Aussi bien sur le plan social que sur le plan pédagogique, cette mesure a une grande importance : elle permet d'affirmer l'identité propre de l'école maternelle. Les assises de l'école maternelle, qui ont été présidées par Boris Cyrulnik, ont été l'occasion de le rappeler. L'annonce du Président de la République s'inscrit dans ce contexte historique. Toutes les évolutions de la scolarité obligatoires ont correspondu à des évolutions profondes de l'école ainsi qu'à des considérations sociales – je vous les ai rappelées – elles-mêmes articulées avec des considérations pédagogiques.
Les conséquences financières de cette mesure, que vous avez évoquées, concernent en premier lieu l'éducation nationale, puisqu'il lui faudra créer plus de postes dans les écoles maternelles pour accueillir ces nouveaux élèves. Nous l'anticipons pleinement, dans le cadre de la priorité donnée par le Gouvernement à l'école primaire, et les créations de postes dans le premier degré sont programmées pour les prochaines années.
Par ailleurs, les services de l'éducation nationale travaillent en lien étroit avec la direction générale des collectivités locales, pour la mise en oeuvre concrète de l'abaissement à trois ans de la scolarité obligatoire. Les conséquences, tant pour les municipalités que pour les services de l'éducation nationale, sont donc étudiées.
Une vaste consultation des associations représentatives d'élus sera par ailleurs conduite, dans le cadre du projet de loi qui sera présenté en 2019, ce qui nous laisse du temps. Ce sera l'occasion de faire le point sur les disparités territoriales, qu'il s'agisse du taux de scolarisation à trois ans ou de la part respective de l'enseignement public et de l'enseignement privé, qui peut être très différente selon les régions. Ce sera également l'occasion de travailler sur la démographie : nous observons en effet une baisse continue du nombre des élèves dans le premier degré, confirmée par l'INSEE pour les prochaines années. Cette baisse permettra à l'école publique comme à l'école privée de mieux gérer l'absorption des nouveaux élèves.
Quant aux conséquences juridiques et financières de la mesure, elles seront étudiées dans l'intérêt des élèves dans le respect de l'article 72-2 de la Constitution.

Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'il faut laisser à l'auteur de la question la possibilité de vous répondre. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, brièvement ma chère collègue.

Monsieur le ministre, je tiens à vous rassurer : je ne cherche pas du tout à minimiser la mesure. C'est un objectif louable que d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire afin de scolariser les 5 % d'enfants restants.
Mon propos concernait les conséquences financières de cette mesure pour les collectivités, d'autant que des communes, vous le savez, ont déjà dû faire face sous le précédent gouvernement à des ponctions très importantes et que la moitié d'entre elles voient leur dotation continuer de baisser.

Je le répète : l'objectif est louable, et ma question était purement financière.

La parole est à Mme Marietta Karamanli, pour exposer sa question, no 292, relative à la dénomination du collège Roger-Vercel du Mans.

Monsieur le ministre l'éducation nationale, je voulais vous interroger sur la dénomination du collège Roger-Vercel du Mans dans la Sarthe.
Les enseignants, les parents d'élèves et la Fédération nationale des déportés et internée résistants et patriotes réclament le changement de nom de ce collège depuis 2012. Les parents d'élèves ont exprimé massivement, à près de 90 %, leur souhait de voir ce collège changer de nom. Comme moi, de nombreux élus se sont joints à cette demande.
Si l'on connaît Roger Vercel comme le lauréat du prix Goncourt 1934, on sait aussi qu'il a collaboré en tant qu'éditorialiste à un journal vichyste condamné à la Libération, dans lequel il a pris une position clairement antisémite en 1940. Il se félicitait alors de la prochaine élimination du Juif de la vie littéraire française : « l'élimination du Juif, en tant que penseur et écrivain réagira d'extraordinaire façon sur la littérature de demain ».
Ces propos publics ne sont pas seulement condamnables, ils condamnent aussi leur auteur à ne pas pouvoir incarner les valeurs qu'on attend de celui à qui le nom d'un établissement d'enseignement public est donné. Le choix du nom propre qui s'inscrit aux frontons de nos collèges est porteur de sens et de valeurs. Nommer un collège, c'est rendre hommage à une personnalité, à son oeuvre et à ses actions.
Même si cette modification appartient juridiquement au conseil départemental, le ministère de l'éducation nationale ne peut rester indifférent à cette situation. Le conseil municipal du Mans qui, en 1968, nomma ce collège Roger-Vercel, a, il y a trois semaines, abrogé majoritairement cette décision. Cette délibération, qui a probablement peu de valeur juridique, représente en revanche l'expression d'une opinion locale acquise.
L'exécutif du conseil départemental s'oppose à cette décision pour des raisons comme « On ne refait pas l'histoire » ou « Il appartient aux enseignants d'expliquer aux élèves que la France, lors de l'Occupation, fut antisémite ». À ces arguments, il est répondu : « L'histoire, c'est ce que nous en faisons, c'est une science humaine et vivante » et « Les enseignants font leur travail quand ils traitent de la France occupée ».
Or, comment transmettre des valeurs laïques et républicaines quand les élèves du collège doivent porter le nom d'un homme qui ne partageait pas ces valeurs ? Comment parler du devoir de mémoire aux enfants si le département ne prend pas lui-même en charge ce devoir ? En cette période où la République cherche à être exemplaire, maintenir le nom d'un écrivain dont les idées exprimées sont détestables n'est guère audible.
Monsieur le ministre, quelle est la position de l'État sur cette situation, qui doit nous conduire à ne pas laisser croire que la nation, porteuse de valeurs, ne les défend pas au quotidien au profit des générations actuelles et nouvelles ? La terrible actualité récente doit nous conduire à une vigilance accrue.
Madame la députée, votre question est importante et on ne peut qu'être épouvanté à la lecture des phrases que vous avez évoquées, a fortiori compte tenu de l'actualité que vous avez rappelée. C'est mon rôle que de souligner cette évidence.
Je dois aussi être très attentif à ce que les compétences de chacun soient respectées. Comme vous l'avez vous-même souligné, l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que la dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Le changement de dénomination du collège Roger-Vercel relève donc de l'unique compétence du département de la Sarthe. Il doit pour cela prendre l'avis du maire de la commune siège de l'établissement, ainsi que du conseil d'administration de l'établissement. Ces avis ne lient pas la collectivité qui est la seule compétente pour se prononcer à titre définitif.
Les services du ministère de l'éducation nationale n'exercent donc aucune compétence en la matière et n'ont aucun moyen d'interférer dans une décision qui a été légalement prise par le conseil départemental de la Sarthe.
Je tiens à respecter les compétences des collectivités en la matière, tout en vous assurant de nouveau que je partage votre indignation s'agissant des propos que vous avez cités. De manière plus générale, j'invite chacun à la prudence lorsqu'il s'agit de baptiser ou de débaptiser des collèges. Projeter des querelles historiques sur l'ensemble des noms des établissements risquerait d'ouvrir une boîte de Pandore, ce qui serait contre-productif. En revanche, les collectivités locales doivent pouvoir considérer les cas extrêmes.
Je profite de l'occasion pour vous donner l'état des lieux des dénominations des établissements en France, dénominations dont la vocation est d'avoir une résonance éthique et historique auprès de nos élèves. Ces dénominations rendent souvent hommage à la République et aux hommes et aux femmes qui l'ont construite – politiques, écrivains, scientifiques. Jules Ferry, le grand homme de l'école gratuite et laïque, est le nom le plus fréquemment choisi par les collectivités. Il devance Jacques Prévert, Jean Moulin, Jean Jaurès, Antoine de Saint-Exupéry, Victor Hugo, Louis Pasteur et les époux Curie. Les établissements rendent également hommage aux pédagogues qui ont façonné notre système éducatif : Jean Macé, Paul Bert, ancien ministre de l'instruction publique, Pauline Kergomard, considérée comme ayant inventé l'école maternelle, ou encore Jean Zay, figure mythique de l'éducation nationale, assassiné par la Milice en 1944.
La carte du nom des écoles traduit également la géographie culturelle de la France. Ces noms permettent de porter nos valeurs, et j'ai recommandé que celui du colonel Beltrame soit donné à des établissements. J'ai été heureux d'apprendre qu'un collège des Alpes-Maritimes portera bientôt son nom.

Je dois respecter le règlement, madame, les six minutes sont écoulées. Le ministre répond longuement, et c'est très bien, mais il serait bien aussi de laisser quelques secondes à l'auteur de la question pour lui répondre.

La parole est à Mme Pascale Fontenel-Personne, pour exposer sa question, no 277, relative aux postes d'enseignants non pourvus.

Monsieur le ministre, ma question concerne le nombre de postes non pourvus et les problèmes de recrutement de professeurs dans l'éducation nationale. De nombreux professeurs ont manqué à l'appel de la rentrée 2017 et nombreux sont les établissements scolaires qui n'ont pas trouvé de remplaçants.
Cette situation perdure en Sarthe depuis trois ans. Une association de parents d'élèves a effectué un comptage et relevé la non-nomination de plusieurs professeurs. Le 4 septembre 2017, trois professeurs n'étaient pas encore nommés dans l'établissement. Différentes démarches ont alors été engagées par cette association pour les remplacer, en utilisant les réseaux sociaux et en appelant régulièrement le rectorat.
Monsieur le ministre, vous n'ignorez pas cette situation délicate puisqu'une pétition vous a été adressée en février dernier. Cependant, à ce jour, outre l'absence répétée de nombreux autres professeurs, il manque toujours un professeur de technologie alors même que cette matière est au programme du brevet.
Bilan pour les quatre-vingt-huit élèves de quatrième : depuis septembre, ils ont eu 54 heures de cours de physique-chimie au lieu des 189 prévues par le programme, soit 72 % de cours non dispensés ; et 21 heures de cours de technologie sur les 126 prévues, soit 84 % de cours non dispensés. Cette absence de professeurs a créé un grave déficit d'enseignement pour ces collégiens, qui ne pourra pas être rattrapé d'ici à la fin de l'année et creuse ainsi d'importantes inégalités entre les élèves. Malheureusement, vous le savez, ce collège n'est qu'un cas parmi tant d'autres.
À l'heure où la rentrée 2018 se prépare, il est urgent d'agir. L'égalité des chances face à la réussite scolaire est une priorité essentielle et je sais, monsieur le ministre, que cela vous importe énormément. Aussi, quelles mesures comptez-vous mettre en oeuvre pour garantir le droit à l'enseignement pour tous ? Quels moyens pourraient être mis en place pour pallier ces problèmes de recrutement ? Des procédures temporaires voire permanentes telles que le recrutement d'enseignants dans d'autres académies, sur la base du volontariat, ou l'amélioration des conditions de formation et d'admission des enseignants seraient-elles envisageables ?
Madame la députée, la question du remplacement des enseignants absents, que ce soit au collègue, à l'école primaire ou au lycée, est évidemment l'une des plus importantes pour le système scolaire. Le non-remplacement de ces enseignants est l'un des aspects vécus le plus négativement par les familles.
Ce n'est pas seulement une question de moyens : à la rentrée dernière, en effet, nous avons battu des records en termes de moyens de remplacement, tant dans le premier degré que dans le second degré. C'est aussi une question d'organisation, qui pose des problèmes encore plus importants dans certains secteurs où l'éloignement rend les choses difficiles – on l'a vu dans l'une des questions précédentes. Bref, ce n'est pas tant une question de budget ou de moyens qu'une question d'organisation et c'est pourquoi je mène actuellement des réflexions sur l'évolution de nos méthodes de remplacement.
Avant d'aborder le cas particulier que vous avez évoqué, je dois vous dire que l'amélioration du remplacement des enseignants absents sera donc l'une des priorités des temps à venir, avec trois impératifs : une meilleure information, un renforcement du potentiel existant et une amélioration de la gestion du remplacement.
Les premières mesures décidées en la matière se sont traduites par la publication du décret du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré et de la circulaire du 15 mars 2017 relative à l'amélioration du dispositif de remplacement. Mais nous devons aller plus loin.
La circulaire que je viens de citer réactive les protocoles prévus par le décret du 26 août 2005 qui définissent, dans chaque établissement du second degré, l'organisation du remplacement. À mes yeux, en effet, l'internalisation du remplacement au sein de chaque établissement est une bonne méthode. Ces dispositions permettent, dans le cadre d'un protocole défini dans chaque établissement, de mobiliser les enseignants pour un remplacement de courte durée, conformément à leurs qualifications, dans la limite de cinq heures supplémentaires par semaine et de soixante heures par année scolaire. Le chef d'établissement doit rechercher en priorité l'accord des enseignants pour participer à ce dispositif, même s'il a la possibilité de recourir à la désignation en l'absence d'enseignants volontaires.
Aux remplacements effectués par les enseignants de l'établissement s'ajoutent ceux pris en charge par les titulaires sur zone de remplacement – TZR – , qui assurent prioritairement des remplacements de longue durée mais peuvent aussi être mobilisés pour des remplacements de courte durée. Ainsi, plus de 20 000 heures ont été assurées par des TZR au titre du remplacement de courte durée.
Les efforts des académies pour pallier les difficultés de remplacement sont tangibles. Le 1er septembre 2017, 702 contractuels, en moyens d'enseignement, étaient déjà en poste dans les lycées et collèges de l'académie de Nantes. Tout au long du mois de septembre, 169 équivalents temps plein supplémentaires ont été recrutés.
La Cour des comptes reconnaît les efforts réalisés par le ministère de l'éducation nationale pour lutter contre la désaffection du métier d'enseignant. C'est une stratégie globale de recrutement des enseignants qui permettra de répondre structurellement au problème que vous avez soulevé. Cela fait partie des réformes à venir : nous engagerons en effet une réforme de la formation des professeurs qui inclura une réforme du pré-recrutement et permettra de disposer des viviers nécessaires.

Il faut conclure, monsieur le ministre, si vous voulez que Mme Fontenel-Personne puisse vous répondre.
S'agissant du département de la Sarthe et plus particulièrement du collège Paul-Chevallier du Grand-Lucé, auquel vous avez fait référence, je tiens tout de même à vous transmettre de bonnes nouvelles, qui témoignent de l'attention que nous portons à cet établissement.

Sur une question aussi grave, il est nécessaire que notre collègue réponde au ministre !
Un professeur de physique-chimie a été recruté à la rentrée des vacances d'hiver. Quant au professeur de technologie, il vient d'être recruté, vendredi dernier. Un accompagnement personnalisé sera possible pour les élèves qui ont pâti des absences dont vous avez parlé.

La parole est à Mme Pascale Fontenel-Personne, pour une très brève intervention.

Je vous remercie, monsieur le ministre. Effectivement, je viens d'apprendre que le remplacement est effectué depuis lundi.

La parole est à Mme Laurence Dumont, pour exposer sa question, no 291, relative au CROUS de Normandie.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République – loi NOTRe – et de la création d'une seule Normandie, un équilibre avait été trouvé entre la Basse-Normandie et la Haute-Normandie sur la répartition des compétences et le siège des institutions publiques. Ainsi, les établissements publics de l'éducation nationale et de la recherche auraient leur siège à Caen tandis que la préfecture de région et d'autres services se situeraient à Rouen. Avec la création du CROUS – centre régional des oeuvres universitaires et scolaires – de Normandie, cet engagement de l'État semblait avoir été respecté puisque la ministre de l'enseignement supérieur annonçait, en octobre dernier, que le siège de cette nouvelle institution serait implanté à Caen, comme prévu.
Or cette déclaration a été remise en question, un mois plus tard, par le Premier ministre lui-même, décidant unilatéralement que le CROUS de Normandie serait implanté à Rouen, ce qui a stupéfié de nombreux élus et les personnels des deux CROUS actuels. C'est pourquoi la quasi-totalité des parlementaires du Calvados, le maire de Caen et le président de l'université de Caen-Normandie ont interpellé à deux reprises le Premier ministre. En réponse à nos courriers, ce dernier nous a indiqué que c'était au nom de l'équilibre entre les territoires qu'il avait fait ce choix. Cependant, nous n'avons eu aucun élément financier sur ce dossier.
Or les locaux actuels du CROUS de Rouen, peu adaptés, sont situés, a contrario du CROUS de Caen, en dehors des campus universitaires. Cela nécessiterait donc très certainement la construction d'un nouveau siège à Rouen. Aussi, dans un souci de transparence, le Gouvernement peut-il s'engager à nous transmettre, avant toute publication au Journal officiel de l'implantation du CROUS de Normandie, une étude financière comparative détaillée entre les sites de Caen et de Rouen ? À l'heure où des efforts sont demandés aux Français, il serait inconcevable que la solution choisie soit la plus onéreuse.
Madame la députée, vous avez déjà interpellé ma collègue Frédérique Vidal sur cette question. Elle me charge aujourd'hui de vous apporter cette réponse, ce que je fais bien volontiers.
Comme vous le savez, la région Normandie a demandé à être la première région à expérimenter une nouvelle organisation des services de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est une bonne nouvelle pour cette région, puisque nous sommes en train de la placer à l'avant-garde d'un certain nombre d'innovations dans les domaines de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. En particulier, les deux académies ne sont plus pilotées aujourd'hui que par un seul recteur, ce qui a entraîné un rééquilibrage des services : le rectorat est installé dans une ville et le CROUS dans une autre. La décision initiale avait été prise à l'époque où la région comptait un rectorat de région et deux rectorats académiques, mais je puis vous rassurer pour l'avenir : un équilibre a été trouvé en installant le rectorat à Caen et le CROUS à Rouen. Il est important de souligner que le rectorat, institution fondamentale de l'éducation nationale, restera implanté à Caen, ce qui garantira le respect des équilibres dont vous avez rappelé la nécessité.
Le CROUS de Normandie verra ainsi le jour le 1er janvier 2019. Grâce au mouvement que je viens de décrire, ce CROUS devrait être le troisième ou le quatrième CROUS de France en termes d'effectifs et de parc de logements. Certes, son siège sera à Rouen, mais il sera organisé en trois pôles, Caen, Rouen et Le Havre, chaque pôle pilotant à la fois les services aux étudiants relevant de son site et des fonctions transversales à l'échelle de la région. Cette organisation permettra de disposer d'un CROUS plus important, avec davantage de capacités d'investissements, tout en créant des directions de sites dans les villes universitaires, pour une meilleure symbiose avec les établissements d'enseignement supérieur répartis sur l'ensemble du territoire de la région Normandie.
Nous avons la chance de conduire ce chantier pour construire, et non pour réduire. En effet, la dotation du futur CROUS de Normandie pour 2019 devrait être au moins égale à la somme des dotations des deux CROUS actuels de Caen et Rouen. Il en est de même du plafond d'emplois. C'est d'abord et avant tout cette nouvelle qui doit être retenue par les acteurs, car c'est une bonne nouvelle pour la Normandie, pour Caen et pour Rouen.
Grâce à l'excellent travail de la directrice générale préfiguratrice, aucun mouvement géographique de personnel n'est prévu ni nécessaire : l'organigramme équilibré entre les trois sites a permis à chacune et à chacun de se positionner, à l'issue d'une concertation individuelle et collective exemplaire, sur un poste correspondant à ses compétences et à ses aspirations. Ceux qui ont souhaité bouger ont pu le faire, ceux qui ont préféré rester au même endroit ont vu leur demande acceptée.
À terme se posera la question du bâtiment du siège à Rouen. Le travail prospectif est engagé avec les collectivités et les établissements, l'idée étant de privilégier naturellement une implantation sur un campus, dans la transparence que vous avez demandée et qui est évidemment toute naturelle.

Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas qualifier cette nouvelle de « bonne » puisqu'elle est contraire à tous les engagements pris par l'État jusqu'au mois d'octobre dernier. Cela n'a rien à voir non plus avec le fait que nous soyons une académie pilote avec un recteur unique.
Ma question portait uniquement sur le coût financier de l'opération. Si le siège du CROUS est maintenu à Caen, comme c'était prévu, cela ne coûtera rien. Or, si le siège de la nouvelle institution est délocalisé à Rouen, il faudra construire un nouveau bâtiment, pour un coût qui atteindra vraisemblablement plusieurs millions d'euros. Je regrette que vous ne m'ayez pas éclairée sur cette question et que vous n'ayez même pas pris, au nom du Gouvernement, l'engagement de nous transmettre une étude comparative du coût financier de ces deux options.
L'ensemble des parlementaires du Calvados, le maire de Caen et le président de l'université de Caen-Normandie sont préoccupés par cette question. La moindre des choses est de répondre aux questions posées ! Encore une fois, nous parlons de l'engagement des deniers publics.
Je suis bien d'accord.

Votre remarque relative au fait que le budget du futur CROUS correspondra à la somme des dotations des deux CROUS actuels ne suffit pas pour nous satisfaire ou nous réconforter. Encore une fois, il s'agit de construire ex nihilo un nouveau CROUS à Rouen alors que nous avons tout ce qu'il faut à Caen et que l'État avait pris un engagement en faveur de cette ville.

La parole est à Mme Nicole Dubré-Chirat, pour exposer sa question, no 268, relative à la représentativité des communes nouvelles.

Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, je souhaite vous interroger sur l'essor et la mise en place des communes nouvelles sur l'ensemble du territoire de la République. En effet, 517 communes nouvelles ont été créées en deux ans, regroupant près de 1 800 communes et 1,8 million d'habitants.
Élue du Maine-et-Loire, où le développement des communes nouvelles a été particulièrement important, je m'interroge sur la possibilité de dresser un premier bilan de la mise en place de ces nouvelles collectivités territoriales ou de se baser sur celui réalisé par l'Association des maires de France afin de réfléchir à de nouvelles propositions visant à assurer la bonne représentation des communes déléguées au sein des conseils municipaux des communes nouvelles, tout cela sans ignorer le cadre actuel découlant de la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle.
Les résultats de ces regroupements semblent globalement positifs. On a constaté un phénomène général d'engouement autour de la commune nouvelle, tant de la part de la population et du secteur associatif que des personnels et des élus. Les difficultés rencontrées tiennent essentiellement aux problèmes d'adressage et à la complexité de certaines démarches administratives en phase transitoire. Des inquiétudes demeurent quant à la représentation des élus et à l'organisation de la commune après 2020.
Les élus de ces communes nouvelles interrogés par l'Association des maires de France et ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma circonscription plaident pour une augmentation du nombre d'élus, pour la fixation d'un nombre minimum d'élus par commune historique au sein du conseil municipal de la commune nouvelle, ou encore pour une adaptation du mode de scrutin en intégrant une dose de proportionnelle ou en prévoyant des listes représentatives avec des places réservées.
Je souhaite connaître la position du Gouvernement sur l'organisation de ces collectivités avant d'aborder les prochaines élections municipales.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Madame la députée, vous m'interrogez sur les communes nouvelles. En effet, comme vous l'avez rappelé, depuis 2015 – sachant que la décision de la création des communes nouvelles date de la réforme des collectivités territoriales de 2010, aménagée par la loi Pélissard – 1 856 communes ont fusionné pour former 554 communes nouvelles, rassemblant près de 1,9 million d'habitants. Un grand nombre de ces communes, par une sorte de tradition culturelle, se trouvent dans le quart nord-ouest du territoire métropolitain, notamment dans le département du Maine-et-Loire, dont vous êtes élue, madame la députée, et qui est particulièrement actif en la matière.
Pour le dire simplement, le Gouvernement soutient la création de communes nouvelles. Le maintien du régime financier incitatif spécifique pour les communes nouvelles créées d'ici au 1er janvier 2019, voté dans la loi de finances pour 2018, devrait se traduire par la création de communes nouvelles supplémentaires dans les mois à venir.
Vous savez en effet que la particularité de ce dispositif des communes nouvelles réside dans les communes déléguées : les anciennes communes deviennent toutes automatiquement des communes déléguées, sauf décision contraire des conseils municipaux prise avant la création des communes nouvelles.
De nombreuses dispositions régissent le nombre d'adjoints aux maires et de maires délégués. Il faut cependant rappeler que les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne sont pas comptabilisées au titre du plafond de 30 %, ce qui est une facilité pour les maires délégués. De nombreuses possibilités sont également offertes pour créer des conférences municipales dans les communes déléguées.
Derrière votre question, j'ai bien compris que vous m'interrogez aussi sur le nombre des conseillers municipaux. Aujourd'hui, en effet, lorsqu'une commune nouvelle se crée, les deux conseils municipaux peuvent siéger ensemble, quel que soit le nombre des conseillers réunis – qui peut être important lorsqu'il s'agit de grandes communes, comme c'est le cas pour la commune nouvelle créée à Annecy.
Dans une deuxième étape, les communes nouvelles bénéficieront de l'avantage de la strate supérieure : si la commune nouvelle compte par exemple 3 500 habitants, elle bénéficiera de la strate supérieure et comptera donc un nombre plus important de conseillers municipaux, sachant que, bien entendu, les élections de 2020 porteront sur une seule unité – la commune nouvelle – et que les listes devront être établies pour celle-ci. Il appartiendra à chaque liste candidate d'intégrer des représentants de toutes les communes déléguées, comme c'est le cas dans une commune « normale », où l'on s'attache à constituer des listes intégrant des candidats issus de tous les quartiers.
Troisième étape : le nombre de conseillers sera ramené à celui qui correspond à l'effectif de la population.
Je sais que certains demandent de modifier la loi pour revenir sur la représentation des communes déléguées dans les communes nouvelles. C'est très compliqué, car les nouvelles communes sont parfois formées de nombreuses communes. Pour le dire très clairement, les cartes étaient connues avant la constitution des communes nouvelles. En un mot, les communes nouvelles sont de nouvelles communes à part entière.

La parole est à Mme Laurianne Rossi, pour exposer sa question, no 276, relative aux tarifs de stationnement résidentiel.

Madame la ministre, je veux, avant toute chose, associer à ma question mes collègues Bergé, Cesarini, Fugit, Lazaar, Lebec, Marsaud, Perea, Perrot, Petit, Raphan, Taquet et Vanceunebrock-Mialon, frappés aux aussi, dans leurs territoires, par une politique municipale du stationnement qui doit tous nous alerter et nous mobiliser. Ma question concerne en effet l'évolution très préoccupante des tarifs du stationnement résidentiel dans plusieurs communes de notre pays, au premier rang desquelles la ville de Montrouge, située dans ma circonscription des Hauts-de-Seine.
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Les collectivités peuvent ainsi, depuis le 1er janvier 2018, fixer librement les tarifs de stationnement et de forfait post-stationnement, et déléguer la gestion de ce service à un tiers.
Or, nous constatons dans plusieurs villes, Montrouge en tête, que cette délégation de service public s'est accompagnée d'une hausse très préoccupante des tarifs de stationnement résidentiel, qui vont jusqu'à doubler par rapport aux anciens tarifs, souvent sans justification pertinente ni concertation citoyenne.
La dépénalisation des amendes, telle que prévue par la loi MAPTAM, impliquait-elle d'infliger à nos concitoyens une telle augmentation des tarifs, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois ? Est-il acceptable pour nos concitoyens, nos commerçants et nos artisans de devoir s'acquitter parfois de plus de 30 euros pour quelques heures seulement de stationnement ?
Les choix de ces collectivités en matière de stationnement sont très lourds de conséquences en termes de pouvoir d'achat bien sûr, d'emplois et de vie commerçante, mais aussi de mobilité. Je constate déjà, dans ma circonscription, un report du stationnement dans les villes voisines. Je vois également des habitants, jusqu'alors usagers des transports en commun, reprendre chaque jour leur voiture pour échapper à cette tarification perçue comme injuste, avec des effets très préoccupants en termes de congestion du trafic et de pollution, alors même que nous oeuvrons collectivement pour une mobilité plus propre.
Vécus par bon nombre de nos concitoyens comme un nouvel impôt et une marchandisation de l'espace public, ces choix politiques et tarifaires, certes municipaux, ne peuvent laisser indifférente la représentation nationale. Je souhaite donc savoir, madame la ministre, quelle est la position du Gouvernement sur ce qui s'apparente à un dévoiement de la loi MAPTAM et quelles actions il entend mener pour remédier à de telles situations.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Je voudrais vous rappeler, madame la députée – ainsi qu'à tous les collègues que vous avez associés à votre question ! – que la réforme du stationnement payant s'inscrit dans le cadre de la décentralisation et a d'ailleurs été mise en place à la demande des collectivités territoriales sous le précédent gouvernement. J'étais alors moi-même sénatrice et je me souviens très bien de la volonté exprimée par les élus de réformer le stationnement.
Ainsi, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, il appartient désormais à chaque commune ou intercommunalité qui a fait le choix d'appliquer cette réforme de définir les modalités de sa mise en oeuvre dans le cadre fixé par la loi. C'est vraiment là la liberté communale ou intercommunale qui s'applique.
En l'occurrence, conformément à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la collectivité doit établir par délibération d'une part le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement, et d'autre part le montant du forfait de post-stationnement, en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement. Chaque collectivité peut moduler ce barème et, notamment, prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents de la commune.
Au vu des éléments recueillis par les acteurs de la réforme, dont les associations d'élus, la majorité des collectivités n'ont pas augmenté le tarif des premières heures de stationnement par rapport aux grilles qu'elles appliquaient en 2017 pour une même durée de stationnement. Cependant, dans la mesure où le montant du forfait de post-stationnement correspond à la durée maximale de stationnement prévue, ces mêmes collectivités ont souvent décidé d'allonger la plage horaire du stationnement autorisé et ont fait évoluer en conséquence leur grille tarifaire, ce qui a pu susciter localement des réactions de la part des usagers.
Il est encore trop tôt pour tirer les enseignements d'une réforme entrée en vigueur voilà trois mois et demi et alors que plus de la moitié des quelque 530 collectivités qui ont déjà décidé de l'appliquer n'étaient pas opérationnelles début avril, faute d'avoir achevé leurs chantiers techniques – comme la mise à jour d'horodateurs.
Néanmoins, madame la députée, après vous avoir écoutée et au vu des premiers éléments qu'elles ont rendu publics, je sais que certaines villes constatent depuis le début de l'année une diminution du nombre de voitures ventouses, une plus grande facilité pour les automobilistes de trouver une place, une augmentation très sensible du paiement immédiat à l'horodateur, une hausse du nombre de demandes de cartes de stationnement pour les résidents et les professionnels et d'abonnements dans les parkings, et enfin une assez faible contestation à l'échelle nationale.
Le Gouvernement est attentif, madame la députée, à la situation que vous avez évoquée et nous regarderons de près les éléments liés à la situation de Montrouge.

Merci, madame la ministre, pour ces précisions. J'entends en effet que le principe de libre administration des collectivités s'applique et que chaque collectivité peut moduler ce barème et prévoir des tarifications spécifiques. J'entends également, et je m'en réjouis, que la majorité des collectivités n'ont pas augmenté ces tarifs.
Cependant, certaines villes affichent des augmentations très préoccupantes, ce qui crée des inégalités tout aussi préoccupantes entre territoires et entre villes voisines.

Le nombre de voitures ventouses diminue certes, mais le fait que certains de nos concitoyens reprennent leur véhicule pour se déplacer me semble aller à l'encontre des politiques de mobilité.

La parole est à M. Éric Pauget, pour exposer sa question, no 282, relative aux effectifs de police dans les Alpes-Maritimes.

Madame la ministre, ma question porte sur le problème récurrent du déficit d'effectifs de police nationale dans le département des Alpes-Maritimes, et tout particulièrement au sein des services de police des communes d'Antibes Juan-les-Pins et de Vallauris-Golfe-Juan.
Nous nous accordons tous, sur ces bancs, pour dire que la lutte contre toutes les formes de délinquance et de criminalité doit trouver une traduction concrète sur le terrain et se matérialiser par une dotation en effectifs appropriée : elle est la première mission régalienne de l'État.
Dans ma circonscription, les communes d'Antibes et de Vallauris sont confrontées depuis de nombreuses années à un problème de sous-effectif chronique par rapport à l'importance de leur bassin de population. Cette situation affecte bien entendu les conditions d'exercice des missions des policiers.
Concrètement, les chiffres fournis par votre ministère font état de l'arrivée, entre fin septembre et fin décembre 2017, d'un policier du corps d'encadrement et d'application et de cinq adjoints de sécurité au commissariat d'Antibes. Par ailleurs, on assiste depuis plusieurs années à une diminution régulière des effectifs du commissariat à Antibes Juan-les Pins pendant la saison touristique. Quant aux forces de sécurité CRS, elles n'officient plus que ponctuellement, au gré des événements, et non plus, comme c'était le cas par le passé, de façon permanente en été sur Juan-les-Pins.
Madame la ministre, les choix capacitaires opérés me semblent très insuffisants au regard du fort potentiel touristique de ces territoires qui voient leur population doubler pendant la période estivale. J'en veux pour preuve que cette situation conduit ces communes à déployer, en pleine saison, des forces de police municipale supplémentaires pour pallier cette carence.
Je souhaiterais donc que vous puissiez m'indiquer, dans un contexte budgétaire rendu encore plus contraint par la nouvelle contractualisation financière, les moyens que vous entendez mettre en oeuvre, notamment pendant la période touristique, pour répondre à ce problème de sous-effectif.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Songez à laisser un peu de marge à M. Pauget s'il veut vous répondre, madame la ministre…
Monsieur le député, comme vous le savez, les Alpes-Maritimes font partie des départements retenus dans le cadre de la politique de police de sécurité du quotidien – PSQ – pour la mise en oeuvre de « quartiers de reconquête républicaine » où seront concentrés des moyens et des matériels spécifiques. Dès janvier 2019, tel sera le cas notamment à Nice, dans les quartiers de L'Ariane et des Moulins.
Je sais, et vous l'avez rappelé, que sur le plan touristique, votre département est confronté à des enjeux de tout premier plan, comme, plus largement, ceux de la Côte d'Azur et du littoral varois. Il est également confronté à une immigration illégale importante, ainsi qu'au phénomène de radicalisation islamiste, je me permets de le dire.
C'est pourquoi les effectifs de police dans le département, qui sont à ce jour – au 31 mars 2018 – de 2 818 agents, pour tous services de police, vont très sensiblement augmenter dans les mois à venir : d'ici à la fin septembre, ils doivent en effet s'élever à 2 870.
Pour votre circonscription, qui couvre les villes d'Antibes et de Vallauris, les effectifs ont augmenté ces dernières années, passant de 191 fin 2015 à 196 à ce jour, dont 155 gradés et gardiens de la paix, soit un chiffre conforme à l'effectif cible. À ce stade des prévisions, avec cinq départs et une arrivée prévus, cet effectif devrait effectivement diminuer très légèrement, pour atteindre 192 agents fin septembre 2018. Sur le plan opérationnel, toutefois, il est cohérent avec les progrès enregistrés ces dernières années et la nécessité de conforter aussi d'autres commissariats de la région.
De surcroît, comme vous le savez, les effectifs ne sont pas figés : des renforts départementaux sont mobilisés chaque fois que nécessaire, notamment ceux de la compagnie départementale d'intervention et de la sûreté départementale, voire des forces mobiles. Je souligne aussi que cette circonscription de police bénéficie ponctuellement du renfort de la réserve civile, qui joue un rôle très important et permet d'accroître la capacité opérationnelle du commissariat.
Enfin, la sécurité durant la saison estivale constitue bien entendu un enjeu absolument majeur au regard de l'attractivité. Comme l'été dernier, les Alpes-Maritimes bénéficieront, en 2018, de CRS, notamment de nageurs sauveteurs, dont trois à Vallauris et deux à Villefranche.
Par ailleurs, deux compagnies républicaines de sécurité seront déployées dans les Alpes-Maritimes au titre des renforts saisonniers, soit, et c'est considérable, une compagnie de plus que l'an dernier. Je précise que le Var bénéficiera d'un renfort de même ampleur. Vos préoccupations de sécurité sont tout à fait légitimes, monsieur le député ; nous sommes là pour répondre aux besoins de tous les secteurs de notre pays.

J'ai une proposition à faire : puisque l'on constate que les communes littorales, notamment en milieu touristique, sont obligées de faire des efforts importants l'été en termes de police municipale, ne pourrait-on pas envisager un assouplissement du pacte financier sur cette thématique de la sécurité pour les communes qui font ces efforts ? Si je n'attends pas une réponse dès maintenant, je vous fais cette proposition, qui mérite d'être étudiée.

La parole est à Mme Sarah El Haïry, pour exposer sa question, no 287, relative aux vols de moutons.

Ma question, qui s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, porte sur le vol de moutons, en Loire-Atlantique en particulier, où les problématiques liées aux loups ne sont pas d'actualité puisqu'ils ne menacent pas nos bergeries. Cela n'empêche pas les éleveurs ovins de mon département de voir leurs brebis disparaître et de retrouver des carcasses de moutons dans les champs. En effet, depuis 2014, de nombreux éleveurs de Loire-Atlantique sont touchés par une recrudescence des vols de moutons, vols qui accentuent les difficultés de cette filière déjà en souffrance ; vols qui ont conduit certains d'entre eux à jeter l'éponge et à se reconvertir ; vols qui détournent des jeunes agriculteurs de ce beau mode d'élevage.
Ces vols, aux multiples conséquences, pénalisent les éleveurs à de nombreux égards. Ceux-ci ne peuvent plus s'assurer, puisque les assurances refusent de les couvrir sans mise en place de systèmes de surveillance exorbitants. Du fait de cet abandon, chaque vol représente une perte sèche pour les éleveurs. Ces vols appauvrissent les races de moutons, puisque les moutons volés sont souvent le fruit de sélections génétiques sur des années, voire des décennies.
L'État a failli à protéger ses éleveurs. Ces vols ont lieu en toute impunité, de jour comme de nuit. Un plan loup a été mis en place pour aider, protéger et indemniser les éleveurs victimes du loup à quatre pattes. Madame la ministre, que compte faire le Gouvernement pour protéger nos éleveurs des dommages causés par les loups à deux pattes qui sévissent en Loire-Atlantique, dommages qui ne sont pas moins importants ? Quelles actions pour que nos campagnes ne soient plus des zones de non-droit, pour que nos bergeries ne soient plus des zones en libre-service, où l'on peut impunément se servir ?
En 2017, plus de 200 moutons ont été officiellement volés dans mon département, sans compter les moutons volés chez des particuliers ou encore ceux qui n'ont pas été déclarés volés par peur des représailles. Oui, madame la ministre, certains agriculteurs en Loire-Atlantique ont peur de se déclarer victimes et même d'apparaître au sein d'une association qui vient de se créer pour se regrouper et se défendre.
Il y a peu de temps, M. le ministre de l'intérieur, avec votre collègue Jean-Michel Blanquer, proclamait : « Vive l'autorité républicaine ! » Mon département n'est pas le Far West, et j'aimerais savoir ce que l'autorité que vous représentez compte faire pour que les éleveurs ovins puissent travailler sereinement et sans peur.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Madame la députée, géographiquement isolées dans un espace rural très étendu, les exploitations et élevages agricoles peuvent présenter une certaine vulnérabilité face à une délinquance d'appropriation mobile et organisée – ce terme élégant dépeint la réalité de ce qui se passe dans notre territoire et que vous avez décrit.
Dans le cadre des directives ministérielles du 11 mars 2014, la gendarmerie nationale a mis en oeuvre soixante-dix-neuf plans départementaux dédiés à la sécurité des exploitations agricoles. Élaboré à partir d'un constat local partagé avec les différents représentants du monde agricole, chaque plan comporte une analyse criminelle mettant en exergue les phénomènes de délinquance dans le département, ainsi que les axes d'efforts à produire. Il prévoit différentes mesures préventives et répressives.
En premier lieu, ce plan permet un renforcement des échanges entre les forces de sécurité et le monde agricole. La mise en oeuvre des plans départementaux s'est traduite dans vingt-quatre groupements par la signature de conventions de partenariat avec les acteurs du monde agricole comme les chambres d'agriculture, la FNSEA – Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles – , etc.
Afin d'encourager les initiatives locales et de renforcer le partage d'informations, la direction générale de la gendarmerie nationale et la FNSEA ont signé une convention nationale ; parallèlement, soixante conventions établissant un dispositif d'alerte des agriculteurs par SMS ou par mail ont été signées entre les groupements de gendarmerie et les chambres d'agriculture. Ce dispositif SMS est présent en Loire-Atlantique, sous le nom AGRI 44, depuis décembre 2014 et concerne 121 acteurs. Il peut utilement relayer les messages de prévention face aux exactions commises à l'encontre des éleveurs de moutons afin de renforcer les vigilances.
Par ailleurs, les gendarmes peuvent également apporter un appui dans la mise en sûreté des exploitations et élevages. Les plans départementaux comportent des mesures visant à informer les exploitants agricoles sur les menaces et les mesures de protection, notamment par l'organisation de réunions publiques animées par les correspondants territoriaux prévention de la délinquance, qui dépendent de la gendarmerie.
Enfin, les référents et correspondants sûreté interviennent également au profit du monde agricole par la réalisation de diagnostics écrits ou de consultations orales de sûreté. Ils délivrent aux exploitants des préconisations humaines, organisationnelles et techniques, ciblées et adaptées aux sites, afin de renforcer la sécurité passive et de réduire le risque de malveillance dans les exploitations. Ainsi, sur l'année 2017, 191 diagnostics écrits et consultations orales de sûreté ont été réalisés au profit des exploitations agricoles les plus vulnérables, et soixante-quinze au profit des concessionnaires agricoles.
Vous l'avez compris, cet engagement au profit du monde agricole reste fort et ce, alors même que nos forces sont extrêmement sollicitées par d'autres sujets, comme vous le savez ; et, naturellement, la justice fait ensuite son travail.

La parole est à M. Paul Christophe, pour exposer sa question, no 294, relative à la prise en charge des mineurs non accompagnés.

Avec l'augmentation continue de l'arrivée et du besoin de prise en charge des mineurs non accompagnés, dits MNA, les départements connaissent une saturation des dispositifs de mise à l'abri. Les structures d'accueil nécessaires aux missions d'aide sociale à l'enfance ne permettent plus d'accueillir ces jeunes dans des conditions suffisantes de dignité et de sécurité.
Les mineurs non accompagnés ont des besoins bien différents des autres enfants accueillis en protection de l'enfance. On relève couramment un manque de maîtrise de la langue française, des problèmes de santé et des traumatismes liés aux événements vécus dans le pays d'origine ou pendant le parcours migratoire.
Cela nécessite une prise en charge spécifique. Les départements, dans leur grande majorité, réitèrent leur attachement à ce que les MNA bénéficient d'un accompagnement éducatif tout au long de leur prise en charge dans le cadre de la protection de l'enfance. Toutefois, la question migratoire relève de la responsabilité de l'État et implique donc sa participation à la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance.
À l'occasion du congrès de l'Assemblée des départements de France, le Premier ministre a confirmé son engagement sur la prise en charge de la période d'évaluation et de mise à l'abri des MNA, sans en indiquer pour autant les modalités opérationnelles de mise en oeuvre. Il a également évoqué une possible adaptation des dispositifs législatifs.
Je souhaiterais donc savoir comment le Gouvernement souhaite faire évoluer le dispositif législatif et l'accompagnement financier des départements au regard de sa compétence régalienne sur la question migratoire.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, le Gouvernement porte une attention particulière à la question des mineurs non accompagnés. La plupart du temps, vous l'avez vous-même rappelé, ces jeunes particulièrement vulnérables ont connu des expériences de vie traumatisantes et doivent être protégés, comme la convention internationale des droits de l'enfant nous y oblige.
Une mission bipartite, composée de l'Assemblée des départements de France, de l'Inspection générale des affaires sociales – c'est de ce ministère que dépendent les mineurs non accompagnés – , de l'Inspection générale de l'administration ainsi que de l'Inspection générale de la justice, a rendu un rapport étayé le 15 février 2018. Ce rapport dresse effectivement le constat d'une augmentation du nombre de personnes, des garçons principalement, demandant à être reconnues mineurs depuis l'été 2017 et du nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. La mission pointe également une diminution de l'âge de ces mineurs.
De nombreux départements sont aujourd'hui confrontés à des difficultés d'hébergement avant l'évaluation de minorité mais aussi d'accompagnement des personnes une fois qu'elles ont atteint l'âge de 18 ans. Les constats dressés par la mission sont partagés entre l'État et les départements.
Les solutions pour faire face à cet enjeu d'accueil et de protection des personnes sont de plusieurs ordres. Il faut lutter avec énergie et détermination, dans un cadre européen, contre les filières de passeurs qui instrumentalisent les enfants et leur font subir des traitements inhumains et dégradants.
Il faut ensuite harmoniser les procédures d'évaluation de la minorité, qui sont aujourd'hui trop disparates sur le territoire, y compris en ce qui concerne les délais d'évaluation. L'État s'est engagé à soutenir les départements dans cette phase. Il faudra aussi faire en sorte que les aspects sanitaires de l'évaluation soient davantage pris en considération.
Il faut augmenter les capacités d'hébergement en amont de l'évaluation de minorité et mieux soutenir les départements dans le financement de cet hébergement et de l'accompagnement social associé.
Il y a aussi une difficulté : la concentration de l'arrivée des mineurs au sein de quelques départements – les départements frontaliers et ceux comportant de grosses agglomérations. La question de la répartition géographique des personnes en amont de la phase d'évaluation et avant la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance départementale est donc posée dans le but de mieux accueillir ces mineurs non accompagnés.
Les scénarios proposés par la mission sont à l'étude et font l'objet d'échanges entre le Gouvernement et les départements. Quel que soit le scénario retenu, l'État prendra toute sa part dans la conduite de cette politique publique de protection des mineurs, en lien avec les départements. Je ne peux pas encore vous communiquer les conclusions des discussions car elles n'ont pas encore été rendues, mais sachez que le Gouvernement, avec l'Assemblée des départements de France, y travaille avec beaucoup de volonté politique.

Madame la ministre, je sais toute l'attention que vous portez à cette question importante pour notre territoire. Je souhaite ajouter que la clé de répartition proposée est contestable au regard des critères qui avaient été retenus, notamment la présence de jeunes de moins de 19 ans sur le territoire.
L'embolisation des services d'accueil de l'enfance pénalise les départements dans l'exécution de leurs missions d'aide sociale à l'enfance ; cela pose un vrai problème. Ces jeunes relèvent aussi d'un accompagnement un peu différent de ce que l'on a l'habitude de proposer dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ; les différentes remarques que nous venons d'échanger démontrent que nous sommes d'accord sur ce point.
Nous avons donc besoin d'un véritable accompagnement et d'un vrai partenariat entre l'État et les départements sur cette question ; c'est bien ce qui se dessine, et je m'en réjouis.

La parole est à M. Erwan Balanant, pour exposer sa question, no 289, relative au plan « Action coeur de ville ».

Je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur le plan Action coeur de ville. Ce plan, doté de 5 milliards d'euros sur cinq ans, a désigné les villes qui seraient attributaires des crédits nécessaires à la revitalisation de leurs centres. Cette action, que vous avez qualifiée comme étant « une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires, au service de leurs habitants », confirme l'attachement du Gouvernement au développement de territoires abritant 35 % de la population française.
Si nous ne pouvons que saluer votre initiative, je m'interroge sur la qualité des critères retenus puisque seules les communes ayant un « rayonnement régional » ou celles jouant un rôle de « centralité pour leur bassin de vie » sont éligibles au financement et semblent avoir été sélectionnées.
Dans le Finistère, Morlaix et Quimper font partie des 222 heureuses élues nationales et je les félicite. Le Finistère a d'importantes particularités : département du bout du monde, ou du début du monde, selon l'endroit où l'on se place, il a d'abord une spécificité agricole et agroalimentaire certes dynamique, mais aujourd'hui fragilisée ; un caractère péninsulaire appelant un effort d'avenir, sur lequel le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; et surtout un fort maillage de villes petites et moyennes, qui structurent le territoire – autant de caractéristiques qui m'amènent à vous interroger sur la situation de ces petites villes, qui ont le sentiment de n'appartenir à aucune catégorie éligible aux dispositifs de l'État : contrats de ruralité ou, en l'espèce plan Action coeur de ville.
Je prends ainsi l'exemple de deux villes qui me sont chères, Concarneau et Quimperlé qui possèdent un caractère éminemment central dans le développement économique du département, entre territoire maritime dynamique, territoire d'innovations, territoire d'équilibre, territoire durable ; autant de sources d'attractivités qu'il convient de préserver et d'alimenter.
Si les villes moyennes sont l'identité de notre pays et des moteurs de développement qui ont longtemps été négligés, est-il prévu, au cours des cinq années que recouvre le plan Action coeur de ville, de revoir ou de compléter la liste des villes attributaires des crédits ? Quelles actions comptez-vous engager pour ces petites et moyennes villes qui se sentent écartées du dispositif existant et dont les élus communaux et intercommunaux luttent chaque jour pour leur revitalisation ? Quels pourraient être les dispositifs et les moyens financiers pour accompagner ces villes dans leurs efforts salutaires ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, je réponds à votre question au nom du ministre de la cohésion des territoires.
Petite ville, ville moyenne, cela ne recouvre pas exactement la même chose selon les départements. Quand on compare une région comme la Bretagne et une autre du centre de la France, comme le Limousin, on sait qu'on n'a pas la même configuration. L'agglomération de Limoges représente 80 % de la population de la Haute-Vienne.
Je vous remercie pour le soutien que vous apportez au plan Action Coeur de Ville et je peux vous dire que les villes bretonnes qui ont été choisies en sont très satisfaites.
La France a la chance de pouvoir s'appuyer sur un maillage solide de villes moyennes, qui regroupent environ un quart de la population nationale et environ un quart également de l'emploi. Elles sont donc un véritable outil de redynamisation de notre pays et, par leur distribution sur l'ensemble du territoire national, un vrai levier de cohésion sociale et territoriale. L'ambition du plan Action Coeur de Ville, qui associe l'État, trois financeurs principaux qui sont la Caisse des dépôts et consignations, l'ANAH – Agence nationale de l'habitat – et Action logement, est de redynamiser durablement l'attractivité économique des coeurs de ces villes moyennes. Ce plan reprend le fil d'une tradition française vis-à-vis du réseau des villes moyennes qui ont un rôle déterminant d'équilibre et de cohésion du territoire, mais qui n'avaient pas fait l'objet d'un programme spécifique depuis 1974.
Action Coeur de Ville mobilise pour cela un montant de 5 milliards d'euros sur cinq ans. Les 222 villes sélectionnées se verront accompagnées financièrement et en ingénierie au niveau local pour faciliter les projets définis par les élus.
Par ailleurs, je souscris à votre analyse : des villes plus petites que des villes moyennes exercent des fonctions de centralité importantes, notamment lorsqu'elles se situent en zone peu dense.
Cependant, le plan Action Coeur de Ville n'a pas une vocation de dispositif urbain universel : il constitue pour les villes moyennes le pilier d'une politique d'ensemble, complémentaire d'autres actions de l'État pour conforter toutes les centralités qui maillent notre pays. Ainsi, le programme pour la revitalisation des centres-bourgs permet d'élaborer des stratégies de revitalisation pour 54 petites villes. De même, les 456 contrats de ruralité qui couvrent une part grandissante du territoire français incluent déjà des actions en faveur de la ville-centre. Le ministre de la cohésion des territoires veillera à l'harmonisation de l'ensemble de ces politiques.

La parole est à M. Christophe Lejeune, pour exposer sa question, no 270, relative au projet de maison d'arrêt à Lure.

Madame la ministre de la justice, garde des sceaux, lors de son discours devant la Cour de cassation, le Président de la République a demandé " un plan pénitentiaire global ", portant notamment sur l'immobilier des prisons.
La construction d'une nouvelle maison d'arrêt à Lure, sous-préfecture de la Haute-Saône, avait été annoncée par la garde des sceaux Christiane Taubira, et confirmée en septembre 2015 par le Président de la République François Hollande. Le dossier de faisabilité est d'ailleurs bien avancé et symbolise la continuité de la parole de l'État. L'ancienne prison est quasiment démolie. Sa vétusté ne permettait plus au personnel de l'administration pénitentiaire et aux détenus d'y séjourner dans des conditions satisfaisantes de sécurité.
Ce projet immobilier rassemble autour de lui l'ensemble des élus, des institutionnels et des habitants du territoire. Cette maison d'arrêt, initialement prévue pour 150 détenus, pourrait en accueillir davantage. La proposition de créer un centre de détention de 150 places supplémentaires a d'ailleurs été faite, ce type d'établissement n'existant pas en Franche-Comté.
Le traitement de la psychiatrie, question récurrente dans le milieu carcéral, pourrait s'appuyer sur une structure hospitalière départementale spécialisée très importante, l'association hospitalière Bourgogne-Franche-Comté-Saint-Rémy-Clairefontaine. De même, pour préparer la réinsertion des détenus, le tissu industriel et l'important massif forestier, en recherche constante de main-d'oeuvre, peuvent leur offrir une activité professionnelle de proximité suffisante pour maintenir le lien social. C'est donc un projet global qui se construit autour de cette nouvelle maison d'arrêt. J'en profite pour remercier les services de l'État qui oeuvrent depuis presque trois ans à l'aboutissement de ce dossier.
Madame la ministre, le projet de nouvelle maison d'arrêt de Lure figurera-t-il dans votre plan prisons ?
Monsieur le député, depuis plusieurs mois, des recherches foncières ont été engagées en vue de construire de nouveaux établissements pénitentiaires, afin notamment de réduire la très importante surpopulation carcérale en maison d'arrêt, qui dégrade la prise en charge des personnes détenues et les conditions de travail des personnels. Comme l'a rappelé récemment le Président de la République, 7 000 places supplémentaires seront ainsi créées d'ici à la fin du quinquennat. Dans cette perspective, des études de faisabilité ont été réalisées ou sont en cours partout où des terrains ont été proposés, et les investigations se poursuivent là où elles n'ont pas encore pu aboutir.
La priorisation de l'implantation des nouveaux établissements sera fonction de la nécessité de répondre aux besoins pénitentiaires les plus importants, des ressources budgétaires et du délai de réalisation des opérations. Elle devra tenir compte également de la nouvelle politique pénitentiaire annoncée par le Président de la République à Agen le 6 mars dernier. Cette priorisation sera également liée à la nécessité d'avoir des établissements adaptés aux différents types de détenus que nous devons accueillir dans ces établissements et j'ai bien noté, monsieur le député, que vous insistiez sur les problèmes psychiatriques que présentent un certain nombre de détenus.
Comme vous le savez, la programmation immobilière sera arrêtée dans le cadre du projet de loi de programmation pour la justice en cours de finalisation. Vous comprendrez donc que je ne puisse pas me prononcer aujourd'hui précisément sur telle ou telle opération mais je serai amenée à me présenter devant vous pour vous proposer les options que nous souhaitons retenir très prochainement, au moment de la présentation du projet de loi.

La parole est à Mme Danièle Obono, pour exposer sa question, no 264, relative à la santé mentale des personnes incarcérées.

Madame la ministre de la justice, vingt-quatre ans après la réforme de la santé en prison, il apparaît que de nombreux dysfonctionnements, parfois très graves, persistent ou se sont intensifiés. À cela s'ajoute l'accroissement continu de la population incarcérée. Si le récent mouvement des personnels de surveillance des prisons a fait connaître au grand public leur situation particulière, elles et ils ne sont pas les seuls à alerter sur la profonde dégradation des conditions de vie en prison, notamment sur la question de la santé.
Je ne vous parle pas là seulement de l'hygiène impossible avec la douche hebdomadaire, des invasions de nuisibles – rats, puces, poux, punaises – ou de la vétusté du bâti, qui a conduit à ce que plusieurs plaintes soient déposées contre la France pour traitement dégradant jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous parle de la santé physiologique où le ou la surveillante et les antalgiques remplacent des personnels spécialisés croulant sous le nombre de patients et patientes et de pathologies, menant une médecine d'urgence dans des conditions d'exercice insupportables.
Je vous parle de la santé mentale, quasiment absente des programmes de formation des surveillantes et surveillants, jugez-en : six heures sur l'ensemble du cursus ! Les agentes et agents sont démunis alors qu'ils sont en première ligne des accès de démence qui sont autant d'insécurité et cause de tant d'agressions entre détenus et à l'encontre des personnels. Les chiffres sont parlants : 20 % des personnes incarcérées sont atteintes de troubles psychotiques, huit hommes détenus sur dix présentent au moins un trouble psychiatrique.
Je vous parle enfin de l'absence de protocole dans la lutte contre la dite « radicalisation » en milieu carcéral, alors que vous vous apprêtez à ouvrir 1 500 places « étanches » pour ces détenus, alors que les binômes éducateurs-agents de probation intervenant au sein des quartiers d'évaluation de la radicalisation n'ont à ce jour aucune formation psychologique ou clinique et interviennent trop souvent sans concertation avec les équipes médicales.
Je voudrais aujourd'hui porter ici la voix de tous ces personnels qui exercent une mission indispensable de service public, parmi les plus difficiles et les moins gratifiantes. Je veux également réaffirmer la dignité à laquelle chaque citoyenne et chaque citoyen a droit au sein de notre République, y compris lorsqu'elles ou ils sont en détention.
Ma question sera donc simple : que comptez-vous faire concrètement, madame la ministre, pour mettre un terme à la déshérence sanitaire qui règne au sein de nos prisons et répondre à cette question urgente de la santé dans nos établissements carcéraux ?
Madame la députée, vous soulevez une question à laquelle j'attache la plus grande importance.
Depuis la loi du 18 janvier 1994, la prise en charge sanitaire des personnes incarcérées est assurée par le service public hospitalier. Il existe de réels besoins en ce domaine, je m'en aperçois régulièrement lorsque je me rends dans les établissements pénitentiaires. La population accueillie en milieu carcéral cumule en effet des besoins de santé importants liés à ses caractéristiques sociodémographiques et à une prévalence élevée des maladies psychiatriques et des addictions. Des initiatives ont été prises par le ministère de la justice pour soutenir le recueil de données à l'entrée en détention par l'intermédiaire des observatoires régionaux de la santé.
Le ministère de la justice est très investi dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022 pour prendre en considération les besoins des détenus. Plusieurs mesures ont été adoptées au bénéfice des personnes placées sous main de justice. Une enquête de prévalence des différents troubles mentaux doit être réalisée en population générale avec un volet détention afin d'évaluer notamment le nombre de personnes présentant des troubles de santé mentale à leur entrée en détention, de généraliser le recueil de ces données au niveau régional par l'intermédiaire des observatoires régionaux de la santé.
Avec ma collègue Agnès Buzyn nous allons également déployer des modalités supplémentaires de prise en charge des détenus présentant une fragilité psychologique.
Nous souhaitons également renforcer la continuité de la prise en charge à la sortie par trois mesures : le renforcement du lien avec les secteurs de psychiatrie et la médecine de ville, en particulier en lien avec les centres médico-psychologiques ; le développement du recours aux aménagements de peine pour raison médicale, aujourd'hui sous-utilisés. La direction de l'administration pénitentiaire a piloté l'élaboration d'un guide méthodologique à destination des professionnels relatif aux aménagements de peine et à la mise en liberté pour raison médicale, élaboré avec la direction des affaires criminelles et des grâces et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que le ministère des solidarités et de la santé.
Nous souhaitons enfin développer l'accès à l'hébergement et au logement des personnes atteintes d'une pathologie mentale, par une meilleure coordination avec les acteurs du logement, les services intégrés d'accueil et d'orientation, les directions départementales de la cohésion sociale, les partenaires associatifs, qui nous appuient dans l'élaboration de ce dispositif.
Votre commission des lois a examiné cette question et je remercie tout particulièrement le député Stéphane Mazars pour la qualité des travaux qui ont été menés dans ce cadre. Je suis sûre que nous aurons un débat à ce sujet lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la justice.

La parole est à M. François Ruffin, pour exposer sa question, no 265, relative à la cour d'appel d'Amiens.

Madame la ministre, un auteur de mon coin, Francis Demarcy, écrit : « Entre le Nord qui ferme ses usines et Paris qui ferme son coeur, il y a la Picardie qui ferme sa gueule. » La Picardie ferme aussi ses usines – Goodyear, Whirlpool, Honeywell, Magneti Marelli, Flodor – , mais à ce choc industriel s'est ajouté un choc symbolique. Avec la fusion des régions, le nom de Picardie a disparu, rayé d'un trait de plume depuis Paris, avec mépris. Sans doute plus concret, moins sentimental, le choc administratif : le conseil régional s'est déplacé d'Amiens à Lille ; à sa suite, bien des services de l'État sont partis, notamment l'agence régionale de santé, et derrière, les sièges régionaux des grandes entreprises comme la Caisse d'épargne, mais aussi d'importantes associations comme la Ligue de football. Tout cela a une double conséquence : la perte d'emplois et l'éloignement des services. D'où ma question, madame la ministre : comptez-vous poursuivre dans cette droite ligne et enfoncer une impression d'abandon en supprimant ou en réduisant la cour d'appel d'Amiens ?
Vous avez voulu rassurer, déclarant : « Il y aura toujours de l'appel à Amiens ». Mais à vrai dire, ça a plutôt inquiété : que signifiait le partitif « de l'appel » au lieu de « une cour d'appel » tout simplement ? Vous disiez « de l'appel » comme on dit « du pain », et il semblait donc bien qu'il n'en resterait qu'un bout. Comme, à l'occasion de votre visite dans le coin, avocats et magistrats insistaient, vous avez confirmé, un peu agacée : « Nous ne fermerons aucun lieu de justice. » Et en même temps, vous ajoutiez qu'Amiens devrait s'entendre avec Douai, dans le Nord, pour répartir les contentieux spécialisés. Comprenez qu'on se méfie, madame la ministre : des entourloupes, on nous en a trop fait, à l'endroit et à l'envers. Vos formules ressemblent à celles d'un directeur de La Poste qui vient rassurer le maire du bourg : « Vous en aurez toujours, de la poste » – et on se retrouve avec un relais postal chez le boucher… Pourriez-vous donc, simplement et sans fioriture, énoncer cette phrase qui lèverait tout doute, toute ambiguïté : « La cour d'appel d'Amiens sera maintenue avec le même périmètre et le même volume de contentieux » ?
Monsieur le député Ruffin, vos désirs sont des ordres : la cour d'appel d'Amiens sera maintenue avec sa compétence, son périmètre – et ses juges, cela va de soi. Plus sérieusement, monsieur le député, conformément aux engagements pris par le Gouvernement et que j'ai réitérés à maintes reprises, je vous le redis aujourd'hui : le projet de loi de programmation pour la justice que j'aurai le plaisir de vous présenter ne comportera la fermeture d'aucun lieu de justice ni tribunal, qu'il s'agisse des tribunaux d'instance, des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Toutes les cours d'appel seront donc maintenues, et celle d'Amiens en particulier.
Pour les cours d'appel, le projet de loi proposera la conduite d'une expérimentation, localisée dans deux régions administratives qui comportent plusieurs cours d'appel. J'ai souhaité cette expérimentation car je ne veux pas, pour l'appel comme pour le reste, imposer, depuis Paris, des décisions qui iraient contre le ressenti du terrain. L'expérimentation proposée consistera à conférer à des chefs de cour des fonctions d'animation et de coordination sur un ressort étendu à celui de plusieurs cours d'appel au sein d'une région, afin d'améliorer le service rendu aux justiciables et d'assurer la cohérence de l'action du service public de la justice, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Elle permettra de spécialiser, dans certaines matières civiles, selon les spécificités locales, des cours d'appel au sein d'une région, pour une jurisprudence plus homogène et plus prévisible. Aucun choix n'a encore été fait sur les cours d'appel qui pourraient expérimenter ces nouvelles mesures, mais même dans ce cadre, aucune cour d'appel ne sera supprimée.
S'agissant du cas particulier d'Amiens sur lequel vous m'interrogez, j'irai beaucoup plus loin encore en vous réaffirmant que non seulement la cour d'appel sera maintenue, mais qu'en outre sa compétence sera renforcée. En effet, dans le cadre de la réforme des juridictions sociales engagée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, il était prévu qu'une cour d'appel serait compétente à compter du 1er janvier 2019 pour toute la France pour connaître du contentieux tarifaire de la Sécurité sociale qui relevait jusqu'à présent de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Or le décret du 5 janvier 2017 est déjà venu désigner la cour d'appel d'Amiens pour exercer cette compétence nationale. Donc non seulement cette cour subsistera-t-elle dans l'ensemble de ses compétences, mais elle aura cette compétence nationale supplémentaire.

Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse qui, je suis confiant, sera suivie d'effet. Pour ce qui est des expérimentations, je ne sais si elles auront lieu dans mon coin ou non, mais j'espère qu'on demandera aussi l'avis des cobayes !

La parole est à M. Alain Bruneel, pour exposer sa question, no 267, relative aux tribunaux de Douai.

Madame la ministre, la semaine dernière, dans cet hémicycle, j'ai eu l'occasion de demander au Gouvernement s'il entendait la colère des Français, et notamment celle des métiers de la justice. Sans prétention aucune, je n'ai pas eu de réponse à la hauteur de ma question. Pourtant dans l'ensemble des juridictions, la colère est toujours aussi forte. Avocats, magistrats, greffiers, personnels administratifs : tous plaident contre la réforme annoncée de la justice. Les conclusions rendues dans le cadre des chantiers de la justice préconisent de nouvelles méthodes de travail cherchant, je cite, à garantir « un maillage de la justice irriguant l'ensemble des territoires, une organisation géographique plus lisible et un meilleur accès au droit et au juge ». À la lecture du projet de loi de programmation pour la justice, j'y vois plutôt un effondrement du système juridictionnel au détriment, encore une fois, des justiciables et des territoires les plus fragiles.
Certes, à propos des tribunaux d'instance et de grande instance, vous n'employez pas le terme de fermeture, lui préférant celui de fusion. Or les tribunaux d'instance sont des juridictions de proximité, rapides, clairement identifiées et proches des justiciables. Ces futurs lieux, vidés de leurs compétences premières, deviendront des « super-tribunaux », mais sans avoir pour autant plus de moyens ni d'effectifs. Vous proposez également la dématérialisation. Le règlement des petits litiges sera totalement déshumanisé et se passera parfois sans audience, sans aucune possibilité d'avoir accès au juge. Aujourd'hui, les tribunaux d'instance ont des délais de traitement de six mois contre quinze mois dans les tribunaux de grande instance, et un taux d'appel de 6 % seulement. Alors ma question sera simple : pourquoi s'en prendre à ce qui fonctionne ?
Autre point de désaccord, la spécialisation des tribunaux et des cours d'appel pouvant intervenir à n'importe quel moment par décret, après avis des chefs de cour. Pour étayer mon propos, je prendrai l'exemple d'un couple entamant une procédure de divorce à Douai, mais qui, pour le traitement de la liquidation de leur communauté de vie, devra peut-être aller à Dunkerque ou dans une autre ville pour s'adresser à un tribunal spécialisé en la matière. Pardonnez-moi, madame la ministre, mais je n'y vois ni simplification ni proximité pour les justiciables.
Monsieur le député, je voudrais brièvement réaffirmer ici mon ambition pour la justice, qui sera le fil rouge de la loi de programmation. Il s'agit de garantir une justice à la fois plus proche, plus efficace et plus rapide pour les justiciables – qui se trouvent au centre de toute la réforme. C'est pourquoi je répète devant vous, monsieur le député, que tous les tribunaux d'instance seront maintenus dans le plein exercice de leurs compétences, qui sera garanti par décret, avec affectation correspondante de magistrats. Cela montre notre volonté de garantir la proximité de la justice pour le justiciable. Les tribunaux de grande instance seront également maintenus dans le plein exercice de leurs compétences. Simplement, dans les départements où il y en a plusieurs, si des chefs de cour souhaitent répartir les compétences spécialisées de façon à réaliser un maillage équilibré sur le territoire, nous pourrons examiner ces propositions de terrain. Attention, je ne parle pas du divorce, mais de compétences de faible volume, très complexes et très techniques. Il n'y a là rien qui éloigne le justiciable de ses juges ; au contraire, cette possibilité doit rendre la justice plus rapide et plus efficace, vu que les affaires seront traitées par des magistrats parfaitement au fait des dossiers.
Enfin, monsieur le député, je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous êtes opposé à la numérisation de la justice, processus qui touche l'ensemble des administrations. Là encore, il s'agit, non d'éloigner le justiciable, mais au contraire de rendre la justice plus accessible en permettant aux professionnels du droit et aux citoyens d'accéder partout à leur dossier en ligne, et en accélérant le traitement des affaires. Il ne faut pas diaboliser chacune des mesures qui seront proposées, mais en mesurer l'impact exact. Or cet impact est construit à l'aune du justiciable et des exigences que celui-ci est en droit d'avoir envers le service public de la justice.

J'ai bien entendu votre réponse, madame la ministre, mais permettez-que mes craintes demeurent. La dématérialisation peut supprimer le contact humain avec le justiciable et ce que vous proposez – mais j'ai peut-être mal compris – me semble éloigner de plus en plus le citoyen de la justice. La spécialisation peut également être facteur d'éloignement, surtout dans un département aussi grand que celui du Nord.

La parole est à M. Christophe Jerretie, pour exposer sa question, no 269, relative à l'avenir des établissements de l'ex-GIAT Industries à Tulle.

Madame la secrétaire d'État, je me permets d'appeler l'attention de la ministre des armées sur l'avenir de plusieurs sites industriels de la ville de Tulle, qui produisent dans le domaine de la défense. L'ancienne Manufacture nationale d'armes de Tulle abrite trois établissements industriels : Nexter Mechanics, le Pôle Graphique et un détachement de la 13e base de soutien du matériel. Ces sites d'armement historiques ont connu, ces dernières années, des évolutions en matière d'effectifs, d'efficacité et de problématique ; ils ont fait l'objet d'annonces de restructuration, voire de dissolution. Les trois établissements ont une histoire, ils sont importants pour la commune de Tulle : il s'agit d'emplois, mais aussi de la vie au coeur d'un bassin. Aujourd'hui, certains font face à une disparition programmée, d'autres à la nécessité d'une consolidation. Il faut faire la lumière sur la situation de ces trois sites qui dépendent du ministère de la défense et de ses commandes. La ville de Tulle a été retenue pour le plan Action coeur de ville, qui exige que l'on porte une attention particulière aux aspects économique et historique.
J'aimerais avoir des précisions quant à ces trois sites : quel est l'avenir du Pôle Graphique qui dépend de votre ministère, du détachement de la 13e base de soutien du matériel et de Nexter Mechanics dont l'ancien ministre de la défense, aujourd'hui ministre des affaires étrangères, M. Le Drian, avait évoqué la consolidation ? Je vous propose d'en débattre et j'attends vos éclaircissements.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées.
Monsieur le député, vous m'interrogez sur l'avenir des différentes emprises qui dépendent du ministère des armées ou qui sont indirectement liées au monde de la défense, en Corrèze et plus spécifiquement à Tulle. Vous l'avez indiqué, la Corrèze est une terre d'accueil pour les organismes de la défense, et elle le restera. Comme vous le rappeliez, la 13e base de soutien du matériel terrestre est implantée à Tulle. Cette base est un acteur logistique et industriel majeur pour l'armée de terre, et se trouve en première ligne pour accompagner la remontée capacitaire de la force terrestre suivant les objectifs de maintien en condition opérationnelle d'ici à 2025. Le site de Tulle est spécifiquement chargé de l'appui études et ingénierie au profit de l'ensemble des unités de maintenance terrestre.
Le projet de loi de programmation militaire, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale à une large majorité, consacre une augmentation sans précédent des crédits liés au maintien en condition opérationnelle et à l'entretien programmé du matériel. Cette augmentation garantira la régénération des matériels et un niveau de disponibilité suffisant des équipements et des véhicules. Ainsi 22 milliards d'euros y seront-ils consacrés sur la période 2019-2023, soit 4,4 milliards d'euros par an en moyenne. C'est un effort supplémentaire important. Pour relever ce défi, nous comptons sur l'ensemble des compétences qui servent à la 13e base de soutien du matériel : j'en veux pour preuve le fait que celle-ci a recruté en 2017 et le fera également en 2018.
La situation du Pôle Graphique de Tulle, lequel n'a pas le même objet, n'est pas du tout la même. Ce pôle a été créé en 2004 pour compenser un plan de restructuration de GIAT Industries, et accompagner de manière individuelle chacun de ses agents. À l'heure actuelle, 41 agents y travaillent. Grâce à leurs compétences, ils produisent de très nombreux supports de communication pour l'administration centrale du ministère, recouvrant toute la chaîne de l'industrie graphique : composition, impression, finition et diffusion. Pour prendre un exemple, c'est le Pôle Graphique de Tulle qui a édité la Revue stratégique de défense de 2017 – que vous avez tous lue, je n'en doute pas !
L'inscription de ce pôle, en décembre 2017, sur la liste des entités restructurées, a provoqué une incompréhension et une vive émotion en matière de ressources humaines. Dans les faits, il s'agissait simplement de permettre à ceux qui partaient en retraite, notamment parmi les ouvriers d'État, de bénéficier de l'indemnité de départ volontaire. Le ministère n'a pas l'intention de se priver de cette capacité de production dont il a besoin. Sur le long terme, du fait de la pyramide des âges, un certain nombre de départs en retraite est prévu. Un projet d'établissement sera élaboré afin de définir une stratégie pour ce site : ses conclusions sont attendues pour la fin de l'année au plus tard.
J'en viens au troisième site, celui de Nexter Mechanics. Il me semble que l'investissement qui sera réalisé en matière d'équipements par le groupe Nexter, qui est notre partenaire industriel, au cours de la période couverte par la future loi de programmation militaire, est de nature à répondre à vos interrogations. Pour prendre un exemple, le 12 février dernier, la ministre des armées a annoncé…

Il faut conclure, madame la secrétaire d'État, si vous voulez que M. Jerretie puisse reprendre la parole.
… l'attribution d'un contrat qui permettra à Nexter de poursuivre son activité.

La parole est à M. Christophe Jerretie. Monsieur le député, il ne vous reste que treize secondes !

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, pour la justesse de vos propos. Vous avez bien différencié les trois sites. Nous suivrons avec attention l'évolution – que nous espérons favorable – des mesures que vous avez annoncées.

La parole est à Mme Marine Le Pen, pour exposer sa question, no 296, relative aux soldats blessés en opération.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, lorsque j'ai déposé cette question, il y a quelques semaines, je ne savais pas qu'elle serait – hélas – autant d'actualité. Nous avons en effet appris ce week-end que plusieurs soldats français ont été blessés au Mali dans une attaque menée contre les camps de la force Barkhane et de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies – MINUSMA. Ces blessés viennent s'ajouter à ceux des mois derniers.
Les morts en opération sont connus, et à juste titre médiatisés, notamment avec l'hommage organisé sur le pont Alexandre-III, qui permet de saluer l'engagement de ces hommes et femmes qui ont choisi de servir la France sous les drapeaux, et de rappeler à nos compatriotes l'importance des missions qu'ils remplissent sur les différents théâtres d'opérations. Toutefois les blessés sont, eux, quasiment passés sous silence ; en tout cas, ils sont rarement évoqués dans cet hémicycle.
Le rapport annuel du Haut comité d'évaluation de la condition militaire, paru en décembre 2017, rappelle qu'entre 2007 et 2016 plus de 600 soldats ont été blessés physiquement. À ce chiffre, il faut ajouter les blessures psychologiques, plus difficiles à détecter, qui peuvent apparaître plusieurs mois après le fait générateur. Certains blessés peuvent espérer retrouver un jour toutes leurs facultés ; mais ceux qui souffrent de graves blessures en garderont toute leur vie des séquelles.
Qu'ils soient atteints physiquement ou psychologiquement, ils méritent une attention toute particulière de la nation, car c'est bien pour elle qu'ils ont été blessés. C'est pourquoi je souhaite connaître le nombre de blessés en opération depuis un an. Ce nombre est-il, comme le rapportent certaines sources, en augmentation ? Je voudrais aussi avoir des éléments précis sur la nature et la gravité des blessures.
Je souhaite par ailleurs avoir des éléments sur les dispositifs mis en place par le ministère des armées pour prendre en charge ces blessés – dispositifs de soins, dispositifs de suivi à court et à moyen termes et dispositifs de réinsertion – que ce soit au sein de l'institution militaire ou dans le monde civil. Enfin je souhaiterais savoir si des accompagnements existent pour les familles de ces blessés.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées.
Madame la députée, vous avez raison : l'actualité nous oblige à accorder une attention toute particulière à nos militaires blessés. Sur tous les terrains d'opérations nos armées sont exposées à des risques importants. Le ministère des armées prend en charge cette question importante de façon très consciencieuse, avec beaucoup d'engagement.
L'évaluation du nombre de blessés et de malades en service est coordonnée par le service de santé des armées. Celui-ci donne les chiffres suivants pour l'année 2017 : 28 militaires ont été blessés en opération extérieure par arme à feu ou engin explosif, et 226 troubles psychiques en relation avec un événement traumatisant ont été déclarés. Ces chiffres sont sensiblement inférieurs à ceux constatés les années antérieures. Cette tendance est liée à l'évolution du niveau et de la nature des engagements des armées sur les théâtres d'opérations.
S'agissant des troubles psychiques post-traumatiques, il faut rester vigilant. Il est beaucoup plus délicat, à ce sujet, de parler de tendance puisque – comme vous le savez – ces blessures ont pour particularité de pouvoir apparaître à distance de l'événement traumatisant.
La prise en charge des blessés et des malades fait l'objet d'un suivi individualisé qui mobilise de nombreux acteurs afin de permettre une parfaite réhabilitation et réinsertion à chacun des blessés, quelle que soit l'origine ou les circonstances de la blessure – opérations extérieures, opérations intérieures ou autres.
Premièrement, les femmes et les hommes du service de santé des armées prennent en charge nos blessés directement sur les théâtres d'opérations, au plus près du lieu des blessures, au contact des combats s'il le faut. Ils sont les premiers maillons d'une chaîne médicale opérationnelle complète et autonome qui permet d'assurer à nos militaires les meilleures chances de survie avec un minimum de séquelles. De très nombreuses actions de prévention sont menées, notamment pour les syndromes psychiques, avec la présence de psychiatres sur les théâtres d'opérations, pour prévenir les difficultés.
Deuxièmement, que la blessure soit physique ou psychique, le parcours du blessé se poursuit sur le territoire national jusqu'à la réinsertion complète et définitive de nos blessés, en coordination avec le service public de santé. Les armées, par le biais du service de santé des armées aussi bien que des cellules d'aide aux blessés propres à chaque armée, proposent un parcours de reconstruction individualisé.
Troisièmement, l'Action sociale des armées offre un accompagnement psycho-social à tous les militaires blessés et leurs familles, comme aux familles endeuillées. Quatrièmement, l'Agence de reconversion de la défense développe une offre de services adaptée aux blessés : formation, évaluation des compétences, aide à l'insertion dans le civil. Cinquièmement, la Délégation nationale handicap accompagne le blessé s'il est recruté comme personnel civil au sein du ministère des armées, qu'il soit en situation de handicap physique ou psychique.

Madame la secrétaire d'État, si vous voulez laisser à Mme Le Pen la possibilité de vous répondre, il faut vous arrêter là.
Enfin, l'Office national des anciens combattants intervient quand les blessés sont sortis du monde militaire proprement dit et les suit sur une longue durée.

La parole est à Mme Bérengère Poletti, pour exposer sa question, no 283, relative aux centres hospitaliers dans les Ardennes.

Monsieur le président, j'aurais aimé que Mme la ministre de la santé réponde à cette question qui relève en effet pleinement de ses compétences. Même si j'ai beaucoup de respect pour vous, madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées, qui est chargée des anciens combattants, je ne trouve pas cela très adapté.
Madame la secrétaire d'État, il va devenir difficile – voire impossible – d'offrir aux Ardennais, comme aux habitants de tous les territoires ruraux ou à faible densité urbaine, la même qualité de soins que partout ailleurs en France. Notre pays était fier, à juste titre, de cette qualité de soins. L'espérance de vie était et est encore aujourd'hui à la hauteur. Mais cela durera-t-il ?
À l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières, la communauté médicale et paramédicale s'est déjà pliée à plusieurs reprises aux contraintes d'un plan de retour à l'équilibre. Beaucoup d'efforts ont été faits, et la souffrance et l'incompréhension des soignants sont à leur paroxysme. De surcroît, les effets pervers de la tarification à l'activité se font sentir partout, notamment lorsque cette tarification intervient seule, et les plus petites structures hospitalières en France sont les plus touchées.
Cet établissement hospitalier est déjà confronté à de multiples contraintes structurelles, et la perspective d'un nouveau plan de suppressions de lits et de compression du personnel fait redouter une aggravation de sa situation. Il souffre d'une démographie médicale à la peine, avec l'obligation de recourir à des médecins mercenaires, ce qui affecte lourdement le budget des établissements hospitaliers. Par ailleurs la densité de population ne permet pas de contrebalancer le manque à gagner lié à la baisse des tarifs des actes médicaux. Enfin, la situation sociale du département est difficile : depuis des années, le taux de chômeurs et de bénéficiaires des minima sociaux y est supérieur aux moyennes nationales. Dans ce contexte, le moindre effort supplémentaire dégrade l'attractivité de l'établissement, et aggrave par là sa situation budgétaire.
Pour l'année 2018, un résultat déficitaire de 5,4 millions d'euros est prévu. Il en va de même pour l'hôpital psychiatrique Bélair, où l'impact social n'a pas été pris en compte par l'agence régionale de santé. C'est pourquoi je vous demande d'apporter toute votre attention à ces deux établissements de santé de Charleville-Mézières, au-delà des contingences politiciennes. J'associe à ma question mon collègue Pierre Cordier.
Madame la secrétaire d'État, l'État doit assurer l'égalité d'accès à des soins de qualité. Pour cela, il faut trouver un équilibre, accorder des compensations. Qu'entendez-vous faire, en termes budgétaires, pour ces deux établissements ardennais ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées.
Madame la députée, je vous prie d'excuser Mme la ministre chargée de la santé, Agnès Buzyn. Si cela peut vous rassurer, néanmoins, sachez que je connais un peu les questions relatives à la santé, puisque je suis moi-même médecin.
Le plan de performance dont vous parlez poursuit un objectif clair et simple : garantir une offre de santé pérenne, sûre et de qualité, répondant aux besoins de la population du nord des Ardennes. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de mieux répartir les activités des établissements de ce territoire, en développant des filières de soins territorialisées, dans le cadre d'un plan d'actions intégrant tous les champs de la santé.
En fonction des besoins, l'ARS de la région Grand Est s'engage à soutenir financièrement les plans d'investissements des établissements avec une enveloppe comprise entre 10 et 20 millions d'euros. Elle a déjà acté le financement de la reconstruction du service central de stérilisation du centre hospitalier de Manchester, à hauteur de presque 5 millions d'euros. Enfin, en janvier 2018, elle a soutenu la trésorerie du centre hospitalier de Sedan à hauteur de 3 millions d'euros.
Nous partageons le constat des établissements dont vous avez parlé : il est difficile de recruter des médecins hospitaliers sur ce territoire des Ardennes. Mais il faut reconnaître que c'est un peu le cas dans toute la France ! La faculté de médecine de Reims, les centres hospitaliers de Charleville et de Sedan et l'ARS Grand Est mettent en oeuvre des actions concrètes pour faire face à cette pénurie, dans le cadre de la convention hospitalo-universitaire du groupement hospitalier de territoire. Il s'agit notamment de créer et de financer des postes d'assistants partagés entre le centre hospitalier universitaire de Reims et les équipes de pôle du territoire Nord Ardennes.
Des besoins non couverts ont d'ores et déjà été identifiés par l'ARS Grand Est : la politique vaccinale, l'accompagnement des troubles psychiques, le sanitaire – avec l'hospitalisation à domicile, les soins de suite et de rééducation, la plate-forme d'appui territoriale – et le médico-social.
Parmi les départements de la région Grand Est, le département des Ardennes présente le taux de suicide par habitant le plus élevé. Nous y sommes, bien sûr, très attentifs. À partir de ce constat, il est prévu de formaliser en 2018 un plan départemental de santé mentale, en s'appuyant sur l'expertise du centre hospitalier psychiatrique de Bélair et de l'important réseau associatif qui existe dans ce domaine, et en suivant une méthodologie de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, l'ANAP.
Comme vous pouvez le constater, la ministre des solidarités et de la santé ainsi que l'ARS sont particulièrement engagées pour votre territoire. Les difficultés liées à la tarification à l'activité, dont vous avez parlé, sont une réalité : il en sera tenu compte dans les semaines et les mois à venir.

Madame la secrétaire d'État, je n'ai absolument aucun doute sur vos compétences personnelles et je vous remercie de votre réponse, mais je souhaitais vraiment appeler l'attention de Mme la ministre de la santé sur la problématique des personnels de cet hôpital qui ont déjà fourni des efforts très importants et sont en très grande souffrance. Il est absolument essentiel que l'État apporte des enveloppes complémentaires de façon que ces personnels ne s'épuisent pas. Sinon on entre dans un cercle vicieux qui deviendrait épouvantable en termes d'offre de soins.

La parole est à M. Daniel Labaronne, pour exposer sa question, no 272, relative aux parcours emploi compétences et à l'accompagnement des enfants en situation de handicap.

La refonte du dispositif des contrats aidés s'est traduite, dans le département d'Indre-et-Loire comme ailleurs, par le non-renouvellement de contrats d'auxiliaire de vie scolaire et la mise en place d'un nouveau dispositif, le parcours emploi compétences – le PEC. Mais entre la phase du contrat aidé et le recrutement en PEC d'une personne capable de prendre en charge des enfants en situation de handicap, une période plus ou moins longue peut s'instaurer. Dans mon département, des parents m'ont alerté sur le fait que leurs enfants n'étaient plus accompagnés depuis octobre 2017.
Les modalités de recrutement et de renouvellement de contrat dans le cadre des PEC soulèvent des difficultés quand il s'agit d'employer des personnes accompagnant des enfants en situation de handicap, notamment en milieu rural. Le nouveau cadre de recrutement, défini par la circulaire du 11 janvier 2018 relative aux PEC, resserre les publics éligibles et comporte de nouvelles obligations qui paraissent peu compatibles avec l'objectif affiché d'une prise en charge rapide et efficace des élèves en situation de handicap : tout d'abord, les personnes éligibles aux PEC doivent être issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui, en Indre-et-Loire, sont localisés en quasi-totalité dans la métropole de Tours, ce qui laisse craindre que le recrutement d'auxiliaires de vie scolaire ne soit compliqué en zone rurale, que ce soit dans le Lochois, le Chinonais ou le nord du département ; ensuite, la durée de recrutement s'est allongée en raison de l'obligation faite à l'éducation nationale d'organiser des entretiens tripartites entre le DASEN – le directeur académique des services de l'éducation nationale – , Pôle emploi et les candidats au recrutement, ce qui allonge la procédure alors que les enfants et des familles sont en souffrance depuis plusieurs mois ; enfin, l'objectif global d'une durée de douze mois pour les contrats fait craindre aux professionnels et aux familles un accroissement du turnover des personnels alors que la construction d'un lien durable entre l'accompagnant et l'élève favorise l'insertion dans le cadre scolaire ainsi que les apprentissages, et que, dans le même temps, des AVS formés donnant satisfaction sont aujourd'hui sorties du dispositif d'accompagnement.
À ces difficultés liées au dispositif PEC s'ajoute un autre problème : l'inadéquation entre, d'un côté, le besoin estimé par les Maisons départementales des personnes handicapées du nombre d'heures d'accompagnement nécessaires pour chaque enfant selon son degré de handicap, et, de l'autre, le stock d'heures disponibles dans l'enveloppe budgétaire que l'académie peut orienter vers le département, d'autant qu'une fongibilité entre les PEC de droit commun et ceux prenant en charge les enfants en situation de handicap n'est pas possible.
Le développement de l'accompagnement des élèves en situation de handicap voulu par notre majorité reste aujourd'hui subordonné à la politique de l'emploi.
Madame la secrétaire d'État, le Gouvernement peut-il me communiquer les pistes de travail envisages pour refonder radicalement cette politique ? Pourrait-on envisager, par exemple, de rattacher le recrutement des AVS au ministère de l'éducation nationale ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées.
Monsieur le député, l'accompagnement en milieu scolaire des enfants en situation de handicap est une des priorités du Gouvernement, avec un objectif clair : l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction. Or cet accompagnement a longtemps reposé sur des dispositifs relevant de la politique de l'emploi, dont font partie les contrats aidés. Ces derniers ont permis de pallier le manque de moyens attribués à cette mission, mais le cadre est désormais en train de changer. En effet, le ministère de l'éducation nationale met en place, depuis 2016, un plan de création de 32 000 CDI d'accompagnement d'élève en situation de handicap, plan qui comporte également la transformation progressive de 56 0000 contrats aidés. Pour répondre à l'urgence, le ministère a décidé d'aller plus loin encore et de renforcer cet effort par l'ouverture de 4 500 postes supplémentaires. Les besoins étant massifs, l'attribution d'un volume important de parcours emploi compétences dédiés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap a été maintenue en 2018.
Pour les postes d'auxiliaires de vie scolaire, l'enjeu est double. Il s'agit tout d'abord de répondre à l'objectif d'inclusion scolaire ; ensuite, et c'est tout aussi important, d'appliquer à ces contrats aidés la transformation qualitative souhaitée par le Gouvernement, ce qui signifie davantage de formation, un meilleur accompagnement, un suivi renforcé par le prescripteur, et ainsi des chances accrues pour le bénéficiaire de s'insérer dans un emploi durable. L'éducation nationale s'est engagée à mettre en place une formation systématique de soixante heures pour toutes les personnes recrutées en parcours emploi compétences. L'application de ces nouvelles obligations qualitatives appliquées aux postes d'AVS a fait l'objet d'une note commune entre les ministères concernés et Pôle emploi, laquelle a été récemment transmise aux services déconcentrés. Elle devrait permettre d'assurer une prescription fluide de ces contrats. Les services concernés seront bien sûr attentifs à sa mise en oeuvre pour éviter toute situation de blocage. Une évolution tournée vers la qualité et la formation nous paraît particulièrement indispensable pour une inclusion réussie.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, d'avoir réaffirmé notre volonté politique commune d'une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap dans les écoles. Je vous remercie également pour ces éléments chiffrés extrêmement précis qui illustrent cette volonté politique. Je souhaitais simplement appeler l'attention du Gouvernement sur la phase de transition entre la fin des anciens contrats aidés et les nouveaux recrutements en PEC car c'est durant cette phase que les familles et les enfants sont en situation de souffrance car il n'y a pas alors, notamment en zone rurale, d'accompagnants.

La parole est à M. Sébastien Huyghe, pour exposer sa question, no 285, relative à l'avenir de l'unité de douane de Lesquin.

Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, il y a près de deux ans, j'interpellais ici même le Gouvernement sur l'avenir de l'unité de douane de Lesquin. En effet, le 8 février 2016, dans le cadre du projet stratégique de la direction interrégionale des douanes de Lille, le comité technique de réseau a pris la décision de fusionner les brigades de Lesquin et de Baisieux. Cette fusion acterait la fermeture du site de Lesquin en regroupant les deux unités sur le seul site de Baisieux. La décision a depuis été suspendue, mais le projet reste d'actualité.
La présence d'une brigade de douane à Lesquin est pourtant stratégique en raison de la proximité de l'aéroport international de Lille-Lesquin. L'État et la région, sous l'impulsion de son président Xavier Bertrand, partagent d'ailleurs l'ambition d'accroître la fréquentation de cet aéroport, conformément à la volonté de développer les plates-formes régionales. Cette brigade de douane, dont les locaux sont mis à disposition par l'aéroport, effectue des missions de première importance sur un site particulièrement sensible, missions de type sécuritaire, sanitaire et de lutte contre la fraude. L'unité de douane est donc appelée à être davantage sollicitée, sur des missions de plus en plus nombreuses et complexes, du fait de la menace terroriste mais également des enjeux du Brexit. Il apparaît donc contradictoire de l'affaiblir en l'éloignant géographiquement et en renonçant à l'expérience précieuse accumulée par les douaniers en poste à Lesquin. Il est en effet bien évident que les fonctionnaires des douanes regroupés à Baisieux ne pourront pas assurer de présence systématique à l'arrivée de vols d'origine extracommunautaire.
Il y a quelques jours, après avoir pris connaissance du sujet, le ministre Gérald Darmanin assurait que la présence douanière à Lesquin serait maintenue, sans en préciser toutefois les modalités. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous m'indiquer si le projet de fusion avec l'unité de Baisieux est définitivement abandonné et si les effectifs aujourd'hui en poste à Lesquin y seront maintenus dans leur intégralité ? Enfin, quels moyens le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre afin de permettre aux douaniers d'effectuer leurs missions à l'aéroport de Lesquin et à ses abords ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.
Monsieur le député, comme vous venez de le rappeler à l'instant, le projet stratégique de la direction générale des douanes et droits indirects, véritable feuille de route qui, à l'horizon 2020, en fixe les orientations – soutien à la compétitivité, simplification et dématérialisation des procédures ou encore renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale – , avait amené la direction interrégionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France à réclamer un nouveau schéma d'organisation de la surveillance qui vise notamment à optimiser la présence douanière sur les axes routiers et autoroutiers desservant les trois plus grands ports européens pour le trafic de containers – Rotterdam, Anvers et Zeebrugge. Ces axes relient les aéroports de Bruxelles, de Schiphol et de Roissy, et constituent de ce fait des axes de transit très utilisés par les bandes criminelles et trafiquants. Ce schéma envisageait le regroupement de la brigade de Lesquin avec celle de Baisieux, distante de seize kilomètres, afin de permettre la constitution d'une unité supérieure, composée de plus de cinquante agents, plus polyvalente et avec une plus grande souplesse d'emploi, une meilleure capacité de projection sur les axes routiers et autoroutiers de l'agglomération lilloise ainsi que sur les zones frontalières relativement sensibles et sur l'aéroport de Lille-Lesquin.
Un certain nombre d'inquiétudes se sont fait jour, et le ministre Gérald Darmanin s'est intéressé à la question, non seulement parce qu'elle concernait les Hauts-de-France mais aussi et surtout parce que les douanes relèvent de son domaine de compétences. Ce matin, il a rencontré Christophe Coulon, président du syndicat mixte de l'aéroport Lille-Lesquin, et ils ont échangé, avec d'autres acteurs locaux, sur la question que vous évoquez. À l'issue de cette réunion a été annoncé le maintien de la brigade de l'aéroport de Lille-Lesquin. Les modalités en seront précisées ainsi que la façon dont sera accompagné le développement du trafic de l'aéroport à l'initiative, vous l'avez dit, de la région Hauts-de-France. Mais la volonté est claire : la brigade sera bien maintenue.

Fort bien, monsieur le secrétaire d'État, je me réjouis de cette réponse. Mais le diable se nichant dans les détails, vous comprendrez que j'attends avec beaucoup d'impatience de savoir dans quelles conditions s'effectuera ce maintien : les effectifs seront-ils préservés en totalité ou, comme le craignent certains intervenants et des douaniers, ne s'agira-t-il que d'une permanence de deux ou trois douaniers ? C'est très important. En tout cas, je vous remercie pour l'orientation que vous avez indiquée.

La parole est à M. Jean Lassalle, pour exposer sa question, no 297, relative à la disparition des services publics.

Mon temps de parole étant limité, je suis contraint, monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, de vous présenter une série de questions en cascade et j'en suis désolé.
Compte tenu des bonnes relations que j'entretenais avec le Président de la République avant son élection, je lui ai adressé une demande de rendez-vous le 19 juillet 2017 afin de lui présenter mon immense circonscription, qui allie mer et montagne, en vue de la constitution d'un laboratoire pour une nouvelle politique des territoires. Or m'a été opposée une fin de non-recevoir.
Lorsque le tunnel routier du Somport fut ouvert, voilà près de vingt ans, la route nationale 134 – rebaptisée européenne 7 – y conduisant devait être améliorée, avec notamment des déviations pour les communes les plus touchées. Rien n'a jamais été fait.
Malgré des années d'initiatives et de propositions, et le fait que le maire d'Oloron-Sainte-Marie ait trouvé les médecins nécessaires, la maternité d'Oloron, tout comme celle de Saint-Claude dans le Jura et tant d'autres, a été fermée. Au moment où l'on parle d'égalité entre hommes et femmes, certaines femmes qui habitent dans un territoire de piémonts et de vallées se trouvent en 2018 à deux heures trente de la maternité la plus proche ! L'hôpital d'Oloron est lui-même, avec ses 400 employés, condamné d'ici quelques mois, alors qu'il couvre un bassin de vie de 60 000 habitants.
Vous vous apprêtez à fermer la compagnie de gendarmerie de Mauléon. L'abattoir de Mauléon se trouve, lui aussi, en grande difficulté.
Notre territoire n'a jamais perdu autant de postes scolaires que cette année.
La fondation caritative des Apprentis d'Auteuil a licencié ses quatre-vingts salariés d'Audaux, dans la campagne béarnaise, pour se délocaliser à Pau – avec l'accord de François Bayrou, le maire actuel. Notre territoire n'est même plus reconnu apte à former des apprentis ! Quel message d'espoir pour nos jeunes !
J'ai présenté au mois de décembre dernier avec Marc Lassus, le créateur et le diffuseur mondial de la carte à puce, à l'entourage du Président un très beau projet susceptible d'apporter de l'eau pure, de l'énergie, le wifi et le développement de la permaculture. Ce serait la solution aux difficultés de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de tous les territoires victimes des typhons, et aussi un grand outil de coopération avec les pays en quête de développement ; des centaines d'emplois en perspective dans notre département. Vous m'avez personnellement, monsieur le secrétaire d'État, très bien répondu sur ce sujet il y a quelques jours.
Enfin, jugeant certainement le moment opportun, le Gouvernement s'apprête à introduire – ce qui en fera six au total – deux ours slovènes chez nous, dans les Pyrénées, dès le mois de septembre prochain, ruinant ainsi un pastoralisme renaissant.
Le Gouvernement envisage-t-il enfin d'apporter quelques réponses à tant de questions et à l'immense sentiment d'abandon que ressentent mes compatriotes ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.
Monsieur le député, vous avez effectivement évoqué de nombreuses questions et de nombreux projets qui vous sont chers et qui, je n'en doute pas, pourront prospérer dans les semaines qui viennent.
Permettez-moi de ne répondre que sur deux points : les questions médicales d'une part et l'ambition du Gouvernement pour la ruralité d'autre part.
Depuis quelque temps effectivement, la maternité d'Oloron-Sainte-Marie a connu une succession d'événements indésirables graves qui ont suscité de réelles interrogations quant à la sécurité et la qualité de la prise en charge des femmes et des nourrissons du territoire. Depuis 2014, la maternité a en effet enregistré quatre événements indésirables graves, alors que seuls vingt-deux événements du même type ont été recensés dans l'ensemble des maternités de Nouvelle-Aquitaine au cours de la même période. Au vu du risque avéré, les professionnels du centre hospitalier et les médecins libéraux du territoire ont, à plusieurs reprises, alerté les autorités concernées sur la nécessité de trouver une alternative à cet établissement.
La maternité était en outre confrontée à un important problème de démographie médicale. Le seul gynécologue-obstétricien avait annoncé l'arrêt de ses gardes obstétricales à la fin de 2017 ; parmi ses deux remplaçants habituels, l'une était une praticienne âgée de 69 ans ; en outre, depuis le mois de mai 2015, la maternité ne comptait plus de pédiatre titulaire ; enfin, elle recourait massivement à l'intérim. La permanence des soins en pédiatrie n'ayant pu être assurée dans des conditions réglementaires, cela avait conduit, à trois reprises, à la fermeture du plateau d'accouchement.
Au regard de ce mode de fonctionnement extrêmement dégradé, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine n'a pu laisser perdurer la situation. Dès le mois de novembre 2015, la commission médicale d'établissement du centre hospitalier s'était prononcée, avec le soutien des directions des centres hospitaliers de Pau et d'Oloron, en faveur de la mise en place d'un centre périnatal de proximité – CPP – en lieu et place de la maternité. Elle s'est à nouveau exprimée en ce sens, et à l'unanimité, au mois d'octobre 2017.
L'agence régionale de santé a souhaité s'appuyer sur les compétences présentes au sein de la maternité. Un véritable projet de santé publique, construit avec les réseaux de périnatalité et les sages-femmes libérales, a donc été envisagé. Ce CPP permettra d'assurer, sur le territoire concerné, un suivi prénatal et post-natal des femmes comme des nouveau-nés, et dans des conditions de sécurité qui seront bien meilleures.
J'en viens à un autre volet de votre question, l'accompagnement de la ruralité. Le Gouvernement est pleinement mobilisé sur ce sujet et agit notamment au travers du maintien des dotations de fonctionnement comme d'investissement, du développement du haut débit et du numérique sur l'ensemble des territoires à un rythme accéléré par rapport à ce qui était prévu initialement, au travers enfin, sous l'égide de Jacques Mézard et de Julien Denormandie, d'outils spécifiques au profit des villes-centres.
Le Gouvernement a un objectif : faire en sorte que les territoires les plus ruraux, comme votre circonscription, monsieur le député, soient mieux accompagnés par l'État.

Monsieur le secrétaire d'État, vous qui avez fait preuve il y a quelques jours de compréhension à mon égard, je vous demande simplement une chose : que quelques-uns de vos collègues – peut-être vous-même – me reçoivent, afin que je puisse faire directement état de ces problèmes.

La parole est à M. Paul Molac, pour exposer sa question, no 275, relative à la situation du Crédit mutuel Arkéa.

Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, je souhaite vous interroger sur le conflit opposant le Crédit mutuel Arkéa au Crédit mutuel 11-CIC.
Ce conflit s'est aggravé, menant le premier à lancer auprès de ses caisses locales une consultation sur le principe d'une indépendance face à la volonté centralisatrice de la branche majoritaire de la Confédération nationale du Crédit Mutuel.
Regroupant les fédérations de Bretagne, du Sud-ouest et du Massif central, le groupe Arkéa, dans une logique de long terme, investit pleinement dans l'économie régionale. Avec 10 000 emplois basés en région et une prise de décision locale – le siège étant situé au Relecq-Kerhuon, près de Brest, dans le Finistère – , Arkéa s'est hissé, au niveau national, au septième rang en matière de produit net bancaire. Arkéa dispose en outre, au sein de la place bancaire française, d'une solidité financière du plus haut niveau ainsi que d'une capacité d'autofinancement évaluée à 93 %. Par ailleurs, elle se situe, au niveau européen, dans le premier quart des 120 banques supervisées par la Banque centrale européenne. Elle affiche en outre, au niveau régional, le premier résultat privé de Bretagne en 2018.
Les résultats du groupe Arkéa prouvent qu'il est possible de réussir en se focalisant sur l'économie réelle, ce qui est contradiction avec le modèle visé par le Crédit mutuel 11-CIC : celui de banque universelle présente sur tous les continents et dans tous les métiers, y compris la banque de financement et d'investissement.
La centralisation, ou plutôt la rationalisation initiée par le Conseil national du crédit mutuel depuis l'automne 2015, fait craindre une disparition en région des services centraux, filiales, caisses, agences et centres d'affaires. Le risque sur l'emploi d'une telle évolution est estimé au minimum à 4 500 emplois, directs et indirects.
En parfaite conformité avec ses statuts et dans l'esprit d'une gouvernance coopérative et mutualiste, Arkéa a lancé un processus de consultation de ses caisses locales sur l'indépendance du groupe. Les résultats définitifs ne seront officialisés qu'à partir de demain. Tous les éléments disponibles à ce stade indiquent toutefois que le vote sera un véritable plébiscite en faveur de l'indépendance du groupe Arkéa et de ses caisses locales.
Comment le Gouvernement compte-t-il reconnaître le résultat de cette consultation et la volonté politique qui aura été ainsi clairement exprimée par les caisses locales du groupe Arkéa ? De même, comment compte-t-il assurer le maintien d'Arkéa en tant que banque coopérative et mutualiste ?

Permettez-moi, mon cher collègue, de m'associer à cette question. Peut-être que d'autres, dans cette enceinte, le feront également.
La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.
Monsieur le député, je voudrais tout d'abord rappeler à la représentation nationale que les pouvoirs publics ont toujours cherché à favoriser une sortie par le haut de la situation actuelle du Crédit Mutuel, c'est-à-dire une solution qui ne fragilise ni le groupe ni le secteur mutualiste dans son ensemble, et qui respecte les identités de chacun des sous-groupes.
C'était l'objectif de la mission de médiation confiée à Christian Noyer par la directrice générale du Trésor et le gouverneur de la Banque de France. Le Gouvernement partage les conclusions de cette mission, tant en ce qui concerne le caractère préférable du maintien de l'unité qu'en ce qui concerne les voies éventuelles d'une séparation, si celle-ci devait s'avérer inévitable.
En tout état de cause, alors que les dirigeants de Crédit mutuel Arkéa ont lancé fin mars une consultation des conseils d'administration de leurs caisses locales afin d'obtenir un vote d'orientation sur le principe d'une séparation avec le reste du groupe Crédit mutuel, le Gouvernement souhaite être ferme sur deux points.
En premier lieu, ce différend, de nature interne au groupe Crédit mutuel, relève de ses différentes composantes. Les perspectives de séparation que Crédit mutuel Arkéa pourrait présenter ne peuvent reposer sur l'hypothèse d'une modification du cadre législatif des banques mutualistes. Le Gouvernement exclut en effet de modifier celui-ci. Non seulement une telle modification reviendrait pour le Gouvernement à prendre parti dans un conflit interne à un groupe, mais, surtout, elle serait susceptible, dans l'esprit notamment du régulateur européen, d'aboutir à une fragilisation du modèle mutualiste dans son ensemble. Il en résulte qu'après une éventuelle décision de séparation d'avec le groupe Crédit mutuel, Crédit mutuel Arkéa perdrait son statut d'établissement bancaire mutualiste et ne pourrait pas solliciter un nouvel agrément de même nature.
Le Gouvernement est également ferme sur un autre point : le nouvel établissement à constituer pourrait choisir, sous certaines conditions, de rester dans le secteur coopératif, avec les caractéristiques qui s'y attachent en termes de gouvernance et d'appartenance au monde de l'économie sociale et solidaire.
Il est primordial qu'un éventuel vote sur la séparation soit précédé d'une information complète et précise des sociétaires sur le scénario de séparation envisagé, comme sur ses implications juridiques, prudentielles, financières et commerciales. Il en va de la sincérité et de la crédibilité de la consultation des sociétaires sur un choix stratégique dont les conséquences – en termes de risques, de structure, de stratégie, voire même de viabilité de l'ensemble Crédit mutuel Arkéa – sont potentiellement très importantes pour les sociétaires, les salariés et les clients, si la voie de la séparation devait finir par s'imposer.
Le Gouvernement n'a pas connaissance à ce jour d'un tel scénario, qu'il appartient aux dirigeants de Crédit mutuel Arkéa de définir. Comme la presse s'en est fait l'écho, les autorités de supervision française et européenne, qui ont pourtant pris connaissance du dossier soumis aux sociétaires à l'occasion de la consultation sur laquelle vous m'interrogez, n'en ont pas non plus connaissance. Elles n'ont donc pu, a fortiori, se prononcer sur les risques qui résulteraient de la sécession d'Arkéa, et ne pourront le faire que lorsqu'un tel scénario leur aura été formellement présenté. En tout cas, ces autorités seront appelées à se prononcer sur ce dossier, dans la mesure où ce sont elles qui, si la séparation devait se concrétiser, donneront ou non l'agrément à la nouvelle entité.
En résumé, les pouvoirs publics souhaitent avant tout que soit garantie la protection des déposants, des clients du groupe Crédit mutuel et de l'ensemble des banques mutualistes. Afin d'y parvenir, au-delà du cas particulier d'Arkéa, il est essentiel à nos yeux d'assurer la stabilité du cadre législatif des groupes mutualistes français.
Dans ce cadre et sous ces réserves, le Gouvernement appelle les dirigeants du groupe Crédit mutuel à faire preuve de la plus grande diligence ainsi que d'une complète transparence à l'égard des sociétaires comme des clients du Crédit Mutuel Arkéa si ceux-ci devaient être sollicités pour décider d'une séparation définitive d'avec le groupe Crédit Mutuel. En tout état de cause, une telle opération devrait se dérouler en toute transparence.

J'entends bien, et je comprends aisément, la préoccupation du Gouvernement qui est de protéger les déposants.
Aujourd'hui, la séparation me semble inéluctable. Je note que le Gouvernement se dit ouvert à la possibilité que soit créé un nouvel établissement au sein du secteur coopératif, et cela me paraît une bonne chose. C'est également la volonté des caisses locales que de demeurer au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais je vois mal comment cette séparation pourrait être évitée. Et chacun sait que parfois, mieux vaut une bonne séparation qu'un ménage qui tourne mal !

La parole est à M. Jean-Marc Zulesi, pour exposer sa question, no 280, relative à la revitalisation du site de LyondellBasell.

Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, source de fierté et de progrès, notre industrie est une force capable de faire rayonner nos territoires. Mais elle doit être capable de s'adapter à un monde en mutation.
J'appelle donc votre attention sur l'importance d'accompagner la revitalisation de nos sites dont les activités industrielles se réduisent, ou ont même parfois tout simplement cessé, et de faciliter la transition de ces sites vers des activités plus innovantes et plus durables.
Dans ma circonscription des Bouches-du-Rhône, à Berre-l'Étang, se trouve la raffinerie de LyondellBasell, fermée depuis six ans déjà. Si un processus de revitalisation est en cours, il se heurte à de multiples obstacles : difficulté à mobiliser des investisseurs, ambition industrielle limitée des projets proposés.
Pourtant, ce site situé sur les rivages du joyau écologique qu'est l'étang de Berre a tout pour bénéficier d'une revitalisation à la hauteur du potentiel de son territoire. Bien connecté, le site de LyondellBasell se trouve dans un bassin d'emploi qualifié, doté de compétences reconnues dans les secteurs de l'aéronautique, du numérique, de la pétrochimie et de l'énergie.
Monsieur le secrétaire d'État, j'ai la conviction – d'ailleurs partagée par l'ensemble des acteurs de ce territoire – que ce site classé Seveso pourrait être la vitrine d'une ambition industrielle française retrouvée.
Sous l'impulsion de la métropole Aix-Marseille-Provence et de son président, Jean-Claude Gaudin, la région, la chambre de commerce et d'industrie, le Grand port maritime de Marseille, ainsi que les acteurs industriels, ont uni leur force et lancé Provence Industry'Nov. Cet appel à manifestation d'intérêt vise non seulement à attirer des projets industriels innovants mais également à faire de cette métropole une championne capable d'attirer les meilleurs.
Monsieur le secrétaire d'État, je connais votre volonté de faire rayonner notre industrie et nos territoires : pourriez-vous rappeler les ambitions du Gouvernement en matière de modernisation des sites industriels existants dans nos territoires ?
S'agissant de l'enjeu spécifique de la raffinerie de LyondellBasell, quelles mesures complémentaires à l'AMI – aide à la modernisation par l'investissement – pourraient être envisagées pour accompagner la revitalisation du site ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.
Monsieur le député, l'État veille scrupuleusement à la qualité et à l'efficacité des plans de revitalisation, en privilégiant, chaque fois que cela est possible et réaliste, l'implantation de nouvelles activités industrielles.
Telle est l'ambition qui sous-tend l'obligation de revitalisation qui encadre les plans de restructuration ou de réduction de capacités qui pèsent lourdement sur nos territoires, et sur le vôtre en particulier, monsieur le député.
Engagé en avril 2015 pour une durée de deux ans, le plan de revitalisation de l'ancienne raffinerie LyondellBasell, située à Berre- l'Étang, a été renouvelé, pour deux années supplémentaires, en accord avec l'entreprise. Ce plan doit aboutir à la création de 100 emplois et concerne un espace exceptionnel tant par sa dimension – 122 hectares – que par son statut Seveso, sa densité d'équipements en réseaux – vapeur, gaz, électricité, eau – et de services aux entreprises.
Le comité de suivi de la convention de revitalisation qui s'est tenu en février 2017 a étudié deux projets d'implantation : le premier émane du groupe Charles André qui propose une activité de logistique pour la préparation de voitures neuves destinées à la vente au grand public. Cette activité, déjà existante à proximité de la commune de Berre et employant actuellement 40 personnes, serait alors relocalisée et permettrait la création, à l'horizon 2020, de 110 emplois supplémentaires.
Le second projet, Baytree, consiste en la création d'un entrepôt logistique destiné à la gestion de produits compatibles avec des activités classées Seveso. Le terrain envisagé se situe à Vaine, au sud de la raffinerie, sur une emprise foncière de 15 hectares, et 170 emplois pourraient être créés. D'autres projets, à trop faible impact, n'ont pas été retenus par le comité de sélection.
Si les deux projets qualifiés sont potentiellement créateurs d'un nombre significatif d'emplois, leur processus de sélection a toutefois illustré la difficulté rencontrée par les équipes de gestion du plan de revitalisation pour attirer des projets industriels les plus proches possibles des activités historiques de la plate-forme, lesquels auraient la préférence des élus, comme vous-même, monsieur le député, mais aussi celle du Gouvernement.
L'implantation de ces nouvelles activités économiques, qui utilisent l'embranchement fer, constitue une réelle opportunité de redynamiser le site, dont les infrastructures seront maintenues, ce qui constitue un facteur d'attractivité pour de futurs projets industriels.
En complément des deux projets évoqués précédemment, l'État et les collectivités territoriales ont décidé de s'engager pour attirer de nouvelles activités industrielles sur le site. Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé en avril 2018 en vue de proposer un accompagnement renforcé par les pouvoirs publics. Portant sur trois plates-formes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont celle de LyondellBasell, cet appel visera à attirer des projets privés pouvant contribuer à l'émergence d'une filière autour des bio-industries ; c'est en effet là l'ambition que nous avons pour le site.
L'ensemble du Gouvernement, dont Bruno Le Maire, que je représente aujourd'hui, sait, monsieur le député, l'ambition qui est la vôtre pour ce site et votre implication s'agissant de ses projets de revitalisation. Vous serez bien évidemment tenu informé par nos services, et nos cabinets respectifs restent à votre disposition.

Je voudrais juste vous remercier, monsieur le secrétaire d'État, pour cette réponse, et vous inviter sur les rives de l'étang de Berre afin que nous échangions sur les potentialités du site.

La parole est à Mme Sophie Auconie, pour exposer sa question, no 293, relative au régime fiscal des dépenses liées à la dépendance.

Monsieur le secrétaire d'État, le traitement fiscal des dépenses engagées du fait de la dépendance d'une personne est différent suivant que celle-ci est hébergée dans un établissement de soins, situation soumise à l'article 199 quindecies du code général des impôts, ou qu'elle reçoit des soins ou une aide à domicile, situation soumise à l'article 199 sexdecies du même code.
Les incidences fiscales de ces deux dispositifs sont bien différentes. Dans le cas des personnes dépendantes hébergées, situation qui est donc soumise à l'article 199 quindecies du code général des impôts, il s'agit d'une réduction d'impôt égale à 25 % des sommes retenues, dans la limite de 10 000 euros par personne hébergée, soit un avantage maximal de 2 500 euros par personne hébergée. En revanche, dans le cas de l'emploi d'un salarié à domicile, situation qui est donc soumise à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, lorsque le plafond de 20 000 euros de dépenses est appliqué aux personnes remplissant les conditions d'invalidité, l'avantage fiscal maximal est égal à 10 000 euros par foyer fiscal.
Cela crée une sorte de double peine pour les familles qui, ne pouvant plus faire face seules à la maladie de leur proche, se résolvent à placer celui-ci en établissement de soins adaptés aux handicaps lourds, et cela tout particulièrement pour les conjoints contraints d'assumer la charge d'une hospitalisation.
Je souhaite souligner, comme l'avait fait M. Jacques Toubon, le Défenseur des droits, dans un courrier adressé au ministère le 18 novembre 2016, la nécessité d'une harmonisation de ces régimes fiscaux, car leurs différences ne permettent pas une bonne intelligibilité de la règle de droit par les contribuables. Cette harmonisation est-elle envisagée par le Gouvernement ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.
Vous l'avez souligné, madame la députée : le traitement fiscal des dépenses engagées du fait de la dépendance d'une personne est différent suivant que celle-ci est hébergée dans un établissement de soins ou qu'elle reçoit une aide à domicile. Dans le premier cas, les dépenses d'hébergement sont éligibles à la réduction d'impôt liée à la dépendance prévue à l'article 199 quindecies du code général des impôts, tandis que, dans le second cas, les dépenses relatives aux services à la personne sont éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile prévu à l'article 199 sexdecies du même code.
Aux yeux du Gouvernement, cette différence de traitement est justifiée, car les deux dispositifs répondent à des logiques différentes. En effet, le taux et le plafond de dépenses retenus au titre du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ont été fixés à un niveau élevé afin de répondre à un double objectif : lutter contre le chômage et le travail dissimulé, d'une part ; inciter les particuliers à la création directe d'emplois de proximité, d'autre part.
S'agissant de la réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance, celle-ci a pour objet, non pas de compenser intégralement les frais qui résultent d'un séjour en établissement, mais d'alléger la cotisation d'impôt sur le revenu lorsque l'état de santé de la personne justifie un tel placement.
Par ailleurs, le coût de l'adaptation du logement et de l'intervention des services d'aide à domicile de jour comme de nuit peut se révéler, dans le cas de pathologies lourdes, parfois plus onéreux qu'une prise en charge en établissement de soins. Le plafond de dépenses au titre de l'emploi d'un salarié à domicile a donc été fixé de manière à ce qu'il permette le recours à plusieurs services à domicile, tels que l'intervention d'une aide-soignante, celle d'une aide-ménagère ou la livraison de repas.
En outre, l'avantage fiscal au titre des dépenses afférentes à la dépendance est déjà important, tant par son assiette – frais d'hébergement incluant le logement et la nourriture – que par le plafond des dépenses éligibles, fixé à 10 000 euros.
Il existe aussi d'autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes. Ainsi, lorsqu'elles sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire dans le cadre d'une invalidité d'au moins 80 %, les personnes concernées bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial et d'une part supplémentaire lorsque chacun des époux est titulaire de cette carte.
Elles bénéficient aussi d'un abattement sur leur revenu imposable, égal à 2 376 euros pour l'imposition des revenus de 2017 si leur revenu imposable n'excède pas 14 900 euros, et à 1 188 euros si leur revenu imposable est compris entre 14 901 euros et 24 000 euros. Le montant de l'abattement est doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier.
Enfin, si l'un des deux époux est hébergé dans un établissement pour personnes dépendantes et que l'autre époux a recours aux services d'un salarié à domicile, les deux dispositifs sont cumulables à hauteur de leurs limites respectives.
En tout état de cause, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l'État et les collectivités territoriales aux personnes concernées. À cet égard, ces avantages fiscaux se trouvent associés à d'autres dispositions qui permettent d'alléger la charge des personnes dépendantes, notamment les allocations à caractère social versées par l'État et les collectivités territoriales. Il en est ainsi, par exemple, de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, qui, au surplus, est exonérée d'impôt sur le revenu.
Vous l'aurez compris, madame la députée : l'harmonisation que vous appelez de vos voeux ne nous paraît pas justifiée par les objectifs visés à travers les dispositifs d'aide. Dans ma réponse, j'ai toutefois voulu apporter les précisions nécessaires concernant les différents régimes fiscaux et les diverses modalités d'allocation des aides et crédits d'impôt.

J'entends bien votre réponse, monsieur le secrétaire d'État. Cela étant, vous êtes un homme de terrain, ancré dans le territoire, et vous savez combien les charges liées aux personnes dépendantes sont devenues lourdes. Il y a aujourd'hui des familles où les parents doivent soutenir les études de leurs enfants et en même temps assumer un reste à charge dont ne peuvent s'acquitter leurs propres parents. À l'heure du vieillissement de la population, je pense qu'il convient que nous regardions de près ce sujet.

Le président de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui une communication du ministre de l'État, ministre de l'intérieur, l'informant que, le 15 avril 2018, M. Sylvain Brial a été élu député de la circonscription de Wallis-et-Futuna.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Allocution de M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada ;
Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire ;
Suite de la discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures cinquante.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l'Assemblée nationale
Catherine Joly