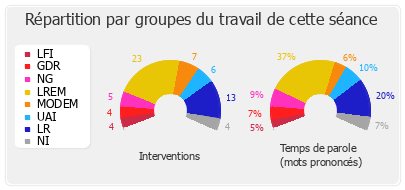Séance en hémicycle du mardi 27 mars 2018 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le président de l'Assemblée nationale a reçu hier une communication du ministre d'État, ministre de l'intérieur, l'informant que, le 25 mars 2018, ont été réélus députés de la première circonscription de Mayotte, Mme Ramlati Ali, et de la quatrième circonscription du Loiret, M. Jean-Pierre Door.

La parole est à Mme Cécile Muschotti, pour exposer sa question, no 223, relative à l'offre de soins à Toulon.

Madame la ministre des solidarités et de la santé, j'appelle votre attention sur la situation préoccupante du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer. L'organisation de ce service, en particulier le dimensionnement des locaux et la disponibilité des soins de suite et de réadaptation, conjuguée à l'offre de soins hospitalière dans la région et de médecine de ville, a des conséquences néfastes pour les patients et le personnel hospitalier, ce qui a motivé le dépôt, jeudi 22 février, d'un préavis de grève illimitée pour l'ensemble du personnel du centre hospitalier.
La situation du CHITS, particulièrement concerné par le vieillissement de la population, conjugué à une démographie expansionniste, doit inciter les pouvoirs publics à réfléchir à une meilleure organisation des soins, en particulier à une articulation plus rationnelle entre la médecine de ville – qui pourrait faire l'objet d'un tableau de garde – et à l'hôpital, dont les urgences drainent 65 % des hospitalisations, lorsque certains des soins devraient être pris en charge autrement.
Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre afin de mieux structurer et coordonner l'offre de soins, hospitalière et libérale, dont souffre notamment la métropole de Toulon ?
Madame la députée, comme de nombreux hôpitaux en France, le service d'urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer est en suractivité depuis plusieurs mois.
Cette situation s'inscrit dans une tendance nationale qui s'explique par des phénomènes saisonniers – notamment la grippe, laquelle est sévère et dont l'épidémie dure longtemps cette année – , par une baisse de la démographie de la médecine de ville mais aussi par une évolution sociétale qui voit beaucoup de citoyens privilégier le recours aux services des urgences hospitalières pour bénéficier d'une prise en charge globale. On estime ainsi à 20 % environ le taux de passages aux urgences qui pourraient être évités par une restructuration globale de l'offre de soins.
Face à ce constat, nous devons apporter des solutions adaptées et durables et non conjoncturelles. C'est tout l'enjeu du chantier engagé par mon ministère à travers la stratégie de transformation du système de santé.
Sur le plan local, la direction du CHITS, avec le soutien de l'agence régionale de santé, a d'ores et déjà apporté des réponses concrètes : six créations de postes ont été proposées, dans le respect de la maîtrise de la masse salariale, pour renforcer le brancardage et la fonction d'infirmière d'orientation et d'accueil.
D'importants travaux, engagés pour améliorer les zones d'accueil des patients et les conditions de travail des personnels, seront finalisés d'ici à la fin de l'année. Les travaux préparatoires ont été conduits en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs depuis plusieurs mois.
Une organisation spécifique dédiée à la gestion des lits – dite « bed management »–, en appui aux besoins du service des urgences, est en place et fonctionnelle depuis plusieurs années. Elle apporte quotidiennement son soutien aux urgentistes, sous l'autorité d'un cadre de direction.
Conformément à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une expertise indépendante sur la situation du service des urgences de l'hôpital Sainte Musse sera lancée dans les prochains jours. Confiée à un cabinet reconnu, cette démarche permettra, le cas échéant, de compléter les mesures déjà proposées.
Madame la députée, j'espère avoir répondu à votre question et levé vos inquiétudes.

La parole est à M. Dino Cinieri, pour exposer sa question, no 202, relative à la situation des EHPAD.

Madame la ministre des solidarités et de la santé, nous souhaitons, avec ma suppléante, Sylvie Bonnet, appeler votre attention sur la situation dramatique dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
En effet, l'augmentation du niveau de dépendance des résidents en EHPAD alourdit la charge de travail des personnels soignants. Les sous-effectifs pèsent lourdement sur les conditions de travail et la diminution brutale des contrats aidés, votée par votre majorité lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, contribuera à fragiliser encore plus un grand nombre d'établissements. Alors que, face au vieillissement de la population, les Allemands ont en moyenne 1,2 agent par résident, la France en affecte à peine 0,6.
Les professionnels – y compris les membres des corps de direction, ce qui est une première – se sont massivement mobilisés le 30 janvier dernier, puis à nouveau le 15 mars, pour expliquer leur souffrance et celle des résidents, car ces métiers sont difficiles. La dégradation des conditions de travail dans les EHPAD épuise les personnels, lesquels endurent une véritable souffrance au travail, ce qui aboutit à un taux d'absentéisme très largement supérieur à la moyenne nationale. Malgré le dévouement des personnels, la prise en charge de nos aînés devenus dépendants s'en trouve gravement dégradée.
De surcroît, la tarification ternaire est source de complexité pour tous les acteurs du secteur, et les établissements publics devront compenser les pertes de ressources de la section dépenses par les crédits d'assurance maladie, alors que ces crédits devaient permettre de créer des postes.
Par ailleurs, les familles s'inquiètent grandement des rumeurs d'augmentation des tarifs journaliers, qui représentent déjà une dépense supérieure à 1 800 euros par mois, soit 500 euros de plus que la pension de retraite moyenne.
Madame la ministre, que répondez-vous aux inquiétudes des personnels et des familles de résidents des EHPAD ?
Comptez-vous engager en urgence une réforme des financements afin de maintenir un service public d'accueil des personnes âgées digne d'une grande démocratie ?
Monsieur Cinieri, permettez-moi tout d'abord de rappeler que le budget global voté en loi de financement de la Sécurité sociale est en hausse de 3,6 % pour l'ONDAM médico-social. Je ne peux vous laisser dire que ce budget est en baisse alors que nous accompagnons la réforme de la tarification des EHPAD de plus de 100 millions d'euros aujourd'hui, votés dans la loi de financement de la Sécurité sociale.
Vous m'interrogez sur un sujet qui est l'une de mes priorités depuis mon arrivée.
Nous sommes face à un véritable enjeu de société : le vieillissement de la population et l'aggravation du niveau de dépendance de nos aînés.
Nous devons, en effet, changer en profondeur le modèle de l'EHPAD en tirant le meilleur parti de ce qui se fait déjà dans les territoires, mais aussi au niveau international.
L'augmentation du nombre de places d'hébergement temporaire me paraît également nécessaire. Nous en avons voté un certain nombre cette année, mais nous devons mieux les valoriser financièrement.
Une de mes priorités sera également de valoriser les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées en orientant notamment les nouveaux contrats parcours emploi compétences vers les EHPAD.
Enfin, nous travaillerons sur la question de l'aide sociale à l'hébergement en réfléchissant au pilotage global de cette politique, en lien étroit avec les départements, puisqu'elle ne dépend pas seulement de l'État – c'est d'ailleurs l'une des difficultés qui se posent aujourd'hui.
S'agissant du taux d'encadrement et de l'objectif du ratio d'une personne soignante pour un résident, rappelons qu'il n'a aucun fondement théorique ou scientifique et qu'il ne saurait être considéré comme une norme. Il n'est pas généralisé au niveau européen, contrairement à ce que l'on entend parfois dire. Il n'a pas de sens dès lors qu'il est déconnecté de tout lien avec le degré de dépendance des personnes. Par exemple, dans certaines unités accueillant des personnes très dépendantes, il y a déjà des cas où l'on se situe à un pour un, en particulier pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer.
Nous devons, dans la mesure du possible, améliorer le taux d'encadrement, en particulier pour la prise en charge de la dépendance et des soins. C'est ce que le Gouvernement fait déjà, en allouant une enveloppe spécifique pour recruter des infirmières et des aides-soignants, y compris des infirmières de nuit, pour les EHPAD, dès cette année.
Nous devons donc travailler ensemble aux voies et moyens de progresser s'agissant de l'environnement humain auprès des personnes dépendantes, afin de rendre cet encadrement le plus efficace possible. C'est la feuille de route que le Gouvernement élabore aujourd'hui pour mieux accompagner le vieillissement de notre population.

Merci pour vos explications, madame la ministre. Certes, le budget a été augmenté de 3,6 %, mais c'est très insuffisant par rapport aux besoins des EHPAD, en particulier ceux de leurs personnels, qui sont en souffrance.

La parole est à Mme Maud Petit, pour exposer sa question, no 208, relative à la surexposition des enfants en bas âge aux écrans.

Madame la ministre des solidarités et de la santé, le programme présidentiel d'Emmanuel Macron avait précisément évoqué le sujet de la prévention dans le domaine de la santé, puisqu'on y lisait que les dépenses de notre système de santé étaient « focalisées sur le curatif », alors qu'il était indispensable d'investir sur le préventif et de conduire une « révolution de la prévention ».
C'est dans cet esprit que je souhaiterais aborder le sujet de la surexposition aux écrans des enfants en bas âge.
Si la généralisation de l'accès au numérique est une avancée technologique utile que nous ne remettons pas en cause, son utilisation peut poser problème. La démultiplication des écrans et leur usage intensif auraient des conséquences sur le développement du jeune enfant : retard de langage, troubles des interactions, troubles de l'attention, troubles des apprentissages, hyperactivité, déscolarisation, troubles du sommeil, de l'alimentation, du comportement, selon une étude de l'Académie américaine de pédiatrie. L'utilisation abusive de tablettes et de smartphones retarderait ainsi le développement normal d'un enfant, censé développer parallèlement ses capacités intellectuelles, ses facultés sensorielles et ses capacités physiques.
À ce jour, en France, il n'existe pas d'étude spécifique sur l'impact de la surexposition aux écrans, mais de nombreux professionnels de santé, des pédopsychiatres, des pédiatres, des orthophonistes, alertent régulièrement les pouvoirs publics à ce sujet, et réclament davantage d'actions de prévention et d'information du grand public, notamment.
Madame la ministre, quelle est votre position à ce sujet ? Comment le Gouvernement compte-t-il agir ?
Madame Petit, vous soulevez ce qui est devenu depuis quelques années un problème majeur de santé publique. Vous le savez, le Gouvernement a fait du renforcement de la prévention un axe majeur de sa politique, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022 : le Premier ministre a rendu public hier un plan de prévention.
Le traitement de la problématique importante de la surexposition aux écrans des enfants en bas âge et de ses effets négatifs sur leur développement s'inscrit tout à fait dans cette approche. Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et moi-même en discutons régulièrement.
L'usage des écrans dès le plus jeune âge vise à créer une dépendance précoce à la télévision. Ce danger a pour conséquences chez le nourrisson des troubles du développement et des risques d'hyperactivité – vous l'avez souligné. Le Gouvernement est très attentif à cette question ; il a déjà pris des mesures et en prendra de nouvelles.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'appuie sur un avis d'experts publié par le ministère chargé de la santé, relatif à l'impact des chaînes télévisées sur le tout petit enfant de zéro à trois ans, élaborera et diffusera des campagnes d'information relayées par toutes les chaînes de télévision qui viseront à rappeler que l'ensemble des programmes télévisuels ne sont pas adaptés aux enfants de moins de trois ans.
Par ailleurs, mon ministère vient de publier le nouveau carnet de santé de l'enfant, qui sera distribué à partir du mois d'avril : à plusieurs endroits, il adresse aux parents un message de prévention relatif aux écrans. De nombreux pays adoptent, à destination des parents, une stratégie de communication préventive en faveur des enfants : nous recourrons nous aussi à cette façon de procéder, en vue d'en faire un enjeu réel de l'éducation des enfants.
Nous devons en outre encore progresser dans la connaissance de cette question : c'est pourquoi nous mènerons des études spécifiques et resterons évidemment très attentifs à la parution de toutes données nouvelles et probantes nous permettant d'asseoir notre politique de santé publique et de renforcer encore la prévention et l'information des familles. Je pense notamment aux mesures que nous mettrons en place visant à assurer un meilleur accompagnement de la parentalité.
Le débat ne fait que commencer. La priorité ira à la prévention et à la sécurité de nos enfants. Vous pouvez compter sur moi.

Madame la ministre, pour communiquer avec les parents, il serait bon d'utiliser également le biais des crèches, des haltes-garderies et des maternelles.

La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo, pour exposer sa question, no 226, relative à la démographie médicale au Havre.

Madame la ministre des solidarités et de la santé, le constat est malheureusement sans appel : la désertification médicale s'aggrave. Si tous les territoires sont concernés, je constate que le territoire havrais, urbain et rural, est devenu un vrai désert médical, et je le déplore.
Je tiens à vous donner quelques exemples. Si la pénurie d'ophtalmologistes en France est criante, elle prend une acuité toute particulière au Havre avec un peu plus de six ophtalmologistes pour 100 000 habitants, contre neuf dans le reste de la France. Le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous est au Havre de 153 jours en moyenne contre 100 jours au niveau national. Un tel délai pose évidemment des problèmes compte tenu de l'augmentation de maladies oculaires, notamment liées à l'âge – je pense évidemment à nos aînés, mais aussi aux plus jeunes, qui passent beaucoup de temps devant les écrans.
La psychiatrie n'est guère mieux lotie. Le nombre de psychiatres pour 100 000 habitants sur le territoire de santé du Havre est en effet deux fois moins élevé que la moyenne nationale. On y compte 6,48 psychiatres salariés pour 100 000 habitants, contre 13 sur le plan national, et 5,55 psychiatres libéraux pour 100 000 habitants, contre 10,2 sur le plan national.
De plus, les effectifs de ces services sont calculés par rapport à une capacité d'accueil théorique, qui est régulièrement dépassée au sein de l'hôpital du Havre, ce qui provoque une surcharge de travail, de la fatigue et donc des arrêts de travail, eux-mêmes insuffisamment remplacés – lorsqu'ils le sont. Ce cercle vicieux épuise les personnels.
Les hôpitaux privés, enfin, connaissent eux aussi des difficultés : ainsi l'hôpital privé de l'Estuaire, situé au Havre, n'a plus de pneumologue, et donc de service de pneumologie. Il se trouve également en très grande difficulté du fait de problèmes de recrutement d'un gynécologue obstétricien, problèmes qui hypothèquent l'avenir de sa maternité et pourraient à terme déséquilibrer l'organisation du service de maternité dans notre territoire.
Face à ce constat, la communauté médicale, l'agence régionale de santé et les collectivités territoriales ne sont pourtant pas restées inactives. Ainsi, le groupe hospitalier du Havre poursuit sa démarche d'universitarisation en partenariat avec le centre hospitalier universitaire – CHU – de Rouen, l'université de Rouen et la communauté d'agglomération du Havre. Toutefois les problèmes demeurent.
En octobre dernier, le Premier ministre et vous-même avez présenté les propositions du Gouvernement pour lutter contre la désertification médicale et renforcer l'accès aux soins pour tous les Français. Toutefois, compte tenu de l'extrême urgence liée à la désertification médicale que subit notre territoire, pourriez-vous m'indiquer les mesures immédiates que vous comptez prendre ?
Madame Firmin Le Bodo, vous m'interpellez sur la question de la démographie médicale, notamment dans la région du Havre. L'un des premiers leviers que nous souhaitons utiliser est celui de la formation des professionnels médicaux. L'agence régionale de santé et l'université de Rouen souhaitent promouvoir les spécialités en tension sur votre territoire, en proposant plus de postes d'internes après l'examen classant national.
Nous souhaitons également promouvoir l'offre de stages en dehors du centre hospitalier universitaire, pour que les futurs médecins découvrent au cours de leur formation les territoires, notamment dans les zones où l'offre de soins est insuffisante. L'agence régionale de santé contribue en outre fortement au financement de postes d'assistants spécialistes régionaux : soixante et onze postes ont été financés en Normandie l'an passé, dont quatorze au groupement hospitalier du Havre. Sur la région, trois assistants spécialistes régionaux ont été sélectionnés en psychiatrie et deux en ophtalmologie.
L'agence investit également dans la région pour développer la télémédecine, notamment pour les publics fragiles comme les résidents en établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes : dix EHPAD ont ainsi bénéficié en 2017 d'un accompagnement financier qui leur a permis de s'équiper.
L'agence travaille par ailleurs à renforcer l'attractivité des postes de praticien hospitalier, via la prime d'engagement dans la carrière hospitalière, et à promouvoir des temps partagés entre établissements dans les spécialités les plus en tension, via la prime d'exercice territorial.
Développer l'accès aux soins implique également qu'on réfléchisse aux organisations innovantes permettant de libérer du temps médical. Je pense en particulier au renforcement de la place des orthoptistes par rapport aux ophtalmologistes pour favoriser et faciliter l'accès au renouvellement des prescriptions de lunettes.
Le récent zonage des médecins reconnaît le territoire du Havre comme zone d'action complémentaire, ce qui le rend éligible aux aides de l'ARS liées à un critère de sous-densité médicale. Dernièrement, l'ARS a proposé à la préfète de Seine-Maritime d'autoriser le président du conseil de l'ordre des médecins à recourir à un contrat de médecin adjoint sur l'agglomération, ce que la préfète a autorisé par arrêté du 2 mars 2018, pour une durée d'un an. Enfin, l'ARS s'est engagée avec la communauté d'agglomération dans un contrat local de santé permettant de soutenir des actions et financements conjoints en matière de prévention et de soins.
Comme vous pouvez le voir, madame la députée, nous actionnons tous les leviers afin d'être présents sur le territoire, aux côtés des élus et des Havrais, en vue de répondre à leurs attentes en matière de santé.

Je vous remercie, madame la ministre, de toutes ces précisions : en effet tous les leviers sont activés, certains, toutefois, sur le moyen terme, voire le long terme.
À court terme, s'agissant de l'ophtalmologie, les négociations sur le plan national vont dans le bons sens et permettront d'alléger les problèmes. Il faut toutefois savoir qu'il y avait trente-cinq ophtalmologistes au Havre, et qu'il n'y en a plus que six. Vous pouvez aisément imaginer les difficultés que rencontrent les Havrais pour obtenir un rendez-vous et se faire prescrire des lunettes.
La psychiatrie et la maternité sont les deux urgences qui m'inquiètent le plus. Si la maternité de l'HPE devait par malheur fermer, nous nous trouverions face à 700 accouchements que ne pourrait pas assumer la maternité de l'hôpital du Havre. C'est un vrai problème d'organisation territoriale. Quant à l'hôpital psychiatrique Pierre Janet, il est vraiment en tension. La création assez rapide d'un poste d'universitarisation y serait bienvenue. Il en est de même à l'HPE au sein du service de gynécologie.

La parole est à M. Paul-André Colombani, pour exposer sa question, no 229, relative à la situation du secteur de la santé en Corse.

Madame la ministre des solidarités et de la santé, ma question rejoint les préoccupations de Mme Firmin Le Bodo.
Je souhaite en effet vous alerter sur la situation préoccupante du secteur de la santé en Corse. Des problèmes persistants et graves touchent aussi bien les hôpitaux par manque de moyens que la médecine libérale en milieu rural en raison de la désertification médicale. Force est de constater que les pouvoirs publics sont en passe de perdre le combat contre la désertification médicale, notamment en Corse, île montagne confrontée de plus en plus à un isolement du monde rural de l'intérieur. Des micro-régions comme l'Alta Rocca, le Niolu et le Cap Corse se retrouvent ou risquent de se retrouver sans médecin.
Ce constat m'alarme non seulement en tant que médecin mais surtout en tant qu'élu de la Corse. Il appelle à une mise en oeuvre audacieuse d'outils innovants, afin que les habitants des villages n'aient plus à renoncer à se soigner.
Certes, des outils existent déjà sur le papier : ils visent notamment à augmenter le nombre de maisons de santé pluridisciplinaires, à faciliter l'ouverture de cabinets médicaux secondaires, à développer le partage de tâches entre professionnels ou encore à favoriser la télémédecine.
Si tous ces outils sont pertinents, leur mise en oeuvre se révèle difficile, en raison de freins administratifs et réglementaires, de stratégies surdimensionnées pour notre région ou de la lenteur des mises en oeuvre face à des basculements parfois très rapides et nombreux, ce qui provoque l'épuisement des élus et des professionnels de santé.
Par ailleurs, l'absence de centre hospitalier universitaire nous interdit de maîtriser le flux des étudiants qui pourraient s'installer dans notre région. La CNAM – Caisse nationale d'assurance maladie – , dans ses négociations conventionnelles, n'est pas à la hauteur des défis qui nous sont lancés. Nous pourrions multiplier les exemples, comme les cotations proposées pour les actes de télémédecine, indigentes et incompatibles avec son développement.
Enfin, l'ensemble des mesures financières d'aide à l'installation qui sont proposées attirent peu les jeunes médecins, et les mesures de contraintes encore moins. Il semble urgent de proposer une véritable revalorisation des actes médicaux dans ces zones qui veulent soutenir l'ensemble des professionnels de santé, aussi bien ceux qui sont engagés en première ligne du combat que ceux qui souhaiteraient s'y installer.
Monsieur Colombani, je tiens à réaffirmer l'engagement fort de l'État auprès des hôpitaux de Corse, qu'il s'agisse du centre hospitalier d'Ajaccio, dont l'État a financé l'intégralité de la reconstruction, pour un montant de 130 millions d'euros, ou du centre hospitalier de Bastia, dont le Président s'est engagé, lors de sa visite du 7 février dernier, à financer la seconde tranche de travaux. Au-delà de l'accompagnement à l'investissement, les établissements de santé corses ont bénéficié en 2017 de près de 40 millions d'euros d'aides exceptionnelles en trésorerie.
Cet effort considérable témoigne de notre volonté de garantir, aux côtés de l'agence régionale de santé de Corse, un accès aux soins hospitaliers et ambulatoires pour toute la population de l'île. C'est la raison pour laquelle, forts du plan territorial d'accès aux soins que nous avons mis en oeuvre en octobre, nous avons favorisé en Corse des terrains de stage hospitaliers et ambulatoires, qui sont désormais accessibles aux internes de Marseille et de Nice sur tout le territoire de l'île.
Par ailleurs, le nouveau zonage des médecins, fondé sur l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée – APL – prend en compte les temps d'accès au médecin, ce qui est une spécificité des zones de montagne. Cela permet d'élargir le périmètre des territoires éligibles aux aides à l'installation ou au maintien des médecins en Corse.
S'agissant de l'organisation des soins dans les territoires ruraux isolés – Niolu, Alta Rocca ou le Cap Corse – , l'équipe de soins primaires permet aux professionnels de travailler ensemble. Trois projets de maisons de santé pluri-professionnelles sont en cours d'instruction et devraient ouvrir dans les tout prochains mois, puisque je cherche précisément à faciliter l'installation de ces professionnels.
Concernant l'accompagnement des professionnels de santé, retenons deux initiatives fortes. La première est une convention de partenariat, en cours de signature, entre la collectivité de Corse, les facultés de médecine de Marseille et de Nice, l'université de Corse, les URPS – unions régionales des professionnels de santé – des médecins libéraux et l'ARS de Corse, pour développer et améliorer l'accueil des internes de médecine générale et des autres spécialités en ambulatoire, ainsi que l'installation des praticiens en Corse.
La seconde est la mise en place d'un guichet unique d'information, d'orientation et d'accompagnement pour l'exercice des professionnels de santé qui souhaitent s'installer en Corse.
Enfin, la télémédecine est un outil très adapté pour favoriser un meilleur accès aux soins : il est donc nécessaire de le développer. Or les négociations conventionnelles avec l'assurance maladie sont en cours d'aboutissement. Donc la télémédecine se déploiera dès la fin de l'année 2018 dans tous les territoires. L'expérimentation de la téléexpertise en dermatologie, déployée en Corse et financée par l'ARS, que vous avez évoquée, était assurément sous-financée. Cette expérimentation ayant toutefois démontré l'intérêt de la télémédecine, le financement des actes relevant de celle-ci entrera désormais dans le droit commun, ce qui facilitera son déploiement.
Comme vous pouvez le constater, monsieur le député, je souhaite vraiment offrir un égal accès aux soins à la population corse. Nous mettrons tout en oeuvre pour y parvenir. Je me rendrai en Corse avant l'été afin de discuter de la situation avec les élus et les communautés professionnelles.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre.
Nos craintes, sur le terrain, portent sur le caractère opérationnel des mesures que vous prenez. J'en veux pour preuve la maîtrise de stage, que vous avez évoquée : nous cherchons depuis presque deux ans à renouveler ces conventions entre l'université de Corse, située à Corte, et la région, mais nous n'y réussissons pas – beaucoup s'y sont épuisés.
S'agissant de l'expérimentation de télédermatologie, elle est menée par les URPS de Corse. Le docteur Florence Ottavy a, durant deux années, consacré un temps fou à convaincre les pouvoirs publics de l'intérêt du dispositif.
Cette mesure, soutenue par l'ensemble de la profession, fonctionne puisqu'elle a permis de dépister plus de quatre-vingt-cinq cancers cutanés en Corse et d'assurer le suivi des plaies chroniques.
Les cotations proposées aujourd'hui par l'assurance maladie ne sont pas adaptées à cette expérimentation : s'agissant du suivi des plaies chroniques, par exemple, on nous propose de ne réaliser que deux photos par an et par patient, ce qui est largement insuffisant. Dans ces conditions, je crains qu'il ne faille abandonner l'expérimentation.

La parole est à Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, pour exposer sa question, no 220, relative à la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés.

Ma question s'adressait initialement à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, puisqu'elle porte sur la prise en charge des mineurs isolés. Cependant, madame la ministre des solidarités et de la santé, elle vous concerne tout autant.
Alors que nous allons bientôt examiner le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, les conseils départementaux mettent en lumière un autre enjeu : celui de l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Permettez-moi de faire un petit clin d'oeil à ma collègue Agnès Firmin Le Bodo, qui est confrontée aux mêmes questions et qui co-préside un groupe d'études sur ce sujet.
Ces jeunes, considérés comme des mineurs avant d'être vus comme des étrangers, relèvent de la protection de l'enfance et donc de la compétence des départements. Leur nombre s'accroît depuis plusieurs années et les départements ont de plus en plus de mal à faire face à ce défi. Par exemple, mon département de l'Eure, qui accueillait 12 jeunes en 2012, avait la charge de 294 en 2017.
Depuis la circulaire du 31 mai 2013, des efforts ont été faits pour la prise en charge de ces mineurs. Toutefois, plusieurs aspects demeurent problématiques : le coût financier de l'évaluation de l'âge et de l'isolement de ces jeunes, les modalités de leur mise à l'abri par les départements, la saturation des dispositifs d'hébergement, la prise en compte de leur état de santé, les difficultés pratiques tenant à l'évaluation de leur situation, ou encore l'anticipation de leur intégration à leur majorité. Certes, un protocole conclu entre l'État et les départements couvre l'ensemble de ces questions, mais compte tenu de l'accroissement de cette population, il a du mal à être mis en place. Face aux défis humanitaires, sociaux, éducatifs et sanitaires auxquels nous sommes confrontés, il reste encore beaucoup à faire.
Comment le Gouvernement entend-il donner aux départements les moyens d'améliorer l'évaluation de la situation et la prise en charge de ces jeunes mineurs non accompagnés dans la dignité, si ces sujets relèvent toujours de la compétence des mêmes collectivités ? Quelles nouvelles dispositions le Gouvernement envisage-t-il face à l'arrivée de ces jeunes en détresse ?
Vous le savez, madame la députée, le Gouvernement porte une attention particulière à la question des mineurs non accompagnés. La plupart du temps, ce sont des personnes particulièrement vulnérables qui ont connu des expériences de vie traumatisantes et qui doivent être protégées, comme la convention internationale des droits de l'enfant nous y oblige : elles bénéficient donc de la protection de l'enfance.
Une mission bipartite composée de représentants de l'Assemblée des départements de France – ADF – , de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la justice a rendu un rapport étayé le 15 février 2018. Ce rapport dresse effectivement le constat d'une augmentation, depuis l'été 2017, du nombre de personnes – essentiellement des garçons – qui demandent à être reconnues mineures et du nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. La mission souligne également une diminution de l'âge de ces mineurs. De nombreux départements sont aujourd'hui confrontés à des difficultés d'hébergement avant l'évaluation de minorité, mais aussi d'accompagnement de ces personnes une fois qu'elles ont atteint l'âge de 18 ans. Les constats dressés par la mission sont partagés par l'État et les départements.
Les solutions pour faire face à cet enjeu d'accueil et de protection des personnes sont de plusieurs ordres.
Il faut d'abord lutter avec énergie et détermination, dans un cadre européen, contre les filières de passeurs, qui instrumentalisent les enfants et leur font subir des traitements inhumains et dégradants.
Il faut harmoniser les procédures d'évaluation de la minorité, qui sont aujourd'hui trop disparates. En particulier, il n'y a pas lieu d'utiliser le test d'âge osseux. De même, les délais de ces procédures sont trop hétérogènes sur notre territoire. L'État s'est engagé à soutenir les départements dans cette phase d'évaluation : il faudra faire en sorte que les aspects sanitaires de la procédure soient davantage pris en considération.
Il faut également augmenter les capacités d'hébergement en amont de l'évaluation de minorité et soutenir davantage les départements dans le financement de cet hébergement et de l'accompagnement social associé. Le Président de la République s'y est d'ailleurs engagé.
Il y a aussi une difficulté : l'arrivée des mineurs se concentre dans quelques départements, à savoir les départements frontaliers et ceux comportant de grosses agglomérations. La question de la répartition des personnes en amont de la phase d'évaluation et avant la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance doit donc être posée.
Les scénarios proposés par la mission sont aujourd'hui à l'étude et font l'objet d'échanges entre le Gouvernement et les départements. Quel que soit le scénario retenu, l'État prendra toute sa part dans la conduite de cette politique publique de protection des mineurs, en liaison avec les départements.

Je vous remercie, madame la ministre. Nous attendons bien évidemment la mise en oeuvre des propositions de cette mission fructueuse.
Les jeunes dont nous parlons sont français, puisqu'ils ont droit à la nationalité française lorsqu'ils atteignent l'âge de la majorité. De l'amélioration des conditions de leur accueil en France dépendra donc leur façon d'être français demain.
Plan social de l'entreprise Gemalto

La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour exposer sa question, no 196, relative au plan social de l'entreprise Gemalto.

Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, je vous alerte sur la situation particulière de la société Gemalto, dont l'activité est elle-même très particulière et d'intérêt national puisqu'elle concerne la sécurité numérique.
Cette société, présente en France sur les sites de Meudon, La Ciotat et Gémenos, à côté de Marseille, a l'air de se porter assez bien puisqu'elle a versé à son PDG un salaire annuel de 1,5 million d'euros et dégagé un bénéfice de 370 millions d'euros l'année dernière. Cependant, elle a décidé de licencier 288 personnes, pour l'essentiel des ingénieurs. Or l'État est présent au capital de cette société par l'intermédiaire de Bpifrance, la banque publique d'investissement. Au demeurant, il a la possibilité de s'opposer à ces licenciements au moyen des procédures administratives normales.
Si nous vous proposons d'engager ces procédures, c'est tout simplement parce que la société Thales, elle-même directement liée à l'intérêt national, a pris la décision d'acheter Gemalto. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle : de cette manière, un secteur stratégique reste entre nos mains. Mais il serait absurde qu'une société d'État rachète une autre société présentant un intérêt public après le licenciement de 288 ingénieurs qui lui fera perdre une part essentielle de la matière grise qui, dans ce domaine, est décisive. Ces ingénieurs sont ceux à qui l'on a demandé de former leurs propres concurrents en Asie.
Voilà pourquoi je lance cette alerte, madame la secrétaire d'État. L'État a-t-il l'intention de s'opposer à ce plan de licenciements, de sorte que le rachat de Gemalto par Thales puisse sauver des emplois ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le président Mélenchon, vous interrogez le Gouvernement sur la situation des salariés du groupe Gemalto à la suite de l'annonce, par l'entreprise, de sa volonté de conclure un plan de sauvegarde de l'emploi affectant la France – un plan justifié, selon l'entreprise, par la nécessité de restaurer sa compétitivité sur un marché concurrentiel.
Soyez assuré que les services déconcentrés de l'État ont fait et continuent de faire preuve d'une vigilance constante dans ce dossier pour s'assurer que les obligations légales de Gemalto sont bien respectées. La participation capitalistique de Bpifrance, que vous avez mentionnée, ne saurait par ailleurs remettre en cause le besoin d'adaptation du groupe Gemalto aux contraintes économiques extérieures.
Vous avez évoqué plus particulièrement le contexte actuel et les conséquences du rapprochement du groupe Gemalto avec Thales. L'accord trouvé entre Thales et Gemalto pour le rapprochement des deux sociétés permettra à l'ensemble combiné de ces deux sociétés, fort de 90 000 salariés et de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de se positionner comme un leader mondial de la cybersécurité, de l'internet des objets et des solutions d'authentification. Dans un secteur de haute technologie et en forte croissance, c'est un groupe mondial fortement ancré en France qui va se constituer, sous réserve, naturellement, des autorisations réglementaires associées à ce type de transactions et de l'adhésion des actionnaires de Gemalto.
Comme vous, monsieur le président Mélenchon, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ce projet est d'abord un projet de croissance et de développement : il doit permettre de renforcer l'investissement et l'innovation en France, tout en sécurisant la préservation de notre souveraineté sur les activités technologiques sensibles.
La société Thales a rendu publics des engagements clairs. Aucune suppression d'emploi ne résultera directement du rapprochement avec Gemalto. En outre, Thales s'engage à préserver l'emploi dans les activités françaises de Gemalto au moins jusqu'à la fin de l'année 2019. Par ailleurs, si Thales n'entend pas mettre fin au plan social en cours chez Gemalto destiné à restaurer la compétitivité de l'entreprise, elle a proposé aux salariés concernés de bénéficier d'un accès aux bourses de l'emploi et aux programmes de mobilité interne de Thales, dans les mêmes conditions que les employés de Thales, afin de maximiser les chances de chaque salarié de trouver une solution adaptée à sa situation.
En tout état de cause, le Gouvernement sera très attentif au respect des obligations légales et des engagements des deux entreprises. Il reste pleinement mobilisé sur ce dossier.

Merci, madame la secrétaire d'État, pour votre réponse. Cependant, si la société Thales a effectivement l'intention de racheter Gemalto et de proposer aux employés de celle-ci une issue positive dans le cadre de la nouvelle société, pourquoi faudrait-il les licencier avant ? Ne pourrait-on pas interrompre le plan de licenciements, puisqu'on nous dit que ces personnes ne seront pas licenciées ? Cette solution était possible, mais le préfet a refusé de la mettre en oeuvre lorsqu'il a reçu les syndicats de l'entreprise le 7 mars dernier.
En outre, la perte de 288 spécialistes d'un secteur de cette nature n'améliore pas la compétitivité d'une entreprise : il la diminue plutôt.

La parole est à M. Arnaud Viala, pour exposer sa question, no 204, relative au pouvoir d'achat des retraités.

S'il est un sujet qui préoccupe aujourd'hui les Français de manière particulièrement pressante, c'est celui de leur pouvoir d'achat et de leur capacité à satisfaire leurs besoins quotidiens tout en participant, par le biais de leur consommation, au retour de la croissance économique dans notre pays – une croissance dont on observe, je l'espère, quelques prémices qui restent à confirmer. Or le pouvoir d'achat des Français dépend étroitement du niveau des prélèvements sociaux et fiscaux de tous ordres qui pèsent sur leurs revenus.
Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, je souhaite vous interroger sur un cas précis et réel que j'ai rencontré dans ma circonscription.
Josette, qui vit seule et qui a travaillé toute sa vie en tant qu'aide à domicile, perçoit en tout et pour tout 1 190 euros de revenus nets mensuels.
Le problème, c'est que ses revenus sont supérieurs au seuil au-delà duquel s'applique l'augmentation de la CSG – en d'autres termes, son revenu fiscal de référence est trop élevé.
Le problème, c'est que Josette est locataire de son appartement et qu'elle paie un loyer de 683 euros par mois. Le problème, c'est que ses charges d'énergie – chauffage et électricité – s'élèvent en moyenne à 150 euros par mois.
Le problème, c'est que Josette conduit une petite voiture diesel – chez nous, les distances sont grandes – et qu'elle veut pouvoir aller rendre service à ses enfants et voir ses petits-enfants. Or, chaque mois, son plein de gazole a augmenté : la hausse a atteint 10 euros en à peine plus d'un an.
Le problème, c'est que, depuis janvier, l'augmentation de la CSG la prive chaque mois de 22,10 euros. Le problème, c'est que la baisse de taxe d'habitation annoncée n'interviendra que pour un tiers, qu'en fin d'année, et qu'elle ne compensera donc pas sa perte de revenus. Le problème, c'est que Josette n'est pas aisée et qu'elle avait besoin de ces 22,10 euros chaque mois pour vivre modestement.
Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous répondre à Josette et aux centaines de milliers d'autres Josette qui existent en France ? Elles ont besoin de savoir comment faire pour continuer d'assumer leur quotidien malgré cette nouvelle ponction sur leurs revenus modestes.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur Viala, afin de garantir l'équilibre des mesures sans précédent de distribution de pouvoir d'achat en faveur des actifs votées à l'automne dernier, le taux de la contribution sociale généralisée a augmenté de 1,7 point au 1er janvier 2018 sur les revenus d'activité, les revenus de remplacement et ceux du capital, à l'exception des allocations chômage et des indemnités journalières.
Depuis le 1er janvier 2018, une partie des bénéficiaires d'une pension de retraite contribue donc davantage, au nom de la solidarité intergénérationnelle : il s'agit des pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l'application d'un taux plein de CSG – on estime à 60 % la part des pensionnés concernés par la hausse de CSG.
Les autres, soit 40 % des retraités, ne sont donc pas concernés : il s'agit des pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et qui demeurent exonérés de prélèvements sociaux. Sont aussi exclus du champ de la hausse de CSG, certains pensionnés restant assujettis à la CSG au taux réduit à 3,8 % parce que leurs ressources le justifient.
Si le système de prélèvement est progressif en permettant d'alléger les prélèvements pour les plus modestes, il crée des effets de seuil : pour 1 euro supplémentaire de revenu, certains retraités changent de taux d'une année à l'autre.
Le Premier ministre a ainsi fait part de son souhait que le dispositif soit corrigé pour les 100 000 retraités redevables de la CSG au taux de 8,3 % et vivant en couple qui sont assujettis lorsque le cumul de leurs deux revenus excède le seuil, même si les deux pensions sont chacune légèrement inférieures à 1 289 euros. Des travaux seront menés pour proposer ce correctif destiné à assurer une équité de traitement pour les pensions individuelles inférieures à 1 289 euros.
Au-delà de la hausse du taux de la CSG, il convient d'apprécier globalement la politique fiscale du Gouvernement. Les ménages retraités bénéficieront de mesures de pouvoir d'achat proposées par le Gouvernement. En particulier, et comme vous l'avez évoqué, les retraités bénéficient de la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui permettra à 80 % des foyers d'en être dispensés d'ici à 2020 lorsque leur revenu net mensuel est inférieur à 2 400 euros nets.
Cet impôt, qui constitue une charge fiscale particulièrement lourde dans le budget des ménages appartenant à la classe moyenne, tout particulièrement dans les communes ayant le moins d'activité économique sur leur territoire. Le montant de la taxe baissera de 30 % dès 2018 et les ménages concernés cesseront de la payer en 2020. À terme, chaque ménage bénéficiaire fera une économie moyenne de 550 euros par an.
Globalement, les deux tiers des retraités ne verront pas leur pouvoir d'achat baisser – soit, pour les 40 % des retraités les plus modestes, parce qu'ils ne sont pas concernés par la hausse de CSG, soit parce qu'ils bénéficient de l'exonération progressive de la taxe d'habitation.
La personne que vous mentionnez, monsieur le député, ne bénéficie pas d'une conjonction favorable lui permettant de maintenir son pouvoir d'achat, contrairement à une grande majorité de retraités.

Je regrette, madame la secrétaire d'État, qu'à une question précise, vous fassiez une réponse générale et circulaire. Je regrette aussi qu'il y ait confusion, dans vos propos, entre les montants nets et bruts, car il ne faut pas induire les Français en erreur. Je regrette enfin que, lorsque nous parlons d'allégement de la fiscalité, notamment par l'intermédiaire de la taxe d'habitation, vous n'expliquiez pas aussi aux Français retraités que leur commune sera probablement obligée d'augmenter le taux d'autres impôts pour continuer de subvenir aux besoins qu'ils expriment en matière de services et d'équipements, étant donné que les finances publiques locales vont également subir l'incidence de la décision de supprimer la taxe d'habitation, même s'il y a dégrèvement, car il faudra, à terme, une substitution.

La parole est à M. Denis Sommer, pour exposer sa question, no 214, relative aux marges arrière dans la filière automobile.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances.
Nos entreprises, particulièrement les PME et PMI, sont confrontées à des enjeux considérables : besoin d'internationalisation, modernisation des moyens de production, numérisation et formation des salariés.
L'usine du futur nécessitera des investissements lourds, tant dans les hommes que dans l'appareil de production. Pour se financer, les entreprises ont besoin de réaliser des marges suffisantes. Or, dans la sous-traitance, les pressions sur les prix sont considérables et les clients, qui sont souvent les grands groupes, exigent des ristournes sur les gains de productivité réalisée par les PME, qui peuvent aller jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires réalisé pour le client, alors que ces entreprises ont des niveaux de résultats rapportés au chiffre d'affaires de l'ordre de 2 % à 3 %.
En Allemagne, les grands groupes organisent leur filière, permettant à toutes les entreprises de la filière de tirer leur épingle du jeu.
Le Conseil national de l'industrie s'est emparé de cette question, exprimée par le Premier ministre le 20 novembre 2017. Pour construire les champions de demain, nous devons renforcer notre logique de filières et y diffuser la culture de l'innovation. Pour y parvenir, nous avons besoin que les rapports entre les grands groupes et les sous-traitants soient beaucoup mieux équilibrés.
Quelles sont donc les mesures que le Gouvernement entend prendre, notamment dans le cadre du futur plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises – dit « PACTE » – , pour que les filières fonctionnent de manière plus collective et solidaire ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur Sommer, le Gouvernement est très attentif à l'équilibre des relations commerciales, en particulier lorsqu'elles font intervenir, d'une part, un grand groupe et, d'autre part, un réseau de petites et moyennes entreprises. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF – ont mené, en 2011 et 2012, des enquêtes sur les relations commerciales au sein de la filière automobile. Ces enquêtes ont révélé l'existence d'engagements contractuels déséquilibrés au profit des constructeurs et au détriment de leurs sous-traitants. À cette occasion, les pratiques du quick cash et du quick saving ont effectivement été identifiées comme susceptibles de contrevenir aux dispositions de la loi de modernisation de l'économie de 2008.
Il s'agit, pour le donneur d'ordre, d'obtenir des avantages supplémentaires de son sous-traitant, soit sous la forme d'un effort en valeur – c'est le quick cash –, le plus souvent par l'octroi d'un avoir, soit sous la forme d'une demande de baisse de prix du marché en cours – c'est ce que l'on appelle le quick saving. Ces avantages obtenus, qui conditionnent souvent l'obtention d'un nouveau marché, sont censés anticiper des gains de productivité à venir et, comme tels, incertains.
Entre 2013 et 2015, l'administration a engagé avec les professionnels une démarche d'engagements visant remédier aux manquements constatés par une modification des clauses contractuelles, qui a permis d'aboutir à des modifications satisfaisantes des contrats pour certaines sociétés.
Le Gouvernement reste vigilant quant à la situation des professionnels de ces secteurs d'activité et de l'ensemble des secteurs dans lesquels des pratiques restrictives de concurrence sont susceptibles d'être observées. Les services de la DGCCRF effectuent ainsi des contrôles pour s'assurer que les relations commerciales entre professionnels ne sont pas manifestement déséquilibrées. Les dispositions actuelles du code de commerce permettent de caractériser ces pratiques et, le cas échéant, de les faire sanctionner par un juge.
Dans le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, en cours d'examen par le Parlement, figure un article qui habilite le Gouvernement à apporter par ordonnance diverses modifications et clarifications des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce – relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées – , rendues nécessaires par l'évolution des textes et les apports de la jurisprudence. C'est donc, monsieur le député, plutôt dans ce projet de loi que dans la loi PACTE que se trouveraient des possibilités de clarification.
Pour l'élaboration de cette ordonnance, les acteurs économiques seront, bien sûr, consultés.

Madame la secrétaire d'État, merci pour votre réponse. Je formulerai deux remarques.
Tout d'abord, les grands groupes que j'évoque ne sont pas nécessairement les grands constructeurs automobiles : il s'agit très souvent des grands équipementiers, qui ont des attitudes commerciales tout à fait discutables.
Quant aux recours en justice, reconnaissez avec moi qu'il est très difficile pour une PME-PMI d'affronter en justice l'un de ses clients, car ce qui est en jeu, ce sont des pertes de marchés.
Le Conseil national de l'industrie devrait donc conduire un grand débat public sur le sujet, afin de sensibiliser l'ensemble des acteurs et, surtout, permettre aux filières de mieux s'organiser. Je le répète : il existe, pas très loin, un modèle qui a montré beaucoup de vertus. Nous aurions tout lieu de nous inspirer de ce qui se fait en Allemagne.

La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour exposer sa question, no 206, relative au report du projet « The Link » à La Défense.

Ma question s'adresse à M. le ministre de la cohésion des territoires.
Is France really back ? Si nous en sommes majoritairement convaincus dans cet hémicycle, ce n'est pas le cas de tous les investisseurs. Alors que les négociations autour du Brexit s'éternisent, certains commencent à s'interroger sur la capacité d'attractivité de notre territoire. Plusieurs décisions ont en effet pu leur apparaître comme autant de signaux négatifs.
Le report récent de l'attribution de l'agrément d'immobilier d'entreprise nécessaire à l'installation du siège du groupe Total sur le site de La Défense participe de cette interrogation. Le préfet de la région Île-de-France a indiqué, dans un communiqué en date du 19 février, vouloir « définir un plan de développement urbain équilibré avec la ville de Puteaux ». Il a également rappelé la nécessité d'« apprécier les modalités prises en compte du développement du quartier d'affaires sur les logements et les transports ». Si j'entends parfaitement le bien-fondé de ces motifs, je m'étonne de la démarche, alors même que nous avons permis, l'automne dernier, la création d'un nouvel établissement public.
En effet, le Parlement a adopté le projet de loi, dont j'étais rapporteure, ratifiant l'ordonnance portant création de l'établissement public Paris La Défense. Or ce nouvel établissement public territorial – EPT – doit précisément permettre de réaliser les travaux de rénovation et d'aménagement nécessaires au renforcement de l'attractivité du site. J'aimerais donc comprendre cette décision qui intervient alors qu'un outil véritablement performant vient d'être installé. Il est nécessaire de pouvoir assurer un équilibre entre la construction de bureaux et celle de logements à proximité. C'est la volonté des collectivités engagées dans ce nouvel établissement public de territoire. Encore faut-il être prudents quant aux signaux envoyés par les différents partenaires.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Madame Florennes, je vous répondrai au nom de M. le ministre de la cohésion des territoires. Votre question est l'occasion de rappeler quelques grands traits de l'attractivité de l'Île-de-France en matière d'activités tertiaires. Je tiens à vous rassurer : notre capacité d'accueil est importante et entre parfaitement dans le calendrier du Brexit.
Un rapport publié en avril 2017 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France évalue entre 10 000 et 30 000 le nombre des emplois du secteur financier qui devraient rejoindre l'Île-de-France à la suite du Brexit, programmé pour la fin mars 2019, ce qui représente un besoin de 450 000 à 500 000 mètres carrés de bureaux.
Or l'Île-de-France dispose dès aujourd'hui de toutes les capacités nécessaires pour accueillir de nouveaux emplois dans des locaux tertiaires neufs ou restructurés selon les derniers standards internationaux. En effet, le marché de l'immobilier est très dynamique, avec une offre de dernière génération de 2,4 millions de mètres carrés actuellement en chantier, qui seront donc livrés à l'horizon du Brexit.
Un zoom sur les pôles à haute visibilité internationale montre que La Défense, le Quartier central des affaires parisien, Issy-Boulogne et Neuilly-Levallois offrent un potentiel de 1,1 million de mètres carrés, dont 422 000 dans Paris et 350 000 à La Défense. Cette dynamique devrait se poursuivre jusqu'en 2022, au vu des opérations déjà agréées par le préfet de région.
Enfin, les agréments en cours de discussion concernent des bureaux qui seront disponibles bien après le Brexit, car ils portent sur des opérations dont la livraison est postérieure à 2022. On peut donc être rassuré quant aux capacités d'accueil du Grand Paris dans son ensemble et selon le bon calendrier.
Les projets en cours d'instruction dans le secteur de La Défense pourraient abriter jusqu'à 20 000 emplois supplémentaires. Ils auront donc des impacts non négligeables sur la demande de logements et de transports, notamment dans le secteur de la station Esplanade de La Défense, directement desservie par la seule ligne 1 du métro.
Cette densification supplémentaire en emplois appelle un minimum d'accompagnement par une offre de logements supplémentaire, dont la proportion serait adaptée et en continuité avec les orientations stratégiques du quartier d'affaires, ces dernières ayant évolué en 2015 vers une plus grande mixité d'usages.
C'est donc l'intérêt général et la garantie d'un bon fonctionnement du quartier d'affaires, dont son attractivité dépend, qui ont présidé aux différentes décisions prises par le préfet de région. L'ajournement de certaines demandes d'agrément s'inscrit ainsi dans la concertation nécessaire pour résoudre en amont les problèmes que posera une nouvelle augmentation significative du nombre de mètres carrés de bureaux à La Défense à l'horizon 2023.
L'action de l'État n'est donc pas en complet décalage avec le Brexit. L'Île-de-France est actuellement la région la plus attractive d'Europe pour les investisseurs. Elle a de nombreux atouts pour accueillir les entreprises et les salariés. Or, pour assurer l'attractivité des différents quartiers sur le long terme, il est nécessaire de travailler sur les questions d'accessibilité tout en assurant une offre de logements répondant aux besoins de proximité.
Dans cette perspective, l'État utilise les outils de régulation dont il dispose en Île-de-France. Il s'agit d'accompagner l'indispensable rénovation du quartier d'affaires en veillant à ce que, dans la perspective de la livraison de nouvelles tours, les entreprises et les salariés puissent vivre et travailler dans un quartier accessible et ouvert. D'ailleurs, le secteur de La Défense bénéficie actuellement d'investissements considérables de la part de l'État et de ses partenaires en matière d'infrastructures de transport, avec la mise en sécurité du complexe autoroutier souterrain et le prolongement du RER E, de la ligne 1 du tramway et de la ligne 15 Ouest.
Madame la députée, soyez assurée que le Gouvernement partage le souhait émis par les collectivités d'un équilibre entre la construction de bureaux et celle de logements. Aussi, je ne doute pas qu'un accord sera trouvé entre l'État, représenté par le préfet, et les collectivités engagées dans le nouvel établissement. Cet accord permettra d'accompagner la construction de nouvelles capacités de bureaux et d'une offre adaptée de logements, tout en poursuivant le développement des infrastructures de transports. Il participera ainsi à l'attractivité de l'ensemble du Grand Paris, au-delà du Brexit.

Je vous remercie de cette réponse très complète, madame la secrétaire d'État, et je tiens à vous assurer que les collectivités sont elles aussi très favorables à cette concertation et qu'elles y sont déjà engagées, au-delà d'ailleurs des questions relatives au logement.
Responsabilité territoriale et objet social des entreprises

La parole est à M. Jean-François Cesarini, pour exposer sa question, no 213, relative à la responsabilité territoriale et à l'objet social des entreprises.

La réduction des inégalités territoriales est l'un des grands enjeux du siècle qui s'ouvre. Nous voyons déjà les conséquences électorales de ces inégalités dans d'autres pays : les électeurs de Donald Trump et les Britanniques qui ont voté pour le Brexit ne sont pas les habitants des grandes villes. À l'inverse, certains territoires, parce qu'ils sont plus riches, comme la Catalogne en Espagne, ou la Lombardie et la Vénétie en Italie, veulent faire sécession pour ne plus financer les territoires les plus pauvres du pays. Les inégalités, on le voit, mettent à mal la cohésion des pays.
J'aimerais donc vous proposer un dispositif permettant de mesurer la responsabilité territoriale des entreprises – RTE – , sur le modèle de la responsabilité sociétale et environnementale – RSE – , un dispositif qui a très bien marché, puisque les grandes entreprises, dans leur majorité, ont joué le jeu et acceptent de mesurer la dimension sociale et environnementale de leur activité. Nous voudrions mesurer plusieurs données : l'impact de ces entreprises sur l'emploi, en dehors des métropoles ; la part qu'elles font au télétravail, notamment au télétravail collectif dans des tiers lieux ; enfin, les dispositifs qu'elles mettent en oeuvre pour trouver un emploi aux conjoints de leurs salariés – car c'est un problème qui se pose souvent.
Ce dispositif a pour objectif d'aller plus loin dans la déconcentration de l'économie. On peut considérer que les dernières décennies ont plutôt déconcentré l'économie depuis les capitales nationales vers les métropoles régionales. En France, nous avons ainsi créé de petits Paris dans nos régions, qui centralisent à la fois la compétence et l'investissement public et privé. Il nous faut à présent penser une véritable déconcentration économique, et plus seulement une décentralisation des compétences au bénéfice des collectivités.
J'aimerais savoir si M. le ministre de la cohésion des territoires serait favorable à un tel dispositif. AU XXe siècle, la déconcentration de l'économie a créé les métropoles, et on peut considérer la métropolisation comme une conséquence de la dernière révolution industrielle du XIXe siècle. Aujourd'hui, la révolution industrielle du numérique permet une autre forme de déconcentration de l'économie dans des territoires non métropolitains. La métropolisation a été un fait du XXe siècle ; ne serait-il pas temps de passer au XXIe siècle ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le député, je vous prie d'excuser M. le ministre de la cohésion des territoires, qui ne pouvait être présent aujourd'hui et qui m'a demandé de vous lire sa réponse.
Comme vous le savez, la délégation de l'Assemblée nationale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dans le cadre de son travail sur la préparation d'une nouvelle étape de la décentralisation, envisage d'ajouter une dimension territoriale à la responsabilité sociétale des entreprises. Le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard confirme également l'intérêt des entreprises pour la RSE.
Cependant, le concept de RSE reste insuffisamment partagé : selon un rapport de France Stratégie, « À peine plus d'un quart des entreprises françaises de plus de 9 salariés déclarent s'impliquer réellement dans des démarches responsables. Elles sont même 60,4 % à déclarer ne pas connaître la notion de RSE. Plus une entreprise est grande, plus il y a de chances qu'elle connaisse la RSE et la mette en pratique. La connaissance et l'appropriation de la RSE peinent donc à se concrétiser sur le terrain en particulier dans les petites structures et dans certaines régions, malgré les nombreuses initiatives réglementaires ou volontaires. »
Néanmoins, on remarque que la notion de responsabilité territoriale s'impose de plus en plus dans le débat public. Un nombre croissant d'entreprises manifeste ainsi le désir de s'engager dans la RSE territoriale, et ce, au-delà d'une question d'image et de réputation. En effet, leur activité est soumise non pas uniquement à des jugements économiques ou à l'efficacité technico-scientifique, mais également à une exigence de développement durable. De plus, les chefs d'entreprise comprennent la nécessité de participer au développement des territoires pour bénéficier des externalités dont leurs entreprises ont besoin, notamment d'un climat de confiance et de l'adhésion des acteurs locaux à leur activité sur le long terme. Enfin, la proximité et les coopérations localement enracinées favorisent la performance économique et la construction d'« actifs spécifiques » par ces entreprises.
Les perspectives en faveur d'une responsabilité territoriale des entreprises sont donc positives. L'État et les entreprises peuvent se rejoindre autour de sujets d'intérêt commun. Nous pensons en effet qu'il faut encourager la prise en compte de l'empreinte territoriale d'une entreprise ou d'un groupe. À cette fin, nous proposons l'introduction d'une liste d'indicateurs dans le code de gouvernement d'entreprises de l'AFEP – Association française des entreprises privées – et du MEDEF.
Ces indicateurs pourront refléter, par exemple, l'engagement des entreprises en faveur de l'emploi local. Ils pourront également mesurer l'évolution de la dynamique économique d'un territoire et de l'innovation locale. Il s'agira également, enfin, de jauger l'amélioration de la qualité de vie qu'auront permise ces entreprises.
Le ministre de la cohésion des territoires souhaite en outre soutenir les entreprises qui désirent contribuer directement à l'attractivité et à la cohésion des territoires par des programmes spécifiques comme le déploiement d'espaces de coworking ou par un programme d'inclusion numérique pour les populations éloignées d'internet. À cet égard, nous considérons que la coopération entre les acteurs publics et les acteurs privés est primordiale. Ainsi, nous souhaitons que soient mises en oeuvre des expérimentations conduites par des binômes d'entreprises et de territoires, qu'il s'agisse d'intercommunalités ou de pôles d'équilibre territorial et rural – PETR. Ces expérimentations pourront consister en l'élaboration d'un référentiel RTE et la définition d'outils pour une gouvernance innovante.
Monsieur le député, la RTE fait de l'entreprise une actrice à part entière des territoires. Elle correspond à une logique gagnant-gagnant associant l'entreprise, son territoire d'activité, ses employés et les citoyens. Le Gouvernement, notamment le ministre de la cohésion des territoires, y est donc favorable et soutiendra les initiatives qui permettront de la développer.

Les entreprises ont désormais compris que leur responsabilité sociétale, environnementale et territoriale n'était pas seulement un objet de communication, susceptible de leur donner davantage de visibilité, mais que le fait d'associer leurs employés autour d'un projet commun était aussi un moyen d'accroître leur productivité. Les mentalités évoluent au sein de l'AFEP : les chefs d'entreprise ont compris à quel point nos territoires sont de nouveaux lieux de croissance pour le pays.

La parole est à M. Philippe Huppé, pour exposer sa question, no 215, relative à l'utilisation des eaux des stations d'épuration pour l'irrigation.

Ma question s'adressait à M. le ministre de l'agriculture.
« L'eau est le sang de la terre. » Par cette citation, vous aurez compris que je souhaite appeler son attention sur l'irrigation. Depuis quelques années, les épisodes de sécheresse se multiplient, notamment autour de la Méditerranée, ce qui nuit à la production agricole, et particulièrement à la viticulture. C'est un élu de l'ouest héraultais, essentiellement viticole, qui vous parle.
Depuis plusieurs années, la production viticole est en baisse et les viticulteurs sont affolés, car ils ne voient pas de solution. On leur propose des moyens d'irrigation, par les lacs, par des bassins de rétention ou des retenues collinaires, mais cela ne suffit pas et ne saurait constituer une solution durable. En outre, certains climatologues nous annoncent, à court terme, une augmentation de la température qui pourrait atteindre 4 degrés en Méditerranée. Dans ces conditions, si nous n'irriguons pas ces terres, si nous ne leur donnons pas la vie, c'est toute la viticulture qui va disparaître.
Je voulais donc interroger M. le ministre de l'agriculture sur la problématique de l'eau usée. Certains pays recourent déjà à l'eau usée pour irriguer leurs terres : c'est le cas, par exemple, de la Californie ou d'Israël, qui ont pris ce problème à bras-le-corps. Dans ma région, une expérimentation a été menée, notamment à Sigean, sur 80 hectares, et elle a donné des résultats très positifs : grâce à un procédé technique, l'eau a été parfaitement traitée et ni la terre, ni les plantes, ni les fruits n'ont subi la moindre pollution. L'agglomération de Béziers Méditerranée est en train de tenter, et j'y prends part, le même type d'expérimentation sur des dizaines d'hectares, et je pense que l'extension de ce procédé serait utile à la viticulture.
J'ai été maire d'Adissan, et la station d'épuration de ma commune traitait 130 mètres cubes d'eau par jour. Je me dis qu'il aurait mieux valu diriger vers les vignes cette grande quantité d'eau, qui partait dans les fossés. Il s'agit non pas seulement d'irriguer, mais de compenser le manque de pluie.
Ma question est simple : pensez-vous qu'il soit envisageable d'assouplir la réglementation actuelle, afin d'utiliser l'eau usée, qui peut sauver la viticulture dans le Midi de la France, notamment dans cette partie de l'Hérault dont je suis député ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur Huppé, vous appelez l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui regrette sincèrement de ne pouvoir être présent ce matin, sur l'inégale répartition des ressources en eau dans le temps et dans l'espace, laquelle peut expliquer des situations locales de pénurie ou de surexploitation des nappes. Les agriculteurs de ma circonscription en font, hélas, eux aussi l'expérience.
Ces éléments peuvent justifier l'intérêt de la réutilisation d'eaux usées traitées comme ressource en eau supplémentaire ou de substitution. C'est en tout cas une solution alternative que nous étudions sérieusement. Néanmoins, comme vous le savez, les principes de la réglementation française se fondent principalement sur les travaux d'expertise qui ont été menés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments – AFSSA – et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES – au cours des dernières années. Ce sont ces agences qui statuent sur l'utilisation des eaux usées et nous avons donc l'obligation de travailler étroitement avec elles.
L'arrêté du 2 août 2010, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2014, s'applique aux stations d'épuration d'eaux usées urbaines. Seule l'irrigation de cultures ou d'espaces verts y est autorisée. Conformément aux avis et rapports de l'ANSES, l'arrêté définit des contraintes d'usage, de distance et de terrain, en fonction du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées. Il impose la mise en place d'un programme de surveillance de la qualité des eaux usées traitées et de la qualité des sols, ainsi que la traçabilité des opérations d'irrigation.
Les ministères en charge de ce dossier – à savoir le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de la transition écologique et solidaire et celui de l'agriculture et de l'alimentation – se sont accordés sur la nécessité de modifier certaines prescriptions de cet arrêté. Des travaux ont donc été engagés depuis 2014 avec les parties prenantes afin de modifier les prescriptions de l'arrêté. Le projet d'arrêté issu de ces travaux devra obligatoirement faire l'objet d'un avis de l'ANSES – je l'ai déjà dit, mais j'y insiste.
La Commission européenne a par ailleurs lancé en décembre 2015, dans le cadre du paquet économie circulaire, des travaux qui visent à définir, par le biais d'une directive ou d'un règlement, des critères minimaux de qualité pour la réutilisation d'eaux usées traitées, pour l'irrigation et la recharge de nappe. Tout cela est très encadré, vous le voyez. La Commission prévoit de faire une proposition de règlement qui devra être soumise à la discussion avec les États membres et le Parlement européen – tout cela prendra du temps. Un groupe de travail national se penchait sur ces questions mais, pour des raisons de coordination entre les différents niveaux de gouvernance, il a été contraint de suspendre la concertation qu'il avait engagée.
Sachez en tout cas que la question de la gestion quantitative de la ressource en eau fait l'objet d'une attention particulière de la part de nos ministères et qu'une cellule d'expertise sur la gestion de la ressource en eau dans le domaine agricole, pilotée par le préfet Pierre-Étienne Bisch, a été mise en place en novembre 2017. Placée sous l'autorité conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la transition écologique et solidaire, elle a pour mission d'examiner les projets en cours, notamment sur le stockage de l'eau, mais aussi d'identifier des solutions susceptibles d'améliorer le dispositif général, la qualité des projets et surtout d'accélérer leur réalisation. Je vous invite donc – même si je suis sûre que vous l'avez déjà fait – à vous rapprocher des ministères concernés, pour voir concrètement comment travailler de concert et accélérer la mise en oeuvre de solutions.

Je remercie Mme la secrétaire d'État de sa réponse claire, qui rassurera les viticulteurs. Il faut toutefois accélérer la procédure. Par ailleurs, je le répète, d'autres solutions existent.

La parole est à Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, pour exposer sa question, no 221, relative aux accidents liés à la chasse.

Je profite de cette séance de questions orales sans débat pour alerter le Gouvernement sur les accidents liés à la chasse et sur la nécessité d'offrir à nos concitoyens la sécurité à laquelle ils peuvent prétendre.
Comme tous les ans à la même saison, les coups de fusil résonnent dans nos forêts et nos plaines et la cohabitation devient périlleuse entre les chasseurs et ceux qui ne pratiquent pas ce loisir.
Durant la saison de chasse 2017-2018, pas moins de douze accidents mortels directement liés à cette activité ont été relevés. Parmi ceux-ci, trois concernaient des non-chasseurs, à savoir un promeneur, un enfant de 13 ans, accompagnateur de chasse tué par son grand-père d'une balle en pleine tête et une femme atteinte dans son propre jardin, prise pour un chevreuil par un chasseur se trouvant de l'autre côté de la haie.
À cela s'ajoutent vingt-huit chasseurs blessés par balle ainsi que sept personnes, non pratiquantes de ce loisir, également touchées par des tirs hasardeux. Il s'agissait de spectateurs de battues mais aussi d'automobilistes blessés au volant de leur voiture, d'un citoyen frappé dans la serre de son jardin, d'un enfant accompagnant son père à la chasse, par ailleurs également blessé, et de promeneurs.
On ne compte plus les animaux domestiques, chiens, vaches, chevaux, ânes, abattus par erreur ni les dégâts matériels.
Chaque fin de semaine a ainsi amené son lot d'incidents, voire d'accidents mortels. Ce triste décompte est bel et bien une réalité. La presse régionale a fait état de tous les cas que je viens de citer et une veille médiatique menée par une association, l'Association pour la protection des animaux sauvages – l'ASPAS – , a permis de les dénombrer. Il s'agit cependant d'un bilan provisoire car tous les incidents ne sont pas relatés dans les journaux locaux. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publiera probablement son bilan au cours du deuxième trimestre 2018, comme cela avait été le cas pour la saison de chasse 2016-2017, durant laquelle 143 incidents avaient été recensés.
Il est tout simplement inconcevable que cette pratique ancestrale, qui ne concerne que 2 % de la population, puisse causer autant de morts, et encore moins audible que des citoyens non participants et non spectateurs de cette activité y laissent leur vie. Nos concitoyens ont tous le droit de profiter sereinement de leur lieu d'habitation et des espaces naturels. Ils ont tous le droit de s'adonner au jardinage, ramasser des champignons, faire du vélo, du cheval ou simplement sortir leur chien ou se déplacer par quelque moyen de locomotion que ce soit sans se sentir en danger.
L'État se doit d'être le garant de la sécurité de tous. L'usage d'armes à feu par des non professionnels est loin d'être anodin. À l'aune de tous ces accidents et incidents, une réforme majeure de la chasse portant sur la sécurité semble urgente.
Que comptez-vous faire pour protéger l'ensemble de la population, chasseurs et non-chasseurs, et permettre la coexistence paisible de toutes les activités de pleine nature ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la députée, vous avez interrogé Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre.
La sécurité des riverains et des promeneurs, comme des chasseurs, les jours de chasse est une priorité pour notre ministère. Les terribles accidents que vous avez évoqués soulèvent une question de fond sur le partage de l'espace entre les différents usagers du milieu naturel, qui sont de plus en plus nombreux.
D'une façon générale, la pratique de la chasse est déjà interdite les jours de forte fréquentation dans les territoires dont la vocation est l'accueil du public et des promeneurs.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire, réalise chaque année un bilan des accidents de chasse. Au cours des dernières années leur nombre s'est réduit, avec 110 à 150 accidents constatés chaque année pour 1 million de pratiquants. On en comptait 200 en moyenne dans les années 2000. On observe aussi une diminution du nombre des accidents mortels, qui sont passés de 30 à 40 par saison au début des années 2000 à moins de 20 aujourd'hui. Ces accidents touchent les chasseurs dans la majorité des cas. Il n'en demeure pas moins que le fait que vingt personnes trouvent la mort chaque année dans de telles conditions est absolument intolérable et dramatique.
La formation et les épreuves pratiques du permis de chasser ont été renforcées ces dernières années, afin de mettre très fortement l'accent sur la sécurité. Sur ce sujet, les mauvaises réponses sont éliminatoires.
La loi de 2008 a par ailleurs rendu obligatoire la fixation de règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le schéma départemental de gestion cynégétique. Ces dispositions s'imposent aux chasseurs et à leurs associations, et leur violation fait l'objet de sanctions, dont la suspension ou le retrait du permis de chasse par l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, les infractions relatives aux atteintes aux animaux domestiques relèvent du code pénal. Le fait d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, sans nécessité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Vous le voyez, madame, les pouvoirs publics sont mobilisés et le nombre de morts diminue nettement d'année en année. Ils sont encore trop nombreux et il faut continuer la mobilisation et la sensibilisation.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État, mais treize accidents mortels en une année de chasse, c'est encore beaucoup trop. Je n'aimerais pas que l'année prochaine ma fille fasse partie du nombre.
En outre, comment partager les espaces naturels, alors que la chasse se pratique essentiellement le week-end et qu'ils sont alors monopolisés par les chasseurs ?

La parole est à M. Pierre-Henri Dumont, pour exposer sa question, no 201, relative à la lutte contre la prolifération des rats musqués.

Ma question s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Le rat musqué, espèce invasive nuisible, prolifère depuis plusieurs années dans les wateringues du nord de la France, minant les routes, détruisant les berges, ravageant les cultures. Dans ma circonscription, il ne se cantonne plus aujourd'hui aux étendues d'eau du milieu rural mais s'aventure jusque dans les aires les plus urbanisées. Vecteur de maladies extrêmement graves, telle la leptospirose, le rat musqué n'a pas de prédateur naturel et n'a en réalité que l'homme comme adversaire.
Malheureusement, depuis l'interdiction il y a près de dix ans du piégeage chimique, nous ne pouvons plus faire face à la prolifération du rat musqué.
Les agriculteurs, les groupements intercommunaux de défense contre les organismes nuisibles – les GIDON – , les communes, les établissements publics de coopération intercommunale – EPCI – , les départements et la région des Hauts-de-France se sont depuis fortement mobilisés pour lutter contre ce fléau. Financement des formations et des vaccins, achats de pièges en X et de nasses, distribution de primes pouvant monter jusqu'à 2 euros par queue pour les piégeurs bénévoles, voire embauche de piégeurs professionnels : rien n'y fait, la lutte mécanique contre la prolifération du rat musqué est aujourd'hui perdue.
Dans la seule communauté de communes de la région d'Audruicq, ce sont ainsi plus de 20 000 rats musqués qui ont été piégés en 2017, soit une augmentation des prises de 50 % depuis 2009, pour un record historique. J'adresse mes plus sincères félicitations à la centaine de piégeurs, bénévoles et professionnels, pour leur action déterminante mais qui n'est plus suffisante.
Je tire aujourd'hui le signal d'alarme : nos petites communes et nos bénévoles ne peuvent plus faire face seuls au fléau. Aussi, je vous demande d'autoriser à nouveau, même temporairement, le piégeage chimique du rat musqué dans le Nord et le Pas-de-Calais, afin que nous puissions réguler les populations qui prolifèrent dans nos wateringues. Je vous demande également de mettre en place un plan d'action pour accompagner financièrement nos communes et leur permettre de stabiliser les berges des wateringues détruites par les terriers des rats musqués, de réparer les routes minées par les galeries du rongeur et de continuer à subventionner les piégeurs bénévoles.
La situation n'a que trop duré, et les élus locaux refusent de devoir attendre qu'une route s'effondre sous le passage d'un bus et que ce dernier se renverse dans un fossé pour que l'État se décide enfin à agir.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur Dumont, vous avez interrogé Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargée de vous répondre.
Le rat musqué est inscrit sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes de l'Union européenne depuis juillet 2017 et sur la liste nationale depuis le mois dernier.
Parallèlement, il est inscrit comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts et figure sur la liste des dangers sanitaires de seconde catégorie.
Au vu des problèmes causés par l'espèce, son introduction dans le milieu naturel, sa détention, son transport et sa commercialisation sont interdits. La réglementation permet aussi le déclenchement d'opérations de gestion et de lutte sur le terrain.
L'espèce est également un gibier chassable, y compris par temps de neige. Par ailleurs, il peut être régulé par tir, par piégeage et par déterrage, toute l'année et en tout lieu en France métropolitaine. Les destructions peuvent être complétées par des régulations administratives ciblées, incluant tirs et piégeage, toute l'année, ordonnées par les maires comme le préfet.
Vous voyez donc, monsieur le député, que cette pression de régulation est potentiellement très élevée et qu'il existe de nombreux dispositifs de régulation de la surpopulation. Toutefois, l'emploi de poisons chimiques n'est pas une solution – cela ne vous étonnera pas pourvu que vous y réfléchissiez concrètement. Il est interdit en zones humides parce que ces milieux sont fragiles. En effet, compte tenu de leur toxicité, leur utilisation est une menace pour la faune et la flore, mais aussi pour la santé publique.
Les difficultés rencontrées dans les marais du Calaisis ne sauraient constituer un motif suffisant pour remettre en cause la protection de l'environnement et de nos concitoyens. A contrario, la diversité des dispositifs existants peuvent apporter des solutions concrètes.
On ne peut en aucune façon, sous prétexte de cibler une espèce, recourir à un procédé qui risque de causer des dommages dramatiques à l'ensemble de la biodiversité. Il ne vous aura pas échappé que la réduction de la biodiversité est entrée dans une phase d'accélération dramatique, en France et partout dans le monde. Notre devoir est de penser à nos enfants et à nos petits-enfants. Les dispositifs existants suffisent et je sais que vous le comprendrez.

Je suis désolé, mais le piégeage mécanique ne fonctionne plus au regard de la prolifération des rats musqués. Le nombre des prises a augmenté de 50 % en moins de dix ans, ainsi que celui des piégeurs tant professionnels que bénévoles. De petits EPCI de 20 000 habitants sont obligés de recruter des piégeurs professionnels en plus des piégeurs bénévoles. La région a dû payer chaque queue de rat 50 centimes de plus tant le problème est aigu.
Si vous nous proposez une solution qui n'implique pas de recourir au poison, nous n'aurons aucun problème à travailler avec vous mais je vous assure que, pour l'heure, le simple piégeage mécanique du rat musqué ne fonctionne plus : le rat a gagné la partie parce qu'en tant qu'espèce invasive et exotique il n'a pas de prédateur.
Je vous invite à venir constater le phénomène dans ma circonscription. Je vous demande surtout de trouver le moyen d'aider les communes dont le budget de fonctionnement doit supporter le coût des formations, des vaccins, des pièges et de l'achat des queues de rat aux piégeurs bénévoles car l'État ne participe en rien à ces frais, pas plus qu'il ne nous aide pour faire face à la destruction des routes et des berges.
Je vous demande de prendre enfin le taureau par les cornes car votre réponse est vraiment décevante.

La parole est à M. Grégory Besson-Moreau, pour exposer sa question, no 216, relative au taux d'incorporation de bioéthanol.

Ma question s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
La transition énergétique est de plus en plus concrète et la place de la France est centrale, mais les décisions récentes prises par la Commission européenne sur les agrocarburants remettent en cause les filières agricoles. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un changement de cap, sans que les filières y soient associées.
Le taux d'incorporation de bioéthanol dans l'essence est à 7 % aujourd'hui. Il est fondamental qu'il reste attribué à la première génération de biocarburants. Le problème majeur est que les pétroliers français et européens ne mettront que leurs propres produits dans le pétrole si l'on dénature ce taux en y intégrant notamment l'huile de palme, laquelle, aux dernières nouvelles, est moins vertueuse que les betteraves – et cela ne fait pas travailler les secteurs présents sur le sol national. À cela s'ajoutent les 7 millions d'hectolitres censés arriver sur le marché européen dans le cadre des accords avec le Mercosur actuellement en discussion.
Je vous appelle donc à la vigilance. C'est un sujet qui ne fait pas la une des médias mais qui est fondamental pour que la France garde une cohérence dans son rôle concernant la transition énergétique.
En outre, ne pas réserver ce taux de 7 % au bioéthanol pose un problème de temporalité : les biocarburants de deuxième génération n'étant pas prêts, le fait de baisser la part de bioéthanol dans ce taux d'incorporation revient à remplacer le biocarburant par du pétrole.
D'un point de vue global, l'Union européenne doit se montrer ambitieuse pour atteindre ses objectifs de 27 % d'énergies renouvelables et de réduction de 40 % des gaz à effet de serre en 2030. Elle a besoin des carburants de deuxième génération ligno-cellulosiques mais en complément des carburants de première génération. Peut-on imaginer des accords entre des pays qui veulent incorporer plus ou moins de biocarburants ? Cette question doit être posée.
Oui, les filières françaises de biocarburants soutiennent le développement des biocarburants de deuxième génération. Elles ont investi dans la recherche et développement sur les technologies de deuxième génération, notamment à travers des projets comme Futurol ou Bio-T-Fuel.
Par ailleurs, les carburants de première génération issus des matières premières européennes – betterave, céréales, colza, tournesol – fournissent à la fois l'alimentation humaine, l'énergie et des coproduits riches en protéines ou fibres pour l'alimentation animale, ce qui réduit la dépendance de l'Europe aux tourteaux de soja OGM d'Amérique du Sud, lesquels contribuent à la déforestation.
Il ne faut donc pas chercher à substituer la première génération par la deuxième, alors que c'est l'addition des deux qui permettra d'atteindre les objectifs. En donnant aux acteurs économiques des filières actuelles un signal très négatif, cette proposition n'incite pas aux nouveaux investissements et prend le risque de fixer une feuille de route théorique, avec toutes les conséquences associées en termes d'activité économique et de climat. Elle doit donc être profondément remaniée.
Dès lors, quelle est la position de la France et quelle action comptez-vous mener pour faire entendre notre filière ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur Besson-Moreau, vous avez interrogé Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Il ne peut être ici aujourd'hui, je réponds donc à sa place.
La France, vous l'avez rappelé, s'est fixé des objectifs ambitieux – parmi les plus élevés d'Europe – en matière d'incorporation de biocarburants : 7,5 % en énergie pour l'essence et de 7,7 % pour le gazole.
Il convient de distinguer deux catégories de biocarburants : d'une part, les biocarburants conventionnels d'origine alimentaire, dits de première génération, dont la consommation entraîne un conflit d'usage des terres et, d'autre part, les biocarburants issus de biomasse non alimentaire, dits avancés, de déchets ou de résidus. Le bioéthanol, qui ne peut être incorporé que dans l'essence, appartient à l'une ou l'autre de ces catégories selon la matière première utilisée pour sa fabrication. Le taux d'incorporation de biocarburants de première génération est aujourd'hui fixé à un maximum de 7 %.
Le Gouvernement veille à ne pas augmenter la part de biocarburants issue de produits alimentaires pour ne pas déséquilibrer le modèle économique des usines existantes. Dans le cadre des discussions sur la révision de la directive énergies renouvelables – dite « RED II » – pour tenir compte de la baisse de la consommation de carburants d'ici à 2030, la France ne s'est pas opposée au maintien du plafond d'incorporation de biocarburants de première génération dans les carburants à 7 %. Elle a néanmoins demandé une révision à mi-parcours de cet objectif. Ce niveau a été entériné lors du conseil des ministres de l'énergie de décembre dernier – j'y étais moi-même – et doit maintenant faire l'objet de débats en trilogue entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.
Le Gouvernement, par ailleurs, soutient le développement de biocarburants dits avancés utilisant des ressources de biomasse n'entrant pas en concurrence avec l'alimentation. C'est là notre priorité. C'est pourquoi le bioéthanol produit à partir des marcs et lies de vin n'est pas inclus dans le plafond des 7 % mais comptabilisé parmi les biocarburants avancés. La France a obtenu qu'un objectif de développement des biocarburants avancés soit également fixé : il est de 3 %.
L'objectif est aussi de mettre au point des processus de fabrication de biocarburants de deuxième génération. Les projets Futurol et Bio-T-Fuel, que vous mentionnez, s'inscrivent dans cette dynamique et utilisent des ressources de biomasse non concurrentielles avec le secteur alimentaire.
Le Gouvernement met aussi en oeuvre une politique ambitieuse de lutte contre la déforestation importée avec des exigences sur les caractéristiques des matières premières. Vous savez que c'est une priorité pour nous – le ministre de la transition écologique et solidaire a lancé récemment une initiative sur la question. Il s'agit de garantir que les matières utilisées en France, y compris l'huile de palme, n'ont pas été produites sur des terres déforestées. Nous voulons donc des certifications exigeantes.
Cette politique se décline sur le plan national – avec l'élaboration d'une stratégie nationale sur la déforestation importée – et sur le plan européen. J'en ai moi-même discuté à de nombreuses reprises récemment avec mes homologues européens.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État. Vous avez répondu à une partie de ma question, même si je ne crois pas que vous ayez rassuré les acteurs de la filière sucrière et betteravière quant à la non-utilisation de l'huile de palme comme biocarburant.
Je vous rappelle tout de même une chose : la filière betteravière a besoin de nous alors qu'elle a été complètement exclue du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, dit « EGALIM ». Aujourd'hui, elle se sent vraiment mise à l'écart.

La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour exposer sa question, no 228, relative au financement des lignes d'obligation de service public.

Ma question s'adressait à Mme la ministre chargée des transports mais c'est donc à vous, madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, que je vais la poser.
Élisabeth Borne, ministre chargée des transports, a ouvert le mardi 20 mars dernier les assises du transport aérien, qui se tiendront jusqu'en juillet prochain afin de définir les mesures à prendre pour améliorer la performance du transport aérien français. Réunissant les différents acteurs de ce secteur, ces assises ont certes l'objectif d'améliorer la compétitivité du pavillon français, mais nourrissent également des ambitions plus globales en abordant notamment les enjeux d'aménagement du territoire.
Dans un entretien publié le 2 mars dernier dans le journal La Tribune, Élisabeth Borne a évoqué l'importance du transport aérien pour le désenclavement de nos territoires et la continuité territoriale et a plaidé pour un renforcement des budgets sur les liaisons sous obligation de service public – OSP.
Or, force est de constater que, depuis 2010, l'État ne cesse de se désengager du financement des lignes d'aménagement du territoire. En 2018, l'État ne contribuera plus qu'au financement de cinq lignes métropolitaines, après avoir arrêté de subventionner six lignes métropolitaines, parmi lesquelles la ligne Tarbes-Paris en 2016.
Si les Hautes-Pyrénées bénéficient d'une obligation de service public depuis 2004, il apparaît que la situation monopolistique d'Air France sur les liaisons radiales conduit la compagnie à demander une compensation en hausse de plus de 60 % par rapport à la convention antérieure, alors même que la fréquentation de cette ligne est actuellement au plus haut.
Ainsi, à la suite du désengagement de l'État, le coût de l'OSP pèse entièrement sur les collectivités, qui assument seules l'intégralité du déficit de cette liaison. C'est une péréquation à l'envers pour les territoires les plus fragiles.
Alors, madame la secrétaire d'État, ma question sera simple : l'État entend-il revoir sa position et participer au financement du déficit de cette ligne, de telle sorte que le coût du maintien de cette desserte soit partagé entre lui et les collectivités locales ? C'est là, je crois, le sens d'un aménagement équilibré du territoire.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame Dubié, je répondrai à la place de Mme la ministre chargée des transports, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui.
Comme vous l'indiquez, compte tenu des contraintes budgétaires de ces dernières années, la participation de l'État au financement des liaisons aériennes métropolitaines d'aménagement du territoire s'est progressivement réduite. L'État a ainsi dû limiter son engagement en privilégiant la desserte des territoires les plus enclavés – vous comprendrez aisément ce choix, madame la députée.
La proximité de l'aéroport de Pau a conduit l'État à considérer que sa participation au financement de la liaison Tarbes-Paris n'était pas prioritaire, l'existence d'un aéroport alternatif faisant partie des critères réglementairement pris en compte dans sa décision.
Les assises du transport aérien, qui ont été ouvertes le 20 mars par la ministre chargée des transports et qui se termineront en septembre, seront l'occasion de repenser la question de la desserte aérienne des territoires en tenant compte de la complémentarité des plateformes et des différents modes de transport. L'objectif est de refondre et de repenser globalement le système de transport aérien. Il s'agira donc d'identifier les enjeux et les priorités pour l'avenir à partir d'un état des lieux et de définir, avec les collectivités territoriales, une nouvelle politique en la matière. Je ne doute pas, madame la députée, que vous y contribuerez assidûment.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État. Je souhaite néanmoins insister sur le territoire desservi par l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Si ce dernier couvre en effet les Hautes-Pyrénées, c'est également le cas du Comminges et du sud du Gers. Vous savez de surcroît que, dans les Hautes-Pyrénées, la desserte en avion de Lourdes, ville cultuelle, est d'autant plus importante que le transport ferroviaire a été affecté ces dernières années par la suppression des trains de pèlerinage.
J'insiste donc, madame la secrétaire d'État, sur la nécessité de conserver le même niveau de service : trois rotations par semaine et deux rotations le week-end, à contribution identique à la précédente convention, qui était déjà très importante.
J'espère que les assises permettront au Gouvernement de revoir un peu sa position et de considérer que cette ligne Tarbes-Paris – et l'existence même de l'aéroport que j'évoquais – sont essentiels pour le développement économique du territoire et de ses entreprises.

La parole est à Mme Brigitte Liso, pour exposer sa question, no 218, relative à la ligne de TER Lille-Comines.

Ma question s'adresse à Mme la ministre chargée des transports.
Je souhaite évoquer un dossier essentiel pour l'agglomération lilloise : le maintien de la ligne de TER Lille-Comines, desservant huit gares. En raison de l'insuffisance de l'entretien, cette ligne, dans un bassin de population en pleine mutation, est menacée à l'horizon 2019. Or cette option n'est pas raisonnable et risque de plonger tout le territoire dans des difficultés économiques nouvelles et, surtout, l'isolement social.
Comment en est-on arrivé là ? Au cours des dernières années, la maintenance n'a pas été, tant s'en faut, la priorité. L'aspect écologique de ce transport a été ignoré et le travail sur les dessertes a été laissé de côté. Il y a actuellement trois allers-retours en semaine et deux le samedi, et ce à des horaires vraiment peu attractifs. Vous en conviendrez : c'est bien peu.
Pourtant, depuis 2010, la fréquentation de cette liaison augmente, comme le montrent des études locales. Pourquoi donc se priver de cette ligne, à moins bien sûr d'avancer l'argument des difficultés à trouver des financements pour la remettre à niveau ? Les enjeux du maintien de ce transport local du quotidien nécessaire à la mobilité et à la cohésion des territoires sont donc essentiels. Comme Mme Borne l'a signalé, plus d'un Français sur quatre refuse un emploi faute de moyen de transport.
Transport écologique s'il en est, cette ligne contribue à diminuer la place de la voiture dans le transport urbain, ce qui en outre répond à la demande de transports publics non polluants dans l'agglomération lilloise. Sur ce dossier, les élus – députée, sénateur et maires, bien sûr – , en prise directe avec la réalité du terrain, parlent d'une même voix : il faut maintenir cette ligne.
À ce jour, la compétence des régions en matière d'exploitation des TER n'exonère pas la SNCF, donc l'État, de l'entretien du réseau. C'est le rôle de l'État d'impulser et d'intervenir en pareil cas. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir soutenir le projet de modernisation de cette ligne, seule solution pérenne, réaliste et non polluante, et de bien vouloir me préciser vos intentions en la matière.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame Liso, vous avez bien voulu interroger Élisabeth Borne, ministre chargée des transports, qui, ne pouvant être présente, m'a chargée de vous répondre.
Vous avez raison, les liaisons ferroviaires sont de vrais leviers de la cohésion sociale et jouent un rôle fondamental pour l'économie de nos territoires, en ce qu'elles autorisent la mobilité des habitants, des biens et des services, tout en constituant une alternative à la voiture. En cela, la ligne ferroviaire Lille-Comines offre une connexion pertinente aux quelque 200 usagers de la vallée de la Lys, qui l'empruntent quotidiennement pour aller dans la métropole lilloise. La situation de cet axe, notamment celle du tronçon La Madeleine-Comines, dont les travaux de remise à niveau nécessitent 20 millions d'euros, est représentative et emblématique du retard affectant l'entretien de ce type de lignes, tant au niveau régional que national.
Les financements nécessaires à la remise à niveau des lignes existantes sont importants – cela ne vous aura pas échappé – pour la région Hauts-de-France, puisque près de 500 millions d'euros sont nécessaires pour assurer une pérennité à trente ans de l'ensemble des lignes régionales. Vous savez aussi que des contraintes particulièrement fortes pèsent sur le budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France – l'AFITF. La difficulté est non pas de démontrer la pertinence de la ligne Lille-Comines, mais de mobiliser les financements nécessaires à sa remise en état. Après plusieurs décennies de sous-investissement, il semble nécessaire à Mme la ministre chargée des transports de dégager collectivement de nouvelles solutions en mesure de répondre aux situations difficiles. À cette fin, les contrats de plan État-région – CPER – constituent actuellement le seul cadre d'intervention financière de l'État en faveur de la régénération des lignes de maillage.
Concernant la région Hauts-de-France, le CPER actuel, qui couvre la période 2015-2020, ne prévoit pas de contribution de l'État en faveur de cette infrastructure ; il revient donc aux collectivités territoriales d'investir pour assurer l'avenir de cette ligne. C'est dans ce cadre qu'intervient l'engagement de la région Hauts-de-France et des collectivités locales de la métropole lilloise, qui financent à parité des études sur l'opportunité de faire circuler des tram-trains sur la ligne Lille-Comines. Les résultats de cette étude permettront aux collectivités de se prononcer sur les orientations à retenir pour la ligne ferroviaire.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État. Ce dossier, que je connais bien, contient un enjeu de financement, mais je voudrais qu'on aille au-delà. Tous les acteurs sont d'accord pour reconnaître que cette ligne n'est pas seulement un axe ferroviaire, mais revêt aussi une dimension politique. Il est très important que l'ensemble de l'agglomération soit desservie raisonnablement. La région des Hauts-de-France prend sa part à cet effort ; j'aimerais que l'État donne également son impulsion.

La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour exposer sa question, no 203, relative au tronçon de la route nationale 12 entre Verneuil-sur-Avre et Alençon.

Ma question, qui était destinée à Mme la ministre chargée des transports, concerne la route nationale 12, voie reliant la région parisienne à la Bretagne. Cette route permet notamment un accès à l'Orne via Paris. Cet axe offre deux fois deux voies entre Paris et Verneuil-sur-Avre, hormis sur quelques portions, notamment les déviations de Dreux et d'Acon. Après Verneuil-sur-Avre, il manque la connexion en deux fois deux voies entre la future déviation de Verneuil-sur-Avre, la liaison entre Saint-Maurice-lès-Charencey – à présent Charencey, commune nouvelle – et La Ventrouze, et la liaison entre Autheuil et Mortagne-au-Perche.
Cet axe routier, qui unit notre région – la Normandie – à l'Île-de-France, est stratégique et indispensable au développement du territoire régional. L'aménagement de la RN12 pour une mise en deux fois deux voies de ce tracé est crucial pour cet axe structurant. Un projet intitulé « AXE 12 », à l'instigation des élus locaux et des chambres consulaires, proposait en 2013 un dispositif public-privé dans le cadre d'un contrat de partenariat avec l'État ; il visait à mettre en place deux fois deux voies sur la RN12 entre Alençon et Nonancourt. L'État n'a pas soutenu ce projet.
À un moment où la mobilité est essentielle pour nos territoires ruraux et permet de mettre en oeuvre des énergies nouvelles, le développement de ce réseau routier en son sein est vital et essentiel pour l'Orne. Par ailleurs, l'amélioration des conditions favorise la sécurité routière – enjeu cher au Gouvernement – et le bien-être des habitants, ce qui est un argument supplémentaire à prendre en compte. En effet, la traversée de villages par une route nationale où le trafic de poids lourds est conséquent n'est pas une solution optimale.

Quelles sont les intentions de l'État quant à l'aménagement de la route nationale 12, le contournement de Saint-Rémy-sur-Avre, et surtout – c'est le principal objet de ma question – la partie entre Verneuil-sur-Avre et Alençon, pour une mise en deux fois deux voies sur tout le tracé ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la députée, vous avez bien voulu interroger Élisabeth Borne, ministre chargée des transports qui, ne pouvant être présente, m'a chargée de vous répondre.
La route nationale 12 est particulièrement importante pour la desserte du département de l'Orne ; elle constitue le lien direct entre sa préfecture, Alençon, ses bassins industriels et l'Île-de-France. Je ne décrirai pas davantage son importance, puisque vous venez de le faire.
La section comprise entre Dreux et Nonancourt a vocation à être mise à deux fois deux voies dans le cadre du projet de mise en concession autoroutière de ce tronc commun entre la RN154 et la RN12. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'est achevée au début de l'année 2017. La commission d'enquête a rendu un avis favorable, assorti de deux réserves, dont l'une porte sur le parti d'aménagement au droit de Chartres. L'objectif est d'obtenir la signature du décret d'utilité publique avant juillet 2018, afin qu'un concessionnaire soit choisi et que l'aménagement soit réalisé dans le cadre du calendrier qui découlera du volet de programmation du projet de loi d'orientation sur les mobilités, qui sera prochainement présenté au Parlement, et que vous aurez l'occasion de discuter.
L'aménagement de la section de la RN12 comprise entre Nonancourt et Alençon a, quant à lui, vocation à être mis en oeuvre de manière progressive dans le cadre des contrats de plans État-région. Pour ces deux sections, une concertation avec le public s'est tenue à la fin de l'année 2017 pour dégager des variantes préférentielles. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique devrait se tenir en 2019. Pour les sections euroises à l'ouest de Nonancourt, les études disponibles sont malheureusement trop anciennes. Les études et les concertations devront être reprises afin de permettre leur réalisation dans le cadre du prochain exercice de programmation pluriannuelle avec la région Normandie.
D'autres modalités de réalisation des aménagements de la section comprise entre Nonancourt et Alençon ont pu être envisagées. Vous évoquez ainsi l'initiative « AXE 12 », qui proposait la mise à deux fois deux voies de la section de la RN12 en question dans le cadre d'un marché de partenariat prévoyant la mise en place d'un péage sur l'itinéraire. Comme vous l'avez dit, l'État a décidé de ne pas donner suite à ce projet. En effet, la robustesse financière du montage proposé n'était pas garantie. Les hypothèses de trafic prises en compte étaient visiblement trop optimistes et n'étaient pas cohérentes avec la circulation relevée sur le secteur au cours des années précédentes. Dans ce contexte, les modalités de portage actuellement privilégiées par les services du ministère des transports pour aménager la RN12 semblent à l'heure actuelle les plus adaptées pour répondre aux besoins de mobilité du territoire que vous représentez, madame la députée.

Merci, madame la secrétaire d'État. Je me félicite que vous nous ayez fourni un calendrier concernant plusieurs engagements. Vous avez évoqué différents tronçons de cet axe routier, qui font l'objet d'une prise en compte distincte. J'ai bien noté que le choix du concessionnaire, s'agissant de la partie de Saint-Rémy-sur-Avre, devait être fait avant juillet 2018, et que, s'agissant du tronçon voisin de l'Orne, la situation allait évoluer progressivement à partir de 2019. Vous avez également évoqué le contrat de plan État-région ; je serai très attentive au respect de la parole de l'État. Vous avez par ailleurs mentionné l'existence d'études trop anciennes concernant l'Eure : le maire de Tourouvre-au-Perche m'indiquait que ce dossier était dans les tuyaux depuis trente ans.

Je serai très attentive au respect par l'État de ses engagements et à l'avancement de ce dossier.

La parole est à M. Jean-Luc Reitzer, pour exposer sa question, no 205, relative à la liaison ferroviaire de l'aéroport international de Bâle-Mulhouse.

Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, en l'absence de Mme la ministre chargée des transports, je vous soumets ma question relative à la liaison ferroviaire de l'aéroport international de Bâle-Mulhouse, dit « Euroairport ».
Alors que la région Grand Est et les cantons suisses de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de Soleure ont signé un protocole d'accord pour la réalisation de la nouvelle liaison ferroviaire de l'aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg, on peut lire dans le rapport Duron – « le fameux rapport Duron », allais-je dire – qu'il n'y a « pas, à ce stade, [… ] un besoin de mobiliser des financements nationaux français dans le cadre de ce projet ». Alors que nos voisins suisses sont prêts à investir en reconnaissant l'importance du développement de l'offre ferroviaire transfrontalière, la France, quant à elle, préconise d'attendre les conclusions d'une énième étude socio-économique pour – je cite à nouveau le rapport – « apprécier l'utilité pour la collectivité de ce projet ».
Madame la secrétaire d'État, les bras m'en tombent ! En effet, cette liaison permettra de relier l'aéroport de Bâle-Mulhouse au TGV Est, en direction de Strasbourg, mais également au TGV Rhin-Rhône, en direction de la Franche-Comté et de la Bourgogne. Dois-je rappeler ici – cela me semble hélas nécessaire – que l'Euroairport est le troisième aéroport suisse, le cinquième aéroport français, le seul aéroport binational du monde, et qu'il accueille quelque 120 entreprises, suscite près de 7 000 emplois directs et plus de 20 000 emplois indirects, et va atteindre cette année 8 millions de passagers ? Il n'est donc pas besoin, me semble-t-il, d'études supplémentaires pour acter cette réalité.
De surcroît, à quelques kilomètres de l'Euroairport se trouve la plus importante plateforme douanière de transport international routier, conçue en 1989 pour accueillir 400 camions ; or, elle en accueille près de 3 000 par jour, ce qui engendre, vous vous en doutez, des embouteillages considérables. Le réaménagement de cette plateforme a été inscrit au contrat de plan État-région 2015-2020 mais, là encore, nous nous demandons si l'État tiendra sa parole.
Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous me confirmer, d'une part, que les travaux d'aménagement de cette plateforme TIR démarreront bien cette année, comme cela a été annoncé, et, d'autre part et surtout, que la plateforme sera réalisée dans les conditions techniques que nous souhaitons et que la France reconnaîtra aussi le caractère prioritaire – objet, je le rappelle, d'accords avec la Suisse – de la liaison ferroviaire de l'Euroairport ? Telles sont les questions qu'à travers vous, je me permets de poser à Mme la ministre chargée des transports.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur Reitzer, comme vous l'avez indiqué, l'aéroport de Bâle-Mulhouse est une infrastructure exemplaire, tant par sa gouvernance internationale que par la dynamique économique qu'il impulse dans la région Grand Est. Bien qu'il soit desservi par la route, avec des transports en commun performants, un projet de raccordement ferroviaire régional a été envisagé en 2010. À la suite des études d'opportunité menées en collaboration avec la région Grand Est, l'Allemagne et la Suisse, le gouvernement français a renouvelé son engagement en faveur de ce projet en proposant l'inscription de 5 millions d'euros dans l'actuel contrat de plan État-région, pour financer les études préalables à l'enquête d'utilité publique. Celles-ci se déroulent actuellement et permettront dans quelques mois de mieux apprécier l'utilité de ce projet pour la collectivité.
Parallèlement à ces études, un groupe de travail a été mis en place sous l'égide de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement– la DREAL – pour préparer les éléments devant figurer dans un futur accord international. Ce groupe de travail associe des représentants de la région et des autres collectivités concernées par le projet, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, l'Euroairport, l'Office fédéral des transports suisse, le canton de Bâle, les chemins de fer fédéraux suisses et des acteurs allemands.
Par ailleurs, vous l'avez souligné, le Conseil d'orientation des infrastructures a récemment rendu ses propositions pour le financement des infrastructures de transport au cours des vingt prochaines années ; la participation financière de l'État français au projet de liaison ferroviaire de l'Euroairport ne figure que dans le scénario le plus ambitieux. À la suite de ce rapport, Mme la ministre chargée des transports a engagé une série de consultations avec l'ensemble des présidents de région, des grandes associations de collectivités et des usagers, afin de préparer le volet programmation du projet de loi d'orientation sur les mobilités, qui sera présenté prochainement au Parlement et dont vous aurez l'occasion de débattre.
Ces consultations permettront de tracer les perspectives du projet de liaison ferroviaire de l'Euroairport, en particulier quant à la participation de l'État et quant à son financement.
Concernant la plateforme douanière située à Saint-Louis sur l'autoroute A35, il s'agit bien d'une opération prioritaire pour l'État au vu des enjeux qu'elle revêt. Comme vous le savez, cette opération est inscrite au contrat de plan État-région 2015-2020, pour un montant global de 8 millions d'euros, et l'engagement financier de l'État, de la région Grand Est et du département du Haut-Rhin s'est concrétisé par une convention de financement le 22 mai 2017.
Toutefois, compte tenu du coût important de cette opération, un comité de pilotage sera prochainement organisé avec les collectivités territoriales intéressées. Par ailleurs, une rencontre est programmée le 27 mars avec la partie suisse afin d'examiner les conditions dans lesquelles cette dernière pourrait participer au financement de l'opération – puisqu'il est important qu'elle y participe. L'objectif reste bien sûr l'engagement du marché de travaux d'ici à la fin de l'année : cela reste notre ligne de mire. Dans ces conditions, les premiers travaux pourraient démarrer au printemps 2019, ce qui, j'en suis sûre, est de nature à vous satisfaire, monsieur le député.

Je prends acte de la volonté du Gouvernement de régler le problème de la liaison ferroviaire, et puis vous assurer que toutes les parties prenantes – française, suisse et allemande, ainsi que les milieux économiques – y sont favorables. L'ensemble de ces partenaires se sont réunis hier à Mulhouse.
En ce qui concerne la plateforme TIR, les « mais » ne sont pas de mise, madame la secrétaire d'État : cette infrastructure, inscrite au contrat de plan, doit être réalisée. Les travaux doivent donc démarrer comme prévu, car les embouteillages qui se créent tous les jours sont considérables. S'il vous plaît, enlevez donc les « mais » de votre discours, et faites en sorte que les engagements de l'État soient tenus.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour exposer sa question, no 210, relative aux transports ferroviaires en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ma question s'adresse à Mme la ministre chargée des transports.
La publication récente des rapports Duron et Spinetta a provoqué de nombreuses inquiétudes dans les territoires. Malgré les nuances apportées par le Premier ministre, un grand nombre de personnes gardent le sentiment que la politique d'infrastructures et d'aménagement du territoire reposera désormais sur la seule rentabilité des projets plutôt que sur leur utilité publique.
En Auvergne-Rhône-Alpes, la possible remise en cause des travaux du contournement ferroviaire lyonnais et de l'accès français au projet de liaison Lyon-Turin, mais aussi l'absence d'évocation et de perspective de la ligne ferroviaire très « malade » Grenoble-Lyon, ne sont ni compris ni acceptés.
De même, la mort programmée des « petites lignes », celles-là mêmes au sujet desquelles le rapport Spinetta proclame qu'il est « impensable de consacrer près de 2 milliards d'euros à seulement 2 % de voyageurs », provoque la colère des usagers, des habitants et des élus locaux. Au coeur de la circonscription dont je suis élue, la ligne Grenoble-Veynes-Gap, par exemple, est menacée. Elle joue pourtant un rôle de lien à l'intérieur de la métropole grenobloise mais aussi avec le sud de l'Isère, avec les villages de montagne – peu ou mal desservis par ailleurs – et entre les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes.
Si des engagements ont été pris s'agissant de projets routiers comme ceux de la RN85, de l'A480 et du Rondeau à Grenoble, les inquiétudes restent vives sur leur mise en oeuvre comme sur les moyens qui y sont consacrés, à ce jour très insuffisants.
Les habitants de notre région, en particulier de l'Isère, ont le sentiment d'être oubliés et même sacrifiés. Alors que le rapport Duron est conçu autour des priorités données aux mobilités du quotidien, à l'amélioration et à la sécurisation des réseaux existants et aux liens entre les métropoles, aucune d'entre elles ne semble retenue dans le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en Isère autour de la métropole grenobloise.
Pouvez-vous rassurer les élus et les citoyens, et nous assurer de votre engagement et de celui de l'État ? Nous parlons ici d'enjeux stratégiques pour la mobilité, mais aussi pour l'emploi et l'aménagement équitable de tous les territoires.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
En lançant les assises de la mobilité en septembre 2017, madame la députée, le Gouvernement a engagé une refondation de la politique des transports, avec l'objectif d'améliorer la mobilité du quotidien de tous les Français.
Les assises ont notamment permis de réunir les contributions de nombreux acteurs, en vue d'alimenter le futur projet de loi d'orientation sur les mobilités. En complément de cette approche, le Gouvernement a souhaité mettre en place une démarche spécifique pour éclairer l'avenir du transport ferroviaire. À l'issue d'une mission de quatre mois que lui a confiée le Premier ministre, M. Spinetta a posé un diagnostic complet et montré la nécessité d'une réforme du service public ferroviaire pour réinventer un modèle performant. Je ne détaillerai pas ici le contenu de ce rapport – je suis sûre que vous le connaissez.
Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures a, de son côté, donné suite à une série de consultations, toujours en cours. Ces consultations nourriront l'élaboration du projet de loi d'orientation sur les mobilités, qui sera présenté au Parlement d'ici à cet été.
La ligne régionale entre Grenoble et Gap, quant à elle, constitue le lien entre le nord et le sud des Alpes françaises. Elle relie les préfectures des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, participant ainsi aux échanges entre les différentes régions. L'état de cette ligne a effectivement imposé la mise en place de ralentissements. Des études préalables sont en cours au niveau de l'étoile de Veynes afin d'établir un diagnostic complet de l'état des installations ferroviaires et les échéances de renouvellement pour les dix ans à venir. Ces études donneront une visibilité pluriannuelle, de 2018 à 2026, sur l'ampleur des montants à investir, mais aussi de connaître les conditions d'exploitation futures et établir des priorités dans l'utilisation des financements disponibles au titre des CPER – contrats de plan État-région – actuels et à venir.
En effet, les investissements consentis pour la rénovation des lignes classées 7 à 9 dans la nomenclature de l'Union internationale des chemins de fer – l'UIC – ont vocation à être financés dans le cadre des contrats de plan État-région. Il appartient donc aux collectivités territoriales, notamment aux régions, d'identifier les priorités d'investissement sur le réseau de desserte fine des territoires en fonction des besoins de mobilité de nos concitoyens. Vous avez eu récemment l'occasion de vous entretenir de ce sujet avec Élisabeth Borne, ministre chargée des transports, et vous savez toute l'attention qu'elle y porte au nom du Gouvernement.

Merci pour ces détails et pour ces informations, madame la secrétaire d'État. J'ai eu en effet, sur ce sujet, un échange avec Mme la ministre chargée des transports, qui m'a fait part de l'attention qu'elle porte aux lignes de montagne. Votre réponse, en revanche, ne me rassure pas puisque vous renvoyez la question du financement aux CPER. Or, vous le savez, les régions ne disposent pas aujourd'hui de l'assise financière suffisante pour supporter de tels projets. L'enveloppe des CPER n'est évidemment pas suffisante ; il faudra donc que l'État la complète par ses propres abondements. J'espère que nous pourrons en débattre dans le cadre du projet de loi d'orientation sur les mobilités. Sachez, en tout cas, que les régions ne pourront assurer à elles seules une desserte convenable des territoires concernés. L'engagement de l'État est donc essentiel.

La parole est à Mme Marietta Karamanli, pour exposer sa question, no 209, relative au maintien des lignes ferroviaires.

Ma question s'adresse à Mme la ministre chargée des transports.
Un rapport récent a posé la question du maintien des lignes autres que les lignes à grande vitesse – LGV. Trois éléments devraient être pris en compte : le potentiel des lignes, la politique de service ferroviaire des régions et la mise en concurrence à venir. Certaines de ces liaisons relèvent à titre principal des régions, et ce notamment à raison du potentiel qu'elles ont de relier deux ou plusieurs régions.
Ainsi, la ligne Caen-Le Mans-Tours irrigue Argentan, Alençon et surtout, bien sûr, Le Mans. Certains la nomment la « voie ferrée des deux mers » puisqu'elle relie la Manche à l'Arc atlantique. Elle a aussi l'avantage de proposer deux points de connexion au réseau TGV, au Mans sur l'axe Paris-Bretagne-Nantes et à Saint Pierre-des-Corps sur l'axe Paris-Aquitaine, avec l'intérêt évident d'assurer des connexions province-province vers Lille, Strasbourg, Lyon et l'Arc méditerranéen. Bien que son potentiel soit évident, sa suppression est évoquée.
Le service est lui-même mal calibré et parfois mal assuré, ce qui, évidemment, concourt au peu d'attrait qu'il a pour les passagers. Ainsi, en 2017, l'offre était très mal distribuée de bout en bout puisque, depuis Caen, deux des trois allers-retours se suivaient à moins de deux heures d'intervalle et, depuis Tours, à deux départs espacés de moins d'une heure succédait un vide de plus de sept heures.
Parallèlement, la région Pays de la Loire a conclu, avec la SNCF, une convention aux termes de laquelle l'indemnisation des usagers, si elle devait être améliorée, le serait au prix d'une réduction forte des heures d'ouverture de guichet, évaluée pour toute la région à 99 000 heures sur trois ans – soit presque 12 000 jours ouvrés de huit heures. Dès 2019, les régions devront passer des appels d'offres, et les lignes déficitaires pourraient disparaître, aucun opérateur privé ne voulant a priori reprendre de telles lignes, sauf si l'État reprend la main et fait valoir la cohésion des territoires.
Ma question est donc double. Le Gouvernement entend-il faire le choix de mobiliser le potentiel de nos lignes ferroviaires et de donner une orientation forte aux transports collectifs de proximité en accompagnant le renouveau de ces lignes ? Entend-il aussi vérifier que les accords passés entre les régions et la SNCF – et demain des opérateurs privés – garantiront un service qui ne met pas en cause l'accès aux trains des habitants en dehors des zones les plus denses ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Vous vous interrogez, madame la députée, sur le rôle qu'entend jouer le Gouvernement dans l'articulation des dessertes ferroviaires sur le territoire national, et appelez plus particulièrement l'attention d'Élisabeth Borne sur les services directs entre Caen et Tours et sur les services de distribution dans les gares de la région Pays de la Loire.
En ce qui concerne ces services de distribution au sein de la région, il est effectivement envisagé, dans la convention TER conclue entre la région et SNCF Mobilités, une réduction progressive des heures d'ouverture des guichets sur la période 2018-2020. L'État, au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, n'intervient pas dans les choix de la région matérialisés dans cette convention. Je tiens toutefois à préciser que la réduction n'est pas automatique, puisque la convention prévoit que tout changement doit faire l'objet, au préalable, d'une démarche de concertation étroite associant la région, les acteurs locaux concernés et SNCF Mobilités et que, à l'issue de cette concertation, la région peut s'y opposer. La convention prévoit également la mise en oeuvre de solutions innovantes et diversifiées en fonction des besoins des clients.
S'agissant des services ferroviaires entre Caen et Tours, leur suppression n'est pas envisagée. L'État a décidé de maintenir cette ligne dont la région Normandie reprendra la gouvernance en 2020. Cette reprise est de nature à améliorer l'organisation globale de la desserte en faveur des habitants des territoires concernés.
Par ailleurs, il existe une offre TER en mesure de répondre aux besoins de mobilité sur la ligne, avec des trains opérant entre Caen et Le Mans et entre Le Mans et Tours, ainsi qu'un train TER direct avec plus d'arrêts intermédiaires que les trains Intercités. Ces services sont exploités par SNCF Mobilités dans le cadre des conventions signées avec les régions Normandie, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. En tant qu'autorités organisatrices, les trois régions sont donc les seules compétentes pour définir cette offre ferroviaire, en fonction de l'analyse qu'elles font des besoins de mobilité des usagers et de leurs priorités budgétaires.
De manière générale, les régions pourront, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, attribuer progressivement les services ferroviaires. Cela ne signifie pas que seuls les services rentables seront assurés : les services d'intérêt national demeureront subventionnés par les régions ou par l'État. C'est d'ailleurs déjà le cas actuellement, via les contrats qui lient l'État ou les régions à SNCF.
Enfin, pour satisfaire aux objectifs d'aménagement et de cohésion des territoires et garantir l'égalité d'accès aux services publics, il sera toujours de la responsabilité de l'État de veiller, dans le dialogue avec les régions, à la complémentarité entre les services d'intérêt national et régional.

J'ai évoqué cette question la semaine dernière avec M. le Premier ministre, qui était en déplacement au Mans. Il a dit le contraire de ce que vous venez de me répondre, madame la secrétaire d'État, puisqu'il a annoncé que l'État interviendrait pour examiner de près les accords qu'il a passés avec la SNCF et les régions. Il faut donc faire attention à ce que l'on annonce, d'autant que, quand trois régions discutent, leurs intérêts ne sont pas forcément les mêmes. J'appelle donc le Gouvernement à la vigilance sur cette question.

La parole est à Mme Michèle Victory, pour exposer sa question, no 211, relative à la desserte routière du nord de l'Ardèche et du nord de la Drôme.

Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, je souhaite appeler l'attention de Mme la ministre des transports sur la desserte routière du nord de l'Ardèche et du nord de la Drôme.
Ces territoires rencontrent depuis quarante ans des problèmes de mobilité. En septembre 2016, le Gouvernement lançait un plan de relance autoroutier. Grâce à la mobilisation des élus locaux, la création de deux nouveaux échangeurs sur l'A7 dans le nord de la Drôme et le nord de l'Ardèche faisait partie des dossiers retenus.
Véritable facteur de développement pour ce territoire, notamment en termes d'attractivité économique et touristique, ces échangeurs autoroutiers permettront de faciliter la desserte locale et d'améliorer grandement le quotidien des habitants.
Toutefois, ils ne seront malheureusement pas suffisants pour faire face à l'important trafic routier et à l'augmentation de la population dans ces territoires. À titre d'exemple, 20 000 véhicules traversent chaque jour le pont autoroutier qui enjambe le Rhône à Tournon-sur-Rhône, une ville de 11 000 habitants située en Ardèche. Pour les habitants qui travaillent dans la Drôme, cette augmentation de 5 % du trafic par rapport à il y a moins de dix ans rallonge de trente minutes leurs trajets déjà longs du plateau ardéchois vers la vallée du Rhône.
L'ouverture de l'échangeur, qui devrait avoir lieu en 2020 ou 2021, entraînera un accroissement du trafic sur les ponts franchissant le Rhône et reliant l'Ardèche à la Drôme, problème d'autant plus sensible pour nos habitants que la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône, qui traverse l'Ardèche, est fermée au transport de voyageurs depuis 1972.
L'Ardèche est ainsi le seul département français qui, tout en ne bénéficiant pas d'une desserte ferroviaire de voyageurs, reste impacté par les nuisances d'un trafic de marchandises en augmentation.
Je souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur l'opportunité de lancer une étude, afin que la construction de ces échangeurs s'accompagne d'une réflexion sur l'ensemble des infrastructures routières du nord de l'Ardèche et sur un troisième pont sur le Rhône, que nous appelons de nos voeux. Plusieurs traversées sont envisageables entre le sud et le nord de la circonscription, mais celle entre Andance et Serrières paraît la plus juste.
Dans cette réflexion que nous menons avec tous les acteurs des collectivités territoriales concernées, il est primordial d'intégrer les nécessaires schémas de mobilité, afin de trouver des solutions de transport en commun intelligentes pour nos habitants. Les collectivités ont toujours manifesté leur intérêt pour ce type d'aménagements et leur volonté d'y travailler, mais la construction d'un pont supplémentaire au-dessus du Rhône suppose évidemment un cofinancement de l'ouvrage par l'État.
Quelles sont donc les intentions du Gouvernement afin de désenclaver le nord de la Drôme et de l'Ardèche ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la députée, vous interrogez Élisabeth Borne, ministre chargée des transports, sur la desserte routière de l'Ardèche et de la Drôme. Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre.
Ces deux départements, ainsi d'ailleurs que ceux de l'Isère, de la Loire et du Rhône, ont récemment fait l'objet d'une étude partenariale, intitulée Étude multimodale de déplacement de l'espace Rhône-Médian, qui figure au volet territorial de l'actuel contrat de plan État-région – CPER – Auvergne-Rhône-Alpes.
En effet, les collectivités locales de ce territoire sont porteuses de nombreux projets et demandes d'aménagements, le plus souvent en lien avec la route nationale 7, qui en constitue de fait l'axe structurant. C'est pourquoi l'étude Rhône-Médian, pilotée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – DREAL – Auvergne-Rhône-Alpes, a reposé sur la construction d'un modèle multimodal de déplacements prenant en compte sur ce territoire les déplacements motorisés et ferroviaires, actuels et futurs, de fret et de voyageurs. L'intégration dans ce modèle des prévisions de croissance économique, de manière concertée avec les collectivités, a permis de construire puis d'évaluer une projection à l'horizon 2040.
Les partenaires ont identifié de nombreux projets en 2016. Un scénario dit de consensus a finalement été retenu avec treize projets, dont la création d'un nouveau pont sur le Rhône au sud d'Andance et l'aménagement de la route départementale 82, en lien avec la création de l'échangeur Nord Drôme, pour un coût estimé à environ 200 millions d'euros.
Afin d'affiner ce scénario, le Gouvernement souhaite poursuivre cette réflexion par la conduite d'une étude d'itinéraire sur la route nationale 7 pour laquelle un bureau d'études sera recruté prochainement. Cette étude doit permettre d'articuler de manière pertinente les projets de développement du territoire et le bon fonctionnement des infrastructures de transport. Elle servira de base de discussion à l'occasion de la prochaine contractualisation pour les projets relatifs à la route nationale 7.
Enfin, s'agissant des deux demi-échangeurs sur l'autoroute A7 dans le nord de la Drôme et le nord de l'Ardèche que vous mentionnez, madame la députée, ils sont maintenus dans le projet de plan d'investissement autoroutier lancé en juillet 2016, sur lequel l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a rendu ses avis en juin 2017.
Il revient désormais au Conseil d'État d'examiner les projets de décret approuvant les projets d'avenant aux conventions de concession relatifs à ce plan d'investissement.

La parole est à M. Fabien Roussel, pour exposer sa question, no 198, relative au maintien des lignes ferroviaires.

Ma question s'adresse à Mme la ministre chargée des transports.
La question de la rénovation des 9 000 kilomètres de lignes SNCF qualifiées de non rentables est aujourd'hui posée.
Le Gouvernement dit ne pas vouloir fermer ces lignes, mais qui financera leur entretien, alors qu'elles se trouvent essentiellement en milieu rural et qu'elles n'ont pas été entretenues par la SNCF ces trente dernières années ? Le directeur délégué de SNCF Réseau a récemment affirmé dans La Voix du Nord, notre journal régional, que « le rôle de la SNCF Réseau ne peut pas être le financement de travaux importants sur les petites lignes ».
Dans ma région des Hauts-de-France, il s'agit des lignes reliant Lourches à Valenciennes, Cambrai à Douai, Lille à Comines, Saint-Pol à Arras ou encore Saint-Pol et Étaples.
Oui, nous sommes inquiets, d'autant que les pires hypothèses circulent, selon lesquelles soit la région devrait décider de reprendre ces lignes et d'entretenir les voies, soit ces dernières seraient carrément remplacées par des autocars ou de l'autopartage.
Alors, info ou intox ? Nous avons besoin d'y voir clair, et ce d'autant plus que le président des Hauts-de-France a plutôt envie d'aller vite dans l'ouverture à la concurrence, ce qui nous inquiète également.
Si votre projet est de laisser le soin aux régions de rénover ces lignes dans le cadre des contrats de plan État-région – CPER – , c'est un marché de dupes, car il s'agit d'une dépense nouvelle, y compris dans ces contrats de plan. Les collectivités n'auront absolument pas les moyens de financer les travaux, surtout avec les baisses de dotations prévues par le Gouvernement. Dans les Hauts-de-France, le montant a déjà été évalué à 400 millions d'euros.
Ces lignes, tellement utiles aux travailleurs ou aux écoliers qui vivent en zone rurale, sont des trésors de vie dans nos campagnes. Même modestement, elles contribuent à relever le défi climatique, en évitant le transport par autocar.
Enfin, ce projet va opposer les régions riches aux régions pauvres, celles qui auront les moyens d'investir dans l'entretien des voies, dans les trains express régionaux – TER – et celles qui ne pourront pas le faire, y compris dans le cadre des CPER. Nous sommes loin du principe de notre République, visant à offrir l'égalité du service public en tout point du territoire, du nord au sud, de la ville à la campagne.
Ainsi, le Gouvernement peut-il nous donner des précisions sur la future gestion de ces mal nommées « petites lignes » ainsi que sur les moyens que l'État doit débloquer en urgence pour leur entretien et leur modernisation ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le député, vous interrogez Élisabeth Borne, ministre chargée des transports. Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre.
En premier lieu, je tiens à réaffirmer que le Gouvernement a pleinement conscience de l'importance des lignes ferroviaires dites de maillage, pour la vitalité des territoires traversés. Contrairement à ce que vous avez laissé entendre dans votre question, nous ne voulons en aucun cas les laisser tomber.
Comme vous en êtes vous-même bien conscient, après des décennies de sous-investissement, l'état du réseau de ces lignes est en effet préoccupant. Les besoins de remise à niveau des 9 000 kilomètres de lignes concernées s'élèvent ainsi à près de 5 milliards d'euros pour la prochaine décennie.
Parallèlement, les besoins sur le réseau structurant sont également considérables. Le Gouvernement s'est d'ores et déjà engagé à consacrer 3,6 milliards d'euros par an dans les dix prochaines années pour la rénovation du réseau structurant, soit 50 % de plus que pendant les dix dernières années.
Dans ce contexte, je tiens à réaffirmer que le Gouvernement ne souhaite pas arrêter d'investir dans les lignes les moins circulées du réseau. Dans son discours du 26 février 2018, le Premier ministre l'a très clairement rappelé : « Ce n'est pas une réforme des petites lignes. Je ne suivrai pas le rapport Spinetta sur ce point ».
Les lignes à faible trafic sont nécessaires au transport du quotidien de très nombreux Français, domaine dont, comme vous le savez, le Gouvernement a fait une priorité. Ces lignes desservent des territoires très divers, y compris des zones rurales avec souvent peu d'offre, et au bénéfice desquelles le Gouvernement est particulièrement mobilisé, dans le cadre de son action en faveur de la mobilité pour tous.
Le financement de la régénération de ces lignes est assuré à la fois par l'État et par les régions dans les contrats de plan État-région. L'engagement de l'État à investir 1,5 milliard d'euros pour la remise à niveau de ces lignes dans le cadre des contrats de plan État-région y sera donc tenu.
Comme vous vous en doutez, monsieur le député, les évolutions futures du réseau ne doivent pas être faites de manière unilatérale. Elles doivent avoir lieu avec les régions, cofinanceurs des CPER et autorités organisatrices des services ferroviaires, dans le cadre de la révision des CPER, et dans une discussion responsable et équilibrée.
Sur ce point, je le répète, nous n'avons pas suivi la recommandation du rapport Spinetta. Pour nous, plus que jamais, les petites lignes sont d'une importance fondamentale.

Cette réponse ne nous rassure pas car le Gouvernement entend bien renvoyer aux régions l'entretien, la rénovation et la modernisation de ces lignes, y compris dans le cadre des contrats de plan État-région. Ces dépenses, qui n'étaient pas prévues, aggraveront les difficultés des collectivités, notamment les difficultés budgétaires des régions, dans une période de baisse des dotations. Cette situation nous inquiète donc fortement.

La parole est à M. Stéphane Peu, pour exposer sa question, no 199, relative à la participation de l'État dans Aéroports de Paris.

Ma question s'adresse à Mme la ministre des transports.
Un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2017, en progression de 22,7 % par rapport à 2016. Un géant économique qui pèse 570 860 emplois directs et indirects, soit 2,2 % de l'emploi en France et 8 % de celui de l'Île-de-France, et qui représente aussi 1,4 % du PIB de la France et 42 % du produit intérieur brut de la Seine-Saint-Denis.
Je présume, madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, que vous savez que ces très saines données économiques sont celles d'Aéroports de Paris. J'ajoute, pour compléter le tableau, que l'avenir est encore plus radieux, si l'on considère que le trafic aérien mondial doit doubler dans les vingt prochaines années.
Les dividendes versés aux actionnaires d'ADP atteignent 261 millions d'euros, et l'État empoche 50,6 % de cette somme, à hauteur du capital qu'il détient. L'entreprise constitue la cinquième source de dividendes pour l'État.
ADP est un patrimoine et un savoir-faire remarquables, que l'État a pourtant décidé de brader. Vous voulez non plus seulement diminuer la part de l'État, comme l'avait fait François Hollande en 2013 lorsqu'il avait déjà cédé 13 % d'ADP à Vinci et à une filiale du Crédit agricole, mais aussi vous désengager en totalité.
Si cette volonté n'a aucune justification industrielle, elle comporte, en revanche, plusieurs dangers. Le premier est géostratégique, puisque Roissy-Charles-de-Gaulle est la première frontière de France. Nous devons conserver la maîtrise publique de nos aéroports quand ils ont cette dimension de frontière.
Le second concerne Air France, puisque notre compagnie aérienne nationale peut être totalement ligotée. Étant en situation de monopole, ADP pourra en effet imposer des conditions et des tarifs qui mettront cette compagnie dans les plus grandes difficultés, sans qu'elle puisse s'en dégager.
Plus de trente ans après le processus de privatisation des autoroutes, qui s'est soldé en 2006 par une grande braderie, offrant une véritable machine à cash à Vinci, vous voulez repaître à nouveau son gros appétit en 2018.
Les syndicats aéroportuaires, notamment la CGT, par la voix de son secrétaire Daniel Bertone, alertent sur une situation de quasi-monopole, qui donnerait à Vinci la possibilité de dicter à l'État ses choix en matière de transport aérien, sans que celui-ci ne puisse plus réguler.
Bien entendu, les députés communistes sont totalement défavorables à ces visées de privatisation, comme nous l'étions déjà au début des années 2000, notamment par la voix de mon prédécesseur, François Asensi.
La privatisation est néfaste pour cinq raisons majeures. Elle est néfaste pour l'emploi et le modèle social d'ADP ; pour les investissements aéroportuaires, qui seraient sacrifiés sur l'autel de la rentabilité à court terme ; pour l'unité et la complémentarité du système aéroportuaire parisien, avec un possible démantèlement d'ADP ; pour la maîtrise du foncier, avec le risque d'une spéculation nocive pour les communes alentours et leurs habitants ; pour la maîtrise de la sûreté nationale, avec le contrôle de la première frontière française sous pilotage privé.
En conclusion, madame la ministre des transports – pardon : madame la secrétaire d'État, non pas madame la ministre des transports, malheureusement –,
Sourires

je souhaite vous poser une question à double détente.
Vous apprêtez-vous à céder totalement ADP pour le laisser tout entier dans la corbeille du privé, afin de réconforter de grands groupes comme Vinci ? Est-ce, de la part du Gouvernement, une compensation accordée à Vinci après l'arrêt définitif du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ?
Avez-vous décidé d'enlever à la nation ce fleuron stratégiquement décisif et économiquement rentable pour l'unique raison qu'après trente années de privatisations en cascade, il ne reste que des actifs stratégiques à livrer au capital ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur Peu, je ne suis effectivement pas la ministre des transports, et j'en suis désolée pour vous, mais je vous réponds à sa place puisqu'elle n'a pu être présente aujourd'hui.
Je vous rassure immédiatement : l'État n'est absolument pas en train de comploter avec Vinci dans le dos des Français. Vous le savez, aucune décision relative à des cessions d'actifs n'a été prise pour l'instant par le Gouvernement. Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances ont indiqué que le fonds destiné à financer l'innovation de rupture, qui vient d'être créé, serait progressivement doté de 10 milliards d'euros, issus de produits de cessions de participations. Plusieurs scénarios sont à l'étude mais, je le répète, aucune décision n'a été prise pour le moment, qu'il s'agisse d'Aéroports de Paris ou d'autres actifs.
En admettant qu'une décision soit prise, et si le Gouvernement décidait que l'État se retire en tout ou partie du capital de la société Aéroports de Paris, une loi devrait être soumise au Parlement. En toute hypothèse, cette loi prévoirait les dispositions nécessaires pour renforcer les leviers qui sont à la main de l'État en matière de régulation, de contrôle des investissements et de qualité du service aéroportuaire – c'est tout simplement la loi, monsieur le député. Par ailleurs, l'État conserverait évidemment ses prérogatives en matière de surveillance de la sécurité et de la sûreté des plateformes, de contrôle aérien et d'attribution des créneaux horaires. Enfin, les tarifs des redevances aéroportuaires demeureraient naturellement soumis au contrôle du régulateur indépendant.
Vous le voyez, monsieur le député, en aucun cas il ne s'agit de laisser libre cours à des intérêts privés qui voudraient nuire à l'économie française et aux Français. Je le répète, aucune décision n'a été prise.

La parole est à Mme Catherine Osson, pour exposer sa question, no 217, relative à l'unité médico-légale de l'hôpital de Roubaix.

Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
En août 2017, le service de médecine légale de l'hôpital de Roubaix a été fermé, ce qui oblige les victimes de violences et d'agressions à se déplacer désormais jusqu'à l'unité médico-judiciaire – UMJ – de Lille.
Alors que le Gouvernement a fait de l'accompagnement des victimes l'une des trois priorités du quinquennat dans le cadre de la grande cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, je ne peux comprendre que l'on supprime un service de proximité aussi essentiel à la lutte contre les violences et à l'accompagnement des victimes.
Lorsque l'on est victime d'un viol, d'une agression sexuelle, d'un vol avec violences ou de violences conjugales, porter plainte au commissariat est déjà une épreuve. L'éloignement géographique des services de l'État accroît le risque de report des démarches, voire de renonciation à celles-ci. En outre, plus le temps passe, plus les preuves risquent de disparaître.
Par un courrier daté du 7 mars, vous m'avez présenté les deux raisons qui ont justifié la fermeture du service de Roubaix. Premièrement, le nombre de médecins au sein de l'UMJ de Lille serait suffisant pour assurer l'activité dont le service de Roubaix avait la charge. La deuxième raison était que « l'UMJ de Lille étant située à 14,5 kilomètres de la ville de Roubaix, le développement du réseau de transports en commun permet de répondre aux besoins des usagers ».
Fonder la décision de supprimer le service de Roubaix sur ces seules considérations statistiques me semble être une erreur. Ce faisant, on ne tient compte ni de la réalité ni des spécificités du territoire roubaisien. En 2014, le taux de pauvreté y atteignait 43 %. Les victimes d'agressions et de violences qui sont en situation de précarité n'ont pas les moyens d'assumer les frais de transport jusqu'à Lille.
Certes, il est prévu que les enquêteurs de police accompagnent ces personnes jusqu'aux centres médicaux, mais cette solution va à l'encontre de l'objectif défendu par le Président de la République qui consiste à recentrer les effectifs de police sur la protection de nos concitoyens sur le terrain. Ainsi, chaque heure passée par un policier à accompagner les victimes à Lille est une heure de moins passée à Roubaix à protéger la population des violences sur le terrain. Les besoins sur le territoire roubaisien, première zone de sécurité prioritaire de France, sont pourtant énormes : le taux de violence pour mille habitants y est 40 % plus élevé que la moyenne nationale.
Dans votre courrier, vous suggériez qu'une activité de consultation de victimes pourrait être réintroduite au sein du centre hospitalier de Roubaix. Ce serait une réelle avancée par rapport à la situation actuelle, mais je reste perplexe quant à sa capacité à répondre aux besoins des victimes. En effet, dans son rapport sur l'évaluation du schéma d'organisation de la médecine légale, l'inspection générale des finances alertait sur le fait que l'« institution occasionnelle d'antennes ou consultations avancées n'a que très partiellement amélioré » la situation et que, pour treize juridictions qui en bénéficiaient en 2013, « à peine plus d'un quart de ces antennes serait [… ] opérationnel tous les jours de la semaine et la proportion de celles qui le seraient la nuit et les fins de semaine est encore plus faible ».
Mme la garde des sceaux entend-elle tenir compte de cette réalité et faciliter la réouverture d'un service de médecine légale à Roubaix ? Dans l'éventualité de la réintroduction d'une activité de consultation de victimes au sein du centre hospitalier de Roubaix, qu'est-ce qui garantit que cette antenne ne connaîtra pas une situation similaire à celle décrite par l'IGF dans son rapport ?

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Je comprends parfaitement votre inquiétude, madame la députée, et je veux vous dire au nom de Mme la garde des sceaux combien nous sommes éloignés d'une approche comptable : notre approche est liée aux personnes – je vais y revenir. Le souci de proximité dont vous vous faites l'écho, en rapport avec les spécificités roubaisiennes, est un élément très important qui a été pris en considération par les services de Mme la garde des sceaux.
Vous le savez, nous avons un schéma directeur de la médecine légale du vivant qui est, pour la commune que vous évoquez, du ressort de la cour d'appel de Douai, dont relèvent les unités médico-judiciaires de Valenciennes, de Lille et de Boulogne-sur-Mer. Le centre hospitalier de Roubaix, vous l'avez dit, n'est pas répertorié dans ce schéma.
Ce n'est pas pour des raisons comptables. Dans les faits, une personne – un médecin – avait pris une initiative individuelle et isolée – ce qui n'enlève rien à la qualité du service qu'il rendait – que la direction de l'hôpital avait acceptée en 2012. Les actes réalisés dans ce cadre étaient donc financés sur frais de justice. Or leur volume ne permettait pas de pérenniser le poste. Cela a été établi grâce à des données chiffrées, mais liées à cette réalité personnelle.
Toutefois, compte tenu des spécificités roubaisiennes que vous avez à juste titre rappelées, il est important que des permanences soient organisées au sein du centre hospitalier de Roubaix. La ministre s'engage donc à ce que des permanences de l'UMJ de Lille soient assurées dans le centre hospitalier, à ce qu'elles soient régulières et se tiennent dans de très bonnes conditions, afin de réagir aux urgences que vous évoquez et de sorte que les mobilités ne soient jamais un obstacle à la qualité du service judiciaire qui doit être rendu.
Ce dispositif, déjà testé, semble donner toute satisfaction aux justiciables comme aux professionnels de la justice, notamment parce qu'il prend en considération les difficultés de déplacement des justiciables. Il importe que vous y prêtiez attention comme parlementaire de ce territoire : n'hésitez pas à nous faire part d'éventuels dysfonctionnements, Mme la garde des sceaux y sera très attentive.

La parole est à M. Jérôme Nury, pour exposer sa question, no 200, relative au tribunal de grande instance d'Argentan.

Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, représentée par M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite appeler votre attention sur la réforme de la carte judiciaire dans l'Orne.
Je sais que le Gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'était pas question de fermer purement et simplement des sites, ce qui, bien sûr, me rassure pour le tribunal de grande instance d'Argentan et pour le tribunal d'instance de Flers, dans ma circonscription.
Mais la fusion envisagée des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au niveau départemental n'est pas sans susciter de légitimes interrogations, notamment concernant la juridiction d'Argentan. En effet, il ne sera possible de constituer des pôles de compétence et de spécialiser les sites ornais – qui comptent aujourd'hui deux TGI, Alençon et Argentan – qu'au détriment du personnel de la justice, au détriment des justiciables, au détriment de la justice elle-même, qui perdra en efficacité. Je ne veux pas croire que, derrière cette évolution qui consisterait à dévitaliser en douceur les sites concernés en les vidant de leurs compétences, grâce à l'anesthésiant des aimables engagements de Mme la garde des sceaux, il y ait l'idée de fermer ultérieurement des sites.
La justice de proximité est la condition indispensable d'une justice efficace, rapide et de qualité, notamment dans un département comme l'Orne où la population est disséminée sur un vaste territoire dépourvu de grandes villes et doit parcourir d'importantes distances pour se rendre dans nos villes moyennes.
En départementalisant et en spécialisant les tribunaux, on va éloigner la justice du justiciable en contraignant celui-ci à faire toujours plus de kilomètres sans transports en commun.
En départementalisant et en spécialisant, on va éloigner les magistrats et les personnels judiciaires du terrain ; on leur enlève ce qui fait aujourd'hui la réussite d'un TGI comme celui d'Argentan : la connaissance des enquêteurs, des situations, des détenus, la solidarité des équipes au sein des tribunaux.
Cette mesure de fusion des TGI serait d'autant plus incompréhensible que la juridiction d'Argentan est l'une des plus réactives de France : ses délais d'attente et d'audience sont parmi les plus courts.
Ma question est plutôt un voeu, adressé au Gouvernement : que deux TGI soient conservés dans l'Orne – c'est une impérieuse nécessité – , de sorte qu'Argentan conserve la totalité de ses compétences.

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Je comprends votre inquiétude, monsieur le député, et je vais tenter, au nom de la garde des sceaux, de vous rassurer une nouvelle fois.
Je vous comprends d'autant mieux que j'ai le souvenir, lorsque j'étais maire d'une sous-préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, d'avoir appris un jour par une dépêche AFP la fermeture du tribunal d'instance de cette commune – Forcalquier. À l'époque, la garde des sceaux s'appelait Rachida Dati. Je sais donc les conséquences qu'une telle décision peut avoir sur un territoire, surtout lorsque fait défaut la consultation en amont que l'actuelle ministre a souhaité engager.
Vous le savez, le Premier ministre et la garde des sceaux ont lancé, en octobre dernier, cinq chantiers en vue de réformer profondément notre justice pour que, conformément à la volonté de tous, la justice soit rendue plus rapidement et plus efficacement. Parmi ces chantiers figurait l'adaptation de notre réseau judiciaire. Je suis conscient des inquiétudes qui sont alors nées, mais je crois que nous avons maintenant, concernant votre département comme le reste du pays, des éléments propres à rassurer chacun.
Acteurs de terrain et élus ont toujours été consultés, afin de faire émerger un diagnostic et des propositions très concrètes. Ces propositions ont ensuite été remises à la garde des sceaux, et c'est sur leur fondement que celle-ci a ouvert un cycle de concertations avec les représentants du monde de la justice, notamment les syndicats, les représentants des avocats et des magistrats et ceux des professions réglementées. J'insiste sur l'importance du choix de cette méthode : aucune décision n'a été prise par avance.
Il est ressorti de ces échanges les propositions que vous connaissez et que vous avez évoquées. Un projet de loi à ce sujet sera présenté par le Gouvernement d'ici à l'été. Les cours d'appel seront maintenues dans leurs compétences actuelles, et les tribunaux de grande instance seront préservés dans les mêmes conditions.
Les tribunaux d'instance demeureront là où ils sont implantés dans votre département. Ils seront organiquement rattachés au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils se trouvent, afin d'améliorer leur gestion, et il est possible que les autorités de justice locales décident d'évolutions concernant non pas leur localisation, mais des spécialisations, et ce sur proposition des chefs de cour, après consultations locales. L'avantage serait de disposer, étant donné la difficulté du droit, de magistrats et d'équipes spécialisés, capables d'apporter toutes les réponses aux questions qui se poseront.
Je le répète, je veux vous rassurer au nom de la garde des sceaux : les tribunaux de grande instance d'Alençon et d'Argentan seront maintenus comme juridictions de plein exercice, avec leurs prérogatives. Rien ne changera avec l'adoption de la loi par cette assemblée puis par le Sénat.

Merci, monsieur le secrétaire d'État, de votre réponse, qui va dans le bon sens.
Je tiens à préciser qu'Argentan accueille également l'un des plus importants centres de détention de France, comptant près de 630 places : cela nécessite un solide volet d'application des peines et la présence de deux juges d'application des peines à proximité. Ces missions exigent un dialogue constant avec le parquet, qui ne pourrait se tenir à distance en cas de délocalisation desdits juges. De même, il est impératif de conserver un juge d'instruction à Argentan, car la présence du centre de détention, avec ses violences, ses trafics, ses suicides, nécessite une politique pénale réactive, impliquant aussi l'ouverture d'informations.
Je réitère donc ma demande au Gouvernement, soutenu par les professionnels de justice, par les habitants et les élus argentanais : il est indispensable de conserver au tribunal d'Argentan l'ensemble de ses prérogatives actuelles. Nous serons vigilants à cet égard et continuerons de nous mobiliser à cette fin.

La parole est à M. François André, pour exposer sa question, no 219, relative au transfert de la compétence « eau potable » et au solde des budgets annexes communaux.

Ma question concerne les modalités financières qui s'attachent aux transferts de compétences des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale – les EPCI – dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », et plus particulièrement au transfert des résultats cumulés des budgets annexes « eau potable » – les soldes budgétaires en quelque sorte. Une commune peut gérer un service public industriel et commercial sous la forme d'une régie dotée d'une autonomie financière. Ces opérations sont retracées au sein de budgets annexes qui doivent être équilibrés sans recours au budget principal.
Dans le cadre d'un transfert de compétences, la mise à disposition des biens recouvre les biens meubles, immeubles et les droits et obligations dévolus à la compétence, tel que constaté à la date du transfert. Reste à définir si le solde du budget annexe – en excédent ou en déficit – est constitutif d'un droit ou d'un bien meuble, auquel cas, sous couvert d'accord entre les parties sur sa répartition, au moins une partie devrait en être transférée.
Il était jusqu'à présent considéré de façon constante par les autorités ministérielles que les soldes des budgets annexes, qu'ils soient positifs ou non, devaient être transférés en même temps que l'exercice de la compétence. Or, un arrêt récent du Conseil d'État, dit « La Motte-Ternant », du 25 mars 2016 pose le principe que le solde du budget annexe ne constitue pas un bien nécessaire à l'exercice d'un service public. En conséquence, le transfert de la trésorerie ne s'impose pas, ce qui laisse donc ouverte la possibilité d'un accord amiable sur les modalités de la répartition des soldes. Cette jurisprudence pose question.
D'abord, cet excédent est financé par les usagers d'une commune sur leur facture d'eau et doit donc continuer de servir à financer les dépenses liées à l'eau et elles seules. Ensuite, l'absence de transfert du solde pourrait amener demain certains EPCI ayant hérité de la compétence à emprunter ou à augmenter les tarifs en vue de réaliser les investissements nécessaires, ce qui reviendrait à faire payer une seconde fois les usagers de la commune pour le même objet. Aussi, je souhaiterais connaître l'interprétation que le Gouvernement donne du droit en la matière et savoir si, de son point de vue, une clarification ne s'imposerait pas, afin que les redevances des usagers demeurent affectées au financement du service concerné et ne viennent pas indûment alimenter, à la faveur du transfert de compétences, les budgets généraux les communes.

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le député, le charme des questions orales sans débat est que l'on descend à des niveaux qui pourraient paraître très techniques, mais qui, pour ceux qui ont comme vous l'expérience du terrain, relèvent de problématiques qui se posent aux élus de façon très régulière. Je tiens à vous rappeler la volonté du Gouvernement de laisser plus de liberté aux territoires pour s'organiser, avec l'aide du Parlement. C'est ainsi qu'une proposition de loi, qui sera prochainement en discussion au Sénat, a été adoptée par cette assemblée le 31 janvier dernier, sur la question du transfert automatique de l'eau et de l'assainissement, avec une double échéance. Il est essentiel que ce soient les élus locaux qui puissent décider de ce qui est bon ou pas pour leur territoire.
Vous me demandez de vous donner la lecture du droit que fait le Gouvernement. Sachez qu'il se plie bien évidemment, pour l'analyse juridique, à la haute autorité qu'est le Conseil d'État, selon lequel le transfert n'est aujourd'hui pas obligatoire. Une évolution législative pourrait conduire le Conseil d'État à se prononcer différemment, mais ce n'est pas ce qui est prévu, notamment dans le texte actuel de la proposition de loi que j'évoquais.
S'agissant de ce transfert, le Conseil d'État apporte deux précisions. Il n'interdit pas qu'un accord entre les représentants des communes et ceux de l'EPCI ait lieu pour obtenir le transfert des montants évoqués. Par ailleurs, vous avez dans votre question une approche positive : …
… celle d'un crédit. On peut cependant imaginer la situation inverse, avec un transfert négatif pour l'EPCI. Aucun amendement tendant à rendre obligatoire le transfert des crédits afférents, en positif ou en négatif, n'avait été retenu, de crainte que cela ne bloque le système. Nous pensons, au nom de la liberté, que la discussion pour définir les transferts doit avoir lieu entre les communes et les EPCI.
Pour conclure, sachez, monsieur le député, que le Gouvernement a fait de la gestion du petit cycle de l'eau l'une de ses priorités. J'en prends pour preuve la tenue prochaine des assises de l'eau. La phase de concertation au cours de laquelle sont associés des élus locaux et des professionnels du secteur ne manquera pas d'apporter des solutions concrètes adaptées qui seront, je l'espère, à la hauteur de vos attentes et de celles de nos concitoyens, et qui nous conduiront peut-être à proposer une évolution législative qui permettra au Conseil d'État d'interpréter différemment la règle de droit s'appliquant aujourd'hui.

Je comprends parfaitement l'interprétation que vient de donner M. le secrétaire d'État de la loi et surtout de la jurisprudence. Je crains néanmoins que d'ici au transfert, rendu possible jusqu'en 2026, si la proposition de loi est adoptée, nous ne soyons confrontés à des discussions picrocholines entre les EPCI et les communes membres.
Je me demande si des précisions d'ordre réglementaire ne pourraient pas être apportées afin que l'usager de l'eau n'en vienne pas à payer deux fois les investissements : la première au titre des redevances passées ayant donné lieu à des excédents ; la seconde par les EPCI héritiers de la compétence, qui seraient conduits à augmenter la redevance.

La parole est à Mme Michèle Crouzet, pour exposer sa question, no 212, relative à l'effectif d'officiers de police judiciaire dans l'Yonne.

Ma question porte sur le déficit du nombre d'officiers de police judiciaire dans le département de l'Yonne, où je suis élue. Dans son discours aux forces de sécurité intérieure, le mercredi 18 octobre 2017, le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la création de 10 000 emplois supplémentaires, sur la durée du quinquennat, au sein des forces de sécurité et pour les services de renseignement. Dès 2018, ce sont 1 400 emplois qui seront créés au sein de la police nationale. Il s'agit de la part de notre gouvernement d'un effort significatif, qu'il convient de saluer, d'autant plus qu'il intervient en période de baisse des effectifs publics.
Néanmoins, j'ai pu constater, dans ma circonscription, que le problème ne relève pas tant de la quantité des effectifs de police et de gendarmerie nationales que de leur qualification. En effet, le peu d'officiers gradés présents ne se maintiennent pas durablement dans l'Yonne. Ce manque de qualification au sein de nos effectifs empêche malheureusement d'apporter une réponse pénale efficace au justiciable. La défaillance du nombre d'officiers de police judiciaire dans le territoire est notamment due au défaut d'attractivité dont souffre le département.
Situé dans la troisième couronne parisienne, il est confronté au même type de délits que ceux qui surviennent en Île-de-France. Il affiche d'ailleurs un taux de délinquance générale important, bien qu'il soit en baisse de 8,8 % en 2017 par rapport à 2016. Cette diminution s'explique, en partie, par l'occupation du terrain et la montée en puissance de dispositifs préventifs. Quelles dispositions pourraient être mises en oeuvre pour encourager la formation auprès des gendarmes et quelles contreparties, par exemple en termes d'évolution professionnelle, pourraient être proposées pour les inciter à rester dans l'Yonne et ainsi assurer une réponse pénale efficace ?
Ah, vous nous aviez manqué, monsieur Di Filippo !

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Madame Crouzet, en matière de sécurité, qu'il s'agisse de terrorisme ou de délinquance quotidienne, les attentes des Français et de leurs élus sont grandes. C'est pour cela que le Gouvernement en a fait une priorité et a doté nos forces de l'ordre de moyens supplémentaires, notamment par la création de 10 000 postes durant le quinquennat.
Toutefois, il faut aussi, comme vous l'avez démontré avec l'exemple que vous avez donné, des réformes en profondeur. La police de sécurité du quotidien est un élément de réponse, quand certains ont pu préférer l'époque où l'on supprimait 12 500 postes dans les effectifs de police et de gendarmerie.
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la justice essaient de définir des stratégies locales de sécurité, placées sous l'autorité des préfets dans chaque département. Ces chantiers doivent porter leurs fruits, dans l'Yonne comme ailleurs, car les principes de la police de sécurité du quotidien s'appliquent sur tout le territoire.
S'agissant de l'Yonne, votre question met en avant les déséquilibres existant dans certains territoires, plus ruraux que d'autres, qui peuvent sembler moins attractifs – n'y voyez pas d'injure, le député des Alpes-de-Haute-Provence que j'ai été connaît aussi ces difficultés. Les effectifs de la sécurité publique dans votre département comptent, au 28 février 2018, 210 sous-officiers de gendarmerie – soit 49,5 % des effectifs du groupement contre une moyenne nationale de 54 % – et 35 gradés et gardiens de la paix ayant la qualification d'officiers de police judiciaire. Le décalage que vous avez souligné dans votre question est bien réel. Parmi ces personnels, 22 sont affectés dans les services d'investigation, qu'il est essentiel de renforcer. Des réflexions sont déjà en cours concernant l'ouverture de deux postes dans le cadre du prochain mouvement de mutation dit « profilé ». Mais je tiens aussi à souligner que les services territoriaux de la sécurité publique dans ce département sont en augmentation, en passant de 221 agents à la fin de l'année 2016 à 231 agents à la fin du mois de février 2018. Telles sont les conséquences très concrètes des augmentations des effectifs dans notre gendarmerie nationale.
Pour la gendarmerie nationale, la formation à la qualification d'officiers de police judiciaire est pilotée par la région de gendarmerie pour répondre aux actuels déséquilibres départementaux. En 2018 aura lieu une arrivée massive de jeunes gendarmes n'ayant pas encore acquis toute l'expérience nécessaire. Il faudra trouver le point d'équilibre entre les gradés et les non-gradés.
Enfin, pour fidéliser les officiers de police judiciaire ou pourvoir des postes vacants, la direction générale de la gendarmerie nationale impose aux militaires nouvellement qualifiés de demeurer au moins quatre ans dans leur région d'appartenance. De plus, un appel à volontaires annuel est diffusé aux gradés des régions voisines pour leur permettre d'occuper des postes d'encadrement et de commandement dans les régions déficitaires. La mobilisation de l'État, en lien avec les élus des territoires, est donc totale ; mais elle doit aussi, vous le savez, pouvoir s'appuyer sur l'engagement de tous ses partenaires locaux, au premier rang desquels les collectivités territoriales, qui sont des acteurs essentiels de la prévention et de la sécurité pour apporter des réponses très concrètes aux enjeux de sécurité, ainsi qu'il l'est nécessaire dans l'Yonne mais aussi dans le reste de la France.

La parole est à M. Adrien Morenas, pour exposer sa question, no 222, relative aux dysfonctionnements de l'Agence nationale des titres sécurisés.

L'accessibilité du site de l'Agence nationale des titres sécurisés – l'ANTS – est difficile à certaines heures, voire totalement impossible pendant toute une journée en raison du fait que le site ne répond pas. La durée d'attente auprès du service de maintenance téléphonique peut parfois atteindre plusieurs dizaines de minutes, sans que l'on parvienne à obtenir un interlocuteur, alors même que l'appel est facturé. Lorsque vous finissez par réussir à échanger avec un agent, on vous renvoie parfois à la cellule web à laquelle il faut exposer sa difficulté par mail, avec un délai de traitement de plus de quinze jours.
On dénombre de nombreux problèmes lors de la validation des demandes en ligne, sans que la raison en soit précisée – mis à part ce message laconique : « Divergence entre le portail ANTS et les données saisies » – , ce qui oblige à appeler l'agence. Il faut également noter l'impossibilité récurrente de valider une demande en ligne si l'adresse mail fournie par l'utilisateur a déjà servi sur un autre site officiel, ce qui oblige parfois à créer une adresse mail dédiée. On ne compte plus les problèmes de plateforme entre les auto-écoles et les candidats, les difficultés de créations de compte en ligne, les refus de réutilisation des photos numériques à la suite du refus du dossier, les dossiers en instruction pendant plus de quarante jours ou encore l'impossibilité de rajouter les pièces manquantes en ligne à un dossier en souffrance – tout cela devant s'effectuer dans le délai de sept jours imposés pour validation complète, sous peine de clôture du dossier entraînant une reprise à zéro de ladite procédure.
Quelles actions le ministre d'État, ministre de l'intérieur compte-t-il mettre en place, afin de pallier au plus vite l'ensemble des dysfonctionnements qui perturbent de manière sérieuse notre service public, tout en entravant la mobilité d'un grand nombre de nos concitoyens ?

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le député, ceux qui connaissent Alfred Jarry et son Ubu se disent parfois qu'il aurait pu créer certains des logiciels auxquels nous nous heurtons. Vous décrivez de fait une situation que beaucoup d'entre nous ont pu connaître. Il ne faut cependant pas négliger l'amélioration du service grâce au plan préfectures nouvelle génération. Cette réforme vise à moderniser, dans la ligne des orientations du Président de la République sur la transformation numérique du service public, les processus de délivrance des titres. Il est en effet plus simple pour nos concitoyens d'effectuer leur demande de titres par la voie numérique chez eux, plutôt que d'aller dans les sites ouverts en nombre assez limité dans nos départements – le Vaucluse, par exemple, le sait bien.
Depuis cinq mois, plus de 2 millions d'opérations sur les cartes grises ont été effectuées, plus d'1 million d'inscriptions à l'examen réalisées et autant de permis délivrés après une demande par internet. Donc oui, le système s'améliore. Et pourtant ce que vous dites est totalement exact car, on le sait, pour tout nouveau système d'information de grande ampleur, des difficultés techniques peuvent apparaître, et sont en l'occurrence apparues. Elles concernent heureusement une minorité de dossiers ; mais même minoritaires, elles restent inacceptables. La résolution des problèmes est d'ores et déjà largement avancée et mobilise pleinement les équipes du ministère de l'intérieur. Les lenteurs de connexion au site de l'ANTS que l'on a pu constater au début sont en nette diminution, et devraient s'atténuer encore avec la création d'un site plus ergonomique. Des dysfonctionnements techniques ont également été constatés dans les procédures de télétransmission des demandes ; vous en avez évoqué quelques-uns. Il faut évidemment y remédier car même si des correctifs ont rapidement été apportés, personne ici ne peut sous-estimer les conséquences pour les professionnels comme pour les particuliers, en particulier l'allongement des délais d'obtention de ces documents.
Vous avez également évoqué la difficulté, pour certains usagers, d'obtenir des informations ou de parvenir à finaliser leur demande ; là encore, il faut agir. Le centre de contact citoyen de l'ANTS permet de répondre par téléphone ou par courriel aux questions des usagers ; il existe des lignes dédiées. Puisque vous avez mentionné le temps d'attente – long sinon interminable – , je précise que nous avons augmenté le nombre de téléconseillers de 48 au début 2017 à 175 début 2018. Pour ceux qui ne disposent pas de la possibilité d'utiliser internet à leur domicile – certains Français sont en rupture de technologie, soit faute de matériel soit faute de connexion – , 305 points numériques ont été installés dans les préfectures et sous-préfectures. L'ensemble de ces mesures traduit l'engagement du Gouvernement – qui partage les exigences légitimes que vous exprimez dans votre question – à garantir un service de qualité sur l'ensemble du territoire national.

Je prends bonne note de toutes les améliorations apportées par le ministère et je resterai vigilant dans ce domaine. Je vous remercie.

La parole est à M. Philippe Dunoyer, pour exposer sa question, no 227, relative au retour des policiers calédoniens sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Comme vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, la situation en matière de sécurité est extrêmement préoccupante. La délinquance a augmenté de 30 % en un an, les cambriolages de plus de 37 %, les violences physiques de 10 %, avec une augmentation sans précédent des violences intrafamiliales – dans ce domaine, la Nouvelle-Calédonie occupe la première ou la deuxième place sur le triste podium national. La violence tend à se banaliser, en particulier chez les jeunes : 25 % des personnes impliquées dans la délinquance générale sont mineures.
Devant ces chiffres alarmants et la vague d'exaspération des habitants qui les accompagne, de nouveaux renforts d'effectifs de sécurité sont attendus. Ils sont nécessaires, et il est urgent de les envoyer. Le sujet est évoqué en ce moment même à Matignon où se tient le XVIIe comité des signataires. Bien entendu, je partage l'objectif affiché par le ministre de l'intérieur de créer une police sur-mesure, qui connaisse parfaitement son territoire et les attentes des citoyens. Je n'oublie pas non plus que le choix de retenir quelques quartiers de Nouméa dans la première liste des « territoires de reconquête républicaine » induit l'arrivée, d'ici à la fin 2018, d'une vingtaine de policiers environ en renfort.
Cependant je tiens à rappeler que, sur une quarantaine de policiers originaires de Nouvelle-Calédonie, affectés aujourd'hui en métropole et qui souhaitent rentrer en Nouvelle-Calédonie, une quinzaine remplit parfaitement les conditions de retour. Dans le contexte de recrudescence préoccupante de la délinquance générale, le retour rapide de ces policiers aguerris, connaissant parfaitement les spécificités humaines et sociales du contexte local calédonien dont ils sont eux-mêmes issus, contribuerait à renforcer efficacement les effectifs en place. Dans la perspective de renforts de sécurité annoncés le 8 mars dernier par le haut-commissaire de la République, le Gouvernement entend-il accorder la priorité aux policiers calédoniens qui demandent à revenir servir l'État sur leur île ?

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur Dunoyer, vous avez à juste titre évoqué le comité des signataires, qui se réunit aujourd'hui pour se pencher sur divers sujets ; celui de la sécurité en Nouvelle-Calédonie exige la mobilisation constante du Gouvernement. Vous savez également que le Livre bleu sur l'outre-mer, qui sera remis en mai au Président de la République, marquera une étape importante dans les relations entre l'État et les outre-mer et témoignera de l'attention que nous portons à ce sujet.
Vous avez évoqué des chiffres que personne ne conteste ici et qui montrent que la Nouvelle-Calédonie est confrontée à d'importants défis sécuritaires. Même si des engagements ont été pris en matière d'effectifs et commencent à produire leurs effets, reste la question de la qualité et de l'expérience des femmes et des hommes mobilisés dans ce territoire.
Les renforts annoncés, notamment dans le cadre du plan sécurité outre-mer de juin 2016, lancé par le gouvernement précédent, se sont concrétisés. Nous poursuivons l'effort : à la fin de l'année 2015, 539 agents étaient mobilisés en Nouvelle-Calédonie ; ils sont aujourd'hui 563 et, comme attendu – par vous, monsieur le député, mais aussi par la population – , d'ici à la fin du mois d'août 2018, ils seront 573 ; d'ici à la fin de l'année, le chiffre augmentera encore. Il est important que l'enjeu de la sécurité en Nouvelle-Calédonie soit traité comme partout ailleurs, mais il faut aussi tenir compte des spécificités de ce territoire. Comme vous l'avez rappelé, dès la première vague de septembre 2018, il y aura un quartier de reconquête républicaine à Nouméa, dans les quartiers Pierre-Lenquette, Montravel et Tindu. Il est essentiel de réhabiliter la place de nos forces de sécurité et de rétablir la présence républicaine. Les quartiers de reconquête républicaine constituent une déclinaison renforcée de la police de sécurité du quotidien dans certains territoires particulièrement confrontés à l'insécurité et aux trafics.
J'en viens plus directement à votre question, qui concerne les fonctionnaires originaires de Nouvelle-Calédonie. Il est important de prendre en compte à la fois le choix personnel des agents qui veulent retourner dans les terres qui les ont vus naître, mais aussi l'efficacité que la connaissance d'un territoire et de ses cultures – dont nous connaissons l'importance en Nouvelle-Calédonie – permet de rehausser.
Je rappelle tout d'abord que le ministère de l'intérieur est naturellement soucieux de favoriser, dans toute la mesure du possible et dans le respect des règles, le retour des agents dont le centre des intérêts matériels et moraux se trouve outre-mer. Pour les affectations en Nouvelle-Calédonie, les postes sont ouverts au mouvement polyvalent de mutation selon les mêmes conditions que pour les autres départements de métropole et départements et collectivités d'outre-mer, mais le choix des agents retenus se fait évidemment en priorité en faveur des personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, à la condition bien entendu qu'elles remplissent les conditions statutaires nécessaires pour obtenir une mutation. Par ailleurs, il faut noter que le mouvement de mutation dit « profilé », c'est-à-dire pour des profils spécialisés – renseignements territoriaux, officiers de police judiciaire – , se heurte aujourd'hui à la faiblesse du vivier, qui nous conduit parfois à affecter des agents non originaires de Nouvelle-Calédonie, même si, là aussi, la priorité est accordée si possible aux Néo-Calédoniens.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse et pour les perspectives très encourageantes qu'elle laisse entrevoir. Vos propos confirment le nombre des agents, y compris originaires de la Nouvelle-Calédonie, venus renforcer les effectifs du commissariat de police de Nouméa. Je n'ignore pas les difficultés statutaires et professionnelles, ni la nécessité de réunir les conditions préalables à ces retours, mais je retiens que lorsque ces conditions sont remplies, dès lors qu'un mouvement sera prévu et que les commissions administratives paritaires pourront se réunir, la priorité ira à ceux qui voudront revenir sur leur île. Je vous remercie pour cet engagement.

La parole est à M. Maurice Leroy, pour exposer sa question, no 225, relative aux horaires des enseignants dans l'enseignement agricole privé.

Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, je vous remercie de me répondre en l'absence du ministre de l'agriculture.
La force de l'enseignement agricole, c'est l'interdisciplinarité et le travail en équipe. C'est un métier difficile, qui n'est pas rémunéré à proportion. Voilà pourquoi je tiens à interpeller ce matin le Gouvernement pour appeler sa bienveillante attention sur la situation professionnelle des enseignants des 200 établissements d'enseignement agricole privé, dont on ne parle hélas jamais.
Les jeunes formés dans cette filière sont tous certains – et on s'en réjouit pour eux – de trouver un emploi à l'issue de leur formation, en particulier dans nos territoires ruraux. Il serait donc bon et juste, monsieur le secrétaire d'État, que M. le ministre de l'agriculture accepte de recevoir les représentants syndicaux de l'enseignement agricole privé. Cela s'est fait par le passé, et il faudrait que cela continue de se faire. La formation professionnelle et l'apprentissage ont besoin de jeunes enseignants pour l'enseignement agricole. Il y a urgence à oeuvrer pour assurer la résorption de la catégorie III de l'enseignement agricole privé ; pour cela, il convient de bloquer le regroupement pour qu'il ne puisse se réaliser que par voie de concours, comme pour les adjoints d'enseignement dans l'éducation nationale.
Des propositions sont faites afin de modifier l'amplitude horaire sur quatre semaines consécutives et mieux répartir le temps de travail sur l'ensemble de l'année scolaire. En effet, monsieur le secrétaire d'État, le travail de l'enseignant devient plus complexe au regard des réformes pédagogiques et de l'évaluation, et exige des recherches importantes compte tenu de la diversité des publics accueillis dans l'enseignement agricole. Étant majoritairement un enseignement professionnel, celui-ci doit s'inscrire dans les territoires et suppose par conséquent la mise en oeuvre d'actions pédagogiques en lien avec l'environnement professionnel. Au final, cette évolution de l'amplitude répond clairement à l'objectif d'amélioration de la qualité du service d'enseignement. Modifier l'amplitude horaire ne dénature pas l'article 29 du décret no 89-406 du 20 juin 1989, ni ne remet en cause le principe de modulation du temps de travail. Cette proposition de modification de l'amplitude horaire, qui permet de mieux répartir le temps de travail dans l'année, fait consensus dans la profession.
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous m'indiquer quand le décret d'application permettant la mise en oeuvre de cette proposition sera publié ?

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur Leroy, il est inutile que j'évoque le Loir-et-Cher, mais l'élu que je fus, président du conseil d'administration d'un établissement public d'enseignement agricole, est totalement convaincu par vos propos sur la qualité et l'ambition des formations délivrées dans ces établissements, ainsi que sur l'exigence de proximité à laquelle elles doivent satisfaire.
Pourtant, vous comme moi – et d'autres – connaissons les particularités de l'enseignement agricole et de la gestion du corps professoral, notamment en matière de modulation du temps de travail. Ces questions sont organisées par le décret du 20 juin 1989, qui permet, dans des limites précises, d'adapter et de faire varier la charge de travail d'une semaine sur l'autre en fonction de l'organisation pédagogique locale et du projet d'établissement. Il est vrai que l'article 29 impose un cadre qui peut sembler trop strict et les enseignants du privé qui exercent à temps plein demandent depuis de longues années une modification qui permettrait de réduire de moitié l'amplitude horaire hebdomadaire actuellement autorisée. Pour un enseignant dont l'obligation de service hebdomadaire est fixée à 18 heures, la modulation pourra se situer entre 20,25 et 13,5 heures, contre 22,5 heures et 9 heures aujourd'hui. Ce dispositif permettra d'améliorer les conditions de travail des enseignants et de préparation de leurs cours, et sera donc profitable aux élèves comme aux 4 900 professeurs de l'enseignement agricole privé sous contrat, sans remettre en cause l'annualité du temps de travail, si importante pour l'organisation globale des établissements.
J'aurais pu me contenter de vous apporter une réponse précise à votre réponse précise, mais je m'en serais voulu de vous répondre de façon trop courte.
Sourires.
La modification du décret, proposée par le ministre de l'agriculture, est en cours d'étude au Conseil d'État ; s'il en résulte une réponse favorable – ce que nous espérons – , le décret sera immédiatement modifié et applicable pour la prochaine rentrée scolaire dans l'ensemble des établissements agricoles privés.

La brièveté de ma réponse tentera d'égaler l'élégance de celle de M. le secrétaire d'État. J'ai été à votre place dans cet exercice et je sais combien il est difficile, parfois même périlleux. Je vous remercie sincèrement car vous ne vous êtes pas contenté d'ânonner la note qui vous a été transmise, comme c'est souvent le cas. Étant vous-même un vrai élu de terrain, vous savez combien l'enseignement agricole compte dans notre pays. Je le redis : tous les jeunes formés en sortent avec un emploi. Je me réjouis pour ces établissements, pour les enseignants et pour les jeunes de votre réponse très concrète, au nom du Gouvernement. Il serait bon que ce décret soit publié le plus tôt possible après l'avis du Conseil d'État. Encore une fois, merci, monsieur le secrétaire d'État.

La parole est à Mme Naïma Moutchou, pour exposer sa question, no 224, relative aux écoles de la deuxième chance.

Le Gouvernement a engagé une réforme en profondeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage, dont l'un des principaux objectifs est de lutter contre le chômage de masse qui frappe une partie des Français les plus jeunes.
Plus de 1,3 million d'entre eux sont sans emploi et sans qualification : ils sont marginalisés et bien souvent dans des situations de grande précarité. L'exclusion de plus d'un million de jeunes du marché du travail, au-delà de ses répercussions économiques, pose la question de la cohésion sociale, car un pays en bonne santé est un pays qui offre des perspectives et du sens à sa jeunesse.
Le Gouvernement a annoncé un programme d'investissement orienté vers les compétences afin de former, en cinq ans, un million de demandeurs d'emploi peu qualifiés et un million de jeunes éloignés du monde du travail. C'est un effort considérable et nécessaire que je tiens à saluer.
J'appelle votre attention sur la place que pourraient occuper les écoles de la deuxième chance dans ce programme d'investissement. Ces écoles ont été créées pour les jeunes en situation de décrochage scolaire. En France, chaque année, 130 000 jeunes en moyenne quittent le système scolaire sans diplôme. Les écoles de la deuxième chance les accueillent, sans exiger ni qualification ni diplôme, de 18 à 25 ans, parfois même à partir de 16 ans, et les aident à construire un projet grâce à l'alternance de formations individuelles et collectives et de stages en entreprise. Elles permettent également de lutter contre le désoeuvrement en redonnant aux jeunes une place, une utilité dans la société.
Ces écoles ont prouvé leur efficacité, chiffres à l'appui, dans la réinsertion professionnelle et sociale. Ainsi, dans le Val-d'Oise – département où je suis élue – , où le dispositif des écoles de la deuxième chance a été déployé, entre autres grâce au travail de Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt, 500 stagiaires et 100 élèves en situation de décrochage sont accueillis chaque année, et 70 % des stagiaires trouvent un emploi ou une situation diplômante à l'issue de leur parcours. Demain, deux sites verront le jour, à Beaumont et à Écouen, dans le cadre d'une plate-forme du numérique.
À Franconville, dans la quatrième circonscription du Val-d'Oise, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans atteint 26,65 %, d'après la dernière étude menée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE. L'idée d'implanter une école de la deuxième chance dans cette ville est donc des plus pertinentes. Elle permettra d'offrir de nouvelles perspectives à ses jeunes, de rapprocher les stagiaires des sites. Elle profitera en outre à l'économie locale, par des formations adaptées aux métiers du bassin d'emploi, parrainées par les grandes enseignes présentes à Franconville et dans toute la circonscription.
Aussi souhaiterais-je savoir quelle place le Gouvernement entend accorder au dispositif des écoles de la deuxième chance, et quels moyens seront alloués à leur déploiement, en particulier à Franconville, dans le Val-d'Oise.

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Madame la députée, le Gouvernement partage le constat que vous avez dressé : le taux de chômage des personnes qualifiées est de 6 %, tandis que celui des personnes non qualifiées s'élève de 18 %. Il y a de grandes disparités entre territoires, dont nous connaissons les raisons, parmi lesquelles figure le manque de formation. Vous avez cité le taux de chômage des jeunes à Franconville, qui est de 26,6 % : nous savons bien que, dans d'autres quartiers d'Île-de-France, les chiffres sont encore plus inquiétants.
Face à cela, le Gouvernement a choisi de pas limiter les politiques d'insertion à des emplois précaires de court terme – je le dis sans avoir l'intention de rouvrir le débat sur les emplois aidés. Notre but est l'emploi durable, lequel passe par la qualification. Pour cela, il faut de bons outils, mais il faut aussi des moyens. C'est pourquoi près de 15 milliards d'euros seront investis dans les compétences sur la durée du quinquennat, grâce au plan d'investissement dans les compétences.
Vous le savez, mais je tiens à le redire : c'est un plan sans précédent en termes d'accès à des formations qualifiantes et certifiantes, notamment pour les jeunes. Nous devons agir ensemble pour atteindre notre objectif, qui est de former et d'accompagner, à l'horizon 2022, un million de demandeurs d'emploi peu qualifiés et un million de jeunes, notamment en situation de décrochage.
Vous avez interrogé le Gouvernement à propos des écoles de la deuxième chance. Vous avez raison : c'est l'une des solutions qu'il faut soutenir. La visite de Mme la ministre du travail, Muriel Pénicaud, en fin d'année dernière, dans l'une de ces écoles, n'a fait que confirmer cette conviction, qui doit nous rassembler. Vous avez évoqué avec fierté les deux nouveaux sites qui verront ainsi le jour dans le Val-d'Oise : c'est un exemple qu'il faut suivre.
Les écoles de la deuxième chance, réparties sur 124 sites et écoles, partout en France, accompagnent 15 000 jeunes vers l'emploi. Elles ont montré leur utilité : c'est pourquoi la contribution de l'État aux écoles de la deuxième chance a été reconduite en 2018. C'est aussi pourquoi le plan d'investissement dans les compétences soutiendra le développement de ces écoles, en lien avec les régions, pour offrir des solutions durables à nos jeunes.
Je ne me prononcerai pas sur le projet que vous avez évoqué, mais je ne doute pas, compte tenu de sa qualité et de votre engagement, qu'il puisse aboutir – en tout cas nous le souhaitons tous.

Je vous remercie infiniment, monsieur le secrétaire d'État, pour cette réponse satisfaisante, qui représente un vrai signal envers les populations qui en ont le plus besoin.

La parole est à M. Alexis Corbière, pour exposer sa question, no 197, relative aux écoles privées hors contrat.

J'appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le développement, que je qualifierais d'exponentiel, des écoles privées hors contrat dans notre pays.
Depuis dix ans, plus d'une école publique est fermée chaque jour ; mais depuis 2014, le nombre d'écoles privées ne cesse de croître. Cette croissance profite particulièrement au privé hors contrat : à la rentrée 2017, l'enseignement privé a gagné 7 000 élèves, dont pas moins de 5 000 pour le privé hors contrat, par rapport à la rentrée 2016. Ces trois dernières années, les effectifs des écoles privées hors contrat ont crû de 15 % en moyenne à chaque rentrée scolaire.
Cette accélération se vérifie particulièrement dans mon département, la Seine-Saint-Denis, qui compte la population de jeunes de moins de 15 ans la plus importante d'Île-de-France. Alors qu'entre 1998 et 2013, soit sur une période de quinze ans, le département a vu onze établissements de ce type ouvrir leurs portes, sur les cinq dernières années, de 2014 à 2018, pas moins de treize écoles hors contrat ont ouvert.
Le développement exponentiel de ces écoles en Seine-Saint-Denis m'alarme, car on peut y voir la conséquence du désinvestissement de l'État en matière scolaire dans ce territoire si particulier. Je tiens à dire que je m'inquiète également du fait que certains de ces établissements, appartenant au réseau Espérance banlieues, ont bénéficié en 2017 de financements publics, via des subventions accordées par plusieurs conseils régionaux.
Je demande donc à M. le ministre de l'éducation ce qu'il compte faire pour stopper l'hémorragie que représente cette fuite des élèves du public vers le privé, notamment hors contrat. Je me permets de suggérer que soit diligentée une étude qui déterminera si l'enseignement dispensé dans ces écoles hors contrat correspond aux attendus pédagogiques définis à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur Corbière, vous exposez une réalité : l'augmentation importante du nombre d'enfants scolarisés dans des établissements privés, et en particulier dans des établissements qui ne sont pas liés au service public de l'éducation nationale. C'est une réalité partout en France, y compris en Seine-Saint-Denis.
Comme vous l'avez dit, l'enseignement privé hors contrat a enregistré une augmentation de 5 000 élèves à la dernière rentrée scolaire. Je précise que cette augmentation ne concerne que les écoles : dans les collèges et les lycées hors contrat, le nombre d'élèves a au contraire baissé de 800 élèves – mais cela n'enlève rien à la tendance que vous avez décrite.
Globalement, les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement hors contrat sont passés de 69 000 en septembre 2016 à 73 500 en septembre 2017, soit une augmentation de 4 500 élèves.
En Seine-Saint-Denis, vous évoquez une accélération de la hausse du nombre d'établissements. Là encore, vous avez raison : le nombre d'élèves scolarisés dans des établissements hors contrat dans ce département est passé de 1 200 en septembre 2016 à 2 100 en septembre 2017, soit une augmentation de 900 élèves. C'est une progression très forte.
Mesdames et messieurs les députés, vous savez que le Premier ministre a annoncé, dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation, que l'État porterait une attention renforcée à l'enseignement hors contrat. Vous examinerez demain la proposition de loi de la sénatrice Françoise Gatel visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat : ce sera pour le ministre de l'éducation nationale l'occasion de compléter ma réponse.
Enfin, monsieur le député, vous interrogez le ministre de l'éducation nationale sur les établissements du réseau Espérance banlieues. D'un point de vue pédagogique, d'abord, le ministre de l'éducation nationale vous confirme que les autorités académiques font preuve de la même vigilance à l'égard de chacun des seize établissements de cette fondation qu'à l'égard de n'importe quel établissement hors contrat. Les sanctions appropriées seront mises en oeuvre contre les établissements au sein desquels seraient constatés des manquements persistants au droit à l'éducation, ce droit étant plus large que les seuls attendus du socle commun, que vous avez évoqués, et qui sont définis à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.
D'un point de vue financier, ensuite, vous conviendrez que le ministre de l'éducation n'est juridiquement pas compétent pour déterminer la légalité des subventions accordées par les collectivités locales : les élus et les contribuables sont les mieux à même de saisir le juge administratif de ces questions.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour cette réponse. Comme vous l'avez dit, le débat aura lieu demain dans notre hémicycle : j'en profiterai pour rappeler à M. le ministre de l'éducation nationale le soutien particulier qu'il a lui-même accordé, avant d'être nommé au Gouvernement, au réseau Espérance banlieues. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose : j'aurai l'occasion de m'en expliquer.
Je me réjouis – même si je le savais déjà – que vous soyez conscient de ce problème de fond, qui conduit à un fort évitement des établissements publics dans mon département. Or, puisque nos services anticipent cet évitement, les moyens ne sont pas mis à disposition des établissements. Je crois que nous devrions, au contraire, promouvoir nos écoles publiques, qui sont les seules écoles de la République où nos enfants, quelle que soit leur origine sociale, peuvent cohabiter.

La parole est à Mme Josy Poueyto, pour exposer sa question, no 207, relative à l'enseignement du catalan.

Ma question porte effectivement sur l'enseignement des langues régionales.
Députée de la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques, je suis élue de la ville de Pau, où se tient chaque année le festival Hestiv'Òc, en hommage aux accents du Sud et à la culture occitane.
Dans ma région, on parle encore le béarnais. Je ne suis pas une spécialiste et, pour ne froisser personne, j'ajoute que d'aucuns considèrent qu'on y parle plutôt le gascon. D'autres encore avancent que l'on n'y parle ni l'un ni l'autre, mais plutôt l'occitan. Les anciens du pays, eux, sont même persuadés qu'on y parle une autre langue encore, notamment en politique : celle du sous-entendu.
Sourires.

Une chose est certaine : le Béarn accueille un réseau dynamique d'écoles associatives par immersion, sous contrat, pour que notre langue régionale reste vivante. On appelle ces écoles les « calandretas ». Celles-ci ont bénéficié du renouvellement de leurs contrats aidés pour assurer l'année scolaire 2017-2018 : je ne peux que vous remercier, à cet égard, d'avoir finalement assuré une égalité de traitement entre les écoles calandretas de la Nouvelle-Aquitaine et celles du réseau Diwan, en Bretagne. J'avais posé, à l'époque, une question à ce propos à M. le ministre de l'éducation nationale.
Mais chez moi, et vraisemblablement ailleurs, il subsiste des inquiétudes pour la rentrée de septembre 2018. En effet, dans le cadre de la refonte du dispositif des contrats aidés, la fédération des calandretas craint des pertes de postes. En fin de compte, cette situation pose la question du financement et du statut des écoles par immersion, que l'on appelle aussi « ikastolas » dans la partie basque de mon département.
Que propose M. le ministre de l'éducation nationale pour répondre à cet enjeu dès la rentrée prochaine ?

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Madame la députée, je suis d'accord avec vous quant à l'importance des langues et des cultures régionales : nous aurons peut-être l'occasion, dans cet hémicycle, de revenir sur la question de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, sans y voir aucun des sous-entendus que certains députés ont cru discerner, et par lesquels ils justifiaient la crainte que leur inspirait ce texte.
Les langues et les cultures régionales appartiennent au patrimoine français : il faut en être fier, les défendre et les promouvoir. L'État doit évidemment participer à la diffusion de ces langues et de ces cultures, en partenariat avec les collectivités territoriales, notamment par des conventions spécifiques. Dans l'académie de Bordeaux sont ainsi passées des conventions concernant l'enseignement du basque et de l'occitan ; il en est de même dans les académies de Rennes et de Nantes à propos de l'enseignement du breton – vous avez fait la comparaison vous-même.
Il est important, et le ministre de l'éducation nationale me l'a demandé, de vous apporter ici des garanties pour lever votre inquiétude sur le statut ou le cofinancement des calandretas et des ikastolas en rappelant qu'il n'y a pas de concurrence avec les établissements des autres réseaux de langues régionales. L'ensemble de ces réseaux est en effet fédéré au niveau national par l'Institut supérieur des langues de la République française, qui vise à harmoniser les demandes des établissements scolaires qui pratiquent l'enseignement de langue régionale par immersion, et ce quelle que soit cette langue.
Pour la rentrée 2018 dans les établissements privés, la répartition des moyens est actuellement en cours. Elle va évidemment se faire dans le cadre du budget pour 2018, voté par le Parlement, et qui ne prévoit pas de créations de poste pour l'ensemble de l'enseignement privé sous contrat. Par conséquent, il y aura des évolutions en fonction des redéploiements de moyens, y compris entre académies, ce qui permettra d'allouer des postes aux établissements dont la situation est la plus tendue sur le plan démographique, et surtout si l'intérêt du service public le justifie.
D'une manière générale, l'ensemble des conventions signées qui promeuvent le développement des langues régionales s'articulent avec les lois de finances et les moyens que celles-ci permettent d'allouer aux différents réseaux d'enseignement privés. Je voudrais tout de même vous préciser, madame la députée, que, depuis 2009, les gouvernements précédents ont décidé d'allouer quarante-trois équivalents temps plein pour les écoles calandretas, soit une dotation moyenne supplémentaire de plus de cinq postes chaque année, les ikastolas étant pourvues à un rythme tout à fait comparable puisqu'elles ont obtenu quarante postes sur la même période. C'est un effort significatif qui permet à ces réseaux d'afficher aujourd'hui un taux d'encadrement très satisfaisant. Un tel effort correspond à l'appétence et à la qualité de l'offre produite dans votre territoire.
Pour conclure mon propos, je tiens à souligner que M. le ministre de l'éducation nationale ne laisse pas au seul secteur privé l'initiative de l'enseignement de ces langues : ainsi, chaque recteur arrête une politique de développement de l'enseignement des langues et cultures régionales dans son académie si celle-ci est concernée. Cette politique est préalablement présentée au conseil académique des langues régionales, auquel participent les collectivités locales.

Je remercie M. le secrétaire d'État et, bien évidemment, que ce soit pour les ikastolas au Pays basque ou les calandretas dans le Béarn, je serai vigilante, et nous solliciterons bien sûr à nouveau en cas de besoin le ministère de l'éducation nationale.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Vote solennel sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 ;
Discussion de la proposition de loi portant transposition de la directive européenne sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
La séance est levée.
La séance est levée à treize heures cinq.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l'Assemblée nationale
Catherine Joly