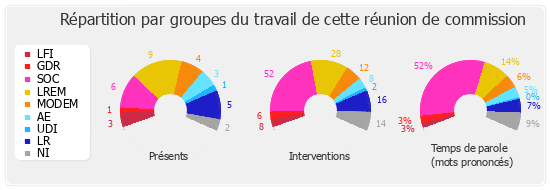Commission des affaires sociales
Réunion du mercredi 10 février 2021 à 14h00
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mercredi 10 février 2021
La séance est ouverte à quatorze heures.

Mes chers collègues, nous entamons l'examen des quatre propositions de loi renvoyées à notre commission, dont le groupe Socialistes et apparentés a demandé l'inscription à l'ordre du jour de la journée qui lui est réservée en séance publique, jeudi 18 février.
La commission procède à l'examen de la proposition de loi relative à la création d'une aide individuelle à l'émancipation solidaire (n° 3724) (MM. Boris Vallaud et Hervé Saulignac, rapporteurs)

En janvier 2019, nous vous présentions une proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base dans les départements volontaires. Nous voulions débattre de la lutte contre la pauvreté, de la situation de la jeunesse, des injustices sociales qui minent le pays, parce que la crise sociale sévissait déjà. Le malaise de la jeunesse ne faisait que peu de doute pour qui voulait bien le voir. En adoptant une motion de rejet préalable, la majorité a répondu par une fin de non-recevoir.
Deux années se sont écoulées, aucune réponse n'a été apportée. Le plan pauvreté, qui aurait pu en constituer une, semble avoir disparu, comme dans un trou noir. La pire crise économique et sociale que notre pays a connue depuis 1945 s'est installée. La jeunesse est frappée de plein fouet, avec un niveau de vie qui recule, des emplois perdus pour les étudiants, moins de stages pour les apprentis, moins d'emplois à la sortie des études, des réponses tardives et partielles du Gouvernement. La crise que nous traversons projette une lumière crue sur la faillite d'une société, qui laisse pour compte ce qu'elle a de plus précieux, ses enfants. 18 ans, c'est en effet l'âge de la majorité, mais c'est aussi celui de la fragilité, de la vulnérabilité. Pourtant, la société accueille sa jeunesse par la petite porte : une majorité civique paraît bien dérisoire quand on a besoin d'une majorité sociale.
Des filets de protection, des accompagnements ont été pensés par les gouvernements successifs tout au long de l'existence, ou presque : de 18 à 25 ans, il vaut mieux compter sur la solidarité familiale lorsqu'elle peut s'exercer, que sur celle de l'État. C'est ce trou béant dans la raquette que la classe politique semble découvrir – d'une certaine manière, on peut s'en réjouir. Les congés payés, la sécurité sociale, le revenu minimum d'insertion (RMI), la couverture maladie universelle ont pour histoire commune d'être nés sur le terreau d'une crise. Qu'en sera-t-il de celle que nous traversons ? Peut-on fermer les yeux plus longtemps devant les files qui s'allongent à l'entrée des banques alimentaires, devant ceux qui concèdent n'avoir qu'un repas par jour, qui s'entassent dans des logements indignes ou qui renoncent à des soins ?
Plusieurs évidences s'imposent : la pauvreté n'a pas d'âge ; notre jeunesse vit cette épreuve comme un abandon des pouvoirs publics ; ce qui existe aujourd'hui pour elle est notoirement insuffisant. C'est pourquoi, avec mon collègue Boris Vallaud et d'autres du groupe Socialistes et apparentés, nous avons travaillé depuis deux ans à une nouvelle proposition de loi qui soit à la hauteur du défi social qui s'impose à nous. Le moment est venu de répondre de manière profonde et pérenne à une aspiration de justice et d'émancipation.
La proposition de loi s'appuie sur ce que nous dénommons le revenu de base. D'emblée, j'indique que le terme fait débat et que nous sommes ouverts à toute suggestion pour le renommer. Ce qui compte n'est pas tant le mot, que la chose. Celle-ci repose sur trois piliers.
Le premier est l'ouverture de ce droit dès 18 ans. Rien ne semble justifier la borne d'âge de 25 ans, qui n'existe que dans quelques pays européens. Elle fait des jeunes des citoyens de second rang. Contrairement à ce que l'on entend souvent, cette borne d'âge n'est pas non plus liée à un âge d'accès au travail puisque la plupart des jeunes trouvent leur premier emploi avant 25 ans – à 22 ans, en moyenne. Elle n'est pas non plus liée à l'existence de bourses puisque tant de jeunes n'en bénéficient pas ou en bénéficient peu. Dans la plupart des cas, leur niveau est bien moins élevé que le montant du revenu de solidarité active (RSA). Et puis, cette barrière d'âge est insupportable lorsqu'on la justifie par l'obligation parentale. Cela revient à répéter sans fin les inégalités de naissance, notamment pour les parents qui n'ont pas les moyens de subvenir dignement aux besoins de leurs enfants. Abolir cette frontière est donc une question de principe, d'égalité, de lutte contre un fait quasiment culturel, un rite initiatique, qui veut qu'un jeune doive en baver pour accéder à une vie émancipée.
Le deuxième pilier est l'inconditionnalité. Les logiques de contreparties, de droits et de devoirs masquent mal des réalités trop souvent méconnues ou des poncifs qui ont la vie dure. D'abord, l'emploi n'est pas une obligation mais un droit, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946. Ensuite, il n'a jamais été démontré que le contrôle et les sanctions avaient un effet sur l'insertion professionnelle. Au contraire, certaines études montrent qu'ils aboutissent principalement à des non-recours ou à la construction de parcours professionnels chaotiques, avec des emplois mal adaptés. Enfin, les acteurs de l'accompagnement dénoncent presque unanimement les moyens administratifs qui sont destinés à rechercher d'hypothétiques fraudeurs chez les bénéficiaires, quand le vrai besoin serait d'abord de les aider à renouer avec l'emploi. Cette inconditionnalité n'est en rien un cadeau. Elle est encore moins un encouragement à l'oisiveté. Au contraire, c'est le rétablissement du sens profond d'un droit protecteur dû à ceux qui sont privés d'emplois, donc de ressources.
Nous avons parfaitement entendu les questions posées par l'articulation avec la garantie jeunes, organisée par les missions locales. Celle-ci restera la principale orientation possible proposée par les conseils départementaux, et ses bénéficiaires auront droit à une majoration du revenu de base tant qu'ils participeront à ce parcours de réinsertion intensif.
Troisième pilier : l'automatisation du versement. Le non-recours demeure considérable s'agissant des minima sociaux. Les prestations quérables n'ont plus aucun sens dans un pays qui dispose de tous les moyens techniques pour identifier les ayants droit. Nous souhaitons donc que le revenu de base soit versé automatiquement, en se fondant sur l'ensemble des informations dont dispose déjà l'État par le prélèvement à la source et la sécurité sociale, par la déclaration sociale nominative. Notre proposition consiste donc à appliquer la logique de l'« aller vers », en confiant le soin à la caisse d'allocations familiales de verser directement la prestation et aux conseils départementaux de proposer un accompagnement adapté. Le tout sera facilité par une prestation unique, qui combine le RSA et l'actuelle prime d'activité grâce à un mode de calcul simplifié et ajusté. La nouvelle prestation ne ferait aucun perdant et serait financée par l'État, sans préjudice des missions du conseil départemental en matière d'insertion et d'accompagnement.
Telles sont les dispositions de l'article 1er.

Le revenu de base est complété par un droit complémentaire, conçu pour aider le jeune construire sa vie d'adulte. C'est un capital pour démarrer dans la vie et amorcer un projet de formation ou d'insertion, librement choisi et construit. Cette « dotation tremplin » constitue le second volet de l'aide individuelle à l'émancipation solidaire que nous proposons. Ensemble, l'un et l'autre forment ce que nous tenons pour un minimum jeunesse.
L'égalité de tous pour accéder à une formation, la possibilité de reprendre des études lorsque l'on a été contraint de les arrêter sont socialement déterminées, notamment par la dotation en capital de chacune et chacun. Comment payer ses frais de scolarité, une première formation qualifiante, son permis de conduire ou amorcer le financement d'un véhicule pour accéder à un premier travail ? Ces questions, qui peuvent sembler simples, sont de véritables obstacles pour de nombreux jeunes qui souhaitent se lancer, mais ne peuvent compter ni sur des bourses – insuffisantes, lorsqu'elles existent –, ni sur les solidarités familiales, qui sont le cœur des inégalités des jeunesses.
Des dispositifs d'accompagnement à la formation existent aujourd'hui, comme le compte personnel de formation, mais ils supposent d'avoir déjà acquis des droits en travaillant, ce qui n'est pas le cas lors d'une première formation ou d'un premier emploi. La situation des jeunes à cet égard est singulière.
Inspirée de l'idéal d'un capital universel parallèle au revenu de base, la dotation que nous avons imaginée viendrait compléter le compte personnel d'activité dans la logique d'un droit individuel portable tout au long de la vie. Une dotation de 5 000 euros serait versée sur le compte personnel d'activité à l'âge de 18 ans pour tous les jeunes ; elle pourrait financer des usages liés à l'enrichissement de son capital personnel – formations, mobilités, engagements associatifs ou projets entrepreneuriaux. Elle serait gérée par un fonds associatif, financé par l'État, qui associerait des représentants de la jeunesse, et pourrait venir compléter la dotation universelle pour les jeunes les plus en difficulté.
Forte d'un revenu de base et d'une dotation universelle, notre aide individuelle à l'émancipation solidaire constitue une puissante réponse à la vague de pauvreté qui déferle sur le pays. Nous voyons les rangs des banques alimentaires se grossir de nombreux jeunes, et nous ne pouvons rester indifférents à cette souffrance, qui paraît tout sauf irrémédiable dès lors que l'on en aurait la volonté politique.
Nous venons donc devant vous avec une proposition de loi très complète, à un moment où cette question semble assez mûre pour être abordée. Le débat est public, pluraliste ; les attentes, fortes. Le constat sur le terrain est fait depuis des années par les associations de lutte contre la pauvreté et celles qui représentent la jeunesse – nous les avons auditionnées. Un travail de fond a été conduit avec des chercheurs, des sociologues, des économistes, des collectifs associatifs, avec l'Institut d'études politiques de Paris et l'Institut des politiques publiques. La proposition de loi a également fait l'objet de plusieurs consultations, car elle résulte d'une longue histoire : le revenu de base était le projet de dix‑neuf départements socialistes, qui en avaient proposé l'expérimentation. Ils ont travaillé pendant près de trois ans sur le sujet et organisé des consultations publiques, qui ont donné lieu à 15 000 contributions. Malheureusement, nous n'avons pas eu le loisir d'en débattre.
Quant à la dotation en capital, elle a émergé d'une consultation de plusieurs dizaines de milliers de jeunes par la technologie citoyenne (civic tech) Make.org, durant la campagne présidentielle de 2017. La proposition avait été plébiscitée ; nous avions choisi de la reprendre à notre compte. Lors d'une mise en débat sur la plateforme Parlement & Citoyens pendant plus de deux mois, elle a recueilli 6 000 participations et 2 000 contributions, auxquelles nous ne pouvons pas rester indifférents.
La proposition de loi est désormais prête à être soumise au vote de la représentation nationale. Après la création du RMI en 1988, de la garantie jeunes en 2013, de la prime d'activité et du compte personnel d'activité en 2016, il est temps d'accomplir ce nouveau grand pas social qui peut changer la vie de millions de nos concitoyens, lesquels ne s'abîment pas dans l'oisiveté, mais s'enfoncent dans la pauvreté, l'âpreté de la vie. Comme républicains attachés à la République sociale, nous devons y prêter attention.
Il est temps aussi de renvoyer nos préjugés sur la jeunesse, la pauvreté, le travail et de faire confiance à la solidarité, pour renforcer notre socle républicain. Nous examinons en ce moment, dans l'hémicycle, un projet de loi confortant le respect des principes de la République. Or de nombreuses promesses sont démenties dès le plus jeune âge. La proposition de loi vise à y remédier en partie.
Nous ne prétendons pas avoir le monopole de cette haute conscience de l'urgence sociale. Les organisations syndicales étudiantes, les conseils départementaux, des communes, comme Grande-Synthe dont nous avons rencontré le maire, la partagent. À lire et à écouter ce qui s'écrit et se dit depuis quelques mois, cette ambition pour la jeunesse dépasse désormais les clivages et interroge les consciences au-delà des jeux de rôle habituels sur ces questions. Une sociologue que nous avons auditionnée a dit qu'en la matière, le terrain social était plus mûr que le terrain politique. Nous pouvons lui donner tort aujourd'hui.
Nous ne devons pas être dupes des contre-propositions qui fleurissent pour gagner du temps. Il y a deux ans, vous aviez repoussé notre proposition de loi d'expérimentation territoriale parce que le revenu universel d'activité devait voir le jour en 2020. Nous sommes en 2021 et avons vu ce qu'il en était. Durant la crise, nous avons été d'une prime à l'autre, comme si la pauvreté, qui nous sautait aux yeux, ne préexistait pas largement à cette brutale apparition, comme si la situation de la jeunesse, indépendamment de la crise, n'était pas déjà difficile. Avec cette proposition de loi, nous devons revenir de l'idée, trop souvent partagée, que la jeunesse est un rite initiatique, qu'elle doit être une épreuve, que chacune des difficultés, pour trouver un emploi, poursuivre des études, se soigner, se loger, se nourrir, formerait la jeunesse. Je crois surtout qu'elles l'abîment, de façon irrémédiable.
Aujourd'hui, nous serons vraisemblablement renvoyés à une hypothétique garantie jeunes universelle. Je vous demande de ne pas avoir cette bassesse. Nous ne connaissons aucun des paramètres de ce dispositif, y compris ce que le mot d'universalité signifiera en l'espèce. On nous renverra à des prêts garantis par l'État pour les jeunes, qui ont déjà bien des difficultés et ne demandent pas à s'endetter davantage.
Il faut donc engager sans plus tarder le nouveau grand chantier social de notre temps, celui qui n'oppose pas travail et solidarité, car je ne connais pas un jeune qui ne veuille pas travailler. Nous devons revenir de cette opposition entre émancipation et accompagnement, entre égalité et liberté. C'est pourquoi nous faisons nôtres les mots du grand Jean Jaurès : « Une fois émancipé, tout homme cherchera lui-même son chemin ». Ouvrons à la jeunesse le chemin de sa liberté et de son émancipation !

Merci, messieurs les rapporteurs, d'avoir précisé clairement ce que vous souhaitiez à travers la proposition de loi. En moins de deux mois, c'est la troisième fois que nous discutons du concept de revenu de base ou revenu universel inconditionnel, qui n'est pas nouveau et peut être décliné sous différentes formes.
En novembre, sur une proposition du groupe Agir ensemble, notre majorité a voté en faveur d'un débat sur le sujet. La France, comme d'autres pays, est confrontée à une crise sanitaire, économique et sociale de grande ampleur, qui frappe les plus vulnérables d'entre nous. Il est donc légitime que les groupes politiques de l'Assemblée nationale cherchent à y répondre. Le débat ne peut faire passer au second plan notre ambition de transformer, d'agir sur les inégalités à la racine, de faire du travail et de la lutte contre le chômage les piliers de notre politique.
Votre proposition de loi a pour ambition et objectif de remplacer le RSA par un revenu de base sous condition de ressources, mais inconditionnel, c'est-à-dire sans obligation pour les bénéficiaires. Comme nous l'avons affirmé lorsque dix-huit départements socialistes ont proposé de l'expérimenter en 2019, une aide pécuniaire inconditionnelle ne suffit pas à lutter contre la pauvreté et les inégalités. L'accompagnement est essentiel et ne peut résulter que d'un contrat, qui est, non pas un contrôle, mais la mise en œuvre de la solidarité, permettant d'aider à sortir de la précarité. C'est ce qui nous sépare sur le fond.
D'ailleurs, il n'y a pas de consensus sur votre proposition, y compris dans votre famille politique, si j'en crois diverses déclarations récentes. Le consensus n'existe pas non plus parmi les associations, les organisations syndicales ou dans les associations représentant les étudiants. Leurs responsables ont affirmé dans la presse que le montant que vous consacrez à ce revenu est nettement insuffisant. La proposition de loi prévoit aussi une recentralisation du RSA sous la forme du revenu de base, recentralisation que la majorité des départements refuse – j'interrogerai l'Assemblée des départements de France à ce sujet. Au revenu de base, vous associez une prime d'activité, calculée en pourcentage du revenu d'activité, ce qui ne va pas dans le sens de la simplification requise pour la fusion des minima sociaux.
Dans la période de crise que nous vivons, le Gouvernement a montré sa détermination à traiter la situation des plus précaires, en particulier des jeunes, d'une manière différenciée, avec efficacité. L'accompagnement, associé à une aide monétaire pour ceux qui en ont le plus besoin, a d'ores et déjà été instauré. Le « quoi qu'il en coûte » a également fonctionné pour les jeunes, qu'ils bénéficient de la garantie jeunes ou qu'ils soient en formation, en insertion, en apprentissage. Il fonctionne aussi en faveur des étudiants, qui apprécient les mesures du Président de la République. Beaucoup reste à faire, et un projet de loi sur l'égalité des chances devrait nous permettre de débattre et d'aller plus loin.
S'agissant de la dotation de 5 000 euros, elle a le mérite d'ouvrir le débat que Stanislas Guerini a amorcé avec sa proposition de prêt remboursable – d'autres pourront l'alimenter.
En l'état, la proposition de loi nous paraît d'inspiration trop administrative et technocratique – elle n'a pas de quoi enthousiasmer les jeunes, à 18 ans. De même, le financement de la réforme, évalué à 21 milliards d'euros, est peu convaincant. D'inspiration très idéologique, il aboutirait surtout à augmenter les impôts.
Pour toutes ces raisons, nous n'approuverons pas votre proposition de loi.

Le sujet est d'importance. C'est tout l'intérêt d'une niche parlementaire que de soumettre au débat des sujets de société, avec la volonté de les faire avancer. N'est-il pas nécessaire de trouver un consensus si l'on veut faire avancer des solutions pour les Français ? Jean Jaurès n'est pas ma référence, et j'ai l'humilité de ne pas me référer à ses belles valeurs. Nos valeurs sont de faire en sorte que chaque homme, chaque femme de ce pays trouve sa place dans la société, de lui donner les moyens, par une trajectoire individuelle et personnelle, de gagner le droit de vivre dignement, comme il ou elle le veut. Tout cela repose sur la communauté nationale. Il nous appartient de l'organiser.
Oui, il y a des difficultés sociales. Oui, l'augmentation de la pauvreté est très préoccupante. Ce matin, avec mes collègues du groupe Les Républicains, nous avons communiqué sur des mesures d'urgence, en particulier en faveur des jeunes, afin de lutter contre la pauvreté, notamment en raison de ce que subit notre pays depuis le début de la crise sanitaire. Vos travaux très denses, qui s'appuient sur de nombreuses auditions et beaucoup de doctrine, vous conduisent à proposer un chemin vers une solution. Si je les salue, je n'aboutis pas à la même réponse sociétale.
La jeunesse est la priorité, l'avenir d'une nation, son dynamisme. Elle représente des idées neuves, des conquêtes. La jeunesse de France aura à porter la dette de notre société. C'est dire s'il faut lui permettre d'être présente, et de trouver sa place dans une société qui lui propose, en amont, un système scolaire pas assez performant pour lui donner des armes et, en aval, un marché du travail pas assez sensible pour l'accueillir.
Dans la proposition de loi, la question du corpus me pose problème. Nous sommes attachés à la valeur travail, à l'entraide de la solidarité nationale. Est-ce qu'aider toutes celles et ceux qui en ont besoin passe automatiquement par l'octroi d'une aide universelle et sans contrepartie ? Je ne peux pas répondre favorablement à cette question.
Même si votre réponse permet de réfléchir et d'aller de l'avant, je m'interroge sur son financement. J'en trouve le système compliqué, inefficace, et probablement injuste. Les mesures financières qui vous permettraient de l'alimenter ne pénaliseront pas uniquement les plus riches, ce qui sous-tend peut-être votre pensée. Elles risquent d'être confiscatoires pour une partie de nos concitoyens et d'entraver encore plus la compétitivité de notre économie et de nos emplois. C'est la raison pour laquelle nous observerons les débats, aujourd'hui et dans l'hémicycle. Je vous remercie d'avoir travaillé cette question à laquelle, hélas ! personne au sein de cette assemblée n'échappera.

Nous ne partageons pas les modalités de la création d'une aide individuelle à l'émancipation solidaire telle que le groupe Socialistes et apparentés nous la propose, mais nous rejoignons nos collègues sur la nécessité d'apporter une réponse satisfaisante aux jeunes majeurs, qui sont les plus exposés à la précarité.
Les mesures prises par le Gouvernement pour faire face à cette précarité accrue en raison de l'épidémie de covid-19 sont nombreuses. Peu adaptées au départ, elles tendent aujourd'hui à répondre à l'ensemble des situations : jeunes en formation professionnelle, en accompagnement de projet, demandeurs d'emploi non indemnisés ainsi que, dans une moindre mesure, et bien tardivement, étudiants, par le projet de la garantie jeunes universelle.
Le groupe du Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés vous rejoindra volontiers sur la nécessité d'automatiser le versement des minima sociaux, car le non-recours demeure beaucoup trop fréquent. Pour ce faire, il est impératif que le Gouvernement active rapidement le déploiement du revenu universel d'activité, car tous les publics ont besoin de cette disposition.
Restent les points de divergence. Si un revenu universel devait être instauré, il devrait l'être pour tous, ce qui impose une vaste transformation de notre système de redistribution, qui ne peut être conduite dans le cadre d'une niche parlementaire. Il en va de même pour l'extension d'un revenu de base comme celui que vous proposez. Pour ce qui me concerne, je suis favorable à une défamilialisation des ressources, gage d'émancipation de la jeunesse, mais la réforme fiscale qu'elle entraînerait mérite un large débat.
S'agissant de la dotation tremplin, des dispositifs locaux tels que le Tremplin citoyen dans l'Essonne apportent, en échange de bénévolat, des aides individuelles aux projets des jeunes, qui favorisent leur autonomie tout en répondant à des besoins. Ce type d'initiative, qui valorise la citoyenneté et répond à l'objectif d'émancipation des jeunes, me paraît préférable.
En conséquence, notre groupe ne votera pas en faveur de ce texte.

Depuis trop longtemps, notre société inflige un parcours du combattant indigne aux jeunes générations avant l'entrée dans la vie adulte : quels que soient leurs diplômes, elle leur impose cinq à dix ans de galère, pendant lesquels se succèdent stages, petits boulots, contrats courts et précaires, avant d'accéder à un emploi durable.
Dans leur grande diversité, les jeunes aspirent à un droit à l'avenir, à un accès à l'autonomie, à un emploi stable, au logement, à la santé. Ils attendent une réponse qui va bien au-delà des mesures exceptionnelles proposées par le Gouvernement pendant cette crise sanitaire, sous forme d'aides ou de primes ponctuelles. Mobilisées depuis plus de quarante ans, ces aides ne suffisent plus, alors que le marché du travail fait subir aux jeunes, devenus une variable d'ajustement structurel, la précarité et la flexibilité. Pendant les confinements, 40 % des étudiants ont dû arrêter de travailler ; la perte de leur contrat de travail les a fait basculer nombreux dans la grande précarité. Les images d'étudiants dans les files d'attente d'épiceries solidaires sont révoltantes.
Outre les étudiants, des centaines de milliers de jeunes voient leur projet – études, concours, stages, entretiens d'embauche, mobilités, séjours à l'étranger – voler en éclats à cause de la pandémie de la covid-19. Le constat est là, les conditions d'entrée des jeunes dans la vie adulte s'en sont encore trouvées dégradées : le taux de chômage des 15 à 24 ans, qui était déjà le double de la moyenne nationale, bondit de 16 % ; les moins de 30 ans représentent plus de 50 % des pauvres, alors qu'ils ne sont que 35 % de la population. C'est pourquoi le refus obstiné du Gouvernement d'ouvrir le revenu de solidarité active aux moins de 25 ans est incompréhensible. Nous voulons aller plus loin. Le sort réservé à notre jeunesse est insupportable. C'est un scandale républicain, pour ces citoyens, qui aspirent à se projeter dans la vie.
En attendant l'expérimentation d'un revenu universel d'existence pour la jeunesse, la réponse publique doit être plus ambitieuse. Nous voulons l'élargissement du RSA aux moins de 25 ans, l'instauration d'un revenu de base et d'une dotation universelle, à 18 ans, qui n'a rien en voir avec les prêts garantis à rembourser que propose le groupe La République en Marche. Le groupe Socialistes et apparentés votera donc la proposition de loi de nos collègues Boris Vallaud et Hervé Saulignac.

. Je salue la qualité, y compris technique, du travail de nos collègues : la proposition de loi est à la hauteur du caractère dramatique de la situation et de l'urgence sociale. Vous avez cité les étudiants ; j'ajouterai les indépendants et tous ceux qui passent à travers les mailles du filet de notre protection sociale.
Ce revenu de base n'est pas une idée neuve. C'est même une très vieille idée, une idée libérale car, avant Benoît Hamon, Thomas Paine l'avait théorisée en 1795. Celui qui aimait passionnément notre Déclaration des droits de l'Homme disait qu'on ne peut être libre et exercer ses droits si l'on n'est pas libéré de la pauvreté. Il préconisait donc d'instaurer un droit au revenu universel. Je partage cette belle idée libérale, avec Thomas Paine et la famille socialiste.
Le revenu universel est aussi une idée macroniste. Je le dis sans faire d'humour, moi qui me suis engagée en 2017 pour un projet d'émancipation, dont le revenu universel est une pierre angulaire pour libérer chacun de la pauvreté. Il est aussi une réforme d'individualisation et d'universalisation des droits, qui est au cœur du projet macroniste de réforme.
Enfin, ma collègue Monique Iborra l'a rappelé, le revenu universel est une proposition du groupe Agir ensemble. Cette proposition se distingue de la vôtre par son mode de financement. Nous voulons une réforme socio-fiscale qui accompagne l'instauration d'un revenu universel, c'est-à-dire d'une aide versée automatiquement et de façon inconditionnelle, dès 18 ans.
Le groupe Agir ensemble, qui a défendu le socle citoyen inscrit dans cette grande famille du revenu universel, ne votera pas contre la proposition de loi ; moi-même, je voterai pour. Un tel vote va dans le sens de l'histoire et de la responsabilité eu égard à l'urgence sociale. J'invite toutes les familles du revenu universel – la vôtre, la nôtre, la famille libérale – à ouvrir la porte pour laisser entrer l'espoir. Nous parlerons après de la « plomberie » et du financement. Soyons, s'il vous plaît, d'abord à la hauteur de l'enjeu et faisons preuve de la modernité nécessaire pour l'emporter. Nous pouvons réaliser ici quelque chose de l'ordre de ce qui a été accompli en 1945 avec la création de la sécurité sociale.

Je félicite également les rapporteurs pour la qualité de leur travail. Le groupe Libertés et Territoires attache beaucoup d'importance à ce sujet et y réfléchit tout particulièrement.
La crise socio‑économique que nous traversons depuis près d'un an a été brutale et violente, exacerbant une précarité qui s'est développée depuis longtemps. Les jeunes sont concernés au premier chef ; or ils continuent d'être exclus de certaines prestations. Notre groupe fait partie de ceux qui, malgré le refus du Gouvernement, appellent à étendre le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, même si nous sommes conscients que cette réponse ne peut être qu'une solution d'urgence, insuffisante et temporaire. Cette aide ne doit pas être une fin en soi, et devra être réévaluée à la fin de la crise. Il s'agit de définir une véritable politique ambitieuse, qui doit accompagner les jeunes. Nous ne pouvons fermer les yeux plus longtemps sur les inégalités qui se creusent et sur un système qui favorise la reproduction sociale, économique et professionnelle, qu'il s'agisse de notre système fiscal, insuffisamment redistributif et progressif, ou de notre système social et éducatif, qui ne garantit plus la promesse républicaine de la méritocratie.
Agir sur le seul terrain de l'emploi et de l'insertion ne peut pas suffire. Il est urgent de repenser nos politiques de lutte contre la pauvreté. Aussi souscrivons-nous à l'idée d'un revenu de base, garantissant trois impératifs : l'automaticité, pour lutter contre le non-recours aux droits, bien trop fréquent dans notre pays ; l'absence de contrepartie, pour faire confiance et mettre l'accent sur l'accompagnement des personnes ; la progressivité dans la prise en compte des revenus, ce qui répond à un enjeu de justice sociale.
Par ailleurs, l'idée d'une dotation universelle utilisable dans un but de formation, de mobilité ou d'entrepreneuriat est intéressante. Un tel dispositif pourrait être utile pour casser les cycles de reproduction sociale, qui nourrissent toujours plus les inégalités. La dotation pourrait être un vrai tremplin pour démarrer dans la vie et assurer enfin une égalité réelle des chances. Doit-on, en revanche, l'attribuer à tous les jeunes, sans considération de revenus ? Je laisse la question ouverte.
Notre groupe aborde très favorablement cette proposition, non sans relever que son financement reste toutefois à déterminer. Il serait souhaitable de réorienter certains financements, notamment ceux accordés à des entreprises qui n'ont pas été vertueuses dans la gestion de leur personnel ou le reversement de leurs dividendes.

Je salue, à mon tour, le travail d'Hervé Saulignac et Boris Vallaud, qui cherchent depuis longtemps des dispositifs concrets et opérationnels à proposer pour faire face à certains défis.
L'urgence est grande, avec l'explosion de la pauvreté causée par la crise sanitaire. Mais la pauvreté existait déjà bien avant. Les inégalités sont massives en France, en Europe et dans le monde. La pauvreté n'est pas un choix ; elle est le résultat d'une organisation du monde, de décisions politiques. C'est à cela que nous devons nous attaquer en trouvant les moyens d'y faire face, avec celles et ceux qui en sont les victimes.
La jeunesse préoccupe particulièrement le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Une commission d'enquête de notre assemblée a récemment pointé du doigt la situation particulière dans laquelle elle se trouve. J'espère que les débats qui se multiplient dans la période – cette proposition de loi y concourt – inspireront des décisions à la hauteur des difficultés auxquelles les jeunes, étudiants et non‑étudiants, ont à faire face.
La proposition de loi promeut l'idée d'un revenu dit de base – d'autres parlent d'un revenu universel qui serait mis en œuvre différemment. Nous sommes intéressés par l'automaticité que vous proposez, car il y a trop de renoncements aux droits. Nous attendons, d'ailleurs, un rapport sur le sujet, que le Gouvernement ne nous a pas encore rendu. Vous engagez une réflexion sur l'adaptation des aides sociales aux situations qu'il nous semble également intéressant de poursuivre. Enfin, vous proposez, avec la dotation universelle, un dispositif innovant sur lequel nous devons poser un regard positif. Les pistes de financement sont également intéressantes : il y a matière à prendre de bonnes décisions.
Nous abordons donc ce texte avec beaucoup d'intérêt.

La pauvreté, déjà très importante, s'accentue dramatiquement avec les effets de la crise. Les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires ; les services sociaux sont débordés ; les demandes de RSA explosent. La précarité s'installe ; elle touche dorénavant massivement les jeunes. Notre famille politique de la droite et du centre a toujours répondu présent lorsqu'il a fallu combattre le fléau de la précarité, notamment avec la création du salaire minimum interprofessionnel garanti, du SAMU social de Paris ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Si nous partageons avec vous la volonté de lutter contre l'augmentation préoccupante de la pauvreté, nous nous interrogeons sur votre méthode. Plutôt que de créer un revenu de base sans contrepartie, nous proposons de pallier le basculement dans la pauvreté par l'emploi, à travers la création de 300 000 emplois dédiés aux jeunes de 18 à 25 ans. Ces emplois seraient pris en charge par l'État, sur le modèle du chômage partiel tel qu'il est déployé par les collectivités territoriales, les associations d'utilité publique et les administrations. Parce qu'il est essentiel d'encourager les projets des jeunes plutôt que de leur faire attendre des aides financières, nous proposons de créer un prêt bancaire spécifique pour les jeunes, conditionné à un projet professionnel, qui serait garanti par l'État et qui leur permettrait de créer ou de poursuivre des activités. Enfin, je m'interroge sur les mesures financières de la proposition de loi, qui pénaliseront les plus riches et conduiront à un système confiscatoire, alors que l'adhésion à notre mode de répartition faiblit. Cela pourrait nuire à notre compétitivité.
Si nous partageons vos objectifs, il n'en est pas de même de la méthode et du projet que vous présentez.

Je suis partagé entre l'envie de vous remercier, car vous avez été nombreux à saluer le sérieux et la qualité de notre travail ainsi qu'à partager notre diagnostic, et l'incompréhension devant notre incapacité à nous mettre d'accord sur l'essentiel : chaque jour, des jeunes de ce pays n'arrivent plus à manger.
Nous avons fait le choix d'un travail sérieux, partagé, nourri de nombreux échanges et consultations, et dénué de toute ambition doctrinaire ou idéologique, comme certains l'ont laissé entendre. Si telle avait été notre optique, nous aurions soutenu l'idée d'un revenu universel de 1 500 euros, pour tous, pour toute la vie. On en est assez loin. Le dispositif cible les plus proches, et ne relègue pas au second plan la solidarité familiale, qui doit s'exercer quand elle le peut. Il limite le revenu de base à 564 euros, le montant du RSA. On n'encourage pas à l'oisiveté avec un tel montant : c'est un revenu de subsistance, juste pour ne pas crever, si j'ose dire. C'est à cela que nous nous sommes volontairement limités, pour que la proposition que nous faisons, pour la jeunesse mais pas seulement, paraisse crédible et acceptable par tous, au-delà de nos divergences de vue politiques.
Madame Iborra, je vous le dis avec respect, nous ne vivons pas dans le même monde. Vous semblez considérer que la jeunesse trouve des réponses dans toutes les actions que le Gouvernement entreprend à son intention. Je ne crois pas que ce soit vrai. Vous proposez un débat à l'Assemblée : cela tombe bien, nous l'avons en ce moment ! Ne reportons pas à plus tard ce qui relève de l'urgence, que presque tous ici ont constatée. Exiger un débat à l'Assemblée nationale sur ces questions me paraît un peu court.
Évitons aussi la caricature. Cette proposition de loi ne se limite pas à l'apport d'une aide pécuniaire. La question de l'accompagnement est centrale et il n'y aurait aucun sens à penser la lutte contre la pauvreté, notamment celle qui touche les plus jeunes, sans accompagner ces derniers sur le chemin de l'emploi. Mais tout de même... Lorsque l'on ne mange qu'une fois par jour, on a besoin d'un peu de dignité, ce qui passe par un minimum de subsides. Il n'est donc pas possible de faire comme si la question de l'aide pécuniaire était secondaire alors que, pour un certain nombre de jeunes, elle est urgente.
Je ne suis pas sûr, madame Iborra, que la majorité à laquelle vous appartenez ait attendu qu'un consensus se dégage pour mener certaines réformes. Je ne crois pas non plus que l'action politique consiste à l'attendre pour prendre des décisions. En tout cas, le consensus existe sur le diagnostic et ce n'est déjà pas si mal.
De plus, cette mesure n'a rien d'administratif ou de technocratique. Je ne crois pas qu'il soit possible de faire plus simple : un revenu de base automatique dès 18 ans, c'est simplement un droit nouveau qui se justifie de lui-même.
Cette proposition de loi, monsieur Viry, serait un peu doctrinaire ? Si combattre la pauvreté relève de la doctrine, alors, je veux bien être doctrinaire.
Je crois que chaque jeune aspire à l'émancipation d'abord par l'entrée dans le monde du travail qui lui procurera le revenu nécessaire. Notre proposition de loi ne heurte en rien la valeur travail. Le revenu de base n'a d'ailleurs aucun effet négatif sur le travail, l'exemple finlandais en atteste. De plus, en Europe, sur vingt-huit pays, quatre seulement accordent les minima sociaux uniquement à partir de 25 ans, dont la France. Si nous voulons que les conditions d'entrée dans le monde du travail soient les plus favorables possible, il n'est peut‑être pas utile que cette jeunesse endure un parcours du combattant pendant presque sept ans.
Madame de Vaucouleurs, à force de partager le diagnostic, nous finirons peut-être un jour par partager le remède ! Je regrette que vous n'en tiriez pas la conclusion que le moment est venu d'y aller ! Je vais m'y employer, mais je ne pense pas pouvoir vous faire changer d'avis.
Je n'ai jamais douté une seconde du soutien de mon collègue Juanico, qui ne m'en voudra pas de ne pas épiloguer sur son intervention, que j'ai particulièrement appréciée.
Je vous remercie, madame Petit, pour le retour historique, que je partage. Vous avez rappelé les enjeux avec des mots très justes mais je ne comprends pas pourquoi, selon vous, le revenu universel est un projet macroniste. Si tel est le cas, quand le proposerez-vous ? Le temps politique ne doit pas s'enliser dans les bonnes paroles car le temps social, lui, file très vite. Peut-être pourra-t-on dire encore pendant quelques semaines à cette jeunesse que le revenu universel est un projet macroniste, mais chaque jour qui passe jette le doute sur cette belle déclaration.
Je vous remercie pour votre avis favorable, madame Wonner. Vous avez soulevé la question centrale du financement, qui implique d'abord de savoir combien coûte la pauvreté dans notre pays : selon l'enquête d'ATD Quart Monde de 2015, plus cher, de toute façon, que ne coûterait à la société une dépense pour essayer de l'éradiquer.
Je suis d'accord avec Pierre Dharréville, qui a beaucoup insisté sur l'urgence de la situation. Si nous persistons à nous égarer dans de bonnes paroles en disant aux jeunes que nous comprenons leur souffrance mais qu'il est trop compliqué de nous mettre d'accord sur un dispositif essentiel et élémentaire pour leur venir en aide, nous leur enverrons un mauvais signal. Je ne sais pas ce que pourrait donner, dans les mois et les années à venir, une jeunesse qui ne croirait plus en la vertu d'un État protecteur... Cette idée me préoccupe à titre personnel et en tant que législateur. Si nous ne répondons pas très rapidement à cette urgence, nous devrons peut-être un jour en payer le prix fort.

Que le Gouvernement s'efforce de trouver des solutions pour chaque jeune, tant mieux : il serait coupable de ne pas le faire. Les élus socialistes, chaque fois qu'ils le peuvent, s'engagent dans la voie offerte, mais cela ne suffit pas. Chaque soir, des jeunes, la tristesse au front, font la queue devant les banques alimentaires.
Nous pouvons tous convenir qu'il est temps d'agir. Que proposons-nous ? Un mécanisme dont l'automaticité permet de récupérer 30 % des gens qui n'exercent pas leurs droits, et dont certains s'abîment dans la grande pauvreté avec ce que cela implique comme conséquences sociales, médicales, psychologiques pour eux et leurs enfants.
Cette jeunesse a le désir ardent de s'inventer un avenir, d'avoir une place dans la société, de trouver un stage, une formation, un emploi. Nous défendons la valeur travail, la possibilité d'obtenir un travail digne, qui permette de vivre, d'être, de s'émanciper, car nous savons aussi que le travail peut abîmer et que la question de la vie et de la santé au travail est fondamentale. Mais cette jeunesse connaît une extrême pauvreté, éprouve une angoisse existentielle au cœur d'une crise sans précédent. Nous ne pouvons pas nous quitter cet après‑midi, après avoir partagé un diagnostic accablant pour un grand pays comme le nôtre, sans avoir dit à la jeunesse et aux plus précaires de nos concitoyens que nous mettons tout en œuvre pour que chacun puisse sortir la tête de l'eau.
Nous avons réfléchi à la question de la conditionnalité, avec les droits et les devoirs. Le premier des droits, c'est celui d'être accompagné. Le dispositif de la garantie jeunes est, de ce point de vue, un modèle. Nous attendons la concrétisation du service public de l'insertion annoncé par le Gouvernement, tout comme l'instauration du revenu universel d'activité, mais nous ne voyons rien venir.
Là où se sont déroulées les expérimentations, les bénéficiaires de ce filet de sécurité, de ce revenu d'existence se sont-ils abîmés dans l'oisiveté ? Ont-ils renoncé à chercher du travail ? En aucun cas, nulle part ! En Finlande, ceux qui cherchent le moins un emploi font partie du groupe témoin, celui qui ne perçoit aucune allocation. Lorsque votre horizon se limite à la fin de la journée, au mieux à la fin de la semaine, pour vous nourrir, vous et vos enfants, et pour vous loger ; lorsqu'un jeune est obligé de rendre son appartement pour revenir vivre chez ses parents, au lieu de déployer ses ailes pour entrer dans l'âge adulte, ce n'est pas la même chose que lorsque l'horizon s'ouvre : vous repartez à la recherche d'un emploi, vous vous saisissez à bras-le-corps de votre projet de formation, vous reconsidérez l'avenir, vous vous soignez. Et les résultats sont positifs pour tout le monde, car, comme l'a dit Hervé Saulignac, la pauvreté coûte plus cher que les politiques de lutte contre celle-ci.
Certains ont évoqué un contrat et non un contrôle. Or, à Pôle emploi, vous n'avez recruté que des contrôleurs.
Monsieur Viry, nous avons en partage ce que les gaullistes sociaux, les socialistes et les communistes ont su construire au fil de l'histoire, cet héritage commun qui a survécu aux alternances, ce socle qui permet de mener une vie digne, qui a un sens.
Nous n'avons pas soumis au débat la question des modalités de financement, mais pas par esprit de « y'a qu'à, faut qu'on » ; nous savons comment financer : plutôt que de voir un problème dans la dépense publique, il faut parfois considérer que c'est dans la recette publique qu'il se pose. Lorsque les multinationales ne paient pas leurs impôts, que 40 % de leurs résultats sont consolidés dans des paradis fiscaux, ce sont des milliards qui manquent aux États et aux services publics. Quand le taux d'effort est plus important dans les premiers déciles de l'impôt sur le revenu, il y a un problème de justice. Quand, avec la suppression de la dernière tranche de la taxe d'habitation, 20 % des Français vont capter 46 % des dépenses fiscales, on est en droit de se demander si tout cela est bien juste.
Nous avons proposé un financement du dispositif à travers la réforme des très grosses successions. Il n'est évidemment pas question de toucher à un héritage qui est le fruit d'une vie de travail. Mais lorsque l'on est né rentier, que l'on transmet une rente grossie par la spéculation, il est juste de participer mieux à la solidarité nationale. Dans notre proposition, 85 % des Français étaient, comme aujourd'hui, exonérés des frais de succession. En fait, ce que nous mettons en débat, c'est la justice de notre modèle fiscal et social, et son efficacité redistributive. Choisir l'universalité, c'est préférer des droits pour tous à des allocations pour certains.
Cette proposition de loi a été très travaillée et a fait l'objet d'une très large consultation, ce qui est assez inédit pour une proposition de loi de l'opposition, avec les moyens dont celle-ci dispose. Je remercie, à ce propos, les administrateurs de la commission, qui ont fait un travail considérable.
Nous avons un rendez-vous. Sommes-nous capables de proposer un progrès social supplémentaire pour ces jeunes de 18 ans qui n'ont droit à rien, qui sont majeurs à 16 ans sur le plan pénal, à 18 ans sur le plan civique, et qui ne le sont qu'à 25 ans sur le plan social, ce qui est une singularité française ? Nous pouvons changer les choses ; nous pouvons nous soucier de l'avenir en nous souciant de la jeunesse. C'est précisément le sens de ce texte.
La commission en vient à l'examen des articles de la proposition de loi.
Article 1er Instaurer un revenu de base inconditionnel
La commission rejette l'article 1er.
Après l'article 1er
La commission examine l'amendement AS7 des rapporteurs.

Des femmes, en particulier, pourraient être pénalisées pour l'attribution de ce revenu dès lors que leur conjoint disposerait de ressources. Nous demandons donc au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, afin d'examiner les effets de la prise en compte de la situation conjugale du bénéficiaire dans le calcul du montant du revenu de base. Une prestation individualisée pourrait être ainsi envisagée.

Il a beaucoup été question de dignité, mais je me demande si une prestation individuelle de 564 euros mensuels est digne. La France insoumise plaide pour que le RSA jeune actif tende vers 800 ou 1 000 euros.
En matière d'insertion professionnelle, ne conviendrait-il pas de parler d'une garantie universelle de l'emploi plutôt que d'un revenu universel ? Le versement d'une allocation ne saurait en effet régler la question de l'accès à l'emploi. Nous avons proposé une conscription obligatoire pour que les jeunes qui participent à des travaux d'intérêt général soient payés au SMIC, ce qui serait un véritable tremplin vers l'autonomie et la dignité.
Puisque vous parlez de partage, cher collègue Vallaud, celui du temps de travail serait une piste plus évidente et plus facilement finançable, non seulement pour les jeunes mais pour tous, afin de mieux répartir les richesses créées dans notre pays.

Aucune question que vous soulevez n'est exclusive des autres. Une autre piste de partage dans l'entreprise est celui de la valeur ajoutée, qui fait l'objet d'une captation entre très peu de mains ; il permettrait d'augmenter les salaires les plus bas. Nous devons évidemment réfléchir à la garantie universelle de l'emploi, notamment, mais cela n'interdit pas de réfléchir également au dispositif que nous proposons.

Mécaniquement, les employeurs risquent de miser sur cette dotation de base qu'est le revenu universel pour réduire le salaire complémentaire qu'ils devront verser. Les salaires seront donc tirés vers le bas et la répartition de la valeur ajoutée au sein des entreprises n'en sera pas améliorée.

L'individualisation est en effet importante et s'inscrit dans la logique du revenu de base ou universel visant à émanciper les jeunes vis-à-vis de leur famille et les femmes vis-à-vis de leur conjoint. Le revenu universel, monsieur Prud'homme, tend à éradiquer la pauvreté, pas le chômage. Pour cela, d'autres politiques publiques existent – nous proposons, par exemple, l'instauration d'un service public de l'activité. Ne mélangeons pas tout !

Le revenu de base serait fondé sur la fusion du RSA et de la prime d'activité. Ceux qui ont droit au RSA et qui n'en bénéficient pas disposeraient ainsi automatiquement de ce revenu, ce qui permettrait de tirer 30 % des personnes privées d'emploi de la très grande pauvreté.

Précisément !
J'ajoute que la création du RMI et de la prime d'activité n'a entraîné aucune baisse de salaire. Nous aurons l'occasion d'en discuter lors de l'examen de la proposition de loi pour une limite décente des écarts de revenus.
La commission rejette l'amendement.
Article 2 : Instaurer une dotation tremplin universelle sur le compte professionnel d'activité
La commission rejette l'article 2.
Après l'article 2
La commission est saisie de l'amendement AS8 des rapporteurs.

Certains des 2 000 contributeurs à la consultation citoyenne se sont interrogés sur le montant de la dotation tremplin et sur les usages autorisés de cette dernière sur le compte personnel d'activité, dont nous avons souhaité qu'ils soient encadrés et limités à la formation, à la recherche d'un emploi et à la création d'une activité entrepreneuriale. Nombre de contributeurs auraient souhaité que nous allions au-delà, voire, qu'il n'y ait aucune limitation à ces usages.
Cet amendement prévoit donc que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi examinant l'opportunité d'une évolution du dispositif sur ces deux points.
La commission rejette l'amendement.
Article 3 : Coordinations
La commission rejette l'article 3.
Après l'article 3
La commission examine l'amendement AS9 des rapporteurs.

Notre proposition vient de loin ; elle ne relève pas d'un caprice personnel. Des collectivités locales, en première ligne dans l'application de la politique sociale et d'insertion, de nombreuses associations et organisations syndicales, des chercheurs s'y sont impliqués. C'est avec beaucoup de regret et de tristesse que je constate le sort que vous réservez à ce travail, qui a été longuement mûri. Vous avez l'art de balayer d'un revers de la main ce qui mérite, au contraire, une discussion approfondie.
Nous sommes au moins tous d'accord : la jeunesse souffre, ne mange pas à sa faim, et nous nous devons d'agir, mais peut-être pas en adoptant une réforme structurelle qui soulève un certain nombre de questions en matière de financement, d'accompagnement, d'automaticité. Dont acte. Je vous propose donc qu'à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 – mais le Gouvernement pourrait décider d'avancer la date puisque nous sommes empêchés par l'article 40 –, nous ouvrions le bénéfice du revenu de solidarité active aux bénéficiaires âgés de plus de 18 ans. Ce serait un compromis républicain par lequel nous nous montrerions à la hauteur de la situation et éviterions que nos réserves n'hypothèquent l'avenir de la jeunesse. Vous vous êtes fait élire sur la promesse d'écouter tout le monde : montrez-le un peu !

Il n'est pas question de mettre en cause la qualité de votre travail mais, comme nous respectons vos convictions, respectez les nôtres ! Nous avons en effet des divergences, mais nous ne pensons pas pour autant que tout est parfait et qu'il n'y a rien à faire !
Ce que vous proposez ne correspond en rien à notre engagement lors de l'élection présidentielle et ne règlera pas le problème des inégalités, lequel doit être traité à la racine, ce que les précédents gouvernements n'ont jamais fait. Je regrette que les socialistes persistent sur cette trajectoire.

Un jeune qui vous écouterait sombrerait dans la dépression ! Je vous assure que nous vivons dans le même monde. J'ai participé aux auditions, je suis élue depuis dix ans, je discute régulièrement avec des jeunes en visioconférence depuis trois semaines : je suis certaine que ce n'est pas de cela qu'ils ont besoin. Je ne nie pas les difficultés, mais l'enjeu est de savoir quelles en sont les causes et s'ils sont informés sur leurs droits. Il faut partir à la recherche des « invisibles » et les accompagner beaucoup mieux que nous ne le faisons.
Je veux bien que vous prévoyiez un accompagnement des jeunes par les conseils départementaux, mais ils sont d'ores et déjà très bien accompagnés par les missions locales. Le tableau n'est ni rose ni noir. La crise est même une opportunité pour remettre les politiques en direction de la jeunesse au cœur de nos préoccupations.
Encore une fois, nous n'avons pas la même méthode que vous. Nous partageons votre volonté d'accompagner les jeunes vers l'autonomie et l'émancipation, mais nous parions qu'elles passent par la formation et l'emploi, certainement pas par un RSA jeunes qui, de surcroît, est très stigmatisant. Les jeunes s'interrogent bien plutôt, par exemple, sur l'accès au logement et à l'information sur les aides, qui existent bel et bien.
De plus, vous semblez nier tout ce qui a été accompli depuis le lancement du plan jeunes et les résultats obtenus : 615 000 jeunes sont entrés dans des parcours d'insertion et 500 000 en apprentissage ; les entrées en garantie jeunes, dont les critères ont été assouplis, ont doublé. En 2021, les jeunes bénéficieront de 1 200 000 propositions. Sans doute faut-il aller plus loin, mais certainement pas avec le RSA jeunes.

Nous partageons cet objectif de création d'un revenu universel, mais il y faut une réforme historique qui prendra du temps et qui ne relève pas d'une « niche » parlementaire. Le groupe Agir ensemble défend également une réforme fiscale qui, elle aussi, nécessite de prendre le temps.
Compte tenu de l'urgence pour la jeunesse, comment faire ? Votre proposition de loi s'inscrit dans ce contexte. J'ai, quant à moi, écrit récemment au Premier ministre afin de lui proposer une expérimentation de « notre » revenu universel, en urgence, pour les moins de 25 ans.
Je suis d'accord avec mes collègues du groupe La République en Marche, l'extension du RSA aux moins de 25 ans n'est pas la bonne solution, mais nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Je ne voterai pas, toutefois, cet amendement.

Ce débat s'impose. Je constate que nombre de jeunes sont en dehors des radars de l'aide sociale. On ne peut pas simplement prétendre que leur situation s'améliorera lorsqu'ils auront un emploi. Il convient donc d'agir, en particulier dans le contexte dégradé que nous connaissons.
Si, d'après une collègue de la majorité, cette proposition de loi ne permet pas de remédier aux inégalités, je crains que le projet de la majorité ne les aggrave. Toutes les enquêtes économiques produites dans la dernière période le montrent. Un changement de cap politique s'impose et il importe de revenir sur un certain nombre de mauvais choix.

Nous ne voulons pas du RSA jeunes. À titre personnel, je suis favorable à l'instauration d'un revenu universel, mais il ne me semble pas opportun de proposer un minimum social à partir de 18 ans, car cela pourrait réduire leur situation à celle d'assistés. Nous devons faire en sorte que chaque jeune dispose de ressources, notion qui me paraît essentielle. Leur dépendance financière vis-à-vis de leurs parents est dommageable alors qu'ils aspirent à l'autonomie.
Si je ne voterai pas cet amendement, je considère qu'il faut éliminer tous les trous dans la raquette, inacceptables, et poursuivre rapidement le débat. Le groupe MoDem et Démocrates apparentés a d'ailleurs voté la proposition de résolution relative au lancement d'un débat public sur la création d'un mécanisme de revenu universel appelé socle citoyen.

Nous avons l'habitude d'entendre des propos comme ceux que vient de tenir M. Dharréville mais je lui rappelle que, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, le taux de pauvreté a diminué en 2019 et que nous avons également élargi le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité, dont nous avons aussi augmenté le montant.

Mme Cloarec-Le Nabour a parlé de dépression. Lorsque j'entends une autre représentante de la majorité affirmer qu'il n'est pas question d'aller plus loin que ce qui a déjà été déjà fait, il y a de quoi faire sombrer un député dans la dépression. Cela montre combien le décalage entre la réalité vécue par la jeunesse et certains parlementaires est immense : 22 % des jeunes sont en détresse psychologique, 50 % sont inquiets pour leur santé mentale, 36 % ont perdu le petit boulot qui leur permettait de financer leur budget d'étudiant, 25 % vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons le devoir impérieux de réagir urgemment à l'urgence !
La semaine prochaine, en séance publique, notre assemblée pourra émettre un signal à l'intention de cette jeunesse qui s'impatiente, en tout cas à ceux qui, parmi elle, croient encore que nous pouvons répondre à leur appel. Cet amendement est de repli de repli de repli, puisque nous proposons une mesure temporaire et pas d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans ad vitam æternam. Il s'agit d'une mesure réactive et massive. Si la formule de RSA jeunes vous dérange, Boris Vallaud et moi-même n'avons aucune vanité d'auteur. Mme de Vaucouleurs a évoqué les « ressources ». Pourquoi pas, dès lors que la réponse est efficace !
Nous proposons une extension du RSA parce qu'il existe, qu'il a fait ses preuves et qu'il est financé. Il n'est pas question de faire prendre à la nation un risque budgétaire immense : nous proposons simplement d'éteindre un incendie. Vous pouvez dire que ce n'est pas la bonne façon de le faire, mais si vous n'en proposez pas une autre, vous ne serez pas à la hauteur de vos responsabilités.

M. Saulignac se campe en sauveur d'une jeunesse qui, du jour au lendemain, se retrouverait grâce à lui dans une situation enviable. L'Union nationale des étudiants de France, syndicat qui est proche de vous et, en tout cas, loin de nous, considère que les 564 euros que vous proposez sont nettement insuffisants et propose un doublement de cette somme. Je vous invite donc à faire preuve d'un peu plus de modestie.

Le débat aura lieu dans l'hémicycle et c'est tant mieux. La souffrance psychique concerne principalement les étudiants mais elle ne s'explique pas par des raisons nécessairement financières : certains se sentent isolés et n'ont pas pu rentrer dans leur famille en raison de l'enseignement en distanciel et des confinements.
Vous ne pouvez pas dire que nous ne faisons rien avec le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, la garantie jeunes, l'accompagnement intensif des jeunes de Pôle emploi, l'objectif premier emploi de l'Association pour l'emploi des cadres, les écoles de la deuxième chance, les établissements pour l'insertion dans l'emploi, le dispositif prépa‑apprentissage ! Les jeunes diplômés boursiers pourront, quant à eux, conserver une partie de leur bourse pendant quatre mois supplémentaires. Nous essayons de trouver des solutions pour chaque profil et nous continuerons.
La commission rejette l'amendement.
Article 4 : Entrées en vigueur
La commission rejette l'article 4.
Article 5 : Gage financier
La commission rejette l'article 5.
L'ensemble des articles de la proposition de loi et des amendements portant articles additionnels ayant été rejeté, l'ensemble de la proposition de loi est considéré comme rejeté par la commission.

Je remercie à nouveau nos administrateurs et tous ceux parmi vous qui ont soutenu ce texte, lequel ne tend pas à supprimer tout ce qui a été fait – nous sommes manifestement plus attentifs que ne l'est la majorité. Quoi qu'il en soit, nous venons de rater un rendez-vous et c'est bien dommage.
*
La commission procède ensuite à l'examen de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19 (n° 3723) (M. Régis Juanico, rapporteur).

Je souhaite vous faire part du témoignage de Pauline Oustric, jeune chercheuse en comportements alimentaires et présidente de l'association AprèsJ20 rassemblant de nombreuses personnes atteintes de formes longues de la covid-19, qui a accepté de nous parler de son expérience et des principaux symptômes de cette pathologie : « Je ne peux plus vivre une journée normalement. On m'a diagnostiqué il y a quelques mois une dysautonomie, une dérégulation du système nerveux. J'ai encore des problèmes pour digérer, des malaises post-efforts, de la tachycardie au repos, ce qui est quand même préoccupant à 27 ans. Ces symptômes durent depuis dix mois, car j'ai contracté la covid-19 fin mars, sans besoin d'hospitalisation. Je ne peux plus aujourd'hui vivre comme avant, où je travaille, et faire des choses normales à la maison. C'est une autre vie. »
La vie de Pauline, comme celle de tant d'autres, a ainsi été bouleversée depuis qu'elle souffre d'une forme de « covid long », pathologie reconnue en août par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui y consacrait hier un séminaire. Ce covid long se caractérise par des symptômes persistant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après la contraction de la maladie.
Aux très nombreuses victimes de la covid-19 – celles qui ont été hospitalisées, celles pour qui il a été nécessaire de recourir à des soins de réanimation et celles qui sont malheureusement décédées des suites de la maladie – s'ajoutent d'autres victimes, moins connues et pas toujours identifiées, dont le quotidien a pourtant été bouleversé depuis leur infection par le virus de la covid-19.
Les séquelles de la covid-19, polymorphes et marquées par différents degrés de gravité, relèvent de trois catégories principales qu'il s'agit ici de rappeler.
De nombreux patients dont l'état a nécessité des soins à l'hôpital, souvent en service de réanimation, sont d'abord atteints de séquelles importantes résultant des formes graves de la maladie et du mode de prise en charge particulièrement lourd associé. Les personnes concernées souffrent le plus souvent de séquelles lourdes, notamment respiratoires et cardiaques – fibrose pulmonaire, insuffisance rénale aiguë –, de troubles musculo-squelettiques très invalidants et d'atteintes au système nerveux central.
Un deuxième type de séquelles de la covid-19 touche des personnes ayant contracté des formes relativement légères de la maladie, sans besoin d'hospitalisation. Ces personnes – le plus souvent des femmes et de nombreux jeunes – souffrent d'un covid long, évoqué à l'instant, caractérisé par des symptômes lancinants, persistants et particulièrement invalidants, au premier rang desquels figurent un épuisement terrassant, un essoufflement rapide, une fatigue chronique, une désadaptation à l'effort, des troubles cognitifs, une anosmie et une agueusie.
Un grand nombre de spécialistes évoquent enfin des séquelles psychiatriques de la covid-19 particulièrement alarmantes chez de nombreux patients : anxiété, insomnie, dépression, syndromes post-traumatiques, symptômes obsessionnels. Le lien entre maladie infectieuse, inflammation et déclenchement de troubles psychiatriques a été démontré de longue date. Selon la professeure Marion Leboyer, les conséquences psychiatriques de la covid-19 sont devant nous.
S'il est encore tôt pour dire avec précision combien de personnes souffrent de ces séquelles polymorphes de la covid-19, il est aujourd'hui établi qu'elles concernent plusieurs centaines de milliers de victimes. Ces victimes, ce sont d'abord nos soignants, qui ont fait et font toujours l'admiration de tous pour leur courage et leur mobilisation sans faille dans la lutte contre l'épidémie. Ce sont aussi tous ces travailleurs de première ligne qui, tout au long de la crise sanitaire, ont assuré la continuité de la nation au péril de leur santé et, parfois, de leur vie. Ce sont enfin toutes ces personnes que nous appelons « victimes environnementales » ou « collatérales », qui ont été contaminées par leurs proches, lesquels avaient eux-mêmes souvent contracté la maladie dans l'exercice de leur profession.
Ces personnes, nous les avons applaudies tous les soirs, pendant de longues semaines, pour leur témoigner notre reconnaissance. La nation tout entière a reconnu leur courage et leur dévouement. Nous leur avons promis notre gratitude et notre soutien. Et pourtant, le Gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Le dispositif de réparation des préjudices subis par les victimes de la covid-19 prévu par le décret du 14 septembre 2020 est très loin d'être à la hauteur des enjeux. Particulièrement insuffisant, il fait l'objet d'un rejet unanime de la part des associations de victimes et de l'ensemble des organisations syndicales salariées.
Pour les soignants, d'abord, contrairement à ce qui avait été annoncé à de multiples reprises par le Gouvernement, y compris dans notre assemblée, la reconnaissance de la covid‑19 comme maladie professionnelle n'est ni automatique ni systématique. Pour recevoir une indemnisation, les soignants et assimilés doivent être atteints d'affections respiratoires aiguës et avoir eu recours à une oxygénothérapie. Ces critères sont particulièrement restrictifs et peu pertinents dans la mesure où, comme on l'a vu, les séquelles cardiaques, neurologiques ou cérébrales de la covid-19 touchent de nombreux patients atteints, au départ, de formes peu graves de la maladie.
Pour les autres travailleurs et les personnes dont la pathologie ne correspond pas aux critères très stricts que je viens d'énoncer, la reconnaissance de la covid-19 comme maladie professionnelle relève d'un véritable parcours du combattant. Fin janvier, les organisations syndicales faisaient ainsi état de seulement cent reconnaissances au titre du nouveau tableau MP100 des maladies professionnelles et de quinze reconnaissances au titre de la procédure complémentaire. Ces victimes sont tenues de prouver l'existence d'un « lien direct et essentiel » entre leur travail et la contamination par le virus ; or ce lien est particulièrement difficile à établir dans le cadre d'une épidémie comme celle que nous connaissons. L'existence d'un système à deux vitesses fait, par ailleurs, l'objet d'une vive incompréhension de la part des victimes. Il témoigne d'une forme de mépris face à l'engagement de nombreux travailleurs, ces aides à domicile, hôtesses de caisse, agents des forces de l'ordre et de sécurité, pompiers, enseignants, agents de propreté et commerçants montés au front en pleine crise sanitaire. Alors qu'ils souffrent souvent des mêmes séquelles, comment expliquer qu'ils ne soient pas placés sur un pied d'égalité avec les soignants et assimilés ?
Uniquement centré sur la reconnaissance comme maladie professionnelle, le dispositif d'indemnisation existant laisse, en outre, de nombreuses victimes de côté. Je pense aux travailleurs indépendants, dont une très faible minorité seulement est assurée contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), aux très nombreuses victimes environnementales contaminées hors du cadre professionnel, aux bénévoles venus prêter main-forte aux associations de solidarité, aux retraités – les plus de 65 ans représentent 90 % des personnes décédées –, aux résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui ont payé le plus fort tribut à la crise avec 30 000 décès sur les 80 000 recensés à ce jour, ou encore aux proches des personnes décédées.
L'indemnisation proposée est, enfin, largement insuffisante : uniquement forfaitaire, elle ne prend pas en compte les nombreux préjudices physiques, économiques et moraux dont souffrent les victimes.
Nous devons agir face à la détresse de ces nombreuses personnes qui nous appellent à passer aux actes. La réparation des nombreux préjudices subis par ces victimes est un devoir, à plusieurs titres.
La responsabilité de l'État dans la situation de ces victimes est indéniable. Qu'il s'agisse de la question des masques, des lourdeurs dans le déploiement d'une véritable stratégie de dépistage ou du retard important dans la prise de mesures protectrices à l'égard de nos aînés dans les EHPAD, la façon dont les pouvoirs publics ont répondu à la crise sanitaire s'est caractérisée par de nombreux errements et n'est pas étrangère à la propagation rapide et massive de l'épidémie. Notre but n'est pas ici d'établir une liste exhaustive des manquements constatés dans la gestion de la crise sanitaire – les commissions d'enquête parlementaires s'en sont chargées, et ce travail est loin d'être achevé. Au-delà de la recherche des responsabilités, la mise en place d'un système ambitieux d'indemnisation des victimes de la covid-19 relève avant tout de la solidarité nationale.
Il s'agit d'abord de reconnaître l'engagement de tous ceux qui ont pris de nombreux risques pour assurer la prise en charge des malades et la continuité de la vie de la nation.
Il s'agit aussi de prendre en compte la souffrance insupportable vécue par ces victimes, nombreuses à dépendre aujourd'hui de leurs proches pour l'ensemble des gestes du quotidien. À la douleur physique s'ajoute souvent, pour ces personnes, une difficulté à faire reconnaître leur pathologie, dont les formes demeurent encore peu connues. La fatigue physique et intellectuelle intense, caractéristique de cette pathologie, les empêche bien souvent de poursuivre leur travail et constitue pour un grand nombre d'entre elles un risque majeur de désinsertion professionnelle, voire de désocialisation.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, avec Christian Hutin et les députés du groupe Socialistes et apparentés, la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de la covid-19, outil aux objectifs ambitieux et aux nombreux bénéfices.
S'adressant aux laissés-pour-compte du dispositif existant, ce fonds a pour vocation d'offrir une réparation des préjudices subis par toutes les victimes présentant des séquelles temporaires ou définitives de la covid-19, qu'il s'agisse de séquelles lourdes résultant de formes graves de la maladie ou de symptômes persistants caractéristiques du covid long. La réparation que nous envisageons s'adresse aussi aux ayants droit des personnes malheureusement décédées des suites de la maladie ; nous ne les avons pas oubliées. Nous proposons la mise en place d'une réparation intégrale, qui permette à la victime de vivre dans des conditions aussi proches que possible de la situation antérieure à la maladie.
Le fonds d'indemnisation des victimes de la covid-19 s'inspire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le modèle est aujourd'hui largement éprouvé. La création d'un tel fonds présente de nombreux avantages.
Elle permettrait, tout d'abord, de limiter considérablement le risque de contentieux, qui suscite inquiétudes et incertitudes pour des victimes déjà fortement éprouvées par leur maladie. Le dispositif du fonds est, par ailleurs, particulièrement protecteur : dès lors que la victime fait état d'un dommage pris en compte par le fonds, elle peut obtenir une indemnisation sans qu'il soit nécessaire pour elle de prouver une faute.
L'intérêt de la mise en place d'un fonds d'indemnisation réside aussi dans la rapidité et la simplicité de la procédure. Le fonds assure une indemnisation à titre principal, sans que la victime ait à faire valoir son droit d'indemnisation par une action en responsabilité individuelle. Le fonds est, par ailleurs, tenu de présenter une proposition de réparation dans les six mois suivant la réception de la demande.
Le mode de financement du fonds que nous proposons est particulièrement équilibré : principalement fondé sur une contribution de l'État et de la branche AT-MP, il fait participer les employeurs et l'État, qui agissent au titre de leurs responsabilités respectives et de la solidarité nationale.
Telles sont les principales modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de la covid-19 que nous vous invitons à mettre en place. Le principe de la création de ce fonds recueille le soutien des organisations syndicales salariées et des associations de victimes que nous avons entendues et qui nous ont fait part de leur grande attente. Il est également soutenu par l'Académie nationale de médecine. Ne restons pas dans les incantations. Agissons vite pour ces victimes, qui comptent plus que jamais sur notre soutien et notre mobilisation !

Avec le covid, on a un antigène ; avec cette proposition de loi, on a juste une gêne. En lisant cette proposition de loi et en participant aux auditions, j'ai en effet ressenti beaucoup de gêne.
Tout d'abord, le périmètre du fonds d'indemnisation proposé est assez mal déterminé, de l'aveu même du rapporteur. Nous manquons de recul sur cette pathologie encore mal connue. Dans une première version, la proposition de loi devait s'appliquer aux seuls assurés de la branche AT-MP ; aujourd'hui, le texte concerne tous les Français.
Nous sommes également gênés par la financiarisation de la maladie, en dehors de toute préoccupation médicale, scientifique ou thérapeutique. L'attente principale des personnes auditionnées n'est pas l'argent, mais le soin et la guérison.
En outre, le mécanisme proposé se caractérise par la lenteur. Il est approprié pour les victimes de l'amiante, mais il n'est absolument pas adapté aux victimes du covid.
Comme nous l'avons entendu dans le propos liminaire du rapporteur, cette proposition de loi apparaît comme un outil polémique, politique, qui utilise la souffrance de nos concitoyens pour chercher à prouver la responsabilité de l'État, alors même que nos dirigeants ont œuvré pour le meilleur. Nous ne sommes pas ici à la hauteur de la situation.
On ressent également une certaine gêne chez le rapporteur. Le dispositif est manifestement mal adapté. Il ne comporte aucune mesure sur le volet AT-MP, auquel le rapporteur avait pourtant initialement voulu s'intéresser. Nous proposons, quant à nous, une procédure dérogatoire, rappelée hier par le ministre des solidarités et de la santé, pour la prise en charge globale de tous nos concitoyens touchés par le covid dans le cadre de leur travail. Dans son intervention liminaire, le rapporteur a, par ailleurs, très vite dévié vers la problématique du covid long, que nous traiterons dans le cadre d'une proposition de résolution déposée par les députés de la majorité présidentielle et très attendue par les associations.
« L'oubli est une gêne », écrivait Julien Green. On sent bien ce sentiment permanent de gêne qui flotte dans cette proposition de loi. Malheureusement, le texte oublie les préoccupations principales des victimes : la majorité ne peut l'envisager. Nous ne voterons donc pas cette proposition de loi.

Comme vous, monsieur le rapporteur, et comme l'ensemble des députés ici présents, je considère évidemment qu'il est impératif d'accompagner les personnes atteintes des conséquences de la maladie. Il est urgent qu'un véritable programme sanitaire à la hauteur de l'épidémie de covid-19 soit mis en œuvre pour que les médecins et les scientifiques mènent une recherche sur les conséquences de cette dernière sur la santé physique et mentale des patients. Il convient d'établir une liste complète des symptômes, de la documenter et de la diffuser tant auprès des patients que des médecins. Cette première étape est essentielle car, même si ce syndrome a été reconnu par l'OMS, le nombre de malades reste encore difficile à évaluer, de même que la durée des symptômes à partir de laquelle la covid‑19 peut être qualifiée de longue.
Si je souscris au principe de la création de ce fonds d'indemnisation, elle me semble peut-être trop rapide. Vous mettez, en quelque sorte, la charrue avant les bœufs. Encore faut-il que la responsabilité de l'État vis-à-vis des victimes soit reconnue. Il est nécessaire de faire la différence entre la responsabilité politique d'un gouvernement et la responsabilité juridique d'un État. Pour que ce fonds ait véritablement du sens, il faudrait que les éventuelles fautes commises soient reconnues, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Si la responsabilité de l'État, des employeurs ou d'autres personnes devait être établie, il pourrait alors être envisagé de créer ce fonds d'indemnisation des victimes.
Je souhaite, pour ma part, que le statut des malades soit d'ores et déjà reconnu, que la population et les professionnels de santé soient informés des symptômes de cette pathologie et que les patients souffrant de covid long fassent l'objet d'une prise en charge adaptée, avec un réel parcours de soins, en coordination avec toutes les associations de malades et l'assurance maladie. Je le répète, il est également nécessaire d'amplifier la recherche sur les formes persistantes de covid-19 : c'est, à mon sens, un prérequis indispensable, que nous devons garantir aux malades.
Il est donc beaucoup trop tôt pour discuter aujourd'hui de la création d'un fonds d'indemnisation, alors qu'aucune responsabilité n'a encore été établie.

Le groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et démocrates apparentés considère cette initiative comme inopportune, sur le fond comme sur la forme.
Sur la forme, d'abord, l'exposé des motifs de la proposition de loi indique que la création de ce fonds vise à « reconnaître les responsabilités de l'État dans la crise sanitaire actuelle ». Permettez-nous de nous insurger contre une telle intention. Comme tous les pays du monde, la France a dû faire face à la crise. Certes, notre réponse a souffert de certaines faiblesses, qui s'expliquent par la soudaineté de l'épidémie, mais elles ont été corrigées, si bien que notre pays est désormais l'un des mieux armés pour protéger sa population. Nous ne pouvons laisser dire et même concevoir que la responsabilité d'une pandémie et de ses conséquences incombe à l'État. La nature est belle, mais elle n'est pas toujours gentille ! Ce genre de déclaration est au mieux démagogique, au pire dangereuse.
Sur le fond, vous proposez de créer un fonds d'indemnisation pour une maladie dont les formes ne cessent d'évoluer et dont les connaissances ne sont pas encore consolidées scientifiquement. Vous me faites penser aux huissiers ou aux agents d'assurance surgissant au milieu d'un sinistre pour faire des promesses aux victimes. Si la réponse scientifique à la pandémie a été rapide et efficace – des vaccins ont déjà été approuvés –, il faut garder à l'esprit que la médecine a besoin de temps pour constater les possibles séquelles et conséquences du covid avant de formuler des conclusions définitives.
Nous sommes évidemment favorables à une réflexion sur la reconnaissance concrète de ce que l'on appelle communément les covid longs. La Haute Autorité de santé (HAS) devrait d'ailleurs publier prochainement des recommandations quant à la prise en charge des personnes souffrant de troubles persistants de la covid-19. Par ailleurs, M. Borowczyk a rappelé que notre assemblée serait amenée à se prononcer, la semaine prochaine, sur une proposition de résolution visant à reconnaître et prendre en charge les complications à long terme de la covid-19, par laquelle nous inviterons le Gouvernement à renforcer la recherche sur ces complications de long terme et à reconnaître comme maladies professionnelles les infections causées par les formes graves de l'infection. Il s'agira d'une étape importante avant d'étendre, à terme, les dispositifs AT-MP à un panel plus large de la population. C'est, selon nous, l'option la plus appropriée.
Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe s'opposera à cette proposition de loi.

Cette proposition de loi est nécessaire à plusieurs égards.
D'abord, pour reconnaître la responsabilité indéniable de l'État vis-à-vis des victimes de la covid-19. Je pense, bien sûr, aux conséquences de la pénurie de masques ; je rappelle à ce sujet qu'il avait été délibérément décidé, en 2018, de ne pas renouveler le stock de masques chirurgicaux dont la quasi-totalité était arrivée à péremption.
Ensuite, pour concrétiser la promesse d'une indemnisation des victimes au nom de la solidarité nationale. Le dispositif de reconnaissance de la covid-19 comme maladie professionnelle actuellement en vigueur est défaillant. Il ne s'adresse qu'à une partie infime de la population, excluant de fait la grande majorité des travailleurs ayant contribué, en première ou en deuxième ligne, à la continuité de la vie de la nation durant la crise. Il ne permet pas non plus de prendre en compte la diversité des formes graves de la maladie, notamment les covid longs, qui se caractérisent par des symptômes durables et parfois handicapants, voire invalidants, et qui peuvent empêcher une reprise d'activité ou, tout simplement, un retour à la vie normale.
Nous avons donc besoin de cette proposition de loi, qui prévoit la création d'un fonds d'indemnisation destiné à l'ensemble des victimes graves de la covid-19 et à leurs ayants droit. Notre rapporteur vous a déjà exposé les raisons pour lesquelles ce nouveau système serait plus simple et, surtout, plus juste. À travers ce texte, notre groupe propose un dispositif clefs en main, crédible et opérationnel, permettant de répondre à l'impératif de solidarité nationale.
Je vous invite à comparer notre démarche avec celle de la majorité, qui prévoit, pour la veille de l'examen de notre proposition de loi en séance publique, la discussion d'une proposition de résolution n'ayant aucune valeur contraignante, invitant simplement le Gouvernement à se pencher sur la question des symptômes durables et de la reconnaissance de la covid-19 comme maladie professionnelle. Il est bien trop tard pour ce type de démarche ! Nous devons désormais agir rapidement pour toutes les victimes et leurs proches, qui comptent sur le soutien des représentants de la nation. Passons donc enfin des paroles aux actes, des promesses aux avancées concrètes, en adoptant cette proposition de loi qui permettra la réparation de l'ensemble des préjudices subis par toutes les victimes graves de cette terrible maladie.

Le covid long, qui est une forme de la maladie caractérisée par des symptômes polymorphes, résurgents et persistants, affecte considérablement la vie des patients, qui en voient leur quotidien bouleversé. L'anxiété majeure que ressentent ceux qui ont vécu la maladie témoigne de la gravité de ses effets, nécessitant une prise en charge circonstanciée, à la hauteur du ressenti psychologique et physique de la pathologie.
À cela s'ajoute l'injustice liée au lieu de contamination. Nombre de nos concitoyens n'ont pas eu d'autre choix que de continuer leur activité professionnelle malgré la situation sanitaire. Ce sont les commerçants, les transporteurs et les agriculteurs, qui ont œuvré pour la continuité des besoins vitaux de notre pays. Le 21 avril 2020, lors des questions au Gouvernement, j'avais interpellé le ministre des solidarités et de la santé afin que soit établie, à l'avenir, une protection financière et juridique complète et adéquate pour ces professionnels qui ont participé à l'effort collectif et national.
L'exemple du FIVA a évidemment beaucoup de sens pour moi. Aux côtés de mon collègue et voisin dunkerquois Christian Hutin, je peux en mesurer toute l'utilité au contact des victimes de l'amiante, ou plutôt de leurs veuves.
Pour autant, à ce stade de la discussion, notre groupe estime qu'il est un peu prématuré de mettre en place ce dispositif d'indemnisation, tant l'ampleur de la maladie nous est encore inconnue. Comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, les données sur les conséquences psychiatriques de la covid-19 sont encore rares ; or elles peuvent être déterminantes pour évaluer l'impact global de cette pathologie. Si nous souhaitons construire un dispositif efficace et réparateur pour ces malades, nous devons posséder des données complètes et suffisantes sur les symptômes au long cours, que seul le temps nous fournira. Il y va de l'efficacité du dispositif envisagé. En tant que rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour la branche AT-MP, vous comprenez aussi l'attention que je porte à ce sujet.
Le groupe Agir ensemble comprend l'ambition de votre proposition, mais il est réservé, à ce stade de nos débats, quant au calendrier choisi et au moyen utilisé.

Je remercie le rapporteur et son groupe d'avoir inscrit une proposition de loi sur ce sujet à l'ordre du jour de sa niche parlementaire – je sais que vous n'en avez pas choisi la date.
J'entends que certains collègues sont choqués par l'expression « responsabilité de l'État ». Au mois de mars, des employés des libres-services et des soignants ont été envoyés au travail sans masque, sans blouse et sans gants. À l'époque, on disait que les masques n'étaient pas utiles. Des personnes sont tombées malades, et certaines souffrent désormais d'un covid long. Pour être reconnu comme atteint d'une maladie professionnelle, il faut être passé par la case « réanimation » et avoir eu de gros problèmes respiratoires ; or certains patients atteints d'un covid long n'ont pas connu ces situations.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir rappelé qu'un fonds d'indemnisation présentait l'avantage de la rapidité et de la simplicité. M. Borowczyk se dit gêné par la financiarisation de la maladie. Lorsque vous êtes atteint d'une pathologie longue et que vous ne percevez que 50 % de votre salaire normal, ce n'est pas simple ! Vous n'avez pas choisi d'être malade, et vous n'avez pas choisi non plus d'aller travailler sans les outils nécessaires pour vous protéger. Alors oui, j'assume cette financiarisation de la maladie, et je remercie le groupe Socialistes et apparentés de nous proposer ce dispositif utile, qui permettra aux victimes d'avoir au moins de quoi remplir leur frigo et de vivre dignement. Je suis désolée que cela vous gêne.

Je remercie Régis Juanico du travail qu'il a effectué. Je connais son attachement à la reconnaissance des maladies et à leur prise en charge pleine et entière.
Il s'agit là d'un sujet majeur. Nous voyons bien l'ampleur que prend cette maladie dans notre société. Nous nous rappelons aussi les difficultés que nous avons eues à l'appréhender. Des femmes et des hommes ont été mis à contribution pendant la période de confinement : ils ont dû faire face, sans tout connaître de cette maladie, et aller au travail pour répondre aux besoins fondamentaux de notre pays. C'est le cas des personnels soignants, mais ils ne sont pas les seuls.
Les dispositions prises par le Gouvernement pour que cette pathologie puisse être reconnue comme maladie professionnelle sont nettement insuffisantes. S'ajoutent à ces difficultés les symptômes de la maladie persistant dans la durée. Nous devons trouver des solutions. Celle qui nous est proposée ici permet de partager la responsabilité entre l'État et les entrepreneurs, qui financeront conjointement le fonds d'indemnisation. Compte tenu de la gestion de la crise, cela peut tout à fait se défendre. Nous regardons donc cette proposition de loi avec intérêt.

Je remercie Caroline Fiat et Pierre Dharréville pour leurs commentaires constructifs. Je salue aussi Paul Christophe pour la modération de ses propos. J'ai entendu ses remarques sur le caractère prématuré du dispositif, mais nous y viendrons.
La majorité est peut-être gênée, monsieur Borowczyk, mais moi, je ne le suis pas du tout. Je n'ai jamais réécrit ma proposition de loi : l'appel à la solidarité nationale et au financement de l'État figurait déjà dans la première version du texte. En revanche, vous avez écrit trois fois votre proposition de résolution ! Vous en avez déposé une première le 1er décembre, puis une autre le 22 décembre ; dans la troisième, déposée en janvier, vous avez opportunément ajouté un volet relatif à l'indemnisation. L'argent n'est peut-être pas le problème, mais, même quand ils déposent une proposition de résolution, qui est une pure déclaration d'intention, les députés de la majorité commencent à penser qu'il faudra un jour indemniser les victimes. L'argent n'est pas le problème, sauf pour tous ceux qui ne sont plus capables de travailler ! Il faut bien mettre en place des mécanismes de compensation.
Certes, les malades bénéficient de la prise en charge à 100 % des soins, qui est très importante. Mais le caractère d'affection de longue durée n'est pas reconnu à tous les malades : c'est un problème. Le covid long se caractérise par de vrais handicaps, par des symptômes invalidants et persistants. Les personnes qui en sont atteintes ne peuvent pas retourner à une vie normale, ni reprendre leur vie professionnelle – quand elles retournent au travail après un premier arrêt, elles sont obligées de s'arrêter à nouveau. La recherche fait de vrais progrès ; elle pourra nous aider à comprendre.
Bernard Perrut, qui a tenu, comme à son habitude, des propos très modérés, a évoqué la nécessité de disposer de données chiffrées. Vous le savez, le bilan que nous pouvons dresser aujourd'hui n'est que provisoire. Malheureusement, nous venons de passer la barre des 80 000 décès dans notre pays. Plus de 30 000 de ces décès sont survenus en EHPAD. Nous en sommes à environ 3,3 millions de cas déclarés de covid-19 depuis le début de la pandémie. Quelque 300 000 personnes ont été hospitalisées. Lors de la première vague, beaucoup de patients hospitalisés ont dû être admis en réanimation, et parfois intubés, avec des séquelles graves qu'il est tout à fait possible de quantifier – je les ai décrites tout à l'heure. Lors de la deuxième vague, moins de personnes ont été intubées, du fait du recours croissant à l'oxygénothérapie et aux traitements à base de corticoïdes : il y a eu moins d'interventions invasives, ce qui explique peut-être le moins grand nombre de séquelles graves. Mais certains patients sont confrontés au covid long et à ses nombreux symptômes polymorphes. Cette situation concernerait environ 10 % des personnes ayant été touchées par la covid, même dans une forme moins grave. Dans certains pays, on parle plutôt d'une fourchette de 20 à 30 % – c'est en tout cas ce que laissent à penser des statistiques qui nous remontent d'Amérique du Nord. Quoi qu'il en soit, plusieurs centaines de milliers de malades pourraient être concernés par ces formes durables, longues, de la covid-19. Nous devons nous y préparer dès maintenant.
La question de la responsabilité de l'État n'est pas du tout l'objet de la proposition de loi. Des procédures pénales ont été engagées devant des tribunaux, notamment devant la Cour de justice de la République. Ces procédures, très complexes, mettront beaucoup de temps – de nombreuses années – à aboutir. Ce n'est pas notre affaire. Par ailleurs, les commissions d'enquête du Sénat et de l'Assemblée nationale ont effectué un travail politique remarquable. Dans l'exposé des motifs de notre proposition de loi, nous n'avons fait que citer quelques extraits des rapports de ces commissions ; il ne s'agissait pas de pointer la responsabilité de l'État. Nous voulons faire appel à la solidarité nationale : c'est pourquoi nous prévoyons un financement provenant très majoritairement de l'État et accessoirement de la branche AT-MP.
L'indemnisation ne s'oppose pas aux soins ; elle leur est complémentaire. Elle sera nécessaire – vous le verrez dans quelques mois, lorsque les victimes témoigneront de leur difficulté à reprendre une vie normale et qu'elles se mobiliseront pour obtenir une indemnisation. Il faudra bien, alors, que nous nous penchions sur le sujet.
La commission en vient à l'examen des articles de la proposition de loi.
Article 1er : Réparation des préjudices rencontrés par les victimes de la covid-19
La commission examine l'amendement de suppression AS22 de M. Julien Borowczyk.

Le périmètre de l'indemnisation proposée pose problème, d'autant que nous ne sommes pas capables d'évaluer l'imputabilité du préjudice. En cela, l'adossement du fonds d'indemnisation au FIVA est assez surprenant. L'indemnisation globale des séquelles liées à un virus serait inédite, d'autant que nous avons affaire à un virus très contagieux disséminé sur toute la planète.
Il est parfois difficile de savoir précisément de quoi l'on parle. Dans le cadre de la branche AT-MP, les choses sont claires : la reconnaissance comme maladie professionnelle est systématique dès lors que le patient a subi une oxygénothérapie. Or, jusqu'à preuve du contraire, toute personne hospitalisée a bénéficié de ce traitement.
S'agissant de la question du covid long, je viens de relire notre proposition de résolution, car le rapporteur avait semé le doute dans mon esprit : à aucun moment il n'est question d'indemnisation. Au contraire, nous parlons de reconnaissance. Mais avant la reconnaissance, il faut la connaissance ; or de nombreux députés ont justement souligné que nous manquions d'informations à ce stade. C'est pourquoi nous privilégions le soin, une notion qui n'apparaît nulle part dans cette proposition de loi. Avant de nous engager dans la voie d'une quelconque financiarisation, nous préférons soigner les gens et les guérir.

Il n'est pas question d'un adossement au FIVA : nous souhaitons créer un nouveau fonds d'indemnisation sur le modèle du FIVA. N'essayez pas d'embrouiller les choses !
Si nous avons un certain nombre de points de désaccord, nous avons aussi quelques points d'accord. Nous partageons la volonté de la majorité d'assurer aux malades, y compris aux patients atteints d'un covid long, une prise en charge et un accompagnement adaptés. Les connaissances progressent assez vite. Nous avons d'ailleurs reçu en exclusivité les résultats d'une étude « Constances » menée par des médecins spécialistes français sur une cohorte de quelque 43 000 personnes : cette étude montre notamment quels sont les symptômes qui réapparaissent de façon persistante chez les malades atteints d'un covid long. L'OMS s'est exprimée hier, et la HAS va prochainement formuler des recommandations sur ce sujet.
En revanche, la création d'un fonds d'indemnisation me paraît réellement utile et nécessaire. De nombreux patients sont incapables de reprendre leur activité professionnelle, parfois plusieurs mois après avoir contracté la maladie. Certains sont arrivés en fin de droits et risquent de voir s'ajouter à la souffrance psychique ou psychologique une grande difficulté financière. En outre, les symptômes persistants du covid long étaient encore difficiles à identifier il y a quelque temps : aussi un grand nombre de ces patients ne bénéficient-ils pas de la reconnaissance de leur maladie comme affection de longue durée. S'il faut évidemment approfondir nos connaissances sur cette pathologie, via la recherche, comme vous le suggérez, il faut également répondre à l'urgence de la situation dans laquelle se trouvent ces personnes qui éprouvent énormément de difficultés à reprendre une vie normale, sur le plan personnel, familial ou professionnel. Les organisations syndicales que nous avons auditionnées ont souligné le risque majeur de désinsertion professionnelle ; elles ont fait état de plusieurs cas de licenciement pour inaptitude parmi les salariés souffrant de ces symptômes invalidants.
La proposition de résolution qui sera discutée en séance publique le 17 février prochain nous paraît tout à fait insuffisante au regard des enjeux. Le fonds d'indemnisation que nous proposons pour l'ensemble des victimes de la covid va bien au-delà de la reconnaissance comme maladie professionnelle, qui ne suffit pas pour répondre à l'ensemble des situations, car elle ne permet pas de prendre en compte les innombrables victimes collatérales ou environnementales. Par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, l'indemnisation au titre de la maladie professionnelle est forfaitaire, donc insuffisante. Pour notre part, nous proposons une réparation intégrale. Enfin, permettez-moi de souligner qu'une résolution adoptée au titre de l'article 34-1 de la Constitution est un acte par lequel l'Assemblée nationale émet un simple avis sur une question déterminée : il ne s'agit en rien d'un outil législatif contraignant. Il faut passer aux actes. Notre proposition de loi aura, si elle est adoptée, des conséquences immédiates.

Il serait dommage de supprimer l'article 1er.
Je suis d'accord avec M. Borowczyk – tout arrive –, il faut penser aux soins et trouver des solutions pour ces personnes, qui veulent guérir. Mais les médecins ici présents savent que, souvent, pour commencer à guérir, il faut être reconnu. C'est ce que propose l'article 1er. Reconnaissons que ces personnes sont victimes d'une maladie longue et accordons-leur tous les aménagements nécessaires. Certaines ne sont plus autonomes et doivent solliciter les services d'une aide à domicile sans bénéficier pour autant d'une aide financière. Pourquoi attendre que ces malades soient soignés, voire guéris, pour leur ouvrir ce droit à l'indemnisation ? Nous proposons de leur venir en aide immédiatement.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 1er est supprimé et l'amendement AS1 du rapporteur tombe.
Article 2 : Création du fonds d'indemnisation des victimes de la covid-19
La commission examine l'amendement de suppression AS23 de M. Julien Borowczyk.

Il faudrait apporter une réponse rapide, immédiate, instantanée. Précisément, de ce point de vue, cette proposition de loi m'inquiète : entre la création d'un établissement public, l'avis du Conseil d'État sur son fonctionnement, l'installation d'un conseil d'administration et la procédure de la navette parlementaire, il s'écoulera beaucoup de temps avant que la proposition de loi soit adoptée définitivement.
Une fois de plus, ce qui nous intéresse, c'est la connaissance de la maladie et la reconnaissance des malades – c'est déjà le cas pour certains d'entre eux, en particulier pour les soignants. Ces malades veulent guérir. Dans l'exposé des motifs de notre proposition de résolution, nous citons d'ailleurs Voltaire : « L 'espérance de guérir est déjà la moitié de la guérison. » L'essentiel, aujourd'hui, est de prendre en charge les patients, en particulier s'ils sont atteints d'un covid long, en mettant l'accent sur la recherche, le soin et la reconnaissance. Allons-y, et vite ! D'ailleurs, comme l'a indiqué le rapporteur, différentes structures telles que la HAS proposeront, dans les prochains jours, des parcours de soins qui trouveront un écho dans notre proposition de résolution.

Je suis tout à fait d'accord : il faut aller vite. C'est pourquoi je propose que notre proposition de loi soit adoptée en séance publique la semaine prochaine, afin que son parcours parlementaire soit le moins long possible.
Le dispositif du fonds d'indemnisation, en particulier celui du FIVA dont nous nous inspirons, est un modèle très utilisé depuis plusieurs années, qui a prouvé son efficacité. Il permet aussi de lutter contre la multiplication des procédures judiciaires, de proposer aux victimes un guichet unique, d'assurer un traitement homogène des demandes sur l'ensemble du territoire et de réduire les délais d'instruction. C'est peut-être la meilleure réponse que nous pouvons apporter aux victimes, même si ce n'est évidemment pas la seule – elle doit être complémentaire à la prise en charge médicale des patients.
Je suis évidemment défavorable à cet amendement de suppression.

En quoi l'adoption de cette proposition de loi retarderait‑elle les soins ou la recherche ? Cela n'a rien à voir !
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 2 est supprimé et l'amendement AS19 du rapporteur tombe.
Article 3 : Instruction des demandes d'indemnisation
La commission examine l'amendement de suppression AS24 de M. Julien Borowczyk.

Je souhaite évoquer le dispositif que le ministre des solidarités et de la santé a rappelé hier s'agissant de la reconnaissance des maladies professionnelles par la branche AT-MP. Le patient doit avoir subi une oxygénothérapie ; or, quand il a été hospitalisé, il a forcément reçu ce traitement. Cette procédure dérogatoire, instituée en septembre 2020, ne concerne pas seulement les soignants mais toutes les personnes qui travaillent dans le milieu des soins, que ce soit dans le secteur public, privé ou libéral. Le champ des bénéficiaires est très large : il s'étend notamment aux personnels administratifs et à ceux qui travaillent dans des structures pour personnes âgées ou handicapées.
Pour les personnes ne travaillant dans ce domaine, un comité régional unique a été mis en place – si cette instance est unique, c'est pour garantir un traitement équitable des demandes. Vingt-huit praticiens hospitaliers universitaires ont été chargés de ce dossier ; ils se réunissent huit fois par semaine et visent un traitement des demandes en trois mois.
M. le rapporteur nous disait tout à l'heure que, selon les syndicats, environ 100 reconnaissances comme maladie professionnelle avaient été prononcées courant janvier. Au dernier pointage, qui date d'il y a quelques jours, nous en sommes à 220 reconnaissances – 200 dans le cadre du tableau et 20 en dehors du tableau. Les bénéficiaires sont des pompiers, des chauffeurs routiers, des agents d'aéroport, des agents de sécurité. On voit bien que le système fonctionne et que nous tenons nos engagements : c'est pourquoi je demande la suppression de l'article 3.

Je persiste à dire que le critère restrictif de l'oxygénothérapie exclut du dispositif un certain nombre de pathologies, notamment cardiaques et neurologiques, liées à la covid-19. La reconnaissance n'est pas automatique.
200 reconnaissances, c'est un chiffre relativement modeste, dix mois après le début de la pandémie. Seules quinze reconnaissances ont été prononcées au titre de la procédure complémentaire – une procédure que nous connaissons bien dans le cadre d'autres affections –, qui continue de relever du parcours du combattant. Il faudra mettre en place un système beaucoup plus fluide. Je ne sais pas si les comités régionaux uniques ont donné entière satisfaction en termes de simplification.

Il est vrai que l'on constate de plus en plus souvent des tableaux de symptômes persistant bien après les premières infections – ce que l'on appelle des covid longs. Dans mon domaine de compétence, jusqu'à 18 % des personnes ayant été touchées par le covid, pas forcément très gravement sur le plan somatique, développent des tableaux psychiatriques qui posent de nombreux problèmes. Ces cas n'ont pas forcément de lien avec des problématiques de thrombose cérébrale, même si, dans certains cas, les IRM et les PET scan sont très perturbés. Il est absolument nécessaire de tenir compte de ces patients qui, pour la plupart, sont incapables de reprendre le travail. Je vous invite donc à prêter attention à toutes les formes de covid, quelles qu'elles soient, bien au-delà des formes classiques où les malades ont été hospitalisés en réanimation ou placés sous oxygénothérapie.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 3 est supprimé.
Article 4 : Moyens d'action pour assurer la réparation
La commission examine l'amendement de suppression AS25 de M. Julien Borowczyk.

La proposition de loi vise tout de même, à un moment ou un autre, à pointer la responsabilité de l'État. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué le remarquable travail de la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider. Certaines de nos auditions ont été très éclairantes. J'ai entendu dénoncer, tout à l'heure, un problème de stock en équipements de protection individuelle : nous avons appris que ces stocks n'existaient pas vraiment à la fin de l'année 2018, puisqu'aucune commande n'avait été passée pendant de nombreuses années et que les masques existants avaient pourri dans un entrepôt laissé sans surveillance. Une doctrine énoncée en 2013 prévoyait d'imposer aux employeurs de pourvoir leurs salariés en équipements de protection. Ainsi, les aides à domicile auraient dû se voir dotées de tels équipements par les départements. Malheureusement, cette doctrine n'a pas été portée à la connaissance des employeurs et, pendant ce temps, l'État réduisait ses commandes de masques. La responsabilité est donc probablement partagée. Comme vous le disiez, c'est un temps long que celui des procédures judiciaires. C'est pourquoi il convient de supprimer l'article 4.

Nous sommes ici en commission des affaires sociales : ne prolongeons pas les débats de la commission d'enquête ! Nous nous sommes contentés de reprendre, dans l'exposé des motifs, un certain nombre d'extraits de l'excellent rapport publié par cette commission.
Je rejoins les propos de Martine Wonner. Les professeurs Leboyer et Pelissolo nous ont alertés sur les liens entre les inflammations causées par les coronavirus et les troubles psychiatriques. La documentation scientifique sur ce sujet commence à s'étoffer depuis que sont étudiés les premiers coronavirus comme le SARS-CoV-1. Plusieurs mois après l'infection peuvent persister des symptômes d'anxiété et de dépression – les uns et les autres représentant 40 % des troubles psychiatriques observés –, des troubles post-traumatiques ou des syndromes obsessionnels. Comme nous l'a dit la professeure Leboyer, les conséquences psychiatriques de la covid-19 sont devant nous. Nous devons absolument anticiper ce problème.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 4 est supprimé et l'amendement AS18 du rapporteur tombe.
Article 5 : Modalités de l'offre d'indemnisation
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS26 de M. Julien Borowczyk.

L'article traite de l'offre d'indemnisation. Lors des auditions, le chiffre de 16 milliards d'euros a été avancé, ce qui correspond à 35 000 ou 40 000 euros pour chacune des 300 000 ou 400 000 personnes concernées. Or il est impossible, comme l'indique le rapport, d'évaluer, faute de recul, l'impact d'une telle mesure. Certaines structures, notamment syndicales, ont, par ailleurs, fait part de leur crainte d'un saupoudrage.
Encore une fois, la question qui se pose, avant la financiarisation de la démarche, est celle de la reconnaissance AT-MP, mais aussi du soin, de la statistique et de la connaissance.

Je me suis bien gardé de donner des chiffres, tant au cours des auditions que dans le rapport. Je n'ai donné que ceux du FIVA, pour avoir un ordre de grandeur – environ 20 000 victimes indemnisées chaque année par un fonds doté de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros –, même si l'amiante et la covid-19 ne sont pas comparables.
Je me bats depuis dix ans au sein de cette assemblée pour que nos propositions de loi puissent bénéficier d'études d'impact. J'ai même déposé un rapport avec Laure de La Raudière sur la fabrique de la loi. Pour l'instant, cet espoir n'est pas encore devenu réalité. Le jour où cela arrivera, je saurai m'en servir !
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 5 est supprimé.
Article 6 : Droits d'actions en justice contre le fonds
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS27 de M. Julien Borowczyk.

L'article 6 traite du droit d'action à l'encontre du fonds, alors même que l'on manque de connaissances sur la pathologie.
Contre l'avis du rapporteur, la commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 6 est supprimé.
Article 7 : Règles relatives aux délais de prescription des demandes d'indemnisation
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS28 de M. Julien Borowczyk.

Si la prescription de la demande d'indemnisation peut s'entendre dans le cadre du FIVA, puisque l'on parle de mésothéliomes et de cancers de la plèvre qui se déclarent à distance, elle paraît surprenante dans un contexte d'urgence.
Contre l'avis du rapporteur, la commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 7 est supprimé.
Article 8 : Modalités de financement et dépenses du fonds
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS29 de M. Julien Borowczyk.

L'article 8 ne proposant pas beaucoup de modes de financement, je propose de le supprimer.
Contre l'avis du rapporteur, la commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 8 est supprimé.
Article 9 : Application du dispositif en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS30 de M. Julien Borowczyk.

L'article 9 prévoit l'application du dispositif en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. En cette période de grand froid, notre proposition de résolution nous semble offrir beaucoup plus de réconfort en axant notre action sur la recherche, le parcours de soins et une reconnaissance élargie en AT-MP. J'espère, monsieur le rapporteur, que vous la voterez mercredi prochain.

Je laisse planer le suspense sur le sens de notre vote jusqu'à mercredi après-midi... Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'une proposition de résolution ait une valeur législative ou réglementaire supérieure à une proposition de loi, aussi vous invité‑je à voter celle-ci.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 9 est supprimé.
Tous les articles de la proposition de loi ayant été supprimés, l'ensemble de la proposition de loi est considéré comme rejeté par la commission.
Puis la commission examine, en deuxième lecture, de la proposition de loi, rejetée par le Sénat, visant à renforcer le droit à l'avortement (n° 3793) (Mmes Albane Gaillot et Marie‑Noëlle Battistel, rapporteures).

Je suis ravie de vous présenter, en deuxième lecture, cette proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement, avec Marie-Noëlle Battistel pour corapporteure. Il s'agit de proposer des solutions afin de renforcer le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en facilitant le parcours des femmes souhaitant y recourir. Ce sujet est primordial à mes yeux ; aux vôtres aussi, je le sais.
Initialement articulée en deux articles, cette proposition de loi a été particulièrement enrichie en première lecture, en commission comme en séance, grâce à une véritable mobilisation transpartisane que je tiens une nouvelle fois à saluer. Aujourd'hui, elle se compose de neuf articles. D'emblée, je précise que deux articles ont vocation à être supprimés : l'article 1er ter A, parce qu'il a déjà été adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, et l'article 3, qui est le gage que nous devrons demander au Gouvernement de lever en séance publique.
Cette proposition de loi a un seul et unique objectif : améliorer l'effectivité de ce droit fondamental qu'est l'avortement. Cette ambition se traduit par des mesures concrètes et d'autres de nature à favoriser un changement de mentalité. L'un ne va pas sans l'autre.
Commençons par les deux mesures très concrètes visant à renforcer le droit à l'avortement.
D'abord, l'article 1er permet d'allonger le délai légal d'IVG de douze à quatorze semaines de grossesse. Vous avez à maintes reprises entendu mes arguments en faveur de cet allongement. Je citerai aujourd'hui l'avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), saisi sur ce sujet par le Gouvernement à l'occasion de la première lecture de cette proposition de loi : « En définitive, si la liberté d'avorter en France n'est pas remise en cause à ce jour, un faisceau de facteurs (découverte tardive de la grossesse, insuffisance de l'information et des mesures préventives, inégalité territoriale dans la prise en charge, non-respect de la loi...) peut contribuer à la difficulté de sa réalisation durant le délai légal autorisé, conduisant ainsi des femmes à ne pas pouvoir réaliser leur décision personnelle, sauf à solliciter un déplacement à l'étranger pour en concrétiser la réalisation. »
On estime aujourd'hui qu'au moins 2 000 femmes sont, chaque année, contraintes de se rendre à l'étranger pour faire valoir leur droit fondamental à l'IVG. Mais d'autres situations sont moins bien connues : combien de femmes doivent continuer une grossesse non désirée, dont on connaît l'impact délétère tant sur elles-mêmes que sur l'enfant à naître ? Combien ont recours à une IVG de manière clandestine, mettant ainsi en danger leur propre santé ? Nous ne pouvons pas accepter ces situations. En France, en 2021, une femme doit pouvoir avorter si elle le souhaite ! Et le CCNE vient de l'affirmer : « il n'existe que peu, voire pas de différence entre douze et quatorze semaines de grossesse ». Aussi paraît-il incompréhensible de pérenniser cette situation aussi injuste qu'inégalitaire.
Ensuite, l'article 1er bis étend le champ de compétences des sages-femmes à la pratique de l'IVG par voie instrumentale. Cette disposition permettra de renforcer le maillage territorial des professionnels habilités à pratiquer une IVG. À la lumière des disparités territoriales existantes, elle représente une avancée majeure pour les femmes souhaitant avorter. Je tiens, d'ailleurs, à apporter mon soutien aux sages-femmes et à leurs revendications pour une meilleure rémunération et un meilleur statut.
Pour que ces mesures soient efficaces, il faut aussi faire changer les mentalités et cesser de voir l'IVG comme un acte médical à part. Les femmes souhaitant recourir à un avortement ne doivent plus être infantilisées et stigmatisées pour un acte loin d'être rare, puisqu'une femme sur trois y a recours durant sa vie.
Trois mesures vont en ce sens. L'article 1er ter supprime le dernier délai infantilisant : celui de deux jours de réflexion imposé aux femmes, après la consultation psychosociale préalable, pour confirmer une demande d'IVG. Laissons aux femmes le choix de leur temps de réflexion !
L'article 2 supprime la clause de conscience spécifique à l'IVG. D'une part, l'existence de la clause de conscience générale rend cette disposition superfétatoire. Elle résulte d'un équilibre politique vieux de quarante-cinq ans et n'a donc plus sa place aujourd'hui dans le code de la santé publique. D'autre part, la clause de conscience spécifique perpétue également une vision arriérée de l'IVG : en refusant à celle-ci le statut de soin apporté aux femmes, elle contribue à en faire un acte médical simplement toléré, et non un droit à part entière énoncé par la loi. Cet article prévoit également la création d'un répertoire recensant les professionnels et les structures de santé pratiquant l'IVG, de manière à gagner en transparence. Quand une femme souhaite recourir à une IVG, elle doit savoir vers qui se tourner.
Enfin, l'article 2 bis A clarifie l'obligation faite aux professionnels de santé de délivrer un moyen de contraception en urgence, ainsi que les sanctions associées au manquement à cette obligation de non-discrimination.
Par ailleurs, cette proposition de loi contient également deux demandes au Gouvernement de présenter un rapport au Parlement, qui permettront d'enrichir les connaissances sur l'accès à l'IVG et de mieux mesurer la nécessité de continuer à faire valoir ce droit.
En conclusion, cette proposition de loi est transpartisane. Son contenu n'est pas le fruit de l'idéologie mais de la nécessité de renforcer le droit à l'IVG face tant aux difficultés rencontrées par nos concitoyennes, une fois prise leur décision d'avorter, qu'aux inégalités constatées par les acteurs de santé dans l'accès à ce droit. Quand la vie des femmes est en jeu, nous nous devons de dépasser nos clivages politiques afin de faire évoluer notre système vers un accès à l'IVG effectif et plus juste.

Je me réjouis qu'après avoir adopté cette proposition de loi en première lecture le 8 octobre 2020, nous poursuivions le processus législatif en l'examinant en deuxième lecture au sein de notre assemblée. Je salue l'initiative de notre groupe Socialistes et apparentés qui, dans une logique transpartisane en faveur des droits des femmes, a choisi de l'inscrire dans sa niche parlementaire, d'abord au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Ainsi continuons-nous le combat en faveur des droits des femmes.
C'est d'ailleurs un honneur pour moi d'être aujourd'hui la corapporteure de ce texte aux côtés de ma collègue Albane Gaillot. J'ai beaucoup travaillé sur l'avortement dans le cadre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, notamment en rédigeant, avec notre collègue Cécile Muschotti, un rapport sur l'accès à l'IVG dans notre pays. Ce travail de longue haleine a été l'occasion de constater, en allant à la rencontre des acteurs de terrain, que, plus de quarante-cinq ans après l'obtention de ce droit, le bilan de l'accès à l'IVG est alarmant.
Professionnels de santé, médecins, sages-femmes, travailleurs sociaux, associations, plannings familiaux, tous font état de plusieurs difficultés dans le parcours d'accès à l'IVG, plus ou moins accrues selon des situations locales parfois très différentes. Il s'agit de difficultés pour accéder à une information claire et exacte, pour savoir à qui s'adresser, pour trouver un professionnel. Certains des praticiens qui refusent de pratiquer l'IVG réorientent les femmes vers un confrère qui l'accepte, mais d'autres ne le font pas. Certains autres, opposés à l'IVG, ne le disent pas et font leur possible pour retarder la prise en charge de sorte que les délais soient dépassés.
Trouver des rendez-vous rapidement et être prise en charge dans les délais impartis sont encore d'autres difficultés liées à l'éloignement des structures de santé, voire à une forme de désertification médicale, encore accrue en matière d'IVG dans certains territoires. D'une région à l'autre, l'offre de soins est contrastée et le délai de prise en charge peut varier du simple au quadruple. Dans les zones rurales, notamment, le nombre des services d'orthogénie se réduit avec la fermeture progressive des petites maternités.
Ces difficultés touchent encore plus frontalement les femmes les plus vulnérables : celles qui n'ont pas de moyen de locomotion, celles qui ne peuvent pas s'absenter de leur travail, celles qui n'ont que peu de moyens pour organiser la garde de leurs enfants afin de se rendre aux consultations obligatoires.
Comment justifier une application à géométrie variable d'un droit absolument fondamental ? De surcroît, ces difficultés ont été exacerbées par la crise sanitaire. Au cours du premier confinement, sur la période allant de mi-mars à mi-mai, le numéro vert national « Sexualité contraception IVG » a connu une augmentation spectaculaire du nombre d'appels par rapport à 2019 : de 330 % pour ceux concernant des difficultés d'accès à l'IVG, et de 100 % pour ceux portant sur une demande d'aide ou d'information pour avorter hors délais à l'étranger. Peur de déranger des soignants déjà débordés, peur d'attraper le virus, impossibilité de se déplacer en France comme à l'étranger, difficulté pour maintenir le secret et l'anonymat dans certaines situations, difficulté d'accès à l'information : la crise sanitaire a renforcé les difficultés d'accès des femmes à l'avortement.
Toutefois, cette crise aura prouvé qu'en cas de nécessité, le système peut être réformé. La généralisation de la téléconsultation, ainsi que l'allongement de cinq à sept semaines de grossesse du délai de recours à l'IVG médicamenteuse en ville démontrent la nécessité et la volonté partagée de renforcer l'effectivité du droit à l'IVG.
Si des mesures importantes ont donc été prises, elles ne sont que provisoires et ne sauraient répondre aux difficultés structurelles d'accès au droit à l'IVG. C'est cette même ambition qui nous amène, Albane Gaillot et moi-même, à vous soumettre cette proposition de loi dont de nombreuses dispositions sont issues du rapport sur l'accès à l'IVG. Dans celui-ci, nous recommandions, avec Cécile Muschotti, l'allongement du délai de recours à l'IVG, la suppression de la clause de conscience spécifique, l'extension de la compétence des sages‑femmes à la pratique d'une IVG par voie instrumentale, la mise en place d'un répertoire des professionnels pratiquant l'IVG géré et mis à jour par les agences régionales de santé (ARS), un bilan sur l'application de la législation relative au délit d'entrave, ainsi que l'amélioration de l'information des femmes sur leur droit au choix de la méthode d'IVG. Je ne peux donc que me féliciter de voir l'ensemble de ces recommandations intégrées dans la proposition de loi.
Ces mesures font d'ailleurs l'objet d'un consensus très important, et tous les récents travaux sur le sujet, qu'ils émanent du Conseil économique, social et environnemental (CESE), de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEFH), font des recommandations dans le même sens. Ces recommandations, d'ordre législatif, devront évidemment être complétées par des mesures réglementaires, notamment dans le domaine de la formation des professionnels de santé. Les médecins, généralistes comme gynécologues, ne sont pas suffisamment formés à l'acte d'avortement – il existe même une forme de désinformation à son sujet. Il faut faire évoluer les mentalités et les pratiques des médecins. Il n'est plus possible que des services de gynécologie soient encore dirigés par des médecins opposés à l'avortement !
Il ne s'agit d'ailleurs pas que des médecins : tous les personnels médicaux doivent être mieux sensibilisés et formés à l'accueil et à l'accompagnement des femmes souhaitant recourir à une IVG. Nous devons agir résolument en ce sens afin de garantir le droit fondamental qu'est l'avortement et faciliter le parcours des femmes pour y avoir accès. Les débats d'aujourd'hui en commission, puis en séance publique la semaine prochaine, en seront l'occasion.
Alors, soyons tous ambitieux : nous ne devrions jamais hésiter lorsqu'il s'agit de protéger nos concitoyennes et les droits des femmes dans notre société. Comme le dit la professeure de droit Diane Roman : « L'interruption volontaire de grossesse est perçue comme une simple dérogation au droit à la vie. » Mes chers collègues, il est temps de rendre ce droit effectif. Nous comptons sur votre entier soutien.

Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, le 8 octobre 2020, la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement a été rejetée par le Sénat, en commission, le 13 janvier dernier. Elle est chère à nombre de parlementaires, pas tous membres de la majorité, puisqu'elle avait été déposée à l'origine par feu le groupe Écologie Démocratie Solidarité à l'Assemblée, puis reprise par le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat pour être enfin inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée par le groupe Socialistes et apparentés dans le cadre de sa niche parlementaire. Elle revient donc aujourd'hui en commission des affaires sociales pour son examen en deuxième lecture.
Entre-temps, le 12 novembre, le CCNE, saisi par le ministre des solidarités et de la santé le 2 octobre, c'est-à-dire une semaine avant son examen en première lecture dans l'hémicycle, a rendu son avis sur la question de savoir si l'allongement du délai légal d'accès à l'IVG de douze à quatorze semaines était envisageable. Il le conclut par ces mots : « [...] en axant sa réflexion sur les principes d'autonomie, de bienfaisance, d'équité et de non‑malfaisance à l'égard des femmes, le CCNE considère qu'il n'y a pas d'objection éthique à allonger le délai d'accès à l'IVG de deux semaines, passant ainsi de 12 à 14 semaines de grossesse ». Le Gouvernement ayant, lors de l'examen de ce texte en première lecture, opposé publiquement cet avis à sa décision de soutenir l'allongement du délai de deux semaines, nous pouvons tous considérer que le débat en deuxième lecture sera serein et nous permettra de continuer efficacement la navette parlementaire.
Je rappelle que l'examen d'une proposition de loi, s'il s'achève après adoption du même texte par les deux chambres, peut faire l'objet, lorsque la procédure accélérée n'a pas été engagée par le Gouvernement, d'un nombre indéterminé d'allers-retours entre l'assemblée et le Sénat, sauf si le Gouvernement convoque une commission mixte paritaire pour provoquer une lecture définitive par la seule Assemblée. À ce stade, il nous appartient « simplement » de rétablir le texte que nous avions adopté en première lecture afin de veiller au respect de l'équilibre obtenu par notre assemblée. Il est même possible, sans rompre celui‑ci, d'enrichir encore légèrement le dispositif.
Je remercie les députés du groupe La République en Marche d'avoir soutenu ce texte, en particulier les membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que nos corapporteures, Albane Gaillot et Marie Noëlle Battistel. Continuons d'œuvrer pour l'effectivité du droit à l'avortement, et donc pour le droit des femmes à disposer de leur propre corps dans notre pays !

Promouvoir l'allongement du délai de recours à l'IVG de douze à quatorze semaines de grossesse est, à mon sens, une solution inappropriée. Donne‑t‑on aux femmes les moyens de choisir librement leur grossesse lorsqu'il est établi que la probabilité du recours à une IVG décroît avec l'augmentation du niveau de vie ? Les aide‑t‑on lorsqu'année après année, le nombre des établissements de santé la pratiquant se réduit, créant de véritables déserts médicaux pour les femmes dans nos campagnes ? Aide‑t‑on nos femmes et nos fils lorsque 25 % des établissements scolaires ne dispensent pas de cours d'éducation à la sexualité et que la majorité des établissements ne respecte pas les trois séances par an prévues par la loi en la matière ?
Ces deux semaines supplémentaires empêcheront-elles que quelque 2 000 femmes partent chaque année à l'étranger pour avorter, alors que, pour 70 % d'entre elles, la cause est l'absence de diagnostic de grossesse ou de signes cliniques, ou une tendance à cycle de menstruation irrégulier ?
On ne peut nier la dimension éthique d'un tel allongement : l'avortement n'est pas un acte médical anodin et sa pratique est sensible. Seulement 37 % des professionnels interrogés par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français déclarent qu'ils réaliseront des IVG à ce stade. Il y a là de quoi s'interroger.
Entre les deux lectures, ma conviction n'est allée qu'en se renforçant, notamment à la lumière des avis du CCNE et de l'Académie de médecine. Cette proposition n'offre pas de solution ni de garanties d'amélioration. J'y vois une réponse inappropriée au manque d'information, d'éducation et de moyens qui ne peut plus être ignoré. Sans effort en la matière, nos successeurs se retrouveront, dans quelques années, dans cette même salle pour examiner un texte visant à nouveau à allonger le délai de recours à l'IVG, qui ne constituera toujours pas une avancée pour les femmes.

Comme en première lecture, ce texte demeure sensible parce qu'il touche à l'intime. Les membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés voteront donc librement. À titre personnel, j'y reste favorable.
En première lecture, notre assemblée a accompli des avancées, comme l'autorisation pour les sages-femmes de pratiquer les IVG chirurgicales préconisée par le rapport de la délégation aux droits des femmes. Je proposerai un amendement visant à préciser cette disposition, qui demeure primordiale tant la question de l'accès à l'IVG demeure prégnante. La réalité de certains de nos territoires, c'est que les médecins ne sont pas toujours accessibles, ou qu'il n'y en a tout simplement plus. C'est aussi que certains d'entre eux, par convenance ou par conviction, refusent de pratiquer l'avortement. La loi a tenté d'y remédier, sans donner de résultat probant, à voir les chiffres.
Ces situations sont autant d'obstacles à la liberté des femmes. Quand elles se combinent, ceux-ci sont encore plus difficiles à franchir. Dans notre pays, nous ne pouvons tolérer de telles situations. Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, nous avons voté une expérimentation permettant aux sages-femmes de pratiquer de telles IVG. Mon groupe l'avait accompagnée de nombreux garde-fous en matière de formation, d'assurance et de rémunération, renvoyant ces décisions à des actes réglementaires. Quatre mois plus tard, ces dispositions n'ont toujours pas été prises. C'est peut-être peu à l'échelle de l'administration, mais c'est beaucoup trop dans la vie d'une femme. Je saurai le rappeler dans l'hémicycle.

Je vous remercie, mesdames les rapporteures, pour ce texte qui constitue une avancée majeure pour les droits des femmes, comme je remercie nos collègues Cécile Muschotti et Marie-Noëlle Battistel pour la qualité de leur rapport.
Cette proposition de loi répond certes à un véritable besoin sociétal et correspond à la maturité collective de notre pays sur ce sujet, mais elle ne peut pas tout résoudre. Les problèmes d'accès et d'information qui subsistent sont réels, comme la carence en matière d'éducation à la sexualité, qui constitue pourtant un levier majeur. Ainsi, aux Pays-Bas, où le délai légal pour avorter est de vingt-quatre semaines, le taux de recours à l'IVG, comme celui des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes, est le plus bas d'Europe, simplement parce que, dès la maternelle, une éducation à la sexualité est dispensée, qui implique les garçons.
Cette proposition de loi restera un levier, un élan commun qu'il nous faudra soutenir pour renforcer l'effectivité du droit d'accès à l'IVG et de l'avortement pour toutes. On sait, en effet, que les droits des femmes ne sont jamais acquis et qu'ils sont parmi les premiers à disparaître en cas de crise, comme nous l'avons vu au cours de la crise sanitaire, de conflits ou de montée des populismes – on pense spontanément, en Europe, à la Pologne ou à la Hongrie.
Face à cela, nous devons affirmer en France ce droit intangible par le soutien ferme et collégial de tous les groupes à nos concitoyennes. Si certains membres du groupe Agir ensemble ont exprimé des réserves à l'égard de quelques articles, celui-ci se prononcera néanmoins en faveur de la proposition de loi.
Je nous souhaite que cette deuxième lecture se déroule dans un climat apaisé, car l'enjeu est essentiel pour la liberté et les droits des femmes.

Le groupe UDI et Indépendants est très attaché au droit à l'IVG, fondement du droit, si durement acquis, des femmes et de leur émancipation. Nous pouvons nous réjouir de ce que ce droit progresse dans le monde – l'IVG est autorisée depuis deux mois en Argentine, où plusieurs dizaines de milliers de femmes étaient encore hospitalisées chaque année après avoir dû recourir à une IVG clandestine. L'IVG n'est pas une décision facile à prendre ni une solution de confort : il s'agit d'un choix libre mais difficile, et nous devons faire preuve d'humilité.
Ce qui motive cette proposition de loi, ce sont les près de 2 000 femmes qui continuent chaque année à partir à l'étranger pour y subir une IVG tardive. Or c'est aussi ce qui avait motivé l'allongement du délai à douze semaines par la loi de 2001. S'il est toujours difficile de fixer une limite, notre groupe pense que le problème n'est pas une question de délai qu'il faudrait rallonger mais plutôt l'accessibilité de l'IVG dans les territoires du fait du manque de praticiens et de structures hospitalières, ainsi que d'une prévention encore bien défaillante.
La publication d'un fichier dressant la liste des praticiens pratiquant des IVG, qui revient à dresser a contrario la liste de ceux qui s'y refusent en usant de leur liberté de conscience, constitue, pour nous, une ligne rouge qui nous conduit à voter contre cette proposition de loi.

Je remercie le groupe Socialistes et apparentés d'avoir inscrit la deuxième lecture de cette proposition de loi à l'ordre du jour, nous permettant ainsi d'avancer sur ce sujet important, malgré le rejet du Sénat. Je salue également le travail des rapporteures ainsi que celui de la délégation aux droits des femmes, dont le rapport sur l'accès à l'IVG a formulé un grand nombre de recommandations, certaines ayant été reprises dans ce texte. Cet enrichissement est la preuve des bienfaits des démarches transpartisanes que nous devons sans cesse encourager.
Grâce à la proposition de loi, le délai d'accès à l'IVG sera allongé et la double clause de conscience supprimée ; la compétence des IVG chirurgicales sera étendue aux sages‑femmes et la pratique du tiers payant pour les actes en lien avec l'IVG rendue obligatoire : autant d'avancées que nous saluons.
Les difficultés d'accès sont nombreuses et se manifestent à différents niveaux, ce qui nous impose d'agir sur tous les plans, technique comme symbolique. Dans trop de cas, l'accès à l'IVG n'est pas effectif à cause du manque de médecins, d'inégalités territoriales persistantes ou du désintérêt à l'égard de cet acte médical, ou encore à cause de pressions sociales ou familiales. Le premier confinement et la crise sanitaire nous ont brutalement rappelé le parcours du combattant imposé à des femmes bien souvent trop seules et trop vulnérables. Renforcer l'accès à l'IVG, c'est lutter contre ces inégalités et aplanir tous ces obstacles qui portent atteinte aux choix des femmes, à leur droit de disposer de leur corps et à leur santé.
Adopter cette proposition, c'est continuer le long combat pour les droits et la dignité des femmes. C'est envoyer le signal qu'il n'est jamais fini et que nous devons toujours demeurer vigilants.

Je remercie nos rapporteures Albane Gaillot et Marie-Noëlle Battistel ainsi que Cécile Muschotti et tous nos collègues qui ont travaillé sur ce texte à la délégation aux droits des femmes, sans oublier le groupe Socialistes et apparentés, de n'avoir rien lâché. Espérons qu'enfin, en 2021, on y arrive !
En première lecture, on nous opposait toutes les cinq secondes l'absence de l'avis du CCNE. Bonne nouvelle, maintenant nous l'avons, et puisqu'il est favorable, nous pourrons avoir des débats sereins !
Merci encore au groupe Socialistes et apparentés d'avoir inscrit ce texte dans sa niche parlementaire – on sait comme elles offrent peu de place.

Ce sujet essentiel mobilise les femmes et les hommes ; c'est un combat que nous devons mener en commun. Je remercie également nos deux rapporteures, Albane Gaillot et Marie-Noëlle Battistel, ainsi que Cécile Muschotti et toutes celles et tous ceux qui ont permis à ce texte de continuer, malgré ses difficultés de parcours.
Le droit à l'IVG est une conquête essentielle pour les femmes, qui mérite toujours d'être défendu et protégé, non pas comme un droit théorique mais comme un droit réel, compte tenu des difficultés rencontrées pour le faire valoir. Les propositions qui sont sur la table permettent de remédier à un certain nombre d'entre elles. Disposer librement de son corps constitue une dimension essentielle de l'émancipation des femmes.
Nous sommes bien conscients de la nécessité de prendre des mesures concrètes, mais également symboliques, qui ne sont d'ailleurs pas sans effet sur cette clause de conscience spécifique dont notre groupe de la Gauche démocrate et républicaine demande la suppression depuis fort longtemps. Prendre une telle décision aujourd'hui représente donc une victoire et enracine encore plus ce droit, de façon tout à fait nécessaire à voir comme il est remis en cause un peu partout en Europe et dans le monde.
Nous serons donc favorables à ces dispositions.

Je me réjouis de l'examen aujourd'hui de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement, dans le cadre de la niche du groupe Socialistes et apparentés. Ce texte, présenté par Albane Gaillot et s'inspirant du rapport d'information sur l'accès à l'IVG rédigé notamment par ma collègue Marie-Noëlle Battistel au nom de la délégation aux droits des femmes, avait été adopté de manière transpartisane par l'Assemblée nationale, le 8 octobre 2020. Défendu par notre collègue Laurence Rossignol et les sénateurs socialistes et apparentés, il a ensuite été rejeté au Sénat par le biais d'une question préalable. Parce qu'il est nécessaire de consolider et de rendre effectif l'accès à ce droit fondamental reconnu par la loi et essentiel pour la vie comme pour la liberté des femmes, je me félicite donc que cette proposition de loi continue son chemin à travers la navette parlementaire et arrive en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Cette proposition de loi vise à garantir que toute femme souhaitant recourir à une interruption volontaire de grossesse puisse trouver une solution adaptée, dans un laps de temps adéquat. Elle prévoit, pour cela, d'allonger le délai de recours à l'IVG instrumentale, de supprimer la clause de conscience spécifique tout en réaffirmant le principe d'une clause générale, ou encore d'étendre la compétence d'IVG chirurgicale aux sages-femmes jusqu'à dix semaines de grossesse.
En raison de toutes ces avancées en faveur des droits et des libertés des femmes, le groupe Socialistes et apparentés votera cette proposition de loi. Que tous ceux qui craindraient qu'elle ne fasse exploser le taux d'avortement se rassurent : au Canada, alors qu'il n'existe pas de délai, 90 % des avortements ont lieu avant la douzième semaine. Cela montre bien que lorsqu'une femme souhaite avorter, elle le fait au plus vite.

Je remercie tous nos collègues qui sont intervenus dans un esprit de consensus pour soutenir cette avancée pour les femmes.
Je dirai à Mme Levy qu'effectivement, le seul allongement du délai ne permettra pas un accès total à l'IVG en France. Notre rapport a bien montré qu'il fallait lever plusieurs difficultés au travers d'un panel de mesures. Cet allongement en fait partie. Comme mon collègue Régis Juanico vient de l'indiquer, allonger les délais n'entraîne pas une augmentation du nombre d'IVG. Nous l'avions aussi constaté lorsque nous les avions allongés à douze semaines. L'exemple du Canada, où il n'existe plus de délais et où quasiment toutes les IVG sont pratiquées avant les douze semaines, est extrêmement parlant : il montre bien que lorsque la femme a fait ce choix, elle veut aller le plus vite possible. Elle n'a d'ailleurs aucun intérêt à faire traîner les choses.
L'allongement non seulement n'entraînera pas une augmentation considérable du nombre d'IVG mais, surtout, il permettra à toutes les femmes en France d'accéder à celle-ci. C'est le moins que l'on puisse faire s'agissant d'un droit. Il n'est pas acceptable que des femmes n'y aient pas accès, qu'elles soient 2 000 ou 200.
Je remercie Perrine Goulet pour son soutien. Nous sommes évidemment favorables aux avancées en matière de formation et de reconnaissance des métiers, que notre rapport a d'ailleurs identifiées. Il faut effectivement travailler dans ce sens en adoptant certains amendements.

Chère Annie Chapelier, nous sommes bien conscientes que la proposition de loi ne résoudra pas toutes les difficultés d'accès à l'IVG. Oui, il y a quelque chose à faire en matière d'éducation à la sexualité, car elle n'est pas dispensée de la même manière sur tout le territoire et dans tous les établissements scolaires, alors qu'elle est prévue par la loi. Je travaille sur ce sujet, comme certains d'entre vous, depuis le début de mon mandat.
Vous avez raison, madame Six, de soutenir l'IVG tout en relevant le caractère difficile de la décision d'y recourir : il ne s'agit pas de quelque chose que l'on fait de gaîté de cœur, mais parce que l'on y est obligée.
J'aimerais, en revanche, vous convaincre de l'utilité du répertoire, qui faciliterait grandement l'accès à l'IVG et raccourcirait considérablement le délai de prise en charge. Pour avoir visité hier matin, avec des collègues, un centre d'orthogénie, je peux vous assurer que sa création répondrait à un réel besoin et ne mettrait pas en porte-à-faux des médecins qui ne voudraient pas y figurer.
Comme vous l'avez souligné, madame Wonner, on pourrait, s'agissant de la disparité territoriale, tendre la perche au Gouvernement afin que des mesures soient prises, comme la création de centres d'orthogénie et d'IVG sur l'ensemble du territoire. Il n'est pas normal qu'une jeune femme n'ait pas, selon qu'elle habite dans la Nièvre ou à Paris, la même possibilité d'accès à un centre d'IVG.
Enfin, j'ai bien entendu le soutien plein et entier de nos collègues Pierre Dharréville et Caroline Fiat.
La commission en vient à l'examen des articles de la proposition de loi.
Article 1er : Allongement du délai de recours à l'interruption volontaire de grossesse de douze à quatorze semaines de grossesse
La commission examine les amendements de suppression AS1 de M. Thibault Bazin et AS15 de Mme Josiane Corneloup.

En complément des arguments avancés par ma collègue Geneviève Levy, je m'interroge : si les délais représentaient un obstacle majeur pour accéder à l'IVG, comment expliquer l'augmentation constatée du nombre d'IVG ? Ce sont plutôt les disparités territoriales, en particulier dans les départements et territoires d'outre-mer, qui devraient nous interroger. Deux semaines supplémentaires apporteront-elles une solution à celles qui partent à l'étranger, dont le nombre est d'ailleurs très faible par rapport au nombre total d'IVG ? J'en doute.
Contrairement à ce qui est allégué, des arguments médicaux et scientifiques permettent de s'opposer à un tel allongement, qui ne fait consensus ni dans l'ensemble de la sphère médicale ni dans la société, sans remettre en cause le droit à l'IVG. Si des délais encadrent ce droit, c'est bien en raison d'incidences au fur et à mesure du déroulement de la grossesse : durant ces deux semaines, l'embryon évolue, comme le corps de la femme.
Compte tenu de ces différents éléments, il ne me semble pas opportun de maintenir l'article.

Je ne suis pas certaines que l'allongement des délais permette de réduire le nombre d'IVG. Aujourd'hui, 95 % des femmes demandent une IVG avant la dixième semaine ; seules 5 % y recourent au cours des deux dernières semaines. On voit donc que l'allongement ne concerne qu'une proportion assez peu importante d'entre elles.
Il me semble que cette proposition pallie les conséquences plutôt que les causes. Il faut plutôt que nous nous attaquions aux disparités territoriales d'accès à l'IVG et à la déficience de l'éducation à la vie sexuelle et affective. D'où l'amendement de suppression.

Effectivement, les inégalités territoriales nous interrogent, notamment dans les territoires ultramarins, tout comme les aspects de la formation, de l'information et de l'accompagnement.
L'allongement vise non pas à faire baisser le nombre d'IVG, mais à rendre le droit effectif. Il ne l'est pas en France puisque certaines femmes sont contraintes, dans le meilleur des cas, de se rendre à l'étranger.
L'exposé sommaire de vos amendements invoque des contre-indications techniques ou éthiques à l'allongement des délais. En première lecture, vous aviez réclamé avec insistance l'avis du CCNE. Eh bien, celui-ci établit qu'il n'existe que peu, voire pas de différence entre douze et quatorze semaines de grossesse, et qu'il n'y a pas d'objection éthique à allonger de deux semaines le délai d'accès à l'IVG.
Nous pouvons donc, en conscience et de manière tout à fait éthique, proposer un tel allongement, dont je répète qu'il n'est pas la seule mesure à prendre pour rendre effectif le droit d'accès à l'IVG.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Puis, suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement AS13 de M. Fabien Di Filippo.
Elle adopte ensuite l'article 1er, sans modification.
Article 1er bis : Extension de la compétence des sages-femmes à la méthode chirurgicale d'interruption volontaire de grossesse jusqu'à la dixième semaine de grossesse
La commission examine l'amendement de suppression AS2 de M. Thibault Bazin.

L'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a validé une expérimentation de trois ans de la pratique de l'IVG instrumentale par les sages-femmes. Il me semble donc prématuré de voter une extension générale.

Nous comprenons votre demande, mais nous voulons aller vite, parce que tous les jours des femmes ont du mal à accéder à l'IVG et, on le sait, la mise en application de cette disposition va être longue. Permettre aux sages-femmes de pratiquer l'IVG instrumentale répond, qui plus est, à l'obstacle des disparités territoriales que vous avez soulevé.

Il n'y a aucune raison de ne pas accorder aux sages‑femmes une telle possibilité, d'autant plus qu'elles ont le droit d'accomplir des gestes endo‑utérins. Il ne s'agit donc de rien d'autre que de leur permettre de faire ce qu'elles savent faire. Comme par ailleurs elles ont le droit de procéder à des IVG médicamenteuses, c'est assez absurde de leur refuser des IVG par gestes endo‑utérins, alors que, je le répète, elles ont le droit de les pratiquer. Il faut le permettre le plus vite possible, parce que, dans certaines parties du territoire, l'accès à l'IVG est très difficile et les délais d'attente sont de dix à onze jours. Or c'est souvent, dans ces cas, le manque de gynécologues qui est en cause. C'est nécessaire pour les femmes qui attendent et pour les sages-femmes. C'est une forme de reconnaissance que nous leur devons. Elles devraient d'ailleurs, à mon sens, bénéficier d'une reconnaissance salariale pour les missions additionnelles que nous leur confions et qu'elles réalisent très bien.

Les sages-femmes s'occupent des mamans pendant les naissances, souvent sans les gynécologues, sans que cela inquiète personne. Elles font des points chirurgicaux extérieurs mais aussi intérieurs, sans médecin. Or personne ne leur demande d'arrêter ! Si c'était le cas, tout le monde serait bien embêté, puisqu'il n'y aurait pas assez de gynécologues pour s'occuper de toutes les mamans. Elles savent très bien s'occuper de leurs patientes. Faisons-leur confiance.

L'expérimentation n'a pas réellement démarré. Seuls les travaux d'études préalables ont commencé.

Il me semble tout de même que qui dit expérimentation dit évaluation. Je trouve regrettable que nous généralisions avoir d'avoir évalué.

Je vais proposer des amendements concernant la rémunération et l'évaluation. Comme l'administration traîne, il faut la booster un petit peu.
La commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS18 de Mme Josiane Corneloup.

Il est urgent de rétablir le principe selon lequel une IVG ne peut être pratiquée que par un médecin, aussi bien pour des raisons de sécurité évidentes qu'eu égard à la nature même de la mission des sages‑femmes.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement AS19 des rapporteures.

Il est issu de la recommandation n° 6 du rapport d'information de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui préconise de pérenniser l'allongement du délai de recours à l'IVG médicamenteuse en ville de cinq à sept semaines de grossesse, conformément à ce qui est déjà autorisé pour l'IVG médicamenteuse réalisée en milieu hospitalier. L'amendement vise à rendre pérenne une mesure pour le moment temporaire et qui n'a posé aucun problème.
La commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite les amendements AS8 et AS9 de Mme Perrine Goulet.

Dans de nombreux territoires, les sages‑femmes remplacent les gynécologues. En plus du suivi de grossesse, elles accomplissent des actes gynécologiques et assurent le suivi des femmes tout au long de leur vie. Il est important qu'elles puissent également accompagner les femmes au moment de la délicate décision de procéder à une IVG. Puisqu'elles remplacent les médecins, il faut les accompagner dans leur montée en compétences, pour ce qui est de leur formation, des assurances dont elles ont besoin pour exercer et de leur niveau de rémunération. C'est pourquoi je propose de demander au ministre de préciser par décret la mise en œuvre concrète de cette nouvelle compétence.
Le second amendement vise à demander un rapport pour évaluer l'application des nouvelles dispositions.

Nous vous remercions pour vos deux amendements, qui tendent à préciser et à encadrer les nouvelles dispositions et ne manqueront pas de rassurer les députés qui pourraient se poser des questions sur cette pratique de l'IVG instrumentale par les sages‑femmes. Préciser les missions, le statut et les rémunérations associées par décret répond à notre ambition de rassurer les sages‑femmes. Elles manifestaient cette semaine parce qu'elles s'interrogent sur leurs missions et veulent être rassurées sur l'évolution de leur rémunération. Le rapport permettrait aussi de répondre aux interrogations relatives au suivi et à l'efficience du dispositif.
Avis favorable.

Je remercie Perrine Goulet pour ses deux amendements. Je travaille depuis un an avec les sages‑femmes qui se posent beaucoup de questions sur leur statut, leur domaine de compétences, leur formation, l'organisation des soins et l'accompagnement global en maternité ainsi que leur rôle en tant que professionnelles de santé sexuelle et reproductive, qui est largement sous-estimé. Nous avons l'occasion d'augmenter leurs compétences, en leur permettant d'accéder à un geste qu'elles peuvent assez facilement acquérir avec une formation adaptée. Mais il est essentiel que cela s'accompagne d'un dispositif particulier.
La commission adopte successivement les amendements.
Puis elle adopte l'article 1er bis modifié.
Article 1er ter A : Systématisation de la pratique du tiers payant pour les actes en lien avec l'interruption volontaire de grossesse et protection du secret pour la prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS20 des rapporteures.

Les dispositions ayant d'ores et déjà été adoptées au travers de l'article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, elles peuvent être retirées de ce texte.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 1er ter A est supprimé.
Article 1er ter : Suppression du délai de réflexion de deux jours pour confirmer une demande d'interruption volontaire de grossesse en cas d'entretien psychosocial préalable
La commission examine les amendements de suppression AS3 de M. Thibault Bazin et AS12 de M. Fabien Di Filippo.

L'article vient supprimer le délai de quarante‑huit heures prévu entre l'entretien psychosocial préalable et le recueil du consentement. Il ne me semble pas opportun de revenir sur l'un des éléments de l'équilibre de la loi de Simone Veil. C'est pourquoi je vous propose de maintenir cet ultime délai.

Cet entretien est seulement proposé aux femmes majeures et n'est obligatoire que pour les mineures non émancipées. Nous considérons ce délai de réflexion comme inutile, parce que la femme a très largement réfléchi lorsqu'elle prend sa décision. C'est un peu contradictoire avec votre souhait de ne pas prolonger le délai : plus on prend du temps, moins on peut rester dans le délai des douze semaines. Nous respectons l'autonomie des femmes qui ont décidé bien avant leur rendez-vous ce qu'elles ont à faire.
Avis défavorable.

Si la femme veut prendre un délai pour réfléchir, malgré cet article, elle le pourra toujours. C'est seulement que nous ne l'obligeons pas à le prendre. Si elle est prête, qu'elle a passé son entretien psychologique, qu'elle a reçu les informations et qu'elle a décidé de le faire, elle le fait. Aujourd'hui, elle ne le peut pas, elle doit attendre quarante-huit heures. Demain, elle pourra faire le choix : manifester tout de suite sa décision ou attendre.

Madame Battistel, vous avez évoqué la question des délais et la spécificité de traitement des femmes mineures. Cela me fait penser à nos précédents débats : il me semble que, selon les statistiques, le nombre d'IVG concernant des moins de 18 ans a plutôt baissé, alors qu'il a plutôt augmenté pour les femmes de plus de 30 ans. Il serait intéressant de savoir si, parmi les 5 % de femmes qui vont à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai légal, les mineures sont les plus concernées ou non.
Par ailleurs, j'ai bien compris qu'elles auront toujours la faculté de prendre du temps pour réfléchir. Mais pourquoi supprimer le délai de réflexion qui faisait partie de l'équilibre initial de la loi ? Avez‑vous remarqué dans vos travaux que ces quarante-huit heures sont l'une des raisons qui conduisent les femmes à partir à l'étranger ?

Je suis sûr que M. Bazin a un infini respect pour ses collègues féminines et pour les femmes en général. Je sais donc qu'il comprendra que, pour une femme, c'est un peu une humiliation de s'entendre dire qu'elle doit réfléchir avant de prendre la décision. C'est un peu comme si on vous disait, monsieur Bazin, lorsque vous déciderez de faire un enfant avec votre femme que vous aurez un délai de réflexion avant de pouvoir entreprendre votre acte procréatif...

C'est tout de même un sujet douloureux...
Pourquoi enlever ces deux jours de réflexion, à moins d'avoir eu la preuve qu'ils sont un frein et que des femmes n'ont pas pu avorter dans les délais à cause d'eux ?

Un avortement n'est pas anodin. C'est un fait qui marque la vie d'une femme. Donner ce temps, si court soit-il, c'est laisser une place à la réflexion. Il me semble qu'il a une réelle valeur. Mais s'il y a des preuves que ces deux jours entravent l'avortement, il faut en effet se poser la question de les supprimer. Parfois l'avortement se fait sous la pression du conjoint, de l'entourage. La femme ne choisit pas toujours d'avorter. Dans de tels cas, ces deux jours ont d'autant plus leur place.

Ce débat est intéressant, mais je pense que, lorsqu'une femme va voir un gynécologue pour demander une IVG, elle y a déjà réfléchi. Il faut arrêter de complexifier. Ces réserves n'existent que lorsqu'il s'agit du choix des femmes, comme si elles n'étaient pas capables d'être sûres d'elles au premier rendez-vous. Quant à la pression, ces quarante-huit heures peuvent, au contraire, laisser du temps à la famille pour faire pression sur la jeune femme pour garder l'enfant. La pression existe avec ou sans le délai : ce n'est pas un argument.
Une femme n'a pas besoin de ces quarante-huit heures. Soit sa décision est prise avant son rendez-vous chez le gynécologue, soit elle se donnera elle-même un temps de réflexion, une fois que le médecin lui aura donné toutes les informations. C'est infantiliser les femmes de leur dire qu'elles sont obligées d'attendre quarante-huit heures, même si elles ont pris leur décision. Pensez à une femme qui est enceinte de dix semaines, qui n'a pas envie de garder plus longtemps cet enfant en elle, qui a vraiment besoin de recourir à une IVG parce qu'elle n'est pas bien psychologiquement et qui s'entend dire qu'il va encore falloir attendre ! Il faut laisser aux femmes la capacité de faire ce qu'elles veulent. Elles auront toujours loisir de prendre le temps qu'elles veulent, mais on n'a pas à leur imposer ces quarante-huit heures.

Le délai de quarante-huit heures, rappelons-le, n'est obligatoire que pour les mineures. Nos collègues, à juste titre, s'interrogent pour savoir si un grand nombre de femmes sont concernées par le dépassement de délai. La réponse n'est pas simple, du fait d'une très grande hétérogénéité territoriale. Dans chaque milieu géographique et dans chaque région, l'accès à l'IVG est différent. Outre-mer, il est encore plus compliqué qu'ailleurs. Les taux d'IVG y sont relativement importants et beaucoup de mineures tombent enceintes.
Lorsque ces jeunes filles se rendent compte qu'elles sont enceintes, il y a des délais d'attente pour obtenir les rendez-vous, parce qu'il n'y a pas assez de personnels, même pour réaliser les entretiens. Donner quarante-huit heures de plus, alors qu'elles sont déjà inscrites dans une démarche d'IVG et qu'elles ont déjà fait leur choix, c'est leur faire courir le risque de dépasser le délai. Il ne s'agit pas réellement d'une infantilisation, comme certaines l'ont dit, à mes yeux. Mais il faut dépassionner la question : lorsqu'une femme, qu'elle ait 15 ou 35 ans, décide d'avorter, elle le fait généralement après une réflexion très poussée et ce ne sont pas quarante-huit heures qui y changeront quelque chose, alors qu'elle y pense vingt‑quatre heures sur vingt-quatre.

Autant je peux entendre certains arguments, même si je n'y adhère pas forcément, autant le parallèle de Jean-Louis Touraine se situe un peu à la limite... J'espère qu'il fait la différence entre avorter et donner naissance. Cela me fait penser à un autre débat et à une remarque qui m'avait profondément heurté, lorsque quelqu'un m'avait dit qu'il espérait que je finirais dans un centre hospitalier régional universitaire pour comprendre leur utilité. Pour un débat apaisé, mieux vaut éviter ce genre de réflexions. Et laissons ma femme de côté...

Une femme est encore capable de réfléchir par elle-même. Elle est également dotée de la parole. Si elle considère, après son entretien psychosocial, qu'elle souhaite réfléchir, elle saura par elle-même, sans être accompagnée par un homme, prendre ce délai. Si, au contraire, elle souhaite recourir à l'IVG, elle saura aussi l'exprimer.
N'oublions pas que l'IVG implique toute une organisation parallèle. Les rendez‑vous ont lieu en journée, ce qui signifie, quand vous travaillez, poser une après-midi. Ce sont parfois, du fait de ce délai supplémentaire, deux jours de congés à poser dans la même semaine. Supprimer ce délai permettrait de ne poser qu'une journée et d'éviter des soucis supplémentaires avec son employeur, par exemple.

Faisons confiance aux femmes. L'article n'interdit pas une réflexion supplémentaire, c'est seulement qu'il ne l'impose pas.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l'article 1er ter, sans modification.
Article 2 : Suppression de la clause de conscience spécifique relative à l'interruption volontaire de grossesse et création d'un répertoire recensant les professionnels de santé et les structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse
La commission examine les amendements de suppression AS4 de M. Thibault Bazin et AS16 de Mme Josiane Corneloup.

L'article 2 supprime la clause de conscience spécifique, ce qui ne fait pas consensus dans notre société. Le Conseil national de l'ordre des médecins a rappelé son opposition à cette suppression. La loi de 1975 était, sur ce point également, parvenue à un équilibre. La clause spécifique, inscrite dans la loi, est d'ailleurs différente de la clause générale, d'ordre réglementaire. Elle possède, par sa nature législative, une force plus importante. Qui plus est, la clause spécifique existe pour tous les autres personnels soignants, ce qui n'est pas anodin.

La plupart des ARS ne déclarent pas de difficultés majeures d'accès à l'IVG, qui seraient spécifiquement liées à l'exercice d'une clause de conscience. Les professionnels de santé qui ne souhaitent pas pratiquer cet acte informent la patiente sans délai et lui communiquent le nom d'un autre professionnel de santé acceptant de pratiquer une IVG. Le geste médical nécessaire pour une IVG après douze semaines n'est plus le même et le protocole doit être révisé compte tenu des risques importants pour la femme enceinte. Cette clause de conscience est d'autant plus nécessaire si les délais sont allongés. De plus, sa présence dans le code de la santé publique est liée à la nature particulière de l'acte qu'est l'interruption d'une grossesse. Il est donc justifié qu'elle soit distincte de la clause générale.

La suppression de la clause de conscience spécifique est une disposition importante de la proposition de loi. La clause de conscience générale, qui s'applique aux médecins, sera maintenue. On nous a rétorqué que les gynécologues seraient obligés de pratiquer les IVG. Non, ils auront toujours leur clause de conscience générale et pourront toujours les refuser. Précisons d'ailleurs que ce sont surtout les médecins généralistes qui pratiquent les IVG. On connaît le pourcentage exact de médecins ne souhaitant pas pratiquer l'IVG. Les professionnels nous disent tous que la clause de conscience spécifique fait de l'IVG un acte à part. Pourquoi la santé des femmes ferait-elle l'objet d'une mesure spécifique, qui les infantiliserait, alors que la clause de conscience générale suffit à cette pratique médicale volontaire, où le médecin choisit de pratiquer une IVG ?
Quant aux risques, madame Corneloup, selon le CCNE, il n'y a pas plus de risques à quatorze semaines qu'à douze. La responsable du centre d'orthogénie du Kremlin‑Bicêtre nous a expliqué hier qu'il y avait aussi une question de matériel et de technique. Les professions médicales sont mal formées aux pratiques de l'IVG instrumentale. Dans d'autres pays, on la pratique jusqu'à vingt-quatre voire vingt‑huit semaines, sans risque pour la femme. Je ne dis pas que nous allons vers cela, mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas plus de risques à quatorze qu'à douze semaines.
Avis défavorable.

Madame Corneloup, la double clause de conscience pose bien des difficultés d'accès à l'IVG. Dans mon hôpital public, sur sept gynécologues, un seul pratique l'IVG. Les six autres, de nationalité étrangère, refusent de la pratiquer, alors même qu'ils sont dans un hôpital public et payés par l'État. Cette double cause de conscience appartient à la société des années 1970. Notre société a changé. Tous les jours, dans notre hémicycle, nous adaptons nos lois à son évolution. Ne restons pas à côté du chemin et supprimons la double clause de conscience.

Je soutiens globalement le fond de votre proposition de loi. En revanche, j'ai des réticences concernant l'article 2, même si j'entends que, territorialement, il y a des soucis. J'ai vu que c'était le cas dans la Sarthe, par exemple. Néanmoins, il faudrait résoudre ce problème d'une autre manière, peut-être en imposant aux directeurs d'établissement de s'assurer que, parmi les médecins recrutés, ils aient une part suffisante de praticiens acceptant de pratiquer l'IVG. Pour moi, l'acte de soin est un acte d'amour. Si l'on accomplit un acte qui va à l'encontre de ses convictions, la femme risque de ressentir du mépris et peut-être même que l'acte s'accompagnera d'une certaine malveillance.

Je ne comprends pas très bien l'intention derrière la suppression de la clause de conscience spécifique. D'une part, elle demande au praticien d'assurer le suivi de la femme qui le consulte – cet engagement obligatoire, qui n'est pas dans la clause de conscience réglementaire, me semble très important. D'autre part, au nom de la liberté des femmes, comment peut-on ne pas respecter la liberté de conscience des professionnels ? J'entends, dans vos propos, une volonté de pression sur des professionnels de santé, dont la culture peut être heurtée. Il faut que les libertés des deux parties soient respectées. En opposant l'intérêt de l'un à celui de l'autre et en faisant prévaloir l'intérêt des unes sur les consciences des autres, je ne vois pas comment on parviendra à un accompagnement respectant la liberté des uns et des autres.

L'assurance du suivi est garantie par cette loi, qui a été sécurisée lors de la première lecture. La clause de conscience générale permet toujours au médecin de ne pas accomplir cet acte s'il le gêne. Il me semble utile de regarder les chiffres. L'IVG concerne à peu près une femme sur trois. C'est un fait assez stable dans le temps. J'en tire comme conclusion que l'IVG fait partie de la santé et de la vie sexuelles des femmes et cela me semble d'autant plus étonnant qu'un grand nombre de gynécologues fassent valoir leur clause de conscience. Supprimer cette clause spécifique pourrait permettre de changer la conviction des gynécologues réticents. C'est une question de culture. Le regard que l'on a sur l'avortement et surtout sur la santé des femmes qui ont accès à l'IVG mérite de changer. Les femmes ont le droit qu'un gynécologue considère leur demande comme faisant partie de leur parcours de vie. Il est temps de faire évoluer notre culture, tout en continuant à respecter la clause de conscience des médecins.
La commission rejette les amendements.
Puis, suivant l'avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l'amendement AS11 de M. Fabien Di Filippo.
Elle examine ensuite l'amendement AS21 des rapporteures.

À notre sens, il ne s'agit pas vraiment d'un amendement rédactionnel, dans la mesure où « structures » semble moins restrictif que « établissements et centres ». Il nous paraît plus prudent de conserver la rédaction actuelle.

Pouvez-vous préciser votre point de vue, chère collègue ? Qu'y aurait-il comme structures qui ne seraient ni un établissement ni un centre ?
La commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS14 de Mme Catherine Fabre.

Je souhaite m'assurer que le répertoire de référencement des professionnels de santé et des établissements pratiquant l'IVG est accessible par tous les moyens. Il faudrait que les femmes qui n'ont pas accès à internet puissent néanmoins avoir accès à ces informations par le biais d'un numéro vert, par exemple.

C'est un amendement de bon sens. Même si je ne suis pas sûre que cela relève du domaine de la loi, pourquoi ne pas l'écrire ?
Avis favorable.
La commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 2, modifié.
Article 2 bis A : Garantie de la délivrance d'un contraceptif en urgence dans les conditions prévues par le code de la santé publique
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS5 de M. Thibault Bazin.

Tant la Haute Autorité de santé (HAS), le 17 septembre 2019, que l'assurance maladie, le 24 février 2020, considèrent qu'il n'est pas recommandé de prendre deux fois dans le même cycle la pilule du lendemain. Au regard de la sécurité des femmes, il semble donc que la délivrance de la contraception d'urgence devrait rester contrôlée.

La HAS précise que la contraception d'urgence hormonale est, en règle générale, dénuée d'effets indésirables, qu'elle ne rend pas stérile et qu'elle peut être prise chaque fois qu'il y a un risque de grossesse non prévue. L'utilisation répétée au cours d'un même cycle est possible, même si elle n'est pas recommandée. La HAS insiste sur le rôle de conseil et d'information du pharmacien, ainsi que sur le fait qu'en aucun cas un pharmacien ne peut refuser la délivrance d'une contraception d'urgence ou d'une contraception au nom de ses convictions morales ou religieuses. C'est bien ce type de situation qui est visé à l'article : il s'agit de préciser à l'article L. 1110‑3 du code de la santé publique que l'interdiction de la discrimination dans l'accès à la prévention ou au soin concerne également l'accès à un moyen de contraception en urgence.
Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS22 des rapporteures.
Elle adopte ensuite l'article 2 bis A, modifié.
Article 2 bis : Rapport du Gouvernement sur l'application de la législation relative au délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
La commission examine les amendements identiques AS6 de M. Thibault Bazin et AS17 de Mme Josiane Corneloup.

Il s'agit d'établir un rapport qui ferait suite à une véritable étude épidémiologique, analysant les causes, les conditions et les conséquences de l'avortement, afin de mettre en œuvre une réelle politique de prévention de l'IVG.

Je comprends qu'on puisse demander des rapports lorsqu'il n'y en a pas, mais, pour rédiger notre proposition de loi, nous nous sommes appuyées sur plusieurs rapports : celui de la délégation aux droits des femmes, celui du CESE, celui de l'IGAS et celui du HCEFH. Nous avons déjà beaucoup de données.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AS23 des rapporteures.
Puis elle adopte l'article 2 bis, modifié.
Article 2 ter : Rapport du Gouvernement sur l'évaluation du dispositif sur l'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse
La commission adopte l'amendement rédactionnel AS24 des rapporteures.
Puis elle est saisie de l'amendement AS7 de M. Thibault Bazin.

Avis défavorable, puisque l'accompagnement est déjà prévu et qu'évaluer l'accès à l'IVG permettra aussi de l'évaluer dans toutes ses composantes.

Nous nous heurtons à l'impossibilité d'intégrer dans cette proposition de loi d'importance, ou au moins dans la réflexion qui l'entoure, tout ce qui pourrait concourir à la prévention ou à la levée de certains obstacles, qui me semble un peu trop réduite au seul allongement du délai. Nombre de leviers, tels que la couverture du territoire ou la prévention chez les jeunes femmes, par exemple, auraient mérité d'être évalués pendant la préparation de ce texte, ou peut-être au travers d'un rapport.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 2 ter, modifié.
Article 3 : Compensation financière
La commission adopte l'article 3, sans modification.
Puis elle adopte l'ensemble de la proposition de loi, modifiée.
Enfin, la commission procède à l'examen de la proposition de loi pour une limite décente des écarts de revenus (n° 3094) (M. Dominique Potier, rapporteur).

Pour terminer en beauté ! Je suis heureux de partager avec vous un travail entrepris depuis le début de la législature au sein du groupe Socialistes et apparentés, travail collectif auquel Boris Vallaud et Marie-Noëlle Battistel ont largement contribué, avec l'appui bienveillant de notre présidente Valérie Rabault.
Cette proposition de loi a une histoire. Elle s'inscrit dans un travail de refondation de l'entreprise qui a été lancé par le groupe Socialistes en lien avec la société civile. Elle a été fabriquée par un collectif de citoyens, syndicalistes, responsables d'organisations non gouvernementales entre autres, représentant le monde de l'entreprise – pas seulement dans l'économie sociale. Cette coopération entre élus de la nation et représentants de la société civile avait été inaugurée pour élaborer une loi française qui est en train de devenir une directive européenne, la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Ce que nous avions alors appelé un cercle parlementaire nous avait permis de travailler de façon transpartisane, dans le dialogue avec les académiques, les intellectuels et les personnes engagées capables de fabriquer des objets politiques nouveaux et de les porter devant l'Assemblée.
Empruntant ce chemin, nous avons voulu dessiner ce que pourrait être l'entreprise au XXIe siècle. Une des racines les plus importantes de notre réflexion se trouve dans les travaux que le collège des Bernardins a menés, neuf années durant, autour de l'entreprise conçue comme une institution politique dans la société au XXIe siècle. C'est dans l'esprit de ces travaux pluridisciplinaires, ouverts et novateurs que nous avons conçu une première proposition de loi, examinée en 2017 dans le cadre d'une niche parlementaire. Elle s'articulait en neuf points, dont une redéfinition de l'entreprise, qui a été reprise dans la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE »), un projet de codétermination et de partage de pouvoir au sein de l'entreprise, et une proposition sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Au stade de cette première proposition de loi, il ne s'agissait que d'une réflexion sur la réduction des écarts de revenus : les choses restaient assez floues. Nous avons pu en faire un amendement au projet de loi « PACTE », mais je rends ici hommage à la personne qui a conçu précisément le dispositif, Francis Raugel, un cadre à la retraite de la CFDT qui a fait le siège de ma permanence pour m'expliquer cette proposition. L'article 1er du présent texte prévoit donc un système fiscal incitatif pour limiter les écarts de revenus à un facteur 12. L'article 2, lui, fixe un plafonnement, selon un facteur 20. J'ai appris depuis que cette proposition avait déjà été faite à l'Assemblée nationale par un député communiste, le prédécesseur de Pierre Dharréville ici présent, Gaby Charroux. Sous le patronage d'un syndicaliste CFDT et d'un député communiste, j'espère que cette idée ira bien au-delà de la gauche et vous entraînera tous.
Cette proposition singulière du facteur 12, j'ai profité du confinement dû à la pandémie pour l'affiner, rédiger un texte et le déposer, en juin 2020. Pendant toute cette période, j'ai réfléchi au sens que cela avait. J'ai notamment pu conduire pour la commission des affaires économiques une mission d'information sur le partage de la valeur au sein des entreprises et ses conséquences sur leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages.
Ce sujet, qui paraît banal, est finalement peu exploré. Il faut remonter à quelques décennies pour trouver des débats politiques de haute qualité sur la question des échelles de salaire : combien gagnent les cadres, les ouvriers... C'est comme si une forme de désinvolture avait saisi notre société face à cette question qui était structurante jusque dans les années 1980. Cet oubli a été préjudiciable, puisqu'on a vu une forme de démesure s'installer. Retrouver les repères, les outils qui permettent d'appréhender la question sur le plan éthique, philosophique et politique a été l'objet de cette mission passionnante, et je remercie ma collègue issue des rangs de la majorité, Graziella Melchior, qui l'a conduite avec moi. Cette mission a recueilli l'avis de toutes les parties prenantes, sondé les sources documentaires. Son rapport est une mine de documentation, et pointe en même temps les nombreux angles morts et zones d'ombre existants. L'une de nos premières revendications, avec Graziella Melchior, concerne d'ailleurs le besoin de retrouver une culture du chiffre sur ces questions de rémunération, de mieux se documenter pour que le débat politique puisse se tenir dans de belles conditions.
Je ne pourrais pas être juste sans rendre hommage à ceux qui ont conçu le facteur 12 au départ, l'économiste Gaël Giraud et la philosophe Cécile Renouard, qui en ont développé dans un livre les bienfaits économiques, sociaux et environnementaux. Quand on se demande pourquoi le facteur est de 12, on peut répondre grâce à ces pionniers.
La question du partage des revenus est généralement réglée dans notre République, à gauche et même à droite, par l'État providence. Avant redistribution, l'écart entre les 20 % de ménages les plus aisés et les 20 % les moins favorisés va de 1 à 8 ; il n'est plus que de 1 à 4 après. L'État providence fonctionne donc bien dans notre pays, même si son efficacité reste toujours un combat. Mais il ne peut pas tout corriger, et le poids de cette correction a un coût qui correspond à une forme d'épuisement de la puissance publique. Nous avons donc voulu aborder la question par la face Sud, celle de la réduction à la source, par la puissance publique, des inégalités, afin d'alléger la mission de l'État providence et de le rendre plus agile et plus performant.
Le texte en lui-même est d'une grande simplicité. Les dispositions sont limpides. L'article 1er propose un dispositif fiscal : au-delà de 12 fois le premier décile de revenus de l'entreprise, les salaires et les charges afférentes, soit l'ensemble de ce qui constitue une rémunération, ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés. C'est une formule très simple ; il n'y a aucune discussion sur son acceptabilité dans le droit français.
L'article 2 fixe deux plafonds. Lors de la précédente législature, à l'initiative du Président de la République, un plafonnement de 1 à 20 a été instauré pour les directeurs des grands établissements publics ou agences de l'État. À l'époque, je pense par oubli, les autres cadres n'avaient pas été visés par la mesure, ce qui fait que certains gagnent plus que le directeur. Cela crée un désordre qui n'est pas conforme à l'esprit de ce que nous voulions. Le premier plafond vise donc à corriger cet oubli. La véritable innovation tient à ce que l'article 2 étend à l'ensemble des entreprises privées cette limitation à 20 fois le SMIC.
L'article 3 a une portée importante. Il vise à introduire un nouveau critère dans la certification publique, que j'appelle de mes vœux, de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises. La RSE s'intéresse à beaucoup de choses – le bilan carbone, l'égalité hommes-femmes, l'impact du recyclage... – mais très peu à la question qui nous occupe. Les écarts de revenus et le partage de valeur à la source pourraient faire l'objet d'un indice qui deviendrait un élément à prendre en compte. Par là même, nous plaidons pour que le partage de la valeur à la source devienne un élément de la déclaration de performance extra-financière telle qu'elle est en train de se réformer à l'échelle européenne. La France, et je le salue, joue un rôle important en la matière. Elle milite pour une nouvelle norme de RSE, et nous proposons d'y intégrer la question du partage de la valeur, trop peu considérée jusqu'à présent.
Un élément de contexte : avec la crise du covid, au printemps 2020, nous avons redécouvert que si le chauffeur routier qui collecte le lait dans les fermes avait arrêté de travailler, si l'auxiliaire de vie n'avait pas eu le courage d'aller, parfois sans protection, au domicile des personnes en situation de handicap ou fragilisées par l'âge, l'hôpital n'aurait pas tenu, l'agro-alimentaire aurait craqué. Bien d'autres services, la gestion des déchets ou de l'eau par exemple, ont tenu parce que des travailleurs parmi les moins payés de notre pays ont continué à faire leur travail. Du Président de la République à nous tous, nous avons eu un immense mouvement de gratitude non seulement pour les soignants, mais pour tous ces travailleurs invisibles et mal payés. C'est parce qu'ils ont eu le courage de continuer à travailler, souvent pour 1 200 ou 1 300 euros par mois, que le pays a tenu.
Certains m'ont dit, y compris au Gouvernement, que cette proposition de loi était très intéressante, mais pour plus tard, pas maintenant. Cela me met dans une colère terrible. Si nous ne la votons pas maintenant, quand le ferons-nous ? Qui peut prétendre qu'il vaut douze fois plus que ces travailleurs invisibles qui ont tenu le pays ? Ceux qui trouvent normal que les patrons du CAC 40 gagnent 248 fois le SMIC admettent qu'il y a dans notre pays des personnes qui valent 248 fois moins que d'autres, ou même 400 ou 500 fois, si l'on prend les extrêmes.
Le facteur 12, le plafonnement à 20 concernent très peu de personnes. J'ai cru longtemps, avec Boris Vallaud et d'autres, que ces mesures avaient un caractère symbolique, mais peu d'effet redistributif. Grâce à l'étude que j'ai pu mener avec nos deux administrateurs, que je remercie pour leur engagement dans ce travail, nous avons enfin des chiffres – grâce à notre persévérance, et malgré le silence de Bercy, interrogé et relancé depuis quatre mois. La très bonne surprise, c'est que cet effet redistributif est extrêmement important.
Si nous appliquons le facteur 12 pour une redistribution vers les premier et deuxième déciles de notre pays, autrement dit pour des revenus moyens d'environ 1 350 euros, le gain par mois représente 233 euros. Ce sont 3,5 à 4 millions de salariés qui pourraient ainsi bénéficier chaque mois d'une augmentation de salaire de 15 %, et ceci à charges égales pour l'entreprise, puisque c'était notre hypothèse de base. Je répète : la limitation de la rémunération des 0,32 % de salariés qui gagnent plus de 12 fois le SMIC, ce qui représente 9 milliards sur les 600 milliards de volume salarial dans notre pays, représente 15 % de pouvoir d'achat supplémentaire, de pouvoir de vivre diraient certains, pour 3 à 4 millions de salariés. Si la redistribution s'opère au bénéfice de tous les revenus inférieurs au revenu médian, ce seront alors une dizaine de millions de salariés qui percevront 93 euros supplémentaires par mois. Si nous limitons les calculs au périmètre des entreprises qui concentrent ces salaires excessifs – les très grandes entreprises – les effets de redistribution deviennent majeurs : ils permettent quasiment de doubler les revenus des premiers déciles. Mais nous avons voulu tenir compte de la sous-traitance, ou des cabinets libéraux où les écarts de revenus entre la femme de ménage et certains professionnels, médicaux, par exemple sont astronomiques. Pour n'oublier personne donc, nous avons pensé le mécanisme de redistribution au bénéfice de l'ensemble des salariés.
Les sommes redistribuées permettent de rebattre les cartes du pouvoir d'achat. Si toutefois des privilèges exorbitants étaient maintenus par les entreprises au nom de leur liberté et que l'impôt sur les sociétés s'appliquait sur les sommes excédant le fameux plafond de 12, le gain pour la nation serait de l'ordre de 2,4 milliards d'euros, soit à peu près les deux tiers de la perte organisée par la majorité actuelle en 2018 avec la flat tax et l'impôt sur la fortune. Et, pour information, si l'écrêtement s'appliquait non plus aux 0,3 % des salariés mais aux 1 % des Français les plus privilégiés, les sommes seraient d'une tout autre mesure : près de 6 milliards d'euros de fiscalité pourraient être récupérés au bénéfice d'un nouveau partage dans la société. Il y a donc des masses énormes qui profitent à très peu de Français et qui pourraient servir au changement de vie de beaucoup d'autres.
Il n'y a pas qu'un gain social à attendre de cette proposition : sur le plan économique, nous avons vu qu'elle n'aurait aucune conséquence, puisqu'elle se fait à masse salariale égale et sans perte de compétitivité, mais ses retombées écologiques seraient importantes. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie nous renseigne sur les différences de consommation de carbone entre les premiers et derniers déciles des Français. Une étude conjointe d'Oxfam et de l'Institut de l'environnement de Stockholm, vérifiée et consolidée, montre que 1 % des plus aisés des humains consomment autant de CO2 que la moitié de l'humanité. Il est certain que les 0,32 % de salariés dont nous parlons en font partie. Réduire leur niveau de vie, c'est aussi réduire leur impact carbone et leurs comportements désastreux pour l'environnement. En revanche, redonner 15 % de pouvoir d'achat aux plus défavorisés, ceux qui ont été sur les barrages des « gilets jaunes », c'est leur donner la capacité d'isoler leur logement, de consommer plus sainement, de se déplacer de façon moins carbonée, bref de contribuer à la transition écologique.
Le partage de la valeur à la source dans l'entreprise nous permet non seulement de refaire société, sans perdre en compétitivité économique, mais également d'amorcer la transition écologique en donnant aux plus défavorisés les moyens de s'y engager et en calmant les ardeurs de ceux qui surconsomment sans retenue des ressources finies.
Voilà notre dessein. Je terminerai avec une citation de l'abbé Pierre d'une modernité extraordinaire : « Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. »

Cette proposition de loi sur les écarts de rémunération est pour moi l'occasion de rappeler les lignes directrices de l'action de la majorité, qui sont la base de son ADN politique : libérer, protéger, réconcilier. Nombre de mesures ont été adoptées pour donner de la souplesse aux acteurs économiques, rendre transparentes les rémunérations et faciliter la répartition de la valeur. Notre politique est cohérente. Plutôt que de laisser des barrières à l'entrée dans l'emploi, nous avons souhaité que le plus possible de personnes y accèdent. Il y a plus de salariés dans des entreprise plus diverses, avec une dynamique de redistribution de richesse au sein même des acteurs économiques français et un pouvoir de socialisation plus fort.
Notre confiance dans les acteurs économiques et les partenaires sociaux passe aussi par plus de transparence et de dialogue social. C'est l'esprit et la lettre de la loi « PACTE », adoptée en 2019 et qui donne déjà de premiers résultats pour ce qui est de la régulation fine et équitable des rémunérations les plus élevées, en particulier dans les plus grandes entreprises.
Monsieur le rapporteur, vous proposez une hyperfiscalisation des rémunérations qui dépasseraient 12 fois le salaire moyen de l'entreprise, et une interdiction stricte des rémunérations dépassant un plafond de 20 fois le SMIC. Mais quel problème souhaitez-vous vraiment résoudre, alors que notre pays est déjà l'un des plus vertueux de l'Union européenne en termes d'égalité salariale ? Il n'est dépassé que par les pays nordiques, comme l'indique votre rapport d'information de décembre 2020, réalisé avec notre collègue Graziella Melchior. Cette dernière, que vous citez, n'a du reste pas été associée à votre proposition de loi, qui est bien une proposition de votre groupe et non le reflet d'une coconstruction, il est important de le préciser. Je note par ailleurs que les mesures que vous proposez aujourd'hui vont à rebours de celles de la loi « Sapin 2 », adoptée en décembre 2016 par la majorité dont vous étiez membre.
Le groupe La République en Marche rejettera votre texte et ses mesures de blocage immédiat, fiscal et social, sans limite dans le temps, des hautes rémunérations. Les débats sur les articles permettront de développer nos arguments sur notre choix assumé de faire vivre et prospérer les dispositifs existants et de nous appuyer sur les travaux actuellement menés sur ces questions par les partenaires sociaux, notamment sous l'égide du ministère du travail.

Le présent texte formule des propositions maintes fois mises en débat dans notre pays. Je salue Dominique Potier, dont je reconnais bien là les valeurs et les idées.
Comme le rappelle l'exposé des motifs, l'idée vient de loin : dès le Ve siècle avant Jésus-Christ, Platon proposait de fixer un écart maximal entre les revenus des plus pauvres et des plus riches. Ses défenseurs la posent comme un principe moral, mais aussi économique.
Cette proposition de loi vise, tout d'abord, à augmenter le coût des hautes rémunérations, lorsqu'elles dépassent un ratio de 1 à 12 avec les plus faibles, afin d'encourager une forme de sobriété salariale. Elle veut aussi les plafonner à 20 fois le SMIC. L'initiative, si elle peut sembler séduisante, se heurte à la fois à la réalité économique et au droit constitutionnel. En effet, établir de telles règles contraignantes pourrait avoir des effets défavorables sur l'attractivité des entreprises françaises pour les personnels qualifiés, et sur l'attractivité de la France pour les entreprises étrangères qui souhaiteraient s'y installer. Par ailleurs, cela pourrait entraîner une externalisation des tâches, tant pour les bas salaires, dans le but d'augmenter le plafond, que pour les hautes rémunérations, pour contourner la loi. Enfin, le plafonnement strict des rémunérations serait probablement inconstitutionnel au titre de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle.
Nous sommes convaincus que le contrôle, la responsabilisation, la transparence et surtout le dialogue social sont plus efficaces que la contrainte proposée par notre collègue. Notre pays s'est doté d'outils allant dans ce sens, avec le principe du say and pay introduit par la loi « Sapin 2 » et largement renforcé par la loi « PACTE » sous la présente législature. Mais nous sommes surtout persuadés que c'est l'ascenseur social interne à l'entreprise, mû notamment par la formation continue pour tous les salariés, qui sera l'outil de réduction des inégalités le plus efficace.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés n'apportera pas ses suffrages à cette proposition de loi.

Le groupe Socialistes et apparentés a mené depuis près de six ans un cycle de réflexion sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, sous l'impulsion de Dominique Potier, dont je salue l'engagement sans faille. Ces travaux ont notamment permis l'adoption de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Ils ont également donné lieu au dépôt de la proposition de loi dite Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances, qui fut le socle de notre contribution au débat sur la loi « PACTE » s'agissant de la codétermination, de la transparence et de la RSE notamment. Afin de parfaire ses travaux, notre groupe a également fait usage de son « droit de tirage » en commission des affaires économiques afin d'obtenir un rapport d'information sur le partage de la valeur au sein des entreprises et ses conséquences sur leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages.
Cette proposition de loi est donc le résultat d'un travail dense et documenté. Dès 2013, l'Organisation de coopération et de développement économiques s'est inquiétée de l'écart croissant des rémunérations entre salariés et dirigeants d'une entreprise. Selon une étude réalisée la même année par la fédération des syndicats américains, la rémunération moyenne d'un dirigeant d'entreprise américain était ainsi 354 fois supérieure à celle d'un salarié. En France, ce rapport était de 1 à 104. L'exemple le plus frappant est celui de la société Amazon : une étude réalisée dans cinq États a montré que 30 % de salariés avaient recours au programme fédéral d'aide alimentaire, alors que leur président-directeur général (P.-D.G.) était l'homme le plus riche du monde.
L'écart maximal, nous l'avons ici fixé de 1 à 12. Nous proposons un mécanisme incitatif novateur pour la réduction des écarts de salaire, dont l'effet redistributif, comme l'indique l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), sera significatif sur les bas revenus. Nous devons, aujourd'hui plus que jamais, dans la période économique et sociale que nous traversons, redonner du pouvoir d'achat aux plus modestes. J'invite donc tous mes collègues à soutenir ce texte de justice sociale pour l'entreprise du XXIe siècle.

Je remercie le rapporteur, qui prolonge ici un débat important sur la justice sociale et les revenus du travail. Cette initiative fait honneur à notre commission des affaires sociales.
La crise sanitaire nous a révélé l'importance, au-delà des personnels soignants, des travailleurs dits essentiels, ces employés des supermarchés, livreurs, agents de nettoyage qui sont le plus souvent invisibles et peu valorisés mais dont notre société a essentiellement besoin et ne pourrait se passer. Toutes ces professions ont pour autre point commun d'être rémunérées près du SMIC.
Nos sociétés sont bel et bien fracturées par des dynamiques de tensions fortes, avec des écarts de salaires souvent ressentis comme injustes et affaiblissant la cohésion sociale. Cela motive les mesures d'égalité et de transparence défendues par la majorité depuis le début du quinquennat. Je pense, par exemple, aux règles de transparence introduites dans la loi « PACTE » ou encore à la mesure des écarts de salaires entre hommes et femmes prévue par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ces mesures vont dans le bon sens et doivent être approfondies.
Mais votre proposition de loi va beaucoup plus loin. Elle veut une réduction des écarts entre les salaires, avec un dispositif incitatif pour les maintenir dans une fourchette de 1 à 12 et un plafond à 20 fois le SMIC dans les entreprises privées. Elle amène à penser et innover dans un modèle économique différent, en tirant les leçons qui doivent l'être de la crise sanitaire et en se fondant sur la nécessité de se tourner vers un modèle plus respectueux de l'égalité sociale, de la solidarité mais aussi de l'environnement.
Je suis sensible, à titre personnel, à cette proposition, contrairement à certains de mes collègues du groupe Agir ensemble, qui craignent que ces mesures n'entraînent une perte d'attractivité pour notre pays et une fuite de ses talents. Je me réjouis en tout cas que ce débat ait lieu et souhaite qu'il nous permette d'avancer sur ces sujets. Je note enfin que l'enjeu réside tout autant dans l'augmentation des salaires les plus faibles, en favorisant l'intéressement et la participation pour tous. C'est aussi dans cette direction qu'il nous faut avancer.
On peut dire que vouloir moraliser le capitalisme, c'est un peu vouloir labourer la mer. Mais cela vaut le coup d'essayer, vu l'urgence climatique et sanitaire.

Merci à nos collègues de prendre cette initiative dans le contexte de la crise sociale liée à la covid. On voit bien la puissance de la pauvreté qui s'abat sur le pays, et désormais le lien qu'il y a entre son augmentation et la concentration de richesses. On examine en ce moment dans l'hémicycle un projet de loi censé conforter les principes républicains. On ne voit pas lequel de ces principes, la liberté, l'égalité ou la fraternité, en sort conforté. La proposition qui nous est faite y contribuerait davantage.
Certains exemples montrent bien le lien qu'il y a entre l'extension de la richesse et celle de la pauvreté. Ainsi, alors que le nombre de pauvres en France atteint les 10 millions, les milliardaires français ont empoché 175 milliards de plus en 2020. Et, comme on le dit parfois, si quelqu'un avait pu économiser 8 000 euros par jour depuis la prise de la Bastille, il n'aurait aujourd'hui que 1 % de la fortune de Bernard Arnault.
Le problème de l'écart des revenus dans une même entreprise concerne avant tout les plus grandes d'entre elles, notamment les sociétés du CAC 40, où l'écart peut aller de 1 à 240. Une première interrogation d'ordre philosophique se pose : quel effort surhumain, quel mérite supplémentaire, car on peut admettre que les dirigeants en aient quelques-uns, justifient que quelqu'un gagne dans une entreprise 240 fois ce que gagne le plus bas salaire ? Aucun. Ensuite s'impose une considération d'ordre écologique : que fait-on de telles rémunérations, quel type de consommation a-t-on quand on gagne autant d'argent ?
Nos collègues proposent un mécanisme incitatif, fondé sur l'impôt sur les sociétés et qui pénaliserait les écarts au-delà de 1 à 12. Ce dispositif permettrait tout de même à un écart supérieur d'exister. Pour notre part, députés de La France insoumise, nous avions proposé une obligation. On nous répond souvent que ce serait confiscatoire, mais il n'est question de confisquer de l'argent à personne ! Si un grand patron souhaite maintenir son niveau de rémunération exorbitant, il le peut dans notre dispositif : en vertu de la limitation de l'écart, il devra simplement augmenter les revenus de tous les autres. Et j'ajoute un point d'une importance capitale : en augmentant la rémunération de ceux qui sont en bas de l'échelle, on assure aussi une relance de la consommation populaire.
Bref, même si je regrette que nos amendements, notamment fiscaux, pour améliorer le lissage de l'effort entre tous et l'impôt universel n'aient pas été recevables, nous considérons que cette proposition de loi va dans le bon sens.

Plusieurs études économiques mettent en lumière un creusement des inégalités salariales ces dernières années. Ce phénomène s'est accentué de façon assez importante sous l'effet de la crise de la covid-19. Paradoxalement, la pandémie nous a poussés à nous interroger sur la juste rétribution des professions en première ligne, qui sont loin d'être les mieux rémunérées. La présente proposition de loi pose donc la question de la place des salariés dans le partage de la valeur. Elle soulève des enjeux économiques, sociaux et sociétaux. Aussi le groupe Libertés et Territoires rejoint-il la position du rapporteur : agir sur les inégalités au sein de l'entreprise constitue un véritable outil de justice sociale.
Face au scandale des rémunérations de dirigeants de grands groupes, plusieurs propositions de loi ont été déposées pour encadrer les rémunérations au sein des entreprises ou en limiter les écarts. L'une d'elles, du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, avait été adoptée en 2016 mais sa principale disposition, visant à imposer un écart maximum de salaire de 1 à 20, avait été rejetée à une voix près. Pour autant, si l'indécence de certaines rémunérations peut légitimement choquer, la fixation de mécanismes contraignants de modération des écarts salariaux se heurte au principe de liberté de fixation du salaire, lequel est limité s'agissant des minima mais pas s'agissant des maxima.
L'article 1er de la proposition de loi contourne cette difficulté en recourant à un dispositif incitatif pour privilégier des écarts de rémunération compris dans un ratio de 1 à 12, et en alourdissant la fiscalité au-delà. Cependant l'article 2 sur le plafonnement des très hautes rémunérations ne nous semble malheureusement pas être conforme à la Constitution, comme le reconnaît d'ailleurs l'exposé des motifs. Enfin, dans le cas, hélas improbable, où cette proposition de loi serait adoptée, on pourrait s'interroger sur les éventuelles failles qui permettaient de contourner le dispositif, comme les dons d'actions.
Merci pour la très belle phrase de l'abbé Pierre que vous avez rappelée.

Je salue le travail de Dominique Potier et le remercie d'avoir cité mon ami, prédécesseur et député suppléant Gaby Charroux. Il avait effectivement défendu une proposition de loi au cours de la législature précédente qui limitait les écarts de 1 à 20 par le biais d'une échelle mobile des salaires, obligeant les P.-D.G. qui voudraient augmenter leur rémunération à faire de même pour le bas de l'échelle.
À l'heure actuelle, force est de constater que le marché produit des écarts de rémunération qui s'avèrent injustifiables, sur le plan économique comme sur le plan social mais aussi éthique. Comment justifier de tels écarts de rémunération du travail entre deux personnes ? Et nous savons les dégâts que font ces mécanismes qui produisent des inégalités majeures dans la société, parce qu'ils contribuent à la constitution de puissances financières qui sont destructrices pour l'économie.
Les mesures prises par la majorité depuis 2017 ont contribué à aggraver cette situation et nous connaissons une explosion des inégalités dans la société. Il est donc urgent de prendre des mesures pour arrêter cette course vers les inégalités, qui sont un des moteurs du système capitaliste et du libéralisme.
Les propositions qui nous sont faites peuvent constituer un pas décisif en la matière. Selon une étude du Conseil d'analyse économique d'octobre 2020, les 20 % de ménages les plus aisés ont mis de côté 70 % de l'épargne totale accumulée entre mars et août 2020 ; à l'inverse, les 20 % de Français les plus modestes non seulement n'ont pas pu épargner davantage que d'habitude, mais se sont même endettés durant la même période. Il est temps, après ce que nous avons connu, de mettre ces décisions à l'ordre du jour.

Le travail fourni par les administrateurs qui m'ont accompagné, que je salue, a permis de lever quelques-unes des réserves que vous avez exprimées. Les simulations financières mais également les vérifications constitutionnelles que nous avons faites me rendent encore beaucoup plus assuré que je ne l'étais au printemps dernier devant ma proposition de loi fabriquée à la maison avec les moyens du bord. C'est la force de l'Assemblée, qui met au service des députés de l'intelligence et des informations qui sinon sont quasiment inaccessibles.
Je voudrais dire à Thierry Michels, avec beaucoup de respect pour l'opinion qu'il a exprimée, même s'il n'a pas développé beaucoup d'arguments, que je n'ai jamais associé Graziella Melchior à mes conclusions. Nous avons simplement mené une mission ensemble : parmi les vingt-deux propositions que nous avons formulées, une dizaine sont cosignées, et j'en reprends quatre ou cinq dans mes amendements. Tout s'est fait dans la plus grande transparence, elle s'est librement associée à ces propositions, et j'ai rappelé qu'elle en était la co-auteure par respect pour elle. Elle peut exprimer une autre opinion dans des discussions de groupe, mais gardez à l'esprit qu'une mission n'est pas une proposition de loi.
Vous dites, monsieur Michels, que vous avez tout fait dans la loi « PACTE », mais elle n'est pour l'essentiel qu'une promesse, un processus. Il faut aller beaucoup plus loin dans la réforme des entreprises. La vraie réforme, vous le savez, c'est la codétermination, les salariés dans les comités de rémunération et dans la gouvernance de l'entreprise. C'est cela la révolution, le partage du pouvoir et de l'avoir – pas la société à mission, pas la redéfinition de la raison d'être ! Chez les socialistes, on s'intéresse plus à la façon de faire qu'à la raison d'être. C'est de la façon de faire que nous parlons aujourd'hui, de façon effective pour reprendre ce mot cher au Président de la République.
Vous dites aussi que nous ne l'avons pas fait dans la loi « Sapin 2 ». J'en étais rapporteur pour avis sur ces sujets. Quand je pense au devoir de vigilance, je me dis que le peu de réformes que nous avons faites dans le dernier mandat n'aurait eu aucune chance de voir le jour dans l'actuelle majorité. Je regrette votre position qui manque d'ouverture.
Monsieur Turquois, j'ai entendu François Bayrou, en pleine crise des « gilets jaunes », évoquer un plafonnement de 1 à 10, un système volontaire, une obligation... Il cherchait des idées neuves. Je ne désespère pas que, maintenant qu'il est au Plan, cette idée ressuscite : nous la saluerons avec beaucoup d'humilité si c'est le cas, mais je ne comprends pas votre position, car c'est bien typiquement une proposition démocrate-chrétienne qui aurait pu trouver ses racines dans votre groupe.
Vous avez évoqué la Constitution, comme Martine Wonner. On trouve chez le constitutionnaliste Dominique Rousseau, que personne ne conteste, l'affirmation que l'atteinte à la liberté contractuelle des entreprises peut trouver son fondement dans un intérêt général supérieur, celui des exigences minimales de la vie dans l'entreprise, qui serait méconnu par un écart trop important entre les rémunérations des dirigeants et des salariés et qui, par conséquence nécessaire, porterait une atteinte excessive au principe d'égalité et de solidarité. Nous sommes en plein dans ce cas d'espèce, avec ces 0,32 % de Français dont les privilèges exorbitants privent 20 % des salariés français de 15 % de revenus qui leur permettraient de garder la tête haute, partir en vacances, rénover leur logement, changer de voiture, vivre tout simplement. La Constitution, cher Nicolas, ne l'interdit pas. Vous voilà rassuré.
Vous dites aussi qu'il faut avancer par la volonté et le dialogue. C'est l'esprit de la loi « PACTE ». Les résultats ont été rappelés par Adrien Quatennens : l'explosion, depuis 2008 et la première crise des subprimes et encore plus avec la crise actuelle, de revenus indécents, de privilèges exorbitants, de dividendes incroyables. Pour ma part, sur le plan éthique, je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse assumer une telle démesure. Alors comment penser que le dialogue social pourrait résoudre de telles absurdités ? Votre confiance me surprend.
Chère Annie Chapelier, merci pour l'intérêt que vous portez à cette proposition, et pour votre petit mot de poésie : j'aime beaucoup l'idée de labourer la mer. Vous hésitez : l'idée est intéressante, mais pose un problème d'attractivité. Pour ma part, je fais un pari, que je vais illustrer avec le monde de l'hôpital que vous connaissez bien. Il s'y produit aujourd'hui une compétition des talents, et ceux qui en ont font monter les enchères – on les appelle les mercenaires. Je fais le pari que nous pouvons aboutir à un hôpital zéro mercenaires, zéro dépassements d'honoraires. Certains nous disent que cet hôpital va perdre de l'attractivité. Je fais le pari qu'il en gagnera, parce qu'il sera pionnier dans cette éthique du futur sans laquelle nous allons tous crever. Je le dis, il n'est pas possible de justifier l'indécence dans une société qui est au bord du gouffre. Si nous ne luttons pas contre le changement climatique et la pauvreté dans la décennie qui vient, nous irons tous vers une violence extrême. Alors penser qu'on va perdre de l'attractivité parce qu'on empêchera un Canadien, Néo‑Zélandais ou Chinois de travailler en France, c'est de la folie. Au contraire, nous retrouverons une fierté française, une cohésion, nous referons société et redeviendrons un peuple aimable, amoureux de l'égalité, de la fraternité et de la liberté.
Je pense avoir levé les doutes de Martine Wonner sur la Constitution, y compris sur l'article 2, et je salue enfin la proximité des combats de Pierre Dharréville. Je promets d'envoyer à son prédécesseur l'ensemble des documents à ma disposition quand nous aurons terminé nos travaux, je l'espère par un vote en séance.
Article 1er : Favoriser la réduction des écarts de rémunération grâce à l'impôt sur les sociétés
La commission examine l'amendement AS3 du rapporteur.

Je rappelle que cette proposition de loi est un objet artisanal, fabriqué à la maison. La vigilance des administrateurs m'amène à proposer des amendements rédactionnels. Le mécanisme fiscal prévu à l'article 1er s'adressait à l'entreprise, mais nous savons tous qu'elles peuvent s'organiser en holdings. C'est évidemment à l'échelle de l'ensemble du groupe qu'il faut mesurer les écarts de salaires et déterminer le premier décile.

Je vous remercie pour le travail que vous avez accompli, monsieur le rapporteur, dans le but de construire une société plus inclusive où chacun trouve sa place, mais je ne pense pas le mécanisme que vous proposez y parvienne. Vous voulez surfiscaliser les rémunérations élevées, mais vous n'avez pas expliqué comment cet argent qui se retrouvera dans les caisses de l'État va finalement parvenir aux salariés les plus modestes.
Pour notre part, nous avons plutôt cherché à développer la prime d'activité ou les moyens d'évoluer en compétences dans l'entreprise. Et si les inégalités ont effectivement crû pendant la crise, il ne faut pas oublier notre action en matière d'activité partielle : c'est un effort considérable qui a été fait pour aider les salariés, surtout les plus modestes, à passer la crise.
Ce premier amendement montre qu'il faut élargir le périmètre des sociétés concernées par votre mécanisme de régulation. Vous nous proposerez ensuite d'y inclure les prestataires de services, et ainsi de suite... Et tout cela pour quel résultat ? La loi « PACTE », qui permet déjà d'encadrer les plus fortes rémunérations, a été votée en 2019 et est en train de se déployer. Pour le reste, les entreprises classiques que nous connaissons, ces petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaires de nos territoires, sont déjà dans le schéma que vous préconisez ! Pourquoi faire si compliqué pour le seul bénéfice de donner beaucoup plus de travail à nos chefs d'entreprise, celles où les patrons et les salariés travaillent ensemble ? Pourquoi alourdir les contraintes sur toutes ces entreprises qui se battent au quotidien pour maintenir leur activité alors que nous avons déjà traité le problème le plus important, celui des entreprises du CAC 40, qui est réel ?
Le groupe La République en Marche votera contre cet amendement, et contre les suivants.

C'est le travail qui crée la valeur dans une entreprise, et elle doit être partagée le plus équitablement possible. Or nous savons que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et que la loi « PACTE » n'y fait rien. Elle a même encouragé des pratiques qui alimentent la machine à créer des inégalités de rémunération en dehors des salaires. Il ne faut pas nous raconter qu'elle change quoi que ce soit à la situation, c'est une fable.
Vous parlez d'élargir les contraintes, monsieur Michels. En l'occurrence, je serais presque d'accord avec vous pour aller plus loin : qu'on n'en reste pas à l'incitation, qu'on pose une véritable règle ! Mais je sais pertinemment que ce ne sera pas le cas, et je rappelle amicalement à Dominique Potier, au passage, que la proposition de Gaby Charroux n'avait pas été adoptée non plus au cours de la dernière législature. Il trouvait un écart de 1 à 20 raisonnable, mais comme cela avait été refusé, il avait proposé d'aller de 1 à 50, et même de 1 à 100, sans plus de succès ! Mais ce qui est raisonnable et rationnel, aujourd'hui, c'est bien d'agir sur une pratique qui a dépassé l'entendement et qui est délétère et dévastatrice pour notre société.

Le vote pour ou contre les amendements à l'article 1er n'a en lui-même pas grand sens : je voterai pour parce qu'ils sont cohérents avec la philosophie du texte, mais contre l'article.
Vous abordez la question de l'écart des revenus d'une façon que j'entends, mais qui me semble statique. Hier, la ministre Élisabeth Borne évoquait devant nous un plan visant à proposer à des caissières de devenir aides-soignantes. On ouvre la possibilité à des personnes qui, à cause de leurs origines ou de leur quartier, se sentent coincées et ne se croient pas capables de se projeter plus loin, de sortir de ce carcan social qui les limite, elles et leurs revenus. Je préfère ce type de démarche active à une démarche bloquée qui laisse chacun à sa place.
Et, pour répondre à vos propos sur le positionnement du Mouvement Démocrate, si je comprends l'idée que vous défendez, je ne crois pas aux outils proposés.

Je rappelle que nous sommes en train de gérer une crise : M. Potier nous dit que c'est le moment ou jamais d'adopter sa proposition, et il a raison. La France a déjà dépassé la barre des 10 millions de pauvres. Ces pauvres ne sont pas des gens qui ne travaillent pas. Il est donc urgent de se poser les bonnes questions, parce que d'ici à trois mois, nous en serons à 12, voire 13 millions d'individus pauvres chez nous. Souvenez‑vous des « gilets jaunes » – c'était il n'y a pas si longtemps. Ils n'étaient ni des black blocs ni des individus louches ; ils étaient des gens « normaux » : des aides-soignants, des caissières, des boulangers, des retraités. Il faut être très vigilant dans la période que nous vivons, car l'avenir dans lequel nous précipitons, ou en tout cas ne savons pas accompagner, tout une frange de la population est extrêmement sombre.
Par ailleurs, M. Potier a réussi à faire que je n'ai plus aucun doute sur la constitutionnalité du texte, y compris de l'article 2 : il a cité mon maître le professeur Rousseau, qui accompagne mes réflexions sur la privation de libertés que nous imposons aux Français depuis le 23 mars 2020. Merci d'y avoir fait référence.

Monsieur Michels, la proposition de loi ne crée pas de charge supplémentaire. Le mécanisme fiscal est d'une extrême simplicité – les experts-comptables ont parlé d'un « jeu d'enfant ». Quant au plafonnement de 1 à 20, il est aussi très simple. Notons que, pour 90 % des entreprises, le plafond de rémunération est le même avec un ratio de 1 à 20 SMIC qu'avec 1 à 12 du premier décile, car ceux qui gagnent 1 500 euros le tirent un peu vers le haut. Dans les réunions locales, chez nous, l'idée est populaire : on me dit que j'aurais plutôt dû choisir un plafond de 1 à 6. Je suis prêt à en discuter, l'important est que l'on en parle. Si le bon chiffre est 10, nous le mettrons. Je n'ai pas de dogme sur ce sujet.
Pierre Dharréville l'a dit, nous avons joué le jeu dans la loi « PACTE », par exemple lorsqu'il s'agissait de donner des capacités, des facultés. Vive l'entreprise qui se remet en cause, qui bouge ! Mais ne dites pas que la loi contient la moindre mesure à caractère obligatoire. Ce serait un mensonge : dans la loi, il n'y a rien qui conduise à réduire les inégalités.
Vous dites que vous vous êtes occupés des écarts de rémunération pour les patrons du CAC40. La loi « PACTE » a prévu une obligation de ratios d'équité. Les travaux que j'ai menés avec Graziella Melchior ont montré qu'elle n'était pas appliquée, car les questions liées aux groupes ou holdings n'étaient pas réglées. En conséquence, les entreprises s'asseyaient sur les obligations qui leur avaient été faites. Le peu de transparence demandé était largement insuffisant – ma collègue était d'accord avec moi pour étendre la transparence de publication des écarts au centile dans les entreprises de plus de cinq cents salariés. Vous l'avez compris, on n'obtient pas 0,32 % de Français gagnant plus de douze fois le SMIC en demandant la publication des écarts au quartile. Avec cela, on n'y voit rien du tout. Rappelons que huit Français sur dix gagnent entre le SMIC et 3 000 euros, et que le revenu médian est à 1 700 euros. Nous sommes dans des vertiges que ne peuvent pas saisir les efforts de transparence, d'ailleurs non appliqués, qui ont été votés dans la loi « PACTE ». Chaque fois que la majorité dira que cette loi a fait le boulot, nous répondrons que c'est faux : la loi « PACTE » a esquissé ce que pourrait être une réforme en autogestion de l'entreprise, mais elle ne crée rien, ni transparence réelle, ni obligation de réduire les inégalités. Cette loi ne doit pas être un paravent. Il faut se dire la vérité. C'est ce que nous essayons de faire à travers ces chiffres.
Aujourd'hui, 4 millions de Français qui travaillent sont privés de 15 % de leurs revenus par le monopole de 0,32 % des Français qui gagnent au-delà de douze fois le SMIC. C'est la réalité ! J'ai travaillé dans des entreprises où le rapport était de 1 à 1 ou de 1 à 1,5. Je refuse de penser que l'entreprise coopérative où je travaillais était moins compétitive que l'entreprise capitaliste voisine, où les écarts étaient de 1 à 10, sans que l'on sache au nom de quoi. C'est une question éthique, sociale, économique. Ne nous racontons-pas d'histoire !

La loi « PACTE » a dix-huit mois. Assurons-nous de la faire appliquer ! Aujourd'hui, les entreprises calculent mal ces ratios. Travaillons à améliorer cette transparence.
Lorsque j'évoquais des charges, je pensais à l'extension des obligations des entreprises aux groupes d'entreprises ou aux sous-traitants. Elles devront questionner leurs sous-traitants, ce qui pose la question de l'accès aux informations. Vous créez des usines à gaz. L'imposition supplémentaire des sociétés ne se traduira pas mécaniquement par l'augmentation des salaires des personnes les moins payées. Ce qui le permettra, c'est le développement de l'activité économique, des compétences. C'est cela qui créera de la richesse.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle rejette l'amendement de précision AS4 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS5 du rapporteur.

La sous-traitance, l'ubérisation créent des poches de pauvreté et de précarité. Pour saisir ces questions, j'ai pensé – Graziella Melchior ne partageait pas ce point de vue – que nous pourrions intégrer les entreprises sous-traitantes dans l'indice du partage de la valeur, tant par le haut, avec les fonctions surpayées, comme l'externalisation de fonctions informatiques ou le conseil marketing, que par le bas, avec les fonctions sous‑payées.
L'amendement prévoit de s'appuyer sur la notion de « relation commerciale établie », dont j'ai pris conscience lors de la construction du devoir de vigilance, pour identifier les sociétés avec lesquelles l'entreprise a une relation de sous-traitance qui s'établit dans la durée. Nous proposons donc d'intégrer les rémunérations des sous-traitants dans l'indice de partage de la valeur. C'est une manière de tirer vers le haut ces trappes à pauvreté que sont les travaux à temps partiel, notamment dans les métiers de l'entretien et autres métiers de services.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle rejette successivement les amendements rédactionnels AS6 et AS21 du rapporteur.
Elle rejette ensuite l'article 1er.
Article 2 : Plafonner les rémunérations à vingt fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance
La commission est saisie de l'amendement AS20 du rapporteur.

Il s'agit de préciser les données prises en compte pour le calcul du plafonnement des rémunérations à vingt fois le SMIC.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle rejette l'amendement rédactionnel AS19 du rapporteur.
La commission rejette ensuite l'article 2.
Article 3 : Évaluer l'opportunité d'une extension de la transparence et de l'encadrement des écarts de rémunération au niveau européen
La commission est saisie de l'amendement AS8 du rapporteur.

Précision rédactionnelle.
Si au moins vous adoptiez les amendements rédactionnels, vous rejetteriez une loi pour des raisons idéologiques mais bien rédigée...
La commission adopte l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS7 du rapporteur.

L'amendement vise à élargir le champ du rapport remis par le Gouvernement sur la RSE, afin d'examiner la possibilité de créer un indicateur de partage de la valeur ajoutée dans les entreprises.
Nous avons trop de données, une simplification est nécessaire. Il faut créer un indice qui prenne en compte le niveau de rémunération du capital par rapport au travail. L'enjeu est non seulement l'envolée des rémunérations pour les très hauts dirigeants, mais aussi la part des dividendes versés. C'est pourquoi l'indice devra être fondé sur ce double ratio capital/travail et les écarts au sein du monde du travail.
Reste à le fabriquer. Le rapport demandé au Gouvernement y contribuera. Par manque de lisibilité, les bases de données économiques et sociales que les entreprises d'au moins cinquante salariés doivent mettre à disposition des comités économiques et sociaux ou des représentants du personnel sont insuffisamment exploitées. Ces données pourraient être utilisées pour créer un indicateur du partage de la valeur dont les modalités de construction doivent faire l'objet d'un dialogue approfondi avec les partenaires sociaux.
Le monde de l'économie sociale et solidaire a pris les devants. Il rassemble de vrais entrepreneurs, qui ont simplement fait le choix du partage du capital et du travail. Trois cents d'entre eux se sont réunis cet été, en présence de nombreux élus de tous les courants – Manon Aubry, Roland Lescure ou moi-même. Ils nous ont présenté le référentiel de mesure d'impact, ou impact score, qui crée un système de référence et d'indices de la RSE pour les entreprises. Il peut être calculé à données sociales presque constantes par l'expert-comptable. À côté de la comptabilité classique, il donne une indication de la RSE de l'entreprise.
C'est le travail d'approfondissement que nous demandons au Gouvernement en la matière : la société civile l'a pratiquement déjà inventé, et ces trois cents entrepreneurs de moins de 30 ans n'auraient pas du tout apprécié qu'on leur dise qu'ils étaient moins performants que les entrepreneurs traditionnels.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle rejette l'article 3, modifié.
Après l'article 3
La commission est saisie de l'amendement AS13 du rapporteur.

Je propose que le respect d'un écart maximal de rémunérations devienne un critère de passation d'un marché public. Lorsqu'une collectivité, une métropole, un département, une région fait une dépense, il est préférable que l'essentiel de cette somme aille aux 80 % des ménages qui gagnent entre 1 500 et 3 000 euros, plutôt qu'aux 0,3 % qui gagnent plus de douze fois le SMIC. Cette disposition est totalement recevable, elle rentre dans le code du commerce : c'est donc une question de volonté politique. L'aurons-nous ?
La commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS10 du rapporteur.

Dans le prolongement de la mission d'information que nous avons réalisée au sein de la commission des affaires économiques, cet amendement propose d'accroître la transparence sur les rémunérations. Ce sera le premier pas vers un meilleur partage de la valeur au sein des entreprises.
La loi « PACTE » a introduit des obligations de transparence concernant les mandataires sociaux des sociétés cotées. Ce périmètre reste insuffisant. Nous proposons d'étendre les obligations de transparence pour les sociétés cotées au « top 10 ». Pour les sociétés non cotées employant plus de cinquante salariés, les rémunérations des mandataires sociaux doivent être présentées.
Dans une société libérale, au sens philosophique du XIXe siècle, pourquoi cacher la rémunération des plus hauts salaires ?
La commission rejette l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS17 du rapporteur.

Thierry Michels et Nicolas Turquois demandaient davantage de dialogue social : cet amendement va les satisfaire.
Alors que le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF exige qu'un administrateur salarié soit membre du comité de rémunération, moins d'une entreprise sur deux respecte cette recommandation. Pour être clair, il est très fréquent qu'aucun salarié ne siège au sein du comité de rémunération. Nous proposons de rendre cette présence obligatoire, en l'inscrivant dans le code du commerce.
La commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS18 du rapporteur.

Il s'agit, une fois encore, d'améliorer le dispositif introduit dans la loi « PACTE », en proposant que le rapport sur le gouvernement d'entreprise présente de manière claire et détaillée la méthode de calcul employée pour parvenir au résultat des écarts de rémunérations au sein de l'entreprise.
Parce qu'il est impératif d'harmoniser les méthodes de calcul de ce ratio d'équité, l'amendement précise, en outre, que les paramètres devant obligatoirement être pris en compte seront déterminés par décret. Cela permettra d'éviter que les grandes entreprises ne contournent les obligations introduites par la loi « PACTE ». Comment la majorité pourrait‑elle s'opposer à l'accomplissement de son dessein ?
La commission rejette l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS16 du rapporteur.

Nous appelons simplement à un peu de décence : lorsqu'une entreprise lance un plan social, on ne peut pas accepter qu'elle augmente les plus hauts salaires ou qu'elle accorde des retraites chapeaux. On stoppe la machine à augmenter les privilèges pendant trois ans, durée moyenne d'un plan de sauvegarde de l'emploi – j'ai malheureusement eu à en vivre sur mon territoire.
La commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS9 du rapporteur.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, les quartiles et les déciles ne rendent pas compte des écarts de revenus avec assez de précision. Quand on compare les premier et dernier déciles, on trouve un écart de 1 à 3. Pour calculer l'écart entre le SMIC et la moyenne des dirigeants du CAC 40 – de 1 à 240 –, il faut raisonner en centiles, voire en milliles.
Dans notre rapport d'information, nous proposions que, pour les entreprises de 5 000 salariés et plus, l'obligation de communiquer les informations relatives aux écarts de salaire soit étendue au centile. Pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, nous demandons le calcul de la rémunération moyenne par décile. C'est une mesure de transparence.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS15 du rapporteur.

Je propose que soit fixé par décret un écart maximal entre le nombre d'actions distribuées aux dirigeants, y compris les mandataires sociaux, et le nombre total d'actions gratuites distribuées au cours d'une même année. Ce ratio permettra d'éviter certaines dérives. À chaque fois que l'on a pris des mesures pour corriger les privilèges donnés aux très hauts dirigeants, ils ont trouvé des moyens de les contourner ; la distribution d'actions gratuites en est un. Il faut faire appliquer les lois qui ont été votées pour mettre fin aux scandales qui nourrissent la colère des Français.
La commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS11 du rapporteur.

Il va falloir rembourser, au moins en partie, la dette liée à la crise du covid-19 et cet amendement permettrait d'y contribuer.
Il propose d'abaisser de trois à deux plafonds annuels de la sécurité sociale le seuil maximal utilisé pour le calcul des primes de participation lorsque l'accord négocié par les partenaires sociaux retient le principe d'une distribution proportionnelle au salaire. C'est une manière de réduire l'indécence du privilège accordé à ces très hauts revenus – qui est défiscalisé.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement AS12 du rapporteur.

Il conviendrait au moins que l'appareil d'État fournisse à la représentation nationale, à la société civile et aux partenaires sociaux une cartographie des revenus et des ressources claire et transparente. Dans ce but, nous demandons que le Conseil national de l'information statistique (CNIS) établisse une étude statistique annuelle permettant d'établir des comparaisons pertinentes quant aux écarts de rémunérations au sein des entreprises.
Le manque de données actualisées et fiables est un frein à la résorption des inégalités salariales. Cette étude fournira des éléments détaillés par secteurs d'activité, par branches, par filières, par métiers et par tailles d'entreprises. Et j'ajouterais volontiers « par secteurs géographiques », car certains écosystèmes entretiennent la pauvreté et la précarité, tandis que d'autres cultivent, au contraire, l'accumulation des richesses.
Disposer d'une telle cartographie est une nécessité pour notre démocratie. Lorsque nous votons des mesures fiscales, lorsque nous distribuons le budget de la France, nous ne devons pas nous fonder sur des légendes, des rumeurs ou des ressentiments mais sur une vérité éclatante, qui crierait justice.

La transparence est effectivement la condition d'une prise de conscience. C'est vrai pour les rémunérations dans les entreprises, mais ce serait vrai aussi dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale. Une plus grande transparence permettrait de mettre en évidence des dérives ou des situations anormales. Je suis donc favorable à cet exercice de transparence.

J'y suis, moi aussi, tout à fait favorable. Je me demande seulement si c'est bien le CNIS qui doit se charger de cette mission. Ne faudrait-il pas auditionner ses représentants avant de la lui confier ?

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ces outils de la démocratie et de la transparence. Si nous avons pensé au CNIS, c'est parce qu'il dépend de l'INSEE : cela fait partie de ses missions et il faut seulement que l'État lui donne les moyens de les mener à bien. Si c'est la seule chose qui vous ennuie, je suis prêt à lancer une mission « flash » pour déterminer la meilleure manière de procéder.
En tout cas, il nous faut faire la lumière sur ces questions, afin que nos débats reposent sur des données certaines. En tout cas, malgré les difficultés, et grâce à la persévérance des administrateurs de l'Assemblée nationale, je vous assure que la mission d'information que j'ai menée avec Graziella Melchior a permis d'établir nombre de données très intéressantes : je vous invite à lire notre rapport. Pour ma part, j'ai eu des révélations. Que neuf Français sur dix gagnent moins de 4 000 euros, c'est une réalité, et la masse de redistribution est une découverte récente. Plonger dans ces données et les traiter est un formidable exercice, qui ouvre des possibles.
Je le répète aux libéraux qui sont ici : j'aime la conception libérale du XIXe siècle, celle qui crée la transparence sur la réalité du monde et qui laisse à chaque individu la capacité de peser sur lui, à partir du moment où il est informé. C'est ce libéralisme-là qui sous-tend ma proposition de loi.
La commission rejette l'amendement.
Article 4 : Gages financiers
La commission rejette l'article 4.

Margaret Thatcher disait qu'il n'y a pas d'alternative. Ma colère et mon engagement viennent de cette affirmation. Georges Orwell, que j'ai lu pendant le confinement – en français, car le petit paysan que j'étais n'a pas appris l'anglais au lycée agricole –, parlait, quant à lui, de « décence commune ». Cette proposition de loi, que je vous ai présentée au nom du groupe Socialistes et apparentés, avec tous les syndicalistes, les entrepreneurs de l'économie sociale et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à l'écrire est, je crois, un texte de décence commune. Je conclurai en citant à nouveau l'abbé Pierre : « Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. »
L'ensemble des articles de la proposition de loi et des amendements portant articles additionnels ayant été rejeté, l'ensemble de la proposition de loi est considéré comme rejeté par la commission.
La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.