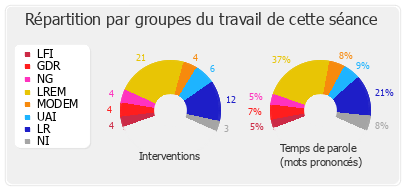Séance en hémicycle du mardi 3 avril 2018 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

L'Assemblée a été informée de la demande de constitution d'une commission spéciale présentée par le président du groupe de la Gauche démocrate et républicaine pour l'examen de la proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés.
Une opposition formulée par la présidente de la commission des affaires sociales est parvenue à la présidence. L'Assemblée sera donc appelée à statuer sur la demande de constitution d'une commission spéciale. Il appartiendra à la Conférence des présidents de fixer l'horaire de ce débat.

La parole est à M. Thierry Solère, pour exposer sa question, no 250, relative à l'exercice de la médecine par les médecins n'ayant pas soutenu leur thèse.

Madame la ministre des solidarités et de la santé, plusieurs dizaines de médecins français ne peuvent pas exercer sur notre territoire, faute d'avoir soutenu leur thèse de fin d'études dans les délais impartis.
Un décret de 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales a en effet imposé la soutenance de cette thèse au plus tard trois années après l'obtention du diplôme, afin de valider le diplôme d'État de docteur en médecine, indispensable pour exercer. Il dispose également que « les étudiants engagés en résidanat ont jusqu'au terme de l'année universitaire 2011-2012 pour valider l'intégralité de la formation théorique et pratique et soutenir leur thèse ».
Cette date butoir a été imposée à des professionnels qui, le plus souvent, exercent déjà, soit en qualité de remplaçants de médecin généraliste, soit comme internes en centre hospitalier. Ceux qui, pour des raisons personnelles, par manque de disponibilité ou même d'information n'ont pas soutenu leur thèse dans les temps sont aujourd'hui contraints de ne plus exercer. Ils ont pourtant les compétences et l'expérience indiquées.
Le gouvernement de Bernard Cazeneuve avait prévu d'assouplir ces dispositions afin de permettre aux médecins n'ayant pas passé leur doctorat de travailler à nouveau. La loi de 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a ainsi autorisé à ceux qui n'ont pas soutenu leur thèse de s'inscrire à l'université, après avis d'une commission placée auprès des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, et à condition qu'ils s'engagent à exercer en zone sous-dotée. Malheureusement, le décret en Conseil d'État qui devait définir les modalités d'application de ces dispositions n'est toujours pas paru.
Au regard de l'investissement, tant économique qu'humain, qu'ont représenté leurs neuf années de formation dans nos universités, il est aberrant de voir des médecins ainsi empêchés d'exercer. En effet, s'ils ne sont pas docteurs, ils sont pourtant bel et bien médecins.
Compte tenu de la désertification médicale que l'on peut observer dans une part croissante de nos territoires, nous ne pouvons nous passer d'un tel vivier de compétences. Dès lors, que compte faire le Gouvernement pour remédier à cette situation ?
Monsieur le député, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après l'avis rendu par le Conseil d'État en mars, la publication au Journal officiel du décret destiné à appliquer les dispositions ajoutées à l'article L. 632-4 du code de l'éducation par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est désormais imminente.
Il s'agissait de traiter la situation des anciens résidents de médecine qui, n'ayant pas soutenu leur thèse dans le délai requis de huit ans, se retrouvaient sans possibilité d'exercer la médecine, malgré leurs années d'études antérieures. Le décret détermine ainsi les conditions dans lesquelles les anciens résidents pourront être autorisés à s'inscrire à l'université en vue de soutenir leur thèse et d'obtenir ainsi le diplôme nécessaire à l'exercice de la médecine.
Bien entendu, il convient au préalable de s'assurer qu'ils disposent des compétences et connaissances requises. À cet effet, nous mettons en place une commission nationale composée de professionnels concernés et présidée par la direction générale de l'offre de soins. Elle pourra autoriser les candidats à s'inscrire à l'université pour soutenir leur thèse, le cas échéant après avoir suivi un complément de formation, en stage ou hors stage. Par ailleurs, les candidats devront s'engager sur l'honneur à exercer, une fois le doctorat obtenu, dans une zone sous-dotée. Une attestation d'installation délivrée par l'agence régionale de santé – ARS – de la région concernée permettra de certifier que cette condition est satisfaite.
Les personnes concernées devront déposer leur dossier avant la fin du mois de mai s'ils veulent s'inscrire à l'université pour l'année 2018-2019. Pour les années ultérieures, le dossier devra être déposé avant la fin du mois de février de l'année d'inscription.
J'espère, monsieur le député, avoir répondu à votre question.

La parole est à M. José Évrard, pour exposer sa question, no 262, relative à la situation sanitaire dans le Pas-de-Calais.

Madame la ministre des solidarités et de la santé, selon un sondage publié dans Le Figaro du 26 mars, les Français constatent une dégradation sensible de leur système de santé. La population de l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, notamment du territoire lensois, est particulièrement touchée par cette évolution négative.
Cet affaissement du système de santé s'effectue dans un contexte de déliquescence d'un territoire où l'emploi se raréfie, où la population se transforme et se fragilise, tant sur le plan physique que psychique, et où les anciennes solidarités de classe se diluent.
L'ancien bassin minier, où vit 1,2 million de personnes, connaît en effet depuis la fin des années quatre-vingt un déclin qui semble inexorable. Le taux de chômage, supérieur à la moyenne nationale, y est de 13 %, atteignant même 20 % dans certaines de ses zones, tandis que le taux de pauvreté se situe à 23,1 %, contre 18,2 % au niveau régional et 14,5 % au niveau national.
À partir de 1945, les luttes des mineurs et de leurs élus ont permis de mettre en place un modèle sanitaire original, constitué d'un réseau de centres médicaux de pointe, qui, adjoint au système de santé publique, assurait aux populations de l'ancien bassin minier à la fois prévention et soins performants.
L'arrêt de l'exploitation charbonnière et la fermeture des usines ont tout remis en cause. Quant à la réindustrialisation de l'ancien bassin minier, elle n'a pas été à la hauteur des enjeux.
Depuis l'explosion de ce modèle, une partie de la population, en augmentation, présente un état de santé dégradé. Les indicateurs de santé des hommes et des femmes du bassin minier sont très anormalement médiocres. Le constat est connu : la surmortalité dans le bassin minier par rapport à la moyenne régionale est particulièrement nette pour certaines maladies respiratoires, pour les maladies de l'appareil circulatoire et pour la plupart des cancers. À titre d'exemple, la mortalité des hommes par cancer y est 74,5 % plus élevée que la moyenne française.
Alors que dans un tel contexte, un soin particulier devrait être accordé à l'ancien bassin minier, un véritable plan de démolition du réseau médical et du service public de santé est appliqué. Je suis sensible à l'action des syndicats qui alertent l'opinion sur ce sujet.
Les fermetures de lits et les suppressions de postes se multiplient au fil des sévères coupes budgétaires imposées à l'hôpital public, alors même que les besoins de la population s'accroissent. Le plan triennal pour les années 2015 à 2017 de l'ancienne ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, a imposé des économies de 3 milliards d'euros sur trois ans. L'actuel gouvernement persiste : 1,6 milliard d'euros sont réclamés pour 2018.
Pour continuer de fonctionner, les hôpitaux s'endettent de façon inquiétante. En 2018, ils connaîtront un déficit historique de 1,5 milliard d'euros, soit une multiplication par trois en deux ans.
La création du futur pôle hospitalier à Lens apparaît sous-dimensionnée. Son ouverture est conditionnée à la réduction drastique des déficits des hôpitaux publics, entraînant des restructurations forcées sous couvert de mutualisation, des fermetures de services, des suppressions massives de lits, ainsi qu'une accélération des transferts d'activités entre établissements du groupement hospitalier de territoire – GHT – , selon une recommandation de l'Union européenne, pour aboutir finalement à une baisse de la qualité des soins, à de plus mauvaises conditions de travail des personnels, dans l'objectif de privatiser la santé.
La situation dans le bassin minier exige un plan d'une ampleur exceptionnelle pour restaurer la santé de la population et éviter une catastrophe humaine. En conséquence, je vous demande, madame la ministre, de bien prendre la mesure des enjeux de santé sur ce territoire. N'est-il pas urgent de décréter un plan ambitieux pour la santé, afin de ne pas ajouter du malheur au malheur que cette région connaît déjà ?
Monsieur le député, il est tout à fait exact que l'état de santé d'une population est en grande partie corrélé à sa situation socio-économique. Les indicateurs de santé de ce territoire, bien qu'en amélioration, restent effectivement préoccupants.
Au-delà de l'effet mécanique qui pourrait résulter de la hausse générale du niveau social de la population, l'amélioration des indicateurs de santé à long terme – on parle en effet là de générations – sur ce territoire passe par des changements significatifs des comportements, et donc par un investissement majeur dans les champs de la prévention et de la promotion de la santé.
En partenariat avec les acteurs locaux, l'État a décidé de se mobiliser de manière ambitieuse dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Le projet de reconstruction du centre hospitalier de Lens a abouti à l'annonce d'un financement de l'État de 102 millions d'euros. La projection du nombre de lits, qui est en effet en baisse, n'en correspond pas moins aux besoins actuels et futurs de l'hôpital en tant qu'établissement public de santé de recours pour le bassin minier du Pas-de-Calais dans le cadre du GHT de l'Artois.
L'objectif des GHT est en effet d'offrir à la population une meilleure organisation et une meilleure gradation des soins afin d'en garantir la qualité et la sécurité, mais aussi de consolider les activités et favoriser l'attractivité du territoire aux yeux des équipes médicales.
La réduction du nombre de lits, qui n'est pas spécifique au bassin minier, n'est pas le signe d'une diminution de l'offre, mais plutôt celui d'une politique volontariste de développement des soins ambulatoires qui entraîne la réduction des durées moyennes de séjour.
L'ARS est porteuse d'une stratégie très ambitieuse pour ce territoire. Dans le cadre du nouveau plan régional de santé, qui identifie le bassin minier dans son ensemble comme prioritaire, nous souhaitons déployer une stratégie commune avec l'assurance maladie, pour augmenter la participation aux dépistages des cancers – cancer du sein, cancer colorectal, et bientôt, cancer du col – sur des cantons ciblés, en croisant le taux de défaveur sociale et le taux actuel de participation pour chacun des dépistages. Nous comptons également déployer un programme d'actions de prévention et de promotion de la santé pour réduire le tabagisme, en particulier dans le Lensois et le Valenciennois.
Par ailleurs, la médiation en santé sera développée.
Monsieur le député, je n'ai pas le temps de faire la liste de toutes nos actions, mais je peux vous assurer que nous avons fait du bassin minier une action prioritaire de l'ARS.

La parole est à M. Éric Woerth, pour exposer sa question, no 239, relative au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

Madame la ministre des solidarités et de la santé, je souhaiterais évoquer à nouveau avec vous la situation du groupe hospitalier du sud de l'Oise – GHPSO – , issu de la fusion administrative des hôpitaux de Senlis et de Creil.
Lors de notre rencontre en janvier, nous avions déjà eu l'occasion de discuter de ce dossier avec les principaux acteurs concernés. Depuis, la situation a évolué plutôt positivement, puisque la commission médicale d'établissement a voté la semaine dernière, quasiment à l'unanimité, le projet médical et la répartition des activités. Je souhaitais donc, madame la ministre, que vous puissiez à nouveau vous exprimer sur trois points, en guise de confirmation.
Tout d'abord, j'aimerais vous entendre réaffirmer la vocation médicale et chirurgicale du site de Senlis. Les deux sites de Senlis et de Creil doivent en effet pouvoir bénéficier d'une répartition équilibrée et conforme aux besoins de la population, susceptible de confirmer la soutenabilité de ces hôpitaux : la maternité, la gynécologie et l'obstétrique seraient regroupées à Senlis et la chirurgie lourde concentrée à Creil, l'ambulatoire étant développé sur les deux sites. Pouvez-vous, madame la ministre, confirmer le soutien de l'ARS à une telle répartition ?
Le deuxième sujet concerne les urgences de Creil, qui sont dans un état pitoyable, indigne d'un hôpital. Il faut injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour les rénover, afin d'attirer des médecins qui, aujourd'hui, ne veulent probablement plus y travailler, tant leurs conditions d'exercice, comme d'ailleurs celles de l'ensemble du personnel, sont mauvaises.
Pour que les patients de cette zone, si proche de Paris, puissent être reçus dignement et en toute sécurité, il faut absolument rénover les urgences de Creil, et confirmer l'existence de celles de Senlis.
Dernier point : le recrutement. Cet hôpital a beaucoup de mal à recruter, quelle que soit la qualité du directeur, qui fait beaucoup pour essayer de clarifier les choses. Même si nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, nous avons besoin de recruter. Pour nous y aider, nous avons besoin du soutien plein et entier de l'ARS.
Ce beau projet a souffert de très nombreux allers et retours et d'indécisions. Aujourd'hui, alors que nous passons en mode action, nous avons besoin d'un soutien plein et entier. Je ne doute pas du vôtre, madame la ministre.
Monsieur le député, je vous confirme tout d'abord, selon les termes de notre discussion, la réorganisation de la maternité dont la partie obstétrique sera implantée à Senlis alors que l'unité périnatale sera maintenue sur le site de Creil.
S'agissant des urgences, comme vous le savez, le GHT dispose non seulement de deux autorisations d'exercer la médecine d'urgence, l'une sur le site de Creil et l'autre sur celui de Senlis, pour une prise en charge par une structure des urgences – SU – et une structure mobile d'urgence et de réanimation – SMUR – , mais aussi d'une autorisation de structure des urgences pédiatriques – SUP – exercée sur le site de Creil.
Le projet de réorganisation des services d'urgence de l'établissement, qui s'inscrit dans la logique d'amélioration de l'efficience des activités présentes sur les deux sites du GHPSO, n'est pas encore finalisé.
Il s'agit en fait d'une réorganisation complète des activités à Senlis et Creil. Ce projet repose en particulier sur la constitution d'une équipe médicale commune, qui n'existe pas actuellement.
Il convient de rappeler que, en application de la réglementation actuelle, l'autorisation de médecine d'urgence ne peut être accordée qu'à un établissement disposant de lits d'hospitalisation de médecine et d'un plateau technique de chirurgie, d'imagerie médicale et de biologie. Elle est aussi soumise à un seuil d'activité, fixé par arrêté, de 8 000 passages par an. Tout titulaire d'une autorisation de médecine d'urgence s'engage à fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour chacune des modalités d'exercice de l'activité.
Compte tenu de ces contraintes, je peux vous confirmer, monsieur le député, que le service des urgences du site de Senlis continuera d'être ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Mme Agnès Thill applaudit.

La parole est à Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, pour exposer sa question, no 256, relative au centre expert autisme du Limousin.

Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
À l'heure où le Gouvernement se prépare à annoncer le quatrième plan autisme, un rapport de la Cour des comptes indique que, dans notre pays, 90 % des enfants de moins de cinq ans atteints de troubles du spectre de l'autisme – TSA – sont exclus du bénéfice de l'intervention intensive précoce. Or cette intervention est reconnue scientifiquement comme une mesure de prévention efficace : elle améliore le pronostic tout au long de la vie et ses conséquences humaines et socio-économiques sont prouvées.
En Haute-Vienne, l'État a formalisé en 2014, dans un contrat investissement parcours – CIP – , des engagements permettant de créer un modèle expérimental en matière d'intervention intensive précoce. À Limoges, un centre expert a été chargé de faire bénéficier de cette intervention la totalité des enfants du département âgés de moins de cinq ans et atteints de TSA. Les résultats sont remarquables : après trois ans de fonctionnement, le taux de scolarisation a été multiplié par près de quatre. Cette expérimentation représente un modèle et un espoir pour tous les parents français.
Or ce modèle va être restructuré administrativement. Il s'agit d'étendre l'intervention intensive précoce à la Creuse et à la Corrèze. Un rapport émis il y a quelques semaines par l'agence régionale de santé – ARS – de Nouvelle-Aquitaine doit servir de base à cette évolution. Il ne semble toutefois pas de nature à apaiser les inquiétudes qui se sont manifestées ces derniers mois quant à la pérennité du dispositif global, alliant diagnostic et intervention précoce. L'absence de toute précision concernant le budget global afférent au nouveau cahier des charges laisse en effet craindre qu'un certain nombre d'enfants soient privés du bénéfice de l'intervention précoce sans que l'évaluation en santé et l'évaluation médico-économique prévues dans le CIP aient eu lieu.
Quelle assurance le Gouvernement peut-il donner concernant le respect des engagements pris en 2014 vis-à-vis d'un centre qui constitue un pôle d'excellence, dont les résultats pourraient servir de modèle dans le cadre du quatrième plan autisme ? L'engagement à une évaluation médico-économique pluridisciplinaire de l'expérimentation sera-t-il respecté ?
Je vous prie tout d'abord, madame la députée, de bien vouloir excuser l'absence de Mme Sophie Cluzel, malheureusement retenue ailleurs ce matin et qui m'a demandé de la remplacer.
Au lendemain de la journée internationale de l'autisme, je suis heureuse de vous rassurer, et de rassurer à travers vous l'ensemble des parents concernés du Limousin, sur l'avenir du centre expert autisme en Haute-Vienne, financé à titre expérimental, dans le cadre du plan autisme 2013-2017, par l'ARS du Limousin.
Ce dispositif expérimental a deux fonctions principales. Premièrement, le diagnostic précoce des enfants présentant un trouble du spectre autistique ; deuxièmement, la mise en oeuvre des interventions précoces, conformément aux recommandations de bonnes pratiques. Les financements attribués dans le cadre du CIP que vous avez mentionné s'élèvent aujourd'hui à 2,4 millions d'euros.
Comme vous l'indiquez, le dispositif a fait l'objet en 2017 d'une mission d'évaluation et d'appui mise en oeuvre par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine en concertation avec toutes les parties prenantes et les associations. Cette évaluation était particulièrement nécessaire, l'évaluation médico-économique que vous évoquez, prévue dans le cadre du CIP, n'ayant pas été produite par le centre expert.
La mission a fait part de ses constats et préconisations lors d'une réunion qui a eu lieu le 16 février dernier. Ils n'ont suscité aucun désaccord de fond parmi les participants. Les parents concernés ont été reçus et constamment écoutés par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, et ont pu, à l'issue de la réunion, transmettre par écrit leur contribution. C'est donc une démarche transparente et de co-construction qui a vu le jour par le biais de l'ARS.
Comme vous l'indiquez, il ressort globalement du rapport d'évaluation de l'ARS – qui ne deviendra définitif qu'au cours des prochaines semaines – que les résultats du centre expert sont indéniablement positifs s'agissant de la mise en oeuvre des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé – HAS – et de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux, l'ANESM, ainsi que de la qualité du service rendu aux parents et aux enfants.
Le rapport souligne toutefois que des améliorations significatives sont à engager, compte tenu des fragilités relevées dans la gestion du dispositif. Par exemple, les professionnels qui mettent en oeuvre les interventions précoces après le diagnostic n'ont pas moins de trois employeurs différents.
De plus, et peut-être surtout, la couverture territoriale du centre est insuffisante. Permettez-moi, madame la députée, de citer quelques chiffres : en 2016, seuls cinquante-sept diagnostics ont été émis par le centre, dont 77 % concernaient des enfants de Haute-Vienne, pour des enfants de moins de six ans, alors que le centre régional a aussi vocation à permettre aux enfants de Creuse et de Corrèze d'accéder au diagnostic précoce.
Par ailleurs, le centre est encore trop replié sur lui-même : il n'a pas pu mettre en oeuvre les coopérations attendues avec les autres partenaires financés sur fonds publics.
Enfin, la comparaison, du point de vue du coût de prise en charge, entre le centre et d'autres structures régionales n'est pas favorable au premier : le ratio financier d'un diagnostic par habitant, pour 100 000 habitants âgés de 0 à 29 ans, s'établit à 145 672 euros pour le centre expert du Limousin, soit près de deux fois celui de l'Aquitaine en général, qui est de 75 700 euros.
La performance et l'optimisation du fonctionnement du centre sont donc clairement en jeu. La qualité des prestations ne doit pas nous détourner de la nécessité de garantir l'efficience accrue de ce qui est financé sur fonds publics. Manifestement, ce centre peut et doit faire mieux compte tenu des moyens qui lui sont attribués.
Vous m'interrogiez sur les évolutions à court terme du dispositif expérimental. Je souhaite vous rassurer : il est bien prévu d'en poursuivre la mise en oeuvre. Ce dispositif reçoit à ce jour, je le rappelle, un financement très substantiel, mais non pérenne, et l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a bien prévu de pérenniser le financement des activités du centre en direction des trois départements de l'ancienne région Limousin. Cette nouvelle sécurisation financière devra permettre des améliorations significatives sur les points que je viens de citer et qui nécessitent un progrès, et favoriser la pleine inscription du centre dans les orientations de la nouvelle stratégie autisme au sein des territoires nationaux.

La parole est à M. Sébastien Jumel, pour exposer sa question, no 232, relative à l'éolien offshore.

Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot a déclaré il y a quelques mois : « Sur l'éolien en mer, on s'y est mal pris. »
S'agissant du projet offshore Le Tréport-Dieppe, on s'y est en effet mal pris avec le monde de la pêche, en imposant en 2013, pour l'implantation du parc éolien, la zone la plus riche en ressource halieutique de toute la Manche Est, une zone qui avait été rejetée lors du précédent appel d'offres. On s'y est aussi mal pris vis-à-vis du parc marin, qui s'est vu retirer sa compétence d'avis conforme au cours de l'année 2017 ; résultat : le parc a explosé en vol.
Mais le feuilleton ne s'arrête pas là. Voilà que le Gouvernement, par un cavalier législatif au Sénat, essaie de tordre le bras aux consortiums attributaires des marchés des six projets offshore en cours pour faire baisser le prix de sortie de l'électricité – comme si Bercy venait de découvrir que ce prix était élevé et que la technologie avait évolué depuis 2013 !
On a tous compris qu'il s'agissait là d'un coup de Trafalgar dans la négociation du prix de l'électricité. Deux issues sont possibles, désormais : ça passe ou ça casse. Dont acte.
Cela prouve, premièrement, que l'État, quand il le veut, n'est pas si désarmé que cela pour agir. Ce que nous demandons depuis plusieurs mois pour le projet éolien offshore Le Tréport-Dieppe était donc possible : on aurait pu profiter du vote du texte simplifiant les procédures de développement des énergies marines pour relancer un projet équivalent à l'actuel projet du Tréport dans une zone située plus à l'ouest, moins pénalisante pour la pêche.
Cela signifie, deuxièmement, que les déclarations faites par le Gouvernement à l'automne dernier, au Havre, sur la nécessité de développer les énergies marines en ayant une vision d'ensemble et en réglant au préalable les conflits d'usage attendent toujours une traduction concrète.
Le troisième enseignement de ce qui vient de se passer au Sénat est le suivant : la définition de l'intérêt général par le Gouvernement se limite pour l'instant à la maîtrise du prix de sortie de l'électricité.
Nous, nous craignons la double peine, c'est-à-dire, dans le cas du Tréport, un projet qui va faire très mal à notre pêche artisanale déjà menacée par le Brexit et par les effets collatéraux de la pêche électrique en mer du Nord, et, par ailleurs, des projets renégociés qui offrent aux consortiums la possibilité de faire de la question industrielle et des fameuses usines de Cherbourg et du Havre la variable d'ajustement des négociations avec le Gouvernement.
Mes questions sont donc simples. Dans la négociation avec les attributaires des parcs éoliens, la promesse d'une filière industrielle et le nombre d'emplois sont-ils à vos yeux négociables ? Les mesures compensatoires promises aux territoires – notamment en matière de formation et de pêche – sont-elles également négociables ? En résumé, les emplois industriels et l'avenir de la pêche entrent-ils pour vous dans le champ de l'intérêt général quand vous renégociez, et quelles garanties pouvez-vous – en Normand, monsieur le secrétaire d'État, donc en voisin – obtenir pour ce parc et pour le territoire que vous connaissez bien ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le député, je vais vous répondre non seulement en Normand, mais aussi en tant que membre du Gouvernement, s'agissant d'un dossier important pour nous tous, car nous avons besoin des énergies marines renouvelables pour réussir notre transition énergétique et notre nouveau mix électrique. Nous avons besoin de toutes les énergies renouvelables, mais particulièrement des éoliennes en mer. Or, aujourd'hui, vous le savez, leur nombre, en France, est modeste : il en existe une, expérimentale, sur flotteur, au large de Saint-Nazaire. Il s'agit donc, pour le Gouvernement, de libérer rapidement ces énergies.
Dans le cadre du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, nous vous avons proposé diverses mesures importantes à cette fin, notamment concernant l'installation. Si aucune éolienne ou presque n'est aujourd'hui installée en mer, c'est en raison de nombreux recours et de redoutables complications techniques, réglementaires ou contentieuses. Voilà pourquoi nous avons institué le « permis enveloppe », qui permet de faire appel à la technologie la plus récente même si le droit a été ouvert à une date assez ancienne. La logique est la même pour le raccordement aux postes terrestres pris en charge par Réseau de transport d'électricité – RTE.
Voilà pour les mesures de libération. Il se trouve qu'aujourd'hui le coût des énergies marines renouvelables diminue. Nous devrions tous nous en réjouir. Ainsi, en mer du Nord, un premier parc va voir le jour – l'appel d'offres vient de prendre fin – sans qu'un centime de subvention publique ait été versé. Cela signifie – pardonnez-moi, monsieur le député, de parler de marché – que l'offre rencontre la demande en ce domaine. C'est bien évidemment une bonne nouvelle pour vous comme pour nous.
L'enjeu de l'amendement déposé au Sénat a peut-être été mal compris ; je profite de votre question pour le réexpliquer. Il s'agit évidemment de permettre une négociation avec les porteurs de projet pour les six parcs choisis dans le cadre des appels d'offres lancés entre 2011 et 2013, afin que le coût des parcs – 2 milliards d'euros par an pendant vingt ans, soit 40 milliards d'euros – tende à se rapprocher des coûts du marché actuel, et ce en lien avec les technologies actuelles, conformément à ce que rend possible le permis enveloppe.
L'objectif n'est pas de réaliser des économies sur ces 2 milliards d'euros – je vous rassure immédiatement sur ce point – , mais de voir comment, avec cette somme, placée sur un compte d'affectation spéciale, installer davantage d'éoliennes que celles des six parcs déjà connus. C'est l'objet d'une négociation que nous tenons à mener avec les différents porteurs de projet au cours des semaines qui viendront ; en tout cas, des décisions seront prises rapidement.
Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux : nous sommes attachés à la filière industrielle dans ce domaine, en Normandie comme ailleurs. Le véritable enjeu pour nous est bien évidemment de rejoindre le marché ; trop de temps a été perdu. Il est vrai que l'amendement déposé au Sénat a pu créer quelque trouble, dont certains ont d'ailleurs dû faire leur miel ; mais j'espère vous rassurer sur ce point.

Je veillerai à ce que les promesses de contreparties pour le territoire, en particulier d'irrigation industrielle, soient tenues, notamment au Havre et à Cherbourg, ainsi que les promesses faites aux pêcheurs, puisque le consortium s'est engagé.

La parole est à M. Stéphane Buchou, pour exposer sa question, no 255, relative à la conformité des ouvrages de défense contre la mer.

Monsieur le secrétaire d'État, le dimanche 4 mars, un hommage aux vingt-neuf victimes de la tempête Xynthia a été rendu à La Faute-sur-Mer, en Vendée.
Au lendemain de cette sinistre nuit de février 2010 au cours de laquelle quarante-sept personnes au total ont perdu la vie, l'État s'est engagé avec détermination dans une longue et nécessaire série de travaux. En février 2011, le plan interministériel de prévention des submersions rapides était lancé, qui prévoyait le renforcement, à l'horizon 2016, de 1 200 kilomètres de digue à l'échelle nationale.
Mais deux ans plus tard, face à la complexité des procédures environnementales et techniques, les travaux accusaient un retard. Une mission d'appui a alors été imaginée, destinée à simplifier ces procédures et à accélérer la mise en oeuvre des programmes d'action de prévention des inondations.
En Vendée, où je suis élu, huit ans après le drame, seul un tiers des 75 kilomètres de digue a été réaménagé.
Qui peut se satisfaire d'un tel constat ? Qu'est-ce qui peut paralyser ainsi la volonté politique manifeste d'un État doté d'une organisation interne pourtant structurée ? Pourquoi l'État ne parvient-il pas à donner corps à ses intentions ?
Interroger n'est pas condamner ; ma recherche est celle de la lumière que produit l'intelligence collective. Face aux changements climatiques et aux risques encourus lors des catastrophes naturelles, la protection et la sécurisation des populations sont plus que jamais des enjeux prioritaires. La question reste urgente.
Un chantier législatif est donc probablement à imaginer pour harmoniser les différentes lois sur la protection de l'environnement. Mais l'envergure d'un tel projet repousserait les réponses très loin dans le temps alors que la nécessité s'impose à nous de les trouver sans délai. Face à de tels problèmes, les populations et les élus locaux reprochent son inertie à l'État, qui serait vite qualifié d'impuissant en cas de nouveau drame. Est-ce bien cela que nous voulons ? Dans l'esprit du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, quelles actions le Gouvernement compte-t-il entreprendre afin de rendre effectives des mesures de simplification pour accélérer les travaux de mise en conformité des ouvrages de défense contre la mer et ainsi assurer la sécurité de nos concitoyens ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le député, la succession, au cours de ces dernières années, de catastrophes liées à des phénomènes météorologiques particulièrement intenses a montré l'importance d'une intervention forte de la puissance publique – État et collectivités locales – en matière de prévention des inondations, en outre-mer comme en métropole – votre département en est une preuve. J'étais d'ailleurs, il y a quelques semaines, en Charente-Maritime pour étudier ces questions. Vous interpellez ce matin le Gouvernement sur les projets prévus suite aux événements tragiques de Xynthia. Comme vous l'indiquez, les projets prévus en 2011 n'ont pas tous abouti dans les délais espérés. En effet, les digues sont des projets très complexes et parfois contestés : choix du tracé, modalités techniques ou encore financement. Aujourd'hui, ces situations ont majoritairement pu trouver des réponses.
Mais cela s'est aussi fait grâce à des avancées notables, comme la création et la mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2018 de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations – GEMAPI – , qui a permis une refonte, pour plus d'efficacité, de la gouvernance concernant la protection contre les inondations et contre la mer, notamment s'agissant de la gestion des digues. Une place est laissée aux conseils départementaux qui, dans votre département comme dans les départements voisins, ont joué un rôle important dans ce domaine.
L'expérience des premiers projets établis après Xynthia a aussi montré la nécessité de simplifier les outils réglementaires. C'est pourquoi la réglementation en matière d'environnement a récemment évolué, principalement avec la création de l'autorisation environnementale unique pleinement en vigueur depuis le 1er juillet 2017. Cette réforme permet de regrouper dans une procédure unique les différentes procédures qui étaient précédemment prévues dans le code de l'environnement. C'est une étape majeure dans l'amélioration de la réalisation des projets.
Par ailleurs, je tiens à saluer la forte mobilisation des acteurs locaux suite à Xynthia. Sur le secteur qui a été touché, il y a trente et un programmes d'action de prévention des inondations – PAPI – et projets d'endiguement dans le cadre du plan national submersion rapide, pour un investissement total de 378 millions d'euros, auquel l'État, par le biais du fonds dit Barnier et du programme budgétaire « Prévention des risques » de mon ministère, contribue à hauteur de 150 millions d'euros.
Sur l'ensemble du territoire national, l'État et les collectivités locales sont fortement mobilisés dans une démarche globale de prévention des risques d'inondation, en veillant à améliorer la connaissance sur les aléas, les dispositifs de vigilance, l'information et la sensibilisation des populations, qui ne sera probablement jamais suffisante, ou encore à réduire la vulnérabilité des territoires, notamment des bâtiments publics et privés. La mobilisation de l'ensemble de ces leviers d'action est essentielle pour être à la hauteur des enjeux liés aux inondations. Il convient de rester pleinement mobilisés sur ces questions.

Je vous remercie pour votre réponse, monsieur le secrétaire d'État, et reste moi aussi mobilisé. J'ai bien entendu que les travaux devraient se réaliser. Nous serons, les uns et les autres, attentifs à ce qu'ils soient faits dans les meilleurs délais.

La parole est à Mme Frédérique Tuffnell, pour exposer sa question, no 252, relative à la réglementation des dispositifs de ridelles sur les véhicules lourds.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur le risque, pour la sécurité des usagers de la voie publique et des transports, des véhicules lourds équipés de ridelles. Comme vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, le matin du jeudi 11 février 2016 à Rochefort, un autocar de transport scolaire croisait un camion benne dont la ridelle latérale gauche était ouverte à quatre-vingt-dix degrés. Empiétant sur la voie opposée au moment du croisement, la ridelle a cisaillé tout le côté gauche de l'autocar, tuant six jeunes lycéens assis côté fenêtre. Plus de deux ans après ce drame, le traumatisme est encore lourd à Rochefort, d'autant qu'un nouvel accident mortel, lié à une ridelle ouverte, s'est de nouveau produit en novembre dernier dans ma circonscription, à Péré, tuant un père de trois enfants.
Le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre – le BEA-TT – a rendu son rapport qui formule deux recommandations. Dans la première, pour les nouvelles installations de ridelles sur les véhicules lourds, le BEA-TT propose de rendre obligatoire l'installation, dans la cabine, d'alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu'une ou plusieurs de ces ridelles ne se trouvent pas dans une position de déplacement sûre. Ces dispositifs existent déjà, mais ils ne sont installés qu'à la demande du client. Ces alarmes ne devront pas pouvoir être désactivées facilement par le conducteur et pourront être remplacées ou complétées par des dispositifs empêchant l'avancée du véhicule ou la limitant à une vitesse très faible, par exemple cinq kilomètres à l'heure. J'ajouterai qu'il faudrait inciter fortement les propriétaires actuels à équiper leur véhicule de tels dispositifs.
Dans sa deuxième recommandation, le BEA-TT préconise que le risque relatif au non-repli ou au non-verrouillage par le conducteur des dispositifs dépassant le gabarit normal du véhicule soit intégré dans le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel.
Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, pourriez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d'État, à quelle échéance vous envisagez de décider l'évolution réglementaire proposée par le BEA-TT ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la députée, Mme Borne, ministre chargée des transports, ne pouvant être présente ce matin, elle m'a chargé de vous répondre. Vous interrogez le Gouvernement au sujet des recommandations proposées par le rapport du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre à la suite des accidents tragiques que vous avez mentionnés. Comme vous le savez, le BEA-TT propose de rendre obligatoire l'installation, dans la cabine, d'alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu'une ou plusieurs des ridelles ne sont pas abaissées.
Cette disposition n'est pas imposée dans le cadre de la réglementation d'homologation des véhicules. Le cas échéant, elle devrait être introduite au niveau de la CEE-ONU, puis des règlements de l'Union européenne. Si cette solution paraît souhaitable, elle ne peut malheureusement être envisagée à très court terme. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement étudie actuellement d'autres voies et analyse les conditions juridiques d'une mise en oeuvre de cette préconisation dans le cadre de la réglementation nationale.
Par ailleurs, plusieurs organismes travaillent actuellement avec les professionnels du secteur sur les moyens de suivre cette recommandation. C'est le cas par exemple de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics qui souhaite travailler avec la profession des carrossiers pour étudier et installer des dispositifs de sécurité contrôlant le bon verrouillage des ridelles. Le Gouvernement vous tiendra informée des avancées sur ce sujet. Nous avons, comme vous pouvez le voir, pleine conscience des enjeux, et nous avons une pensée pour les victimes des catastrophes que vous avez rappelées.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour ces éléments. Je tiens à rappeler l'urgence de la situation. J'ai toutefois confiance dans le Gouvernement et j'espère que nous prendrons très rapidement les dispositions nécessaires.

La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour exposer la question no 234 de M. Raphaël Schellenberger, relative à la déviation de la RN 66 dans le Haut-Rhin.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, comme vous le savez, les conditions de circulation sur la route nationale 66 dans le département du Haut-Rhin sont souvent difficiles et nuisent considérablement au quotidien des habitants de la vallée de la Thur, qui utilisent cette route chaque jour pour se rendre sur leur lieu de travail, déposer leurs enfants à l'école ou rendre visite à leurs proches. Cet axe est central et indispensable, parce qu'il est unique. Mais il répond mal aux attentes des habitants de la vallée de la Thur. Les fortes perturbations subies au quotidien par les usagers de cette route soulignent l'urgence de trouver une solution durable grâce à une stratégie d'investissement permettant de faciliter enfin les conditions de transport des habitants de cette vallée.
Le projet de déviation de la RN 66 à Bitschwiller-lès-Thann et Willer-sur-Thur avait fait l'objet en septembre 2007 d'une première déclaration d'utilité publique. Cette déclaration, prorogée par arrêté préfectoral en 2012, est arrivée à échéance le 20 septembre 2017. Alors que le souhait d'une seconde prorogation de la déclaration d'utilité publique avait été exprimé en juin 2016, le Gouvernement n'a malheureusement pas souhaité proroger cette dernière au-delà du 20 septembre 2017. Pour autant, la situation ne peut pas rester en l'état. Des dispositions sont requises d'urgence. Une journée d'échanges et de réflexions, organisée le 22 février dernier, a rappelé, s'il en était besoin, les attentes fortes exprimées par les collectivités engagées dans ce dossier. Parce que la qualité du transport dans la vallée revêt une forte dimension économique mais également sociale, parce que le développement d'un territoire est intimement lié à la faculté de s'y déplacer dans de bonnes conditions, quelles alternatives crédibles à la déviation le Gouvernement entend-il proposer et quel en serait, compte tenu de l'urgence de la situation, le calendrier de mise en oeuvre ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le député, M. Schellenberger vous a confié sa question, Mme Borne m'en a confié la réponse, nous faisons, vous et moi, ce matin, oeuvre de bons messagers.
Sourires.
Le Gouvernement partage le constat de Raphaël Schellenberger quant à la nécessité d'agir avec efficacité et rapidité pour améliorer les conditions de circulation et réduire les nuisances sur la RN 66 dans le Haut-Rhin – assez loin du Touquet, il faut en convenir – , tout particulièrement dans la traversée de Bitschwiller-lès-Thann.
Concernant le projet de déviation de Bitschwiller-lès-Thann, le Gouvernement a décidé l'année dernière de ne pas proroger la déclaration d'utilité publique de l'opération, car les dernières études montraient une augmentation significative du coût du projet et mettaient en évidence des impacts environnementaux assez significatifs. De plus, aucun plan de financement permettant de couvrir l'intégralité du montant des travaux de l'opération n'avait pu être conclu avec les collectivités territoriales concernées.
Parallèlement, la ministre chargée des transports a demandé que les crédits prévus pour les études de la déviation de Bitschwiller-lès-Thann à l'actuel contrat de plan État-région soient réorientés en vue d'identifier des aménagements réalistes, afin de traiter les sections de la RN 66 les plus exposées aux nuisances et les plus concernées par les questions de sécurité routière, en particulier dans l'agglomération de Thann. Les élus concernés seront bien évidemment associés à cette démarche.
Par ailleurs, je tiens à vous annoncer que la ministre a demandé la réalisation d'une étude d'opportunité sur la faisabilité technique et financière d'une dénivellation du passage à niveau 22 au niveau de Thann. En parallèle de cette étude, des mesures à plus court terme, telles que la modification du système de feux ou l'optimisation du fonctionnement des barrières, pourront être mises en oeuvre rapidement afin d'améliorer le fonctionnement de ce passage à niveau. Je serai la semaine prochaine dans la circonscription de M. Schellenberger pour examiner le dossier Fessenheim. J'aurai donc l'occasion de rencontrer les différents élus qui ne manqueront sans doute pas de m'interpeller sur cette question.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour votre réponse. Il y a en effet peut-être des aménagements, peu coûteux, qui peuvent être réalisés rapidement. J'espère qu'ils permettront d'améliorer véritablement la situation et qu'ils ne seront pas une manoeuvre destinée à repousser des travaux plus conséquents mais nécessaires pour régler définitivement le problème.

La parole est à M. Christophe Naegelen, pour exposer sa question, no 260, relative aux infrastructures routières dans les Vosges.

Monsieur le secrétaire d'État, je profite de cette séance pour vous interpeller au sujet de deux routes très importantes pour les habitants de la troisième circonscription des Vosges dont je suis l'élu.
Tout d'abord, sur la RN 66, empruntée par plus de 10 000 véhicules par jour et qui traverse plusieurs centres-villes, dont celui du Thillot, nous avons eu à déplorer trop d'accidents mortels – deux encore au cours des deux dernières années. Il est nécessaire que l'État investisse pour remettre en état cette route couverte de rustines et tout simplement indigne. Toujours sur cet axe, la municipalité du Thillot veut remettre en état le carrefour où une jeune fille a perdu la vie il y a deux ans. Malheureusement, elle ne peut le faire seule, et l'État doit être à ses côtés. Monsieur le secrétaire d'État, les sommes en jeux sont dérisoires et l'objectif n'a pas de prix. Pouvez-vous vous engager à ses côtés ?
Depuis de nombreuses années, on nous promet une déviation entre Ferdrupt et Saint-Maurice-sur-Moselle, dans la continuité de celle de Rupt-sur-Moselle, avec toujours les mêmes objectifs : sauver des vies et désenclaver nos territoires – deux objectifs que le Gouvernement semble aussi vouloir poursuivre. Il est nécessaire d'inscrire ce projet, pour lequel un arrêté d'utilité publique vient à nouveau d'être signé, dans le prochain contrat de plan État-région. Pouvez-vous vous engager dans ce sens ?
Enfin, je tenais à aborder la question de la circulation sur la RN 57, particulièrement au niveau de la montée de La Demoiselle. Elle progresse depuis des années dans cette zone, au point d'atteindre désormais plus de 15 000 véhicules par jour, dont un nombre très important de poids lourds. La pollution sonore est extrêmement nocive pour les habitants, et la mise en place de murs antibruit serait nécessaire. Là encore, l'investissement n'est pas énorme mais il serait salutaire pour la population.
Monsieur le secrétaire d'État, alors que les territoires ruraux ont besoin de signaux positifs montrant que vous ne les oubliez pas, et au moment où vous cherchez des solutions pour réduire la mortalité routière, je vous propose des exemples concrets et vous suggère des actions concrètes.

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le député, votre question porte sur l'état des infrastructures routières dans les Vosges, et plus particulièrement de la RN 57 et de la RN 66. Je connais votre attachement à votre territoire et votre attention à ce sujet. Vous rappelez à juste titre que ces axes sont importants pour la mobilité des Vosgiens et indispensables au désenclavement de la région. Pour ce qui est des nuisances dues au bruit en bordure de la RN 57, je tiens à rappeler que l'État s'est engagé dans le cadre de l'actuel contrat de plan État-région sur un programme de réduction des nuisances sonores le long des routes nationales et autoroutes non concédées en Lorraine. À ce titre, une enveloppe conséquente de plus de 20 millions d'euros, intégralement financée par l'État, est inscrite au contrat pour l'installation de protections phoniques. Cette enveloppe recouvre de multiples opérations, parmi lesquelles la réalisation de protections phoniques à Thaon-les-Vosges, le long de la RN 57, où les travaux ont débuté. Étant donné la multiplicité des priorités régionales, les protections phoniques dans le centre de Saint-Nabord, classé en « point noir bruit », n'ont pu être à ce stade incluses dans le programme retenu dans le cadre de cette enveloppe.
Vous citez par ailleurs un besoin de protection phonique au lieu-dit La Demoiselle sur la commune de Saint-Nabord, mais le plan de prévention du bruit dans l'environnement ne le classe pas en « point noir bruit ». Des travaux de protection phonique à cet endroit n'ont donc pas été programmés à ce stade.
Autre sujet : les derniers accidents répertoriés sur la RN 66 sont situés dans les traversées d'agglomération. Comme vous le savez, les actions permettant d'améliorer la sécurité routière relèvent de la compétence des communes. La direction interdépartementale des routes se tiendra à leur disposition pour apporter son expertise dans la conduite de ces actions et, le cas échéant, un soutien en ingénierie.
Enfin, s'agissant de l'état des chaussées de la RN 66 entre Ferdrupt et Bussang, sur les 17 kilomètres de l'itinéraire, 11 sont en traversées d'agglomération, qui bénéficient du programme d'intervention pluriannuel. Les principaux travaux prévus cette année sont situés dans la traversée de Ramonchamp. Sachez également que la réhabilitation des chaussées dans la traversée de Fresse, l'entretien des chaussées à la jonction avec la RN 57 et en entrée d'agglomération de Ferdrupt, ainsi que l'entretien des chaussées au col de Bussang auront lieu entre 2019 et 2021.

Après cette belle visite du département des Vosges, la parole est à M. Christophe Naegelen.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse, mais elle laisse plusieurs points en suspens. S'agissant de la RN 57, c'est entre Saint-Nabord et Plombières – zone située au démarrage d'une côte – qu'il est impératif d'installer des murs anti-bruit. La population a monté un collectif et il est important de le soutenir.
Pour ce qui est de la RN 66, j'aurais souhaité vous voir évoquer la déviation qui nous est promise. Le préfet a prorogé l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, mais j'aurais voulu savoir où en était la réflexion du Gouvernement quant à cette déviation et au moment où elle pourrait être inscrite dans le contrat de plan État-région.
Enfin, vous avez raison à propos du carrefour du Thillot : la municipalité prendra en charge une partie des travaux, mais comme l'endroit est situé le long d'une route nationale, l'État doit également assumer ses responsabilités.

La parole est à M. Adrien Quatennens, pour exposer sa question, no 231, relative l'ouverture du service public ferroviaire à la concurrence.

Ma question s'adresse à Mme la ministre chargée des transports. En ce jour où démarre la mobilisation, je souhaiterais l'interroger sur l'application des directives européennes contenues dans le quatrième paquet ferroviaire de la Commission, qui prévoient la généralisation, à brève échéance, de l'ouverture du secteur à la concurrence. Ce que le Gouvernement appelle une réforme de la SNCF n'est en fait que la suite de la remise en cause du service public ferroviaire et de la libéralisation du secteur. Ce mouvement est entamé depuis la loi du 13 février 1997 adoptée sous Alain Juppé pour transposer la directive européenne du 21 juillet 1991. Celle-ci prévoyait la séparation entre le réseau et l'exploitation, et ouvrait surtout aux opérateurs privés un droit d'accès au réseau. La succession des paquets ferroviaires européens en 2001, 2004 et 2007 a accéléré le processus. Ils ont été appliqués en France par les gouvernements Raffarin, Villepin et Fillon. C'est dans leurs pas que s'inscrit l'action du Gouvernement actuel : il s'agit d'appliquer le quatrième paquet ferroviaire de 2014 et d'achever la libéralisation du secteur à l'horizon 2020 pour les lignes à grande vitesse et 2023 pour le réseau dit secondaire, qui contribue à la cohésion territoriale.
Pourtant, rien ne justifie objectivement l'ouverture à la concurrence. Le Gouvernement entend l'étendre au transport de voyageurs alors qu'aucun bilan n'a été tiré de la libéralisation du fret en France. Au Royaume-Uni, pays ayant le plus rapidement appliqué ces directives européennes, deux usagers sur trois sont pour la renationalisation. Ils condamnent les hausses de tarifs et la baisse de la qualité du service des opérateurs privés : 27 % en moyenne d'augmentation du prix des billets, mais près de 80 % de trains en retard sur plusieurs lignes depuis l'ouverture à la concurrence. Dès lors, ma question est la suivante : quelles sont les motivations réelles de ce Gouvernement qui n'envisage finalement cette réforme que sous le prisme de sa foi absolue dans le dogme du marché libre ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur Quatennens, vous n'allez pas découvrir ce matin que je ne suis pas d'accord avec votre approche, qu'on a beaucoup commentée dernièrement. Plutôt que de citer l'exemple britannique, pourquoi ne pas évoquer l'exemple allemand ? En Allemagne, l'ouverture à la concurrence date de plus de vingt-cinq ans. La Deutsche Bahn reste une grande entreprise allemande ; contrairement à ce qu'on entend parfois sur les ondes, elle n'a pas été privatisée. La qualité du service s'est fortement améliorée et le nombre de voyageurs a augmenté, ce qui est très vertueux en matière de transition écologique. Nous considérons donc que c'est un exemple à suivre.
En France, l'ouverture à la concurrence a déjà été effectuée pour les transports internationaux de voyageurs et le fret. Elle présente de nombreux intérêts, donc à part un dogme de votre part – celui de vous y opposer quoi qu'il arrive – , je ne vois pas bien ce qui vous oblige à faire cette déclaration ce matin. L'ouverture à la concurrence a été décidée en 2015, sous le quinquennat précédent ; il s'agit pour nous de l'appliquer dans la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux, afin de faire basculer dans la loi des éléments ayant fait l'objet d'un accord entre les représentants des différents syndicats et le Gouvernement. Pour les lignes régionales, l'horizon a été fixé à décembre 2019 ; pour les lignes TGV, nous travaillons également en bonne intelligence avec les partenaires sociaux. Je comprends que pour des raisons idéologiques, vous ne soyez pas d'accord, mais pour des raisons pragmatiques, vous devez reconnaître que le modèle allemand, dans ce domaine, n'est pas à rejeter.

Il est intéressant que vous citiez le modèle allemand car en Allemagne, l'État a repris la dette de l'opérateur. Le Gouvernement s'y engage-t-il ce matin ?
Nous n'avons jamais dit que nous ne le ferions pas !
Ne nous faites pas de procès d'intention !

Derrière l'intention louable d'améliorer le service, affichée sur les ondes – pour reprendre votre expression – , vous vous livrez à une traduction zélée des directives européennes qui doivent aboutir à l'ouverture à la concurrence. Mais, monsieur le secrétaire d'État, nul n'est à ce jour capable de faire la démonstration du lien entre ouverture à la concurrence et amélioration du service. On peut se jeter à la figure des exemples contradictoires sans pour autant aboutir à une conclusion. La réalité, c'est que pour satisfaire l'Europe des idéologues, vous défaites la France, ce qu'elle est – notamment le service public du rail. Aujourd'hui, dans le contexte de crise écologique, nous avons besoin d'un État stratège ; nous avons plus que jamais besoin d'un pôle public du rail qui nous permette de faire de grands choix. L'application de ces directives va lourdement handicaper notre pays face aux défis qui se dressent devant lui. Chacun doit comprendre ce matin que les cheminots mobilisés ne se battent pas pour eux-mêmes ou pour leur statut en particulier, mais bien pour un modèle et pour l'intérêt général.

La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour exposer sa question, no 238, relative la ligne Paris - Amiens - Boulogne-sur-Mer.

Monsieur le secrétaire d'État, ma question s'adresse à Mme la ministre chargée des transports et concerne la situation de la ligne de chemin de fer entre Paris, Amiens et Boulogne-sur-Mer. Avant toute chose, je veux associer à ma question les élus de la côte picarde et de la Côte d'Opale, ainsi que les acteurs économiques et les usagers réunis au sein de l'association Ferelec que je copréside avec le maire d'Abbeville. Lors de notre dernière réunion, qui a fait suite à plusieurs rencontres sur le terrain et à une grande enquête menée pendant plusieurs mois, il m'a été demandé de vous interroger sur trois points.
Tout d'abord, les usagers de cette ligne sont excédés par les retards répétés, quand ils ne renoncent pas à prendre le train tant il est devenu courant que celui-ci n'arrive pas à l'heure. Problème de matériel, de personnel : à chaque retard, il y a une explication différente, mais il faut surtout comprendre que cette ligne Intercités est le cadet des soucis de la SNCF et du ministère des transports, interpellés à plusieurs reprises sans succès.
Une lueur d'espoir est apparue quand l'État a enfin conclu un accord avec la région pour le remplacement du matériel roulant. En mars 2017, une convention promettait que l'État verserait à la région 400 millions d'euros pour l'achat de nouveau matériel et 15 millions d'euros par an pour l'exploitation des lignes. Mais rien n'a été fait et certains trains, datant parfois de 1975, continuent à circuler alors qu'ils sont très abîmés et très dégradés.
Enfin, malgré l'inscription au contrat de plan État-région de l'électrification de la ligne reliant Amiens à Rang-du-Fliers, longue de 83 kilomètres, ce projet est mis à mal par le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, COI, et le rapport Spinetta. Pour les habitants de la Côte d'Opale et de la côte picarde, pour les entreprises, pour l'essor de l'économie touristique, il est pourtant indispensable que l'électrification déjà réalisée entre Boulogne et Rang-du-Fliers soit achevée. Les usagers espèrent en outre, demain, bénéficier d'un accès à Roissy et à la gare de l'Est, beaucoup moins encombrée que la gare du Nord, une fois le barreau entre Creil et Roissy réalisé. Avec mes collègues – en particulier les députés Emmanuel Maquet et Jean-Pierre Pont – , nous souhaitons savoir si l'État va enfin se mobiliser en faveur de cette ligne et si les engagements pris pour le remplacement du matériel roulant et l'électrification de la ligne seront tenus.

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur Fasquelle, nous voilà désormais dans le Pas-de-Calais, et non plus en Alsace ! Vous avez raison : l'exploitation du service de trains d'équilibre du territoire Paris - Amiens - Boulogne-sur-Mer rencontre des difficultés et la qualité du service peine à se maintenir dans la durée à un niveau acceptable. Les causes sont multiples, mais principalement liées à l'obsolescence du matériel roulant. L'État a programmé le renouvellement de l'ensemble du matériel de la liaison entre Paris et Boulogne via l'acquisition de dix rames Alstom Regiolis. Cet engagement fait partie de l'accord conclu entre l'État et la région Hauts-de-France, présidée par Xavier Bertrand, le 16 mars 2017. L'accord prévoit également le financement par l'État du renouvellement du matériel roulant des autres lignes reprises à hauteur de 250 millions d'euros, ainsi que sa participation à leurs coûts d'exploitation. Cela représente pour l'État un effort d'investissement exceptionnel dans les années qui viennent. En attendant, je peux d'ores et déjà vous informer que le déploiement des dix rames Alstom Regiolis sur la ligne Amiens - Boulogne-sur-Mer devrait avoir lieu entre mars et septembre 2019.
Pour ce qui est du projet d'électrification de la ligne Amiens - Abbeville - Rang-du-Fliers, le Conseil d'orientation des infrastructures a en effet eu l'occasion d'examiner cette opération, représentant un coût de l'ordre de 220 millions d'euros, dont une partie est inscrite dans le contrat de plan État-région des Hauts-de-France. Le Conseil a considéré qu'« un prolongement des TGV jusqu'à Boulogne est aujourd'hui peu réaliste au regard des coûts d'exploitation de ce type de train sur ligne classique ». Le Gouvernement a pris acte des conclusions du COI, mais je précise qu'il ne s'agit que de recommandations qui n'engagent pas notre position. Les recommandations du Conseil font l'objet de consultations avec les élus en vue d'élaborer le volet programmation des infrastructures du projet de loi d'orientation des mobilités, qui sera examiné prochainement par le Parlement.
En tout état de cause, le ministère des transports n'ignore pas l'importance de cette ligne pour la vitalité des territoires traversés et je tiens à réaffirmer la détermination du Gouvernement à redonner la priorité aux transports du quotidien et au désenclavement des territoires. Dans le cadre de l'écriture du projet de loi, le cabinet d'Élisabeth Borne se tient à votre disposition et à celle des élus que vous représentez pour étudier de près la question de cette infrastructure après la remise du rapport.

Plutôt que de prendre l'avion, le Président de la République devrait prendre le train pour venir en week-end au Touquet.
Pas d'attaques personnelles !
Sourires.

Je suis certain qu'il deviendrait un soutien infaillible de la rénovation du matériel roulant ! Je prends acte de ce que vous nous dites, mais du côté de la région, on est impatient de voir l'État respecter son engagement. J'espère qu'il le fera, et rapidement, car on a besoin de ce nouveau matériel.
En ce qui concerne l'électrification, je rappelle qu'il s'agit d'un engagement de l'État, inscrit dans le contrat de plan État-région ; or Mme la ministre chargée des transports a annoncé que les engagements qui figurent dans ce contrat seraient tenus. Nous voulons cette électrification, car elle permettrait de réduire considérablement les temps de trajet.
Le barreau ferroviaire Creil-Roissy étant achevé, cela donnerait en outre à notre région un accès à l'aéroport de Roissy. Ce serait bénéfique au développement de l'économie du sud de la Côte d'Opale et du nord de la côte picarde, qui est principalement touristique. C'est, pour nous, un enjeu majeur – sans parler de l'accès à la gare de l'Est, puisque l'on sait combien, à l'heure actuelle, la gare du Nord est encombrée.
Nous continuerons donc à nous battre à la fois pour obtenir du nouveau matériel roulant, et pour l'électrification de cette ligne.

La parole est à M. Hugues Renson, pour exposer sa question, no 249, relative à l'accueil des enfants sourds dans les unités localisés d'inclusion scolaire à Paris.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, des dizaines d'enfants sourds parisiens attendent la rentrée prochaine avec beaucoup d'inquiétude quant à la poursuite de leur cursus dans l'enseignement secondaire classique. Parmi ces enfants, il y a Gabriel, âgé de quinze ans, qui est présent dans les tribunes : je le salue.
Gabriel est atteint d'une maladie génétique rare appelée syndrome d'Usher. Il souffre d'une surdité profonde bilatérale associée à une déficience visuelle progressive ainsi qu'à une absence totale d'équilibre. Son courage et ses efforts lui ont permis de poursuivre une scolarité ordinaire, mais rien n'aurait été possible sans les ULIS, les unités localisées d'inclusion scolaire.
Au lycée, toutefois, Gabriel et les nombreux enfants sourds parisiens dont j'ai parlé n'auront pas les mêmes perspectives que les enfants entendants. En effet, à Paris, un enfant sourd ou malentendant qui souhaite poursuivre sa scolarité dans un lycée général n'a que très peu de possibilités. Deux solutions seulement s'offrent à lui : soit il rejoint le lycée Morvan, un établissement privé sous contrat où les enfants souffrent tous de troubles de l'audition ou du langage, soit il intègre le lycée Rodin, qui ne permet pas de suivre un cursus général, et où les enfants atteints de limitation auditive sont contraints de maîtriser la langue des signes.
Pourtant l'inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire a été consacrée comme un droit, tant au niveau international qu'au niveau national. Sur le plan international, la Déclaration de Salamanque de 1994 exhorte tous les gouvernements à « adopter [… ] le principe de l'éducation intégrée, en accueillant tous les enfants », y compris ceux ayant des besoins éducatifs spéciaux, « dans les écoles ordinaires. » Au niveau national, la loi du 11 février 2005 a fixé un principe clair concernant la scolarisation des enfants handicapés dans les écoles ordinaires : « Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. » Tout enfant sourd ou malentendant a donc le droit de poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire comme tous ses camarades.
Monsieur le ministre, est-il acceptable qu'en 2018, un enfant, quel que soit son handicap, ne puisse pas poursuivre sa scolarité comme les autres ? Pouvez-vous nous dire ce que le Gouvernement compte faire pour favoriser l'accueil des enfants sourds qui ne sont pas scolarisés dans des lycées inclusifs à Paris, comme sur l'ensemble du territoire français ?
Monsieur le député, je vous remercie pour cette question qui met l'accent sur les grands enjeux de l'école inclusive. Je vous répondrai en plusieurs étapes, pour bien cerner les différents aspects de cette question importante.
C'est d'autant plus opportun que cette semaine est dédiée à la sensibilisation à l'autisme, comme le symbolise le ruban bleu que je porte au revers de ma veste : c'est l'occasion d'évoquer les enjeux relatifs à l'inclusion de tous les élèves à l'école. Votre question, précisément, concerne l'une des dimensions de l'école inclusive, à savoir l'accueil des élèves atteints de surdité. Cela fait un certain temps que l'éducation nationale y travaille, dans une perspective de progrès.
Les unités localisées pour l'inclusion scolaire sont des dispositifs de scolarisation destinés aux élèves en situation de handicap. Elles leur offrent la possibilité de poursuivre, en inclusion, des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins, et leur permettent d'acquérir des compétences sociales et scolaires. Vous avez souligné, à juste titre, le rôle important qu'elles jouent pour la scolarisation de Gabriel comme de tant d'autres enfants.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, au sein des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, a pour mission de définir le parcours de formation de l'élève dans le cadre de son projet de vie. Elle peut se prononcer pour une orientation en ULIS au regard de ses compétences scolaires, ce qui permet à l'élève de bénéficier de temps de scolarisation dans sa classe de référence et de temps de regroupement en ULIS avec l'accompagnement de l'enseignant coordonnateur de l'ULIS.
Elle peut aussi statuer sur une scolarisation en milieu ordinaire avec ou sans accompagnement humain. Enfin, dans certaines situations, elle propose à la famille une scolarisation dans une unité d'enseignement d'un établissement spécialisé. Sa décision est prise au plus près des besoins éducatifs particuliers de l'élève, quel que soit son handicap – sourd appareillé ou non.
Dans le second degré, le nombre d'ULIS est passé de 1 548 à 3 570 entre 2008 et 2016, soit une augmentation de 130 %. À l'occasion du comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 20 septembre dernier, la création de 250 ULIS en lycée – établissements d'enseignement général et technologique et établissements professionnels confondus – a été annoncée d'ici 2022. Cette décision aura, à n'en pas douter, un effet bénéfique pour les personnes que vous avez mentionnées.
L'académie de Paris, quant à elle, s'est engagée dans une démarche d'évolution : cinq ULIS en lycée professionnel ouvriront ainsi à la rentrée 2018, dans des établissements qui offriront une plus grande diversité de formations avec une meilleure répartition géographique.
Pour agir au plus près des besoins des élèves, nous avons aussi créé la cellule « Aide handicap école », que l'on peut joindre en composant le 0810 55 55 00. Cette cellule nous permet de définir, avec les parents, le parcours le plus adapté pour leurs enfants. Enfin je souligne l'importance des évolutions technologiques, notamment concernant les problèmes d'audition : nous travaillons avec les chercheurs pour que les élèves soient le plus possible intégrés dans les lycées ordinaires.

Merci, monsieur le ministre. Je rappelle que l'ensemble composé de la question et de la réponse ne doit pas dépasser six minutes. Il faut tenir le rythme !

La parole est à M. Julien Borowczyk, pour exposer sa question, no 257, relative à la carte scolaire dans la Loire.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, ma question concerne la définition de la carte scolaire, pour la rentrée 2018, dans ma circonscription, la sixième du département de la Loire.
Je ne conteste pas qu'il soit nécessaire de dédoubler les classes de cours préparatoire – CP – et de cours élémentaire première année – CE1 – dans les réseaux d'éducation prioritaire – REP – et les réseaux d'éducation prioritaires renforcés – REP+. Les apprentissages fondamentaux dans ce cycle doivent se faire dans les meilleures conditions possibles : à ce titre, le dédoublement des classes ne peut être que plébiscité.
Les professeurs des écoles ont un rôle fondamental, en REP+, pour éviter le décrochage scolaire qui apparaît dès le début de ce cycle, car ce qui n'est pas acquis en CP et en CE1 le sera difficilement par la suite. Or ce retard cause des décrochages, conduit certains jeunes à abandonner leur scolarité, ce qui a des conséquences néfastes pour leur insertion sociale et professionnelle à l'âge adulte.
Mais ce dédoublement ne doit pas se faire au détriment d'autres zones géographiques. Dans ma circonscription l'élève de CP de Saint-Paul-de-Vézelin, de Roche, de Verrières-en-Forez, de Lérigneux, de Dancé, de Palogneux, de Saint-Just-en-Bas, a les mêmes devoirs mais aussi les mêmes droits que l'élève en REP+ : c'est l'égalité, valeur qui nous est chère dans cet hémicycle, que je veux défendre. On ne peut pas balayer, d'un revers de la main, des postes dans des zones rurales, qui plus est de montagne.
Or c'est ce qui se passe dans ma circonscription, qui est à 80 % rurale : quinze postes y seront supprimés, pour une seule création. Je tiens à souligner que les élus des zones rurales de montagne ont fait, depuis plusieurs années, des efforts considérables, notamment par le regroupement pédagogique intercommunal. Ils ont dû mettre aux normes leurs établissements et réorganiser les transports scolaires.
J'ai été porté à la députation par les électeurs de ma circonscription pour en finir avec le jeu sordide des calculs, de l'opposition stérile de la France rurale à la France des villes. Nous devons rétablir la confiance dans le système éducatif de notre pays, qui doit faire face à de lourds enjeux – mais nous pensons que ces mutations ouvriront de nouvelles perspectives pour la libération et l'épanouissement des individus.
Je souhaite que les dispositions figurant à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985, dite « loi Montagne », soient appliquées non seulement aux communes considérées comme communes de montagne au sens de cette loi, mais aussi aux zones de piémont des monts du Forez et des monts du Lyonnais. Cette loi dispose que des modalités spécifiques d'organisation scolaire doivent être fixées dans les communes concernées, notamment en ce qui concerne les seuils d'ouverture et de fermeture de classes, au regard des caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transport scolaire.
Monsieur le député, la préparation de la rentrée 2018 est marquée par un soutien budgétaire incontestable en faveur du premier degré. Je vous rappelle les données générales de cette rentrée : 3 881 emplois de professeurs des écoles seront créés, alors même qu'il y aura 32 657 élèves de moins dans le premier degré.
Je précise que si la baisse démographique avait été appliquée strictement, 1 438 postes auraient été supprimés. C'est donc une politique d'une ampleur inédite : même si certains, dans l'opposition, prétendent le contraire, ces chiffres sont incontestables.
Cet effort budgétaire se traduira concrètement, dans votre circonscription, par un meilleur taux d'encadrement dans le premier degré dès la rentrée prochaine : le nombre de professeurs pour 100 élèves sera de 5,55 à la rentrée 2018, contre 5,46 à la rentrée 2017. Pour mémoire, ce ratio était de 5,2 à la rentrée 2012. Le niveau que nous atteindrons sera ainsi un record historique : il ne faut pas dissimuler cette réalité, que nous aurons le meilleur taux d'encadrement à l'école primaire que notre pays ait jamais eu.
Ce taux d'encadrement dans les écoles primaires sera encore plus élevé dans les départements ruraux que dans les autres départements.
Je dis cela en présence de M. le ministre de la cohésion des territoires, qui vient d'arriver dans l'hémicycle.
Nous travaillons beaucoup, ensemble, sur cette question : je ne peux donc pas laisser dire que nous ne serions pas attentifs aux départements ruraux. C'est tout le contraire : j'étais encore la semaine dernière dans le Cantal pour le dire. Il n'y aura pas une seule fermeture d'école à la rentrée prochaine dans toute la région Auvergne, qui est pourtant très rurale. Faisons très attention à ne pas accréditer de fausses idées.
Dans chaque département, je le répète, il y aura davantage de professeurs par élève à la rentrée 2018. S'agissant plus particulièrement du département de la Loire, 15 emplois seront créés malgré une baisse prévue de 310 élèves. Le nombre de professeurs pour 100 élèves dans le département sera ainsi de 5,38 à la rentrée 2018 contre 5,33 à la rentrée 2017.
Pour combattre les difficultés scolaires, il faut agir à la racine. Le choix a ainsi été fait de cibler les efforts sur l'éducation prioritaire où les besoins sont le plus importants, en desserrant les effectifs de manière significative, avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 et un objectif de douze élèves par classe. Cette mesure ambitieuse sera intégralement réalisée par des créations de postes. Il ne s'agit pas de supprimer des postes en zone rurale pour en créer en zone urbaine !
Par ailleurs les dédoublements de classes en réseau d'éducation prioritaire peuvent parfaitement avoir lieu dans des toutes petites villes, voire en zone rurale. Nous ne diminuerons pas les capacités de remplacement ; nous sommes même en train de les améliorer : la part des postes consacrée au remplacement est estimée, pour la rentrée prochaine, à 9 %. Enfin, nous n'avons pas gagé le dédoublement sur la fermeture d'autres classes. C'est donc un effort significatif en faveur de l'école primaire.
Les fermetures de classes restent toutefois possibles : il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, car la carte scolaire doit tenir compte de la démographie. Ces fermetures sont décidées sur la base d'éléments objectifs, partagés avec les élus, comme la constitution de regroupements pédagogiques intercommunaux – vous avez évoqué cette formule – , la mise en oeuvre de projets territoriaux, ou l'incapacité à maintenir des conditions d'enseignement minimales pour les élèves, lorsque leur nombre est trop faible pour atteindre la masse critique.
Le ministère de l'éducation nationale a proposé aux élus des départements ruraux ou de montagne d'engager une démarche contractuelle pluriannuelle, avec des ETP supplémentaires possibles chaque fois qu'un de ces contrats est conclu. J'ai en outre confié une mission au sénateur Alain Duran pour améliorer encore la couverture des départements ruraux, avec l'objectif de signer une vingtaine de nouvelles conventions. Cent emplois supplémentaires dans le premier sont prévus, dans le budget 2018, au titre des conventions « ruralité ».
Soyez assuré, monsieur le député, de ma très grande vigilance et de mon soutien, pour les efforts qui seront réalisés dans votre département comme dans tous les départements ruraux, lors de la prochaine rentrée comme lors des rentrées ultérieures.
Mme Agnès Thill applaudit.

La parole est à Mme Aude Luquet, pour exposer sa question, no 240, relative à l'application de la loi SRU à l'échelon intercommunal.

Monsieur le ministre de la cohésion des territoires, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU, vise à rétablir un équilibre social dans chaque territoire en répondant à la pénurie de logements sociaux.
L'article 55 de cette loi oblige certaines communes à disposer d'un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel. En application de la loi du 18 janvier 2013, les obligations de production de logements sociaux ont été renforcées. La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a ensuite révisé les conditions d'exemption des communes du dispositif SRU.
Pour autant, le cadre législatif ne propose pas une appréhension de la loi SRU au niveau intercommunal alors que les récentes réformes territoriales ont incité les communes à s'organiser au sein d'intercommunalités dont les compétences et les pouvoirs en matière d'urbanisme se sont largement étendus, notamment par la mise en oeuvre des schémas de cohérence territoriale ou encore des PLUI – les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Au regard de ces évolutions, il semblerait plus approprié d'appliquer les obligations de la loi SRU à l'échelle des EPCI, d'autant plus qu'au sein d'une intercommunalité, certaines communes peuvent avoir un taux de logements sociaux inférieur à 25 % alors que d'autres auront un taux nettement supérieur.
À titre d'exemple, au sein de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, la ville de Melun compte près de 45 % de logements sociaux, celle de Pringy en comptant seulement un peu plus de 10 %. Cette dernière, comme tant d'autres villes en France, a pour obligation, pour se mettre en conformité avec la loi, d'augmenter significativement son parc social au cours des prochaines années. Elle compte ainsi passer à 21 % de logements sociaux en 2020, ce qui nécessite de lourds investissements. Ce taux, s'il reste inférieur au taux minimal prévu par la loi, démontre la volonté de la commune de s'y conformer. Il m'apparaît alors nécessaire que la loi SRU prenne en considération, d'une part, les efforts consentis par les communes pour se mettre en conformité, et, d'autre part, le taux de logements sociaux au niveau intercommunal.
En conséquence, ne serait-il pas plus pertinent, monsieur le ministre, que le taux minimal de 25 % de logements sociaux soit apprécié non pas au niveau communal mais au niveau des EPCI, c'est-à-dire au niveau d'un bassin de vie afin de refléter davantage la réalité de l'offre ?
Madame la députée, vous posez une question que nous nous posons les uns et les autres depuis un certain temps, …
… et d'autant plus en ce qui me concerne que j'ai présidé une communauté d'agglomération pendant seize ans. Cela étant, je ne pense pas qu'en l'état actuel des choses, nous puissions aller très rapidement dans la voie que vous suggérez. Vous demandez en effet s'il ne serait pas plus opportun d'appliquer les obligations issues de l'article 55 de la loi SRU au niveau des intercommunalités. Je rappelle que notre système en matière d'urbanisme continue aujourd'hui à poser le principe que la signature du permis de construire est entre les mains de chaque maire, et je crois que l'immense majorité d'entre eux y sont attachés. Et même si on s'est, ici aussi, posé la question, la réponse actuelle est de le conserver. Le temps n'est pas encore venu – s'il doit venir un jour dans le cadre des recompositions territoriales – de changer cela. Je note d'ailleurs que depuis la mise en vigueur de l'article 55, le législateur, quelles que soient les sensibilités au pouvoir, a considéré que cet article devait s'appliquer à l'échelle de la commune, considérant que c'était la maille pertinente pour solutionner les questions relatives aux logements sociaux.
Si l'on passait directement à l'échelle intercommunale, cela pourrait conduire à un ralentissement de l'effort global de production de logements sociaux car le taux cible est d'ores et déjà atteint dans la majeure partie des intercommunalités alors que les besoins, eux, sont toujours là.
Une remarque personnelle, au-delà des éléments de langage préparés par mes services : la taille des intercommunalités varie énormément dans notre pays. Ainsi, vous savez pertinemment qu'il y a aujourd'hui des intercommunalités dites « XXL », ce qui pose un véritable problème pour le passage direct au niveau intercommunal des obligations prévues par l'article 55. Nous savons bien qu'y compris à l'intérieur des intercommunalités, certaines communes jouent totalement le jeu alors que d'autres le jouent moins, et qu'il faut en plus tenir compte des difficultés s'agissant de l'application de certains textes – je pense à la loi Littoral ou encore à la loi Montagne.
Vous me citez l'exemple éloquent de Melun-Val-de-Seine qui respecte le seuil de 25 % de logements sociaux alors que pourtant, sur son territoire, il y a encore une forte demande non satisfaite en la matière. On doit donc attendre souvent plusieurs années pour avoir un logement social, ce qui est regrettable. Cela étant, en l'état actuel de la réflexion, le Gouvernement a considéré, je le répète, qu'il n'était pas encore opportun d'aller dans le sens que vous suggérez. Mais il y a des évolutions en cours, et je fais confiance aux collectivités locales. Ainsi, on voit bien que de plus en plus de communes s'en remettent à leur intercommunalité pour instruire les permis de construire. Voilà une démarche positive qui est en train de se mettre en place dans le cadre d'une collaboration entre communes et intercommunalités.
Par conséquent, oui, votre question mérite d'être posée, je vous ai donné l'état de nos réflexions, mais je pense que nous avons encore besoin d'approfondir le sujet.

La parole est à Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, pour exposer sa question, no 254, relative à la transition vers l'agriculture biologique.

Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sous l'impulsion du Président de la République, un plan global de modernisation et de valorisation de l'agriculture française sera mis en place d'ici 2022. Nous savons que notre pays a deux défis à relever : obtenir une rémunération plus équitable pour nos producteurs ; accompagner la transition vers une agriculture durable en encourageant la transformation des pratiques et des systèmes agricoles.
Plusieurs initiatives ont déjà été lancées par le Gouvernement et la majorité parlementaire, le projet de loi issu des États généraux de l'alimentation en constituant le premier pilier. Il sera débattu dans cet hémicycle fin mai. D'autres mesures viendront le compléter, notamment la mise en place du plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour l'agriculture, la réalisation de l'objectif de 15 % de surface agricole utile en bio d'ici 2022 ou encore la mise en oeuvre du plan Écophyto 2 – qui vise à réduire de 50 % le recours aux produits phytosanitaires d'ici 2025. Des réflexions ont également été engagées sur le foncier et sur la fiscalité agricoles. Enfin, la renégociation de la politique agricole commune pour l'après-2020 permettra de compléter et de porter nos ambitions au plus haut niveau européen.
Un tel chantier est ambitieux. Il est indispensable à la transformation dont a besoin l'agriculture française pour rester compétitive. Mais ces mesures ne seront efficaces que si elles aboutissent rapidement et apportent des solutions concrètes aux agriculteurs français. À cet égard, vous savez qu'elles sont très attendues en Bretagne. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser le contenu et l'articulation de ces différents projets ?
S'agissant plus précisément du plan de 5 milliards d'euros, le Premier ministre en a présenté les grands axes le 25 septembre 2017, indiquant que 5 milliards d'euros seraient investis pour accélérer l'adaptation des outils et le changement des pratiques afin de mieux intégrer la réponse aux défis climatiques, pour renforcer la compétitivité des différentes filières et pour soutenir la recherche et l'innovation. Comment se décomposera en détail ce plan d'investissement ? Quelles en seront les sources de financement, les orientations et le calendrier de mise en oeuvre ?
Madame la députée, vous venez de l'indiquer : le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a en effet lancé plusieurs chantiers dont la mise en oeuvre s'échelonnera tout au long de l'année 2018, mais aussi sur l'année 2019 pour ce qui concerne le chantier du foncier. Cette feuille de route est issue des travaux menés dans le cadre des États généraux de l'alimentation.
Concernant la fiscalité agricole, je me suis engagé avec mon collègue Bruno Le Maire à formuler des propositions pour le projet de loi de finances pour 2019. Une concertation a été lancée à cet effet avec onze députés et onze sénateurs issus de l'ensemble des bancs des deux hémicycles, mais aussi avec les représentants des organisations syndicales agricoles. Ils sont chargés de nous proposer un certain nombre de mesures d'ici le mois de juin prochain.
S'agissant de l'accompagnement au développement de l'agriculture biologique, les travaux de concertation auront lieu ces prochaines semaines dans le cadre du comité de pilotage du plan Ambition Bio 2022. Le plan d'action sera présenté à la mi-juin et je présiderai personnellement, courant mai, un grand conseil d'orientation de l'Agence Bio. Ce plan accompagnera les filières afin de leur permettre d'atteindre 15 % de surface agricole utile en agriculture biologique ou en cours de conversion, et de mieux répondre ainsi aux attentes des consommateurs.
Enfin, s'agissant du volet agricole du Grand plan d'investissement 2018-2022, j'aurai l'occasion, dans les toutes prochaines semaines, de préciser les actions qui le constitueront. Son volet agricole, je l'ai déjà indiqué, a vocation à être le principal instrument de transformation des secteurs agricole, agroalimentaire, forêt-bois, pêche et aquaculture, en réponse aux enjeux et aux attentes exprimés lors des États généraux de l'alimentation. Il s'articulera autour de trois axes structurants : le premier visera la transformation de l'amont agricole et forestier, et représentera un peu moins de 3 milliards d'euros ; le deuxième accompagnera l'amélioration de la compétitivité de l'aval agricole et forestier, et représentera un peu plus de 1,5 milliard d'euros, l'objectif étant d'aider les entreprises, notamment de l'industrie agroalimentaire, qui tirent vers le haut notre agriculture ; le troisième axe soutiendra l'innovation et la structuration des filières à hauteur de 500 millions d'euros sur cinq ans. Ces différents outils seront mis en oeuvre progressivement. J'annoncerai le calendrier dans les prochains jours.
Je conclurai en rappelant le travail à mener sur la politique agricole commune. Comme vous le savez, la France est à cet égard porteuse d'une ambition sur la prochaine programmation : une PAC plus lisible ; une PAC dotée d'un budget très volontariste ; une PAC qui préserve des filets de sécurité pour nos agriculteurs grâce à des financements directs sur le premier pilier. Bref, il doit s'agir d'une politique agricole commune au service de la compétitivité de nos exploitations agricoles. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines.

La parole est à M. Thierry Michels, pour exposer sa question, no 248, relative à l'ouverture d'un bar identitaire à Strasbourg.

Ma question s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et j'y associe mes collègues bas-rhinois de la majorité présidentielle et tous les parlementaires touchés par un fléau croissant… Lyon, Chambéry, Aix-En-Provence, Strasbourg, Marseille : ces villes ont en commun l'insidieuse montée de l'ultra-droite. Sur tout le territoire, des groupuscules prolifèrent et s'installent au mépris des lois et des valeurs de la République. Après l'implantation d'un squat identitaire à Lyon en mai 2017, c'est à Strasbourg, au coeur d'une ville symbole de paix, capitale de l'Europe, que s'est créé l'Arcadia, sous l'égide d'un bastion qui n'a de social que le nom puisqu'il entend porter assistance à des sans-abri, mais à la seule condition que ceux-ci soient, selon son expression, « de race blanche et de souche européenne ».
Les habitants, les associations et les parents d'élèves des écoles du quartier concerné ont peur. Dernier événement en date : le jeudi 30 mars, des membres du Bastion social ont agressé lycéens et étudiants sur le campus de l'université de Strasbourg. Je rappelle que le 22 janvier dernier, le conseil municipal de Strasbourg a voté à l'unanimité une motion contre la présence de l'Arcadia sur le territoire de la ville, à l'exception notable du Front National qui s'est abstenu – preuve de la collusion qui demeure entre ce parti et ces mouvances identitaires. Le colonel Arnaud Beltrame, lui, n'a pas regardé la couleur de la peau ou l'origine de l'otage avant de prendre sa place et de donner sa vie pour la République. L'assassinat barbare dont a été victime Mme Mireille Knoll nous démontre que nous devons agir !
À l'instar de M. Dominique de Villepin, alors ministre de l'intérieur, qui avait obtenu la dissolution de l'Elsass Korps en 2005, est-il possible d'envisager une telle mesure au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ? De quels moyens dispose le Gouvernement pour lutter contre la discrimination, la haine et la xénophobie qui menacent l'ordre public et notre république ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, vous appelez mon attention sur l'ouverture à Strasbourg d'une antenne locale affiliée au Bastion social, dénommée l'Arcadia.
Au préalable je précise que – contrairement à ce qui s'était passé à Lyon, où le Bastion social squattait illégalement un bâtiment – ce mouvement occupe son local strasbourgeois de manière légale.
Cela étant, nos services exercent une vigilance particulière à l'égard du respect des réglementations en vigueur, notamment celles encadrant les établissements recevant du public. Le local de cette association a ainsi fait l'objet, le 1er février 2018, d'un contrôle par la commission de sécurité.
Je réaffirme que les associations ou groupements de fait qui provoquent à la haine, à la discrimination ou à la violence font l'objet d'une attention tout à fait particulière de mes services. Le Président de la République peut en outre procéder, par décret en conseil des ministres, à la dissolution administrative de ce genre d'associations.
Au regard des atteintes potentielles aux libertés publiques, ces mesures de police administrative sont, bien sûr, fortement encadrées. En effet, la liberté d'association constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Elle a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa célèbre décision du 16 juillet 1971.
Face à la situation préoccupante que vous avez, monsieur le député, décrite, soyez assuré que j'ai saisi les services compétents du ministère de l'intérieur. Dans l'hypothèse où les conditions se trouveraient effectivement réunies, le Gouvernement pourra en effet engager une procédure de dissolution à l'encontre du Bastion social de Strasbourg.
Vous soulignez également le risque de reconstitution d'associations ayant fait l'objet d'une dissolution administrative. Or l'article 431-15 du code pénal dispose à cet effet que le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Monsieur le député, le Gouvernement condamne fermement toute atteinte aux valeurs comme aux lois de la République et attache une grande importance à la lutte contre l'extrémisme sous toutes ses formes, qu'il soit le fait d'un individu ou d'une organisation.
Les services du ministère de l'intérieur resteront donc particulièrement vigilants à l'égard des activités du Bastion social et de son antenne de Strasbourg.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Effectivement, nous devons rester vigilants sur ce dossier, tout en restant bien conscients de la nécessité de respecter les libertés publiques, et notamment la liberté d'association.
Nous devons l'être également, de manière particulière, à l'égard de ces associations et de ces mouvements qui constituent un facteur de rupture de la cohésion sociale et du bien-être collectif que nous cherchons tous à promouvoir. L'heure nous montre que le combat contre la bête immonde n'est jamais achevé. Je resterai donc en relation avec les services du ministère afin de m'assurer que toute leur vigilance continuera de s'exercer à l'égard de telles associations.

La parole est à M. Yves Daniel, pour exposer sa question, no 258, relative à la mortalité routière des enfants.

Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, j'appelle votre attention sur la sécurité routière lors des trajets scolaires.
Avec 3 693 tués et 77 476 blessés, dont un tiers gravement, les chiffres de l'année 2017 ne sont pas bons : nous devons redoubler d'efforts pour rendre la route plus sûre.
Je m'arrête, puisque la situation est insupportable et nous impose de trouver des solutions, sur les chiffres qui concernent nos enfants : 108 d'entre eux, âgés de moins de quatorze ans, ont trouvé la mort sur nos routes en 2016, soit neuf enfants sur un million, alors que la moyenne européenne est de huit.
Nos enfants sont avant tout, dans 55 % des cas, victimes alors qu'ils sont passagers de véhicules mais aussi, dans 25 % des cas, en tant que piétons. Les accidents qui les touchent se produisent dans le cadre du transport scolaire, au cours du trajet entre le domicile et l'école, aux arrêts de car ainsi qu'aux abords de l'école, aux heures d'entrée et de sortie. Les trajets se déroulent en majeure partie tôt le matin ou tard le soir, alors qu'il fait souvent nuit. En outre, dans certaines zones, notamment rurales, tant les conditions hivernales que l'absence d'éclairage public constituent des facteurs diminuant la visibilité des automobilistes.
Mobilisé depuis plusieurs années sur cette question, d'abord au conseil départemental de Loire-Atlantique puis à l'Assemblée nationale, j'ai déposé, à l'occasion de l'examen de plusieurs projets de loi de finances, des amendements visant à mettre en place une expérimentation.
Ma proposition est simple et peu coûteuse : équiper tous les enfants de gilets jaunes réfléchissants lorsqu'ils utilisent les transports scolaires, c'est-à-dire à partir de leur domicile, à l'arrêt de car et au cours de tous leurs déplacements entre le domicile et l'école.
Enfiler un tel gilet fait partie des « gestes qui sauvent » qui doivent être enseignés dès le plus jeune âge afin qu'ils soient retenus et reproduits : il convient donc de rendre son port obligatoire. Madame la ministre, quel est donc votre avis sur ce sujet ? Pouvons-nous, avant l'examen du prochain budget, travailler ensemble à une solution ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, le sujet que venez d'évoquer nous concerne bien sûr toutes et tous. Si, ces dernières années, la mortalité routière frappant les enfants a reculé – de 64,6 % entre 2000 et 2010 et de 16,9 % entre 2010 et 2016 – , 108 enfants ont en effet trouvé la mort sur nos routes en 2016. Ce sont 108 de trop.
Près d'un tiers d'entre eux sont décédés alors même qu'ils se rendaient à l'école. Or si le transport scolaire reste le moyen le plus sûr pour s'y rendre, la montée ou la descente du véhicule au point d'arrêt peut générer des situations à risques. Aussi des initiatives, adaptées aux situations et aux contextes locaux, ont été prises en vue d'augmenter la visibilité des élèves empruntant les cars de ramassage scolaire ou se déplaçant sous la responsabilité d'enseignants ou d'adultes référents.
En effet, le déplacement des élèves depuis leur domicile jusqu'aux écoles maternelles et élémentaires constitue, compte tenu de la vulnérabilité de ces usagers, un enjeu de sécurité.
C'est pour ces raisons que le Gouvernement a décidé, lors du comité interministériel à la sécurité routière du 9 janvier dernier, de favoriser la sécurité des déplacements des enfants, qu'ils les effectuent en tant que piétons ou en tant que cyclistes, en encourageant le développement d'itinéraires dédiés et encadrés comme les pédibus et les vélobus.
S'agissant de l'expérimentation visant à rendre obligatoire, pour tous les élèves utilisateurs des bus scolaires, le port d'un gilet de sécurité jaune fluo, le Gouvernement considère qu'il peut, en 2018, être demandé de prioriser, dans le cadre des plans départementaux d'action pour la sécurité routière, les PDASR, l'équipement des élèves en gilets haute visibilité : il lui paraît en effet plus efficace de laisser le niveau local analyser la situation et définir la pertinence de ce dispositif.
Nous sommes convaincus que c'est par la sensibilisation que nous réduirons encore le nombre d'enfants accidentés. L'éducation à la sécurité routière organisée à l'école – et à partir de cette année, au lycée – est un moyen efficace pour informer les plus jeunes sur les comportements et les règles de sécurité élémentaires. Les enquêtes le montrent : ce qu'il apprend comme piéton, l'enfant le reproduira, plus tard, comme automobiliste.
L'examen de l'attestation scolaire de sécurité routière, l'ASR, que tous les élèves passent en classes de cinquième et de troisième, comporte des questions spécifiques sur ce thème.
La sensibilisation est assurée dans le cadre de la préparation à ces examens et, pour les plus jeunes, dans le cadre de l'attestation de première éducation à la route, l'APER, qui est délivrée à l'école primaire.
Soyez assuré, monsieur le député, que notre mobilisation reste totale pour qu'aucune vie ne soit perdue sur nos routes.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. J'insiste sur l'intérêt que présente la responsabilisation de tous, et avant tout de nos enfants. Ils sont en effet les premiers concernés. La mesure que je propose participe en outre, de manière plus générale, de l'éducation à la sécurité routière, en cohérence avec la politique que nous voulons mener en la matière.

La parole est à M. Bruno Millienne, pour exposer sa question, no 242, relative à la responsabilités des acteurs publics en cas de catastrophes naturelles.

Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, puis la loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI – gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations – , qui l'a complétée et corrigée en assouplissant les modalités de délégation de cette compétence, ont permis de combler les lacunes dont souffrait la stratégie de prévention des risques d'inondation. Pour autant, ces deux lois n'avaient pas pour objet de poser la question des responsabilités de la gestion et du financement des opérations d'urgence effectuées pendant et au lendemain d'une calamité naturelle.
L'affirmation de la compétence GEMAPI vient rompre avec une situation où la prévention des inondations était une compétence émiettée et facultative. Or, au-delà de la prévention et de protection face aux risques d'inondations, se pose concrètement, sur le terrain, la question de la gestion des situations de crise. Les derniers épisodes climatiques, qui ont entraîné des crues aux conséquences parfois dévastatrices, ont en effet vocation à se reproduire de plus en plus fréquemment.
Le réchauffement climatique est une réalité qui doit nous amener à agir en amont en vue de prévenir ces événements naturels. À cet égard, la taxe dite GEMAPI, que le bloc communal peut lever, permettra de réaliser des investissements tels que la construction de digues, son produit ne peut être comparé à un fonds d'urgence.
Certes, différents fonds et aides existent, mais ils demeurent insuffisants et ne permettent pas de répondre dans l'urgence à une situation de crise. S'ajoute à cet argument budgétaire le constat d'une désorganisation de la gouvernance et des responsabilités. Impuissantes ou peu à même d'endosser la gestion de telles crises, les petites communes sinistrées peuvent en effet parfois rester plusieurs mois sans solution.
Que pensez-vous, madame la ministre, de l'opportunité de créer, à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi de finances, un fonds d'urgence permanent dédié à cette problématique ? Ne vous semble-t-il pas, en outre, nécessaire de redéfinir les responsabilités des acteurs centraux, déconcentrés et locaux dans la gestion de crises résultant de catastrophes naturelles ? Enfin, jugez-vous pertinent de confier l'exercice de cette compétence et les modalités de gestion des financements et des actions y afférent à une agence ou à une autorité du ministère de l'intérieur, sur le modèle de la FEMA – la Federal Emergency Management Agency – aux États-Unis ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, vous soulignez, face aux risques d'inondation, le caractère positif des volets prévention et protection prévue par la compétence GEMAPI, tout en émettant des réserves quant à l'efficacité, dans notre pays, des dispositifs de réponse d'urgence aux situations de crise.
De nombreux dispositifs ont vocation à répondre à cette nécessité. Les services de l'État, à l'occasion du retour d'expérience organisé à l'issue de chaque crise significative, travaillent en permanence à améliorer l'efficacité de leur réponse.
Les dispositifs ne sont en effet pas concentrés au sein d'un fonds d'urgence unique, dont le Gouvernement ne juge pas la création souhaitable, du point de vue de l'efficacité de la réponse à apporter aux sinistrés comme de la bonne gestion budgétaire.
En matière de gouvernance, l'expérience montre que le système actuellement organisé par la loi, éprouvé, fondé sur la subsidiarité des moyens, permet une réponse immédiate, de proximité, proportionnée aux événements : il ne nous apparaît donc pas opportun de le modifier. Articulé entre le maire, le préfet de département et le préfet de zone, il prévoit, dans la chaîne de responsabilité, une place et un rôle bien défini à chaque acteur identifié.
La concertation organisée entre les acteurs nationaux et locaux a en outre permis, notamment au cours de la période récente, d'améliorer significativement les outils dont nous disposons. Le dispositif a ainsi été réformé en 2016 en vue d'en renforcer l'efficacité, la réactivité et la lisibilité. Les deux fonds destinés au financement des mêmes besoins ont été fusionnés. La dotation de solidarité bénéficie désormais d'une ouverture de crédits – de 40 millions d'euros en 2018 – qui permet un soutien rapide de l'État. Dans les cas les plus graves, il est même possible d'ouvrir une avance aux collectivités.
Pour les biens assurables des collectivités locales et des particuliers, la France dispose, depuis la loi du 13 juillet 1982, d'un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles conjuguant, en une sorte de partenariat public-privé, solidarité nationale et assurance.
Enfin, lors de catastrophes naturelles d'ampleur, les plus démunis ont accès à un fonds d'aide au relogement d'urgence ainsi qu'à un fonds de secours d'extrême urgence qui été activé à la suite du cyclone Irma et, plus récemment, dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Je rappelle par ailleurs que le Gouvernement a la volonté de simplifier les procédures. Ainsi, le ministère de l'intérieur s'est engagé à améliorer les délais d'instruction des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À titre d'exemple, la dématérialisation complète de la procédure est – grâce à l'application iCatNat, dont le déploiement est en cours depuis le début de l'année – en voie d'achèvement. Les services de l'État et les communes disposeront ainsi d'un outil opérationnel de suivi de l'instruction des dossiers.
Cette application permettra à la fois de simplifier et d'accélérer encore l'instruction des dossiers, grâce à une transmission instantanée des demandes instruites aux niveaux communal, départemental et ministériel.

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour exposer sa question, no 261, relative à la délivrance des titres réglementaires.

Madame la ministre, je souhaite, une nouvelle fois, appeler l'attention du Gouvernement sur les conséquences du plan « Préfectures nouvelle génération » pour nos territoires.
En généralisant le recours aux téléprocédures ou à des tiers de confiance, ce plan a profondément réformé les modalités de délivrance des titres réglementaires que sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire et la carte grise. Si je soutiens, bien entendu, l'objectif de modernisation de nos services publics, je ne peux pas accepter que cela se fasse au détriment de la qualité du service rendu à nos concitoyens, particulièrement en milieu rural.
Parmi les objectifs de cette réforme, tels qu'ils sont présentés par la communication gouvernementale, figurent ceux d'offrir à l'usager « un service de qualité adapté à ses attentes », de « veiller à l'égalité d'accès au service public », et cela en inscrivant les préfectures « dans l'avenir des territoires ». Pourtant, madame la ministre, les usagers en attente d'une carte grise ou d'un permis de conduire sont confrontés à de nombreux dysfonctionnements dans le cadre de la mise en place de la plateforme en ligne de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS : demandes sans réponse, saturation de la plateforme téléphonique ou encore délais d'obtention de documents très longs font partie des désagréments subis régulièrement par nos concitoyens.
Par ailleurs, depuis un an, les cartes nationales d'identité ne peuvent être déposées et retirées que dans les mairies équipées d'un dispositif de recueil d'empreintes, et cela, notamment, pour des raisons de sécurité. Le nombre de mairies agréées pour la délivrance des cartes d'identité est cependant très limité et, comme vous le savez, mal réparti géographiquement. Cela a un impact négatif sur l'égalité d'accès à ce service pour le plus grand nombre, impact qui a été dénoncé à de nombreuses reprises.
Dans le plus beau département de France, la Somme – avec toutefois le Loir-et-Cher –,
Sourires

sur 779 communes, seules seize sont équipées de ce dispositif. Cela a pour conséquence de créer une charge supplémentaire pour ces seize communes, qui, soit dit en passant, ont vu leurs dotations d'État diminuer fortement ces dernières années, tout en retirant aux autres communes, rurales, un service public qui était auparavant assuré au plus près des citoyens. Une fois encore, la ruralité se trouve pénalisée.
Grâce à une concertation continue et aux nombreuses interventions des parlementaires et associations d'élus locaux, des moyens supplémentaires ont toutefois été mis en place et des améliorations ont été apportées à cette vaste réforme ces dernières semaines. Malheureusement, force est de constater que, sur le terrain, il reste encore beaucoup à faire.
Pourriez-vous, madame la ministre, nous présenter un premier bilan de la réforme, détailler les mesures envisagées afin d'assurer une juste compensation pour nos communes, ainsi que l'égal accès à ces services sur tous les territoires, enfin, préciser dans quels délais les problèmes seront réglés ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, le plan « Préfectures nouvelle génération » vise à moderniser le processus de délivrance des titres. Les citoyens doivent désormais effectuer leurs demandes de titres – carte d'identité, permis de conduire, certificat d'immatriculation et autres – par voie numérique, et ce gratuitement, sans déplacement, ni attente à un guichet : c'est, comme vous l'avez souligné, un progrès considérable.
Toutefois, je ne nie pas que des dysfonctionnements techniques des téléprocédures ont été constatés. Néanmoins, cela va mieux. Des améliorations ont été apportées. Les problèmes sont aujourd'hui réglés pour les permis de conduire : plus d'1 million de ces titres ont été délivrés.
La situation est moins satisfaisante pour les cartes grises. Il y a eu beaucoup de remontées visant à nous le signaler. J'ai moi-même entendu dans les territoires des plaintes relatives aux délais trop longs. Pour dire les choses rapidement, il y a eu à la fin de l'année beaucoup d'achats de voitures à l'étranger, et le système a bogué à cause de cela.
Vous insistez sur les demandes de carte nationale d'identité. Pour cela, les usagers doivent se rendre dans une mairie équipée d'une station biométrique. Compte tenu du caractère sensible des informations transmises, celles-ci doivent transiter par des réseaux informatiques spécifiquement sécurisés. Bien évidemment, toutes les communes n'ont pu en être équipées – vous avez indiqué quelle était la situation dans votre département. Néanmoins, nous avons reçu cette année de nouveaux équipements, en vue de renforcer l'égalité entre les territoires. De nombreux dispositifs de recueil de prises d'empreintes ont été déployés, et l'indemnisation des mairies a été doublée ; 528 nouvelles stations biométriques se sont ajoutées en 2017 et 2018 aux 3 526 qui avaient été installées avant la réforme, afin d'assurer un niveau de production satisfaisant et garantir un maillage territorial suffisant – même si j'entends bien que le département de la Somme, qui compte, si ma mémoire est bonne, 800 et quelques communes, doit s'équiper davantage.
Pour les personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité, cent dispositifs de recueil mobiles sont mis à la disposition des mairies par les préfectures, afin de répondre aux besoins du territoire.
Enfin, concernant les charges nouvelles pour les communes, l'État a fortement renforcé son accompagnement financier en faveur des communes équipées d'un dispositif de recueil, en vue de compenser la nouvelle charge que représente l'accueil d'usagers extérieurs à la commune. Cet effort, substantiel, s'est élevé à 21,5 millions d'euros.
Je sais les problèmes que rencontrent les personnes éloignées du système digital et de l'internet. Nous nous efforçons de mettre en place des points d'accueil avec des accompagnants dans les maisons de services au public, dans une relation de proximité avec les territoires, afin d'aider le public à faire ses demandes de carte d'identité et autres documents officiels.

La parole est à M. Dimitri Houbron, pour exposer sa question, no 247, relative au respect de l'interdiction de vente d'alcool.

Madame la ministre, j'appelle votre attention sur le non-respect de l'interdiction de vente d'alcool après une heure précise par certains commerces. Il s'agit d'un fléau national, auquel doivent faire face les élus locaux, les services déconcentrés de l'État et les forces de l'ordre.
Prenons l'exemple de la ville de Douai, dont le maire a rédigé un arrêté pour interdire la vente d'alcool dans certains commerces du centre-ville, excepté les restaurants, après vingt heures. Près de quatre ans après sa publication, certains commerçants ne respectent toujours pas l'interdiction, et pour cause. En cas de non-respect de l'arrêté municipal, le commerçant est sanctionné d'une contravention d'un montant de 38 euros : vu la faiblesse de ce montant, certains commerçants préfèrent prendre le risque de devoir payer l'amende plutôt que celui de perdre des clients.
Outre cette forme de concurrence déloyale entre ceux qui respectent l'arrêté et ceux qui ne le respectent pas, les nuisances sont quotidiennes. Riverains et gérants des restaurants se plaignent des désagréments provoqués par des personnes alcoolisées. Les plaintes recensent des insultes verbales, des déjections sur les paliers, ou encore des canettes jetées sur la voie publique. Cette situation risque de dégrader l'image de la ville et de nuire à son attractivité.
En dépit des nombreux rappels à l'ordre et de la répétition des sanctions financières, la municipalité douaisienne ne dispose pas d'autres moyens relevant de sa compétence pour faire appliquer l'arrêté. Même la décision de procéder à une fermeture administrative d'un commerce semble très compliquée, comme l'a indiqué le sous-préfet de Douai.
Aussi, j'aimerais savoir par quels moyens dissuasifs un maire, comme celui de Douai, peut faire respecter cette interdiction.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, au cours des dernières années, les dispositions légales visant à encadrer la vente nocturne d'alcool et permettant donc de prévenir les troubles à l'ordre public ont été considérablement renforcées, dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie.
S'agissant, d'abord, de la prévention, toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place ou d'un restaurant doit se soumettre à une obligation de formation ; cela vaut aussi, depuis 2009, pour tout commerçant souhaitant vendre des boissons alcoolisées à emporter entre vingt-deux heures et huit heures. Ces formations, qui sont aujourd'hui d'une durée de vingt heures pour les débitants de boissons à consommer sur place et les restaurateurs, et de sept heures pour les personnes qui vendent de l'alcool à emporter la nuit, sont dispensées par 117 organismes agréés par le ministère de l'intérieur. L'absence de formation est passible d'une amende de 3 750 euros.
L'encadrement de la vente de boissons alcooliques passe également par l'amplitude horaire d'ouverture de ces commerces. Dans chaque département, le préfet fixe les horaires d'ouverture des débits de boissons à consommer sur place et à emporter. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Atlantiques et Paris, la vente de boissons alcooliques à emporter sur la voie publique est interdite au-delà de vingt-deux heures dans les deux premiers départements et de minuit trente à Paris.
Si les circonstances locales le nécessitent, le maire peut accentuer la contrainte imposée par le préfet en matière d'horaire, et aussi interdire la consommation d'alcool sur la voie publique à l'intérieur d'un périmètre géographique défini. Le non-respect d'un tel arrêté est sanctionné, selon le code pénal, par une contravention de première classe. Ce manquement constitue également une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, ce qui permet au préfet de prendre une mesure de fermeture administrative de l'établissement pour une durée maximale de six mois, après avertissement préalable. S'agissant des établissements de vente à emporter, et dans l'hypothèse où leur activité occasionne des troubles à l'ordre, à la sécurité ou tranquillité publics, cette fermeture administrative peut être de trois mois.
Enfin, les désordres causés par des personnes en état d'ébriété sont susceptibles de constituer des infractions pénales, réprimées dans les conditions du droit commun.

Merci pour ces précisions, madame la ministre. Si nous souhaitons prendre ce problème à bras-le-corps, c'est pour apporter un sentiment de sécurité chez nos concitoyens. Cela participe aussi à l'attractivité de nos villes ; Douai fait ainsi partie des villes pilotes en matière de redynamisation des centres-villes. La sécurité, notamment le fait de ne pas avoir de personnes alcoolisées sur la voie publique, participe à cette attractivité.
Je relaierai votre réponse à l'échelon local, afin que le maire puisse agir dans l'intérêt de la commune.

La parole est à M. Julien Dive, pour exposer sa question, no 235, relative à la nouvelle carte judiciaire.

Madame la ministre, depuis le mardi 27 mars les avocats de Saint-Quentin sont en grève. Depuis une semaine, il n'y a ni permanence ni audience. Je me joins à leur mobilisation ; j'aimerais vous interroger sur la nouvelle organisation territoriale de la justice.
La potentielle suppression de juridictions ne manque pas de susciter de vives craintes auprès des professionnels de la justice partout en France, particulièrement auprès des Français habitant dans des villes moyennes et dans nos territoires ruraux. Le Gouvernement a récemment tenté d'éteindre l'incendie en s'engageant à ne fermer aucun lieu de justice et à maintenir tous les tribunaux de grande instance (TGI).
Alors, oui, la dernière mouture de votre texte ne contient plus de hiérarchie entre les cours d'appel et entre les tribunaux de grande instance, comme cela avait été imaginé à l'origine. Toutefois, votre réforme n'est guère plus rassurante, puisqu'elle préfère renvoyer à des décrets l'avenir de certaines juridictions et la répartition des compétences au sein de chaque département. En l'état, le texte ne supprime pas de lieu de justice, mais l'actuelle rédaction de l'article 57 du projet de loi de programmation pour la justice ne fait que repousser l'échéance. C'est pourquoi, à Saint-Quentin, la mobilisation des professionnels du barreau en faveur du maintien d'un tribunal de pleine compétence reste soutenue.
Le premier projet de réforme envisageait la création d'un seul et unique tribunal judiciaire, délaissant Saint-Quentin, deuxième ville de Picardie. Concrètement, pour les habitants du Saint-Quentinois, de la ville et des villages environnants, une telle évolution les éloignerait de leurs droits et les contraindrait à parcourir plusieurs centaines de kilomètres, ce que tous les justiciables, notamment les plus démunis, ne seraient pas en mesure de faire. Je comprends l'impératif d'efficacité qui est le vôtre, mais le droit fondamental de chaque citoyen d'accéder à la justice ne doit pas être sacrifié pour des raisons budgétaires.
La réforme de la justice envisagée par le Gouvernement est en l'état incomplète, car elle pénalise les villes moyennes et rurales qui connaissent déjà des difficultés : dévitalisation des centres-bourgs, désertification médicale, accès restreint aux services publics et, peut-être bientôt, éloignement de la justice.
Madame la ministre, entendez-vous modifier l'article 57 du projet de loi de programmation pour la justice pour 2018-2022, qui, pour l'heure, exclut les barreaux locaux et les élus du territoire de la concertation préalable à la création de pôles spécialisés, dont on ignore encore ce qu'ils recouvriront vraiment ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, je vous prie tout d'abord d'excuser la garde des sceaux, qui m'a demandé de la remplacer.
En matière d'organisation judiciaire, l'engagement du Gouvernement est clair, et cela depuis le début : nous ne supprimerons aucun site juridictionnel.
Exclamations sur les bancs du groupe LR.
Je dis bien aucun, mesdames, messieurs.
Cet engagement est au coeur du projet de loi de programmation pour la justice qui sera bientôt soumis au Parlement. L'engagement de la garde des sceaux est celui d'une justice au plus proche des justiciables, simple d'accès et efficace.
Le projet de loi qui vous sera bientôt soumis, disais-je, lèvera vos doutes, monsieur le député : tous les tribunaux de grande instance seront maintenus en tant que juridictions de plein exercice. Il n'y aura pas de « tribunaux judiciaires », ni de « tribunaux de proximité », mais seulement des tribunaux de grande instance, avec leurs chefs de juridiction.
Le projet de loi prévoit, par ailleurs, la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance afin d'améliorer la lisibilité de l'organisation judiciaire. C'était nécessaire, car le justiciable est aujourd'hui contraint de naviguer parmi les nombreuses règles de compétences de ces deux juridictions. Cela n'est pas acceptable, tous nous le disent.
Cette fusion se fera en maintenant intacte la proximité de la justice. Toutes les implantations actuelles des tribunaux d'instance seront conservées – je dis bien toutes, monsieur le député. Le socle de compétences de ces implantations est garanti dans le projet de loi. Les acteurs locaux pourront contribuer à y ajouter des compétences, mais uniquement en ajouter, non en retirer.
En réalité, vous le voyez bien, loin de pénaliser les villes moyennes et rurales, cette réforme les renforcera. C'est bien à l'initiative des acteurs locaux que les structures juridictionnelles pourront être renforcées en compétences. Ce sont ceux qui vivent dans les territoires qui les connaissent le mieux, et qui peuvent le mieux y évaluer le besoin de justice. C'est bien l'ambition défendue par le Gouvernement à travers ce projet de loi.

La justice, madame la ministre, ne relève pas de vos compétences, j'entends bien ; aussi je vous remercie de vous être livrée à l'exercice de me répondre.
Je ne suis pas rassuré pour autant, puisque la note qui vous a été transmise par la garde des sceaux indique : « acteurs locaux », sans préciser s'il s'agit des élus, notamment le maire de la ville concernée et celui des communes environnantes. Je sais, de par votre parcours et vos compétences au sein du Gouvernement, votre attachement aux territoires. J'insiste également, de mon côté, sur la défense des petites communes et des villes moyennes, tout en vous rappelant qu'il convient d'y associer les élus, mais aussi les barreaux. La précision est d'importance, car l'expression « acteurs locaux » veut dire tout et rien à la fois. Il importe donc de préciser, sur ce point, l'article visé du projet de loi de programmation.

La parole est à Mme Michèle Tabarot, pour exposer sa question, no 236, relative à l'avenir des tribunaux de grande instance.

Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ; j'y associe le maire de Grasse, Jérôme Viaud, et de nombreux élus de l'ouest du département des Alpes-Maritimes ainsi que le barreau de Grasse. Elle porte sur la réforme de la justice et sur son impact sur les tribunaux de grande instance, que mon collègue Julien Dive vient d'évoquer.
Depuis le lancement du chantier de l'adaptation du réseau des juridictions, les professionnels du droit s'inquiètent de la possible disparition de certains TGI et du placement de certains autres sous une coordination départementale. L'engagement gouvernemental de ne supprimer aucun TGI en France n'a pas suffi à les rassurer. La mobilisation était d'ailleurs encore forte vendredi dernier, à Grasse et dans la France entière.
Le projet de loi de programmation de la justice comporte, en effet, plusieurs dispositions qui pourraient, à terme, conduire à vider certains tribunaux de leur substance. Ainsi, dans les départements qui comptent plusieurs TGI, un décret permettrait de désigner spécialement un tribunal pour traiter de l'ensemble de certains contentieux ; le procureur général pourrait aussi confier un rôle de coordination pénale à un seul procureur de la République ; des TGI pourraient être privés de juge d'instruction.
Si cette réforme est mise en oeuvre, des tribunaux pourront donc être privés, d'un trait de plume, d'attributions et de compétences essentielles. Pourtant, dans certains départements, le maintien de plusieurs TGI de plein exercice se justifie sans hésitation. C'est le cas du TGI de Grasse, qui couvre une population de plus de 570 000 habitants, 10 juridictions comptant 212 magistrats et fonctionnaires et 618 avocats inscrits au barreau. Qui pourrait comprendre que le dix-neuvième TGI de France, en termes de volume d'activité, perde un jour sa plénitude de juridiction ?
Au regard de ces éléments, pouvez-vous me dire, madame la ministre, si le Gouvernement reviendra sur ces dispositions contestées, et m'indiquer vos intentions réelles concernant l'avenir du TGI de Grasse, qui doit conserver toute son autonomie ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Nos intentions réelles, madame la députée, sont de maintenir l'ensemble des tribunaux de grande instance en tant que juridictions de plein exercice. Aucun tribunal de grande instance « chef de file » ne sera créé. Ainsi, le tribunal de grande instance de Grasse conservera son autonomie, avec à sa tête ses chefs de juridiction. Il conservera une plénitude de compétence et pourra, le cas échéant, se voir confier des compétences spécialisées.
Le projet de loi permettra aux juridictions qui le souhaitent, dans les départements où plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés – ce qui est le cas du vôtre – , d'en désigner un par décret pour traiter de contentieux déterminés, qu'ils soient civils ou pénaux. Cela pourra constituer un moyen supplémentaire de renforcer l'efficacité de la justice en première instance. Les chefs de juridiction, associés aux chefs de cour, seront chargés de proposer, après concertation locale, l'organisation la plus performante afin d'adapter au mieux l'organisation judiciaire à la réalité du besoin de justice.
En matière pénale, un rôle de coordination pourra être confié à l'un des procureurs de la République. Cela pourrait permettre de renforcer la conduite de la politique pénale et partenariale dans le département, mais ne videra en rien les attributions juridictionnelles des autres procureurs de la République.
Comme vous le voyez, madame la députée, loin de pénaliser le tribunal de grande instance de Grasse, cette réforme le confortera. C'est bien à l'initiative des acteurs locaux – expression dont il faudra préciser le sens – que les structures juridictionnelles pourront être renforcées en compétences. Ce sont en effet ceux qui vivent dans les territoires qui, je le répète, les connaissent le mieux, et qui peuvent le mieux évaluer le besoin de justice. C'est bien l'ambition portée par le Gouvernement à travers ce projet de loi.

Nous ne sommes toujours pas rassurés, madame la ministre. Il y a encore beaucoup de « pourrait » dans votre discours. Les acteurs locaux et tous les responsables du monde de la justice souhaitent participer, dans les plus brefs délais, à des séances de travail concrètes, afin de savoir ce qu'il adviendra des TGI sur chaque territoire.

La parole est à M. Bernard Perrut, pour exposer sa question, no 237, relative au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.

Je veux appeler l'attention de Mme la garde des sceaux sur les juridictions de plein exercice, qui assurent un maillage essentiel des territoires, en particulier sur le tribunal de grande instance de Villefranche, dans le Rhône, à mon sens menacé par la réforme de la justice.
Vous avez pris l'engagement qu'aucune juridiction ne sera fermée, mais cette réponse n'est pas rassurante car elle masque un danger, celui du transfert partiel des compétences des petites et moyennes juridictions vers les grandes ; en l'espèce, le transfert des compétences du tribunal de grande instance de Villefranche vers celui de Lyon. L'objectif de Mme la garde des sceaux d'un accès simple, direct, transparent et rapide à la justice est partagé à Villefranche, où les décisions sont rendues dans des délais bien plus brefs qu'au TGI de Lyon. Pour une procédure de divorce, par exemple, le délai d'attente pour l'audience est de six mois à Lyon, contre sept semaines seulement à Villefranche.
Aussi la population est-elle très mobilisée. Plus d'une centaine de maires se sont déjà exprimés, les avocats vous ont fait des propositions sérieuses et les magistrats, tout comme les greffiers, sont inquiets. Tous regrettent l'absence de concertation et d'étude d'impact. Nous refusons un transfert de compétences, qui aurait pour conséquence un allongement des durées des procédures civiles et pénales et un éloignement des justiciables de leurs juges en raison de déplacements difficiles jusqu'à Lyon, le risque d'évolution vers une justice virtuelle et déshumanisée, et un réel coup porté à un territoire, le département du Rhône qui, clairement distinct de la métropole de Lyon, est reconnu pour son développement économique et se trouve en pleine expansion démographique.
Aussi je souhaite connaître votre engagement précis pour le maintien à Villefranche du TGI dans la plénitude de ses compétences actuelles, sans transfert d'une partie du contentieux vers Lyon, et pour le maintien des juridictions rattachées – tribunal de commerce et conseil des prud'hommes – qui fonctionnent avec rapidité, efficacité et sérieux. La création d'un tribunal dans le département du Rhône, distinct de celui de la métropole de Lyon, serait la meilleure réponse. Je propose que ce soit là un objectif commun.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Avant de me rendre dans cet hémicycle, monsieur le député, je me suis entretenue avec un ancien procureur de Villefranche, que vous connaissez bien. Il y a toujours eu des inquiétudes, me disait-il, sur l'avenir du tribunal de cette ville. Comme je l'ai déjà dit deux fois, monsieur le député, tous les tribunaux de grande instance seront maintenus en tant que juridictions de plein exercice, et le tribunal de grande instance de Villefranche conservera non seulement ses compétences actuelles, mais en gagnera de nouvelles.
Le projet de loi prévoit, en effet, la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance afin d'améliorer la lisibilité de l'organisation judiciaire. Tous les tribunaux de grande instance actuels seront donc conservés – je dis bien tous, monsieur le député. Leur socle de compétences est garanti dans le projet de loi ; les acteurs locaux pourront proposer de modifier certaines d'entre elles s'ils le souhaitent.
Les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes sont des juridictions à part entière, qui ne sont pas directement concernées par la réforme. S'agissant des tribunaux des affaires de sécurité sociale – TASS – , la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a d'ores et déjà prévu leur transfert au sein d'une formation collégiale des tribunaux de grande instance, qui seront prochainement désignés par décret.
Il ne faut donc vraiment pas vous inquiéter, monsieur Perrut, pour le tribunal de Villefranche.

Votre réponse est rassurante si elle est confirmée, madame la ministre. Le projet de loi prévoit bien que les chefs de cour, en lien avec les chefs de juridiction, seront chargés de proposer l'organisation la plus performante dans les départements de leur ressort.
Vous venez toutefois d'annoncer le maintien des compétences actuelles du tribunal de grande instance de Villefranche, qui pourrait même en acquérir de nouvelles. C'est dire, peut-être, l'ouverture vers la reconnaissance de ce tribunal, ou en tout cas la nécessité de son extension à une plus grande échelle territoriale, qui pourrait être celle du département du Rhône. Quand on connaît les durées d'attente au tribunal de Lyon, ainsi que votre attachement aux définitions de la métropole et du département, il serait logique que le département dont nous parlons dispose d'un véritable tribunal, faute de quoi il serait le seul, en France, à ne pas en avoir : ce serait pour le moins inquiétant.
J'insiste d'ailleurs sur l'importance de ce département et de la ville de Villefranche, dont dépendent, pour le tribunal, douze brigades de gendarmerie et deux pelotons d'autoroute, un service de douane, une prison de six cents places et un commissariat de police. C'est dire combien le tribunal de Villefranche a toute sa place. Je vous en crois convaincue, madame la ministre, et je prends aujourd'hui vos propos comme une assurance qui me permettra d'annoncer, dans ma ville et dans ma circonscription : « Oui, j'ai entendu Mme la ministre ; le tribunal de grande instance sera maintenu dans toutes ses compétences, et il pourra même en acquérir de nouvelles. »

La parole est à Mme Béatrice Descamps, pour exposer sa question, no 259, relative à la carte judiciaire dans le département du Nord.

Ma question, madame la ministre, ressemble beaucoup aux précédentes : je vous prie de m'en excuser à l'avance. Vous avez choisi, vous l'avez dit, de ne pas toucher à la carte judiciaire, ne fermant aucun TGI ni aucune cour d'appel. Nombre d'entre nous, nombre de citoyens, nombre de professionnels de la justice aussi, peuvent apparemment être rassurés sur ce point et vous en remercier.
Pouvez-vous nous rassurer également sur la question des compétences juridictionnelles ? La France est complexe de par sa géographie et sa démographie ; de ce point de vue, le département du Nord représente, vous le savez, une exception notable, avec 2,6 millions d'habitants, 270 kilomètres de frontière et de nombreuses industries. Surtout, sa population a besoin d'être rassurée quant à la facilité de son accès à la justice, aux droits de la défense et aux conseils des avocats.
Madame la ministre, chaque TGI conservera-t-il toutes ses compétences ? Que signifie « répartir les contentieux sur un même département » ? La justice restera-t-elle une justice de proximité pour tous ? Notre population et nos avocats du barreau de Valenciennes peuvent-ils se sentir rassurés ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Madame la députée, en matière d'organisation judiciaire, l'engagement du Gouvernement, je le répète, est clair : nous ne supprimerons aucun site juridictionnel. Cet engagement est au coeur du projet de loi de programmation pour la justice, qui sera très bientôt soumis au Parlement.
Mme la garde des sceaux prend l'engagement d'une justice au plus près des justiciables, simple d'accès, compréhensible et efficace. Le projet de loi qui vous sera bientôt soumis lèvera vos doutes, madame la députée, du moins je l'espère. Tous les tribunaux de grande instance seront maintenus en tant que juridictions de plein exercice.
Le projet de loi prévoit, par ailleurs, la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance afin d'améliorer la lisibilité de l'organisation judiciaire, ce qui est absolument nécessaire. À l'heure actuelle, le justiciable est souvent contraint de naviguer parmi les nombreuses règles de compétences de ces deux juridictions, ce qui n'est pas très lisible et en définitive pas acceptable, comme le confirment les observations sur le terrain.
Cette fusion maintiendra intacte le caractère de proximité de la justice. Toutes les implantations des tribunaux d'instance seront conservées – je dis bien toutes. Leur socle de compétences est garanti par le projet de loi. Les acteurs locaux, s'ils le souhaitent, pourront proposer de modifier certaines compétences.
En réalité, loin de pénaliser le département du Nord, la réforme y conforte la place de la justice, madame la députée. C'est bien à l'initiative des acteurs locaux que les structures juridictionnelles pourront être renforcées en matière de compétences. Ce sont, en effet, ceux qui vivent sur les territoires – je l'ai toujours dit et j'y crois profondément – qui les connaissent le mieux et peuvent le mieux évaluer les besoins en matière de justice. Telle est bien votre préoccupation, madame la députée, et j'espère vous avoir rassurée.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Notre population a particulièrement besoin de disposer d'un accès facile à la justice – je vous remercie d'en avoir convenu – mais aussi à la connaissance des droits de la défense et aux conseils des avocats. J'espère que notre population et nos avocats pourront très prochainement se sentir rassurés.

La parole est à M. Hervé Pellois, pour exposer sa question, no 253, relative à l'Université Bretagne Sud.

Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et porte sur la place de l'Université Bretagne Sud – UBS – dans les restructurations universitaires en cours. J'y associe les six députés et les trois sénateurs du Morbihan ainsi que les élus communautaires du département.
L'UBS est née en 1995 de la volonté d'offrir aux lycéens du Morbihan la possibilité d'y faire des études supérieures et d'y développer la recherche et l'innovation. Elle se classe parmi les toutes premières universités françaises pour la réussite des étudiants et l'insertion professionnelles de ses diplômés.
Elle est aussi autorité de tutelle de plusieurs laboratoires affiliés au CNRS et héberge des recherches de premier plan en réseau avec d'autres établissements bretons. Elle est enfin un acteur économique contribuant à l'innovation et au développement de l'économie dans des domaines tels que les matériaux composites, la cybersécurité, la mer ou encore le big data.
L'Université Bretagne Sud joue donc un rôle essentiel sur notre territoire. Elle doit désormais envisager sa future place dans les bouleversements que connaîtra au cours des prochains mois l'enseignement supérieur aux échelons régional et interrégional. L'Université de Bretagne occidentale – UBO – , à Brest, et l'UBS ont annoncé une alliance stratégique prévoyant le rapprochement de leurs politiques respectives, une réponse commune aux appels à projets et le partage de bonnes pratiques.
Aux yeux des élus du Morbihan, il importe que l'UBS conserve son identité et sa capacité à agir tout en développant ses collaborations avec les partenaires de Brest, de Rennes, de Nantes ou d'ailleurs. Il faut également éviter une partition de la Bretagne entre un ensemble centré sur Rennes et Lannion et un autre organisé autour de Brest, Lorient, Vannes et Pontivy. Il serait regrettable de revenir au système antérieur à 2007, année de création de l'UEB – Université européenne de Bretagne. Il y va du devenir du système d'enseignement supérieur breton et de l'attractivité du territoire.
À cet égard, l'article 28 du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance devrait donner davantage de souplesse aux établissements d'enseignement supérieur en matière de rapprochements.
Compte tenu de ces observations, quelle sera la place de l'UBS dans le bouleversement du paysage de l'enseignement supérieur ? Quelles possibilités de rapprochement seront ouvertes aux établissements en mode projet ?

La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le député, l'Université Bretagne Sud est reconnue pour son engagement dans la modernisation de la pédagogie de ses enseignements. Elle a notamment prévu, dans le cadre du plan Étudiants, de mettre en place, dès la rentrée prochaine, un tutorat généralisé entre ses étudiants et de créer des collectifs apprenants rassemblant professeurs et étudiants. Elle est aussi reconnue en matière de recherche et d'innovation. Il s'agit donc bien d'une université à part entière.
Sa situation au sein de la région Bretagne doit être appréciée à la lumière de ses relations très étroites avec l'Université de Bretagne Occidentale, d'une part, et avec la communauté d'universités et établissements – COMUE – de l'Université Bretagne Loire, d'autre part. À ce jour, aucune fusion n'est prévue entre l'UBS et l'UBO. En revanche, leurs autorités respectives souhaitent établir une relation stratégique et équilibrée en matière de formation et de recherche. Elles procèdent, en outre, à un rapprochement avec l'école nationale d'ingénieurs de Brest, l'ENIB, en vue de proposer une politique de sites originale.
Je souhaite, en effet, que tous les établissements d'enseignement supérieur préparent leurs projets respectifs et réfléchissent à ce que j'appelle leur signature. Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance leur permettra de s'organiser afin de soutenir ces projets, plutôt que de se préoccuper en premier lieu des questions d'organisation.
L'UBS et l'UBO présentent d'ores et déjà une réelle convergence à l'échelle de nombreux laboratoires de recherche ainsi que de la mise en oeuvre de projets communs à haute valeur ajoutée. Elles ont notamment été lauréates des appels à projets « Écoles universitaires de recherche » et « Nouveaux cursus à l'université ». Par ailleurs, elles disposent de laboratoires d'excellence en commun et sont impliquées dans des actions bipartites ou tripartites telles que des contrats doctoraux communs, des formations co-accréditées et des démarches communes à l'international.
Le Gouvernement est attaché à la cohérence de l'offre de formation et de recherche dans la région Bretagne et veillera à la garantir. Tous les établissements concernés sont actuellement membres de la communauté d'universités et établissements de l'Université Bretagne Loire, qui est néanmoins en cours de réorganisation afin de donner davantage de souplesse à chaque université dans l'établissement de son projet. Tel est notamment le cas de l'université de Rennes 1, dont les autorités ont manifesté leur volonté de retrouver davantage de souplesse dans leurs relations avec la COMUE.
En aucun cas, nous ne souhaitons une partition en deux pôles concurrents du paysage breton de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes, en revanche, favorables à une évolution du modèle d'organisation de l'Université Bretagne Loire tel qu'il a été pensé lors de la création de la COMUE interrégionale. L'UBS jouera tout son rôle dans ce processus, qui prendra forme juridiquement dans le cadre d'une ordonnance que le Gouvernement promulguera si le Parlement lui en donne l'habilitation.

Je vous remercie, madame la ministre, d'avoir confirmé l'intérêt de ces territoires de projet. Nous y croyons beaucoup, d'autant plus que l'Université Bretagne Sud est de création récente et qu'elle a su, peut-être mieux que d'autres universités, établir une relation très concrète avec les entreprises de notre secteur ainsi qu'avec les élus.
Nous sommes très attachés à faire en sorte qu'elle ne soit pas englobée, perdue dans un univers trop vaste afin qu'elle demeure réellement au service de tous les étudiants, en particulier des étudiants morbihannais qui choisissent le territoire de proximité.
La séance, suspendue quelques instants, est immédiatement reprise.

La parole est à M. Didier Le Gac, pour exposer sa question, no 246, relative à l'emploi dans le secteur de la déconstruction navale.

Je souhaite appeler l'attention du ministre de l'économie et des finances sur la situation du secteur de la déconstruction navale. À côté du secteur de la construction et de la réparation navales, civiles comme militaires, qui représentent environ 42 000 emplois en France, il existe également des activités de déconstruction des navires dont il importe également de se préoccuper afin d'assurer le développement d'une filière durable intégrant récupération, traitement et valorisation des matériaux issus du secteur naval.
À cet égard, il est fondamental d'assurer la déconstruction des navires français dans les chantiers du territoire national et de suivre une logique de proximité impliquant que les navires soient déconstruits au plus près de leur lieu de dépôt, sans les remorquer sur de longues distances ni les exporter hors de France. C'est ainsi qu'à Brest, par exemple, deux sous-marins diesel attendent leur déconstruction alors que le port de Brest dispose d'un chantier homologué aux normes européennes. Je rappelle d'ailleurs que la France compte trois sites sur les dix-huit homologués de l'Union européenne.
Il faut également prendre en considération l'aspect international et concurrentiel de cette activité. Des chantiers étrangers, qui sont parfois de simples plages, comme en Inde ou au Bangladesh, assurent un démantèlement très en deçà des normes sociales et environnementales exigées par la réglementation en France et dans l'Union européenne, en dépit de l'adoption, le 15 mai 2009, de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. Encore récemment, vingt-deux ports situés hors de l'Union européenne, dont sept en Turquie, se sont portés candidats à une homologation européenne !
Je souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de favoriser les ports français face aux ports étrangers en la matière ainsi que l'accès à la déconstruction des navires militaires, notamment à Brest.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le député, la capacité des chantiers français à assurer la déconstruction des navires est une nécessité environnementale tout autant qu'un enjeu économique pour la filière navale.
La France mène de longue date une action au niveau européen et international pour faire respecter par le maximum de pays des normes de protection des travailleurs et de l'environnement dans le démantèlement des navires. Elle s'est impliquée dans l'élaboration de la Convention de Hong Kong au sein de l'Organisation maritime internationale, et a été le premier État membre de l'Union européenne à la ratifier, le 2 juillet 2014.
La France a également soutenu l'adoption d'un règlement européen relatif à la déconstruction des navires, qui sera applicable à la fin de l'année 2018. Elle s'implique activement dans la mise en oeuvre de ce nouveau cadre et sera présente au comité qui se réunira le 18 avril prochain pour discuter de la mise à jour de la liste des installations homologuées.
Les installations situées hors de l'Union européenne qui en ont fait la demande n'intégreront la liste que si elles respectent les mêmes normes que les installations françaises déjà homologuées. Lorsque ce règlement sera entré en vigueur, la France restera attentive à sa portée effective, en particulier quant à l'utilisation et aux effets de la mise en oeuvre de la liste européenne des installations de recyclage des navires.
Ces actions sont essentielles à la compétitivité, dans des conditions équitables, des quatre sites homologués aux normes européennes que compte aujourd'hui le territoire national, dont deux sont situés au Havre, un à Brest et un à Bordeaux.
En ce qui concerne les navires militaires, ils sont déconstruits dans le périmètre des pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, selon une interprétation très stricte – et purement française – du règlement européen 10132006 relatif au transfert des déchets.

Merci de cette réponse, de nature à rassurer les acteurs de la filière de déconstruction. Vous avez notamment rappelé la nécessité de mettre à jour la liste des installations de recyclage et d'y inclure uniquement des sites qui respectent les normes européennes.
Pour donner la mesure de ce secteur, je ne citerai qu'un seul chiffre : selon l'ONG Shipbreaking Platform, parmi les 835 navires de transport océanique qui ont été envoyés dans les chantiers de démolition en 2017, 543 ont été déconstruits sur des plages.

La parole est à Mme Jacqueline Maquet, pour exposer sa question, no 251, relative au droit à l'oubli.

Madame la secrétaire d'État, en 2015, le Gouvernement, par le biais d'une convention entre le ministère de la santé, le ministère de l'économie et les assureurs, avait fait un pas majeur dans le domaine du droit à l'oubli. Derrière cette notion se cachent des centaines de milliers de personnes victimes d'un cancer ou d'une hépatite et qui, malgré leur rémission, devaient encore affronter la déclaration de leur ancienne maladie dans le cadre de la souscription à une assurance emprunteur.
Aujourd'hui, le délai est de dix ans pour les adultes n'ayant pas connu de rechute et de cinq ans pour les mineurs. C'est bien, mais c'est encore trop. Ces maladies sont déjà suffisamment pénibles pour ne pas y ajouter la difficulté de construire un projet de vie.
Le candidat Emmanuel Macron avait, dans son programme présidentiel, souhaité poursuivre cette lutte contre la discrimination médicale en fixant le délai à cinq ans pour les adultes, tout en élargissant le droit à l'oubli à d'autres maladies.
Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, confirmer la volonté du Gouvernement de s'engager en faveur du droit à l'oubli, et ainsi de faire en sorte qu'à l'épreuve de la maladie ne s'ajoute pas celle de la marginalisation sociale ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Madame la députée, le droit à l'oubli a en effet constitué une avancée très importante dans l'accès à l'assurance emprunteur, et donc au crédit, pour des personnes dont les données scientifiques prouvent qu'elles ne représentent pas un risque aggravé. Il y avait là une discrimination qui n'était pas acceptable.
Ce droit, consacré par le législateur en janvier 2016 avec la loi de modernisation de notre système de santé, repose sur le processus conventionnel « s'assurer et emprunter avec un risque aggravé en santé », AERAS, qui rassemble associations de malades et de consommateurs et professionnels de l'assurance et de la banque.
Les groupes de travail, composés notamment de médecins spécialistes, s'attachent à étendre toujours plus le champ d'application de ces dispositions, pathologie par pathologie. Ce travail de fond fait de la convention AERAS un outil précieux, auquel nous sommes très attachés.
D'éventuelles évolutions législatives feront l'objet d'échanges avec le ministère de la santé, puisque le droit à l'oubli est défini dans le code de la santé publique.

Madame la secrétaire d'État, l'évolution des traitements et de la recherche permet d'ores et déjà, me semble-t-il, de mettre en oeuvre cet engagement.

La parole est à Mme Valérie Rabault, pour exposer sa question, no 244, relative au Crédit mutuel Arkéa.

Ma question porte sur la stabilité du secteur mutualiste, notamment au regard du souhait récemment exprimé par le Crédit mutuel Arkéa de faire sécession du groupe Crédit Mutuel. Ce souhait de sécession suscite plusieurs questions.
Tout d'abord, confirmez-vous que le Gouvernement n'a pas l'intention de modifier la loi existante concernant les établissements mutualistes ? Dans ce cas, confirmez-vous que si la société Arkéa se séparait du groupe Crédit Mutuel, ses sociétaires perdraient aussitôt ce statut ? Vos services se sont-ils assurés que l'ensemble des sociétaires d'Arkéa ont bien compris cette conséquence d'une éventuelle sécession ? Cette vérification est primordiale pour éviter par la suite tout recours lié à une mauvaise information des sociétaires.
Ensuite, en tant que régulateur du secteur bancaire français, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, a-t-elle apprécié les risques de crédit, de liquidité et de taux qui résulteraient de la sécession d'Arkéa ? Si cette étude a été menée, le Gouvernement peut-il en révéler les conclusions ? Dans le cas contraire, pouvez-vous nous indiquer pourquoi, et le Gouvernement s'engage-t-il à la réaliser ?
Enfin, bien que la relation qui lie Arkéa au groupe Crédit mutuel relève du droit privé, l'ACPR est en droit d'apprécier l'évolution des risques bancaires – de marché, de taux, de liquidité – qui seraient susceptibles de résulter de cette séparation pour l'ensemble du système bancaire français, et notamment du secteur mutualiste. Sur ce point, pouvez-vous nous apporter des précisions ?
Mes questions sont très précises ; j'espère vraiment que les réponses le seront tout autant.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Madame la députée, le Gouvernement suit attentivement les développements du différend qui oppose la Confédération nationale du crédit mutuel et Crédit mutuel Arkéa, mais il n'a pas vocation à arbitrer ce conflit, qui relève d'une divergence de vues stratégique et commerciale. Nous souhaitons toutefois que, dans toute la mesure du possible, ce différend soit résolu à l'amiable, d'une façon qui satisfasse l'ensemble des parties prenantes, sous le contrôle du superviseur bancaire.
Nous prenons note de la consultation en cours des administrateurs de caisse du Crédit mutuel Arkéa sur l'opportunité d'une scission. Nous souhaitons qu'elle apporte toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité nécessaires. Les administrateurs et sociétaires des caisses du Crédit mutuel Arkéa doivent être dûment informés des conséquences d'une scission, pour les sociétaires comme pour les clients et épargnants. Des précisions doivent notamment être apportées sur les modalités juridiques de la mise en oeuvre d'une telle évolution.
Le Gouvernement exclut toute évolution du cadre législatif applicable aux groupes mutualistes. Une modification pourrait l'affaiblir, au moment où nous devons, au contraire, veiller à préserver son intégrité afin de mieux en défendre les spécificités au niveau européen.
Christian Noyer a conduit une mission de médiation, qui a montré que des voies d'évolution à cadre législatif constant existaient. Ce sont ces pistes qu'il convient d'envisager de suivre de manière privilégiée, sous le contrôle de l'ACPR.
Il appartient donc aux parties prenantes de préciser les modalités d'une séparation, et d'en discuter avec l'autorité de contrôle afin que celle-ci apprécie et donne son agrément à ce nouveau schéma.

Je comprends donc que le Gouvernement n'envisage pas de modifier la loi, et qu'en conséquence, s'il y a scission – à l'issue d'une discussion qui relève effectivement du droit privé – , les sociétaires d'Arkéa perdront ce statut, puisque le nouvel établissement ne pourra pas bénéficier des spécificités du statut d'établissement mutualiste.

La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille, pour exposer sa question, no 241, relative à la déclaration des versements en espèces et à la lutte contre l'économie souterraine.

Le trafic de stupéfiants et l'économie souterraine dans son ensemble représenteraient 0,1 % de notre PIB. Beaucoup de gens en vivent et règlent leurs dépenses usuelles en espèces : le paiement en espèces rend possible et favorise le fonctionnement de l'économie souterraine ; il permet de rester dans l'anonymat et de faire entrer dans notre économie des sommes acquises de manière illégale. Comment mieux connaître, afin de mieux le limiter, le recyclage de cet argent issu de l'économie souterraine ?
Les administrations, les services communaux ou encore les offices de logements sociaux acceptent des paiements en espèces en fonction de plafonds variables : pour les finances publiques, le règlement en espèces est autorisé jusqu'à 300 euros ; pour les loyers, le plafond est fixé à 1 000 euros pour tous les citoyens. La loi prévoit deux exceptions : les personnes n'ayant pas de compte de dépôt ou ne résidant pas en France au sens fiscal peuvent payer l'intégralité des sommes dues en liquide.
Les services de proximité de nos communes sont confrontés en permanence à des personnes réglant systématiquement leur loyer ou les factures de cantine ou les activités de leurs enfants en espèces. Pourrions-nous imposer aux différents organismes précités la déclaration systématique de ces règlements en espèces, lorsqu'ils sont effectués de manière régulière, aux services municipaux, fiscaux et préfectoraux, ainsi qu'aux autorités de police ?
Cette mesure facile et pratique permettrait aux autorités de mieux connaître et de mieux évaluer l'importance de l'économie souterraine, et surtout d'identifier les familles qui vivent de ces trafics.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le député, la lutte contre l'économie souterraine et pour une meilleure détection des flux financiers, notamment en lien avec le financement du terrorisme, constitue pour les pouvoirs publics une préoccupation constante. Le Gouvernement a pour objectif de limiter la circulation des espèces et d'accroître la traçabilité de l'ensemble des paiements, par exemple des cartes prépayées.
S'agissant de l'estimation de la part de l'économie souterraine, les nombreuses études nationales et internationales qui ont été produites se heurtent toutes au même écueil de la mesure de l'économie informelle. Parmi les ordres de grandeur très variables qui sont donnés, votre chiffre de 0,1 % me semble plutôt bas.
À la fin de l'année 2015, dans le contexte dramatique des attentats, le ministre de l'économie et des finances avait pris plusieurs mesures dans le cadre du plan d'action national contre le financement du terrorisme. L'une d'elles a abaissé à 1 000 euros le seuil, auparavant fixé à 3 000 euros, des paiements en liquide pour les transactions entre un particulier et un professionnel. Nous sommes ainsi en pointe sur ce sujet au sein de l'Union européenne.
Ce plan vise également à faire reculer l'anonymat des paiements. À cet effet, il renforce l'encadrement de l'usage des cartes prépayées. Ainsi, sur le territoire national, tout support physique de paiement alimenté depuis des moyens de paiement non traçables – espèces ou monnaie électronique anonyme – doit faire l'objet d'une prise d'identité au premier euro à chaque rechargement de ladite carte prépayée.
D'ores et déjà, les administrations de l'État, les collectivités territoriales et toutes les personnes chargées d'une mission de service public peuvent adresser à Tracfin, le service en charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins, des informations de soupçon sur des personnes ou des groupes de personnes pour lesquels l'usage des espèces pourrait être mis en lien avec des signaux faibles portant sur divers trafics illicites. Des actions de communication sur ce dispositif sont envisagées afin d'en expliquer le mode opératoire.
En matière de déclarations systématiques sur l'usage des espèces, il existe deux dispositifs qui portent à la connaissance de Tracfin de tels flux financiers. Les lois du 28 janvier 2013 et du 26 juillet 2013 ont créé, pour les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique, une obligation de communication systématique d'informations à Tracfin.
S'agissant des opérations de transmission de fonds, depuis le 1er octobre 2013, chaque mois, les établissements gestionnaires adressent à Tracfin un fichier répertoriant les envois et réceptions de fonds effectués à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaies électroniques dépassant 1 000 euros ou 2 000 euros cumulés, par client, sur un mois civil.
Depuis le 1er janvier 2016, les établissements financiers envoient mensuellement à Tracfin un relevé retraçant les opérations de dépôt et de retrait d'espèces supérieurs à 10 000 euros cumulés sur un mois.
Ces dispositions permettent d'enrichir les investigations menées sur les personnes physiques et morales citées dans une déclaration ou une information de soupçon.
Le Gouvernement est disposé à engager une réflexion sur l'adaptation d'un dispositif équivalent retraçant les paiements en espèces, à partir d'un seuil à expertiser, pouvant s'appliquer au règlement des loyers que vous abordez dans votre question.

Dans les communes, nous sommes habitués à voir des personnes payer régulièrement en espèces. Les personnes qui vivent de trafics règlent sous cette forme leurs dépenses – cantine ou autres loyers – auprès des services municipaux. Il n'est pas question ici d'établissements financiers. Bien plus simplement, il serait intéressant qu'un établissement public qui est payé en espèces de manière systématique par un usager puisse le signaler. Je serais reconnaissant au Gouvernement d'examiner cette question.

La parole est à M. Hubert Wulfranc, pour exposer sa question, no 233, relative à la situation du groupe Essity France.

Le groupe suédois Essity, anciennement SCA Tissue et spécialisé dans les produits d'hygiène et de santé à base de cellulose, est en passe d'officialiser un plan de restructuration supprimant 200 emplois dans ses deux entreprises normandes, dont l'une est condamnée à la fermeture à la fin de l'année 2018.
Déjà frappés par un plan de sauvegarde de l'emploi en 2016 qui s'est traduit par la suppression de 200 postes, les sites normands de Saint-Etienne-du-Rouvray et d'Hondouville font définitivement les frais de la stratégie du groupe qui a scindé récemment ses activités en deux branches distinctes : d'un côté, SCA, premier propriétaire forestier d'Europe, qui s'est recentré sur la production de pâte à papier ; de l'autre, Essity, numéro deux mondial du secteur qui fabrique les marques Lotus, Demak'Up, Nana, ainsi que des produits de marques distributeurs.
Essity a été introduit en bourse en 2017. Le groupe a réalisé 215 millions d'euros de bénéfice net à la fin de la même année et annonce viser un rendement de ses capitaux à hauteur de 15 % pour ses actionnaires.
Interrogé par mes soins en mars 2016, au sujet du premier plan de sauvegarde de l'emploi, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, notait, concernant le site de Saint-Etienne-du-Rouvray, « un manque certain de volonté de la direction de partager des informations avec les services de l'État et un réel manque d'activité qui perdure sur cette implantation depuis son acquisition ». Aussi concluait-il en indiquant avoir demandé « un préambule écrit à un accord de méthode précisant la politique industrielle du groupe SCA pour les prochaines années pour les sites français ; les investissements industriels prévus notamment sur les sites normands et leur effet sur l'emploi. »
Le ministère de l'économie a-t-il eu connaissance de tels engagements et si non, pourquoi ? S'il en a eu connaissance, la situation actuelle était-elle déjà prévisible, sans que rien n'ait été entrepris vis-à-vis du groupe ou pour la protection des intérêts des salariés ?
Que comptez-vous faire pour qu'Essity assume ses responsabilités en matière sociale et industrielle ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le député, vous appelez l'attention du Gouvernement sur la situation des salariés du groupe Essity qui a annoncé une réorganisation d'une partie de ses activités productives sur le territoire national. Cette restructuration pourrait concerner plusieurs sites du groupe, à Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime, à Hondouville dans l'Eure, et à Kunheim dans le Haut-Rhin.
J'ai demandé à mes services de suivre ce dossier avec la plus grande attention. À cet effet, le délégué interministériel aux restructurations d'entreprise recevra, dans les jours qui viennent, la direction de l'entreprise.
En application de la loi de sécurisation de l'emploi, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit être saisie pour homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) négocié entre l'entreprise et les instances représentatives du personnel. Pour ce faire, elle doit s'assurer du respect de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel et de la qualité des mesures contenues dans le PSE. Ces mesures feront l'objet d'une étude attentive, tout particulièrement les mesures d'accompagnement des salariés qui ne pourraient bénéficier d'un reclassement interne au sein du groupe.
Je veux ici assurer que les services de l'État resteront attentifs quant à l'évolution de la situation afin que cette opération se déroule de manière responsable pour les salariés et les territoires concernés.

J'ai moi-même eu affaire aux représentants du groupe Essity, et j'avoue que mes craintes demeurent sur la stratégie du groupe et sur la capacité de ce dernier à honorer ses engagements, si engagements il y a.
J'appelle également votre attention, madame la secrétaire d'État, sur le fait que l'entreprise de l'agglomération rouennaise, celle que je connais le mieux, est l'une des rares à demeurer dans ce désert industriel qu'est devenu l'axe de la Seine entre Rouen et Oissel, qui était, dans les années soixante-dix, le fleuron de l'industrialisation de l'agglomération rouennaise.
J'espère que le Gouvernement prend bien la mesure de ces enjeux de redynamisation industrielle, d'autant que ce périmètre est toujours menacé par la réalisation d'infrastructures – en particulier le contournement est de Rouen – qui privent de centaines d'hectares le développement industriel de Seine Sud. Vous admettrez que, dans une telle situation, les craintes des élus locaux quant à la redynamisation industrielle de ce secteur majeur de la métropole rouennaise sont légitimes.

La parole est à M. Michel Larive, pour exposer sa question, no 230, relative aux dépenses d'action sociale des départements.

Depuis plusieurs années, les dépenses d'action sociale des départements augmentent constamment. Le nombre de bénéficiaires du RSA a bondi de plus de 30 % entre 2009 et 2015, tandis que le taux de prise en charge de cette allocation par l'État est passé de 90,4 % en 2009, à moins de 60 % aujourd'hui.
La part de l'aide sociale à l'enfance dans le budget des départements augmente considérablement avec l'arrivée massive des mineurs non accompagnés, les MNA. En Ariège, les montants consacrés à l'accueil de ces mineurs ont presque doublé entre 2016 et 2017.
Les dépenses engagées pour soutenir les personnes en situation de handicap augmentent elles aussi, tandis que le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie – CNSA – a beaucoup diminué. Quant au taux de prise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie par la CNSA, qui était autour de 50 % en 2002, il n'est plus que de 35 % aujourd'hui, alors que les projections démographiques indiquent que le nombre de bénéficiaires de cette allocation va inévitablement s'accroître.
Les transferts de fiscalité vers les départements sont insuffisants pour couvrir ces dépenses. La plupart des départements ont donc entrepris de se restructurer et de rationaliser leurs dépenses, au prix d'une réduction des services publics et d'une baisse de la qualité de l'aide sociale.
Compte tenu de tous ces éléments, et sachant que certains départements, comme l'Ariège, ont déjà réalisé de lourds efforts budgétaires, pourquoi imposer aux départements, sous peine de sanctions financières, un taux d'augmentation maximal de leurs dépenses de fonctionnement de 1,2 % ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Le dispositif de contractualisation prévu par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 vise à faire contribuer toutes les collectivités à l'effort de réduction de la dépense publique à juste proportion du poids des dépenses locales dans l'ensemble de la dépense publique.
L'effort demandé s'élève à 13 milliards d'euros au cours de la période 2017-2022. Il est calculé par rapport à la hausse tendancielle estimée des dépenses locales, sans procéder – au moins en ce qui concerne l'année 2018 – à une baisse de dotations, ainsi que l'a confirmé le Président de la République le 5 septembre 2017. La loi de finances de 2018 prévoit, pour la première fois depuis 2014, le maintien intégral de la dotation globale de fonctionnement.
La concertation entre l'État et les collectivités locales, dans le cadre de la conférence nationale des territoires et de sa réunion à Cahors le 14 décembre dernier, a permis de définir les modalités de la maîtrise des dépenses locales, inscrites désormais aux articles 13 et 29 de la loi de programmation des finances publiques.
L'article 13 fixe à 1,2 % par an l'objectif national d'évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il prévoit, par ailleurs, un objectif national d'amélioration du besoin annuel de financement de 2,6 milliards d'euros chaque année sur la période 2018-2022.
L'article 29 dispose que les collectivités s'engageront par contrat avec l'État sur un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que sur un objectif de réduction du besoin de financement.
Ainsi, en application de l'article 29, une procédure innovante de contractualisation est prévue pour 322 collectivités – les départements et les régions, ainsi que les communes et EPCI dont les dépenses de fonctionnement 2016 sont supérieures à 60 milliards d'euros – qui concentrent les deux tiers des dépenses des collectivités locales.
Dans le contrat prévu entre les départements et l'État sur la période 2018-2020, n'entrent pas en compte dans le calcul des 1,2 % les dépenses au titre des AIS – allocations individuelles de solidarité, qui regroupent l'allocation personnalisée autonomie, la prestation de compensation du handicap, et le revenu de solidarité active. L'objectif national d'évolution de 1,2 % des dépenses réelles de fonctionnement – DRF – , est assorti d'une possibilité de modulation selon trois critères retenus par le législateur : le critère de population ou logement autorisés ; le critère du revenu moyen par habitant ; le critère de l'évolution des DRF. Ainsi, tous les départements ne se voient pas automatiquement assigner un taux d'évolution à 1,2 % : chaque situation individuelle est examinée au cas par cas au moment de la discussion avec les services de l'État.
S'agissant de la situation financière des départements à partir des dernières restitutions comptables disponibles, les résultats prévisionnels de 2017 sont les suivants : les dépenses réelles de fonctionnement 2017 des départements afficheraient une baisse de 0,6 %, en partie grâce au recul des achats et charges externes qui se poursuit en 2017. En effet, les autres postes de dépenses connaissent une progression : plus 1,5 % pour les charges de personnel, plus 1,5 % pour les aides à la personne et plus 2,8 % pour les frais de séjour.
En matière de recettes, les départements bénéficieraient, cette année encore, d'une forte dynamique des recettes de droits de mutation à titre onéreux – DMTO – à hauteur de 16,6 % – , mais accusent une baisse de la fiscalité directe de 4,7 % et des concours de l'État de 7,5 %. Au final, les produits de fonctionnement réels sont à un niveau inférieur de 0,8 % à celui de 2016. La capacité d'autofinancement brute s'établit à 8,3 milliards d'euros, en léger retrait par rapport à 2016.
S'agissant du financement des dépenses d'AIS, les discussions sont en cours, sur la base notamment des récentes préconisations de la mission confiée à Alain Richard et Dominique Bur.

La parole est à M. M'jid El Guerrab, pour exposer sa question, no 263, relative aux prélèvements sociaux auxquels appliqués aux Français de l'étranger.

Je souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une question de justice fiscale à l'égard des Français établis hors de France.
Depuis 2012, les revenus français des non-résidents sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 15,5 %. Or, le 26 février 2015, la Cour de justice de l'Union européenne – CJUE – a estimé que ces prélèvements constituaient non pas des impôts mais des cotisations sociales et a donc déclaré cette disposition non conforme au droit européen. Pour se conformer à cette décision, l'État français reverse, depuis le 1er janvier 2016, les recettes des prélèvements sociaux sur le Fonds de solidarité vieillesse.
Par ailleurs, le prélèvement de ces contributions étant incompatible avec l'interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale, avec la libre circulation des travailleurs et avec la liberté d'établissement, l'État français a été contraint de restituer le trop-perçu. Toutefois, l'administration fiscale a procédé au remboursement des prélèvements indûment perçus aux seules personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse. Cela a eu pour effet direct d'exclure du remboursement les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État situé hors de l'Union européenne.
Cette distinction géographique est inéquitable, puisque les contribuables établis hors de l'Union cotisent à un régime de protection sociale sans pouvoir en bénéficier. Il y a là une rupture d'égalité, accentuée par le fait que les pouvoirs publics ont contourné la jurisprudence de la CJUE avec le versement sur le Fonds de solidarité vieillesse. Les revenus du patrimoine immobilier de source française perçus par les non-résidents ne devraient pas être assujettis aux prélèvements sociaux.
Je me félicite de l'annulation du décret du 30 décembre 2017, intervenue le 19 février dernier. Néanmoins, au moment où ma collègue Anne Genetet réfléchit à la situation des Français de l'étranger dans le cadre de la mission que lui a confiée le Premier ministre, je souhaiterais savoir si une évolution plus globale du cadre juridique de ces prélèvements était envisagée.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur El Guerrab, comme il a déjà eu l'occasion de le dire devant l'Assemblée des Français de l'étranger, le Président de la République souhaite que, dans un contexte marqué par une mobilité croissante de nos compatriotes, les administrations françaises s'engagent dans un effort supplémentaire de simplification pour les Français résidents à l'étranger et que soit examinés avec attention certains dispositifs de fiscalité et de sécurité sociale.
C'est pourquoi le Premier ministre a confié à Mme Anne Genetet, députée, une mission sur l'ensemble de ces sujets. Il lui est notamment demandé de procéder à une évaluation du régime de prélèvements obligatoires applicable aux citoyens français non résidents, afin d'évaluer leur niveau de participation aux finances publiques et au financement de la protection sociale de la France, notamment en établissant une comparaison avec la situation des contribuables non résidents des pays étrangers.
Un deuxième volet de la mission doit porter sur l'accès des citoyens français non résidents aux prestations de sécurité sociale, en particulier sur le fonctionnement de la Caisse des Français de l'étranger. Des recommandations pourront, si nécessaire, être formulées afin d'améliorer la qualité des services proposés.
Sur ces deux volets, la simplification de l'accès aux services ainsi que leur dématérialisation devront faire l'objet d'une évaluation et de recommandations. La mission doit certes s'appuyer sur les services des administrations compétentes, mais elle prêtera une attention particulière aux revendications des Français établis hors de France. Ses conclusions sont attendues pour le 1er juin 2018.

Nous attendons effectivement avec beaucoup d'impatience les résultats de cette mission. Je suis certain que ma collègue Anne Genetet mènera ses travaux – auxquels nous contribuerons – avec la plus grande méticulosité, en associant l'ensemble des associations représentant les Françaises et les Français de l'étranger. En tout cas, il faut vraiment partir du principe qu'il est anormal que les Françaises et les Français de l'étranger contribuent sans contrepartie à un régime de protection sociale dont ils ne bénéficient pas ; il serait légitime de remettre tout le système à plat et de leur « rendre » cet argent.

La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour exposer sa question, no 243, relative aux moyens des missions locales.

Ma question s'adresse à Mme la ministre du travail. Elle concerne l'avenir de notre jeunesse et celui des missions locales. Celles-ci font face, depuis quelques semaines, à une baisse sans précédent de leurs moyens, qui sont destinés à accompagner les jeunes dans leurs parcours d'insertion.
En juin dernier, nos collègues sénateurs François Patriat et Jean-Claude Requier ont présenté un rapport indiquant que les missions locales obtenaient de bons résultats en matière d'insertion des jeunes. Pourtant, depuis quelques semaines, partout en France, l'inquiétude monte face à une baisse drastique des moyens qui ne dit pas son nom. Au titre de la convention pluriannuelle d'objectifs – CPO – , 206,5 millions d'euros ont été alloués, hors garantie jeunes, aux missions locales, ce qui signifierait, en théorie, une très légère augmentation des crédits par rapport à l'année précédente. Or, sur le terrain, il n'en est rien ; le compte n'y est pas : on constate partout des baisses de financement, de l'ordre de 4 à 10 % selon les missions locales. De plus, les crédits spécifiques destinés à financer l'allocation que peut percevoir un jeune dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, le fameux PACEA, sont passés de 23 millions d'euros en 2016 à 10 millions pour 2018, soit une division par deux. Cette très forte régression est encore aggravée par le financement, sur l'enveloppe 2018, des restes à payer de 2017.
Au vu de cette situation alarmante, les missions locales, comme les jeunes, souhaitent connaître les intentions concrètes du Gouvernement en vue de garantir les moyens indispensables au fonctionnement desdites missions, dont l'efficacité est reconnue. Plus particulièrement, quelles corrections entendez-vous apporter en urgence pour que les engagements pris par l'État dans le cadre de la CPO soient réellement tenus et pour que les moyens d'accompagnement de notre jeunesse, notamment l'allocation PACEA, soient à la hauteur des besoins ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Madame Pires Beaune, je vous réponds au nom de ma collègue ministre du travail, dont je vous prie d'excuser l'absence.
Les missions locales sont un maillon important du service public de l'emploi, chargé de repérer, d'accueillir, d'orienter et d'accompagner les jeunes en difficulté, notamment les moins qualifiés d'entre eux. Notre priorité est de donner une qualification, un métier à ces jeunes, et les missions locales ont toute leur place pour y contribuer.
Vous l'avez dit, la contribution de l'État au financement des missions locales a été reconduite en 2018. Il est important de le souligner, car les collectivités territoriales, qui financent elles aussi les missions locales, n'ont pas toujours toutes fait de même. L'État apportera ainsi 22,1 millions d'euros aux missions locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2018.
De plus, il faut avoir une vue beaucoup plus large de la question. Le plan d'investissement dans les compétences a été doté de 15 milliards d'euros sur le quinquennat afin de former et d'accompagner 1 million de jeunes peu qualifiés et 1 million de demandeurs d'emploi de longue durée faiblement qualifiés. C'est un effort considérable, sans précédent, et, naturellement, une part importante des actions destinées aux jeunes dans le cadre de ce plan sera mise en oeuvre par les missions locales. Tel sera le cas, bien sûr, de la garantie jeunes, démarche intensive d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. En 2018, 480 millions d'euros y seront consacrés, la perspective étant que 100 000 jeunes soient accompagnés à ce titre.
Dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, les missions locales pourront aussi se porter candidates, à travers des appels à projets, pour conduire des actions dites de « repérage » des jeunes en difficulté, auxquelles nous consacrerons 100 millions d'euros sur le quinquennat. D'autres actions encore pourront être menées par les missions locales.
Il n'y a donc aucun retrait de l'État : les moyens sont bien présents pour les jeunes et pour ceux qui les accompagnent vers la qualification et vers l'emploi. La place centrale des missions locales est réaffirmée.

J'entends bien – je l'ai dit moi-même – que, globalement, les crédits ne diminuent pas. Toutefois, je vous interrogeais plus particulièrement sur le PACEA, car toutes les missions locales nous alertent à ce sujet. Vous n'avez pas répondu à la question posée, pas plus que Mme la ministre du travail le 20 mars dernier lorsqu'elle a été interrogée par mon collègue Jean-Louis Bricout.
Surtout, il est un peu facile de vous réfugier derrière la garantie jeunes. Celle-ci fonctionne effectivement très bien – nous sommes bien placés pour le savoir, puisque c'est nous qui l'avons créée – , mais ce n'est pas le sujet ; le PACEA est un autre dispositif. Mme la ministre du travail a répondu en évoquant la fongibilité des enveloppes, mais celle-ci ne sert à rien si les crédits ne sont pas suffisants. À défaut de crédits finançant le PACEA, les missions locales pourront-elles bénéficier d'une rallonge ? Ces crédits sont indispensables pour l'avenir de notre jeunesse.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Débat sur le rapport d'information de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants ;
Débat sur la constitution d'une commission spéciale pour examiner la proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures quarante.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l'Assemblée nationale
Catherine Joly