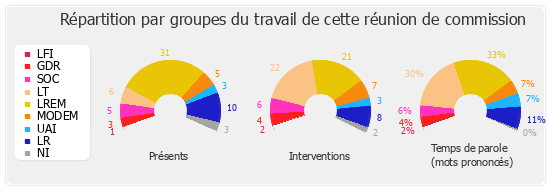Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Réunion du mercredi 5 février 2020 à 9h30
La réunion
Mercredi 5 février 2020
La séance est ouverte à neuf heures trente.
Présidence de M. Stéphane Testé, vice-président
La commission des Affaires culturelles et de l'Éducation procède à l'examen de la proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (n° 2519) (M. Bruno Studer, rapporteur).

Mes chers collègues, je suis heureux d'assurer aujourd'hui la présidence de notre réunion de commission pour l'examen de la proposition de loi du groupe La République en marche visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.
Ce texte a été déposé le 17 décembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le président Bruno Studer, qui en est le premier signataire, a été désigné rapporteur le 22 janvier. Cette proposition de loi sera examinée en séance mercredi 12 février.
Monsieur le rapporteur, voilà un peu plus d'un an que vous travaillez sur ce texte. Vous avez procédé à de nombreux entretiens pour recueillir l'avis des personnes concernées par le sujet sensible et totalement inédit que vous abordez : la protection des enfants face aux nouveaux usages de l'internet.
Vous avez la parole pour nous exposer l'objet de cette proposition de loi et les dispositions que vous avez retenues.

Chers collègues, j'ai grand plaisir à vous retrouver ce matin en qualité de rapporteur de la présente proposition de loi.
J'ai commencé d'y travailler voilà plusieurs mois après m'être rendu compte que se multipliaient ces dernières années sur des plateformes de partage telles que YouTube, pour ne mentionner que la plus connue d'entre elles, des vidéos réalisées et tournées par des parents mettant en scène leurs enfants. Ces derniers sont filmés dans différentes activités, souvent anodines – déballage de jouets, dégustation d'aliments, défis divers tels que passer vingt-quatre heures dans un carton ou manger pendant vingt-quatre heures de la nourriture jaune ou noire.
Mes propres enfants n'échappant pas au phénomène de visionnage – certains comptes rassemblent jusqu'à 5 ou 6 millions d'abonnés, une audience à faire pâlir d'envie les chaînes de télévision classiques –, j'ai regardé avec eux certaines de ces vidéos et j'ai pu faire plusieurs constats. Certains enfants apparaissent dans de très nombreuses vidéos, qui peuvent incorporer des placements de produits ou des publicités. Les situations que font apparaître certaines vidéos peuvent en outre poser problème au regard des droits de l'enfant.
Si je me réjouis qu'internet constitue un espace de création et d'innovation propice à l'apparition de nouvelles formes d'entreprenariat, celles-ci me paraissent néanmoins devoir respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, principe à valeur constitutionnelle auquel nous sommes tous très attachés. J'ai donc souhaité entamer ce travail pour établir un cadre protecteur.
La République sociale s'est construite autour de l'encadrement du travail des enfants, qui, sauf dérogation, est interdit. C'est le cas notamment pour les enfants du spectacle ou les enfants mannequins. Ces régimes ont constitué la base de ma réflexion, et j'ai cherché avec cette proposition de loi à combler le vide juridique actuel.
Même si certaines vidéos peuvent apparaître à la limite de ce qui est acceptable, à l'instar de certaines émissions de télévision, mon ambition était non pas de porter un jugement mais, avant tout, de responsabiliser les différents acteurs, notamment les parents, en leur offrant un cadre juridique clair pour la réalisation de ces activités.
C'est l'objet de l'article 1er de la proposition de loi, qui légalise dans une certaine mesure le travail des mineurs de moins de 16 ans en leur étendant le régime protecteur des enfants du spectacle, et plus particulièrement des enfants mannequins.
Les enfants qui tournent dans des films ou qui se font photographier, par exemple, bénéficient en effet de mesures protectrices qui encadrent leur activité. Ils doivent disposer d'une autorisation individuelle délivrée par la direction départementale de la cohésion sociale pour pouvoir travailler. L'employeur peut aussi demander à l'autorité administrative de bénéficier d'un agrément qui l'exonère de l'obligation d'une demande d'autorisation individuelle pour chaque prestation.
Ce cadre juridique inclut l'obligation de respecter des limitations horaires fixées par décret, et le versement d'une part des revenus de cette activité de travail sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations.
Les parents que j'ai rencontrés sont tout à fait demandeurs d'un tel cadre. Certains ont d'ailleurs déjà entamé des démarches pour agir dans la légalité, et ces dispositions combleront un vide juridique pour les situations dans lesquelles l'activité relève d'une relation de travail.
Toutefois, et c'est ce qui a rendu ce travail à la fois passionnant et chronophage, avec internet, on se situe bien souvent dans une zone grise, notamment pour caractériser la relation de travail. Dans certains cas, celle-ci est très difficile à établir, par exemple du fait de l'absence de consignes.
Des situations qui ne peuvent être qualifiées de travail relèvent donc du loisir, bien qu'elles induisent une exploitation commerciale de l'image des enfants filmés. C'est pourquoi je propose à l'article 3 de rendre obligatoire une déclaration des parents dès lors que les enfants consacrent beaucoup de temps à la réalisation des vidéos ou que celles-ci génèrent d'importants revenus. Cette déclaration entraînera l'application de mesures protectrices pour les enfants, à la fois par la limitation du temps consacré à l'activité et par la protection des revenus qui en sont tirés.
Prenons l'exemple d'un enfant qui jouerait très bien au football. Vous pouvez le filmer sans lui donner de consigne et monétiser cette vidéo ou répondre aux sollicitations d'entreprises qui vous demanderaient de faire du placement de produit en faisant porter à l'enfant des vêtements ou des chaussures d'une marque donnée. Il n'y a pas de relation de travail en l'espèce, mais les vidéos génèrent des revenus. Il faut donc bien s'assurer que l'argent profite à l'enfant, et que l'activité n'est pas réalisée au prix de l'instruction de l'enfant, de sa santé, de son repos, de ses loisirs, ou contre son consentement.
L'article 3 permet donc de couvrir par un cadre protecteur les situations où une relation de travail ne peut être caractérisée, mais dans lesquelles l'image de l'enfant est exploitée commercialement et génère des revenus. Ce cadre reste toutefois moins contraignant que celui de l'article 1er, qui s'applique en cas de relation de travail classique.
Par ailleurs, il m'a paru important de responsabiliser les plateformes et les entreprises concluant des contrats de placement de produit.
S'agissant des plateformes, elles tirent des revenus publicitaires de ces vidéos et, à ce titre, ne peuvent donc s'exonérer de toute responsabilité. Quant aux annonceurs, ils utilisent eux aussi l'image des enfants filmés pour promouvoir leur activité commerciale.
L'article 4 assigne ainsi plusieurs obligations aux plateformes, dans le respect des dispositions du droit européen concernant les hébergeurs et les contenus générés par leurs utilisateurs. Elles doivent permettre aux utilisateurs, réalisateurs ou simples spectateurs, de signaler la présence d'un mineur de moins de 16 ans dans une vidéo.
Au sein de ce premier ensemble de vidéos identifiées grâce au signalement des utilisateurs, la plateforme devra isoler celles qui sont monétisées – et dont elle tire elle-même des revenus – et les transmettre à l'autorité compétente. Celle-ci aura pour charge d'identifier les vidéos problématiques et de mener les enquêtes nécessaires en matière de protection de l'enfance, de droit du travail, de publicité clandestine ou de droit fiscal.
Les plateformes doivent aussi faire oeuvre de pédagogie à l'égard de leurs utilisateurs, afin que ceux-ci soient le mieux informés possible de la réglementation existante et des risques qu'ils font courir à leurs enfants.
Il m'a paru également nécessaire d'améliorer la protection des mineurs dans le domaine du droit à l'image et à la vie privée. Il n'est pas acceptable que des vidéos de vous enfant restent visibles sur internet alors que vous ne souhaitez plus qu'elles le soient. Quand on est mineur et qu'on fréquente le collège ou l'école primaire, on peut regretter être apparu, plus jeune, dans une vidéo réalisée pour un placement de produit ou en vue d'une exploitation commerciale, et souhaiter qu'elle soit supprimée de la plateforme.
L'article 5 permet donc à une personne mineure de demander à la plateforme le retrait d'une vidéo qu'elle ne souhaite plus rendre accessible. Enfin, l'article 6 prévoit les sanctions applicables aux plateformes en cas de non-respect de ces obligations.
L'objectif de la proposition de loi est donc bien de mieux protéger les enfants, et c'est ce qui a véritablement guidé mon travail.
Je le répète, le phénomène visé est relativement nouveau. À l'étranger, ces activités génèrent plusieurs millions d'euros ou de dollars par an. En France, des parents ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à cette production de contenus, et certains d'entre eux souhaitent qu'un cadre juridique clair soit établi.
Aux autres, il faut rappeler que même quand un enfant s'amuse, exploiter commercialement son image peut caractériser une relation de travail, au même titre qu'un enfant jouant un rôle dans un film au cinéma, et il doit être protégé dans l'exercice de cette activité. Quand un enfant déballe des produits, des cadeaux, il peut avoir l'impression de s'amuser, mais si la captation de cette image dégage des revenus, il n'est plus tout à fait dans une activité de loisirs.
La proposition de loi fixe donc un cadre juridique clair aux activités de partage de vidéos mettant en scène des mineurs de moins de 16 ans. Elle place chacun devant ses responsabilités – parents, plateformes, entreprises. Elle permet aux autorités publiques de mieux détecter les situations problématiques au regard des droits de l'enfant, ce qui est un véritable défi quand on sait le nombre de vidéos publiées chaque jour en France et dans le monde.
Ce texte nous donnera la possibilité d'agir, en nous appuyant sur les entreprises et les plateformes, pour que nous puissions proposer des solutions efficaces.

Depuis plusieurs années, nous constatons que sur les plateformes numériques ouvertes, les chaînes et les vidéos mettant en scène des enfants se multiplient. Ces contenus peuvent générer d'importants revenus pour les parents et les plateformes. Certaines vidéos et chaînes ont une audience très forte pouvant atteindre jusqu'à plusieurs millions d'abonnés, et totalisant des milliards de vues.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à offrir un encadrement juridique protecteur pour les enfants concernés par ces vidéos familiales de plus en plus nombreuses sur internet.
Ce phénomène d'ampleur mondiale nous pousse à réagir en tant que législateur afin de combler le vide juridique actuel du droit français. Ce texte ne vise en aucun cas à autoriser le travail des mineurs, qui est strictement interdit et le restera ; il tend à élargir aux enfants youtubeurs le régime dérogatoire en vigueur pour les enfants du spectacle.
Ces activités peuvent en effet s'avérer extrêmement rentables. Certains parents cesseraient même de travailler pour se consacrer pleinement au développement de la chaîne de leur enfant ou au tournage de vidéos. Des parents s'improvisent scénaristes, et peuvent demander à leurs enfants de recommencer une prise de vue plusieurs fois pour obtenir la vidéo parfaite et la diffuser, ce qui caractérise en droit une relation de travail.
En outre, les gains financiers générés, que ce soit par le placement de produits d'entreprises ou du fait de l'audience obtenue, ne sont pas encadrés, et rien ne permet de garantir que l'enfant les percevra à sa majorité.
C'est donc la double peine : les enfants ne bénéficient pas de la protection juridique offerte par le droit du travail et ne touchent pas les revenus dont ils sont pourtant à l'origine.
Bien souvent, les vidéos montrent simplement un moment quotidien passé en famille, un petit-déjeuner ou une promenade au parc. Parfois, sous couvert de divertir un large public au moyen de défis tels que le cheese challenge, qui consiste à envoyer des tranches de fromage au visage d'un jeune enfant, les vidéos diffusées sont clairement dégradantes. Aux États-Unis, des situations ubuesques filmées et diffusées ont d'ailleurs permis d'identifier des cas de maltraitance infantile. Ces abus sont très inquiétants, et la diffusion sur internet de ces moments immortalisés soulève de nombreuses questions au regard de l'intérêt de l'enfant.
Nous n'avons aujourd'hui aucun recul sur les effets psychologiques de l'exposition médiatique sur les enfants, ou sur l'augmentation du risque de cyber-harcèlement et de pédopornographie consécutive à une telle exposition.
La présente proposition de loi est pionnière en matière de protection des droits de l'enfant sur internet : aucun État au monde n'a encore légiféré sur le sujet. Elle s'inscrit dans une action plus large déjà engagée par notre majorité avec le vote de textes visant à lutter contre les fausses informations ou contre la haine sur internet.
Les dispositions du texte doivent encore faire l'objet d'un contrôle juridique – le droit européen, en vertu notamment du principe de territorialité, ne permet pas actuellement de contraindre les plateformes qui ne joueraient pas le jeu.
Protéger les enfants n'en demeure pas moins un souci primordial, et c'est bien le but premier de cette proposition de loi. C'est pourquoi le groupe La République en marche votera ce texte avec beaucoup de conviction.

Au nom du groupe Les Républicains, je tiens à féliciter le rapporteur Bruno Studer de ce texte par lequel il s'est saisi d'un enjeu majeur : l'encadrement de l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.
En effet, si YouTube se décrit habituellement comme une plateforme n'étant pas destinée aux enfants de moins de 13 ans, elle est aujourd'hui le vecteur d'une exploitation commerciale des mineurs au travers de vidéos où se mêlent rémunération, placement publicitaire ou quasi-travail, hors de tout contrôle légal.
Ce phénomène de société s'est particulièrement développé ces dernières années. Certaines chaînes YouTube mettent d'ailleurs en scène presque quotidiennement des enfants, lesquels peuvent être suivis par des millions d'abonnés. Elles dégagent grâce à ces contenus des revenus importants pouvant atteindre jusqu'à 50 000 euros par mois.
Ce « vlogging », dérivé du mot-valise « vlog », contraction de blog et de vidéo, pose des questions majeures d'ordre juridique, telles que la protection de la vie privée des enfants, la licéité de leur exposition à des messages publicitaires pas toujours explicites, et l'exploitation de leur caractère influençable.
Comment le législateur pourrait-il ne pas s'inquiéter d'abord de la protection des enfants quand l'activité de production de telles vidéos atteint des volumes horaires importants ou surexpose les enfants à la publicité, alors même que celle-ci est très encadrée à la télévision aux heures de diffusion des programmes destinés aux plus jeunes ?
Le vlogging pose également la question de l'encadrement des rémunérations tirées du placement publicitaire, des publicités et des produits dérivés.
Cette proposition de loi s'inscrit dans une démarche positive : elle vise non pas à interdire cette pratique, mais à l'encadrer de manière à préserver le développement psychologique des enfants de la surmédiatisation et de la surexposition aux écrans.
L'exposition de la vie privée concerne des enfants de plus en plus jeunes, et aux vecteurs classiques que sont Facebook, Snapchat ou Instagram s'ajoutent de nouvelles formes telles que le vlogging. Cette pratique s'accompagne d'une forte pression sociale et d'une course aux « j'aime », au nombre de vues d'une chaîne ou d'une vidéo.
Cette pression et le rythme qu'impose la poursuite de la célébrité sont potentiellement dévastateurs et ont des conséquences avérées sur la santé et le développement des enfants.
Le groupe Les Républicains considère en outre que les enfants n'ont pas vocation à se transformer en télévendeurs, et que ces pratiques doivent rester secondaires. Le risque de dérive ne faisant l'objet d'aucun encadrement par le droit en vigueur, notre groupe se réjouit particulièrement des nouvelles dispositions prévues par le texte, qui visent à renforcer la législation en s'inspirant du cadre protecteur applicable aux enfants mannequins.
L'article 3, qui fixe un volume de vidéos et un niveau de revenus à partir desquels l'activité de diffusion doit obligatoirement être déclarée auprès de l'autorité administrative, élargit la portée de ce cadre juridique. Les durées de travail pourront ainsi être limitées, et l'enfant bénéficiera à sa majorité du versement d'une partie des revenus tirés de la diffusion, conservés sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations. À l'heure actuelle, rien ne garantit à un enfant qui participe à des vidéos générant des revenus qu'il recevra le moindre euro.
L'examen de cette proposition de loi me donne l'occasion de rappeler que, pour les députés du groupe Les Républicains, l'enfance est un stade crucial du développement et ne saurait se transformer en une période d'activité professionnelle pour assouvir les désirs parentaux de profit. C'est ce qui avait conduit à l'adoption en 1963 de la loi relative à l'emploi des enfants dans le spectacle, et des dispositions renforçant ce régime ont été introduites à notre initiative en 2007 et en 2008.
Nous sommes évidemment attachés à la liberté sur internet, mais il est aussi de la responsabilité du législateur de protéger les plus fragiles. Face à l'appât du gain et d'une rémunération potentiellement importante et en apparence facile, notre rôle est donc de garantir une protection aux plus vulnérables.
Enfin, l'application du droit à l'oubli, rendue de plus en plus effective pour les adultes, doit bénéficier également aux enfants. À cet égard, l'article 5 est une avancée notable pour les droits des auteurs de vidéos.
En conclusion, le groupe Les Républicains est favorable à cette proposition de loi.

Nous examinons ce matin la proposition de loi de notre collègue Bruno Studer visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Cette tentative est une grande première, et nous ne pouvons que nous en réjouir.
En effet, en quelques heures, une simple vidéo peut devenir virale et faire sortir de l'anonymat n'importe quelle personne. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il doit nous interpeller, en particulier quand il implique des mineurs, dont les droits doivent être protégés.
Des vidéos mettant en scène de jeunes enfants ou des adolescents dans diverses situations quotidiennes et visionnées parfois des millions de fois exposent ces mineurs à la vue de tous. Le législateur doit s'interroger sur les moyens de protéger ces enfants, leur image et leur dignité, en encadrant une pratique qui, de surcroît, est à l'origine d'importants revenus dont rien ne garantit qu'ils pourront en bénéficier à leur majorité.
C'est tout l'objet de cette proposition de loi, dont le dispositif nous paraît pertinent. Pour encadrer le phénomène, le texte prévoit de nouvelles dispositions inspirées des régimes en vigueur pour les enfants dans le spectacle et le mannequinat, pratiques qui peuvent être caractérisées comme des activités professionnelles et qui génèrent des revenus.
Dans les cas où l'enfant aurait donné son assentiment et où l'autorisation individuelle aurait été délivrée par l'autorité administrative, mais qu'une relation de travail ne peut être caractérisée, l'article 3 prévoit un encadrement des horaires de travail et la garantie d'une rémunération du mineur par le dépôt jusqu'à sa majorité d'une partie des revenus liés à la diffusion sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations.
Une autre disposition essentielle de ce texte est l'engagement de la responsabilité des plateformes : celles-ci sont tenues de retirer les contenus méconnaissant les obligations prévues.
Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés (MODEM) salue donc l'ambition que cette proposition de loi s'assigne, et souhaiterait même en étendre la portée.
Il faudrait préciser davantage encore le cadre général de l'utilisation de l'image d'enfants sur internet. Ces pratiques, par leur nature, nous obligent à faire preuve d'une grande vigilance et à anticiper les évolutions possibles. L'exposition permanente a des impacts sur la conscientisation et l'appropriation de l'image de soi par les adultes ; qu'en est-il quand la surexposition concerne des enfants en pleine construction ? La manière dont on a laissé s'installer certaines situations est déjà trop dommageable à bien des égards. Le groupe MODEM défendra un amendement qui va dans ce sens, et soutiendra toutes les propositions tendant à préserver la dignité des enfants et à protéger leur image, en particulier par la garantie d'exercice d'un droit à l'oubli.
En conclusion, le groupe MODEM soutient bien évidemment ce texte, qui va dans la bonne direction, mais entend aller encore un peu plus loin en matière de protection de nos enfants sur internet.

Monsieur le président, une fois n'est pas coutume : je serai brève, et vous n'aurez pas à me couper le micro !
Je salue cette proposition de loi dont l'objectif est partagé par le groupe Socialistes et apparentés : protéger les enfants, y compris de leurs propres parents lorsque c'est nécessaire.
Monsieur le rapporteur, nous partageons votre souci de lutter contre la maltraitance, contre l'atteinte à la dignité des enfants, contre l'exploitation commerciale de leur image. Il nous paraît également important de responsabiliser les plateformes, mais nous regrettons que le délai de retrait des vidéos ne soit pas plus précisément défini.
En sus de ces dispositions législatives, il nous semblerait important que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, notamment, s'empare de cet enjeu de société et contribue à l'information des enfants et de leurs parents. Les associations de parents d'élèves pourraient également apporter leur contribution à ce dessein.
L'article 5 prévoit que l'enfant mineur pourra exercer lui-même son droit à l'oubli. Cette possibilité doit faire l'objet d'une campagne d'information auprès des jeunes. Une telle démarche ne va pas de soi dans notre société du tout internet où l'image est reine.
En conclusion, soyez assurés que nous serons au rendez-vous, à vos côtés.

Je salue à mon tour, au nom du groupe UDI, Agir et indépendants, l'initiative de notre collègue Bruno Studer sur un sujet éminemment important. J'ajoute que notre groupe entame toujours avec beaucoup d'enthousiasme les débats sur un texte d'initiative parlementaire – c'est l'occasion de démontrer que, si nous votons la loi et contrôlons l'action du Gouvernement, nous sommes également force de proposition.
La situation que ce texte tend à encadrer est relativement nouvelle ; nous n'y étions pas confrontés voilà dix ou quinze ans. Toutefois, quand on mesure l'étendue du sujet et le manque de protection dont bénéficient les enfants en raison du vide juridique existant, on peut se dire et on doit se dire qu'il est temps de légiférer. Nous vous remercions donc d'en avoir pris l'initiative, monsieur Studer.
Des vidéos mises en ligne sur des plateformes de partage nous invitent à regarder des enfants en train de découvrir des produits envoyés par des marques, de réaliser des défis ou de jouer à des jeux ; les plus regardées peuvent être vues jusqu'à plusieurs millions de fois et, sur les chaînes les plus connues, elles représentent une vraie mine d'or pour les parents, à qui elles rapportent des revenus pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Parfois l'activité est telle qu'il n'est plus question de jeu ou encore moins d'un loisir mais d'une activité à plein temps : l'enfant travaille, ni plus ni moins, sans bénéficier d'aucune protection ; il sacrifie son enfance pour produire toujours plus de contenus, divertir toujours plus, attirer toujours plus de fans, gagner toujours plus en popularité, avoir toujours plus de succès.
Il convient d'encadrer ces activités afin qu'elles restent un loisir et ne se muent pas en un business très rémunérateur. Loin de porter une atteinte excessive à cette activité, qui doit par ailleurs être plaisante lorsqu'elle s'exerce raisonnablement tant pour les enfants, devant la caméra, que pour ceux qui visionnent ces contenus, ce texte propose donc de poser des limites afin d'éviter les abus. Pour ce faire, il reprend le droit existant en étendant le régime applicable aux enfants du spectacle. Il s'agit d'une proposition de bon sens, simple et pragmatique, répondant à besoin primordial, celui de protéger nos enfants.
Il est donc proposé de soumettre cette activité à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable, d'encadrer le volume horaire hebdomadaire, de verser une partie des revenus tirés de l'activité à la Caisse des dépôts et consignations et d'édicter une sanction pécuniaire en cas de non-respect des obligations. Les seuils évoqués seront déterminés par décret : nous ne remettons pas en cause ce recours au décret, mais pouvez-vous nous indiquer, monsieur le rapporteur, les seuils qui devraient être retenus ?
Si notre groupe se réjouit que notre commission puisse, grâce à ce texte, débattre de ce sujet majeur, nous nous demandons si ces dispositifs n'auraient pas pu trouver leur place sous la forme d'amendements au projet de loi portant réforme de l'audiovisuel dont nous débattrons prochainement.
Cela étant, le groupe UDI, Agir et Indépendants votera bien sûr cette proposition de loi, qui propose une solution équilibrée permettant aux enfants de s'adonner à une activité qu'ils affectionnent, tant que celle-ci ne peut être assimilée à un travail, pratiqué hors de tout cadre légal et source d'une importante rémunération pour les parents.

Soucieux de protéger les libertés individuelles et la sécurité des mineurs, nous comprenons évidemment les enjeux de cette proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Nous sommes d'ailleurs plutôt rassurés par la qualité du rapporteur qui en est à l'origine, et nous imaginons que ce texte a dû faire l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Pourrions-nous disposer d'une liste des concertations qui ont été menées, de façon à vérifier qu'elle ne pose aucune difficulté aux uns ou aux autres ?
Nous saluons l'option consistant à s'attaquer aux cas des vidéos qui génèrent des revenus et dont les contenus s'apparentent à du travail déguisé, alors même qu'aucun cadre juridique ne s'applique à cette forme de travail. Quelques questions subsistent malgré tout sur l'opérabilité des dispositifs prévus : quelle place pour la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), l'entité régulatrice vouée à fusionner à terme le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) ? Comment s'assurera-t-on qu'ont bien été délivrés les autorisations individuelles ou les agréments préfectoraux ? Comment faire respecter les horaires de travail, dès lors que ces vidéos sont le plus souvent tournées dans un cadre familial et privé ? Compte tenu de la quantité de contenus en ligne, quelle efficacité doit-on attendre de la procédure de signalement par les utilisateurs des vidéos où figurent des mineurs ?
Notre groupe est évidemment favorable à ce que l'on responsabilise davantage les plateformes numériques – nous avons déjà eu l'occasion de le dire à l'occasion de précédentes discussions, lors de la transposition des directives sur les droits d'auteur ou les droits voisins ou lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet –, à la condition toutefois que cette responsabilisation passe par des actions crédibles et réalisables.
S'agissant enfin du droit à l'oubli, que nous considérons comme un dispositif intéressant, il nous semble important de préciser que des contenus pourront rester en ligne, même après la suppression d'une vidéo, notamment à travers des images y faisant référence. Dans ces conditions, comment faire en sorte que le déréférencement soit efficace ?
Tout en étant plutôt favorables à cette proposition de loi, nous aimerions des éclaircissements sur tous ces points avant d'arrêter notre position définitive.

Avec l'avènement du web 2.0, de nouveaux médias sont apparus. Cette deuxième génération du web permet à chaque internaute de déposer et de promouvoir du contenu sur un réseau informatique mondial, potentiellement visible par des millions d'internautes, notamment par les plus jeunes générations, ce qui entraîne des problématiques spécifiques.
La proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne vient donc combler un vide juridique, et c'est une bonne chose. Le phénomène de popularisation d'enfants et d'adolescents sur internet s'étend sur de nombreuses plateformes, comme Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube, selon des formats aussi divers que la vidéo – qui nous occupe ici –, la photo ou les stories. Créés à l'initiative des parents ou des adolescents, les contenus sont divers, culturels, scientifiques, journalistiques et plus ou moins personnels, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en scène son quotidien. La frontière entre le simple partage en ligne, la recherche de popularité et la démarche commerciale n'est pas toujours clairement affichée.
Certains de ces influenceurs jouissent d'une grande visibilité auprès de communautés d'internautes, et cette « web-notoriété » est lucrative : convoitée par les marques ou sociétés de communication, elle ne fait pas forcément l'objet d'une rémunération directe, mais donne accès à des lieux privilégiés, à des voyages ou à des produits offerts, qui sont autant de contreparties à de contenus promotionnels.
Or ces contreparties ne sont pas valorisées comme des revenus financiers, ni même soumises aux cotisations sociales, alors qu'elles peuvent atteindre des sommes importantes. Il fallait donc légiférer.
Cependant, cette proposition de loi gagnerait à aller plus loin sur certains points. Afin que l'intention des parents et de leurs enfants soit clairement identifiée comme une démarche à but promotionnel, il semble opportun qu'après une demande préalable auprès de la commission des enfants du spectacle soit obligatoirement créé sur les plateformes un compte professionnel qui inclurait le numéro d'agrément délivré par la préfecture. Par ailleurs, les contreparties matérielles non valorisées pourraient, quant à elles, faire l'objet d'une déclaration à partir d'un seuil défini.
Enfin, dans l'article 2 relatif à la méconnaissance de l'obligation d'autorisation individuelle, le délai de retrait devrait être précisé, car le terme « promptement » est trop vague ; il en est de même pour l'article 5 relatif au droit d'oubli numérique, l'expression « dans les meilleurs délais » devant être définie en nombre de jour précis. Nous proposerons en vue de l'examen en séance, des amendements à ce texte, auquel nous sommes plutôt favorables.

Comme ma collègue Muriel Ressiguier, je pense en effet que, compte tenu de l'expansion en France du nombre de ces vidéos commerciales qui mettent en scène des enfants, il était important que l'Assemblée se saisisse du sujet. Je vous remercie donc, monsieur le rapporteur, de cette proposition de loi, même si nous souhaitons y apporter, pour la séance, quelques améliorations.
Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, dénoncent les dangers du playbour – mot-valise constitué à partir de play (jeu) et labour (travail). Ce phénomène nous invite à nous interroger sur l'essor de ce capitalisme digital qui bouleverse les formes d'organisation du travail, dans tous domaines. En effet, la plateforme ici ne coordonne rien, ce sont les parents, voire les adolescents qui sont les donneurs d'ordre, les acteurs produisant la totalité de la valeur ajoutée : une vidéo qui dépasse les onze millions de vues générera environ 10 000 euros mais, pour la plateforme, l'essentiel des revenus provient des données générées par l'analyse des comportements des mineurs. D'où la nécessité de travailler sur la protection des données des mineurs, problématique qui n'est malheureusement pas abordée dans cette proposition de loi.
Il faut également poser la question de l'encadrement du travail des enfants car, contrairement à ce qui se pratique pour les enfants du spectacle, les horaires et la durée de tournage de ces enfants ne sont pas encadrés par le droit du travail, situation d'autant plus préoccupante que certaines chaînes peuvent publier jusqu'à plusieurs vidéos par semaine. Ces enfants n'étant pas considérés comme des enfants du spectacle, ils évoluent dans une véritable zone grise en termes de droit du travail. Nous devons donc contraindre les plateformes à s'adapter à ce code, sans pouvoir y déroger.
Lors du débat en séance sur cette proposition de loi, à laquelle nous sommes plutôt favorables, nous aborderons également la question du cyber-harcèlement des enfants, que l'actualité récente a malheureusement remis au premier plan.

Monsieur le rapporteur, notre groupe propose d'encadrer la commercialisation et la diffusion d'images d'enfants et de bébés sur les réseaux sociaux, phénomène récent qui se développe sur les plateformes de contenus en ligne. La multiplication du nombre de parents qui postent des photos de leurs bébés et de leurs enfants, à des fins commerciales ou non, nous oblige à nous interroger sur le droit à l'image de ces derniers, mais également sur la responsabilité d'entreprises favorisant l'essor de ce phénomène comme Bilbo Kid.
Véritables sources de revenus pour les parents, le placement de produit ou la possibilité qui leur est offerte de devenir influenceurs parentaux oblige à revoir le droit du travail des mineurs. La proposition de loi entend ainsi légiférer pour mieux protéger les enfants, mais plusieurs points restent, me semble-t-il, à préciser : comment détecter les situations d'abus ? Quelle sera l'autorité compétente ? Quel rôle joueront les associations de protection de l'enfance ? Sur quels critères enfin seront fondées les mises en garde, voire les demandes de retrait de contenus adressées aux hébergeurs ?

Cette proposition de loi très intéressante suscite néanmoins des interrogations. En effet, s'il paraît nécessaire de protéger l'image des enfants et d'encadrer certaines pratiques abusives, la question du contrôle sera importante : comment surveiller et contrôler les initiatives individuelles de parents qui postent ponctuellement ces vidéos ? Qui sera en charge de ce contrôle, à quelle échelle et à quel niveau ? En aucun cas en effet, nous ne devons mettre en place une loi qui ne permettrait en réalité ni de contrôler ni de sanctionner, le cas échéant, les auteurs de ces vidéos.

Le sujet dont nous débattons aujourd'hui est d'une grande importance, et il nous appartient en particulier de légiférer pour garantir la protection des enfants qui sont sollicités pour ces vidéos. Il s'agit notamment de s'assurer que la rémunération à laquelle donnent lieu leurs prestations leur reviendra bien lorsqu'ils seront majeurs. Je me réjouis donc que la commission se soit saisie du sujet pour combler le vide juridique actuel.

Je remercie à mon tour notre collègue pour cette proposition de loi qui nous permet d'aborder un sujet d'actualité.
Avez-vous pu auditionner les enfants concernés, mais également les youtubeurs, les twitcheurs, tous ces jeunes auto-entrepreneurs en herbe ?
Qu'en est-il par ailleurs des enfants qui n'agissent pas à l'initiative de leurs parents ? Mon fils de 6 ans connaît Fortnite beaucoup mieux que moi, et les enfants d'aujourd'hui disposent pour certains, même très jeunes, d'une expertise qu'ils vont pouvoir un jour décider de leur propre chef de monétiser. Avez-vous pu également entendre ces enfants ?

Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer l'initiative que vous avez prise avec cette proposition de loi, qui nous permet de venir encadrer une pratique dont les dérives bafouent les droits de l'enfant. Elle ouvre également une réflexion plus large sur la place de l'enfant dans l'univers numérique.
Ce texte s'appuie sur le fait que l'enfant a des droits : il est, par principe, interdit de le faire travailler ; dans le cas contraire, il faut recueillir son consentement et s'assurer qu'il puisse profiter à sa majorité des fruits de son travail ; le contrôle de son image, enfin, lui appartient.
Je voudrais plus particulièrement attirer votre attention sur leurs droits en matière de protection des données personnelles. En effet, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met en exergue la vulnérabilité des enfants et considère qu'ils méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, dans la mesure où ils ne sont pas toujours conscients des risques ou des conséquences liées au traitement de leurs données.
Nous devons donc veiller à interdire le traitement à des fins commerciales des données personnelles que les plateformes pourraient recueillir par le biais de l'identification des contenus audiovisuels où figure un enfant de moins de 16 ans. L'article 6 bis de la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) pose l'interdiction du traitement à des fins commerciales telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. Il est fondamental que ce principe s'applique en l'espèce.

Des parents sont prêts à exposer au tout venant d'internet l'image de leurs enfants filmés dans l'intimité familiale, pour en tirer des revenus, ce qui pose un certain nombre de questions, tout comme la pratique consistant à utiliser l'image de ses enfants à des fins publicitaires, pour permettre le placement de produits. Cette proposition de loi pose certes un cadre nécessaire à ces pratiques mais ne faudrait-il pas tout bonnement les interdire, dans la mesure où elles peuvent s'apparenter à faire travailler des enfants ?

Je m'arrêterai sur l'article 5 et la notion de droit à l'oubli. Lorsque je fais intervenir, chaque année, des spécialistes de la DGSI auprès de mes étudiants, la première chose qu'ils vous apprennent, c'est que le droit à l'oubli, ça n'existe pas : à partir du moment où une image a été mise sur internet, d'une part elle mondialement accessible, d'autre part, même si elle semble avoir disparu, elle existe en réalité toujours quelque part.

En 2018, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique a saisi le Conseil national de la protection de l'enfance au sujet des chaines YouTube familiales. Celles-ci mettent en scène des enfants dans des activités de la vie quotidienne et génèrent pour leurs parents des revenus pouvant atteindre plusieurs millions d'euros, suivant certains exemples américains. L'association a estimé que ces vidéos ne relevaient pas uniquement d'une activité de loisir, mais bien d'un travail qui, dans les faits, est un travail illicite. Cette proposition de loi propose certes d'encadrer ces pratiques, mais ce cadre est-il suffisant et permettra-t-il d'éviter la dérive que constitue cette forme de travail illicite ?

Plusieurs collègues se sont interrogés sur notre capacité à contrôler les images d'enfants mises en ligne, ce qui me paraît en effet une question importante. Encadrer une pratique implique, en amont du contrôle, de la prévention et des efforts pédagogiques. Le texte prévoit-il l'élaboration de ce qui pourrait s'apparenter à une charte des bonnes pratiques dans ce domaine ?

Merci à tous pour le soutien que vous apportez à cette initiative. C'est l'occasion pour nous d'avoir une discussion sur un sujet qui en appelle forcément d'autres, puisque, dès lors qu'on tire un fil, la pelote se déroule à l'infini ; tout l'enjeu de cette proposition de loi est donc d'ébaucher un cadre, dans les limites juridiques qu'impose le statut des plateformes tel qu'il est fixé par le droit européen.
Parmi les sujets connexes auxquels nous touchons émerge la question de la viralité, largement responsable du succès que connaissent les vidéos auxquelles nous nous intéressons. La quête incessante des « like », qui incite à poster toujours davantage, renvoie chacun à sa responsabilité individuelle lorsqu'il décide de partager des vidéos faisant apparaître des enfants, avec cette question : cela en vaut-il la peine ?
De nombreuses questions ont porté sur l'applicabilité des mesures proposées, sur la mise en oeuvre du contrôle et sur l'instance qui en aurait la charge. La proposition de loi offre aux associations de protection de l'enfance un outil supplémentaire pour leur permettre de saisir soit l'autorité administrative, soit la justice, et permettre au juge ainsi saisi de rendre des décisions qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de base légale.
Ainsi, l'article 1 étend aux enfants apparaissant dans des vidéos diffusées sur internet le régime des enfants du spectacle. L'article 4, quant à lui, entend développer la coopération entre les plateformes et les associations pour leur permettre d'élaborer, sous l'égide du CSA, des chartes régissant les « zones grises » où la protection de l'enfance est en jeu. L'idée est donc que tous ceux qui sont en charge de la protection de l'enfance, les associations, puis, au niveau administratif les préfets et les directions départementales de la cohésion sociale, et enfin le juge, disposent d'outils leur permettant de travailler.
Certes, Madame Meunier, la tâche est lourde. D'où le recours aux décrets – c'est l'objet de l'article 3 –, qui devront déterminer les seuils critiques. Pour fixer ces derniers, il est nécessaire de disposer d'une connaissance du phénomène plus fine que celle que nous pouvons avoir, puisque, en tant que députés, nous n'avons pas les moyens de réaliser d'étude d'impact. C'est la raison pour laquelle nous renvoyons la définition de ces seuils au pouvoir réglementaire. Il s'agit de pouvoir se saisir des cas les plus lourds, que ce soit au regard des revenus générés ou du nombre d'heures de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Il était important en effet de retenir des critères alternatifs pour parer, par exemple, aux cas où les heures de vidéos sont importantes mais ne rapportent pas grand-chose. Quant au choix du décret, il a été guidé par le fait que ce dernier a l'avantage de pouvoir être modifié beaucoup plus rapidement que la loi, dont le rôle est d'abord de fixer un cadre général. La tâche des pouvoirs publics ne sera donc pas simple, mais vous m'accorderez que, dès lors qu'on parle de régulation du net, rien n'est simple.
Madame Kuster, vous avez raison, ces vidéos sont en quelque sorte le téléachat du XXIe siècle. Les enfants y font la promotion de produits, comme il en était vendu à la télévision dans ce type d'émissions. C'est donc le même travail, et il s'agit ici de l'encadrer, avec cette difficulté que, si dans certains cas la relation de travail est facilement démontrable, dans d'autres, ce n'est pas le cas, notamment lorsque le réalisateur de la vidéo ne semble avoir donné aucune consigne à l'enfant filmé.
Madame Petit, il faut en effet aller plus loin. Nous pourrons travailler ensemble en vue de la séance, mais nous en rediscuterons lorsque vous présenterez votre amendement.
Madame Ressiguier, le terme « promptement » est celui qui figure dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il est possible d'être plus précisément exigeant dans le cas de contenus terroristes ou pédopornographiques, qui sont manifestement illicites mais, dans le cas qui nous occupe, c'est plus compliqué, et nous sommes tenus de nous en tenir à ce type d'indication. Nous pourrons cependant, si vous le souhaitez, discuter d'amendements à cette formulation.
Madame Tolmont, je suis très sensible à votre proposition concernant l'information des enfants sur le droit à l'effacement. Nous pourrions examiner la question ensemble afin de proposer un amendement allant dans ce sens.
Monsieur Brotherson, les plateformes que nous avons auditionnées ont semblé prêter une oreille attentive à l'idée de s'engager avec nous dans la lutte contre le travail des enfants. Reste à espérer que cela se traduira concrètement dans les faits, grâce notamment aux dispositions que je vous propose d'adopter.
Quant aux enfants, nous n'avons malheureusement pas pu les rencontrer. Nous avons pu en revanche auditionner les vidéastes, notamment la Guilde des vidéastes, qui fédère ces nouveaux acteurs, globalement très demandeurs d'un cadre dans lequel ils puissent s'inscrire.
Cela m'amène à répondre à M. Pancher que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord pour subir de nouvelles contraintes mais que, globalement, les parents y sont favorables et que les plateformes ne doivent pas perdre de vue le fait qu'elles tirent de ces activités un tiers de leurs revenus, ce qui les oblige à prendre leurs responsabilités, même si nous sommes conscients des limites juridiques de cette obligation.
S'agissant des enfants qui agissent comme des acteurs autonomes – car nous savons tous que certains mineurs sont inscrits sans autorisation parentale – je rappelle que l'âge minimum pour s'inscrire sur une plateforme vidéo est fixé en France à 15 ans et qu'il faut être âgé d'au moins 16 ans pour disposer d'une carte bancaire – si un mineur de moins de 16 ans parvient à ouvrir un compte sur internet avec une carte bancaire sans l'aval de ses parents, cela ne peut donc être imputable qu'à un manque de vigilance de ces derniers.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'encadrer l'exploitation commerciale des enfants de moins de 16 ans. Nous avons choisi de privilégier la pédagogie à la sanction, ce qui est le sens de l'article 3, qui pose le principe de la déclaration auprès de l'autorité administrative. Je me dois de préciser néanmoins que cela ne vaut que pour cette zone grise encore mal couverte par le droit du travail ; dès lors, au contraire, qu'il est avéré que l'on a affaire à du travail dissimulé, c'est l'article premier, plus protecteur, qui s'applique.
C'est, me semble-t-il, toute l'innovation de ce dispositif combiné, qui tente de s'adapter à la manière dont internet rebat les cartes et nous oblige à revoir entièrement notre conception intellectuelle et juridique du travail.
Madame Provendier, je propose que nous travaillions ensemble d'ici la séance sur la question du traitement des données personnelles à des fins commerciales. Vous avez déposé un amendement en ce sens, mais il risque de tomber. Cela étant, peut-être le président vous permettra-t-il d'en dire quelques mots.
Madame Bazin-Malgras, interdire les pratiques dont nous parlons comporte un risque d'inconstitutionnalité. Certes, l'intérêt supérieur de l'enfant est également un principe constitutionnel et conventionnel – nous avons fêté il y a peu l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant –, mais, en l'espèce, poser une interdiction qui ne concerne pas vraiment le travail illicite nous placerait hors du cadre constitutionnel. D'où le choix que nous avons fait. Je vous rappelle néanmoins que le travail des enfants est interdit, sauf dérogation ; si dérogation il y a, celle-ci doit être clairement lisible, car internet n'est pas un espace de non-droit.
Monsieur Pancher, pour des questions de recevabilité financière, nous n'avons pas pu inscrire l'action du CSA ou de la future ARCOM dans le texte, mais nous travaillons avec le Gouvernement à un dispositif s'inspirant de celui que j'avais proposé dans la loi relative à la manipulation de l'information et dans lequel le CSA exercerait sa surveillance sur l'action des plateformes. Le rôle du régulateur devrait donc être précisé d'ici la séance.
En ce qui concerne le droit à l'oubli, l'article 5 a surtout vocation à poser le débat que vous avez bien voulu nourrir de vos questions. Nous sommes, là encore, dans une zone grise, et nous n'avons pas beaucoup de marge de manoeuvre pour contraindre les plateformes. Néanmoins, je pense qu'il faut faciliter les démarches permettant aux enfants de demander le retrait d'une vidéo de la plateforme où elle a été postée, même si cela ne garantit pas son effacement total.
Madame Descamps enfin, ces dispositions auraient parfaitement leur place dans le projet de loi sur l'audiovisuel mais, dans l'attente et ne sachant pas de quoi l'avenir sera fait, nous avons voulu qu'elles soient déjà dans les tuyaux. Par ailleurs, il nous semble important que ce sujet puisse faire l'objet d'un véritable débat entre nous et d'un vote public de notre assemblée, d'autant que, comme l'a rappelé Bertrand Sorre, la France est à l'avant-garde des pays de l'OCDE en matière de protection des enfants contre l'exploitation commerciale de leur image sur les plateformes.

J'aurais aimé avoir votre avis, d'une part, sur la proposition consistant à considérer comme une rémunération les voyages ou les objets offerts comme contreparties, d'autre part, sur l'obligation, lorsqu'on ouvre un compte sur une plateforme de vidéos, d'y inscrire le numéro d'agrément de la préfecture. Non seulement cela faciliterait l'identification mais cela permettrait également aux parents et aux enfants de comprendre que ce qu'ils font est assimilable à un travail.

La proposition de loi prévoit que tous les revenus, directs et indirects, sont pris en compte.
Pour ce qui concerne les comptes professionnels, je rappelle que, si vous voulez monétiser vos vidéos, il faut produire des coordonnées bancaires, donc avoir plus de 16 ans. Dans le cas contraire, l'article 3 prévoit une obligation de déclaration afin que les entreprises rémunérant des parents qui exploitent l'image de leurs enfants soient sanctionnées en cas de non-respect des dispositions prévues par la loi.
La commission en vient à l'examen des articles de la proposition de loi.
Article 1er : Extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne
La commission adopte l'article 1er sans modification.
Article 2 : Obligation, pour les plateformes de partage de vidéos, de faire cesser la diffusion de contenus méconnaissant l'obligation d'autorisation préalable
La commission adopte l'article 2 sans modification.
Article 3 : Encadrement des pratiques de partage de vidéos mettant en scène des mineurs ne relevant pas du droit du travail
La commission examine l'amendement AC3 du rapporteur.

Le présent amendement a pour objet de permettre à l'autorité administrative compétente, en l'occurrence la direction départementale de la cohésion sociale, de formuler des recommandations à destination des parents quant aux modalités de réalisation des vidéos mises en ligne, notamment en ce qui concerne les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires souhaitables.
Ces vidéos étant tournées dans le cadre de la sphère privée, on peut en effet procéder à des recommandations, sans aller jusqu'à l'interdiction, laquelle serait d'ailleurs difficile à faire respecter.
La commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement AC4 du rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec le dispositif existant pour les enfants du spectacle.
La commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement AC5 du rapporteur.

Le présent amendement précise la rédaction de l'alinéa 6, afin de responsabiliser plus spécifiquement les annonceurs qui placeraient des produits dans le cadre de vidéos mettant en scène, à titre principal, des enfants.
La commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 3 modifié.
Article 4 : Responsabilisation des services de plateforme en matière de diffusion de contenus faisant figurer des enfants de moins de seize ans
La commission examine l'amendement AC6 du rapporteur.

L'amendement réécrit l'article 4 pour aboutir à un dispositif plus souple, afin de privilégier l'efficacité et l'applicabilité. Il s'agit de faire participer plus activement les services de plateformes en ligne, notamment celles établies en dehors du territoire français. C'est un enjeu majeur : voter un texte qui ne s'appliquerait qu'au territoire français serait très limitant, notamment si l'on considère que ces plateformes établies à l'étranger sont les plus puissantes actuellement.
Je travaille sur cet article avec le Gouvernement pour obtenir des mesures plus complètes sur la future autorité de régulation – aujourd'hui le CSA ; demain, l'ARCOM. Puisqu'elles alourdissent les charges publiques, je ne peux pas déposer d'amendement à ce sujet. Il reviendra au Gouvernement de le faire en séance.
La commission adopte l'amendement.
L'article 4 est ainsi rédigé et l'amendement AC2 de Mme Florence Provendier tombe.

L'amendement AC2 visait à interdire le traitement à des fins commerciales des données personnelles que les plateformes pourraient recueillir dans le cadre de l'identification des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de 16 ans. Cette proposition de loi a pour objectif de protéger l'enfant. Il ne faudrait pas qu'en instaurant des procédures de protection, on offre aux plateformes une possibilité de bénéficier de ces données.

Dans son article 28 ter, la directive sur les services de médias audiovisuels, dite directive SMA, prévoit en effet que les services de partage de vidéos ne peuvent pas traiter à des fins commerciales les données recueillies sur les mineurs dans le cadre des procédures de vérification d'âge et de contrôle parental.
C'est une disposition qu'il pourrait être intéressant de reprendre à notre compte dans cette proposition de loi, même si le cas qui nous occupe n'est pas prévu par la directive, qui vise plutôt à protéger les mineurs spectateurs des pratiques publicitaires néfastes. Il est vrai qu'indirectement, le fait de signaler la présence d'un mineur dans une vidéo pourrait aussi informer indirectement la plateforme de la présence de mineurs parmi le public de cette vidéo.
Je vous propose donc de retravailler votre amendement d'ici à la séance.
Article 5 : Ouverture de l'exercice du droit d'effacement aux mineurs
La commission adopte l'article 5 sans modification.
Après l'article 5
La commission examine l'amendement AC1 de Mme Maud Petit.

L'amendement, qui vise à modifier le code pénal, tend à protéger la vie privée des mineurs ne pouvant exprimer un consentement en créant une nouvelle infraction d'atteinte à la vie privée de ce mineur. Cette infraction rendrait les titulaires de l'autorité parentale responsables pénalement lorsqu'une utilisation de l'image de l'enfant porte atteinte à sa dignité.
Sur certains réseaux sociaux, on a constaté la multiplication de comptes ou de pages dédiés à la vie de bébés, mettant en scène le jeune enfant dans des scènes de la vie quotidienne, lesquelles, nous l'avons rappelé, peuvent faire l'objet de partenariats avec des marques. Cette exposition permanente de la vie intime de l'enfant peut avoir des conséquences à long terme sur son image et sur le respect de sa vie privée.
L'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle ainsi que « nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Je partage tout à fait l'objectif de l'amendement. J'ai moi-même adopté une vision maximaliste lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Toute monétisation, quel que soit le seuil, tout placement de produit, me semblaient entrer dans une relation de travail, non de loisir.
Mais pour réglementer efficacement sur les cas les plus graves, il faut accepter l'idée de seuils, comme je l'ai fait notamment à l'article 3, non seulement lorsque les vidéos rencontrent le succès, c'est-à-dire lorsqu'il y a des revenus, mais aussi si de nombreuses heures de vidéo sont postées. Ces seuils permettront de déclencher les contrôles, qui se feront d'abord avec davantage d'informations du fait des plateformes, puis en saisissant l'autorité administrative, la direction départementale de la cohésion sociale, voire la justice. Voilà la façon dont j'ai choisi d'aborder cette problématique.
Je ne prévois d'ailleurs pas de peine pour les parents car la visée du texte est avant tout pédagogique, non répressive.
L'amendement semble de plus poser des questions au regard de la Constitution, notamment du principe de proportionnalité des délits et des peines. Tel qu'il est rédigé, il empêcherait par exemple les parents de transmettre au cercle familial une vidéo mettant en scène un enfant, qui porterait de fait atteinte au respect de sa vie privée.
Je vous propose donc que nous retravaillions ensemble l'amendement d'ici à la séance.
L'amendement est retiré.
Article 6 : Sanctions applicables aux services de plateforme
La commission adopte l'article 6 sans modification.
Puis elle adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
(Présidence de M. Bruno Studer, président de la commission)
La commission examine ensuite la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (n° 2548) (M. Paul Molac, rapporteur).

Je commencerai mon propos par un bref rappel historique. Les rapports entre la France et les langues régionales n'ont pas toujours été simples. Je n'évoquerai pas l'Édit de Villers-Cotterêts, la fin du latin comme langue administrative, car dans le sud de la France, l'occitan restera la langue administrative et la langue de la justice.
La véritable coupure intervient plutôt avec la Révolution française. Un certain Barère, par exemple, disait : « Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; […] et le fanatisme parle le basque. » Si l'abbé Grégoire était favorable à la disparition et à l'éradication de tous les patois, Jules Michelet affirmait : « La Bretagne est une colonie, comme l'Alsace, comme les Basques, encore plus que la Guadeloupe. » Il visait dans son appréciation la distance de la langue par rapport au français, le créole étant effectivement plus proche du français que ne peuvent l'être l'alsacien, le breton ou le basque. Cette distance rendait plus impératif le besoin d'une colonisation.
La première loi sur les langues régionales, la loi Deixonne, qui date de 1951, dispose que l'on peut enseigner les langues régionales, à partir du moment où l'on peut tirer profit de cet enseignement pour l'étude de la langue française. L'ambition était donc pour le moins limitée.
Sous la Ve République, quarante-cinq propositions de loi ont été déposées sur le bureau de l'Assemblée ; deux seulement ont été étudiées. Il y a, on le voit, un problème majeur. Sans doute avons-nous besoin d'un changement culturel.
Notre droit comprend quelques mentions, plutôt fragmentaires, des langues régionales. La loi Peillon, par exemple, définit l'enseignement bilingue, en 2013. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, et la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) font des langues régionales une compétence partagée entre les différentes collectivités locales et l'État, avec la région comme chef de file. La loi NOTRe établit aussi le forfait scolaire, que la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a élargi aux écoles associatives et privées sous contrat.
Mais le droit va parfois en réaction : en 2017, dans la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, nous avons par exemple modifié le décret du 2 thermidor an II, toujours en vigueur, qui punissait tout officier public écrivant dans une langue régionale de six mois de prison et de destitution. Il était temps de changer tout cela !
Si nous disposons de lois cadres s'appuyant sur la Constitution, dont l'article 2, par exemple, qui fait du français la langue de la République, nous avons également la loi relative à l'emploi de la langue française, ou loi Toubon.
En revanche, l'article 75-1 de la Constitution, qui dispose que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » n'a presque aucune déclinaison législative. Je me propose d'y remédier, et de rappeler que le Conseil constitutionnel a enjoint au législateur de prendre cet aspect en compte. En tant que tel, l'article 75-1 ne donne en effet aucun droit sans déclinaison législative ultérieure.
Le procureur général de la cour d'appel de Rennes a récemment appelé le législateur à se prononcer sur l'affaire du tilde, après avoir appliqué la loi en refusant le prénom Fañch. Nous voyons bien que l'actualité nous sollicite.
J'ai donc décidé de me saisir de ces aspects patrimoniaux pour, dans les articles 1er et 2, reconnaître que les langues régionales font partie du patrimoine de la France, pour appeler à leur conservation, à leur connaissance et à leur diffusion ainsi que pour assurer que l'État et les collectivités territoriales en feront la promotion. J'ai également déposé un amendement afin de remplacer la référence à la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par une mention de notre code du patrimoine.
L'article 2 vise à préserver tout bien matériel qui présenterait un intérêt majeur du point de vue linguistique, pour la connaissance ou l'expression des langues régionales – en particulier les enregistrements ou manuscrits. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Les articles 3 à 7 concernent l'éducation, domaine dans lequel il faut porter le fer. Il s'agit d'étendre l'enseignement de la langue régionale dans les territoires concernés par le biais de conventions avec l'État et de rendre la proposition systématique. Aujourd'hui, ce sont les parents qui inscrivent leurs enfants, hormis en Corse. Nous proposons donc de généraliser les dispositions existant en Corse, qui fonctionnent bien.
L'article 4 reconnaît les expérimentations d'immersion dans l'enseignement public. Il s'agit de redonner le pouvoir aux pédagogues pour donner aux enfants une égale maîtrise des langues nationale et régionale. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, que j'ai interrogé, a considéré la maîtrise du français comme normale mais quelque peu superfétatoire celle de la langue régionale. On peut pourtant se demander comment préserver une langue régionale si les habitants de la région ne la parlent pas. La maîtrise de la langue est donc nécessaire. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur notre expérience de l'enseignement bilingue, qui est très ancienne, les premières expérimentations remontant aux années 1930.
Les articles 5 et 6 visent à permettre aux collectivités territoriales, dans des conditions bien définies, d'octroyer des aides aux établissements sous contrat, telles que les écoles associatives, qui pratiquent l'enseignement des langues régionales. L'article 5 concerne plus particulièrement le premier degré ; l'article 6, le second.
S'agissant du forfait scolaire, l'article 7 vise à préciser les articles L. 212-8 et L. 442-5-1 du code de l'éducation, en rajoutant le terme « bilingue ». Aujourd'hui, si la langue régionale n'est pas enseignée dans une commune, le maire d'une commune voisine où elle est enseignée est obligé d'accepter un enfant et de demander à son homologue de la commune de résidence le montant du forfait scolaire. Nous souhaitons qu'un enseignement bilingue, plus à même de développer la maîtrise de la langue, soit institué plus largement.
L'article 8 vise à sécuriser la signalétique bilingue voire trilingue, comme à Bayonne, qui dispose de panneaux en basque, en occitan et en français. Je rappelle qu'à Villeneuve-lès-Maguelone, un résident avait assigné la mairie devant le tribunal administratif de Montpellier, au motif que les panneaux d'entrée dans la ville comportaient une mention en occitan, susceptible de provoquer des accidents. Il a fallu aller jusqu'à Marseille pour faire casser le jugement ! L'article vise donc à sécuriser les dispositions existantes, pour que les maires n'aient pas à être sollicités pour de tels problèmes.
L'article 9 vise à intégrer les signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil. La question concerne non seulement le breton, avec le tilde sur le n du petit Fañch, mais aussi le catalan, avec l'accent sur les voyelles i, o, et u. Une telle mesure fera plaisir au secrétaire d'État Laurent Nuñez, qui tient beaucoup au tilde de son nom, ce en quoi il a bien raison.
L'opportunité d'une loi sur les langues régionales est souvent repoussée, à Paris. L'Unesco classe pourtant toutes les langues régionales, à l'exception du basque, en grand danger d'extinction. Il y a donc urgence si l'on veut protéger ce patrimoine.
Certains argumenteront que l'évolution historique est responsable de la disparition des langues. Il n'y a pourtant rien d'inéluctable, si l'on instaure une politique linguistique visant à la préservation des langues régionales. La France, il est vrai, dispose de mesures plutôt fragmentaires, alors que le Québec, qui mène une véritable politique linguistique depuis les années 1960, a pu rester un îlot francophone, entouré par des locuteurs, de la langue anglaise, dont on connaît la force, et préserver sa culture. Je pourrais aussi évoquer les exemples de régions plus proches géographiquement, comme le Pays basque sud, dans la communauté autonome du Pays basque, où le basque, largement employé, gagne des locuteurs, ou encore le Pays de Galles. Les locuteurs gallois, qui étaient 200 000 dans les années 1950, dépasseront bientôt le million. Aujourd'hui, ce sont les générations âgées qui ne parlent pas gallois.
Il existe donc un fort besoin sur le terrain. Trois journalistes m'ont contacté ce matin. Une de mes publications sur ce sujet a obtenu 20 000 vues sur Facebook, hier : le sujet intéresse donc la population et on voit qu'une loi est très attendue dans les territoires où il existe des langues régionales. Cette proposition de loi reste modeste, nous aurions pu rédiger un texte couvrant bien d'autres aspects. J'ai choisi d'être court et de ne pas attaquer des sujets faisant polémique, par exemple la co-officialité. Dans le cas de la Corse, la proposition de loi ne donnera aucun avantage supplémentaire aux locuteurs corses, car elle ne fait que généraliser à d'autres territoires, qui le demandent, un dispositif existant.
Mes chers collègues, j'espère que nous pourrons avancer ensemble dans l'étude de cette proposition de loi.

Le groupe La République en marche salue l'initiative du groupe Libertés et territoires, et plus particulièrement celle du rapporteur, M. Paul Molac, dont la proposition de loi met à notre ordre du jour des éléments majeurs de notre culture nationale que sont les langues régionales et leur protection.
La question du patrimoine linguistique concerne en effet l'ensemble des régions françaises, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines. La reconnaissance progressive de leur importance est cruciale. Elle a été constitutionnalisée par la révision du 23 juillet 2008, qui érige à juste titre les langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de notre pays. Avant d'examiner plus en détail les articles de cette proposition de loi, j'aimerais revenir sur les trois grands volets qui la composent : la protection patrimoniale des langues régionales ; leur enseignement ; leur utilisation dans la signalétique et les actes d'état civil.
S'agissant de la protection patrimoniale des langues régionales, la proposition de loi peut présenter une véritable valeur ajoutée. Elle poursuit la reconnaissance de la richesse de la langue régionale pour notre patrimoine national, amorcée par l'article 75-1 de la Constitution. Ce volet renouvelle les termes du débat public en la matière et consacre la nécessité de la protection de ces langues sur tout le territoire national. Il semble donc pertinent de se saisir de l'importance culturelle que revêtent les langues régionales.
S'agissant du volet relatif à l'enseignement des langues régionales, de multiples avancées ont été réalisées en leur faveur à l'initiative du Gouvernement. Je n'exposerai pas en détail tous les articles qui composent le titre II de la proposition, dont plusieurs impliquent des financements et des formations pour permettre d'approfondir l'enseignement des langues régionales. Un tel approfondissement est déjà soutenu dans une large mesure par le Gouvernement.
Je tiens à ce sujet à remercier M. le rapporteur, qui, par cette proposition de loi, a pu souligner les acquis du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en matière d'enseignement des langues régionales. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a ainsi largement contribué à la promotion de l'enseignement de ces langues, notamment en étendant aux écoles privées l'obligation d'un accord entre les communes pour la prise en charge du forfait scolaire des élèves qui s'inscrivent dans une école dispensant l'enseignement en langue régionale en dehors de leur commune de résidence. Les débats sur cette loi ont été l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, de souligner les mesures de soutien de l'État aux collectivités volontaires pour développer l'enseignement en langue régionale. La réforme du baccalauréat a également permis de mieux prendre en compte les langues régionales dans les épreuves.
Nous entendons le besoin de dialogue et d'évolution qui sous-tend cette proposition de loi. Comme vous le savez, les réformes que je viens de mentionner sont récentes. Leur application est déjà très observée par le Gouvernement et la majorité. Avant de voter de nouvelles mesures reprenant de nombreuses considérations existant autour de l'enseignement des langues régionales, nous devrions analyser en profondeur les effets de telles réformes sur l'enseignement desdites langues.
S'agissant ensuite de l'utilisation des langues régionales dans la signalétique, la possibilité donnée par l'article 8 d'étendre la signalétique bilingue dans les espaces publics offre une belle occasion de montrer que les langues régionales sont des langues vivantes, puisque que les citoyennes et les citoyens les appréhenderont au quotidien par des éléments concrets. Leur déploiement dans l'espace public les défait du caractère ancien et uniquement coutumier, qui pourrait leur être prêté.
Si elles sont le produit d'un héritage historique, les langues régionales sont bel et bien vivantes et dynamiques. Cela se constate en Bretagne, en Corse et dans de nombreux autres départements hexagonaux, ainsi que fréquemment dans nos territoires ultramarins qui, je le souligne, rassemblent les deux tiers des langues régionales existant en France.
S'agissant enfin de l'autorisation des signes diacritiques des langues régionales dans l'état civil, nous pouvons nous satisfaire du fait que l'article 9 est en fait d'ores et déjà adopté puisque la Garde des Sceaux, dans un courrier daté d'hier, a confirmé qu'un décret était en cours de finalisation et qu'il serait prochainement transmis au Conseil d'État afin de permettre que les noms et prénoms inscrits à l'état civil soient accompagnés de signes diacritiques régionaux. Cela constitue également une avancée sensible dans la reconnaissance des langues régionales, au même titre que les dispositions des articles 1er et 8 de la proposition de loi.
Pour ces raisons, le groupe La République en marche votera la proposition de loi reconnaissant l'importance patrimoniale des langues régionales et contribuant à leur dynamisme dans l'espace public.

Le groupe Les Républicains a toujours témoigné un grand attachement à nos langues régionales. J'en veux pour preuve la réforme constitutionnelle de 2008, qui a introduit l'article 75-1, lequel dispose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
L'exposé des motifs de la proposition de loi acte le fait que, depuis 2008, aucune loi-cadre n'est venue fixer un statut législatif des langues régionales. Certains ont en effet considéré la proposition de loi déposée en 2016 par nos collègues socialistes, cosignée et défendue par le rapporteur actuel, comme bavarde, de circonstance, donc inopportune.
La présente proposition de loi serait également justifiée par le fait qu'en octobre 2015, le Sénat a rejeté la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cette décision aurait sérieusement et durablement mis en cause les potentielles avancées sur le sujet.
La position défendue par nos collègues sénateurs repose toutefois sur deux explications juridiques, qui apparaissent indiscutables. La première est que la France met déjà en oeuvre les 39 mesures de la Charte ; la seconde, et non des moindres, que certaines dispositions sont contraires à notre Constitution.
Attaché à mon identité picarde, à sa langue et ses traditions, je ne le crois pas, mais cette question relève de la conviction profonde de chacun d'entre nous, de la vision qu'a chacun de l'État-nation et surtout, comme parlementaire, de l'adéquation entre l'article 75-1 et l'article 2 de notre constitution. Contrairement aux pratiques de la majorité, ce point doit être tranché par un vote non pas de confiance aveugle, mais de conscience.
Je suis donc convaincu que ces dispositions doivent être envisagées, autant que possible, de façon objective, pour déterminer si elles sont réellement utiles et applicables. Au-delà de la simple déclaration d'intention louable, mais juridiquement inefficace, la réponse à cette question devra être donnée à la lumière de toutes les évolutions législatives éparses sur ce sujet, que l'exposé des motifs a rappelées. Il en ressort que, si certains articles présentent des dispositions juridiques nouvelles, d'autres en revanche sont de pure forme et participent à une inflation législative qui ne satisfait que ses auteurs, malheureusement au détriment de la clarté et du principe de la nécessité de la loi.
Enfin, comme en 2016, nous sommes en droit de nous interroger sur le choix de l'inscription d'un tel texte à notre ordre du jour, à quelques semaines d'une élection locale.

La révision constitutionnelle de 2008 a inscrit les langues régionales au patrimoine de la France. Plusieurs initiatives bienvenues ont suivi, comme la reconnaissance de l'enseignement bilingue dans la loi pour la refondation de l'école de la République en 2013, ou la participation financière pour la scolarisation, dans la loi NOTRe de 2015.
Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés, depuis longtemps attaché à la défense et la reconnaissance des langues régionales comme partie de notre patrimoine immatériel, est plutôt favorable aux dispositions de la proposition de loi relatives à une inscription plus marquée des langues régionales dans le code du patrimoine.
Ainsi, l'article 2, qui vise à inscrire la connaissance de la langue française et des langues régionales au titre des trésors nationaux, nous paraît positif, de même que la possibilité d'inscrire les signes diacritiques dans les actes d'état civil. Cette disposition semble de bon sens. Un décret est d'ailleurs annoncé pour l'intégration de ces caractères. Nous avons déposé un amendement pour repositionner cette autorisation dans un autre article concernant l'inscription à l'état civil de l'enfant.
Nous sommes enfin favorables à la dernière disposition visant à renforcer la visibilité des langues et l'immersion dans la vie quotidienne, qui permet d'assurer leur pleine transmission.
Les articles relatifs au code de l'éducation nous posent en revanche un sérieux problème d'application, si nous venions à les adopter tels quels. Ainsi, les articles 5 et 6 proposent de conditionner l'obtention de locaux et de la subvention d'investissement octroyée par la commune aux établissements privés du premier et second degré au fait de dispenser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Cela risque de mettre en grande difficulté les équipes pédagogiques de nombreux départements. Faudra-t-il, en Mayenne, proposer le breton, au risque de réveiller la susceptibilité ou l'enthousiasme de nos voisins, le gallo, que nous partageons avec eux ou le mainiot, qui est un dialecte plutôt qu'une langue régionale à proprement parler ?
Par ailleurs, des dispositions nouvelles ont été adoptées dans la loi pour une école de la confiance, comme l'extension de la participation financière de la commune de résidence en cas de scolarisation de l'élève dans une autre commune poursuivant l'enseignement bilingue d'une langue régionale. Nous pensons qu'il faut laisser le temps aux mesures votées d'entrer en application, avant de tout chambouler à nouveau.
Le groupe du MODEM, bien que fervent défenseur des langues régionales, qui appartiennent à la mémoire collective, ne pourra donc pas se prononcer en faveur d'une proposition de loi d'application bien difficile.

L'article 75-1 de la Constitution dispose clairement que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la République. Le texte présenté définit trois domaines où ces langues peuvent être utilisées : le patrimoine via la reconnaissance de l'intérêt patrimonial majeur des différentes langues régionales, qui bénéficieront d'actions et politiques de conservation et de promotion confiées à l'État et aux collectivités territoriales ; l'enseignement, par l'octroi de subventions et de locaux par les communes et leurs groupements aux établissements laïcs du primaire et du secondaire dans le privé, ainsi que par la possibilité d'avoir un enseignement bilingue français-langue régionale immersif, dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d'enseignement, sans limite dans la durée d'enseignement ; et les services publics, via le recours à une signalétique plurilingue et l'usage des signes caractéristiques de ces langues dans les actes d'état civil.
En dehors de ces domaines, le texte permet aussi de faire reconnaître, de pérenniser et de promouvoir la diversité qui existe au sein de la République française. N'oublions pas que la France est composée d'une multitude de territoires où se pratiquent différentes langues régionales. Je pense notamment au breton, au flamand, au mosellan, à l'alsacien, au basque, au corse.
Cette diversité linguistique concerne non seulement la métropole, mais aussi nos territoires ultramarins, géographiquement éloignés de l'Hexagone. Première frontière et avant-garde de notre pays par-delà les mers, ces territoires sont empreints d'une multiculturalité exceptionnelle, dont les racines linguistiques proviennent de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Ces langues sont, entre autres, un héritage de notre histoire commune, à l'instar de la Caraïbe où différentes langues régionales cohabitent avec le français – créole martiniquais, créole guadeloupéen, guyanais, créole haïtien – ; de l'océan Indien – shimaoré à Mayotte, créole à la Réunion – ou des îles du Pacifique avec les différentes langues tahitiennes. Vous l'avez compris, la diversité et l'histoire de notre République vivent aussi pleinement à travers ces différentes langues, dites minoritaires.
Si la République est une et indivisible, elle n'est pas uniforme. Cela n'enlève rien au fait que le français est la langue de la Nation, et n'empêche en rien l'unité de notre pays dans la diversité, ce que rappelle la devise de l'Union européenne.
À ce titre, nous rappelons que la France est signataire de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires depuis 1999, sa ratification n'ayant pu se faire puisque le Sénat s'y est opposé et que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont jugé qu'il y avait une méconnaissance des principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi, d'unicité du peuple français et d'usage officiel de la langue française. Avec ce texte, il sera possible de dépasser ces réserves, tout en formulant des propositions de bon sens.
C'est pourquoi le groupe Socialistes et apparentés votera cette proposition de loi.

L'examen de cette proposition de loi est l'occasion pour le groupe UDI, Agir et indépendants de rappeler son attachement aux langues et cultures régionales.
Il est communément admis que l'apprentissage de langues différentes favorise l'ouverture de son locuteur à d'autres cultures. Dans de nombreux territoires, ces dialectes sont encore parlés par nos aînés. L'enseignement de ces langues est donc un vecteur de lien intergénérationnel.
Une langue s'attache à un territoire et les particularités qui la composent sont autant de traductions de l'essence même du territoire dans lequel elle s'inscrit. Son apprentissage apporte donc la compréhension de la réalité d'un territoire, de son histoire, de sa culture.
De prime abord, nous ne pouvons que souscrire à ce texte visant à consacrer les langues régionales comme patrimoine français, à renforcer l'apprentissage et la maîtrise de ces langues au sein des établissements scolaires et à permettre aux collectivités territoriales de les valoriser.
Quelques interrogations subsistent toutefois sur l'article 1er, qui prévoit la valorisation des langues régionales par leur inscription au sein de l'article 1er du code du patrimoine. Il semblerait que cette disposition soit satisfaite par l'article L. 312-10 du code de l'éducation, lequel dispose : « Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé, prioritairement dans les régions où elles sont en usage. » Cette disposition semble de nature à satisfaire l'article 1er de la proposition de loi.
Nous sommes plutôt favorables à l'article 2 considérant les biens relatifs aux langues régionales comme trésors nationaux. Cela peut en effet permettre de sauvegarder certains biens qui recèlent une importance primordiale pour nos territoires.
S'agissant de l'article 3, relatif à l'extension du dispositif corse en matière d'enseignement à l'ensemble du territoire, on peut se demander s'il s'agit de la meilleure manière de valoriser les langues régionales. Aujourd'hui, les conventions sont conclues entre les collectivités territoriales et l'État pour déterminer les modalités de l'apprentissage de ces langues, territoire par territoire. On peut estimer que le noeud du problème se trouve donc plutôt dans la conclusion de ces conventions. Monsieur le rapporteur, vos travaux ont-ils permis de mesurer l'impact de ce dispositif, le nombre d'enseignants qu'il faudra recruter, ainsi que la façon d'améliorer leur formation initiale pour qu'ils puissent assurer le nouvel enseignement ?
Pourriez-vous également apporter des précisions sur l'article 4 ? Dans l'exposé des motifs, vous indiquez que l'article L. 312-10 du code de l'éducation ne mentionne pas l'enseignement bilingue dit immersif. L'article 4 se propose d'y remédier en reconnaissant dans la loi toutes les formes d'enseignement bilingue qui sont dispensées en France. Or cette méthode d'enseignement a été déclarée non conforme à la Constitution par la décision n° 2001-456 du Conseil constitutionnel, en date du 27 décembre 2001.
Le groupe UDI, Agir et indépendants défend une position modérée, celle d'un apprentissage d'une langue et d'une culture régionale complémentaire des enseignements fondamentaux de l'école républicaine.
Enfin, concernant l'inscription au sein des actes de l'état civil, il semblerait qu'un décret sera publié en la matière. Pouvez-vous nous confirmer qu'il va bien dans le sens de votre article 9 ?

La France est riche de sa diversité linguistique patrimoniale, la plus grande de celle de tous les pays d'Europe occidentale.
Rappelons-le, si la richesse linguistique de la métropole est considérable avec les langues de trois familles indo-européennes différentes – latine, germanique et celte, plus le basque –, que dire de celle de l'outre-mer ? On ne peut pas dire pour autant que la France soit un pays de langues. Nous assistons en effet depuis des décennies, à des degrés variables, à une perte rapide de ses capacités. Cette richesse a en effet été longtemps combattue et la France peine aujourd'hui à reconnaître sa diversité linguistique et à mettre en place des politiques linguistiques appropriées, ce qui explique ce déclin alarmant.
Ce riche patrimoine pourrait être notre fierté. Or la construction politique de notre pays s'est paradoxalement faite par la négation de la diversité linguistique. Quelle erreur ! Aujourd'hui encore, la France est l'un des seuls pays d'Europe où les langues régionales ne bénéficient pas de véritables mesures de protection et de promotion assurant leur pérennité. Elle est l'un des derniers pays d'Europe à ne pas avoir ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, pourtant obligatoire pour tout nouveau pays souhaitant entrer dans l'Union européenne.
Comme le rappelait Michel Guillou, qui a été premier recteur de l'Agence universitaire de la francophonie et fondateur du réseau international des chaires Senghor de la francophonie, le multilinguisme est à la démocratie culturelle, ce que le multipartisme est à la démocratie politique. Le pluriel linguistique croît rapidement. Le multilinguistique est moderne ; la langue unique est un concept maintenant dépassé. La langue française doit lier son destin à l'essor du multilinguisme, préalable au maintien de la diversité culturelle dont elle est un des fers de lance.
En militant pour le multilinguisme, du local à l'international, et en France même, on assurera la pérennité de la langue française, en trouvant là l'un des fondements de son attrait comme grande langue internationale et moteur de son rayonnement.
Nous sommes donc dans un cadre légal qui oscille entre franche hostilité et timide reconnaissance. La récente réforme du baccalauréat, qui a vu le nombre d'inscrits dans les filières en langue régionale drastiquement baisser, témoigne des grandes difficultés dont fait preuve l'État pour ne serait-ce que maintenir un même niveau d'enseignement au lycée, alors qu'il a pourtant mis les moyens nécessaires pour les langues mortes, le grec et le latin.
Pour protéger ces langues bien vivantes, il convient de préciser le sens de l'article 75-1 de la Constitution, qui fait des langues régionales le patrimoine de la Nation, afin qu'il ne reste pas un ensemble vide. Le législateur doit continuer à définir les premiers éléments de ce statut, en précisant quelles mesures la patrimonialisation des langues régionales appelle dans notre Constitution.
Il faut considérer que les langues régionales constituent, au même titre que la langue française, une part essentielle du patrimoine immatériel linguistique. À ce titre, elles doivent bénéficier de politiques de conservation et de connaissance, au même titre que le patrimoine immobilier. Il convient ainsi de saisir l'urgente nécessité de les protéger et de les mettre en valeur pour les générations futures.
Cette protection et cette mise en valeur passent par une politique transversale de l'État et des collectivités territoriales, non seulement dans le patrimoine mais aussi dans des domaines aussi différents que l'enseignement, la signalétique ou encore les prénoms et noms de famille. Les langues régionales doivent pouvoir trouver une place plus importante dans notre société.
Chers collègues, je vous invite donc à voter cette proposition de loi de notre collègue Paul Molac, que l'ensemble des membres de notre groupe Libertés et territoires soutient.

(M. Moetai Brotherson commence son intervention en tahitien). Je vais bien évidemment traduire pour ceux qui parmi vous ne maîtrisent pas le reo Tahiti.
Je tiens à remercier notre collègue Paul Molac pour cette proposition de loi relative à ce que vous appelez des langues régionales mais qui, pour nous, sont notre âme et notre essence même. Ce sont les langues qui ont accueilli les premiers Européens arrivés sur nos côtes – ils n'ont pas été accueillis par des cocotiers mais par des gens qui parlaient des langues entendues dans le ventre de leurs mères, des langues dans lesquelles aujourd'hui encore nous rêvons.
Cette proposition de loi a certes ses limites et peut être améliorée mais il n'est pas possible de ne pas la soutenir.
Il est étonnant que l'on mette autant d'énergie à défendre la francophonie face au reste du monde sans promouvoir les langues régionales au sein même de notre République française. On nous rappellera que la France est une et indivisible, qu'une seule langue y est en vigueur, que c'est là la condition sine qua non du patriotisme et de l'existence même de la nation. Expliquez-moi, alors, pourquoi les Néo-Zélandais nous mettent continuellement la pâtée au rugby alors qu'ils ont deux langues officielles, le maori et l'anglais ! Seraient-ils dès lors moins patriotes que les Français ?
Pour toutes ces raisons, il est évident que le groupe GDR soutiendra cette proposition de loi.
M. Moetai Brotherson conclut son intervention par une formule en tahitien.

Nous l'avons constaté il y a quelques jours en examinant la proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, la question du patrimoine immatériel est appelée à occuper une place de plus en plus importante dans notre législation.
Ne peut-on pas envisager d'inscrire le développement de la place des langues régionales dans notre droit dans le cadre plus large d'une loi sur le patrimoine immatériel, ce qui permettrait d'appréhender cette question d'une manière beaucoup plus globale ?

Les langues régionales sont à la racine de notre culture et de notre histoire. En tant que telles, depuis la révision constitutionnelle de 2008, elles appartiennent au patrimoine de la France. Jusqu'à ce jour, toutefois, aucune disposition législative n'a précisé ou concrétisé ce principe constitutionnel alors qu'il importe grandement de sauvegarder et de promouvoir les langues régionales, comme l'a souligné l'Unesco à travers deux chartes que la France a signées.
Un recensement des traditions et des pratiques immatérielles à préserver existe dans le cadre de l'inventaire national du patrimoine culturel et immatériel, mis à jour par le ministère de la culture : le conte occitan en Périgord y est par exemple répertorié. Comment faire pour que cet inventaire soit mieux connu du public ?

Je remercie bien évidemment notre collègue Paul Molac d'avoir mis à l'ordre du jour de la « niche » parlementaire du groupe Libertés et Territoires cette proposition de loi.
En complément des propos tenus par mon collègue polynésien, je tiens à resituer les enjeux dont nous parlons.
Une révision constitutionnelle a permis, par l'article 75-1, de reconnaître que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la République mais aucune suite législative n'a été donnée, au point que ces langues pourraient être considérées comme mortes ou constituant un patrimoine voué à la disparition. Et en effet, cela a été dit à plusieurs reprises : ces langues sont en danger de mort.
Pour utiliser une métaphore médicale, je dirais que l'on ne soigne pas un malade atteint d'un cancer avec de l'Efferalgan. Traiter une maladie grave ou rare suppose de se doter de moyens adaptés. C'est précisément cette question qui se pose lorsque l'on discute des langues dites régionales ou minoritaires avec, nous le savons tous, un arrière-fond de défiance. Nous savons bien que, pour la République, ce n'est pas un sujet facile et qu'il suscite souvent un certain malaise car il est trop rapidement associé au communautarisme.
Or une langue est constitutive d'une identité profonde. Je suis quant à moi parfaitement bilingue mais il ne s'agit pas seulement d'un langage. Au-delà de cette proposition de loi, qui constitue donc une tentative d'avancée législative, il faudra bien se poser un jour la question du droit d'usage des locuteurs de ces langues – c'est en tout cas pour cela que j'ai été élu. Sans droit d'usage, en effet, la langue se meurt et mourra. Une langue ne peut pas vivre sans droit de cité permanent dans l'espace public. Si je ne peux pas parler corse à la banque ou à la sous-préfecture, si mon fils ne peut pas le faire, si la langue est cantonnée, comme la religion, à la sphère privée – comparaison insupportable, une langue, une culture n'étant pas une religion et le parallèle avec la laïcité, quoi qu'il en ait, ne peut pas s'appliquer – cela signifie que l'on encourage l'euthanasie de ces langues.
Il faudra donc bien poser ces questions, sauf à considérer que des dizaines de milliers de personnes devront choisir entre leur identité profonde, intime, leur sensibilité, leurs émotions… leur mère, et la République. À cette aune, je choisirai ma mère.
J'ajoute, s'agissant de la proposition de loi – à laquelle je suis bien sûr favorable – que la généralisation des dispositifs prévus pour la Corse fait l'objet d'études et de diagnostics.

Je remercie également notre collègue Molac de cette proposition de loi mais j'ai besoin d'un éclaircissement à propos de l'article 5 relatif au financement des établissements privés dispensant un enseignement bilingue par les collectivités territoriales compétentes et volontaires : j'entends parler de contrainte, or, je n'y vois qu'une possibilité. Quelle est votre interprétation, monsieur le rapporteur ?

Je remercie l'ensemble des collègues qui se sont exprimés, témoignant ainsi de leur intérêt pour les langues régionales. Il importe en effet de préserver ce patrimoine et d'en faire la promotion.
Madame Atger, les associations de défense des langues régionales, d'enseignants et de parents d'élèves, se heurtent à de vrais problèmes avec la réforme du bac. Les effectifs se sont en effet effondrés – j'ai quant à moi prévenu le ministre depuis fort longtemps – et une certaine acrimonie se fait jour. Sur le terrain, les choses ne se passent pas bien avec le choix des langues vivantes B ou C, la concurrence des options, etc.
Nous parlerons peut-être des signes diacritiques dans la discussion de l'un de mes amendements.
M. Minot a rappelé la ténacité dont a fait preuve un autre député breton, M. Le Fur, pour inscrire les langues régionales dans la Constitution. Je connais son ardeur !
La ratification de la Charte suppose de disposer d'une majorité pour modifier la Constitution, or, vous savez que cela n'est pas forcément très simple, pour différentes raisons que je ne détaillerai pas ici.
Je reviendrai sur la question de l'usage de la langue dans le cadre de la discussion des articles.
Deux ministres de l'éducation nationale nous ont fait du bien, madame Bannier : Jack Lang, qui a tout de suite compris ce qu'est une langue régionale et qui a rédigé de très utiles circulaires, ainsi que François Bayrou. Je tenais à le dire.
Les articles 5 et 6 relatifs aux écoles associatives n'emportent aucune obligation en matière de financement – mais je peux comprendre que nos avis diffèrent : la convention est la règle. J'ajoute qu'il n'est pas possible d'obliger un territoire à étudier ou à parler telle ou telle langue. Si le texte comportait une contrainte, le Conseil constitutionnel rappellerait de surcroît que le volontariat s'impose. Ces deux articles dont, si vous le souhaitez, nous reparlerons, portent sur le financement des locaux dans les secteurs primaire et secondaire.
En effet, madame Manin, les territoires d'outre-mer sont particulièrement riches de leurs diverses langues et sont confrontés à de non moins diverses problématiques puisque, par exemple, certaines d'entre elles ne sont pas écrites. Il ne faut pas confondre uniformité et unité. Je ne reviens pas sur la ratification de la Charte.
L'article 1er, madame Descamps, ne concerne pas l'enseignement mais les seules questions patrimoniales, ce qui est assez différent. Vous avez été par ailleurs l'une des seules à parler de bilinguisme, ce qui est en effet important : les enfants décuplent ainsi leurs capacités langagières, y compris pour l'apprentissage des langues étrangères. Certains de mes enfants sont bilingues depuis leur prime jeunesse. En classe de terminale, ils étaient ainsi capables de parler quatre langues : le breton, le français, l'anglais et l'espagnol ou l'allemand.
Vous avez raison, madame Anthoine : je me suis référé à l'article 75-1 parce qu'il est le seul, dans la Constitution, à traiter de la question qui nous intéresse aujourd'hui. Certains me l'ont reproché en me demandant de travailler à la modification de son article 2 en y inscrivant par exemple que « le français est la langue de la République, dans le respect des langues régionales », mais sachant combien il est difficile de modifier la Constitution, je n'ai pas cherché à le faire.
S'agissant du recensement et de l'inventaire national, un travail est possible avec l'éducation nationale, l'étude des contes faisant partie des programmes de sixième. Ensuite, c'est la question de la diffusion qui importe. Comment des associations peuvent-elles s'en emparer ? Comment la faire vivre ? En l'occurrence, la promotion de l'enseignement de l'occitan ne peut qu'aider à la perpétuation de ces formes littéraires qui viennent de si loin. Je rappelle que la langue d'oc a eu une influence considérable à la fin du Moyen-Âge et qu'elle fut la langue écrite dans tout le sud de la France, jusqu'à la Révolution, y compris d'ailleurs dans le Pays basque, ce que l'on ignore souvent.
En effet, monsieur Acquaviva, il y a urgence, le danger guette et nous devons organiser des politiques linguistiques. Il est vrai, par ailleurs, que l'on confond souvent en France la culture et la citoyenneté : ne pas être de culture française, ce serait d'une certaine façon ne pas être un bon citoyen français. Un Breton, par exemple, peut avoir cette impression-là. Certains diront même : « Vous parlez breton ? Vous n'êtes pas français. » Quel est le rapport ? Citoyenneté et culture sont deux choses différentes. La République s'adresse à tout le monde, quels que soient les milieux sociaux ou la culture d'origine, et confère des droits politiques aux citoyens. Il ne faut pas la confondre avec une culture ou avec une langue, même si je sais bien qu'en France, cela n'est pas très clair. Ce n'est pas une raison pour persévérer dans ce sens-là !
La commission passe ensuite à l'examen des articles.
Article 1er : Caractère d'intérêt général de la conservation et de la connaissance du patrimoine immatériel, et des langues régionales en particulier
La commission examine, en discussion commune, les amendements AC7 du rapporteur et AC6 de Mme Céline Calvez

Initialement, l'article faisait référence à la convention internationale du patrimoine culturel immatériel. Lors des auditions, les représentants du ministère de la Culture ont jugé que la question de l'inclusion ou non de la langue dans le patrimoine immatériel dépassait le cadre de ce que la France avait signé, rien n'empêchant d'ailleurs d'aller plus loin que le texte initial, qui se situe parfois en-deçà de l'action de certains pays.
J'ai donc décidé de viser directement le code du patrimoine, ce qui est conforme à l'esprit de cette proposition de loi et à l'article 75-1, seule base constitutionnelle dont nous disposons.

M Kerlogot commence son intervention en breton.
Nous avons entendu votre volonté, Monsieur le rapporteur, de faire en sorte que l'article 1er inscrive les langues régionales dans le patrimoine immatériel et que leur connaissance et leur conservation relèvent bien de l'intérêt général. Nous proposons par cet amendement de réunir en un seul article les articles 1er et 2 afin de placer devant leurs responsabilités à la fois l'État et les collectivités territoriales, lesquels « concourent à leur enseignement, à leur protection, à leur diffusion et à leur promotion », en écrivant : « La conservation et la connaissance des langues régionales sont d'intérêt général, contribuant au dialogue des cultures et à la richesse du patrimoine français. L'État doit s'engager, en lien avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, à développer des partenariats pour soutenir les structures valorisant les langues régionales autour d'objectifs prioritaires. »
L'exposé sommaire se réfère notamment à l'Office de la langue bretonne et à l'Office public de la langue basque.
Les actions nationales et locales doivent se développer autour d'objectifs prioritaires – aide à l'édition sur et dans les langues régionales, soutien au développement numérique, à des créations originales dans le champ du spectacle vivant et de l'audiovisuel, soutien, aussi, aux nombreux festivals.

Cet amendement est assez semblable au mien mais je pense qu'une inscription dans le code du patrimoine aura une portée normative plus grande. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement AC7
Elle adopte l'amendement AC6
En conséquence, l'amendement AC3 de Mme Josette Manin tombe et l'article 1er est ainsi rédigé
Article 2 : Caractère de trésor national des biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales
La commission adopte l'article sans modification
Article 3 : Enseignement des langues régionales dans le cadre de l'horaire normal des écoles et établissements d'enseignement
La commission rejette l'article
Article 4 : Enseignement immersif en français et en langue régionale
La commission examine l'amendement AC8 du rapporteur

J'ai tout d'abord souhaité que l'enseignement bilingue tende à une maîtrise des deux langues « à chaque niveau d'enseignement », or, outre que cela dépend des niveaux respectifs auxquels on se situe, les situations peuvent être différentes d'un territoire à l'autre.
Ce qui importe, c'est la langue parlée dans le milieu familial. En France métropolitaine, c'est le français dans 99 % des cas mais tel n'est pas le cas dans les territoires d'outre-mer. Une adaptation de la pédagogie s'impose donc : en France métropolitaine, il conviendra d'insister sur les langues régionales car elles sont peu usitées dans le milieu familial et dans la société ; en outre-mer, c'est l'inverse.
Les deux langues doivent être respectées de la même façon. Il ne faut pas dire aux enfants qui parlent le créole qu'ils s'expriment en mauvais français. Locuteur du breton, je le suis également du gallo. Lorsque j'utilise des bretonismes, on me dit que je parle un mauvais français, or, c'est du gallo – par exemple, « On ne peut pas parler avec eux » pour « Je ne peux pas leur parler ».
Par cet article, je donne en quelque sorte le pouvoir aux pédagogues : « à la fin de la scolarité obligatoire », ils doivent se débrouiller pour que les élèves maîtrisent les deux langues.
La commission rejette l'amendement.
Elle rejette ensuite l'article 4
Article 5 : Financement des établissements privés du premier degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale
La commission rejette l'article.
Article 6 : Financement des établissements privés du second degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale
La commission rejette l'article.
Article 7 : Inscription d'un élève dans une école d'une autre commune afin de bénéficier d'un enseignement en langue régionale et prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence
La commission examine l'amendement AC9 du rapporteur.

L'écriture de la loi doit être très subtile, ce que permet cette nouvelle rédaction.
Un enfant dont les parents souhaitent qu'il étudie une langue régionale doit pouvoir le faire dans une autre commune si celle où il habite ne le permet pas. Il convient également d'éviter que le maire puisse se dédouaner si son école ne dispense qu'une heure d'initiation par semaine. Si la langue régionale n'est absolument pas enseignée, l'enfant doit pouvoir étudier dans une commune voisine dès lors que les parents le souhaitent. Ces derniers sont donc libres de faire comme ils l'entendent.
La commission rejette l'amendement.
Elle rejette ensuite l'article 7
Article 8 : Traductions en langue régionale des inscriptions publiques
La commission examine l'amendement AC10 du rapporteur

Il s'agit de supprimer la première partie de la première phrase concernant les collectivités territoriales de manière à ce que ce soit les services publics qui, globalement, soient impliqués. La collectivité d'Alsace, par exemple, comme toutes celles dont le statut est un peu particulier, peut s'emparer de cette question.
La compétence étant donc partagée, l'article commencerait ainsi : « les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions… » – ce qui relève du droit mou, de la possibilité.
La commission adopte l'amendement
Elle adopte ensuite l'article 8 modifié
Après l'article 8
La commission examine l'amendement AC2 de M. Jean-Félix Acquaviva

Pour diffuser et promouvoir l'enseignement des langues régionales, il me paraît essentiel de sensibiliser les fonctionnaires à la langue et à la culture régionales du territoire dans lequel ils sont appelés à servir.
Cette formation vise à renforcer l'intégration des fonctionnaires, notamment d'État, grâce à une meilleure connaissance du territoire d'implantation, ce qui permettra aux agents des services publics, notamment à ceux qui ont des carrières mobiles, de mieux appréhender les particularités et les subtilités propres à chaque territoire.

Avis favorable à cet amendement de bon sens.
Je note qu'un certain nombre de collectivités proposent déjà ce genre de dispositifs, par exemple en Bretagne, où les agents peuvent se former en langue bretonne.

Le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, propose des formations aux agents dans les départements ou au sein des régions. Ne pourrait-on pas envisager un rapprochement des fonctionnaires d'État intéressés pour bénéficier de cette formation plutôt que de s'engager dans une démarche qui risque d'alourdir ce qui existe déjà ? En revanche, vous avez raison : les agents de l'État intéressés doivent pouvoir suivre un tel apprentissage.
La commission rejette l'amendement
Article 9 : Présence des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil
La commission étudie l'amendement AC1 de Mme Géraldine Bannier

Cette disposition relève bien plus de l'article 57 – et non 54 – du code civil, qui évoque précisément l'état civil de l'enfant.

À mes yeux, ce n'est pas seulement l'acte de naissance qui doit être concerné mais l'ensemble des documents officiels dont, par exemple, la carte d'identité. Vous limitez ainsi considérablement la portée du texte. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement
Elle examine l'amendement AC5 de Mme Josette Manin

Il s'agit d'interdire la possibilité de limiter l'usage de certains caractères diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil en insérant à l'alinéa 2, après le mot « autorisés », les mots « sans condition limitative ».

Avis défavorable. Dès lors que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés par la loi dans les actes d'état civil, je ne vois pas de quel droit le pouvoir réglementaire limiterait leur usage. Forcément, il n'y aura pas de conditions limitatives.

Je le retire mais je souligne qu'une circulaire du ministère de la justice datée de juillet 2014 énumère de façon limitative les signes diacritiques autorisés lors de l'établissement d'actes d'état civil.

Certes, mais cela concerne la langue française. Les signes diacritiques des langues régionales y seront quant à eux tous inclus.
L'amendement est retiré
La commission étudie l'amendement AC4 de Mme Josette Manin

Il vise à étendre la possibilité d'utiliser les caractères diacritiques dans les délibérations adoptées par les collectivités territoriales.

Je ne comprends pas trop : soit la langue française, qui est celle de l'administration, est utilisée ; soit seuls les signes diacritiques des noms de lieux seraient en l'occurrence concernés. Sagesse !
La commission rejette l'amendement
Elle rejette ensuite l'article 9
Article 10 : Gage
La commission rejette l'article 10
Elle adopte ensuite l'ensemble de la proposition de loi modifiée
Enfin, la commission procède à l'examen de la proposition de loi visant au gel des matchs de football le 5 mai (n° 2547) (M. Michel Castellani, rapporteur).

M. Michel Castellani, premier signataire de ce texte, a été désigné comme rapporteur et, à cette occasion, a rejoint notre commission.
Monsieur le rapporteur, je vous donne tout de suite la parole.

Je vous remercie de votre présence, chers collègues, de même que le groupe Libertés et Territoires – qui nous a considérablement aidés dans cette affaire – et tous les collègues qui se sont manifestés en cosignant cette proposition de loi mais aussi à travers un certain nombre de contacts et de messages.
Vous le savez, le 5 mai 1992 devait se dérouler à Bastia une demi-finale de Coupe de France de football opposant le Sporting Club de Bastia à l'Olympique de Marseille. Compte tenu des insuffisances du stade Armand-Cesari, une tribune de 10 000 places a été montée à la va-vite. Quelques minutes avant le début du match, elle s'est malheureusement effondrée, causant la mort de 19 personnes et en blessant 2 357 autres, parfois très grièvement.
Ce fut un traumatisme considérable, compte tenu du nombre des victimes mais aussi de l'ampleur relative d'un événement sportif qui intéressait l'ensemble du pays et avait déplacé des télévisions nationales. Le Président de la République, M. François Mitterrand, est venu sur place et a annoncé qu'aucun match n'aurait plus jamais lieu le 5 mai.
Puis le drame s'est éloigné dans le temps. On en est venu à la recherche des responsabilités puis les victimes ont été peu à peu mises de côté. C'est pourquoi a été créé le Collectif des victimes du 5 mai 1992.
Le Collectif s'est toujours battu pour la reconnaissance officielle de ce drame. Mais il a fallu attendre vingt-trois ans pour qu'une avancée significative se produise avec le fameux accord du 22 juillet 2015 conclu entre le ministre des sports d'alors, M. Thierry Braillard, et le Collectif, aux termes duquel cet événement a été reconnu comme un drame national. Il a également été décidé qu'aucun match professionnel ne se déroulerait lorsque le 5 mai tomberait un samedi et une plaque commémorative a été apposée au ministère des sports. Ce fut une avancée relative, le drame s'étant produit un mardi, mais surtout en raison de toutes les insuffisances des termes de cet accord.
Depuis, de nombreuses entorses ont été commises. Des matchs se sont déroulés les 5 mai, parmi lesquels des rencontres importantes comme une finale de Coupe de la Ligue. Imaginez ce que les gens qui souffrent dans leur chair ont ressenti ! L'Olympique de Marseille a fêté son titre de champion de France un 5 mai…
Le Collectif a continué son combat en demandant le respect et le gel de cette date mais cette demande est aussi soutenue par de nombreux clubs de football, des associations de supporters, des personnalités.
En défendant cette proposition de loi, je voudrais souligner que le 5 mai est la date d'un drame national. Il ne s'agit pas là d'un fait divers local. Il en va du respect porté aux victimes, à tous ceux qui, chaque jour, vivent douloureusement, à divers titres, le souvenir de ce drame.
Il en va également de l'idée que l'on se fait du sport, qui comporte certes une dimension économique – nous le savons – mais aussi une dimension éthique. On peut s'interroger sur ce qu'est la part de l'humain et celle des intérêts purement économiques. Quel est le poids de la mémoire des événements passés ? Le sport, c'est aussi une formidable aventure humaine, personnelle, collective. C'est aussi un facteur de cohésion sociale ! L'opposition entre ces deux aspects est-elle si forte qu'ils ne puissent cohabiter ? C'est aussi tout cela qu'il y a derrière cette proposition de loi.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de l'adopter. Les matchs professionnels doivent être gelés le 5 mai.

Michel Castellani a rappelé ce qui s'est passé le 5 mai 1992. Les faits ont marqué et touché celles et ceux qui, comme moi, ont un lien – quel que soit sa nature – avec la Corse. Nous avons toutes et tous connu quelqu'un qui était présent et qui a subi ce drame de plein fouet.
Le président François Mitterrand s'est rendu sur place dès le lendemain. Il a déclaré qu'aucun match de football n'aurait lieu, désormais, le 5 mai. Cette position a été tenue pendant des années mais il est devenu très difficile de la faire respecter depuis le début des années 2000. Un accord conclu en 2015, à l'initiative du secrétaire d'État Thierry Braillard, a interdit tout match le 5 mai s'il s'agit d'un samedi. Cet accord a depuis été respecté d'une manière très variable, et on a constaté que les matchs se tenant le 5 mai suscitaient des tensions – avec le sentiment, en Corse, de ne pas être compris par la communauté nationale.
Je voudrais également revenir sur les conditions dans lesquelles le drame s'est produit. Une tribune provisoire avait été montée sans autorisation – et sans l'expertise nécessaire. Par ailleurs, une double billetterie avait été instaurée. On a vu ensuite tout le poids que l'argent a pris dans le football français – on en était aux prémices.
Le groupe La République en Marche votera pour cette proposition de loi, mais pas pour le deuxième amendement du rapporteur.

Nous avons tous en mémoire ce qui s'est passé le 5 mai 1992. En marge de la demi-finale de la Coupe de France, qui opposait le Sporting Club de Bastia à l'Olympique de Marseille, la tribune provisoire du stade de Furiani s'est effondrée : 19 personnes en sont mortes et il y a eu 2 357 blessés. Comme l'a très justement souligné le rapporteur, ce n'est pas un fait divers local, mais un drame national – le plus grave que le sport français ait connu. Des réglementations très strictes ont ensuite été adoptées pour éviter qu'un tel accident se reproduise lors d'une compétition sportive.
La trace de ce drame est indélébile dans le monde du football français et en Corse. Si on prend en compte les familles des morts et celles des blessés, presque 1 % de la population de la Corse a été touchée. On peut comprendre que l'émotion ait été considérable. On est passé en quelques secondes d'une fête magnifique – Bastia recevait l'Olympique de Marseille, le meilleur club français à cette époque, et ensuite le meilleur d'Europe – à l'horreur absolue. La demande exprimée par le Collectif des victimes du 5 mai 1992 montre à quel point la douleur reste vive.
On peut se demander si le contenu de la proposition de loi relève réellement du domaine législatif. À l'évidence, ce n'est pas le cas : il n'appartient pas à la loi de fixer la programmation des matchs de football. Néanmoins, nous ne vous en ferons pas le reproche, monsieur le rapporteur, car la Ligue de football professionnel (LFP) – qui est chargée d'organiser les compétitions sportives – n'a pas traité le sujet depuis 1992. Elle propose aujourd'hui, en réponse à ce texte, d'organiser des minutes de silence avant chaque match qui se tiendrait le 5 mai en arguant qu'un « gel » pourrait désorganiser les compétitions. Mais pourquoi n'a-t-elle pas agi en 28 ans ?
Un amendement déposé par des collègues du groupe majoritaire reprend la proposition de la Ligue. Pour ma part, j'ai une idée à vous soumettre au cas où le texte que nous examinons ne serait pas adopté en l'état : pourquoi ne pas prévoir une cérémonie associant des enfants ? Il me semble que cela perpétuerait mieux la mémoire de ceux qui sont morts ce jour-là. Nous travaillerons à cette proposition en vue de la séance, avec Jean-Jacques Ferrara, qui est député de Corse.
Des avancées ont eu lieu, comme le rapporteur l'a rappelé. Thierry Braillard, qui était alors secrétaire d'État en charge des sports, a acté l'idée qu'il n'y aurait plus de matchs le 5 mai s'il s'agissait d'un samedi. Mais pourquoi juste le samedi ? Le drame de Furiani s'est produit un mardi ! Et puis, si on arrive à déplacer des matchs ayant lieu le samedi, pourquoi n'y arriverait-on pour ceux qui se déroulent le dimanche ou le mardi ? S'agissant des compétitions européennes – cette question a parfois été mise en avant – j'observe que la proposition de loi n'en fait pas état : elle ne vise que la Ligue 1, la Ligue 2 – ou plutôt la première et la deuxième division –, ainsi que la Coupe de France. On pourrait ajouter à la liste la Coupe de la Ligue – elle est aujourd'hui suspendue mais rien ne dit qu'elle ne sera pas rétablie un jour.
Je rappelle aussi que de nombreuses rencontres ont pu être déplacées l'an dernier pendant la crise des gilets jaunes, sur ordre des préfets, parfois du jour au lendemain, sans que cela pose de problème ni à la Ligue de football, ni aux diffuseurs. Plusieurs journées du championnat se déroulent, par ailleurs, sous la forme d'un multiplex – plusieurs rencontres ont lieu en même temps. Ce sont même les journées les plus rémunératrices – les chaînes de télévision se les arrachent.
La proposition de loi aura notamment le mérite d'obliger la ministre des sports à prendre position. Elle a répondu le 5 mai 2019 qu'elle n'avait pas d'avis sur la question. Elle était probablement la seule à ne pas en avoir – ce qui est une chose d'ailleurs étonnante de la part d'une ministre des sports qui a en général un avis sur tout ou presque et qui, ces derniers jours, a fait part de convictions particulièrement fortes et pertinentes sur un autre sujet.
Cette proposition de loi aura le mérite de trancher un débat qui est devenu récurrent chaque 5 mai. C'est pourquoi, même si le texte ne semble pas relever du domaine de la loi, le groupe Les Républicains ne s'y opposera pas.

J'étais une jeune collégienne le 5 mai 1992. Je n'ai rien oublié de l'image de désolation produite par l'enchevêtrement inouï de tôles et de barres de métal qui s'était formé, ni de la stupeur suscitée par la disparition de 18 de nos concitoyens et le très grand nombre de blessés. La question de la mémoire du drame est incontournable. Mais il s'agit de se demander comment la transmettre au mieux aux générations qui suivent. Chacune a ses drames : on m'a raconté à plusieurs reprises le choc causé, dans ma région, par l'accident qui s'est produit en 1955 lors des 24 heures du Mans et causa la mort de 84 personnes dans des conditions atroces. Je ne crois pas que pour autant on ait interdit toute course automobile le 11 juin. Pourtant, chacun tressaille au souvenir de cet événement.
Le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés préférerait qu'il y ait simplement une minute de silence en mémoire de la catastrophe de Furiani avant chaque match se déroulant le 5 mai, que ce soit dans un cadre professionnel ou amateur – c'est un acte de mémoire qui nous paraît plus à même de parler aux générations à venir.
Par amitié pour les Corses et par respect pour les victimes, nous ne voterons pas contre cette proposition de loi – sauf choix personnel contraire – mais nous nous interrogeons sur la forme de jurisprudence à laquelle cela pourrait conduire en ce qui concerne d'autres événements tragiques.

L'article unique de cette proposition de loi dispose : « En hommage aux victimes du drame national de Furiani, aucun match de football des championnats professionnels de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Coupe de France n'est joué à la date du 5 mai ».
La date de la catastrophe de Furiani est indiscutablement douloureuse pour les Corses et pour l'ensemble du monde du football français. Personne ne peut oublier les victimes, leurs familles et leurs proches. Outre l'absence de match les samedis 5 mai, comme le prévoit l'accord conclu en 2015 entre le secrétariat d'État en charge des sports, le collectif des victimes, la fédération française de football et la LFP, une démarche de commémoration active a été engagée. Elle s'est notamment traduite, le dimanche 5 mai dernier, par l'organisation d'une minute de silence dans les stades où des rencontres de la Ligue 1 avaient lieu.
Le devoir de mémoire a vocation à être amplifié et pérennisé, mais le gel des matchs le 5 mai ne nous paraît pas la mesure la plus à même de rendre hommage aux victimes. Il faudrait plutôt rappeler ce qui s'est passé à travers une série d'actes symboliques – faire porter un brassard noir à toutes les personnes jouant un match en France, imposer une minute de recueillement avant le début des rencontres, diffuser un film et faire défiler les noms des victimes sur les écrans géants des stades ou encore obtenir des diffuseurs, en les sensibilisant, qu'ils relaient des messages.
Des dispositions harmonisées et étendues au football amateur permettraient d'apporter un éclairage utile à la tragédie de Furiani et de rendre hommage activement à la mémoire des victimes. Sur ce plan, j'observe que la rédaction actuelle de la proposition de loi ne couvre que la Ligue 1, la Ligue 2 et la Coupe de France. Un match européen ou international qui se déroulerait un 5 mai en France ne serait donc pas concerné.
La commémoration est la logique privilégiée dans le monde entier jusqu'à présent. Au Royaume-Uni, la catastrophe de Hillsborough – qui a été l'une des plus graves de l'histoire du football et du sport en général –, est commémorée tous les 15 avril par un décalage du début des rencontres de sept minutes, ce qui correspond au temps qui s'était écoulé entre le début du match et son interruption. L'article unique de la proposition de loi pourrait s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger en décidant que le 5 mai devient une journée nationale de commémoration. Ainsi, un hommage aux victimes serait organisé à l'occasion de chaque rencontre de football ayant lieu à cette date.
Cependant, le groupe Socialistes et apparentés ne s'opposera pas à ce texte.

Je partage naturellement tout ce qui vient d'être dit. Nous avons tous vécu, plus ou moins, ce drame. Alors que nous attendions, devant nos téléviseurs, un match de football, nous avons assisté à un drame absolu. Le rapporteur a souligné, à juste titre, qu'il n'y a plus beaucoup de solidarité dans le monde du football, mais elle a existé ce jour-là. Je me souviens que les joueurs et les présidents des deux clubs ont essayé d'apporter leur soutien.
La proposition de loi tend à perpétuer cette solidarité. Toute la question est de savoir si cela relève de la loi. Nous partageons votre émotion – et je pense que nous déposerions le même texte si nous étions à votre place – mais faut-il légiférer sur tous les sujets ? Ne serait-il pas préférable que le monde du football fasse lui-même preuve de solidarité ? Avec la proposition de loi, on impose mais là encore on ne donne pas au football l'occasion de faire preuve de solidarité.
Au-delà du 5 mai, on peut penser à la journée de la Ligue 1 qui est la plus proche de cette date : cela pourrait être l'occasion de faire passer un message, de rappeler que quelque chose s'est passé et que le foot doit en être solidaire. Ce serait la meilleure façon d'agir. Le simple fait d'interdire un match de foot, une journée, ne résoudra pas tout.
Comme le rapporteur l'a dit, il faut aussi veiller à ce qu'une telle catastrophe ne se produise plus jamais. Ce qui s'est passé était indigne : c'était une histoire d'argent et d'obligations non respectées – le préfet n'avait même pas organisé une réunion de sécurité. On a corrigé ces problèmes, et c'est tant mieux !
Nous partageons la souffrance que vous avez ressentie – et que vous ressentez encore –, mais je reste persuadé que la loi ne peut pas tout et ne résoudra pas ce problème comme cela. Personne ne s'opposera à ce texte, mais nous pensons que l'on pourrait agir beaucoup plus efficacement d'une autre manière. Si on diffuse de l'information, on peut répondre au problème.

Merci, chers collègues, de m'accueillir dans votre commission. Cette proposition de loi de Michel Castellani a une résonance particulière pour les membres du groupe Libertés et Territoires. Nous l'avons inscrite à l'ordre du jour du séminaire que nous avons organisé en mai dernier, à Bastia – précisément au stade de Furiani, où il y a eu une rencontre entre l'équipe de football des parlementaires et une équipe d'élus de Corse.
Les habitants de Bastia, les Corses et tous les amoureux du football se souviennent du 5 mai 1992, des 19 morts et des 2 357 blessés, qui étaient venus par amour du football et pour soutenir leur club pendant la demi-finale de la Coupe de France, face à l'Olympique de Marseille – mon club de coeur. Pendant la précédente législature, j'ai accompagné Avi Assouly, qui a été député mais aussi journaliste. Présent dans la tribune, il a été l'un des plus graves blessés lors de son effondrement. Trente ans plus tard, la cicatrice est encore vive dans les mémoires – nous le sentons bien dans les interventions des uns et des autres. Nous ne pouvons pas effacer ce drame, mais nous pouvons nous assurer de ne pas l'oublier, de ne pas recommencer. Nous avons, plus encore qu'un devoir de commémoration, un devoir de protection.
Le drame de Furiani aurait pu être évité : c'est une tribune construite à la hâte qui s'est effondrée. Il s'agissait d'accueillir plus de monde et de vendre plus de places, autrement dit de faire plus de bénéfices. C'est à cause de l'avidité que tant de personnes sont mortes et que tant d'autres vont souffrir toute leur vie. Au-delà de ce qui s'est passé en Corse et du football, nous devons prendre conscience, collectivement, du danger qui résulte du primat des intérêts économiques et de la recherche du profit dans le monde sportif.
Un audit des infrastructures a permis de changer la situation, et le Président François Mitterrand a émis le souhait que plus aucun match ne se déroule en France le 5 mai. Thierry Braillard a ensuite décidé, en 2015, qu'aucun match n'aurait lieu les samedis 5 mai.
La principale raison avancée par les instances du football français pour refuser la sanctuarisation de cette date est que cela déréglerait le calendrier. Je pense que nous devons nous donner les moyens d'aller au-delà. Le drame de Furiani ne se résume ni à la Corse – il s'agit d'un drame national – ni au football : c'est la question du vivre ensemble qui est posée.
Afin de rendre hommage aux victimes de Furiani, de lutter contre le non-respect des règles et la cupidité qui ont causé tant de morts dans le monde du spectacle sportif ou culturel, et de continuer à protéger nos concitoyens – vous avez rappelé les victimes des 24 heures du Mans –, nous devons faire du 5 mai une date symbolique, comme il en existe déjà d'autres. C'est pourquoi je vous invite à adopter la proposition de loi.

Cette question relève-t-elle de la loi ? On peut en discuter, bien sûr, mais je me félicite que l'on examine ce texte, pour deux raisons.
D'abord, ce qui nous est proposé correspond à une demande historique des familles des victimes – 19 morts et 2 357 blessés, il faut toujours le rappeler. Une catastrophe nationale s'est produite : toute la population a été touchée, au-delà des hommes et des femmes qui sont attachés à la pratique du sport.
Il y a, ensuite, l'autre raison évoquée à l'instant par notre collègue. Ce qui s'est passé à Furiani n'était pas un accident mais la conséquence d'une accumulation de dysfonctionnements. Une commission de sécurité s'est réunie ; les pompiers ont appelé l'attention, à deux reprises, mais la préfecture n'a pas suivi. Le directeur de l'entreprise qui a monté la tribune – avec des matériaux qui ne convenaient pas –, la ligue, le club, la fédération et le directeur de cabinet du préfet ont été condamnés. Au-delà de la question de la cupidité, qui a déjà été évoquée, il y a eu toute une série de faux. Une fausse déclaration de mise en conformité a même été envoyée à la Fédération française de football. C'est cela que cette proposition de loi permet de dénoncer : le fait qu'au nom de l'argent, on peut commettre de tels actes qui amènent à un tel drame.
Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine votera en faveur de ce texte.

Je voudrais apporter quelques éléments complémentaires. Il se trouve que Michel Castellani et moi-même étions présents. Nous savons donc très bien ce qui s'est passé avant et après.
Si on en arrive à une proposition de loi, c'est à cause de ce qui a eu lieu ce jour-là – un drame de la cupidité, du « footfric », causé par des faits qui ont conduit à la condamnation de l'État et des instances du football – mais aussi à cause de ce qui est arrivé après. Le collectif des victimes a dû se battre pour que justice soit rendue, puis il a continué à se heurter à des murs pendant des années. Il a également fallu lutter contre l'absence de respect et la relativisation du drame. Je rappelle qu'il était prévu d'organiser la finale de la Coupe de France le 5 mai 2012, vingt ans plus tard… Il n'y a jamais eu de commémoration du 5 mai – c'est peu de le dire.
Le gel des matchs de football professionnel vise notamment à réconcilier ; c'est une dimension qui doit être prise en compte dans le contexte de souffrance massive qui existe encore aujourd'hui. Je rappelle que dans les vingt ans à venir, il s'agit en fait de cinq dates. Qui peut le plus peut le moins !
Par ailleurs, rien n'empêchera une commémoration dans d'autres cadres, notamment celui du football amateur, afin que la jeune génération participe – j'invite à déposer des amendements d'ici à la séance –, mais il faut que les instances du football professionnel assument, ce qu'elles n'ont pas fait depuis trente ans.
Ce qui nous est proposé relève de la loi et constitue un acte moralement nécessaire en réponse à un drame causé par le « footfric ».

La catastrophe de Furiani est une date douloureuse pour les Corses et, au-delà, pour l'ensemble du monde du football. Il est essentiel de se souvenir de ce qui s'est passé. Je garde, monsieur le rapporteur, un souvenir ému et fort du moment de recueillement que nous avons partagé en mai dernier lorsque vous avez accueilli le Onze parlementaire à Furiani.
D'autres formes d'hommage ont été évoquées. Comme l'a souligné Mme Manin, une logique de commémoration est privilégiée dans le monde entier. Dans le championnat anglais, par exemple, la catastrophe de Hillsborough est commémorée tous les 15 avril par un décalage du début des rencontres de sept minutes, ce qui correspond au temps qui s'était écoulé entre le début du match et son interruption. Par ailleurs, les clubs mythiques de Liverpool et de Nottingham Forrest ne jouent plus jamais ce jour-là de l'année. Avez-vous envisagé, monsieur le rapporteur, de proposer une mesure inspirée de cet exemple, qui conduirait à ce que seuls les clubs de Bastia et de Marseille ne jouent pas le 5 mai ?

Je voudrais remercier Michel Castellani de nous avoir rappelé, avec cette proposition de loi, la catastrophe de Furiani et d'avoir engagé un travail de mémoire collective autour de la sanctuarisation du 5 mai.
Le sport est relativement en difficulté sur le plan des repères. Au-delà de l'hommage que l'on peut rendre aux victimes – ce qui n'est pas rien –, je crois qu'il faut baliser l'histoire du sport et permettre des moments de réflexion sur ses usages et sur son sens.
Il me semble qu'il est totalement du ressort de la représentation nationale – contrairement à ce que j'ai pu entendre précédemment – de dire qu'une solidarité doit exister dans le football en France, à travers des moments de recueillement et d'hommage, dans toutes les temporalités collectives qui voient des gens se réunir autour d'un objet sportif.

La catastrophe de Furiani s'inscrit dans un contexte européen lourd, qui a déjà été évoqué : les 39 morts du drame du Heysel, qui s'est produit en 1985 lors d'une finale entre Liverpool et la Juve, les 96 morts de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre à Hillsborough en 1989, puis les 19 morts de Furiani en 1992.
Au-delà de la douleur et de la cicatrice pour les Corses, il y a eu un tournant pour les supporters de football : le drame national de Furiani a conduit à adopter toute une législation visant à renforcer la sécurité lors des matchs de football. Cela peut se justifier en ce qui concerne l'accueil du public, mais c'est autrement plus contestable quand il s'agit de restreindre les libertés fondamentales de personnes qui sont, avant tout, des supporters de football. Je me suis penché sur cette question avec Marie-George Buffet dans le cadre de la mission d'information que nous conduisons ensemble – nous avons notamment rencontré des supporters lensois et nous nous rendrons demain à Marseille.
Lorsque les fédérations et les ligues ne prennent pas spontanément leurs responsabilités, l'État, qui concède un service public, doit agir. C'est le sens de cette proposition de loi que je soutiens naturellement.

Je voudrais remercier tous ceux qui se sont exprimés.
Le fait de sacraliser une date, par un gel des matchs, entre-t-il vraiment dans le domaine de la loi ? Je comprends cette question – comme je comprends la proposition d'en rester à l'accord du 22 juillet 2015, qui constituait déjà une avancée. Certains se demandent aussi si on ne pourrait pas aller plus loin, par exemple en retardant tous les matchs de sept minutes, comme le font les Britanniques pour Hillsbourough.
Chacun se déterminera selon sa sensibilité personnelle. Notre position correspond à la sensibilité de personnes qui ont vécu cet événement et qui le vivent encore chaque jour, dans leur chair. Lorsque je participe à la cérémonie organisée le 5 mai à Furiani, tous les ans, je vois des gens brisés, qui ne peuvent pas oublier un enfant qui ne s'est jamais relevé ce jour-là, ou qui sont eux-mêmes en fauteuil roulant pour le reste de leur vie. C'est à ces gens que nous avons pensé quand nous avons déposé la proposition de loi.

Je voudrais remercier nos collègues d'avoir proposé ce texte. C'est un sujet qui a traumatisé la Corse, mais aussi tous les passionnés de football et tous les Français.
Je me pose une question : est-ce le football qui a tué et blessé ce soir-là ? Ma réponse est non ! Je pense que ce n'est pas le sport, mais la cupidité et la lâcheté qui ont fait des victimes ce soir-là. Les responsabilités doivent être placées là où il faut. Certaines réglementations ont ensuite été adoptées pour éviter que ce genre d'incidents ne se reproduise.
Nous devons le respect aux morts et aux blessés, ainsi qu'à leurs familles. Face à la mort, ma philosophie est considérer qu'il faut célébrer la vie. Je ne suis donc pas favorable à l'interdiction des matchs le 5 mai. En revanche, par respect, je pense que nous devrions commémorer, sur tous les terrains de France, ce qui s'est passé. Nous ne devons jamais l'oublier. J'aimerais savoir si les auteurs du texte sont prêts à l'amender dans le sens que je viens d'évoquer. Si ce n'est pas le cas, je ne m'opposerai pas à la proposition de loi mais je m'abstiendrai.
La commission en vient à l'examen de l'article unique de la proposition de loi.
Article unique : Neutralisation de la date du 5 mai dans le calendrier des compétitions et des rencontres de football en souvenir du drame de Furiani
La commission examine l'amendement AC2 du rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel. Il s'agit de rappeler très précisément à quoi fait référence l'expression : « drame national de Furiani ».
La commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement AC3 du rapporteur.

L'amendement précise les compétitions entrant dans le champ de la proposition de loi. Il dispose qu'« aucune rencontre ou manifestation sportive organisée dans le cadre ou en marge des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de football et du Trophée des Champions n'est jouée ».

Ce sont des dénominations commerciales. La dénomination usitée est « première et deuxième divisions du championnat de France de football ».
S'agissant du Trophée des champions, je signale qu'il n'y a aucune chance que cette compétition ait lieu en mai – il faut attendre la fin du championnat et de la Coupe de France.
J'aurais préféré que l'on vise toutes les compétitions organisées par les ligues de football : si une compétition est réintroduite, comme la Coupe de la Ligue, les organisateurs sont capables de choisir le 5 mai – on a failli avoir une finale de la Coupe de France à cette date. Il faudrait peut-être amender le texte sur ce point.
La commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement AC1 de Mme Jacqueline Dubois.

Je tiens à dire que mon intention, lorsque j'ai déposé cet amendement, n'était surtout pas de réduire l'importance du terrible drame survenu à Furiani le 5 mai 1992 et qui a gravement endeuillé la France. Je voudrais en assurer Mme Josepha Guidicelli, présidente du collectif des victimes.
On peut penser que ne pas jouer de matchs le 5 mai est susceptible d'avoir un effet contraire à celui que vous souhaitez : cela pourrait faire oublier d'honorer la mémoire des victimes du drame – les 2 300 blessés et les 19 morts, mais aussi les très nombreuses familles qui continuent à porter le deuil.
Il faut aussi rappeler – cela a été fait tout à l'heure – que la construction de cette tribune, illégale, était un vrai scandale. Des normes drastiques ont ensuite été imposées pour les équipements sportifs et les salles de spectacle.
J'ai déposé cet amendement afin d'inscrire dans la loi l'obligation de respecter une minute de silence avant tout match le 5 mai. Néanmoins, compte tenu des différentes initiatives qui ont été prises depuis 1992 – celles qui sont positives mais aussi les ratés auxquels on a assisté – et du manque de respect que les Corses ressentent, je comprends l'importance de la proposition de loi et je vais donc retirer mon amendement.
L'amendement AC1 est retiré.
La commission adopte ensuite l'article unique, modifié, de la proposition de loi.

Ce texte sera examiné en séance publique jeudi prochain, en première position, dans le cadre de la journée réservée au groupe Libertés et Territoires.
La réunion s'achève à douze heures trente-cinq.
______
Présences en réunion
Réunion du mercredi 5 février à 9 heures 30
Présents. – Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Stéphanie Atger, Mme Géraldine Bannier, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Aurore Bergé, M. Philippe Berta, M. Bruno Bilde, M. Ian Boucard, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Bertrand Bouyx, M. Moetai Brotherson, Mme Marie-George Buffet, Mme Céline Calvez, M. Michel Castellani, Mme Fannette Charvier, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Béatrice Descamps, Mme Jacqueline Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, M. Alexandre Freschi, M. Bruno Fuchs, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Régis Juanico, M. Yannick Kerlogot, Mme Brigitte Kuster, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, Mme Josette Manin, Mme Sophie Mette, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Paul Molac, Mme Sandrine Mörch, M. Sébastien Nadot, M. Guillaume Peltier, Mme Maud Petit, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Muriel Ressiguier, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, Mme Agnès Thill, Mme Sylvie Tolmont, Mme Michèle Victory, M. Patrick Vignal, M. Michel Zumkeller
Excusés. – M. Pascal Bois, M. Bernard Brochand, Mme Anne Brugnera, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Laurent Garcia, Mme Annie Genevard, Mme Cécile Muschotti, M. Frédéric Reiss, Mme Marie-Pierre Rixain
Assistaient également à la réunion. – M. Jean-Félix Acquaviva, Mme Elsa Faucillon, M. Sacha Houlié, M. François-Michel Lambert, Mme Frédérique Lardet, M. Marc Le Fur, M. Serge Letchimy, M. Denis Masséglia, M. Bertrand Pancher, M. François Pupponi