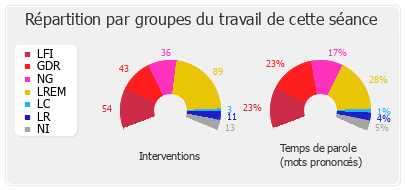Séance en hémicycle du jeudi 23 novembre 2017 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à quinze heures.



Cet amendement concerne les transferts conventionnels de contrats de travail par lesquels, dans le cadre de marchés publics ou de délégations de service public, le personnel est maintenu lors de l'arrivée de nouveaux gestionnaires. L'article L. 1224-3-2 du code du travail, modifié par l'article 34 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, dispose que dans un tel cas, « les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. »
Sous prétexte de sécurisation, le Gouvernement cherche ainsi à abaisser le coût du travail, tout en permettant des conditions de travail différentes entre des salariés effectuant les mêmes tâches sur un même site. En outre, cette disposition remet en cause le principe d'égalité de traitement et fait obstacle à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a toujours estimé que, dans le cadre d'un transfert conventionnel faisant suite à la perte d'un marché de services, les salariés du nouveau prestataire accomplissant le même travail sur le même chantier pouvaient revendiquer l'application du principe d'égalité de traitement.
Monsieur le rapporteur, vous avez vous-même admis en commission que : « la jurisprudence a mis le dispositif à mal en jugeant qu'un tel transfert ne constitue pas une raison objective permettant de justifier une différence de rémunération entre salariés ». Vous légiférez donc sur la base d'une mesure inconstitutionnelle en ce qu'elle remet en cause le principe fondamental : « à travail égal, salaire égal ». C'est pourquoi nous en demandons l'abrogation.

La parole est à M. Adrien Quatennens, pour soutenir l'amendement no 356 .

C'est souvent quand ils ont réussi à instaurer un rapport de forces qui leur est favorable que les salariés parviennent à obtenir des avancées, notamment en matière de rémunération. Ces avancées ne sont donc pas des acquis, mais bien des conquêtes : rares sont les employeurs qui signifient naturellement à leurs salariés qu'ils vont leur concéder une forte augmentation ou de nouvelles primes. C'est en tout cas ce qui se passe dans la plupart des groupes, et surtout dans les plus grands, puisque la maîtrise de la masse salariale y est le moyen le plus utilisé pour enrichir les actionnaires dans les proportions que l'on sait. Pour rappel, aujourd'hui, en France, un salarié travaille en moyenne vingt-six jours par an pour rémunérer les actionnaires, contre neuf en 1980. Le prétendu coût du travail sert surtout à masquer l'exorbitant coût du capital.
Par ces ordonnances, vous introduisez pourtant une mesure visant uniquement à contraindre les salariés à renégocier ce qu'ils avaient déjà arraché par leur lutte au sein de l'entreprise. En cas de cession d'une entreprise, vous voulez rendre impossible la préservation par les salariés des avancées obtenues avant le changement de propriétaire. La négociation collective ne s'inscrit pas a priori dans le dialogue social que vous invoquez. Pourquoi s'obstiner ainsi à vouloir défaire toutes les avancées dont bénéficient les salariés ? Les acquis sociaux à l'échelle de l'entreprise doivent eux aussi être conservés. Ils sont déjà suffisamment attaqués par le reste du contenu de vos ordonnances pour refuser en plus de préserver le fruit des négociations locales.
Notre amendement vise à supprimer cette disposition pour sécuriser vraiment les salariés et revaloriser la négociation collective, en empêchant qu'à chaque changement de propriétaire, les dispositions prises précédemment ne tombent à plat.

La parole est à M. Laurent Pietraszewski, rapporteur de la commission des affaires sociales, pour donner l'avis de la commission sur ces amendements identiques.

Avis défavorable. En invoquant le principe : « à travail égal, salaire égal » M. Lecoq reprend à son compte une inquiétude exprimée en commission par Pierre Dharréville.
Le principe du transfert conventionnel résulte de dispositions définies dans certaines conventions collectives selon lesquelles une entreprise emportant un nouveau contrat est tenue de reprendre l'ensemble des salariés de l'entreprise évincée. Il est donc protecteur pour les salariés. Plusieurs secteurs sont concernés – on cite le plus souvent celui de la propreté.

En effet.
Mais la jurisprudence a mis le dispositif à mal en jugeant qu'un tel transfert ne constitue pas une raison objective permettant de justifier une différence de rémunération entre salariés. Autrement dit, l'employeur qui reprenait d'anciens salariés sur un site pouvait se trouver dans l'obligation d'étendre tous leurs avantages aux salariés de l'entreprise travaillant sur d'autres sites. La loi du 8 août 2016 a mis un terme à ce risque potentiel, en prévoyant que les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise ayant emporté le nouveau contrat ne pouvaient se prévaloir des avantages consentis aux salariés dont les contrats ont été transférés. C'était une première forme de sécurisation.
L'ordonnance se limite à étendre ce principe dérogatoire à l'ensemble de l'entreprise et non plus au seul site concerné par l'exécution du marché car, par un effet de cascade et de mobilités successives, les rémunérations pouvaient être conduites à s'aligner à la hausse entre plusieurs sites et pour plusieurs employeurs. Il s'agit donc bien d'un nouvel élément de sécurisation du dispositif des transferts conventionnels
En commission, j'avais d'ailleurs montré à Pierre Dharréville, par un exemple très concret, que sa proposition de mettre fin à ce principe dérogatoire pouvait représenter un frein pour le salarié soucieux de mobilité. Notre dispositif est, lui, sécurisant pour tout le monde, y compris pour le salarié lui-même.

La parole est à Mme la ministre du travail, pour donner l'avis du Gouvernement sur ces amendements.

Nous proposons d'améliorer l'indemnité allouée aux salariés en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la protection de la grossesse et de la maternité : celle-ci ne pourrait être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Avis défavorable. Vous m'aviez expliqué en commission que, même si vous auriez préféré le maintien du droit antérieur, des évolutions pouvaient être souhaitables en la matière. C'est ainsi que vous souhaitez relever, en la portant à douze mois de salaire au lieu de six, l'indemnité minimale accordée par le juge lorsqu'il prononce la nullité d'un licenciement en raison du non-respect des obligations liées à la protection de la grossesse et de la maternité. Mais pourquoi vouloir modifier spécifiquement ce seuil, alors que pour les autres cas de nullité, il est homogène et équivalent à six mois de salaire ? Faut-il faire une différence entre l'annulation d'un licenciement pour discrimination et celle qui sanctionne le non-respect de l'obligation de protéger la grossesse ? Tous ces cas de nullité doivent être, à mon sens, sanctionnés de la même manière, et il me paraît donc intéressant de conserver l'homogénéité assurée dans les ordonnances.
Je rappelle en outre qu'il ne s'agit que d'un plancher ; libre au juge d'apprécier ensuite la nature de l'illégalité commise par l'employeur et d'adapter l'indemnité versée à la hauteur du préjudice subi.
L'amendement no 191 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.


L'article 7 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, de limiter au territoire national le périmètre de reclassement d'un salarié inapte. Jusqu'à présent, le reclassement devait être recherché non seulement dans les établissements de l'entreprise, mais aussi dans ceux des autres entreprises du groupe auquel elle appartient, y compris, le cas échéant, lorsqu'ils étaient implantés à l'étranger. Notre amendement vise à rétablir cette possibilité.

L'amendement vise à revenir sur les dispositions introduites par l'ordonnance du 22 septembre, que nous jugeons dangereuses, relatives au périmètre de reclassement obligatoire du salarié au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe – à entendre dans sa définition restreinte de groupe capitalistique. La jurisprudence de la Cour de cassation protégeait bien davantage les salariés, dans la mesure où sa définition du groupe incluait également les entreprises partenaires, ce qui décuplait les possibilités de reclassement. On pouvait vraiment parler, alors, de sécurisation des relations de travail, ce qui n'est plus le cas s'agissant de la disposition introduite par l'ordonnance, puisque celle-ci tend à réduire les obligations des employeurs en matière de reclassement des salariés.

Avis défavorable. Ces dispositions ne limitent pas les possibilités de reclassement pour le salarié, mais obligent l'employeur a les définir précisément. Sur ces procédures d'inaptitude, la jurisprudence de la Cour de cassation était telle que, même si l'employeur et le salarié étaient de bonne volonté, ils risquaient de se retrouver devant le juge : le taux de judiciarisation était en effet très important.
Je pense qu'il est très difficile pour un employeur de satisfaire à son obligation de reclassement ; en cas de contentieux, il a toujours la garantie d'avoir tort. Il est raisonnable de considérer que le périmètre de l'obligation de reclassement se limite aux entreprises du groupe situées sur le territoire national. Reclasser un salarié inapte dans une filiale située à l'étranger ne me semble avoir guère de sens.

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement no 111 .
Les deux amendements concernent les obligations de l'employeur en matière de reclassement pour inaptitude de certains salariés. En vertu de l'ordonnance présentée, celui-ci peut être effectué au sein des différentes entreprises du groupe, quelle que soit leur situation géographique sur le territoire national.
Nous ne contestons évidemment pas la possibilité de reclasser un salarié déclaré inapte au travail ; une telle démarche est parfaitement justifiée. Mais il ne faudrait pas qu'elle permette de détourner la législation relative au droit du travail. Nous savons désormais que certains groupes, notamment une grande enseigne de distribution, usent et abusent de ces procédures d'inaptitude pour se débarrasser de salariés qu'ils ne jugent pas suffisamment productifs. Le législateur n'a pas à faciliter les pratiques managériales d'un autre âge ! En effet, certaines entreprises affichent un taux de licenciement pour inaptitude particulièrement élevé compte tenu du nombre de reclassements réellement effectués. Les cadences parfois folles qu'elles imposent à leurs salariés débouchent quasi inéluctablement sur une déclaration d'inaptitude et c'est alors le cercle vicieux qui s'installe. Afin de faciliter les reclassements et pour éviter que cette procédure soit utilisée abusivement pour se séparer des salariés, nous vous proposons de prévoir que les reclassements soient réalisés en priorité dans une entreprise proche du domicile.

Votre amendement propose que dans le cadre de la procédure de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur soit tenu de proposer en priorité au salarié un poste situé « dans le ressort géographique de son domicile ». Je crois avoir bien compris l'objet de votre amendement, mais la façon dont il est libellé pose plusieurs questions. Au fond, le problème tient à la prise en compte des caractéristiques propres à chaque entreprise. Certaines d'entre elles – notamment dans la grande distribution – peuvent avoir des établissements très disséminés, de sorte que l'on puisse toujours en trouver un à proximité du domicile du salarié ; mais ce n'est pas le cas pour les transporteurs ou dans d'autres secteurs d'activité. Par ailleurs, la lecture de votre amendement peut laisser penser qu'un salarié est forcément immobile ; mais il peut exister des possibilités de reclassement ailleurs, et pour les entreprises implantées sur plusieurs sites répartis sur le territoire français, mieux vaut se référer à un périmètre suffisamment large.
Enfin, du point de vue juridique, j'ai une idée de ce que vous mettez derrière le « ressort géographique », mais ce terme est-il vraiment opérationnel ? S'agit-il de la région ou du département au sens administratif ? Si l'on prend le Nord, une mobilité entre Fourmies et Dunkerque apparaît plus compliquée qu'entre Fourmies et Hirson ou entre Dunkerque et Boulogne-sur-Mer, même si cela amène à passer dans le Pas-de-Calais. Tout cela est complexe. Je comprends votre intention, cher collègue, mais le dispositif ne me paraît pas adapté à toutes les activités. De plus, il ferait perdre des chances aux salariés qui, dans les cas où l'inaptitude entraîne une difficulté à se déplacer, peuvent avoir besoin d'être au plus près de leur lieu de travail. Toutes ces interrogations m'amènent à formuler un avis défavorable.
L'amendement no 110 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 6 réduit le champ de l'obligation de reclassement d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en introduisant deux critères limitatifs : un critère géographique et un critère de compétitivité qui restreint le champ d'appréciation des postes où le salarié pourrait être réaffecté. Ce faisant, vous affaiblissez l'obligation de reclassement, dont je rappelle qu'elle est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Cette remise en cause est inacceptable. L'obligation de reclassement ne doit pas consister à fournir une liste de postes équivalents à celui qui était précédemment occupé mais à proposer un poste équivalent en prenant en compte l'état de santé de la personne considérée. C'est le sens de cet amendement.

M'étant déjà exprimé sur le fond de la question, je me limite à indiquer mon avis défavorable.
L'amendement no 198 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'amendement no 111 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Vous modifiez discrètement plusieurs planchers d'indemnisation, comme dans le cas où la priorité à la réembauche n'est pas respectée, ou encore dans celui où un licenciement économique est déclaré nul en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou en raison de l'insuffisance du PSE. Mais plus encore, vous supprimez le plancher de douze mois de salaire pour l'indemnisation du salarié licencié en violation des dispositions sur l'inaptitude professionnelle, renvoyant l'indemnité au « droit minimal » du barème impératif. Nous proposons de rétablir ce seuil.

Cet amendement a été rejeté en commission et j'y suis toujours défavorable. Je sais que je vous déçois, cher collègue, mais l'idée reste la même : il s'agit d'un plancher. Libre au juge d'aller au-delà, voire de retrouver des perspectives que vous appelez de vos voeux en passant par exemple à douze mois.

J'ai bien compris qu'il s'agissait d'un plancher ; c'est pourquoi moi-même, j'en proposais un autre, un peu plus haut. Par ailleurs, je propose bien de « rétablir » ce plancher, et je sais votre attachement au droit constant.
L'amendement no 189 n'est pas adopté.
L'amendement no 324 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon, pour soutenir l'amendement no 113 .
L'amendement no 113 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Nous abordons ici la matrice de votre projet d'ordonnances : la faculté, pour les entreprises, de se livrer à l'optimisation sociale. L'article 15 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail prévoit de limiter le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au territoire national. Ce faisant, il permet à une entreprise de procéder à des licenciements économiques alors même que le groupe auquel elle appartient n'a pas de difficultés financières. S'il fallait chercher le meilleur moyen pour alimenter le déclin industriel de notre pays, l'objectif serait atteint. Nul doute que vous allez créer un appel d'air en laissant aux multinationales tout loisir de détruire des emplois dans des sites français quand elles estimeront qu'il sera plus intéressant de les délocaliser dans des pays à fiscalité ou aux coûts sociaux plus intéressants. C'est une véritable bombe à retardement pour l'anti-made in France.
Chers collègues, nous devrions tous nous accorder dans cet hémicycle sur la nécessité de préserver l'emploi sur le territoire national. Au lieu de cela, vous justifiez cette mesure par l'idée qu'elle permettra d'attirer les investissements étrangers. Ne croyez-vous pas que nous en avons assez fait à l'occasion du projet de loi de finances pour 2018 ? Cessez cette course à la compétitivité par les coûts, qui va tout emporter sur son passage ! Cessez la course au moins-disant social ! Cessez de répondre aux attentes du MEDEF ! Avec cet amendement, nous proposons de revenir à la situation antérieure où le périmètre d'appréciation des difficultés économiques était celui du secteur d'activité du groupe. Le rapporteur nous répondra sûrement que tous les pays d'Europe font ce genre de choses à l'échelle nationale, mais les députés communistes, soucieux de défendre le produire français, insistent sur l'idée de revenir sur cette disposition.

La parole est à Mme Bénédicte Taurine, pour soutenir l'amendement no 359 .

Le Gouvernement évoque souvent les TPE, les très petites entreprises, et les PME ; pourtant toutes les mesures de ces ordonnances sont manifestement destinées aux plus grandes entreprises. Les alinéas 12 à 14 de l'article L. 1233-3 du code du travail réduisent le périmètre d'appréciation des difficultés économiques en cas de licenciement économique. Désormais, seules les activités réalisées en France seront prises en compte. Cela va à l'encontre d'une jurisprudence constante selon laquelle dans les groupes de sociétés, les difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Une véritable politique en faveur des TPE et PME consisterait à les aider à remplir leur carnet de commandes, par exemple en relançant la demande intérieure, alors que vous, à l'inverse, facilitez la tâche aux multinationales en leur permettant de supprimer des emplois pour des raisons boursières.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Sur l'amendement no 201 , je suis saisi par le groupe Nouvelle Gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Régis Juanico, pour soutenir l'amendement.

L'importance particulière de cet amendement – qui porte sur la question du périmètre national d'appréciation des difficultés économiques – justifie la demande de scrutin public. Dans le contexte de mondialisation qui caractérise le moment présent, la fixation d'un périmètre strictement national représente un contresens. Madame la ministre, votre disposition produit d'ores et déjà des effets néfastes dans notre pays, et cela ne fait que commencer ; dans les prochains mois, les exemples devraient se multiplier sur le territoire national.
J'en veux pour preuve ce qui se passe en ce moment même dans l'usine Tupperware qui produit les fameux saladiers en plastique de Joué-lès-Tours. La direction a décidé de fermer l'usine avec pour motif la conjoncture économique. Pourtant, en 2015, deux machines à plasma de cette entreprise ont été démontées et envoyées au Portugal. En 2016, ce sont vingt-huit machines qui ont été démontées ; les plus vétustes ont été envoyées à la casse, et celles en capacité de produire, en Afrique du Sud. En juin 2016, on a procédé à une réorganisation entraînant 200 suppressions de postes. Début 2017, on a assisté à un départ massif de salariés en rupture conventionnelle et à une série de démissions encouragées par la direction et accompagnées financièrement. Le 19 octobre 2017 – c'est l'actualité – , tombe l'annonce brutale de la fermeture du site. Tupperware utilise le biais de vos ordonnances qui lui permettent de ne pas être empêché de licencier alors que les résultats du groupe sont excellents ; les usines de Belgique, de Grèce et d'Afrique du Sud tournent à plein régime et permettent au géant du plastique d'être en pleine forme.
Alors pourquoi avoir licencié en France ? Parce que les résultats seraient mauvais ? En 2015, l'entreprise a augmenté sa marge brute de plus de 2,25 % ; non, la raison est ailleurs. Mes chers collègues, Tupperware a choisi la France parce que chez notre voisin belge où se trouvent d'autres usines, les conditions imposées par la législation en matière de suppression collective d'emplois pour motif économique sont beaucoup plus contraignantes. L'entreprise choisit donc la facilité offerte par vos ordonnances pour supprimer des emplois ; voilà la triste traduction de vos dispositions, mes chers collègues ! Ne demandiez-vous pas du concret et du pragmatisme ?

Les 235 ouvriers de Joué-lès-Tours peuvent remercier la majorité d'avoir permis à leur direction de les licencier en toute quiétude.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe FI.

Le douzième alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa nouvelle version, définit comme périmètre d'appréciation des éventuelles difficultés économiques le seul territoire national. Notre commission a certes cherché à éviter que ce périmètre restreint soit utilisé pour créer des difficultés artificielles ; mais cela ne va pas assez loin. Ne soyons pas dupes : les grandes entreprises, aidées par des myriades d'avocats internationaux, auront vite fait de donner à des difficultés artificiellement créées un aspect bien réel. Surtout, cela pose un problème de fond et de cohérence. Les groupes multinationaux sont les premiers bénéficiaires de la mondialisation dérégulée que l'on connaît actuellement. C'est justement cette dérégulation qui leur permet de faire d'immenses profits qui, au passage, servent bien plus à enrichir leurs actionnaires qu'à créer de la richesse dans notre pays. Mais le bon sens et un certain sens de la justice commandent qu'une solidarité s'exerce entre les différentes entités de ces groupes.
En clair, il ne faut pas que les groupes internationaux puissent profiter de la mondialisation lorsque tout va bien, et se désolidariser de leurs entreprises lorsque des difficultés surviennent dans telle ou telle zone, en l'occurrence notre pays ! Cet amendement vise donc à supprimer la restriction du périmètre au seul territoire national, pour l'appréciation des difficultés économiques.

La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement no 343 .

Le Gouvernement opère une réduction drastique du périmètre d'appréciation des difficultés économiques des entreprises multinationales en matière de licenciement économique : elles ne seront plus appréciées dans leur globalité mais à l'aune de leur seule situation nationale. Cela nous apparaît profondément anachronique. C'est un parfait contresens historique, alors que l'emprise des grands groupes sur notre société n'a jamais été aussi forte.
Encore une fois, le droit, la loi, nos normes, ne sont pas mis au service des besoins élémentaires de la puissance publique ; au contraire, elles sont mises en conformité avec les attentes des grands groupes qui n'auront plus à s'embarrasser d'un droit jugé trop encombrant. Vous embrassez la logique du moins-disant social qui revient en quelque sorte à dire : puisque les autres font ainsi, faisons de même !
Ce repli au niveau national pose question pour qui prétend se battre en faveur d'une véritable harmonisation sociale européenne. Précisons-le sans esprit polémique : cette mesure ne s'appliquera pas aux TPE ; c'est bien une disposition destinée aux grandes multinationales qui pourront ainsi procéder à l'optimisation sociale en sus de l'optimisation fiscale. Mme la ministre ne s'en est pas cachée en commission, où elle a déclaré que « la règle précédente était pénalisante pour les investissements internationaux ». Ce projet de loi de ratification rendra donc plus facile, pour un grand groupe en bonne santé, de licencier en organisant artificiellement des difficultés au niveau national.
À défaut d'obtenir le retrait de l'article 15, nous proposons par cet amendement de retenir l'échelon européen pour juger de la santé économique de l'entreprise. Il s'agit d'une mesure de justice, qui permettra de garantir l'emploi sur nos territoires en nous protégeant des pratiques d'optimisation sociale que peuvent conduire les grandes entreprises multinationales.
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et FI.

Quel est l'avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ?

Ce matin, c'était M. Jumel qui tentait d'influencer les avis que je donne en tant que rapporteur ; cet après-midi, c'est M. Lecoq ! C'est comme si j'avais un assistant, qui m'indiquait quel avis donner : je vous remercie, cher collègue, de votre diligence !

Je n'essaie pas de vous influencer, mais de vous convaincre, et pour cela, il faut bien que je parte de vos arguments, et des promesses du Président de la République !

Je vais à présent répondre aux orateurs ayant présenté ces amendements en discussion commune. Tous visent à revenir sur la limitation du périmètre d'appréciation des difficultés économiques au seul territoire national. Comme vous l'avez dit, la jurisprudence tient aujourd'hui compte du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour apprécier ces difficultés économiques. Et comme je l'ai dit en commission, ce périmètre d'appréciation très extensif est sans équivalent chez nos voisins européens – il est même difficile de trouver, au niveau mondial, une jurisprudence similaire.
Il n'est pas forcément pertinent, du reste, d'évaluer la santé économique d'une entreprise à l'aune de celle d'une autre filiale du même groupe, qui aurait le même type d'activités, mais qui serait – par exemple – située en Inde ou au Pakistan. De nombreux facteurs peuvent expliquer qu'une entreprise soit florissante dans un pays et qu'une autre entreprise, exerçant le même type d'activités, ne le soit pas en France, sans que cela signifie que les difficultés économiques de l'entreprise ne soient pas réelles.
Enfin, vous semblez vous inquiéter du fait que les entreprises puissent en quelque sorte se placer elles-mêmes, artificiellement, dans une situation de difficultés économiques. Mais c'est le rôle du juge d'apprécier la réalité de ces difficultés économiques !

Il aura un pouvoir diminué, conformément à l'ordonnance, et conformément à ce projet de loi !

Enfin, monsieur le député, vous avez exprimé une inquiétude quant au fait que ces ordonnances visent à répondre aux attentes de certains. Je vous le dis clairement : ces ordonnances et ce projet de loi de ratification ne visent pas à répondre aux attentes du patronat…
Exclamations sur les bancs des groupes GDR et FI.
Ça alors ! Et aux attentes de qui répondent-ils, alors ? Certainement pas du peuple !

… mais aux attentes des 3,5 millions de nos concitoyens qui aimeraient pouvoir vivre de leur travail !
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe REM. - Exclamations sur les bancs des groupes GDR et FI.
Même avis : défavorable à l'ensemble de ces amendements en discussion commune.

Puisque vous m'y invitez, monsieur le rapporteur, je vais vous répondre !
Ce que nous voulons, par ces amendements, c'est garder des emplois en France. Si ce n'est pas cela, le meilleur moyen de donner du travail aux 3,5 millions de chômeurs, alors je n'y comprends plus rien !

Notre idée, c'est d'abord de conserver les emplois localisés en France, puis d'en faire venir d'autres. Vous créez les conditions pour que les multinationales puissent retirer leurs emplois : ce n'est pas pour cela qu'elles investiront plus sur notre territoire. Vous l'avez dit vous-même : elles peuvent très bien décider d'investir dans d'autres pays, plus rentables. Nous savons bien comment elles fonctionnent !
Notre démarche, vis-à-vis de nos emplois, est protectionniste : qui s'en plaindra ? Qui refuserait l'idée de protéger nos emplois ? Personne !
Par l'amendement no 343 , défendu par Jean-Paul Dufrègne, nous proposons que les difficultés économiques du groupe soient appréciées à l'échelle européenne. Je le précise, à l'intention de nos collègues : ces amendements en discussion commune ne sont pas identiques, aussi les positions de vote ne seront pas forcément les mêmes pour chacun d'eux.
Nous espérons donc que vous serez sensibles à cette proposition et que vous adopterez l'amendement no 343 .

Concernant la situation de nos entreprises, nous regrettons tous qu'il y ait des fermetures de sites liés à des grands groupes. Dans l'état actuel de notre législation, nous ne pouvons pas empêcher la fermeture de sites, en France, appartenant à des groupes qui se portent plutôt bien à l'échelle mondiale.
Mais peut-être y a-t-il d'autres raisons à ces fermetures ; peut-être sont-elles dues à ce que notre législation du travail est trop contraignante ! Par ailleurs, dans le même temps, des entreprises étrangères cherchent à s'implanter en Europe mais écartent la France en raison de la rigidité de ses règles en matière de licenciement et de fermeture de sites. Je ne connais pas, pour ma part, de chef d'entreprise qui décide de s'implanter en France en se disant : « Dès demain je fermerai le site que je viens d'ouvrir. » En revanche, j'en connais qui raisonnent ainsi : « Si jamais je dois fermer le site que j'envisage d'implanter en France, alors j'aurai les pires ennuis : il n'est donc pas question de s'installer dans ce pays. »
J'ai par ailleurs déposé un amendement, qui a été adopté par la commission des affaires sociales, afin que le juge puisse sanctionner les cas de fraude, c'est-à-dire les cas de « création artificielle, notamment en termes de présentation comptable, de difficultés économiques à l'intérieur d'un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d'emplois. » Dans ces cas, on concentre artificiellement les difficultés sur un site afin de justifier le basculement vers un autre site : nous connaissons ce genre de pratiques. Désormais le juge pourra s'en saisir, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Cet amendement que nous avons adopté en commission est plus protecteur que vous ne le pensez. C'est pourquoi nous rejetterons ces amendements en discussion commune.
Rappel au règlement

Monsieur le président, je vous demande la parole sur le fondement de l'article 58, alinéa 1, de notre règlement, concernant l'organisation de notre séance. Il s'agit plus précisément de l'ordre dans lequel sont classés ces amendements en discussion commune. Vous avez tous compris, grâce à mes explications, que l'amendement no 343 est un amendement de repli, qui aurait du être discuté après les autres amendements en discussion commune. Nous proposons que les difficultés économiques soient examinées au niveau européen : c'est une solution de repli par rapport à l'amendement no 68 , qui visait à ce que ces difficultés soient appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe, et non au niveau national.
Article 6


Nous entendons beaucoup de choses dans cet hémicycle. Mais prétendre que ce que vous faites, par ce projet de loi de ratification, vous le faites pour les chômeurs… Vous franchissez un seuil ! C'est impensable, de telles inepties !
Je trouve cela scandaleux. Imaginez les gens qui vous écoutent ! Certes vous avez des arguments, mais celui-là n'est pas acceptable.

Allez voir les chômeurs et demandez-leur s'ils sont d'accord avec ce que vous êtes en train de faire !
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe REM.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 58 |
| Nombre de suffrages exprimés | 58 |
| Majorité absolue | 30 |
| Pour l'adoption | 12 |
| contre | 46 |
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 58 |
| Nombre de suffrages exprimés | 58 |
| Majorité absolue | 30 |
| Pour l'adoption | 12 |
| contre | 46 |
L'amendement no 201 n'est pas adopté.
L'amendement no 102 n'est pas adopté.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 57 |
| Nombre de suffrages exprimés | 56 |
| Majorité absolue | 29 |
| Pour l'adoption | 11 |
| contre | 45 |
L'amendement no 343 n'est pas adopté.


Instaurée en 2008, la rupture conventionnelle individuelle est bien trop souvent une façon détournée de licencier sans contrôle et sans devoir verser d'indemnité légale. En 2015, 360 000 ruptures conventionnelles de CDI ont été signées : autant de licenciements potentiellement détournés. Une étude récente de la DARES – Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques – montre que seuls 7 % des salariés reçoivent une assistance pour la rédaction de cette rupture. Ce faible taux d'encadrement a des effets directs sur les indemnités perçues : la même étude montre que l'indemnisation moyenne n'est que de 6 000 euros, alors que souvent, elle pourrait être deux fois plus élevée.
Pour preuve définitive, cette étude avance que 40 % des cas de non-homologation sont précisément motivés par des indemnités insuffisantes. La faiblesse des indemnités proposées s'explique d'abord par un rapport de force largement défavorable au salarié face à son employeur. Pourtant, non content de maintenir ce dispositif, vous voulez l'étendre en créant une rupture conventionnelle collective. Que serait-elle, sinon un moyen supplémentaire de faciliter les licenciements, cette fois-ci de façon collective ?
Vous voulez ni plus ni moins remplacer les plans de sauvegarde de l'emploi – qui, eux, donnent des garanties aux salariés licenciés – par des plans de licenciement masqués, sans indemnité légale. Cet amendement vise donc à supprimer la possibilité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et à sécuriser les salariés.
En fait, les mesures que nous proposons par amendement correspondent mieux aux titres de ces ordonnances que leur contenu propre !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Monsieur Quattenens, vous engagez le débat sur un dispositif important et particulièrement innovant de l'ordonnance no 2017-1387 : la rupture conventionnelle collective – sachant qu'il est par ailleurs question, au même chapitre de la même ordonnance, du congé de mobilité.
Pour des raisons techniques, votre amendement a été séparé d'un ensemble d'autres amendements relatifs à cette question, qui viendront en discussion plus tard. Si vous le permettez, je développerai donc mes arguments tout à l'heure. Avis défavorable.
Mais je peux aussi, avec grand plaisir, vous présenter dès maintenant ces arguments.
Exclamations sur les bancs des groupes FI et GDR.
Sourires.

Cet amendement propose de revenir sur l'un des nouveaux dispositifs les plus importants et les plus prometteurs parmi ceux mis en oeuvre dans le cadre des ordonnances : je veux parler des accords de rupture conventionnelle collective. Contrairement à ce que vous avancez, cher collègue, la loi d'habilitation avait bien prévu ce point, répondant au souci de sécuriser les plans de départ volontaire. Je me rappelle que cela avait fait l'objet de nombreux débats. Ces PDV n'avaient jusque-là aucune existence juridique.
Vous prétendez que ce dispositif exclut le droit du licenciement économique, mais c'est précisément l'objectif ! Il s'agit de favoriser la phase en amont du PSE, ce qui par définition exclut l'application de celui-ci et les dispositions du licenciement économique qui reposent sur la négociation avec les collaborateurs pour préparer leur départ. L'objectif est aussi que les accords de rupture conventionnelle collective soient bien sécurisés, à la fois pour les employeurs et pour les salariés, et que ces derniers disposent de mesures d'accompagnement dignes de ce nom. Vous savez que j'ai présenté en commission plusieurs amendements pour qu'ils puissent notamment bénéficier du congé de mobilité.
Par ailleurs, votre exposé sommaire me semble constituer davantage une critique de la rupture conventionnelle individuelle que collective. Je peux vous entendre sur ce point, mais ce n'est pas l'objet du débat. La rupture conventionnelle, qui date de 2008, est une idée que je trouve très productive ; elle a permis de remettre en cause une vision conflictuelle et unilatérale des relations de travail que pour ma part je conteste.
Exclamations sur les bancs des groupes FI et GDR.

Je voulais juste rectifier une affirmation de mon collègue Adrien Quatennens, à savoir que les indemnités auxquelles peut prétendre le salarié bénéficiant d'une rupture conventionnelle sont au moins égales à l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit. C'est la règle. Vous avez évoqué le taux de 40 % de ruptures non homologuées : cela montre bien qu'il y a un contrôle de l'administration. Celle-ci vérifie si les indemnités correspondent au montant légal, ou au montant conventionnel si celui-ci est plus important. J'ajoute qu'en pratique, beaucoup d'employeurs versent des indemnités bien supérieures à ce seuil minimal.
Applaudissements sur les bancs du groupe REM.

J'ai déjà évoqué hier le problème du contrôle par l'inspection du travail. Il est en réalité purement théorique et, en général, n'a pas vraiment lieu.
Exclamations sur de nombreux bancs du groupe REM.
Mêmes mouvements.

Quand vous pressurez les DIRECCTE, les directions régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lesquelles sont maintenant à l'os et vont être contraintes de diminuer les postes d'inspecteur du travail malgré leur tâche supplémentaire – décortiquer le code du travail entreprise par entreprise – , je vois mal comment tout cela ne finirait pas en cadeaux aux entreprises pour « faciliter le dialogue social », selon votre expression, madame la ministre.
C'est une insulte à l'administration du travail !

Mais notre ennemi, c'est le chômage. Et expliquez en quoi, cher collègue, une telle disposition facilite l'emploi. Démontrez-le !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI. – Exclamations sur les bancs du groupe REM.

Il faudrait rappeler à mes collègues ce qu'est la procédure de la rupture conventionnelle : premièrement, elle est à la demande du salarié ; deuxièmement, dès lors qu'il y a accord entre le salarié et l'employeur, elle doit être contrôlée dans un délai de quinze jours par l'administration qui vérifie sa conformité au droit du travail et s'assure donc que le salarié n'est pas lésé. La rupture conventionnelle est un procédé extrêmement bénéfique pour un grand nombre de salariés. C'est pourquoi son extension est une très bonne mesure.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 61 |
| Nombre de suffrages exprimés | 59 |
| Majorité absolue | 30 |
| Pour l'adoption | 11 |
| contre | 48 |
L'amendement no 355 n'est pas adopté.

C'est un amendement de repli par rapport à notre demande de suppression de la réduction du périmètre d'appréciation des difficultés économiques. Il vise à réserver la possibilité d'apprécier les difficultés économiques au niveau national aux seules entreprises ayant fait la preuve d'un dialogue économique et social de qualité, notamment par l'actualisation de leur base de données économiques et sociales – BDES – , négociée depuis au moins deux ans, et par un respect avéré des obligations d'informations-consultations. Cette demande est soutenue par plusieurs organisations syndicales. Je suis certain, monsieur le rapporteur, madame la ministre, que vous aurez à coeur de les entendre.

Avis défavorable car vous proposez, cher collègue, que soit tenu compte du périmètre national au seul cas des entreprises ayant actualisé leur BDES et procédé à la négociation annuelle sur leurs orientations stratégiques. Je crois comprendre l'intention de cet amendement, mais il ne me semble guère opérationnel. En effet, que signifie l'actualisation de la BDES si on ne sait dans quel délai ni sur quoi elle doit porter ? Je rappelle qu'il est déjà prévu que le contenu et l'architecture de la BDES puissent être définis par voie d'accord, de même que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques dans la limite maximale de trois ans – les IRP n'auront donc plus systématiquement à être consultées annuellement. En outre, quand bien même les critères retenus par l'amendement seraient pertinents, il est juridiquement problématique de retenir des périmètres différents pour des entreprises qui ne sont pas forcément placées dans des situations différentes.
L'amendement no 202 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 16 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail introduit une mesure de plus pour alléger les obligations des employeurs en matière de licenciement économique. Rappelons le contexte : pas moins de cinq lois en cinq ans sont intervenues pour détricoter le droit du licenciement économique, bien souvent pour répondre au lobbying des organisations patronales. Or ce droit avait toujours reposé sur deux solides piliers : d'une part, un contrôle de la justification économique de la rupture par les juges ; d'autre part, une obligation de recherche de reclassement, l'employeur devant préalablement au licenciement s'efforcer de trouver une solution alternative. Mais vous proposez, madame la ministre, monsieur le rapporteur, d'aller encore plus loin dans le détricotage en assouplissant l'obligation en matière de reclassement des salariés. Ainsi, la diffusion d'une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés suffira à y satisfaire. Vous comprenez que les députés communistes n'approuvent pas ce nouveau recul.
Pour essayer de convaincre mes collègues de La République en marche,
Exclamations sur divers bancs

je leur précise que c'est justement pour ces raisons qu'il leur est proposé d'abroger cette nouvelle disposition qui affaiblit le droit des salariés victimes d'un licenciement économique, et de revenir à la rédaction antérieure, c'est-à-dire… à la loi Macron de 2015. On va voir si cela vous parle, mes chers collègues.
Sourires.

La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon, pour soutenir l'amendement no 360 .

Cet amendement vise à revenir sur les dispositions dangereuses introduites par l'ordonnance no 2017-1387. En effet, celle-ci réduit le périmètre de reclassement obligatoire du salarié au sein de l'entreprise ou du groupe puisque celui-ci est dorénavant défini uniquement au sens capitalistique. Pourtant, la jurisprudence de la Cour de cassation protégeait les salariés et les sécurisait dans leur relation de travail puisque la définition du groupe pouvait inclure les entreprises partenaires en cas de permutation possible. Ainsi, les possibilités de reclassement étaient beaucoup plus nombreuses. Contrairement à ce que son titre laisse entendre, cette ordonnance ne sécurise pas l'emploi puisqu'elle diminue très nettement l'obligation des employeurs envers leurs salariés en termes de propositions de reclassement. Cette limitation du périmètre de reclassement est une atteinte aux possibilités de retour à l'emploi pour ces salariés. Vous comprendrez aisément, madame la ministre, mes chers collègues, que notre groupe s'y oppose et demande l'extension du périmètre de reclassement.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Il vise à réintroduire l'article L. 1233-4-1 du code du travail, abrogé par les ordonnances, dans le texte suivant : « Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. » Le salarié resterait libre de refuser ces offres. Cet amendement paraît essentiel au groupe Nouvelle Gauche afin d'éviter les situations incroyables que nous avons pu constater il y a quelques années – par exemple, le groupe ArcelorMittal avait proposé à des salariés en reclassement des postes au Luxembourg, mais aussi au Kazakhstan, avec un salaire de 300 euros par mois ! C'est pour éviter le risque que de telles choses se renouvellent que nous proposons donc de réintroduire cet article.

J'en viens d'abord à celui défendu à l'instant. En vous écoutant, monsieur Juanico, j'ai cru qu'on se rejoignait, mais vous proposez de rétablir la procédure de reclassement à l'étranger à la demande du salarié tout en soulignant vous-même, exemple à l'appui, qu'elle était tout de même pour le moins originale, pour ne pas dire baroque. L'ordonnance no 2017-1387 a procédé à la suppression de la procédure de reclassement interne à l'étranger car, quand bien même celle-ci était cantonnée, vous l'avez rappelé, au cas où le salarié la demandait, elle représentait une charge très importante pour l'employeur en matière d'information individuelle pour des propositions d'offres souvent en réalité éloignées des attentes de reclassement des salariés, certains d'entre eux ayant pu se voir proposer de partir à l'étranger sur un poste assez distant, voire très éloigné, de leurs propres compétences, et parfois à un niveau de rémunération moindre. Je précise que cela n'empêchera pas un employeur, s'il le souhaite, de faire des propositions de reclassement à l'étranger à un salarié qui en ferait la demande.
Pour ce qui est des amendements nos 67 et 360 , ils illustrent notre désaccord de fond sur le reclassement interne. Autant je suis d'accord pour dire que l'obligation de recherche de reclassement interne de la part de l'employeur doit être réelle – dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par exemple – , nous nous rejoignons là-dessus, autant le dispositif antérieur présentait tellement de complexité et d'exigence pour l'employeur que celui-ci n'avait guère de chance au contentieux d'être considéré comme ayant satisfait à son obligation de recherche et de proposition de reclassement. L'objectif est-il de faire du contentieux ou de trouver une vraie solution pour le collaborateur ? Une solution à l'étranger, loin de ses bases, dans des contenus de métier qui n'ont pas beaucoup de sens pour lui, est-elle satisfaisante ? On veut tous un dispositif permettant de trouver une solution dans la vraie vie pour les vrais gens, c'est-à-dire une solution pour ceux qui demandent : « Trouvez-moi un job qui soit en cohérence avec mes compétences dans un endroit où je peux aller vivre. » Cela ne peut fonctionner qu'ainsi. Avis défavorable aux trois amendements.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes REM et MODEM.

On peut voir également cette disposition comme une avancée. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le rapporteur s'agissant de la limitation de l'obligation de reclassement au seul territoire national. Dans de nombreux cas, en effet, l'employeur doit faire au salarié des offres de reclassement écrites et précises, sur l'ensemble du territoire et à l'étranger.
Je l'ai vu avec ma soeur, qui a fait l'objet d'une procédure de licenciement dans l'hôtel où elle travaillait. Son employeur lui proposait une offre de reclassement à l'étranger, avec un salaire mensuel de 400 euros – pour moi, une offre de reclassement dérisoire. Ma soeur l'a refusée et s'est retrouvée licenciée.

J'ai en tête une des dernières émissions du magazine télévisé Cash investigation, dans laquelle on voyait l'entreprise Free avoir quelques difficultés pour reclasser ses salariés.
Vous vous souvenez sans doute de ce cas : l'entreprise fermait une plateforme sur laquelle des syndicalistes avaient mené une action syndicale sous la forme d'une grève un peu symbolique, d'une durée de deux ou trois heures. L'entreprise a procédé au démantèlement de ladite plateforme en licenciant des salariés ou en leur proposant, sous divers habillages, des reclassements.
Il se passait alors la chose suivante : le salarié postulait à un poste en interne, parfois à l'autre bout de la France, et, au moment de finaliser l'offre de reclassement, Free lui disait que le poste avait été pourvu entre-temps et attribué à quelqu'un d'autre – c'est tout, au revoir et désolé. Free estimait avoir rempli ses obligations d'employeur en proposant un poste, sauf qu'il avait été pris par quelqu'un d'autre entre-temps.
Cette pratique, au regard de la loi actuelle, semble illégale – mais je ne veux pas m'avancer plus que cela.

En tout cas, je ne vois pas, madame la ministre, en quoi votre ordonnance règle ce genre de problème concret – car l'objectif de ce genre de loi portant sur le travail est bien de régler des problèmes concrets, et non de faciliter les dérives. J'attends donc que vous nous démontriez en quoi votre ordonnance va régler le problème des salariés de Free, qui se sont fait avoir par cette entreprise qui a bénéficié, s'agissant du reclassement, d'un vide juridique.

Si le cadre juridique actuel n'est pas suffisamment protecteur, il le sera encore moins avec votre proposition.

Monsieur le président, un détail : cela ne vous dérange pas qu'on vote ? Sinon on rentre chez nous !

Cet amendement traite des moyens de communication des offres en cas de reclassement. Le texte précise que cette communication peut se faire au moyen d'une liste « des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret ». Or cela présente un risque, pour le salarié, de ne pas bénéficier de l'information nécessaire pour pouvoir se positionner sur ces offres en temps utile.
Par ailleurs, la ministre peut-elle répondre à la demande que nous lui avions faite en commission de préciser le contenu du décret prévu à l'article ?

Cher collègue Boris Vallaud, nous nous étions déjà expliqués sur cet amendement en commission. Nous avions notamment, puisque j'avais donné les éléments figurant dans ledit décret, fait ensemble un peu de lecture. J'espère que ces éléments ont pu vous satisfaire. Quoi qu'il en soit, l'avis de la commission est inchangé : défavorable.
Précision importante, je vous confirme ce que j'avais indiqué en commission, que le nouveau dispositif offrira, en matière de reclassement, un vrai plus.
Jusqu'à présent, on ne demandait à l'employeur qu'une photographie, à un instant t, des postes disponibles en France et à l'étranger. J'ai bien noté le caractère assez illusoire de la proposition de reclassement citée par Mme Sylla : 400 euros par mois à l'autre bout de l'Europe ou du monde, en Roumanie ou en Indonésie.
Le vrai plus, c'est que, dorénavant, en période de reclassement, les salariés auront accès à toutes les offres d'emploi proposées en interne, de façon continue pendant toute la durée du plan, par voie intranet ou par d'autres moyens. En effet, au sein des entreprises, des postes se libèrent en permanence. Les personnes en cours de reclassement pourront donc, pendant toute la durée du plan, accéder au fur et à mesure à toutes les offres disponibles. Le choix de postes auquel elles auront accès sera donc plus large qu'auparavant.
L'amendement no 204 n'est pas adopté.

Précédemment, le comité d'entreprise n'était pas contraint par un délai lorsqu'il devait rendre un avis en cas de licenciement économique. Désormais, ce délai est d'un mois, ce qui peut s'avérer contraignant, notamment s'il souhaite faire appel à un expert.
Il est important qu'au sein de la nouvelle instance fusionnée, la consultation porte également sur les conséquences relatives à la santé et aux conditions de travail des salariés. Mais, alors que précédemment il était possible de recourir à plusieurs expertises, celle du comité d'entreprise et celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, désormais il n'y en aura plus qu'une seule qui regroupera l'ensemble des thèmes. L'un des risques de cette évolution que nous avons identifié est de conduire à des expertises plus coûteuses, et par conséquent à d'éventuels conflits avec l'employeur.
Qui plus est, si l'expert n'est pas un expert-comptable, l'accès à certains documents comptables sera moins large. C'est pourquoi cet amendement précise que l'expert auquel le comité d'entreprise peut recourir a la qualité d'expert-comptable.

Cher collègue Juanico, cet amendement a été rejeté en commission, mais je reviens quand même sur ce que nous en avions dit. Il ne me semble pas nécessaire d'y être favorable pour une raison simple : l'article L. 1233-35 du code du travail précise déjà que l'expert en question demande à l'employeur « toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. » C'est donc une vision large qui permet d'avoir un bon niveau d'exigence en ce qui concerne l'expert.
L'amendement no 206 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Les entreprises de plus de 1 000 salariés peuvent procéder à des licenciements avant le transfert d'une entité économique autonome, en cas d'offre de reprise présentée au comité d'entreprise. Il s'agit d'une exception à l'obligation de transférer les contrats de travail qui visait à faciliter les reprises.
L'article 6 élargit cette faculté de licencier préalablement au transfert à toutes les entreprises soumises à l'obligation de négocier un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE – c'est-à-dire dès qu'elles comptent cinquante salariés – et non plus uniquement à celles de plus de 1 000 salariés.
Le seuil de cinquante salariés nous semble, en l'espèce, trop bas. Contrairement aux très grandes entreprises, on peut craindre que le financement des mesures d'accompagnement des salariés soit, dans les PME en difficulté, limité. En outre, ce seuil ne risque-t-il pas de créer un appel d'air pour certaines entreprises souhaitant se revendre au meilleur prix ?
De surcroît, cette possibilité de licencier avant le transfert prévu est limitée au regard du droit européen, qui considère, notamment, que le transfert ne peut être un motif de licenciement. C'est pourquoi nous proposons de revenir au seuil antérieur de 1 000 salariés.

Cet amendement a été rejeté par la commission. Mon avis reste donc, le concernant, défavorable. Cher collègue Boris Vallaud, l'article 19 de la troisième ordonnance étend le champ d'un dispositif dérogatoire au principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entités économiques. L'enjeu est évidemment de favoriser la reprise d'entreprises confrontées à d'importantes difficultés économiques et qui engagent un PSE prévoyant notamment le transfert d'une ou plusieurs entités.
Cet article a procédé à deux modifications majeures, que vous avez relevées : d'une part, il a élargi la possibilité de déroger au principe du transfert des contrats de travail à l'ensemble des entreprises, alors que cette dérogation n'était jusqu'alors autorisée que pour les entreprises de plus de 1 000 salariés ; d'autre part, il a supprimé l'obligation de consultation des instances représentatives du personnel sur l'offre de reprise.
Sur ce sujet, je suis très à l'aise, dans la mesure où il s'agit de favoriser, autant que faire se peut, ce type de reprises. Pour ma part, je suis persuadé qu'il est toujours préférable, dans ce genre de situation, de ne pas obérer des projets de reprise plutôt que de laisser une entreprise vouée à l'échec à cause précisément de cette obligation de transfert des contrats de travail, qui peut dissuader d'éventuels repreneurs.
L'amendement no 205 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement no 66 .

Nous abordons ici un sujet qui démontre encore votre volonté de faire des salariés des variables d'ajustement des logiques du marché. De quoi s'agit-il ?
Concrètement, vous permettez à une entreprise de procéder au licenciement économique de ses salariés avant la reprise de son site par une autre entreprise, instaurant ainsi un processus de sélection de ces mêmes salariés. Alors que cette faculté n'était, depuis la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi El Khomri, reconnue qu'aux entreprises de plus de 1 000 salariés, il est prévu de l'étendre à toutes les entreprises de plus de cinquante salariés.
Il est donc prévu de déroger à la règle, que nous impose le droit européen, du transfert automatique des contrats de travail en cas de reprise d'une entité économique. Ces dispositions, qui vont à l'encontre de l'esprit des textes communautaires, visent donc à exclure les salariés du bénéfice de règles protectrices en cas de reprise de leur entreprise par une autre entité.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces dispositions et de rétablir le droit antérieur à la promulgation de la loi El Khomri de 2016.

Il s'agit du même sujet que celui que nous venons d'examiner, même s'il est abordé un peu différemment. Vous proposez, cher collègue, de supprimer le dispositif dérogatoire à la reprise d'entités économiques autonomes que nous avons évoqué. Je ne vais pas reprendre le même argumentaire : l'avis de la commission est défavorable.
L'amendement no 66 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements, nos 179 rectifié et 211 , qui peuvent faire l'objet d'une présentation groupée.
La parole est à M. Régis Juanico, pour les soutenir.

L'amendement no 179 rectifié traite du barème obligatoire aux prud'hommes dont nous avons beaucoup débattu depuis ce matin. Pour nous, ce référentiel impératif s'apparente à un droit de licenciement abusif, le barème ayant pour effet de faire converger la jurisprudence.
Avec l'amendement no 211 , nous proposons d'aller plus loin que ne le prévoit le texte, en abaissant à six mois la durée d'ancienneté minimale des salariés en contrat à durée indéterminée leur permettant de bénéficier d'une indemnité de licenciement.

Cet amendement a été rejeté par la commission ; avis défavorable, donc. Quelques instants me paraissent nécessaires pour revenir, comme vous semblez le souhaiter, sur ce sujet du barème prud'homal qui a déjà été abordé.
Les indemnités de dommages et intérêts accordées par le juge prud'homal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse constituent aujourd'hui un vrai sujet. Sur le fond, vous êtes d'accord avec nous sur le constat qu'il existe, d'un conseil de prud'hommes à l'autre, des pratiques très différentes en la matière. Pour une même ancienneté, le montant des dommages et intérêts peut varier du simple au triple, et du simple au quadruple pour ce qui concerne les montants alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des manquements de même nature.
Il existe donc une diversité très importante en la matière. J'ai tout à l'heure évoqué un chiffre très significatif, qui a été repris par Sylvain Maillard, je crois : on ne voit évidemment pas les choses de la même façon selon que l'on est le salarié qui a obtenu un ou celui qui a obtenu quatre. J'ai compris, mes chers collègues, que vous vous rangiez plutôt du côté de celui qui a obtenu quatre. Pour ma part, je me range du côté de celui qui a obtenu un, et je me dis que si nous pouvions atteindre un certain équilibre, ce serait déjà pas mal. C'est précisément ce que visent ces ordonnances.
Pour les entreprises, en particulier pour les très petites d'entre elles, cette situation est également source d'insécurité. Ce point avait sans doute été plus débattu lors de l'examen du projet de loi d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social. Il faut le rappeler, pour les petites entreprises, qui pouvaient parfois être lourdement condamnées, les jugements étaient susceptibles de mettre en danger leur trésorerie et, tout simplement, l'ensemble de leurs emplois.
Il faut, sur cette question, se redire les choses. Dans un système économique où la confiance génère l'envie d'investir, donc l'envie d'embaucher et d'aller chercher de nouveaux contrats pour remplir son carnet de commandes, il est important que l'entrepreneur ait confiance puisqu'il investit son temps et son argent aux côtés de ses collaborateurs…

… et de ses salariés. La définition d'un référentiel obligatoire proposé par l'ordonnance va permettre au juge prud'homal d'homogénéiser les pratiques et d'assurer une meilleure équité entre les salariés, tout en améliorant la prévisibilité que j'évoquais juste avant.
Si je reprends vos arguments, il ne s'agit en aucun cas de donner à l'employeur un droit de licencier sans motif. Le juge prud'homal continuera à apprécier, dans le cas d'un licenciement, l'existence d'une cause réelle et sérieuse et à fixer le montant des dommages et intérêt dus par l'employeur si celui-ci a procédé à un licenciement abusif. Simplement, il disposera désormais d'une grille claire et connue de tous, comportant des planchers et des plafonds qui lui permettront de moduler le montant de ces indemnités.
Nous pourrions, tous ensemble, émettre l'hypothèse suivante : cela permettra, comme cela avait été évoqué hier dans cet hémicycle, de trouver des solutions avant d'en arriver à la judiciarisation.

Ces solutions seront sans doute plus contractuelles et permettront à chacun de redémarrer rapidement. Le salarié, qui n'aura plus besoin de se faire assister d'un avocat, donc d'investir dans ses honoraires une partie des indemnités de dommages et intérêts qu'il espère obtenir, pourra s'appuyer sur le barème et sera sans doute, de ce fait, plus à l'aise.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable aux deux amendements, nos 179 rectifié et 211 .
Les amendements nos 179 rectifié et 211 , repoussés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

Je suis saisi de trois amendements, nos 74 rectifié , 322 rectifié et 257 rectifié , pouvant être soumis à une discussion commune.
La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement no 74 rectifié .

L'article 2 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail instaure la fameuse mesure de plafonnement des indemnités prud'homales. Cette mesure est la porte ouverte à la reconnaissance du droit pour les employeurs à pratiquer des licenciements abusifs.
Si l'on suit votre raisonnement, cette mesure d'assouplissement vise à faciliter les embauches. Or aucune étude n'a jamais démontré le lien entre l'assouplissement du droit du licenciement et la création d'emplois. L'Institut national de la statistique et des études économiques interroge régulièrement les chefs d'entreprise sur leurs difficultés. Quels sont, selon ces chefs d'entreprise, les principaux obstacles à l'embauche ? L'incertitude relative à la situation économique, d'une part ; la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre compétente, d'autre part. Les difficultés en matière de réglementation, qui ne visent d'ailleurs pas toutes le code du travail, n'apparaissent qu'en quatrième position.
Votre approche est donc idéologique, et dangereuse aussi, car pendant que vous oeuvrez au démantèlement du droit du travail, vous ne traitez pas les priorités : stimuler la demande, relancer l'industrie, mieux former nos concitoyens, lutter contre la financiarisation de l'économie – on devrait s'en préoccuper davantage – , synonyme de destruction massive d'emplois. Votre mesure, outre qu'elle n'a aucun fondement économique, constitue une formidable régression : elle limite le pouvoir d'appréciation du juge et interdit la réparation intégrale des préjudices.

La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon, pour soutenir l'amendement no 322 rectifié .

Cet amendement tend à revenir sur le barème des indemnités prud'homales.
La justice n'est pas une institution mécanique ; à un fait X ne correspond pas une peine unique. Un des principes fondamentaux de la justice en France est ce que l'on appelle l'individualisation de la peine : il est laissé au juge la liberté d'adapter la peine à toutes les circonstances qui concernent la situation jugée. Dans un sondage réalisé auprès des avocats du barreau de Paris, on apprend qu'ils sont 63 % à s'opposer à la barémisation des peines et 75 % à estimer que cela n'apporterait pas des relations de travail plus prévisibles et plus sereines. Exemple tiré du journal Libération daté de lundi dernier : avant la barémisation, Véronique, responsable de magasin, avait obtenu 40 000 euros de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; c'est normal, car les prud'hommes ont estimé que son âge, cinquante-six ans, augmentait le préjudice en raison des difficultés à retrouver un emploi. Avec le barème, elle aurait touché entre 2 000 et 8 000 euros. D'autres exemples sont disponibles.
En 2015, l'article 266 de la loi Macron 2 voulait déjà introduire le barème. Par chance, le juge constitutionnel l'a censuré au nom des principes d'égalité devant la loi et d'individualisation de la peine.
Enfin, de nombreux magistrats, de par leur expérience, s'attendent à ce que les taux de recours augmentent, ainsi que les tentatives de contourner la législation en évoquant des motifs dérogatoires : violation d'une liberté fondamentale, harcèlement, discrimination.
Votre mesure, madame la ministre, est injuste, clientéliste et sans doute inconstitutionnelle. Vous parlez de sécurisation, mais il n'y en aura ni pour les employeurs ni pour les employés, car la sécurisation se construit par la confiance. Or votre texte pousse à la défiance et à la guerre sociale.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

La parole est à M. Michel Castellani, pour soutenir l'amendement no 257 rectifié .

Il s'agit d'un des aspects les plus débattus du projet de loi. Le Gouvernement nous propose la ratification d'un texte qui prévoit de fixer un plafond ainsi qu'un plancher pour les indemnités octroyées au salarié en cas de refus de réintégration à l'occasion d'un licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse.
Le motif d'information préalable ne nous semble pas sérieux. Le salarié apparaît comme une variable d'ajustement. Or nous, nous souhaitons, dans ce domaine comme dans d'autres, mieux protéger le salarié. Nous considérons que ce dernier doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice. Tel est l'objet de notre amendement.

Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements en discussion commune ?

Ces amendements visent tous à supprimer le plafonnement des indemnités prud'homales et à revenir au texte antérieur. Je me suis très largement exprimé sur cette question tout à l'heure, grâce à la bienveillance du président, qui m'a laissé un peu plus de temps. Mes arguments sont inchangés. Avis défavorable.

Monsieur le rapporteur, vous nous expliquez que l'objectif de la mesure est d'éviter la judiciarisation, mais, pardonnez-moi, il s'agit là d'employeurs qui sont hors-la-loi, puisqu'ils licencient de manière abusive leurs salariés.

Après que j'ai été viré par mon patron de manière abusive, pour fait syndical ou parce que je suis une femme et que j'attends un enfant, je vais aller lui taper dans le dos, m'expliquer avec lui de manière détendue devant la machine à café et négocier une indemnité de licenciement ? Voyons !
Je pense que nous ne vivons pas sur la même planète. Il s'agit de patrons délinquants qui licencient de manière abusive, et il faut que les juges prud'homaux puissent faire leur travail et juger le fait individuel, comme le rappelait mon collègue Ratenon, en fonction de la situation de l'employé qui se trouve ainsi laissé sur le carreau.

Je voudrais revenir sur les risques psychosociaux et les prescriptions de psychotropes.
On s'inscrit bien là dans le cadre d'un licenciement abusif, qui, comme l'a dit la ministre, ne porte pas atteinte à l'intégrité physique. L'objectif de la barémisation n'est pas d'être contre ; il est, ainsi que nous l'avons répété, de limiter le nombre de procédures. En ce qui me concerne, je vois des gens, y compris du côté des salariés, qui sont désemparés par des procédures trop longues.

Dans ce cas, donnez plus de moyens aux prud'hommes : cela réduira la durée des procédures !

Peut-être arriverons-nous par cette mesure à éviter les procédures trop longues et, du coup, à aller mieux. À la fin, tout le monde sera gagnant et on consommera moins de psychotropes !
Exclamations sur les bancs du groupe FI.

Les patrons sont fautifs et les salariés ont droit à des indemnisations !

On se trouve là dans le cas de licenciements sans cause réelle et sérieuse : ce sont les seuls qui sont concernés par la barémisation.
Tout le monde ici est très attaché à l'égalité et à l'équité des décisions de justice – c'est évident.

Or que constate-t-on aujourd'hui ? Si l'on examine tous les arrêts pris par les chambres prud'homales, on note des écarts extrêmement importants pour des faits similaires.

Il me semble que nous avons là l'occasion de mettre en place un encadrement et, finalement, d'assurer une plus grande équité pour les personnes qui font un recours devant ces chambres. Il me paraît plus équitable de traiter le problème par la mesure qui nous est proposée plutôt que de poursuivre dans la voie du déplafonnement.
Exclamations sur les bancs du groupe FI.
Les amendements nos 74 rectifié , 322 rectifié et 257 rectifié , successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

Depuis le célèbre arrêt Rogie de 1990, lorsque l'employeur commettait une irrégularité dans la motivation ou la procédure de licenciement, celui-ci était considéré comme sans cause réelle et sérieuse. C'est cette jurisprudence que les ordonnances mettent à mal. Désormais, si la cause réelle et sérieuse peut être ultérieurement établie, l'employeur ne versera qu'une indemnité pour irrégularité, qui ne pourra dépasser un mois de salaire.
De plus, vous renvoyez au salarié la responsabilité de demander à l'employeur de rectifier les motifs retenus pour son licenciement. C'est un point crucial, car ces motifs fixent les termes du litige en cas de contentieux : le juge ne pourra rendre sa décision que sur ces seuls motifs. Si le salarié n'en fait pas la demande, l'insuffisance de motivation ne suffira plus à elle seule pour que licenciement soit reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Une telle modification ne nous paraît pas acceptable. Ce coup de canif porté à l'énoncé de la lettre de licenciement va, comme l'ont souligné plusieurs personnalités qualifiées, mettre le juge en difficulté. Pourquoi ? Parce que le juge devra apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement au regard d'éléments qui ne figurent pas directement dans la lettre, alors que c'est elle qui fixe les termes du litige en cas de contentieux.
De nombreuses personnalités qualifiées ont dénoncé ces dispositions, en invoquant notamment le fait qu'elles risqueraient d'enfoncer les victimes de harcèlement – ce que, je n'en doute pas, personne n'imagine. En effet, aujourd'hui, un seul acte de discrimination dans une lettre de licenciement permet de déclarer que le licenciement est nul de plein droit. Avec vos dispositions, le juge devra examiner tous les motifs de licenciement. Dès lors, pour une victime licenciée au motif qu'elle est harcelée et incompétente, le juge ne pourra plus annuler d'office le licenciement, mais il devra examiner tous les reproches d'incompétence formulés.

Avis défavorable. Cher collègue Vallaud, votre amendement propose de supprimer des avancées importantes, à mon avis, en matière de procédure de licenciement.
Il s'agit notamment de la possibilité pour l'employeur de préciser, à son initiative ou à la demande du salarié, le ou les motifs du licenciement qui fixent les limites du litige. Cela n'équivaut pas à un droit à l'erreur pour l'employeur, puisque celui-ci ne pourra pas ajouter de nouveaux motifs, ni même compléter sa motivation ; il pourra seulement préciser un ou des motifs déjà énoncés dans la lettre de licenciement.
Il aurait fait la même chose aux prud'hommes. Désormais, il pourra le faire avant : on retrouve là notre volonté de ne pas créer de la judiciarisation quand on peut l'éviter. Cela me paraît de nature à sécuriser la procédure, car, quand on en arrive au licenciement, on peut penser qu'il existe une forte incompréhension entre les parties, notamment sur la question de la motivation. Pour l'employeur, elle peut apparaître comme un exercice assez acrobatique et le juge assimile assez souvent l'insuffisance de motivation à une absence de motivation, donc à une absence de cause réelle et sérieuse.

Voilà l'objet de cette disposition. Ce n'est pas parce qu'on a mal indiqué le motif que celui-ci n'existe pas. L'assimilation mécanique de l'insuffisance de motivation à une absence de cause réelle et sérieuse n'est pas une bonne chose. À mon avis, on se trompe de combat.
L'amendement no 192 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement no 73 .

Avec l'article 4 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, on crée un droit à l'erreur pour l'employeur en matière de motivation des licenciements. L'employeur pourra ainsi préciser les motifs du licenciement après la notification de ce dernier. L'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne privera plus à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf si le salarié en fait la demande. Le projet de décret pris en application de ces dispositions, qui vient d'être publié, précise que l'employeur aura quinze jours pour préciser le motif du licenciement.
Vous y voyez là un facteur de « sécurisation » – pour reprendre votre terme. Nous y voyons, au contraire, une régression du droit des salariés à se défendre dans le cadre de la procédure de licenciement. Cela pose une question : comment un salarié pourra-t-il se défendre pendant la procédure de licenciement si l'employeur peut modifier après coup les motifs justifiant la rupture du contrat de travail ? Qui aura la capacité financière de recourir aux conseils d'un avocat durant ce laps de temps de quinze jours ? Je vous laisse deviner la réponse.

Une fois de plus, vous faites tourner le rapport de force à l'avantage des employeurs. Pour cette raison, nous demandons la suppression de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe FI.

Avis défavorable. Cet amendement propose de revenir au droit antérieur s'agissant des règles de procédure et de motivation du licenciement. Je viens de m'exprimer sur le sujet.
Une précision, cependant : l'article 4 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail procède à plusieurs innovations importantes, dont la fixation de modèles de lettres de licenciement, ce qui ne peut être qu'à l'avantage des deux parties. Cela permettra d'avoir à l'esprit ce qui s'impose à chacune d'entre elles, y compris les aspects formels relatifs à l'entretien, aux délais et autres, ce qui bénéficiera aussi au salarié.
L'article introduit, en outre, la possibilité pour l'employeur de préciser le ou les motifs du licenciement – nous venons de l'évoquer. Je répète que l'employeur ne peut en aucun cas ajouter de nouveaux motifs à cette occasion.
L'amendement no 73 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement no 194 .

L'argumentation sera d'ailleurs succincte, car ces deux amendements ressemblent beaucoup aux précédents. Ils marquent notre désaccord avec l'instauration de ce que nous considérons comme un droit à l'erreur en matière de motivation du licenciement, car cela porte atteinte au salarié qui souhaiterait faire valoir ses droits, a fortiori dans le cadre d'une procédure non contentieuse et en l'absence d'avocat. Ce qui est un progrès à vos yeux est un recul aux nôtres.

La parole est à M. Jean-Paul Lecoq, pour soutenir l'amendement no 346 rectifié .

Bien que nous ayons déjà débattu du plafonnement des indemnités prud'homales, je veux revenir sur les arguments du Gouvernement et de la majorité pour justifier cette mesure, qui nous paraît sans fondement.
Le Gouvernement et la majorité ont affirmé, à plusieurs reprises, que le temps mis par les conseils de prud'hommes pour rendre leur jugement est source d'insécurité pour les salariés. Les députés communistes en sont tout à fait d'accord ; mais pourquoi en est-on arrivé là ? Parce que l'État n'a jamais donné à la justice prud'homale les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Soyons honnêtes, mes chers collègues : si nous voulons une justice du travail efficace, donnons-lui les ressources pour qu'elle le soit. La logique suivie, sous couvert d'efficacité, est celle d'une automatisation des peines.
Deuxième point : la barémisation des indemnités laissera au juge un pouvoir d'appréciation, a déclaré M. le rapporteur. Mais c'est faux, puisque le juge ne pourra plus tenir compte de la situation familiale ou de la mobilité géographique du salarié qui aura été licencié, je le rappelle, de façon abusive. Chaque cas est différent, c'est pourquoi les indemnités varient d'un salarié à l'autre.
Enfin, répondant aux orateurs inscrits sur l'article 5, Mme la ministre a affirmé que le plafonnement est un élément de la confiance, et qu'il permet de s'adapter rapidement, à la hausse comme à la baisse de l'activité économique. On touche là au coeur de votre projet. Vous parlez d'agilité et de flexibilité, mais restez dans le registre de l'incantation et de la croyance : vos arguments prouvent que les salariés, à vos yeux, constituent la variable d'ajustement du marché économique. Ce n'est notre conception ni du progrès social ni de la justice. C'est pourquoi nous demandons la suppression des dispositions visées.

Je me réjouis que notre collègue Lecoq nous écoute avec attention puisqu'il nous cite : cela montre la qualité de nos débats.
L'amendement no 346 rectifié tend, comme les précédents, à supprimer le barème des indemnités prud'homales. Mes objections restent les mêmes : avis défavorable.

Je soutiens l'amendement de nos collègues du groupe GDR, et il me donne l'occasion de revenir sur le débat. On nous reproche régulièrement, selon moi à tort, d'être contre les entreprises et contre les patrons. Ce n'est pas vrai, nous l'avons déjà dit. Mais nous parlons ici de patrons qui licencient de façon illégale, sans arrangement ou dialogue possible ; nous parlons d'une injustice de fait, d'un acte illégal qui appelle donc des sanctions.
Un barème existe déjà, monsieur le rapporteur, bien qu'il ne soit qu'indicatif ; la différence avec celui proposé ici est que ses plafonds sont plus élevés. Le scandale est que le salarié, victime d'un employeur en faute, sera moins indemnisé avec votre barème, dont les valeurs sont très inférieures à la moyenne actuelle. Pour lui, l'injustice sera donc double.
De fait, vous vous positionnez en défenseur des chefs d'entreprise, même quand ils sont dans l'illégalité et commettent des injustices. Ne vous étonnez pas, ensuite, que l'on dise de votre politique et de ce texte qu'ils sont dirigés contre les salariés et contre la justice sociale ! Sur l'injustice sociale criante dont il est ici question, les amendements précédemment défendus devraient faire l'unanimité ; mais vous avez choisi le camp des patrons voyous, contre les salariés.
L'amendement no 346 rectifié n'est pas adopté.

La parole est à M. Boris Vallaud, pour soutenir l'amendement no 180 .
Sur cet amendement, je suis saisi par le groupe Nouvelle Gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

Cet amendement est d'importance, car il porte sur le barème obligatoire. Il nous éclairera sur les vraies intentions du Gouvernement.
Si votre objectif, madame la ministre, est bien de donner une plus grande visibilité aux employeurs et, de la même façon, aux salariés, et non d'empêcher la justice de réparer correctement les abus commis à l'encontre de ces derniers, vous n'aurez aucun mal à émettre un avis favorable à cet amendement.
Nous proposons un barème précisément établi en fonction des montants octroyés par le juge suite à des licenciements dépourvus de causes réelles et sérieuses. Ces données ne viennent pas d'un travail accompli seul, mais d'une note établie en 2015 par les services de la Chancellerie. Je vous la communiquerai, car je ne suis pas sûr que vous l'ayez lue : vous pourrez ainsi en faire part à la représentation nationale. Cette note se fonde sur l'étude de 400 arrêts rendus en 2014. Elle révèle que, dans près des deux tiers des arrêts, les juges ont fixé des indemnités correspondant à une valeur comprise entre six mois et dix-huit mois de salaire, autrement dit deux ou trois fois les seuils que vous proposez.
Nous proposons donc de retenir les moyennes constatées. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous parlons ici de licenciements abusifs : la réparation des préjudices personnels qui en découlent doit être intégrale.
Invoquer les différences jurisprudentielles entre tribunaux relève d'une erreur d'appréciation, car la réparation porte toujours sur un préjudice personnel. À ancienneté égale, le préjudice ne sera pas de même nature pour un jeune de vingt-cinq ans surdiplômé et pour une femme célibataire sans diplôme avec trois enfants à charge. Cela explique les différences jurisprudentielles.
Il serait donc de bonne justice de fixer un barème correspondant aux réalités de la jurisprudence prud'homale.

Même si l'amendement est un peu différent de celui qui fut repoussé en commission, l'avis reste défavorable. En somme, monsieur Vallaud, vous proposez un barème alternatif, avec des planchers et des plafonds relevés. Je partage certaines de vos préoccupations, mais souhaite apporter quelques éclairages.
En premier lieu, vos planchers sont très supérieurs à ceux fixés par le droit actuel. Il est permis d'être ambitieux, me répondrez-vous. Soit. Votre barème fixe l'indemnité minimale à quinze mois de salaire pour un salarié ayant au moins vingt ans d'ancienneté, contre six mois seulement dans le droit actuel. Admettez que la marge est significative, d'autant que, je le répète, il ne s'agit que de planchers : le juge peut aller au-delà.
Je suis convaincu, pour ma part, que le juge doit garder une marge d'appréciation ; or il n'en aurait plus aucune avec des planchers aussi élevés, qu'il appliquerait assurément dans tous les cas.
En deuxième lieu, vous avez tendance à ne vous référer, dans l'étude mentionnée, qu'aux moyennes constatées, qui, du coup, deviennent des planchers. Pour un salarié ayant vingt et un ans d'ancienneté, vous proposez ainsi un plancher de quinze mois de salaire brut ; or, pour ce niveau d'ancienneté, la moyenne constatée dans la même étude est de 15,1 mois de salaire. Les planchers que vous proposez forceraient donc le juge à aller très au-delà des moyennes constatées dans l'étude dont vous vous prévalez.

Enfin, permettez-moi d'émettre un doute sur l'interprétation que vous faites de cette étude, dont l'exposé sommaire de votre amendement indique qu'elle ne reposerait que sur 400 arrêts. Au total, rappelons-le, la justice prud'homale rend 150 000 arrêts par an ; de surcroît, vous ne retenez que deux tiers de ces 400 arrêts. Quid du tiers restant ? Peut-être manquait-il d'intérêt, mais le fait de ne retenir que deux tiers d'un échantillon aussi faible a de quoi interpeller.
Vous l'aurez compris, votre amendement pose des problèmes de fond comme de forme. Pour avoir un peu étudié la statistique, quoique dans un passé assez lointain, je crois me souvenir qu'un échantillon stratifié représentatif requiert un écart équivalent à 1 sur la racine de la taille de l'échantillon. Il est donc très difficile d'obtenir des éléments précis à partir d'un échantillon de 400 unités.

Je n'ai pas étudié la statistique, mais M. le rapporteur devrait aller exposer ses formules aux instituts de sondage qui annoncent une remontée de la cote de popularité du Président de la République : ce ne sont assurément pas celles qui ont été retenues pour déterminer l'échantillon représentatif !
Quoi qu'il en soit, les députés communistes sont résolument opposés au principe du barème. Le juge doit apprécier les situations au cas par cas : en termes de préjudice, un licenciement abusif n'est pas chiffrable a priori.
Cela dit, entre le barème fixé par les ordonnances et celui de notre collègue Boris Vallaud, nous préférons le second, car il apporterait une garantie minimale aux salariés abusivement licenciés. Nous soutenons donc le présent amendement, tout en rappelant notre opposition à tout barème en ce domaine.

Si je crois être à peu près capable d'interpréter l'étude, les formules mathématiques me sont plutôt étrangères : en mathématiques, j'ai décroché assez tôt dans ma scolarité.
Sourires.

Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les ordonnances, elles, ne se fondent sur aucune étude ni aucun calcul pour les planchers et les plafonds : ceux-ci ont été fixés au doigt mouillé, et selon des valeurs minimales – c'est en tout cas ce que j'en retiens. Les indemnités versées à des salariés de TPE ayant moins de six ans d'ancienneté, par exemple, correspondent à peu près à ce que leur coûterait le recours à un avocat devant les prud'hommes.
Cela dit, nous ne sommes pas non plus favorables à des barèmes obligatoires ; nous souhaitons une réparation intégrale du préjudice, fondée sur la libre appréciation, par le juge, des circonstances dans leur singularité.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 49 |
| Nombre de suffrages exprimés | 44 |
| Majorité absolue | 23 |
| Pour l'adoption | 4 |
| contre | 40 |
L'amendement no 180 n'est pas adopté.

Nous ne sommes pas hostiles à la fixation de plafonds pour le versement des indemnités prud'homales, surtout si cela peut lever les incertitudes et apaiser les angoisses du petit chef d'entreprise lorsqu'il décide de se séparer d'un de ses salariés ; mais il est inacceptable de fixer ce plafond à vingt mois de salaire pour un salarié ayant passé trente ans dans la même « boîte ».
Prenons l'exemple concret d'un salarié qui, entré dans une usine d'assemblage à vingt-cinq ans, est aujourd'hui âgé de cinquante-cinq ans. En cas de licenciement, il pourra donc espérer une indemnité équivalant à vingt mois de salaire tout au plus, soit environ 30 000 euros. Il devra continuer à travailler pendant sept ans encore avant de prendre sa retraite. Inutile, je pense, de vous décrire les difficultés qui seront les siennes pour retrouver un travail, compte tenu du taux de chômage record chez les seniors.
Nous parlons ici, je le rappelle, de licenciements sans cause réelle, non de licenciement économiques ou fondés sur une faute grave.
C'est pourquoi je vous demande de relever le plafond d'indemnisation de vingt mois de salaire à vingt-quatre. Au nom de la justice sociale, il faut rétablir à tout prix un équilibre et garantir un parcours sécurisé aux salariés seniors licenciés.

Avis défavorable. Nous avons longuement débattu de ce barème d'indemnisation avec nos collègues du côté gauche de l'hémicycle. Il faut maintenant lui faire confiance : son plancher et son plafond ont été définis à partir d'observations…

… que Mme la ministre a explicitées à plusieurs reprises en commission.
Relever ces plafonds uniquement pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise dépasse trente ans ne me semble pas souhaitable, d'autant que cela pourrait créer une incohérence par rapport à ce qui existe pour les autres catégories de salariés.
L'amendement no 108 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Boris Vallaud, pour soutenir l'amendement no 181 .
Sur cet amendement, je suis saisi par le groupe Nouvelle Gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

Madame la ministre, vous prévoyez des indemnités particulièrement réduites pour les salariés des TPE. Au-delà du fait que vous considérez qu'un salarié d'une TPE doit être moins bien traité qu'un salarié d'une grande entreprise ou d'une entreprise de taille intermédiaire, vous faites fi de la récente censure du Conseil constitutionnel. Les Sages considèrent, en effet, que la distinction en fonction de la taille de l'entreprise est contraire à la Constitution.
Vous prévoyez, par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, une indemnité d'un mois et demi de salaire, pour six ans d'ancienneté. Tous les avocats spécialistes des prud'hommes nous ont dit la même chose : si vous avez moins de six ans d'ancienneté, il n'y a plus aucun intérêt à saisir la justice au regard des barèmes appliqués. Or on sait que l'ancienneté moyenne des salariés est plus faible dans les petites entreprises que dans les grandes. Ce sont donc 3,8 millions de salariés des PME qui vont subir cette double peine. Une fois encore, vous creusez le fossé entre les grandes et les petites entreprises.
Finalement, mes chers collègues, je ne retiens qu'une chose de cette disposition : si un employeur cherche de la flexibilité, il n'aura plus à recourir au contrat à durée déterminée, pour lequel il devrait payer tous les salaires jusqu'à la fin du contrat, s'il était condamné ; il embauchera en contrat à durée indéterminée, puisqu'il connaît à l'avance le coût maximal, et si faible, de la rupture, y compris en cas de licenciement abusif.
Nous proposons donc de supprimer ce barème.

Avis défavorable. Le barème dérogatoire que vous souhaitez supprimer, monsieur Vallaud, applicable aux entreprises de moins de onze salariés, ne comporte que des planchers dérogatoires. Les plafonds d'indemnisation applicables pour ces TPE sont les mêmes que ceux des entreprises d'au moins onze salariés.
Notons d'ailleurs que, jusqu'à la publication des ordonnances, aucun plancher n'était applicable lorsque le salarié licencié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou lorsque le licenciement était intervenu dans une entreprise de moins de onze salariés. Les indemnités étaient décidées par le juge, en fonction du préjudice subi.
Cette absence de plancher, donc cette différence de traitement selon la taille de l'entreprise, avait été validée par la décision no 2016-582 du Conseil constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité du 13 octobre 2016, qui avait jugé en l'espèce que : « Dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de cette indemnité minimale en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. »
Comme je suis d'accord avec le principe selon lequel il vaut mieux éviter de faire peser une charge trop lourde sur les petites entreprises qui, économiquement, sont les plus fragiles, je serai défavorable à cet amendement.

Entre juillet et novembre, je me suis entretenu avec de nombreux concitoyens au sujet de la barémisation, car, contrairement à la période précédente, nous commencions à en savoir un peu plus sur cette question. Tous sont inquiets, tous mesurent qu'une insécurité du travail se met en place.
Dès lors, il nous paraît anormal que le Gouvernement ne documente pas sa position sur chacun de nos amendements. J'entends bien les réponses du rapporteur et l'avis défavorable de la ministre, mais nous aimerions avoir des arguments. Si nous insistons, c'est parce que le peuple français insiste. Les salariés insistent aussi pour que l'on revoie ces dispositions. Or nous ne mesurons pas d'évolution dans la réflexion du Gouvernement.
Ce n'est pas la peine que le rapporteur et le Gouvernement soient tous deux présents au banc, si le rapporteur est seul à documenter ses avis. Il ne parle pas, lui, au nom du Gouvernement.

On parle beaucoup de justice. Oui, c'est une question de justice et d'égalité, non seulement entre les salariés, mais aussi entre les employeurs. En pratique, les grandes entreprises ne sont pas intéressées par la barémisation. Elles concluent des transactions, et paient.
Pour les petites entreprises, en revanche, l'absence de barémisation peut causer beaucoup de dégâts. Je n'en donnerai qu'un exemple, celui d'une petite entreprise du BTP, que j'ai conseillée. Employant huit salariés, elle a été fortement condamnée à la suite d'un contentieux prud'homal : pour un salarié licencié, sept autres ont été mis au chômage.
Oui, il faut le dire, c'est aussi une question de justice. Les petites entreprises, celles qui emploient le plus, doivent être protégées.
Les grandes entreprises se moquent de la barémisation : elles paient, après avoir conclu des transactions.

Elles n'ont qu'à pas faire de licenciements abusifs ! Vous défendez les délinquants !

Essayons d'avancer dans l'interprétation de ce projet de loi : nous ne sommes pas dans un débat général sur l'éthique, sur la façon de protéger les entreprises. Nous aurions beaucoup de propositions à soumettre pour protéger les entreprises, relancer leurs carnets de commandes, leur permettre d'embaucher ou de payer correctement tous leurs salariés, et relancer l'activité.
Mais le débat n'est pas là : on parle de chefs d'entreprise qui ont commis des licenciements abusifs, illégaux, allant contre la loi. Les personnes que l'on doit protéger, ce sont les salariés. Il y a là un parti pris. Ce n'est pas une question idéologique, mais une question de justice : nous devons prendre parti pour protéger les salariés. Comment y parvenir ?

Ce projet de loi est censé permettre la flexibilité, bla-bla, et la protection des salariés.

Dans ce cas, la loi doit protéger ceux qui sont en situation de faiblesse, toutes les victimes d'un licenciement abusif.

Avec la barémisation, chers collègues, vous ne les protégez pas. Vous donnez les moyens aux entrepreneurs, y compris à des patrons voyous qui ont commis une illégalité, d'anticiper leurs futurs licenciements abusifs.
Exclamations sur les bancs du groupe LR.

Nous vous avons donné des chiffres et des exemples prouvant qu'avec ce projet de loi, vous baissez les indemnités de personnes victimes de licenciements abusifs. Voilà ce que vous faites ! Vous pouvez enrober cela de toutes les manières possibles, vous êtes du côté de l'injustice sociale ! Vous êtes du côté des patrons voyous !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 48 |
| Nombre de suffrages exprimés | 48 |
| Majorité absolue | 25 |
| Pour l'adoption | 12 |
| contre | 36 |
L'amendement no 181 n'est pas adopté.

La saisine du juge prud'homal est par nature protéiforme. Si elle tend le plus souvent, pour le salarié, à voir condamner une rupture du contrat de travail à durée indéterminée, son objectif ne se limite pas à la seule réparation du licenciement dépourvu de motif. Sont ainsi en jeu, à titre accessoire, le versement de salaires impayés ou d'heures supplémentaires, le paiement d'indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, les congés payés afférents, le préavis.
C'est donc l'ensemble des condamnations se rapportant à toutes ces demandes qui constituent le « coût juridictionnel de la rupture », notion parfois confondue avec l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, stricto sensu.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1235-3 propose de laisser la possibilité au juge de tenir compte des autres indemnités versées. En fait, madame la ministre, vous proposez d'ouvrir la possibilité d'établir un barème, non plus pour les seules indemnités liées au licenciement abusif, mais bien pour l'ensemble des indemnités, en permettant au juge d'élargir le périmètre d'appréciation de celles qui pourraient être versées dans le cadre des montants maximaux prévus par le barème obligatoire. Vous le reconnaissez vous-même, monsieur le rapporteur, car vous écrivez dans votre projet de rapport : « Toutefois, l'éventuel cumul des indemnités doit impérativement respecter le montant maximum prévu par le barème obligatoire. » Cette formule, évidemment, nous inquiète et nous fait réagir.
Un amendement a été adopté en commission pour préciser que le juge ne peut, en aucun cas, tenir compte de l'indemnité légale de licenciement pour fixer le montant de l'indemnité accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cela prouve bien que votre rédaction est, au mieux, bancale, au pire, source de diminution des droits pour les salariés.
Comme le montrent Florian Batard et Manuela Grévy dans un article récent de la Revue de droit du travail, vous ramenez la sanction civile à une simple taxation dont l'objet est de dissuader le salarié d'agir en justice. Vous êtes en train de consacrer une thèse doctrinale, celle de l'inexécution efficace, selon laquelle il peut être plus avantageux de payer des dommages et intérêts que de tenir son engagement.

Avis défavorable. Sur ce sujet, dont nous avons longuement discuté en commission, mon argumentaire n'a pas varié, cher collègue.

Je voudrais compléter ce qui a été dit précédemment, sur les licenciements abusifs et le fait qu'on aidait les patrons voyous.
En plus de déséquilibrer le rapport entre patrons voyous et salariés, on crée une autre injustice entre les patrons eux-mêmes, entre ceux qui s'attachent à respecter la législation et à bien traiter leurs salariés, et ceux qui ne se soucient pas du code du travail et qui, à la fin, pourront payer selon un barème. L'injustice au sein du patronat, elle est là !
Si vous voulez lutter contre cette injustice, il faut punir sévèrement les employeurs qui abusent. Ce n'est malheureusement pas ce que vous êtes en train de faire.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
L'amendement no 182 n'est pas adopté.

Le dernier alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, tel qu'il résulte de l'ordonnance, plafonne la somme des indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autres indemnités liées au licenciement économique – indemnités versées en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ; celles versées en cas de non-respect de la priorité de réembauche ; celles versées en cas de licenciement économique dans une entreprise qui n'aurait pas de comité d'entreprise ou de délégué du personnel alors qu'elle y est légalement tenue.
Ainsi, madame la ministre, vous privez le juge de sa mission d'apprécier la réparation adéquate due au salarié. Vous occultez la dimension réparatoire du préjudice de l'indemnité pour lui préférer une sanction d'un montant prévisible et indépendant du préjudice.
Par cet alinéa, vous faites la démonstration que votre barème obligatoire va bien au-delà de la simple prévisibilité pour les entreprises. Nous le regrettons. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet alinéa.

Avis défavorable. L'instauration du barème obligatoire doit permettre à l'employeur comme au juge de disposer d'une meilleure prévisibilité s'agissant des montants susceptibles d'être versés par décision du juge. Il paraît donc logique que le cumul des diverses indemnités ne puisse pas dépasser les montants maximaux prévus par le barème qui, dans le cas contraire, n'aurait plus aucune utilité.

L'indemnité prud'homale pour motif de licenciement abusif vise à réparer un préjudice individuel. Les autres indemnités que j'ai mentionnées n'ont rien à voir avec un tel préjudice. L'agrégation dans le barème n'a donc aucun sens. Aussi, je ne pense pas que cette explication soit recevable.
L'amendement no 183 n'est pas adopté.

Nous en arrivons à un autre sujet majeur.
Pour les licenciements nuls, notamment ceux intervenus en violation des dispositions relatives au harcèlement sexuel, la loi ne prévoyait rien avant 2016. La Cour de cassation avait toutefois pallié ce manque en décidant, selon une jurisprudence constante, que le préjudice découlant d'un licenciement déclaré nul devait être indemnisé, lorsque le salarié ne réintégrait pas l'entreprise, par une somme qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient le nombre de salariés dans l'entreprise et leur ancienneté. La Cour de cassation avait donc institué une protection plus importante pour les salariés victimes d'un licenciement discriminatoire – en toute logique, puisque ce sont les licenciements considérés comme les plus graves et les plus attentatoires à l'ordre public.
L'article 123 de la loi « Travail » d'août 2016 a codifié cette jurisprudence, dans la continuité des travaux de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement vise à porter à douze mois l'indemnité minimale, pour plusieurs raisons.
Premièrement, il reprend des dispositions déjà adoptées par le Parlement en 2014 dans le cadre de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Ensuite, le minimum actuel de six mois ne contraint pas les employeurs à veiller à la prévention du harcèlement sexuel, alors qu'il s'agit d'une obligation légale.
Enfin, comme l'a souligné l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, ce minimum de six mois ne suffit pas à réparer le cataclysme que les violences sexuelles au travail ont provoqué dans la vie des victimes : les atteintes à leur santé, la dislocation de leur vie familiale ou encore la perte de chance de retrouver un emploi équivalent.
Hier, nous avons évité le pire en adoptant à l'unanimité un amendement que j'avais eu la sagesse de présenter ; je ne désespère pas que vous adoptiez celui-là dans les mêmes conditions.
Sourires.

Vous êtes un débatteur émérite, mon cher collègue, je ne le conteste pas !
Pourquoi voulez-vous porter à douze mois l'indemnité minimale, qui est de six mois dans les cas que vous visez, alors que le juge a toute liberté d'aller jusqu'à douze quinze ou dix-huit mois ?

Six mois, ce n'est qu'un plancher, le même qu'auparavant. Le juge apprécie en conscience, en s'appuyant sur des éléments objectifs, pour fixer la réparation du préjudice. Ce devrait être pour vous un motif de satisfaction, au demeurant partagé.
Avis défavorable.

Moi aussi, je propose un plancher, mais rehaussé : cela s'appelle un progrès. Et ce progrès est le fruit du travail de nos prédécesseurs, dans cette assemblée et ailleurs, en France comme en Europe.
L'amendement no 185 n'est pas adopté.

Les licenciements entachés par une faute de l'employeur d'une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination, sont exclus du barème obligatoire.
Toutefois, vous avez supprimé les dispositions qui rappellent que l'indemnité doit être versée sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, du paiement de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Cela nous paraît tout à fait inacceptable.

Défavorable.
Cet amendement est à la fois redondant et incompatible avec le dernier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Il revient sur l'amendement adopté par la commission à mon initiative – je comprends bien qu'il n'y a là rien de personnel ! – et qui visait à exclure de l'application du barème prud'homal les cas de rupture du contrat de travail consécutifs à une prise d'acte ou à une résiliation judiciaire motivées par un manquement grave de l'employeur. Or cet ajout est indispensable pour que les victimes de harcèlement ou de discrimination ayant rompu leur contrat de travail du fait de ces manquements de l'employeur soient traitées de la même manière que les salariés licenciés à la suite de tels manquements. J'imagine que c'est ce que vous souhaitez.
Voilà de bonnes raisons de ne pas adopter votre amendement.
L'amendement no 184 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

C'est un amendement de conséquence de notre volonté de supprimer le barème spécifique applicable aux salariés des TPE. Ce barème contribue à la création d'un sous-droit pour ces entreprises, après l'ouverture à la négociation sans intermédiaire sur tous les thèmes et la possibilité d'adopter des dispositions moins favorables dans les accords d'entreprise.
Il y a quelques années, on dénonçait le droit du travail pour pouvoir créer un droit des grands groupes. Aujourd'hui, vous réagissez à la complexité de la norme sociale en créant un sous-droit du travail dans les TPE.
Toutes ces dispositions seront préjudiciables aux petites entreprises, pour une raison simple : vous allez en faire fuir la main-d'oeuvre qualifiée en amoindrissant leurs droits et en creusant le fossé entre elles et les grandes entreprises.

Quel est l'avis de la commission ?
Défavorable. D'une part, le plancher obligatoire prévu par l'ordonnance n'est qu'un plancher. D'autre part, si un barème dérogatoire s'applique désormais aux entreprises de moins de onze salariés, je rappelle que le droit antérieur ne fixait aucun seuil d'indemnisation pour les salariés de ces entreprises.
L'amendement no 186 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.


Jusqu'en 2008, il n'existait pas de délai de prescription spécifique pour les irrégularités relatives aux licenciements ; c'était donc le délai de droit commun de l'époque, soit trente ans, qui s'appliquait. Cet amendement vise à revenir à une situation normale, de sorte qu'un licenciement intervenu dans des conditions illégales ne soit pas prescrit plus vite que d'autres pratiques frauduleuses honteuses.
En effet, le délai d'un an établi dans l'article ne permet que rarement de contester un licenciement frauduleux, compte tenu des graves difficultés que rencontre un salarié licencié. Le licenciement deviendra incontestable au bout d'une année, même s'il ne repose sur aucun motif réel et sérieux ou s'il est discriminatoire. Or, selon les témoignages de nombreux représentants syndicaux, il faut du temps aux salariés pour se rendre compte du caractère abusif d'un licenciement, sans compter le choc psychologique lié à la procédure, la nécessité d'avoir les moyens d'accéder à certaines informations, l'éventuelle absence de représentants syndicaux – autant de facteurs qui compliquent leur cheminement vers une revendication en justice.
Eu égard à la durée des procédures, à l'engorgement des prud'hommes et aux paramètres psychologiques en jeu après un licenciement, le délai d'un an est beaucoup trop court pour constituer un dossier sérieux et fiable, ce qui nuira à la juste prise en considération des contestations.
Nous vous demandons de voter cet amendement pour protéger véritablement les salariés lors de ce type de procédures.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour soutenir l'amendement no 91 .
Rires sur les bancs du groupe FI.

Il ne faudrait même pas six mois, bien que ce soit le délai que je propose.

Défavorable.
Je suis tiraillé : ce que propose M. Taugourdeau, c'est-à-dire passer de douze mois à six, est plus réaliste…

… que la proposition de Mme Obono, qui souhaite porter le délai à trente ans.

Il y a un peu d'excès dans chacune de ces deux propositions. Il me paraît bon d'en rester à douze mois.

Dans deux ans, vous reviendrez nous expliquer qu'il faut passer à six !

Sans toujours vouloir s'inspirer de l'étranger, on peut noter qu'en Allemagne le délai est, si ma mémoire est bonne, de quelques semaines.

Au moins, en Allemagne, les salariés sont protégés par leurs syndicats ! Et ils connaissent mieux leurs droits !

On entend souvent le rapporteur, le Gouvernement ou nos collègues invoquer un problème de durée : il faudrait que les choses aillent plus vite pour les salariés ; d'où la volonté de supprimer tout droit de recours ou de réduire à rien le délai de prescription. Mais c'est prendre le problème à l'envers. Si le règlement des contentieux aux prud'hommes est trop lent, la solution n'est pas très compliquée : il suffit de donner à la justice prud'homale les moyens de se prononcer dans des délais décents, au lieu de dire « il n'y a pas de moyens, c'est trop long, donc on supprime tout » – ce qui facilite les atteintes au droit qu'ont les salariés de se défendre.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.


Nous en venons aux planchers d'indemnisation, dont plusieurs ont été modifiés dans un sens défavorable aux salariés.
Ainsi, vous divisez par deux l'indemnité minimale due au salarié dont le licenciement est nul et pour lequel la réintégration ou la poursuite de son contrat de travail est impossible : le plancher serait de six mois de salaire, contre douze auparavant.
Certes – vous l'avez dit, monsieur le rapporteur – , au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, mais vous risquez de faire du plancher un plafond et de porter ainsi gravement atteinte au régime de sanction de la nullité. C'est la raison pour laquelle nous proposons de rétablir le plancher de douze mois.

La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement identique no 340 .

En plus de plafonner les indemnités prud'homales, vous modifiez dans un sens particulièrement défavorable aux salariés certaines réparations spécifiques prévues par le code du travail et liées à la rupture du contrat de travail.
Ainsi, vous réduisez l'indemnisation du salarié auquel il est impossible de réintégrer son entreprise après un licenciement économique collectif dont la nullité a été prononcée par le juge. Dans ce cas, le juge octroie au salarié, pour réparer le préjudice qu'il a subi, une indemnité à la charge de l'employeur. Cette indemnité, qui ne pouvait auparavant être inférieure aux salaires des douze derniers mois, doit désormais être au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Quel est le fondement de cette mesure, sinon la volonté de réduire la protection accordée aux salariés licenciés abusivement dans le cadre d'un plan social ? Ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi nous proposons, par cet amendement, de revenir au droit antérieur.

Défavorable.
Il est cohérent de soumettre le licenciement économique dont la nullité est constatée par le juge au même régime que les autres cas de licenciement nul. Nous ne spolions personne. Je le rappelle, c'est le juge qui décide souverainement au vu des éléments qui sont portés à sa connaissance ; vous l'avez fait observer vous-même, monsieur Vallaud. Le plancher n'est qu'un plancher ; ce n'est pas le montant que toucherait le salarié concerné.


Vous ramenez de deux à un mois le plancher de l'indemnité versée en cas de non-respect de la priorité de réembauche. Nous n'y sommes pas favorables. En réduisant les sanctions dont est assorti le non-respect des obligations auxquelles sont tenus les employeurs, vous favorisez celui-ci.
Nous demandons par conséquent le maintien du plancher à deux mois.
J'ai bien conscience du fait qu'il s'agit d'un plancher ; mais, quand on baisse un plancher, on laisse au juge la possibilité de descendre en deçà du plancher précédent. Vous réduisez donc bien les sanctions du non-respect des obligations incombant aux employeurs.

L'amendement identique no 341 étant défendu, je demande l'avis de la commission… Ah, vous voulez vous exprimer, monsieur Lecoq ? Vous avez la parole.
Rires.

Dans le droit-fil de la barémisation des indemnités prud'homales, l'article 2 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail réduit de deux à un mois de salaire le plancher de l'indemnité versée en cas de non-respect de la priorité de réembauche. Nul doute que la réduction des sanctions incitera les employeurs à ne plus se conformer au droit du travail. Vous obéissez ainsi à une dangereuse logique de laisser-faire et de déresponsabilisation des employeurs.
La priorité de réembauche a vocation à préserver l'emploi et à amener l'employeur à tout mettre en oeuvre pour reprendre le salarié et poursuivre la relation contractuelle avec lui.
Voilà pourquoi nous demandons, par l'amendement no 341 , le rétablissement du droit antérieur.

Ces amendements ont été repoussés par la commission, à l'instar des deux précédents, qui soulevaient la même question. Nous souhaitons en effet harmoniser les planchers d'indemnisation. Je vous remercie, chers collègues, d'avoir eu l'honnêteté de préciser qu'ils s'agissait toujours de fixer un plancher, même si votre ambition de le relever autant que possible.
Sourires.

Plusieurs planchers d'indemnisation sont fixés à un mois, notamment en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique en l'absence de mise en place du comité d'entreprise ou de délégués du personnel n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de carence. Or nous visons l'alignement des seuils.

Je le répète, il ne s'agit que d'un plancher. L'alignement par le bas pourrait survenir uniquement si le juge décidait d'attribuer aux salariés concernés une indemnité inférieure au seuil précédent, ce que ni vous ni moi, chers collègues, ne pouvons prévoir.

La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement no 57 .

Nous revenons sur le fameux CDI de chantier, dont l'usage était auparavant limité aux branches du bâtiment et du conseil. Vous proposez, madame la ministre, d'en étendre le champ à d'autres secteurs d'activité. Ce faisant, vous vous attaquez de nouveau au contrat à durée indéterminée, qui pourtant sécurise et stabilise la situation des travailleurs et leur permet de se projeter dans l'avenir.
L'élargissement du champ d'application de ce type de contrat de travail vise à flexibiliser le contrat à durée indéterminée et à créer un CDI low cost. Comme d'autres dispositions du texte, il répond à un vieux caprice du MEDEF, et avant lui du CNPF. L'objectif visé à terme est bien entendu le même : flexibiliser le marché de l'emploi et faire des salariés des variables d'ajustement aux carnets de commandes des entreprises.
Cette disposition permettra de contourner les protections prévues par le droit du licenciement. En effet, à la fin de la mission concernée, qui peut durer un mois, deux ans ou plus – rappelons que la durée d'un CDD est limitée à dix-huit mois – , le salarié peut être licencié pour motif personnel. Comme la fin du chantier constitue un motif valable de licenciement, l'employeur n'est pas tenu de justifier l'arrêt de la collaboration. Il est donc inattaquable devant le juge prud'homal. Il s'agit donc de créer un nouveau type de contrat de travail ultra-précaire qui n'aura de CDI que le nom.
Nous n'avons pas obtenu de réponse aux questions que nous avons posées ce matin. Avez-vous rencontré les salariés concernés, madame la ministre ? Pensez-vous que les banques accepteront de leur accorder des prêts – car tel est l'argument que vous avancez – à la lecture de la mention « CDI de projet » portée sur leur contrat de travail ? Pensez-vous que les propriétaires accepteront de louer leur logement si facilement que vous l'affirmez à ces salariés en CDI low cost ?
Je ne connais pas beaucoup de banquiers qui se contenteront de jeter un oeil sur leur bulletin de salaire – car tel est l'argument que vous avez avancé, affirmant que tout, dans ces contrats, fera croire à un CDI. Loin de sécuriser ces travailleurs, vous précariserez leurs relations de travail comme leur vie quotidienne en matière d'accès au logement ou au crédit. C'est pourquoi nous demandons l'abrogation de ces dispositions.

Avis défavorable. Votre amendement, cher collègue, vise à supprimer les modifications, introduites par ordonnance, de la procédure de licenciement applicable à un salarié dont le CDI de chantier arrive à expiration. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de m'exprimer assez longuement sur ce sujet lors de l'examen d'un amendement défendu par notre collègue Adrien Quatennens.
S'agissant du vôtre, la vraie différence introduite par l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail est l'ajout d'une disposition selon laquelle le licenciement survenant à la fin d'un contrat de chantier est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui semble logique. Il est vrai que, jusqu'à présent, il appartenait au juge de se prononcer sur le fondement d'un licenciement intervenu à la fin d'un CDI de chantier ; mais le juge a toujours considéré que l'achèvement d'un chantier constitue bien une cause légitime de licenciement, même si la durée estimée de ce chantier a été dépassée. Nous faisons donc preuve de cohérence avec la jurisprudence. Il s'agit bien de la rupture du contrat survenant à la fin du chantier ou d'une opération, et non en raison de difficultés susceptibles d'y mettre un terme anticipé ou de l'annuler.
Ces cas doivent être négociés dans le cadre de l'accord de branche. Vos inquiétudes devraient être en partie apaisées par le travail que mèneront les branches, cher collègue, car toutes les dispositions relatives à la mise en oeuvre du CDI de chantier, notamment ses modalités, seront négociées dans ce cadre. Vous savez d'ailleurs que de nombreux partenaires sociaux souhaitent que le pouvoir des branches soit renforcé.
L'amendement no 57 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.


Faute d'avoir obtenu la suppression du CDI de chantier, dont nous contestons la logique, nous proposons un amendement de repli. Il s'agit d'introduire un droit prioritaire, destiné au salarié dont le contrat de projet arrive à expiration, lui permettant de bénéficier d'un CDI de droit commun, c'est-à-dire d'un vrai contrat à durée indéterminée.
À cette fin, le salarié licencié à l'issue du chantier ou de l'opération concernés bénéficierait, pendant un délai d'une année à compter de la date de rupture de son contrat de projet, d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée. L'employeur se trouverait alors dans l'obligation d'informer le salarié de tout emploi disponible compatible avec sa qualification. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficierait également d'une priorité de réembauche s'il en informe l'employeur.
Vous l'aurez compris, chers collègues, le présent amendement entend faire bénéficier le salarié titulaire d'un CDI de chantier, disposant d'une expérience et d'acquis, d'une priorité de réembauche, sur le modèle des protections dont bénéficient les salariés licenciés pour motif économique. Tel est l'objet de cet amendement, auquel je ne doute pas que vous serez sensible, monsieur le rapporteur.


Avis favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement no 384 . La priorité de réembauche est un dispositif applicable dans le cadre du licenciement économique. Vous souhaitez l'étendre au licenciement survenant à l'expiration d'un CDI de chantier ou d'opération. Je n'y suis pas opposé par principe ; toutefois, dans la mesure où les caractéristiques de ces contrats ont vocation à être définies dans le cadre de l'accord de branche, il me semble plus pertinent que les modalités de cette priorité le soient aussi, en particulier sa durée de validité, que vous fixez dans l'amendement à un an. Je propose donc un sous-amendement en ce sens.
L'amendement que vous proposez tend à instaurer une priorité de réembauche au profit du salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération. Dans la mesure où un tel licenciement suppose que le chantier s'est terminé, votre proposition, si je la comprends bien, vise le cas où un nouveau chantier, correspondant aux qualifications du salarié, est ouvert dans les mois qui suivent par la même entreprise.
L'esprit de l'amendement est intéressant et je n'y suis pas opposée. En revanche, si sa finalité ne pose aucun problème, tel n'est pas le cas de sa rédaction. Le droit actuel prévoit une priorité de réembauche uniquement en cas de licenciement économique. Or un CDI de chantier, dont le terme naturel est la fin du chantier, ne s'achève pas à proprement parler par un licenciement.
Cela étant, l'objectif consistant à réinsérer un nombre maximal de salariés dans l'emploi est positif et le sous-amendement présenté par M. le rapporteur permet de renvoyer ses modalités particulières aux accords de branche. Il s'agit d'une bonne démarche. En effet, les champs de négociation obligatoirement inclus dans les accords de branches comprennent bien la gestion de la qualité de l'emploi, dont relèvent les contrats de chantier, auquel il faudra donc négocier des contreparties.
L'introduction d'une forme de priorité, par exemple sous la forme d'une clause facultative, est susceptible de constituer une incitation ainsi qu'une bonne base de discussion pour les partenaires sociaux dans le cadre des branches. C'est pourquoi je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée sur ce point.
Le sous-amendement no 384 est adopté.
L'amendement no 344 , sous-amendé, est adopté.

La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement no 345 .

J'allais dire « jamais deux sans trois », mais encore faut-il passer le cap de deux amendements adoptés !
Sourires.

Avec cet amendement de repli, nous proposons de créer des droits nouveaux pour les salariés embauchés en CDI de chantier en leur accordant une prime de fin de contrat à hauteur de 10 % de la totalité de la rémunération totale brute versée, afin de compenser la précarité de leur situation.
Une telle disposition, inspirée de la prime de précarité accordée aux salariés embauchés en CDD, permettrait d'éviter que les employeurs utilisent le CDI de chantier afin de contourner en leur faveur la législation sur les contrats courts, qui paradoxalement peut sembler plus favorable. Elle permettrait donc d'éviter le développement de pratiques d'optimisation sociale dans les secteurs d'activité ayant décidé de recourir aux CDI de chantier ou de projet. Tel est l'objet de cet amendement dont je ne doute pas, monsieur le rapporteur, qu'il retiendra toute votre attention.

L'amendement précédent a déjà retenu toute mon attention, cher collègue. Or celui-ci est un amendement de repli... Vous êtes sans doute plus satisfait de l'attention que nous avons portée au maintien dans l'emploi de ceux qui s'y trouvent que d'une transformation du CDI de chantier en CDD par l'adjonction d'une prime de précarité. Vous comprendrez donc que mon avis soit défavorable.
L'amendement no 345 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Nous abordons une disposition particulièrement régressive en matière de droits des salariés consistant en l'introduction d'un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle collective. Sous prétexte de sécuriser les départs volontaires, il s'agit en réalité d'accorder aux employeurs la possibilité de procéder à des plans sociaux sans s'embarrasser du droit du licenciement économique, comme vous l'avez vous-même admis en commission, monsieur le rapporteur, lors de l'examen de cet amendement, indiquant qu'en prenant cette mesure « il s'agit effectivement d'exclure certains collaborateurs du droit du licenciement économique ».
Lors de leur audition, les organisations syndicales vous ont alerté sur le risque de permettre aux entreprises de se débarrasser des salariés seniors. Vous l'avez vous-même admis, madame la ministre, indiquant en commission qu'il « subsiste surtout [le risque] qu'une entreprise et ses organisations syndicales se mettent d'accord pour un plan de départs de " seniors " dont l'effet se déporterait immédiatement sur l'assurance chômage. »
D'ailleurs, nous sommes inquiets de vous entendre tenir de tels propos, madame la ministre. Si un dispositif présente le risque d'encourager des pratiques de sélection des salariés licenciés, ne le mettons pas en place ! Il contribuera à aggraver la situation du marché de l'emploi des seniors, dont chacun est soucieux sur les bancs de cet hémicycle, j'en suis persuadé. Les garanties prévues en termes de formation et d'accompagnement des salariés visant à encadrer les ruptures conventionnelles collectives sont largement insuffisantes. C'est pourquoi nous demandons le retrait de ces dispositions.

Je voudrais revenir sur l'amendement no 345 présenté tout à l'heure par nos collègues communistes et repoussé, qui procède du même esprit. En réalité, les dispositions qui vont être adoptées feront du CDI de chantier un CDD dépourvu d'inconvénients pour les chefs d'entreprise. Il aura les mêmes effets qu'un CDD, hormis la possibilité d'en allonger indéfiniment la durée, mais sans donner droit à une prime de précarité comme le CDD.
J'en parlais ce matin avec l'un de nos collègues qui défendait l'utilité des CDI de chantier dans certains métiers : je lui ai rappelé qu'il existait déjà, et depuis longtemps, un dispositif permettant de faire face à un surcroît soudain d'activité : les sociétés d'intérim. Il m'a répondu que le recours à ces sociétés coûtait plus cher.
Voilà ce que vous êtes en train de faire en réalité, madame la ministre : vous vous payez le luxe de rendre accessible, sans surcoût pour les chefs d'entreprise, le régime applicable aux emplois très délimités dans le temps ne débouchant pas sur un CDI, qui relevaient jusqu'à présent de l'intérim. De plus, vous faites du CDI, soit le droit commun en matière de contrat de travail, un CDI borné, une sorte de CDD définitif.
Par le biais du CDI de chantier et des autres dispositifs que vous mettez en place, vous continuez bel et bien, sans le dire, à casser les fondements du droit du travail : alors que le CDI était jusqu'à présent la norme, c'est aujourd'hui la précarité totale.
L'amendement no 69 n'est pas adopté.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.
Suspension et reprise de la séance
La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante.

La séance est reprise.
La parole est à M. Laurent Pietraszewski, pour soutenir l'amendement no 249 .

Cet amendement procède à la suppression du seuil d'effectifs de 300 salariés pour la mise en place du congé de mobilité.
Initialement, ce congé était réservé aux entreprises de plus de 1 000 salariés. Dans le cadre des ordonnances, le Gouvernement a fait le choix d'élargir ce dispositif en le rendant accessible aux entreprises d'au moins 300 salariés dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – GPEC. Or, si ces entreprises sont soumises à une obligation de négociation périodique sur la GPEC, rien n'interdit à une entreprise de moins de 300 salariés de conclure un tel accord.
L'idée du Gouvernement était de réserver le congé mobilité aux salariés des entreprises de plus de 300 salariés, par cohérence avec l'obligation de négocier un plan de GPEC. Mais comme les entreprises de moins de 300 salariés peuvent conclure un accord de ce type, il nous paraît logique de supprimer le seuil initialement prévu pour le congé de mobilité – un dispositif, je le rappelle, très protecteur pour les salariés. Avis favorable.
L'amendement no 249 , modifié par la suppression du gage, est adopté.

Cet amendement vise à préciser que l'initiative de l'accord de rupture relève à la fois de l'employeur et des salariés. En effet, on a l'impression que la rupture conventionnelle collective ne sera, dans les faits, enclenchée qu'à l'initiative de l'employeur. Les salariés qui ne supportent plus de travailler dans des conditions inappropriées doivent pouvoir être à l'initiative d'une rupture conventionnelle collective.
L'expression « rupture collective » masque mal un rapport asymétrique. Cette disposition est, pour les chefs d'entreprise, un moyen supplémentaire pour opérer des licenciements collectifs. Notre opposition n'est pas de principe, et c'est pourquoi nous souhaitons réaffirmer la place du salarié dans le processus.
L'amendement no 235 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.


Je n'ai pas le sentiment que, lors des débats antérieurs, nous ayons parlé de la rupture conventionnelle collective, qui apparaît comme l'une des surprises de ces ordonnances.
Cette disposition, qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2018, est un outil de contournement de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. En effet, elle exonère l'employeur de ses obligations de reclassement et prive le salarié de droits essentiels, tels que le contrat de sécurisation professionnelle qui lui permet de percevoir 75 % de son salaire brut pendant un an et de bénéficier d'un accompagnement renforcé.
De plus, contrairement à ce qui est possible dans les plans de départ volontaire, l'employeur peut réembaucher de suite. Les organisations syndicales, unanimes, nous ont alertés sur le fait que ce dispositif menacera fortement l'emploi des seniors ; il risque de fragiliser davantage leur situation et de coûter plus cher encore à l'assurance chômage, qui assurera le rôle d'amortisseur social.
Nous pensons que la rupture conventionnelle collective résulte d'un coup de téléphone des employeurs à la direction générale du travail ; nous en demandons la suppression.

La parole est à M. Jean-Paul Lecoq, pour soutenir l'amendement no 342 .

Permettez-moi de vous lire un extrait particulièrement éclairant du rapport : « La négociation d'un accord portant rupture conventionnelle collective est menée dans un objectif de "suppression d'emplois" : il s'agit bien d'une alternative au plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne requiert donc pas, comme cette dernière, la justification du motif économique ».
Rendez-vous compte ! Après nous avoir expliqué que la seule raison d'être de la rupture conventionnelle collective était de supprimer des emplois, vous osez nous parler de sécurisation. C'est fort de café !
Le droit du travail a été construit pour sauvegarder les emplois et préserver l'activité économique sur notre territoire. Même dans les PSE, l'objectif de sauvegarde de l'emploi existe.
Le dispositif de la rupture conventionnelle collective est révélateur de la philosophie globale de ces ordonnances qui créent un arsenal juridique pour détruire l'emploi. Il vise à contourner la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en exonérant l'employeur de ses obligations de reclassement et en privant le salarié de droits essentiels tels que le contrat de sécurisation professionnelle. Nous en proposons par conséquent la suppression.

Ces amendements visent à supprimer le dispositif de rupture conventionnelle collective. L'objectif d'un tel accord est en effet de se placer en dehors du cadre du licenciement économique, comme vous l'avez relevé l'un et l'autre, puisque dans ce contexte, il n'y a, stricto sensu, pas de licenciement économique. C'est bien non seulement la volonté mais aussi la logique de ces dispositions.
L'accord de rupture conventionnelle collective comporte d'ailleurs des mesures pour faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents. S'il y a reclassement externe, les postes considérés ont été supprimés.
Une entreprise est amenée à s'adapter, à connaître des évolutions. Si un service ferme, si une activité n'est pas maintenue au sein de l'entreprise, …

Cela s'appelle un licenciement économique ! Il faut pouvoir le justifier !

… et que les salariés concernés le souhaitent, il est désormais possible d'organiser ce type de rupture conventionnelle collective. Si ce n'est pas le cas, d'autres dispositions pourront être prises.
Rappelons enfin qu'un cadre juridique est ainsi donné au plan de départ volontaire, jusqu'à présent jurisprudentiel.

Nous parlons souvent ici des patrons voyous, mais tous ne le sont pas !
« Ah ! »sur les bancs du groupe REM.

J'en ai rencontré. Ils ne poursuivent qu'un objectif, en permanence : trouver des marchés, des clients, pour donner du travail à leurs salariés.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe REM.

C'est le sens premier de leur combat, qu'ils mènent sans faiblir. Je pense aux artisans, aux petites entreprises.
En revanche, s'il devient aisé de se séparer du salarié, pourquoi voulez-vous qu'ils s'acharnent autant à procurer du travail, qu'ils continuent à livrer bataille ? Ils accepteront comme une fatalité de ne pas avoir obtenu un contrat, dès lors qu'il leur restera suffisamment de trésorerie pour régler leurs dettes et ne pas mettre en difficulté leur entreprise.
Vous allez créer une autre logique, une autre approche de leur métier par les patrons. En leur « facilitant la vie », entre guillemets, vous ne leur rendez pas forcément service. Demain, ils mettront moins d'énergie à dénicher des clients, et ils engageront moins.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 49 |
| Nombre de suffrages exprimés | 49 |
| Majorité absolue | 25 |
| Pour l'adoption | 7 |
| contre | 42 |
Je présenterai en même temps l'amendement no 376 , qui concerne le même sujet, mais au préalable, je voudrais rappeler le contexte du plan de sauvegarde de l'emploi et de la rupture conventionnelle collective, afin que nous puissions utilement les comparer.
S'agissant tout d'abord des PSE, nous en comptons chaque année environ 700, avec une baisse de 10 % entre 2015 et 2016. Nous verrons si la tendance se confirme en 2017. Les PSE sont à l'origine de 2,5 % des entrées à Pôle Emploi. Si le sujet est important, gardons à l'esprit qu'il ne représente pas la majorité des licenciements ou des motifs d'inscription, bien davantage liés à la précarité qu'au PSE, d'ailleurs.
Les PSE sont très majoritairement le fruit d'accords signés par les syndicats et seuls 5 % d'entre eux font l'objet d'un recours devant le juge – ce qui montre bien qu'un équilibre a été trouvé avec les syndicats sur ce point-là.
Cela étant, il nous semble important et bénéfique, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés, de donner un cadre à ce qui reste, pour le moment, jurisprudentiel : le plan de départ volontaire, que nous avons appelé rupture conventionnelle collective, en référence à la rupture individuelle.
En effet, il est fréquent qu'en cas de réorganisation, d'anticipation, des salariés veuillent faire la démarche. D'ailleurs, les plans de départ volontaire sont très majoritairement sur-souscrits car ils peuvent être l'occasion de changer de carrière, de métier, d'entreprise – et je ne parle en l'espèce que des départs strictement volontaires.
Du côté des entreprises, nous pensons que plus on anticipe les évolutions de l'organisation, plus on négocie à froid afin de conjuguer les besoins d'adaptation avec la sécurisation ou les aspirations des salariés, plus on évite la situation difficile et douloureuse qu'engendre un plan de sauvegarde de l'emploi. Un licenciement économique est toujours difficile à vivre.
Plus l'entreprise anticipe, plus elle permet à ceux qui le souhaitent de décider librement de leur avenir au moment de cette adaptation, mieux on règle dans l'apaisement un certain nombre de cas.
La rupture conventionnelle collective permettra donc de favoriser les départs strictement volontaires, sur la base d'une rupture amiable du contrat de travail, tout en garantissant aux salariés une véritable sécurité professionnelle grâce à des mesures d'accompagnement et de reclassement négociées avec les organisations syndicales.
Ces accords devront comporter des mesures d'accompagnement et de reclassement, notamment, si les partenaires sociaux le souhaitent, le congé de mobilité – disposition adoptée lors de l'examen du texte en commission. Ces accords seront homologués par l'administration, la DIRECCTE, à laquelle nous donnerons des consignes claires. À cette fin, nous vous proposons deux amendements. L'amendement no 367 vise à préciser que l'accord comporte impérativement des mesures d'accompagnement et non pas seulement de reclassement. L'amendement no 376 tend à ce que la DIRECCTE contrôle la pertinence de ces mesures par une homologation préalable, notamment pour éviter ce qui me semble être le seul risque de ce dispositif : sa transformation en une préretraite déguisée, ce qui irait à l'encontre de l'objectif poursuivi.
C'est le seul risque réel, et je donnerai des instructions pour l'éviter. Si des projets dissimulent des plans de préretraite déguisés, ils ne seront pas homologués par l'administration.

Avis favorable à ces amendements qui accompagnent le dispositif de la rupture conventionnelle collective.
L'amendement no 367 est adopté.

La rupture conventionnelle collective doit faire l'objet de garde-fous qui garantissent le plein consentement du salarié. En effet, le risque de voir des accords collectifs bâclés s'imposer aux salariés sans qu'ils aient pu en mesurer les tenants et les aboutissants, est réel. C'est pourquoi nous devons être très vigilants et permettre aux salariés de pouvoir se rétracter quinze jours après avoir signé l'accord de rupture conventionnelle collective.
À partir du moment où l'on facilite la rupture, on doit, dans le même temps, offrir des garanties supplémentaires pour que le consentement de chaque salarié soit pleinement éclairé.

Je vous invite à le retirer : un amendement que nous avons adopté en commission tend en effet à modifier le texte de l'article L. 1237-19-1 du code du travail en précisant que l'accord portant rupture conventionnelle collective détermine « les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ». Une telle disposition, qui figure désormais à l'alinéa 12 de l'article 6 du présent projet de loi, devrait vous satisfaire.
L'amendement no 112 est retiré.

J'ai apprécié les propos de M. Lecoq, qui a reconnu l'attachement des patrons à leurs salariés. En cas de situation difficile, la rupture conventionnelle collective est désormais une solution possible.
Par ailleurs, nous partageons les propos de Mme la ministre concernant l'accompagnement, sur deux points au moins, que j'ai relevés en commission. Tout d'abord, le salarié, même en cas de refus, car il peut avoir ses raisons, doit être accompagné dans sa démarche.
Par ailleurs, la DIRECCTE doit valider, non l'accord, mais le contenu de l'accord. C'est essentiel pour sécuriser le dispositif et éviter que ces plans ne soient en réalité des « plans seniors » déguisés.
Mon amendement est assez proche de celui du Gouvernement auquel je me rallie, en retirant le mien.
L'amendement no 18 est retiré.
L'amendement no 376 , accepté par la commission, est adopté.

L'ordonnance no 2017-1387 donne aux services de l'État un délai de quinze jours pour homologuer un accord collectif de rupture conventionnelle. Or, compte tenu de leurs moyens très limités, les DIRECCTE ne seront pas en mesure, dans un temps aussi court, de contrôler correctement la conformité des accords à l'article L. 1237-19 du code du travail. Nous proposons donc de le porter à un mois, ce qui serait plus raisonnable. Il ne s'agit pas de compliquer la vie des entreprises, mais d'assurer la bonne application du droit et le respect des garanties offertes aux salariés.

Avis défavorable. Je doute que ce soit la bonne manière d'appréhender le sujet. Autant je comprends vos craintes, autant je pense qu'il ne faut pas faire preuve d'une défiance excessive. En effet, la rupture conventionnelle collective est un dispositif qui s'intègre à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il doit permettre d'anticiper les réorganisations et les restructurations. Dans l'hypothèse où un tel dispositif ne permettrait pas de maintenir la compétitivité de l'entreprise, je ne pense pas qu'il faille empêcher celle-ci de mettre en place un PSE en aval.
L'amendement no 241 n'est pas adopté.

Cet amendement vise à revenir au droit existant, à savoir : la durée maximale du contrat à durée déterminée est fixée à dix-huit mois ; l'accord de branche, sur ce sujet, doit être obligatoirement plus favorable au salarié.
L'amendement no 64 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
Rappel au règlement

Je comprends que tout le monde soit pressé de faire ratifier ces ordonnances mais le vote doit avoir lieu à main levée ou par assis et levé. Cela suppose, monsieur le président, que, sur chaque vote, vous preniez la précaution de regarder quels sont ceux qui lèvent la main et ceux qui ne la lèvent pas, et que nous ayons le temps de le faire.
Sourires.
Article 6

La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour soutenir l'amendement no 99 .

La liberté d'entreprendre et d'organiser son activité m'est chère. Cet amendement vise à laisser à la négociation d'entreprise le soin de préciser les conditions de recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire ainsi qu'aux contrats à durée indéterminée de chantier, afin de faciliter l'organisation des entreprises et ainsi favoriser leur compétitivité et leur réactivité.

Avis défavorable. Le choix a été fait de confier à la branche, et non à l'entreprise, la négociation sur les conditions de recours aux CDD.
L'amendement no 99 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Sur l'amendement no 284 , je suis saisi par le groupe Nouvelle Gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Boris Vallaud, pour soutenir cet amendement.

Vous permettez aux partenaires sociaux de déterminer, sans fixer de plafond, la durée du CDD, un contrat destiné à pourvoir un emploi par nature temporaire. C'est tout à fait contradictoire.
À défaut d'accord, la durée maximale sera de dix-huit mois. Vous incitez ainsi les partenaires sociaux à négocier la précarité en leur suggérant d'étendre au-delà d'un an et demi la durée du CDD. Quelle drôle de vision du dialogue social !
Nous proposons de rétablir un plafond légal de vingt-quatre mois, une durée déjà très conséquente.

Avis défavorable. Cet amendement illustre notre désaccord de fond : nous avons toute confiance, pour notre part, dans les partenaires sociaux qui négocieront, au niveau de la branche, les règles adaptées au secteur d'activité concerné. N'oublions pas que les accords de branche sur le recours aux CDD doivent avoir été négociés avec les organisations syndicales de salariés représentatives. Il s'agit bien d'une norme négociée et non d'un cadre qui serait fixé unilatéralement par les organisations patronales de la branche. Faisons le pari du dialogue social, cher collègue !
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 49 |
| Nombre de suffrages exprimés | 49 |
| Majorité absolue | 25 |
| Pour l'adoption | 8 |
| contre | 41 |
L'amendement no 284 n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour soutenir l'amendement no 100 .

Dans la fonction publique, les contrats à durée déterminée sont conclus pour une durée maximale de trois ans et renouvelables une fois.
Les contrats de courte durée peuvent faire l'objet d'abus lorsqu'ils sont utilisés par les salariés en alternance avec des périodes de chômage indemnisées. Ce n'est pas possible avec les contrats longs, dont l'État fait cependant, de son côté, un usage abusif caractérisé, ainsi qu'en attestent les condamnations prononcées à son encontre pour des renouvellements quasi-perpétuels. On a déjà vu des contractuels passer quinze ans dans des préfectures.
Une durée totale de six ans – une période de trois ans renouvelable une fois – , si elle était respectée, serait satisfaisante, y compris dans le secteur privé.

Cet amendement a été repoussé par la commission. Cher collègue, comparaison n'est pas raison. Il n'y a pas lieu de se féliciter de la précarité durable dans la fonction publique.
L'amendement no 100 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.


Aujourd'hui, un CDD ne peut être renouvelé que deux fois. Votre texte prévoit de supprimer cette limite. Ce faisant, il établit l'instabilité permanente de la vie au travail.
On peut, certes, discuter de la nécessité d'introduire une plus grande souplesse dans la procédure d'embauche. Mais vous proposez un bouleversement radical de la législation du travail en substituant à un travail stable un enchaînement de contrats précaires.
Nous proposons donc une nouvelle rédaction pour l'article L. 1243-13, débutant par la phrase suivante : « Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée ».

La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir le sous-amendement no 391 .

Avis défavorable au sous-amendement comme à l'amendement. Cette question relève de la branche. À défaut d'accord entre les partenaires sociaux de la branche, les dispositions supplétives restent en vigueur, ce qui devrait vous rassurer.
Le sous-amendement no 391 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'amendement no 260 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Cet amendement vise à rétablir les dispositions antérieures aux termes desquelles un salarié n'ayant pas reçu son contrat de travail dans les deux jours suivant son embauche voyait son contrat automatiquement requalifié en CDI. En remettant cette règle en cause, les ordonnances vont en effet permettre à l'employeur la de s'abstenir de fournir un contrat de travail pendant une longue période, sans risquer la requalification.
Il est particulièrement préjudiciable pour un salarié de ne pas disposer rapidement de son contrat de travail. Le risque est que l'employeur, en différant la remise du document, puisse ajuster unilatéralement les termes du contrat de travail signifiés oralement, ce qui instaure un rapport de force malsain. De son côté, le salarié peut commencer à travailler sans avoir connaissance du contenu de son contrat.
Il n'y a aucune raison valable de retirer une telle irrégularité de la liste des cas dans lesquels un contrat est automatiquement requalifié en CDI. C'est la protection minimale que nous devons au salarié.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Les règles, strictes mais pas insurmontables, qui régissent la conclusion d'un CDD, ne sont pas fixées pour le plaisir de contraindre l'employeur mais pour protéger les salariés titulaires de contrats précaires. Qui dit contrat précaire, dit aussi souvent premier poste dans une entreprise. Or chacun sait qu'un salarié qui occupe son premier emploi n'est pas forcément très à l'aise. Précisément parce que le contrat est précaire et dérogatoire au droit commun, les salariés doivent avoir connaissance de ses clauses, et cela, dès la signature.
L'article 4 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail instaure un droit à l'erreur pour l'employeur en cas d'irrégularité de procédure dans la conclusion d'un CDD ou d'un contrat de mission. Il efface ainsi d'un trait de plume une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, en vertu de laquelle en l'absence de transmission du CDD dans les quarante-huit heures, le salarié devait être considéré comme étant embauché en CDI. J'en sais quelque chose, puisque c'est ainsi que j'ai commencé ma vie professionnelle.
Ce mécanisme de retour au droit commun du contrat de travail protégeait le salarié de la négligence de l'employeur dans le meilleur des cas, et de sa mauvaise foi dans le pire. Notre amendement prévoit donc de revenir au droit antérieur.

Cet amendement supprime la disposition aux termes de laquelle l'irrégularité pour non-transmission dans les délais impartis du contrat de mission ne prive plus, à elle seule, le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à une indemnité équivalente à un mois de salaire.
Nous désapprouvons l'instauration d'un tel droit à l'erreur en matière de motivation du licenciement, car il porte préjudice au salarié qui souhaite faire valoir ses droits.

Avis défavorable. Autant la violation de dispositions de fond – portant, par exemple, sur la durée, le renouvellement, ou le terme du contrat – justifie la requalification en CDI, autant, s'agissant d'éléments de forme, la requalification ne me paraît pas normale. L'article 4 de l'ordonnance prévoit donc que le non-respect du délai n'est plus à lui seul constitutif d'une irrégularité justifiant la requalification du contrat.


Nous souhaitons rétablir un délai de recours de deux ans en cas de rupture du contrat de travail. Dans ce domaine, les délais n'ont cessé d'être réduits pour sécuriser les employeurs. Un an nous semble trop court : on se trouverait dans cette situation paradoxale dans laquelle le requérant aurait moins de temps pour monter son dossier que les tribunaux n'en auraient pour l'instruire, puisque certaines procédures en région parisienne durent près de deux ans.
Lorsqu'un salarié est victime d'un licenciement, les conséquences psychologiques peuvent être lourdes. Son premier réflexe ne sera pas forcément de mettre en question la légalité de son licenciement, mais bien « d'encaisser », si vous me permettez l'expression, le choc qu'il vient de subir.
Le fait qu'il faut parfois, aux prud'hommes, deux ans d'instruction avant de rendre une décision nous renseigne sur la complexité de certains dossiers. Et cette complexité est encore plus grande pour un non-spécialiste du droit du travail. Dans ces conditions, pourquoi faudrait-il moins de temps aux requérants pour monter leurs dossiers qu'au juge pour décider ?
L'amendement no 71 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à Mme Bénédicte Taurine, pour soutenir l'amendement no 364 .

Jusqu'à présent, les dispositions des accords de branche devaient être plus favorables aux salariés que le code du travail. Avec les dispositions que vous prévoyez, même un accord d'entreprise moins favorable peut s'appliquer. Nous souhaitons quant à nous protéger les salariés contre les effets de cette inversion de la hiérarchie des normes.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Avis défavorable. Qu'il s'agisse des CDD, des contrats d'intérim ou des contrats de chantier, il convient de donner aux branches la prérogative de négocier avec les partenaires sociaux compétents.

Les partenaires sociaux sont, en effet, qualifiés pour négocier, mais le salarié dans l'entreprise a besoin d'être protégé. Or les ordonnances le privent de cette protection.
L'amendement no 364 n'est pas adopté.

Je tiens à le soutenir, car il est important. Vous instaurez une présomption de conformité aux dispositions d'ordre public pour tous les accords d'entreprise portant sur la mise en oeuvre du travail de nuit.
Il s'agit une fois encore, en empêchant aux salariés de faire valoir leurs droits, de sécuriser les employeurs qui recourent au travail de nuit. Cette disposition nous paraît d'autant plus inadmissible que l'impact du travail de nuit sur la santé est fort bien documenté. Autrefois – à l'époque où l'on se souciait peu de l'égalité entre les sexes – , on disait que le travail de nuit n'était pas bon pour les femmes, pour des questions de santé. On admettait cependant qu'il était parfois indispensable, par exemple dans les hôpitaux.
Le travail de nuit a pour première conséquence d'affecter la vie sociale et la vie familiale. Il perturbe aussi les rythmes biologiques. Ses effets sont avérés sur le risque cancéreux, en particulier pour le cancer du sein, sur l'obésité, le diabète de type 2, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, les performances cognitives et la santé psychique.
Parce qu'il importe moins de sécuriser les employeurs que de protéger les salariés, nous demandons la suppression de cette disposition.

Les dispositions relatives au travail de nuit sont sans intérêt. Plusieurs rapports récents, notamment un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES – , ont montré que le travail de nuit a de graves conséquences sur la santé des salariés… et parfois des députés.
Il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité du travail de nuit dans certains métiers, mais faut-il chercher à le développer ? Quelles difficultés le Gouvernement entend-il résoudre par cette disposition ? En réalité, il ne fragilise un dispositif que pour répondre aux difficultés ponctuelles de quelques commerces de proximité après vingt et une heures dans les grandes villes.

La parole est à M. Michel Castellani, pour soutenir l'amendement no 261 .

Je reprends à mon compte ce qui vient d'être dit. L'article L. 3122-15 prévoit une présomption de bonne foi de l'employeur qui recourt au travail de nuit, dont on vient de rappeler les effets sur la qualité de vie et la santé. Nous y reviendrons dans le cadre d'un autre amendement, car il nous importe de sécuriser le recours au travail de nuit.


Dans la lignée de ceux qu'ont présentés nos collègues, l'amendement tend à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 3122-15 du code du travail, qui instaure la présomption de conformité des accords relatifs au travail de nuit. Ces accords d'entreprise, rendus possibles par la loi El Khomri, permettent des dérogations à l'ordre public, notamment pour la durée du travail de nuit et les modalités de compensation. Ils peuvent donc augmenter le recours au travail de nuit.
Ce mouvement est totalement contraire aux préconisations scientifiques. On vient de le rappeler : selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le non-respect des cycles naturels de repos favorise très nettement l'obésité, le diabète et les maladies cardio-vasculaires. Dans son rapport de juin 2016, l'ANSES préconise un usage limité et exceptionnel du travail de nuit, circonscrit à certains secteurs.
Or, en France, depuis 1991, le nombre des travailleurs ou travailleuses de nuit a augmenté d'un million et le travail de nuit concerne désormais 15 % des salariés.
L'article 32 de l'ordonnance no 2017-1387 entérine ce mouvement puisqu'elle rend plus difficile la contestation des accords relatifs au travail de nuit. En refusant de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 3122-15 du code du travail, la représentation nationale ferait de l'extension indéfinie du travail de nuit à tous les secteurs un mouvement « présumé conforme ».
Une telle décision irait contre le progrès social. J'espère donc, chers collègues, que vous adopterez ces amendements.

Je vais prendre un instant pour répondre aux auteurs de ces quatre amendements, sur lesquels j'émets un avis défavorable. La disposition prévue par l'ordonnance n'a pas vocation à limiter le droit au recours contre les accords collectifs mettant en place le travail de nuit.
Je vous rappelle les termes de l'article L. 3122-1 : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. »
Comme pour la contestation de tous les accords collectifs, l'objectif est de confirmer le principe selon lequel il appartient à celui qui conteste la légalité de l'accord collectif de démontrer que celui-ci n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
Autrement dit, l'intéressé pourra toujours contester que le recours au travail de nuit est justifié, par exemple en arguant qu'il n'y a pas de nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Seulement, il lui incombera de donner les éléments qu'il juge non conformes à ces conditions.

Commençons par rendre hommage à Mme El Khomry et à la précédente majorité, qui vous ont préparé le terrain, car enfin ce sont eux – ne les oublions pas – qui vous ont permis de déréguler le travail de nuit et qui ont aidé les employeurs à y recourir plus aisément.
Quant aux réponses du rapporteur et de la ministre, nous les connaissons. Ils vont encore nous dire que, s'ils facilitent le travail de nuit, ils veillent tout de même à limiter cette facilitation. Tout cela est confondant. Le texte ne vise à rien d'autre qu'à faciliter le travail de nuit. Or, Danièle Obono l'a rappelé, cette position est contraire à toutes les avancées scientifiques, notamment aux études des chronobiologistes. Et surtout, elle constitue un recul terrible par rapport aux avancées sociales. À quel moment allez-vous nous dire qu'il faut travailler dix heures par jour ou, pourquoi pas, qu'il faut faire travailler les enfants ?
Quand cesserons-nous de considérer comme normal que des êtres humains travaillent la nuit ? J'aimerais que nos collègues qui votent de telles dispositions se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, le travail de nuit est possible, à ceci près qu'il est limité et contrôlé. Et vous allez encore le faciliter, au point d'en faire une norme, comme c'est le cas désormais du travail du dimanche. C'est là une pente extrêmement dangereuse. Vous considérez qu'à toutes les heures de tous les jours de la semaine, il est normal que quelqu'un soit à son poste de travail. C'est une façon de penser à laquelle nous nous opposons radicalement.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Je rappelle à nos collègues de la majorité les termes du rapport parlementaire sur la pénibilité au travail, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 2008 : « Les effets nocifs sur la santé du travail de nuit et du travail en horaires alternants sont indéniablement constatés chez les salariés exposés pendant dix ans à cette pénibilité. Le seuil de dix à quinze ans de travail de nuit, avec 200 nuits de travail par an, ou de travail en horaires alternants ou atypiques serait celui au-delà duquel les dégâts sanitaires de cette exposition seraient irréversibles. » Autant que possible, tirons les leçons de ce rapport parlementaire !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 52 |
| Nombre de suffrages exprimés | 52 |
| Majorité absolue | 27 |
| Pour l'adoption | 9 |
| contre | 43 |

Les évolutions enregistrées étaient nécessaires, mais nous souhaiterions obtenir quelques engagements de votre part, madame la ministre sur des points particulièrement sensibles. Quel sera le coût du recours aux services du médecin inspecteur du travail ? Un agent de l'État pourra-t-il se faire rémunérer, alors les services étaient gratuits auparavant ? Enfin, qu'en est-il du secret médical ? En effet, lorsqu'un dossier viendra devant le conseil des prud'hommes, il sera nécessairement soumis aux principes du contradictoire et de l'audience publique. Or, dans ce cadre, des éléments de nature médicale ne pourront qu'être communiqués à la partie employeur, ce qui pose une véritable difficulté. Merci de bien vouloir nous éclairer sur ce point.

Avis défavorable. C'est un sujet que j'ai déjà abordé avec vous en commission, monsieur Vallaud. J'ai d'ailleurs essayé de vous rassurer sur la procédure. Le secret médical sera respecté, puisque seul le médecin inspecteur du travail pourra prendre connaissance des éléments médicaux. Si un employeur souhaitait le faire, il devrait passer par un médecin, qui ne pourrait lui délivrer qu'un avis global.
L'amendement no 199 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'amendement propose de revenir au droit antérieur, en ce qui concerne la prise en charge des frais d'expertise dans le cadre de la procédure de contestation des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail. Par ce biais, le juge, s'il le souhaite, pourra ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, à moins que le conseil de prud'hommes n'en décide autrement.

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir le sous-amendement no 396 .
Monsieur le rapporteur, vous désirez permettre au juge prud'homal de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante. Je partage votre souhait. La rédaction de l'ordonnance est conforme aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ne contient aucune ambiguïté sur cette possibilité : le juge peut ne pas mettre tout ou partie des frais d'expertise à la charge de la partie perdante.
Vous souhaitez cependant modifier cette rédaction, pour indiquer encore plus clairement que le conseil de prud'hommes peut décider de ne pas mettre cette expertise à la charge de la partie perdante. J'émets donc un avis favorable sur l'amendement, puisque nous partageons le même objectif.
Je vous propose toutefois d'ajouter la possibilité pour l'État de fixer par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre du budget le tarif de ces honoraires et frais. L'arrêté fixera notamment le montant des honoraires dus au médecin inspecteur du travail, lequel montant sera forfaitisé dans l'objectif d'éviter les disparités entre juridictions et de limiter le coût de la procédure. Ces honoraires devraient être compris entre 150 et 200 euros.
Il conviendrait d'ajouter à l'amendement la phrase : « Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre du budget. »

Nous traitons ici du sujet important de l'inaptitude. Le droit de l'inaptitude est un droit protecteur, voulu par le législateur. La jurisprudence de la Cour de cassation a imposé avec constance à l'employeur une obligation de reclassement, qu'il remplit dans la limite de ses moyens. Il ne peut procéder à un licenciement que s'il fait la démonstration de l'impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Aujourd'hui, environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon Pôle emploi, près de 64 000 salariés ont été licenciés pour inaptitude physique en 2013 et sont entrés à l'assurance chômage.
L'article L. 4624-7 précise le cadre juridique de la contestation des positions prises par le médecin du travail. Le texte prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur une liste des experts près la cour d'appel.
Historiquement, c'est bien l'employeur qui paie les frais d'expertise au nom d'un principe de gratuité qui permet au salarié de se défendre. Or, vous restreignez encore la possibilité pour le juge de faire peser ces frais sur l'employeur. Nous vous proposons donc de revenir à la rédaction antérieure, qui était plus équilibrée.

J'invite M. Vallaud à se rallier à mon amendement no 288 et à retirer le sien.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 396 du Gouvernement ?
Le sous-amendement no 396 est adopté.

L'article 33 de l'ordonnance prévoit de faciliter le prêt de main-d'oeuvre des grandes entreprises vers les petites, système que je connais bien pour l'avoir vu fonctionner au niveau des clubs de football.
Pendant deux ans au plus, les groupes ou les entreprises d'au moins 5 000 salariés pourront mettre leurs salariés à disposition auprès de jeunes entreprises de moins de huit ans d'existence ou de PME employant au plus 250 salariés. Cette opération sera considérée comme dépourvue de but lucratif, y compris lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux cotisations sociales et aux frais professionnels. Bien !
Or, en commission, monsieur le rapporteur, vous n'avez pas répondu aux questions que nous avons posées sur le fait que le prêt de main-d'oeuvre ainsi proposé serait dépourvu de but lucratif. Une telle disposition pourrait permettre aux grandes entreprises d'externaliser leur main-d'oeuvre dans de petites entreprises qui deviendraient, de fait, leurs sous-traitants, sans qu'elles assument la totalité de la prise en charge des salaires. Cela reviendrait à accroître le pouvoir des donneurs d'ordre sur leurs sous-traitants. C'est du moins ainsi que nous l'analysons. Aussi proposons-nous, par cet amendement, la suppression de cette disposition.

Je pensais vous avoir répondu, mais peut-être n'ai-je pas été assez explicite ou assez clair en commission. Cette disposition ne constitue pas une dérogation au principe du prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, mais seulement à un alinéa de cet article, qui précise les conditions de refacturation. Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif est donc maintenu.
L'amendement no 55 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 23 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche la fixation des règles relatives au renouvellement des contrats à durée déterminée, alors que ce champ relevait auparavant de la loi d'ordre public. Ainsi, les branches ne seront plus contraintes par un nombre maximum de renouvellements. La règle selon laquelle le CDD est renouvelable deux fois ne s'appliquera qu'à défaut d'accord de branche, la loi devenant supplétive. La durée légale du CDD – dix-huit mois – deviendra donc l'exception. Les salariés pourront se voir proposer des contrats de plus de dix-huit mois, renouvelables plus de deux fois, avec des périodes de carence de quelques jours.
Ces dispositions marquent un recul de la loi commune et encouragent une négociation de régression au détriment des protections dont pouvaient bénéficier les salariés, notamment les plus précaires – souvent les femmes et les jeunes – que la loi ne protégera pas. Nous dénonçons fermement ces dispositions qui annoncent l'éclatement des contrats précaires, tout comme nous dénonçons la dialectique ubuesque, répétée comme un mantra à chaque mesure, chaque article, depuis déjà un moment : licencier pour embaucher, fragiliser pour sécuriser.
Pour ces raisons, nous demandons le retrait de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur à la publication des ordonnances.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
L'amendement no 63 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Cela a été dit, un accord de branche étendu peut désormais déroger à certaines dispositions du code du travail applicables aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire. Il est donc possible, en particulier, d'établir des règles spécifiques concernant le délai de carence entre deux CDD successifs sur un même poste, en fonction de la spécificité du secteur d'activité visé. C'est un dispositif sur mesure pour le patronat. Claude Tarlet, patron de l'Union des entreprises de sécurité privée, s'est d'ailleurs réjoui de ces dispositions susceptibles de se traduire par « un allégement du formalisme, un allongement de la durée maximale des contrats et la suppression du délai de carence. » Aucun délai de carence n'est donc plus imposé. En cas de remplacement d'un salarié absent, des CDD successifs pourront être conclus sur le même poste, tant que dure l'absence. Ces règles s'appliqueront aux CDD conclus pour effectuer des travaux urgents, pour les emplois saisonniers, pour les CDD d'usage. Ce n'est qu'à défaut et qu'à titre supplétif que le délai de carence légal s'appliquera.
Ce recul du droit des salariés est inacceptable, car il favorise la négociation à leur détriment. Nous demandons donc le retrait de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur, plus protecteur pour les salariés. Il s'agit simplement de rétablir un principe de base, un principe simple destiné à se prémunir contre la multiplication des CDD successifs – phénomène que notre collègue a décrit précédemment en ce qui concerne l'État – sur un poste relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'amendement no 62 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 26 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche le soin de fixer les règles relatives à la durée des contrats d'intérim. Les branches ne seront ainsi plus contraintes par la durée maximale de dix-huit mois, fixée jusqu'ici par la loi, qui ne s'appliquera plus que de manière supplétive. Comment lire cette mesure sinon comme un encouragement à négocier des accords de régression au détriment des plus précaires ?
Certes, la plupart des entreprises s'assoient aujourd'hui allègrement sur les règles du code du travail, nous le savons, et utilisent des intérimaires sur des postes permanents, nous le voyons tous les jours. Vous leur proposez de le faire désormais en toute légalité. Vous donnez ainsi satisfaction au syndicat des entreprises de travail temporaire, qui réclamait depuis des années de faire sauter la durée maximale de dix-huit mois pour une mission d'intérim. Nous ne saurions vous suivre sur ce chemin de la satisfaction des revendications patronales les plus régressives.
Madame la ministre, si vous venez dans ma bonne ville du Havre, nous aurons peut-être l'occasion de visiter l'usine Renault de Sandouville qui fabrique les Trafic, mais sans doute la connaissez-vous déjà.

Plus de 1 200 salariés y travaillent en CDD pendant dix-huit mois, avant de s'arrêter six mois et de retravailler dix-huit mois, et ainsi de suite. La précarité s'étend, alors que la production ne varie pas et que l'on pourrait employer ces salariés en CDI.

Avis défavorable. Nous débattons depuis le début de la possibilité offerte aux accords de branche d'adopter certaines dispositions.
L'amendement no 61 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Il s'agit ici de revenir sur l'article 27 de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, qui confie à la négociation de branche la fixation des règles relatives au renouvellement des contrats d'intérim sur un même poste, alors que ce champ relevait auparavant de la loi d'ordre public. On l'a dit, et on le répétera autant que nécessaire, en laissant la liberté aux branches de fixer le nombre de renouvellements possibles des contrats d'intérim, ce dispositif accroîtra la précarisation des salariés. Le Gouvernement encourage ainsi le modèle de l'employeur qui utilise – et non emploie – les salariés.
En permettant d'assurer une adéquation presque immédiate entre le nombre de salariés et le niveau de production, comme c'est le cas dans l'usine automobile dont je vous ai parlé, l'intérim fait depuis longtemps figure d'instrument par excellence de la flexibilité, mais il permet aussi au patronat d'encourager le processus d'émiettement des collectifs de travailleurs, de fractionnement, d'éparpillement des salariés dont les intérêts sont ainsi moins défendus. C'est ce que nous constatons dans l'usine de Sandouville. Nous demandons donc le rétablissement du droit antérieur à la publication des ordonnances.
L'amendement no 60 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'amendement no 59 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

La question de l'accès au droit est un enjeu fondamental, notamment pour les petites entreprises qui n'ont ni direction des ressources humaines ni service juridique. Il s'agit là de l'une des nombreuses inégalités entre les grandes et les petites entreprises, et cette inégalité est le terreau de la critique actuelle du droit du travail, dépeint comme étant illisible, trop lourd, excessivement compliqué, qui vient essentiellement des patrons des petites entreprises. Le droit du travail est et restera complexe pour ceux qui doivent et devront l'appliquer.
La question est d'autant plus cruciale que vous avez décidé de renforcer considérablement les normes décentralisées, et tout particulièrement la négociation d'entreprise. Mais les dispositions que vous nous proposez ne nous semblent ni satisfaisantes ni à la hauteur des enjeux que je viens d'évoquer.
Vous proposez, dans un premier temps, la mise en place avant 2020 d'une version numérique du code du travail, oubliant l'existence du site Legifrance, auquel nous nous référons tous. Et vous proposez, dans un second temps, la mise en place d'un rescrit social, en permettant à la personne de bonne foi de se prévaloir d'informations dont on ne sait toujours pas qui les fournira.
Instaurer un rescrit social n'est pas chose facile. Je vous rappelle que, dans la loi d'août 2016, l'article 61 prévoit déjà que tout employeur d'une entreprise de moins de 300 salariés a le droit d'obtenir une information précise, dans un délai raisonnable, lorsqu'il sollicite l'administration sur l'application d'une disposition de droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables. Nous aimerions d'ailleurs savoir, madame la ministre, monsieur le rapporteur, où nous en sommes de la mise en oeuvre du service public territorial de l'accès au droit prévu par ce même article.
Vous le voyez, mes chers collègues, ce chapitre répète, au mieux, des dispositions législatives déjà adoptées qui n'attendent que d'être mises en oeuvre et, au pire, constitue un simple affichage politique sur un sujet qui mériterait une attention beaucoup plus grande de notre part. Il paraît bien plus important de réaliser au préalable un diagnostic de l'existant, notamment des points d'accès au droit, de l'inspection du travail, des commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui ont également pour mission de « donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ». Ce diagnostic doit également porter sur les expériences étrangères, notamment celle des États-Unis, qui ont, depuis 1953, une administration entière consacrée aux petites entreprises, qui leur réserve un service d'accès au droit.
Nous demandons donc la suppression de ce chapitre, et nous vous proposons, madame la présidente de la commission des affaires sociales, de mettre en place un groupe de travail spécifique qui traiterait de la question de l'accès au droit en matière sociale.

La suppression du code du travail numérique ne me paraît pas être la bonne solution. Avis défavorable.
Je suis étonnée de cette proposition. Je pense qu'il s'agit d'un malentendu, car nous avons précisément pour objectif de franchir une étape supplémentaire dans la connaissance des droits. Legifrance présente le droit « à plat », qui est très utile aux avocats, députés, administrateurs et autres experts. Mais notre ambition, qui est très élevée, consiste à mettre en place un code du travail numérique qui permettra au patron d'une petite entreprise, à un salarié de savoir ce que dit la loi, ce que dit la convention collective à propos d'une question posée sous forme de mots-clés, tels que « temps de travail, bâtiment ». Nous voulons offrir un service interactif, « à main », en langage compréhensible par tous. Un amendement avait d'ailleurs été présenté au Sénat visant à ce que le droit soit accessible aux usagers, quel que soit leur handicap, et que ce service rapproche le citoyen du droit. Nous devrions tous être d'accord, et j'espère que vous retirerez votre amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

Madame la ministre, je ne peux m'empêcher de réagir à votre souhait de rapprocher du droit les citoyens et les chefs d'entreprise. Factuellement, vous avez fait exactement le contraire : vous avez mis en place tout récemment une plateforme qui permet aux patrons hors-la-loi de consulter les plafonnements des dommages et intérêts à verser en cas de licenciement.

Beaucoup de chefs d'entreprise attendent un outil offrant cette simplicité, et un grand nombre de personnes y trouveront un intérêt. En discutant sur le terrain avec les chefs d'entreprise et certains salariés, nous avons constaté que c'était vraiment attendu. Il y a donc tout lieu de s'en féliciter.
L'amendement no 176 n'est pas adopté.


La création du code numérique ne peut que faciliter la recherche d'informations, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés. Il convient cependant de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, et notamment les accords d'entreprise et les accords d'établissement. Tel est l'objet de cet amendement.
Je saisis cette occasion, madame la ministre, pour vous solliciter au sujet de l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux groupements d'entreprises de moins de 300 salariés, qui avait été adopté dans la loi travail de 2016, ainsi qu'avec la base de données nationale supposée assurer la publicité des conventions et accords de branche, de groupe, mais aussi des accords interentreprises, d'entreprise et d'établissement signés depuis le 1er septembre 2017. Il s'agit de savoir si ce code du travail numérique a vocation à être une base de données ou à faire office de rescrit, et, dans ce dernier cas, je souhaiterais connaître les conditions d'application du dispositif.


L'avis est favorable sur l'amendement, sous réserve de l'adoption du sous-amendement. Votre amendement pourrait paraître satisfait, cher collègue Cherpion, car la notion de « dispositions conventionnelles » regroupe évidemment tous les accords collectifs conclus à tous les niveaux, celui de la branche, de l'entreprise, mais aussi de l'établissement. Cela étant, ces accords n'ont vocation à être intégrés au code du travail numérique que s'ils font, par ailleurs, l'objet d'une publication : tel est l'objet de mon sous-amendement.
Monsieur le député, je suis évidemment favorable à votre amendement, qui va dans le sens que nous souhaitons. Je pense que le code du travail numérique est très attendu, et le fait de préciser son champ d'application en mentionnant les termes « de branche, d'entreprise et d'établissement » est utile. Néanmoins, je me rallie également au sous-amendement, pour une simple raison : les partenaires sociaux ne souhaitent pas forcément qu'un accord d'entreprise soit publié, et il est difficile de rendre public quelque chose qui n'est pas publié.
Pour répondre à votre deuxième question, la base de données des accords signés depuis le 1er septembre a été ouverte jeudi dernier. En début d'après-midi, 144 accords y étaient publiés.
Le sous-amendement no 394 est adopté.
L'amendement no 17 , sous-amendé, est adopté.

Cet amendement est à mettre en rapport avec le no 176. En cas de litige, vous proposez de présumer la bonne foi de l'employeur, qui pourrait se prévaloir d'une sorte de certification de bonne foi.
En juillet dernier, vous nous avez indiqué, madame la ministre, que ce droit à l'erreur prendrait la forme d'une sorte de rescrit social. Dans la première version de vos ordonnances, vous aviez d'ailleurs prévu un décret fixant les conditions de cette présomption simple. Nous vous proposons de réintroduire ce renvoi au décret, qui nous semble indispensable pour la clarté du dispositif.
Je note, d'une part, qu'aucune évaluation de l'impact de ce dispositif, notamment pour les finances publiques, n'a été conduite. D'autre part, cette question du droit à l'erreur aurait plutôt eu sa place dans le projet de loi « pour un État au service d'une société de confiance », qui sera bientôt présenté devant notre assemblée.

Mon avis est défavorable, cette présomption de bonne foi étant pour moi assez claire. Mme la ministre voudra peut-être expliciter cette notion.
Lorsque le code numérique sera disponible, les employeurs et les salariés pourront y trouver des réponses à leurs questions. Cette consultation numérique sera générale pour toutes les informations publiques. Dans ce cadre, on considère qu'il y a une bonne foi de l'usager. En effet, s'il a trouvé une information sur un site public, il faut présumer de sa bonne foi. Cette information est corrigée ensuite si elle se révèle inexacte, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir utilisé une information publique. Il s'agit d'ailleurs d'une démarche générale qui ne concernera pas que le code du travail numérique.
L'amendement no 177 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Michel Castellani, pour soutenir l'amendement no 263 .

Nous désirerions compléter l'article 1er de l'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail par un alinéa disposant que les services de l'État s'assurent de la couverture numérique sur l'intégralité du territoire afin d'assurer l'accessibilité du code du travail numérique à tous.
Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur le grand attrait du code du travail numérique, mais tous les salariés ne travaillent pas en centre-ville ou dans des territoires bénéficiant d'une forte couverture numérique. Nous désirerions sécuriser concrètement ce travail numérique à travers cet amendement.
Nous nous soucions également d'aménagement du territoire, et cet amendement marque notre préoccupation et notre sollicitude pour les zones rurales à faible densité de population.

Cette préoccupation est liée à la fracture numérique, sujet qui réapparaît à chaque fois qu'il est question d'un enjeu numérique, ce qui est bien compréhensible. J'émets un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, car on ne doit pas traiter cette question dans les ordonnances. Peut-être la ministre nous dira-t-elle un mot de la politique numérique du Gouvernement.
Ce sujet ne relève évidemment pas du code du travail, mais la politique d'aménagement du territoire sur le plan numérique est essentielle. Il s'agit d'un levier de citoyenneté, d'accès au droit et de développement économique. Deux questions au Gouvernement ont porté sur ce thème, et un grand plan d'accélération de la couverture numérique dans l'ensemble du territoire est déployé. Le but est de vous répondre positivement le plus vite possible.
L'amendement no 263 n'est pas adopté.
Compte tenu de l'adoption par l'Assemblée nationale du principe de non-compensation des exonérations sur le congé de mobilité dans le cadre d'un amendement gouvernemental au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, je suis favorable à la suppression de l'alinéa 20 de l'article 6 du projet de loi de ratification, qui prévoit que la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Il s'agit donc de lever le gage.
L'amendement no 366 , accepté par la commission, est adopté.
L'article 6, amendé, est adopté.

Je suis saisi de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 6.
La parole est à M. Jean-Paul Lecoq, pour soutenir l'amendement no 36 rectifié .

Les reprises des TPE et PME par des fonds d'investissement ou d'autres actionnaires peu soucieux de l'emploi se multiplient et provoquent des dégâts colossaux. En tant qu'élus, nous sommes tous confrontés à ces dégâts et nous devons gérer les conséquences des fermetures d'entreprises dans nos circonscriptions. Notre amendement, qui vise à maintenir les entreprises et leurs emplois dans nos localités, devrait donc être unanimement partagé.
Il crée un droit nouveau pour les salariés : le droit de préemption. Ce droit répond à un besoin essentiel et ne porte atteinte ni au droit de propriété, ni à la liberté d'entreprendre. Comme l'indique le Conseil constitutionnel, « Il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées [… ] ainsi qu'à [… ] la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. ». La Constitution protège le droit de chacun à avoir un emploi, le combat contre le chômage et les délocalisations constituant un objectif d'intérêt général indiscutable.
Le droit de préemption que nous proposons respecte le propriétaire, qui n'est ni exproprié ni spolié de son bien, et qui vend toujours parce qu'il le veut et au prix qu'il souhaite. Le propriétaire reste libre et n'est jamais contraint. L'atteinte au droit du propriétaire est donc proportionnée. En outre, ce droit de préemption est encadré, car seuls les salariés de l'entreprise peuvent s'en porter acquéreurs, et à la condition qu'elle compte moins de 250 employés. Ce droit trouve donc son fondement dans les alinéas 5 et 8 du préambule de la Constitution de 1946.
L'intérêt général de ce projet est double : maintenir l'emploi et conserver l'activité économique dans les territoires. Au moment où les maires de France tiennent leur congrès, l'ensemble des élus des territoires de la République saura apprécier cet amendement. Nous vous proposons de permettre, par un vote unanime, à ces TPE et PME d'être reprises par leurs salariés dans le cadre de ce droit de préemption.

Nous n'avons pas encore abordé ce thème, assez technique, dans notre discussion. Cet amendement vise à instaurer un droit de préemption des salariés dans le cadre d'une cession d'une entreprise de moins de 250 salariés. Il semble assez décorrélé de nos débats, cher collègue, puisqu'il porte exclusivement sur des dispositions figurant dans le code du commerce.
Vous proposez d'instaurer un droit de préemption des salariés pour formuler, si je vous ai bien compris, une offre de reprise en cas de vente ou de cession de parts majoritaires d'une entreprise de moins de 250 salariés. Il existe déjà un dispositif, instauré par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui prévoit l'obligation préalable d'information des salariés en cas de vente de leur entreprise. Ce dispositif ne s'applique, pour des raisons légitimes, que dans les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros ou dont le total du bilan est inférieur à 43 millions d'euros.
Aller plus loin sous la forme d'un véritable droit de préemption me semble problématique sur le plan juridique, notamment au regard de la liberté de commerce et d'industrie. Que les salariés soient informés en amont pour leur laisser la possibilité de constituer une offre est une bonne chose ; qu'un droit de priorité leur soit donné sans considération de la nature de leur offre me paraît outrepasser les possibilités offertes par notre droit. Voilà ce qui explique mon avis défavorable.

J'entends bien la réponse du rapporteur, mais elle n'est pas suffisante, et j'incite vraiment mes collègues à bien mesurer l'enjeu de cet amendement.
Vous connaissez tous l'exemple de Fralib, car il s'est souvent invité dans cet hémicycle au cours des dix dernières années. Les salariés de Fralib ont racheté leur entreprise, mais cette reprise a été compliquée. En effet, celui qui souhaitait se séparer de l'entreprise voyait dans le rachat par les salariés l'arrivée d'un concurrent et ne voulait donc surtout pas que cette opération se fasse.
En créant ce droit de préemption, le législateur permettrait à nos territoires et aux salariés de défendre leurs emplois, leur proximité et leur savoir-faire. Et s'il y a concurrence, c'est qu'il y a un marché ! Ce sont des mots que vous entendez, chers collègues de la majorité ! Un acteur a envie de mener son activité dans un autre pays, et cet amendement offre la possibilité à un autre acteur de la conduire chez nous, afin que les salariés et la richesse produite par l'entreprise restent dans ce territoire. Monsieur le rapporteur, je vous invite vraiment à inscrire dans cette loi relative au travail et à l'emploi, et non dans la loi commerciale, la possibilité pour les salariés de faire valoir un droit de préemption. Cela me paraît totalement justifié.
L'amendement no 36 rectifié n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon, pour soutenir l'amendement no 270 .

L'amendement concerne la rémunération des stagiaires, sur la situation desquels je voudrais appeler votre attention, mes chers collègues. La législation qui encadre leur rémunération est, à mon sens, totalement arbitraire et inique. Elle distingue entre les stages d'une durée inférieure ou supérieure à deux mois. Les personnes qui font moins de deux mois de stage ne sont pas obligatoirement rémunérées. Pourquoi donc ? Nous considérons que tout travail mérite salaire.
La France insoumise s'inquiète du recours de plus en plus massif aux stages non rémunérés dans l'économie française. De plus en plus d'entreprises utilisent des stagiaires comme main-d'oeuvre à bas coût pour remplacer un poste de salarié. Il s'agit évidemment d'un abus au regard de la loi, mais ces abus sont très rarement condamnés. Ce phénomène est néfaste pour notre économie et pour la formation des élèves ou des étudiants en stage.
Nous proposons donc que les stages soient rémunérés dès le premier jour pour mettre fin à cette situation inacceptable.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

La question de l'indemnisation – c'est le terme idoine – des stagiaires est importante. Cher collègue, comme pour la proposition de M. Lecoq, le rapport de votre amendement au texte est discutable, et je pense qu'il concerne davantage le code de l'éducation que celui du travail.
Nous devons nous poser la question de l'avenir que nous proposons à nos jeunes, ces derniers devant se former aussi dans des périodes de stage. Les conditions d'indemnisation des stages de plus de deux mois existent ; les dispositions sont claires et sont en partie dues à notre collègue M. Gérard Cherpion, ici présent. Je serai attentif aux évolutions que l'on pourrait mettre en oeuvre dans ce domaine, mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Mon avis est donc défavorable.
L'amendement no 270 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
Cet amendement concerne les bonus des traders – sujet intéressant. Il a deux objets. Tout d'abord, il propose d'exclure ces bonus de l'assiette de l'indemnité légale de licenciement et des éventuels dommages et intérêts que les traders pourraient obtenir aux prud'hommes. Vous savez que la part des bonus dans leur rémunération, quoique volatile, est extrêmement importante. Pour l'attractivité de la place de Paris dans le contexte du Brexit et pour la justice sociale, il nous paraît préférable d'exclure ces bonus de l'assiette de l'indemnité légale de licenciement et des éventuels dommages et intérêts.
L'amendement vise, ensuite, à favoriser une approche de moyen et de long terme des placements. Un débat public important avait eu lieu sur ce sujet, il y a deux ou trois ans. L'idée est de pouvoir récupérer les bonus des traders en cas de résultat de placement négatif à long terme. Il s'agirait d'une sorte d'avance que l'employeur pourrait récupérer si le placement ne s'est pas avéré pertinent. Cela permet de privilégier le moyen et le long terme au détriment du court terme. Pour l'instant, la reprise d'une partie du bonus est juridiquement perçue comme une sanction financière. Avec cet amendement, nous souhaitons autoriser les employeurs des traders à faire ce que l'opinion publique leur a demandé, à savoir encourager la vision à moyen et long terme des placements et sanctionner l'approche à court terme.
Ces deux évolutions vont dans le sens d'une bonne régulation financière et de ce que l'opinion publique souhaite.

On peut, en effet, s'interroger sur la valorisation des bonus des traders, et je partage votre avis sur le sujet, madame la ministre. Je m'inquiète toutefois que ce soit l'occasion pour certains de minimiser la part du salaire et d'augmenter celle du bonus. Il faut être très prudent sur ce point.
Je précise qu'il y a aujourd'hui 3 000 à 4 000 traders en France. Dans ce secteur, la part du bonus dans la rémunération est traditionnellement plus importante que celle du salaire. En retirant le bonus de la base servant au calcul de l'indemnité de licenciement, nous allons dans l'autre sens.
Cette mesure aura également un autre effet. Vous avez appris comme moi la bonne nouvelle de l'installation prochaine à Paris, après le Brexit, de l'agence en charge de la régulation bancaire européenne, dont la dénomination exacte m'échappe à l'instant. Le montant démesuré des indemnités de licenciement perçues par les traders faisait jusqu'alors l'objet de réserves. Le fait de sortir les bonus de la base de calcul de ces indemnités, qui sera perçu positivement par l'opinion comme une mesure de justice, est aussi un facteur d'attractivité pour notre territoire. Cette spécificité française était en effet mal comprise, car il en va différemment dans d'autres pays. Cette mesure jouera donc dans le bon sens.
L'amendement no 372 est adopté.

La parole est à Mme Nicole Sanquer, pour soutenir l'amendement no 276 .

Cet amendement vise à ce que la rémunération des salariés sous contrat vendanges soit calculée sur l'ensemble de la période couverte par le contrat et fasse l'objet d'un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat, de façon que le paiement de la rémunération soit effectué au plus tard le lendemain du dernier jour du contrat.
Aujourd'hui, la situation est en effet complexe : lorsque le contrat vendanges est à cheval sur deux mois civils, les règles actuelles conduisent à l'établissement de deux bulletins de paie et à un calcul différencié des charges sociales pour chacun d'eux. Compte tenu de la durée réduite des contrats vendanges, cette obligation est source de complexité pour l'employeur, contraint d'établir un bulletin de paie en pleines vendanges, puis un second en fin de vendanges, sans utilité réelle pour le salarié.
Par cet amendement, nous souhaitons alléger les contraintes imposées à l'employeur.

Je prendrai quelques instants pour donner l'avis de la commission, car ce sujet, très spécifique, n'a pas été abordé jusqu'à présent.
Je comprends le problème qui se pose pour l'embauche des vendangeurs, même si ce n'est pas mon domaine de spécialité. Les salariés sont généralement employés dans le cadre de contrats courts d'un mois durant la période des vendanges, par exemple du 15 septembre au 15 octobre, ce qui contraint leurs employeurs à éditer deux bulletins de salaire et à procéder au calcul des charges sociales sur deux mois incomplets.
Cette problématique n'est pas propre aux vendangeurs, et peut concerner d'autres saisonniers dans d'autres secteurs. Je ne suis pas d'avis de modifier les règles relatives à l'édition du bulletin de salaire et au calcul des charges selon les spécificités et les besoins de chaque activité. On serait alors confronté à une multitude de situations, et il serait difficile de justifier que les vendangeurs bénéficient de ce traitement et pas les assistantes maternelles, par exemple. Je pense, en outre, à la complexité de gestion que cela augurerait pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les URSSAF. L'avis sera donc défavorable.
Vous vous faites sans doute l'écho de difficultés rencontrées par les vignerons. Cela étant, même si c'est la pratique la plus fréquente, il n'est nullement exigé que le mois civil constitue la période de référence d'une feuille de paie. Il est d'ailleurs fréquent que des périodes de paie soient arrêtées entre le 20 et le 25 du mois et couvrent l'emploi depuis le mois précédent afin de verser le salaire à la fin de chaque mois.
Il n'est donc pas nécessaire de modifier la législation du travail sur ce point. J'appellerai néanmoins l'attention de mes collègues en charge de l'agriculture et de la protection sociale sur cette difficulté, afin que l'information soit plus accessible sur ce sujet qui n'est pas connu des employeurs. Je vous invite, par conséquent, à retirer votre amendement.
L'amendement no 276 n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon, pour soutenir l'amendement no 357 .

Dans l'enquête du magazine Cash Investigation sur l'enseigne de grande distribution Lidl, beaucoup ont pu découvrir que les cadences de travail infernales pouvaient mener à des situations incroyables. Du fait de ces cadences à la limite du soutenable, certains travailleurs n'ont pas même le temps de se dire bonjour. Je profite d'ailleurs d'avoir la parole pour saluer les journalistes de ce magazine pour leur travail, qui est nécessaire pour éclairer les consciences sur de nombreux sujets. En particulier, j'apporte tout mon soutien à Élise Lucet dans son travail, exemplaire, contre ceux qui cherchent à la faire tomber.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Mes chers collègues, tout le monde dans cet hémicycle glorifie le dialogue social, avec plus ou moins de sincérité, mais quel type de dialogue peut exister lorsque deux collègues n'ont même pas le temps de se saluer, de tisser des liens ? Si nous voulons que le travail soit réellement émancipateur, nous devons garantir le lien social entre les salariés. Le droit à la relation sociale du travail : tel est l'objet de cet amendement.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Cet amendement me paraît tout de même un peu étrange, chers collègues, même si je comprends votre objectif. Inscrire dans la loi une obligation de relation sociale a de quoi interpeller. Si des salariés soumis à des cadences « infernales », comme vous dites, ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment de relations sociales avec leurs collègues et leur manager ou leur employeur, je ne vois pas en quoi le fait de prévoir dans la loi de telles relations pourrait les aider. Les relations sociales sont des interactions que les individus établissent entre eux. Je ne vois pas comment on pourrait contraindre les uns et les autres à entretenir des relations sociales.
Cela dit, et je vous rejoins sur ce point, la dimension humaine est primordiale dans les relations de travail, et je parle d'expérience. J'ose d'ailleurs espérer que nous l'illustrons dans le cadre de notre mission. L'idée d'en faire une prescription légale me paraît néanmoins très baroque.

Monsieur le rapporteur, notre proposition peut vous paraître baroque, et d'autres collègues partagent peut-être votre point de vue. Ce que nous visons cependant c'est bien le contenu du travail, et pas uniquement son aspect réglementaire.
Cet amendement pourrait se traduire par l'obligation pour un certain nombre d'entreprises et d'employeurs d'organiser des pauses, …

… de ménager aux salariés des moments au cours desquels ils puissent se retrouver, échanger les uns avec les autres, notamment au sujet de leurs conditions de travail, d'offrir la jouissance de lieux de convivialité. Cela nécessite de passer par la contrainte de la loi. Tel est le sens concret que devrait prendre cet amendement.
Notre rôle est bien de faire en sorte que le code du travail protège et organise ces relations sociales. Loin d'être baroque, cet amendement est donc très concret, monsieur le rapporteur. Et je peux vous assurer que de telles mesures auraient une réelle incidence pour les salariés qui connaissent des conditions de travail extrêmement dures.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe FI.
L'amendement no 357 n'est pas adopté.

La parole est à M. Adrien Quatennens, pour soutenir l'amendement no 305 .

Dans la lignée de mes collègues, je vais à mon tour valoriser l'excellent travail du magazine Cash Investigation, qui a mis en avant voilà quelques semaines les effroyables conditions de travail, les cas graves de harcèlement moral et les nombreux licenciements abusifs dans plusieurs grands groupes.
Comme nous, les journalistes qui ont réalisé l'émission en question semblent ne pas croire au monde merveilleux de l'entreprise que la majorité nous décrit. Le reportage était d'ailleurs intitulé : « Travail, ton univers impitoyable », ce qui n'est pas une signature de La France insoumise. Vous aviez d'ailleurs eu l'occasion de défendre votre politique et de justifier vos ordonnances sur le plateau après la diffusion de l'émission, madame la ministre. La difficulté avec laquelle vous vous êtes prêtée à l'exercice m'a d'ailleurs surpris ; nous avons connu plus habile utilisation des éléments de langage. Vous n'avez pas convaincu sur la prévention des risques au travail.
C'est la raison pour laquelle nous présentons des amendements dont l'objet est de rétablir un véritable compte pénibilité. Quant au présent amendement, il vise le cas particulier du harcèlement robotique dont sont victimes des milliers de préparateurs de commandes poussés à respecter des cadences infernales qui minent corps et âme.
Peu sont ceux qui croient encore qu'une voix permanente dans les oreilles du matin au soir représente une amélioration des conditions de travail des salariés. Cette innovation n'a d'autre but que d'améliorer les performances, la compétitivité des préparateurs, et ce, au mépris de leur santé, malgré toutes les mises en garde des autorités de santé.
Il est donc du devoir du législateur de se saisir de cette question, de prendre ses responsabilités et d'éviter tous les abus pour préserver la santé des individus. Pour notre part, nous prenons nos responsabilités en proposant d'interdire l'usage d'une telle commande vocale et de créer le délit de harcèlement robotique. Madame la ministre, mes chers collègues, à vous de prendre les vôtres en soutenant cette proposition.

Sur ce sujet, cher Adrien Quatennens, le droit en vigueur satisfait largement à votre demande. En préparant la réponse à votre amendement, j'ai examiné les éléments relatifs au harcèlement moral. Pour me les remettre en tête, j'ai relu la partie du code du travail sur le sujet, en particulier l'article L. 1152-1 : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Ayant écouté vos arguments, il me semble que votre demande est satisfaite par cette disposition d'interdiction stricte des comportements de harcèlement moral.
Je ferai la même remarque que le rapporteur. J'ai informé hier la représentation nationale qu'une trentaine de contrôles sont en cours, à ma demande, afin d'objectiver les faits s'agissant du cas particulier que vous évoquez.
Plus généralement, le problème est davantage celui de l'application du droit que de son contenu. L'interdiction du harcèlement moral et la prévention en matière de santé sont déjà inscrites dans le code du travail.

Je vous remercie de vos précisions, monsieur le rapporteur, madame la ministre. Dans le cas précis d'un harcèlement par une machine donnant des ordres aux salariés du matin au soir, envisagez-vous d'effectuer des contrôles ?

Quelles conclusions pourraient alors en être tirées ? Pourrait-on imaginer demain que cette technologie ne soit plus utilisée dans l'entreprise en question ?
J'attends les résultats de l'inspection du travail !
L'amendement no 305 n'est pas adopté.

La situation du marché du travail français est paradoxale : si 85 % des salariés sont en contrat à durée indéterminée, 87 % des nouvelles embauches se sont effectuées en contrat à durée déterminée en 2015, selon la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques – DARES. L'entrée sur le marché du travail se fait ainsi dans des conditions souvent précaires, d'autant plus que les contrats à durée déterminée concernent plus particulièrement les jeunes, les femmes et les personnes les moins qualifiées. Par ailleurs, la durée moyenne d'un CDD était de vingt-six jours en 2011.
En outre, le taux de conversion de CDD en CDI en France est, selon l'OCDE – l'Organisation de coopération et de développement économiques – , parmi les plus faibles en Europe : 21 % des salariés passent de l'emploi temporaire à l'emploi permanent, contre une moyenne de 37 % en Europe.
Cette situation contribue pour une part significative au sentiment de déclassement que ressentent beaucoup de jeunes, en particulier de jeunes diplômés, qui restent bloqués pendant des mois, voire des années, dans une nasse à contrats courts qui empêche la stabilité de leur vie sociale. De plus, la législation sur le contrat de travail s'est complexifiée au fil des années, en en multipliant les différents types. Cette diversité est difficile à appréhender pour les employeurs, en particulier dans les TPE et PME.
Le cadre juridique actuellement à la disposition des salariés et des employeurs n'est plus adapté à la réalité de notre économie. La rigidité du CDI constitue un frein à l'embauche et n'offre pas la souplesse dont ont besoin les entreprises. Le CDD, s'il offre davantage de visibilité et de marge de manoeuvre pour les employeurs, ne protège pas suffisamment les salariés.
Notre marché du travail se caractérise par la nécessité d'une plus grande fluidité, facilitant les transitions professionnelles et la mobilité dans l'emploi, mais aussi d'une plus grande sécurité, tant pour le salarié, qui aspire à la continuité de son parcours professionnel, que pour l'employeur, qui attend de la législation davantage de sécurité juridique. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de mettre fin à la dualité entre CDD et CDI à travers la création d'un contrat unique, un CDI dont les droits augmenteraient au fil de l'ancienneté.

Votre intention me semble louable, mais votre amendement ne proposant pas de dispositif de fond, il m'est difficile de me prononcer dessus concrètement. Une telle simplification risquerait de remettre en cause un ensemble de garanties et de droits pour les salariés, en matière notamment de durée de travail ou de durée de la période d'essai. Par ailleurs, certains droits doivent être garantis dès la signature du contrat de travail et ne peuvent en aucun cas s'acquérir de façon progressive. Avis défavorable.
L'amendement no 27 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Cet amendement vise, si ce n'est à interdire, du moins à limiter largement les licenciements économiques boursiers, dont l'unique but est d'augmenter la rentabilité financière des entreprises, dès lors qu'une entreprise a constitué des réserves, réalisé un résultat net ou d'exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables ou distribué des dividendes ou des stock-options. Nous avons malheureusement tous vu des plans sociaux massifs, voire des fermetures de sites, réalisés alors que les sociétés mères dégageaient des bénéfices colossaux. Ces injustices sont insupportables.
La recherche obsessionnelle de rentabilité financière ne permettra jamais, ordonnances sur le dialogue social ou pas, de retrouver un marché du travail durable et juste, si l'on pense aux milliers de chômeurs qui nous regardent. Si les 46 milliards d'euros qui ont été distribués en dividendes par les entreprises du CAC40 avaient servi à créer de l'emploi et de l'activité économique industrielle, nous n'en serions certainement pas là. Ce gâchis d'argent doit être régulé d'urgence. La mesure que nous proposons constitue une pierre dans l'édifice de la régulation du capitalisme et va dans le sens de la préservation des emplois dans nos territoires et de la sauvegarde de notre appareil industriel.

Votre proposition pose, à mon sens, un problème de constitutionnalité au regard du principe de la liberté d'entreprendre. Je vous renvoie, à cet égard, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la loi de modernisation sociale de 2002.
Votre rédaction également pose un problème. En prévoyant que soit « également [réputé] dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d'emploi sous quelque forme que soit », si un salarié prend sa retraite à taux plein, parce qu'il le souhaite ou qu'il démissionne, et qu'il n'est pas remplacé, cela serait, d'après votre disposition, considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bien sûr que ce n'est pas votre souhait, mais ce serait l'effet de votre amendement. Avis défavorable.

Cet amendement met en lumière une ligne de fracture essentielle, qui devrait tous nous inspirer : celle qui oppose l'esprit d'initiative à l'esprit de spéculation. Autant l'initiative est quelque chose de positif pour la société, parce qu'elle crée de la richesse et de l'emploi ; autant la spéculation est moralement condamnable, dans la mesure où elle consiste à créer des richesses là où il n'y en a objectivement pas. Elle est presque une forme de vol. C'est pourquoi cet amendement me semble tout à fait intéressant.

Je suis d'accord avec Michel Castellani. Il est assez étonnant de prétendre que cet amendement limiterait le droit d'entreprendre, alors que ce n'est pas le cas : il limite le droit de spéculer et d'exploiter des salariés, quelles que soient les conditions, surtout quand une entreprise fait des profits. Comment pouvez-vous faire une telle réponse à des salariés qui, aujourd'hui, en France, notamment dans l'industrie, subissent toujours plus de licenciements boursiers et voient leur entreprise délocalisée dans une Union européenne à laquelle nous n'avons même pas été capables d'imposer une harmonisation sociale et fiscale, ce qui fait que nous sommes dans le seul espace économico-politique au monde où le dumping fiscal et social est non seulement autorisé mais promu ?
Tant que les licenciements boursiers ne seront pas soumis à des contraintes, nous serons dans une situation contraire à l'esprit de la Constitution, qui confère au travail la valeur de droit constitutionnel. Vous ne pouvez pas prétendre qu'il soit légal et constitutionnel, dans la République française, que des entreprises qui font des bénéfices puissent licencier comme elles veulent. Peut-être considérez-vous que cette situation est constitutionnelle, mais de plus en plus de Français la trouvent, eux, injuste.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
L'amendement no 35 n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Paul Lecoq, pour soutenir l'amendement no 34 rectifié .

Quand des principes semblent anticonstitutionnels, on peut aussi changer la Constitution… Les Français apprécieraient que nous la changions pour leur permettre d'avoir accès à des emplois et que cesse la politique de spéculation.
Cet amendement tend à prévoir le remboursement des exonérations de cotisations sociales dont a bénéficié une entreprise, en cas de licenciement pour motif économique jugé sans cause réelle et sérieuse. C'est une mesure de bon sens, à laquelle s'ajoute la perte, le cas échéant, du bénéfice du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle répond à un constat que nous avons tous fait : nous voyons trop souvent des entreprises qui, une fois qu'elles ont engrangé les aides de l'État, délocalisent ou licencient. C'est aussi le cas pour le MEDEF qui n'a jamais tenu sa promesse de créer un million d'emplois en contrepartie du CICE. Dans ce cadre, il n'est pas admissible que les contribuables français financent des suppressions d'emplois, alors qu'on leur promet l'inverse.
À l'heure de l'austérité généralisée, cette dépense sans aucune compensation apparaît comme une anomalie. Dans ce contexte, il est d'autant plus indécent pour les contribuables qui financent ces mesures que des suppressions d'emplois non justifiées ne remettent pas en cause le versement de ces aides.
Cet amendement répond à un besoin de justice sociale, mais aussi à l'exigence d'une régulation de la logique financière. Alors que l'on nous assène régulièrement que la France doit faire des économies, voilà un gisement important.
L'amendement no 34 rectifié , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à Mme Bénédicte Taurine, pour soutenir l'amendement no 350 .

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Depuis leur instauration en 2008, ces ruptures constituent trop souvent une façon détournée pour l'employeur de licencier pour motif économique, sans les indemnités afférentes, les indemnités étant dans ce cas inférieures à celles du licenciement économique.
Par ailleurs, seuls 7 % des salariés se font assister pour rédiger cette rupture conventionnelle. Cette très faible assistance des salariés dans la négociation de leur rupture conventionnelle se répercute sur les indemnités perçues. En outre, l'individualisation de la rupture du contrat de travail, telle qu'elle est prévue par les ordonnances, casse le cadre collectif et les moyens de défense des salariés. Un salarié en train de négocier une rupture conventionnelle n'est pas en position de force : la plupart du temps seul, il peut faire l'objet de pressions pour accepter des conditions qui lui sont présentées comme avantageuses, alors qu'elles ne le sont pas.

Madame Taurine, vous proposez la suppression de la rupture conventionnelle individuelle instaurée en 2008. Il me semble que, de la même façon qu'avec votre collègue Adrien Quatennens au sujet de la rupture conventionnelle collective, nous avons là un désaccord de fond. Je considère que c'est un bon dispositif qui a permis de favoriser un aspect non conflictuel dans la séparation, en permettant de rechercher un accord et d'éviter les déchirements. Chacun peut ainsi repartir du bon pied. Avis défavorable.

Il existe certainement plein d'exemples très positifs de ruptures conventionnelles, et nous en connaissons tous. Cependant, une enquête du Centre d'études de l'emploi, remise en juillet 2013 et réalisée à partir de plus d'une centaine d'entretiens menés avec des salariés aux profils très différents – électricien, cadre commercial, clerc de notaire ou préparatrice en pharmacie – a révélé une tendance lourde : la rupture conventionnelle ne relève du choix du salarié que dans un quart des cas ; dans trois quarts des cas, elle se rapproche plus d'un licenciement ou d'une démission pour cause de souffrance au travail. Si ce dispositif peut être utile pour certains salariés, pour la majorité d'entre eux, des études scientifiquement prouvées, donc plus solides que nos expériences individuelles, montrent qu'il est utilisé de manière viciée. C'est pourquoi il faut le remettre en cause.
L'amendement no 350 n'est pas adopté.

La parole est à M. Loïc Prud'homme, pour soutenir l'amendement no 232 .

Cet amendement vise à instaurer des limites à la proportion des contrats précaires utilisés dans les entreprises : de 10 % pour les plus petites à 5 % pour les plus grandes. Le recours aux contrats atypiques fragilise l'ensemble du tissu social. L'explosion de l'embauche en CDD, parallèlement au maintien d'un taux de chômage élevé, montre que le desserrement du cadre réglementaire et législatif en la matière n'a pas d'influence positive, comme nous l'avons démontré précédemment au sujet de la rupture conventionnelle qui n'a pas d'effet positif sur l'emploi.
A contrario, la précarisation à l'oeuvre dans la société aggrave ses dysfonctionnements, en frappant particulièrement les personnes les plus vulnérables. Ainsi, plus de 30 % des femmes sont salariées à temps partiel, alors que seulement 7 % des hommes sont dans cette situation. Les femmes sont bien les plus touchées par ces contrats à durée déterminée. Par ailleurs, plus d'un tiers des salariés à temps partiel n'ont pas choisi de l'être.
L'instabilité induite par ces contrats atypiques empêche les salariés de se projeter dans l'avenir et provoque une véritable souffrance dont les effets à moyen terme se font sentir sur la santé des personnes, la qualité de l'éducation de leurs enfants et de la vie familiale. D'un point de vue économique, la précarité atrophie la demande intérieure. En conséquence, l'économie pâtit plus de la dérégulation qu'elle n'en reçoit de bénéfices, contrairement à ce que vous tentez de nous faire croire. Je vous invite à adopter cet amendement qui me semble d'un bon sens évident.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
L'amendement no 232 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Attendez, monsieur le président ! Je veux le faire voter celui-là, normalement, il doit passer.
Sourires.

Étant donné tout ce qui a été voté cet après-midi, c'est sûr qu'il passe ! À moins que je ne l'explique mal…

C'est pour ça ! Je vais essayer de bien l'expliquer, et normalement il passe.
Le total des CDD intérimaires, des CDD, des intérimaires et des temps partiels subis représente 4 millions de personnes. Cette précarisation du marché du travail pèse sur les intéressés, comme sur l'ensemble des salariés, tant en matière de rémunération que de conditions de travail. La proportion des emplois précaires traduit aussi la spécialisation de la France dans des productions à bas coûts salariaux au détriment de l'exigence de montée en gamme de notre industrie.
Nous jugeons indispensable d'encadrer davantage le recours aux contrats précaires – avec tout ce que votre majorité a voté, cela devrait être possible ! – afin que ceux-ci cessent d'être utilisés comme un mode de gestion ordinaire des entreprises, et que les salariés ne soient plus la variable d'ajustement qu'ils sont actuellement. C'est pourquoi nous proposons, dans cet amendement, de limiter le nombre de personnes en CDD à 10 % maximum de l'effectif global dans les entreprises de plus de dix salariés. Je suis sûr que si vous avez été attentifs à cet amendement, vous allez le voter !
L'amendement no 38 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
Rappel au règlement

Pardonnez-moi, mais selon l'article 63, on vote à main levée. J'ai bien regardé les mains qui se sont levées pour et contre l'adoption de l'amendement de M. Dharréville. On peut reprendre la vidéo, mais les pour étaient plus nombreux ! Cet amendement est donc adopté.
Après l'article 6

La parole est à M. Jean-Paul Lecoq, pour soutenir l'amendement no 37 rectifié .
Sourires.

Je veux bien qu'on reprenne les images de la vidéo.
Au contraire de votre projet de loi, l'amendement no 37 rectifié vise à mieux encadrer les conditions de recours au travail intérimaire. Il est d'autant plus urgent de mieux encadrer ce dernier qu'il tue. En 2014, on a dénombré 39 869 accidents et soixante-quatre intérimaires morts au travail, et le triste constat était de même ampleur en 2015.
Nous devons cette situation au fait que les entreprises d'intérim et les entreprises utilisatrices se mettent d'accord pour faire intervenir les intérimaires sur les postes les plus à risque, parfois sans formation et souvent sans respecter l'obligation légale de fournir le matériel minimum : chaussures de sécurité, casques, lunettes de protection, etc. De fait, on recense deux fois plus d'accidents de travail chez les intérimaires que chez les autres salariés des entreprises où ils sont missionnés. Ce n'est pas un hasard, car lorsqu'un intérimaire se blesse, l'accident est imputé à l'agence d'intérim et n'entre pas dans les statistiques de l'entreprise où a eu lieu l'accident, ce qui évite à celle-ci de payer les pénalités liées au nombre d'accidents.
Il est donc urgent d'encadrer strictement le travail intérimaire, afin de faire en sorte qu'un utilisateur ne puisse faire appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et limitée dans le temps, et seulement pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail, ou bien pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. C'est le sens de notre amendement.

Avis défavorable sur cet amendement qui souhaite fixer un quota de recours aux contrats de travail intérimaire.

Nous voudrions entendre vos arguments ! Vous nous vendez des ordonnances qui protégeraient les salariés. Vous généralisez les CDD avec les CDI de chantier ; pourquoi craignez-vous, alors, de limiter dans les entreprises le droit de recourir sans arrêt à ces contrats temporaires ? En réalité, non seulement vos ordonnances ne sont en aucune manière un progrès pour les salariés en situation de précarité ou en CDD, mais en plus vous attaquez le CDI avec les CDI de chantier et autres subterfuges. Allez-y, passez à 10 % ! Puisque vous êtes en train de tout autoriser – le travail de nuit, les CDI de chantier… – , que craignez-vous ?
Au moins, répondez-nous sur le fond : en quoi cela défavoriserait-il l'emploi de limiter à 10 % les CDD dans les entreprises de plus de onze salariés ? On aimerait avoir au moins quelques arguments de votre part. Mais non, la proposition est juste rejetée ! En réalité, dans la société que vous défendez, le travail coûte toujours trop cher et les salariés sont corvéables à merci.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
L'amendement no 37 rectifié n'est pas adopté.

Les mains ont été bien levées et bien comptées, donc M. Prud'homme ne me réprimandera pas cette fois-ci…
La parole est à M. Jacques Cattin, pour soutenir l'amendement no 3 .

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour ma première intervention dans cet hémicycle, j'espère que vous me ferez plaisir !
Applaudissements sur les bancs du groupe REM.

L'article L. 2421-8 du code du travail dispose, dans son deuxième alinéa, que « l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme » du contrat. Or cette disposition n'est pas applicable en pratique pour un emploi saisonnier d'une durée courte de moins d'un mois – ni pour l'employeur ni pour l'inspection du travail – et ne permet donc pas de répondre aux obligations législatives.
Dans notre département du Haut-Rhin, un salarié bénéficiant du statut de salarié protégé et ayant connaissance de ce flou juridique ne cesse de multiplier les contrats de la sorte et attaque les employeurs pour ne pas avoir répondu aux dispositions de la loi, mettant en grande difficulté financière plusieurs exploitations et entreprises familiales, souvent de petite taille. En première instance, devant le tribunal des prud'hommes, cette attitude d'abus de droit est même dénoncée par les représentants des salariés, qui rejettent cette pratique indigne. En revanche, la cour d'appel qui, elle, se réfère strictement au droit, condamne systématiquement les employeurs pour des montants allant de 30 000 à 90 000 euros, pour des périodes d'un à vingt-cinq jours de travail. Je tiens à votre disposition une dizaine de cas rien que dans ma circonscription.
Le flou juridique que j'évoque met également l'inspection du travail en contradiction avec l'interprétation des textes. Ainsi, dans sa réponse écrite du 19 décembre 2016 à une entreprise concernée, elle précise que la disposition incriminée ne s'applique que pour un CDI et non pour un CDD – en l'occurrence un contrat saisonnier. Pourtant, dans le mémoire qui vient d'être produit à la cour d'appel de Colmar, cette même exploitation est sur le point d'être condamnée à près de 52 000 euros de dommages alors que son chiffre d'affaires annuel est de 250 000 euros.
Je demande que la loi soit modifiée afin que, dans le cadre d'un contrat saisonnier de courte durée, l'employeur ne soit plus tenu de saisir l'inspection du travail. Madame la ministre, mes chers collègues, j'en appelle au bon sens pour rectifier cette profonde injustice !

Pour votre première intervention, vous avez choisi d'évoquer une disposition très spécifique, très technique et très importante, relative aux salariés protégés dans le cadre de l'arrivée à terme d'un contrat précaire – CDD, contrat d'intérim ou contrat saisonnier. Dans tous ces cas, la procédure qui s'impose à l'employeur est de saisir l'inspecteur du travail un mois avant la fin du contrat, afin que l'inspecteur s'assure que le salarié n'a pas fait l'objet de mesures discriminatoires. Le non-respect de cette obligation conduit le juge, en cas de contentieux, à requalifier automatiquement le contrat en CDI. Comme vous le dites, il paraît en effet compliqué pour l'employeur de saisir l'inspecteur du travail pour la fin d'un contrat de moins d'un mois puisqu'il devrait théoriquement le faire avant même le début du contrat !
Toutefois, la jurisprudence prévoit que la requalification du contrat saisonnier en CDI n'est possible que si le salarié est employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise, ou si ses contrats sont assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante ; peut-être était-ce le cas dans les affaires que vous évoquez. De plus, la loi du 17 août 2015 a introduit une disposition spécifique applicable aux salariés protégés en contrat saisonnier, qui prévoit que lorsqu'en application d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'est engagé, au terme du contrat, à le reconduire pour la saison suivante, il n'y a pas d'obligation de saisine de l'inspection du travail. Selon moi, votre amendement n'a pas lieu d'être. C'est pourquoi je donne un avis défavorable.
L'amendement no 3 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Cet amendement propose de diminuer le temps de travail hebdomadaire à 32 heures, à compter du 1er janvier 2021.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Cela vous laisse le temps d'y réfléchir ! Nous souhaitons ainsi inscrire au coeur du débat une question tant économique que philosophique, que l'on sera amené, quoi qu'il arrive, à aborder dans les années à venir. La majorité parle constamment de la mutation du travail et de la nécessité de le repenser ; c'est vrai. Nous partageons le constat commun que la technologie, et notamment l'émergence de l'intelligence artificielle, va considérablement changer la manière de travailler. Seulement, à aucun moment n'est sérieusement abordée la question de la diminution du temps de travail. Ce n'est pas une idée nouvelle pour lutter contre le chômage : selon le rapport de l'IGAS de 2016, les 35 heures ont permis la création de 350 000 emplois entre 1998 et 2002. Il faut partager le travail dans notre société ; ce sera la seule solution pour lutter contre le chômage structurel, et la seule mesure réellement capable d'offrir à chacun la possibilité de travailler.
La diminution du temps de travail est aussi un appel à repenser les temps sociaux dans notre société. Aujourd'hui, le temps de travail hebdomadaire effectif est de 39,5 heures pour les personnes à temps complet. Interrogeons-nous : quelle part de notre vie consacrons-nous au travail ? Comment valorise-t-on les autres engagements dans notre société ? Cet amendement vise ainsi deux choses : anticiper la mutation du marché du travail en proposant un partage du travail à toutes et à tous pour lutter contre le chômage structurel ; donner à nos concitoyens plus de temps pour s'engager différemment et trouver leur place dans la collectivité autrement que par le travail. C'est un débat à ne pas escamoter !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

En tout cas qui vous enchante, et c'est déjà bien !
Votre amendement propose un passage à une durée légale du travail de 32 heures hebdomadaires. À mon avis, cela mettrait plutôt notre pays dans une situation totalement décalée par rapport à ses principaux partenaires économiques et voisins européens.

Mais je conçois que vous ayez une autre lecture des choses. Avis défavorable.

C'est difficile : si je vous réponds brièvement, vous vous en inquiétez ; lorsque je veux répondre avec un peu de contenu, vous surréagissez. Je vous trouve particulièrement bienveillant, cher collègue Coquerel !

En outre, la question de la durée légale du travail n'est pas au coeur des ordonnances, qui ne modifient en rien cette donnée ; ce n'est donc pas le sujet du débat ce soir. Je vois qu'elle vous préoccupe, et sans doute aurez-vous l'occasion d'en reparler à nouveau avec nous et avec l'ensemble des collègues.

Je tiens à prendre la parole sur cet amendement, car la question qu'il pose me semble essentielle à ce débat, dans la mesure où le principal problème auquel on veut tous s'attaquer est le chômage. C'est bien là-dessus que vous vous penchez depuis le début de la législature. Or il apparaît clairement – et cela a toujours été le cas historiquement – que la baisse du temps de travail est un horizon que nous pouvons atteindre. Sachez qu'aujourd'hui, compte tenu des bonds technologiques, un salarié produit en moyenne quatre à quatre fois et demie plus qu'en 1980. On peut raisonnablement se demander si nous avons quatre ou cinq fois plus de besoins à satisfaire, et donc si nous devons produire quatre ou cinq fois plus qu'à l'époque.
Si le problème est celui de l'emploi, alors la diminution du temps de travail est un horizon nécessaire. En revanche, si le problème est de faire la course à la compétition – une course au moins-disant social – , alors vous allez dans le bon sens, mais c'est une course perdue d'avance. Comme je l'ai souligné il y a quelques jours, même la Roumanie est en train de baisser drastiquement ses cotisations patronales, prétendument pour gagner en compétitivité. Allez-y, nous vous regardons : faites faire à la France la course contre la Roumanie !
La question du chômage en France est vraiment à prendre sous l'angle de la création des emplois. La situation de l'emploi en France est celle d'une pénurie, et ce ne sont pas quelques petites mesurettes marginales sur l'organisation du travail qui vont permettre de relancer la machine.
À ceux qui disent que nous sommes excessifs et utopiques, je rappelle que nous bénéficions tous de congés payés. Avant 1936, si un salarié disait à son collègue : « Écoute, dans un horizon assez proche, notre patron va nous payer pour que nous allions nous dorer la pilule à la plage », il était taxé d'utopiste ; or ce combat a été mené. La diminution du temps de travail, dans la semaine et dans la vie – avec la question de la retraite à soixante ans – , est un horizon souhaitable.
Selon un calcul récent, les emplois sauvegardés ou créés par le CICE coûtent huit fois plus cher que ceux qui avaient été créés par le passage aux 35 heures. Vous pouvez me faire signe de m'arrêter, mais ma démonstration est claire : vos solutions ne relancent pas l'emploi, elles augmentent la flexibilité ; les nôtres, oui, sont créatrices d'emplois.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Nous avons une vraie différence de point de vue : nous pensons que la réduction du temps de travail, contrairement à ce que vous dites, détruit du travail. Vous considérez – et c'est tout à fait respectable – le travail comme un camembert à partager ; nous pensons qu'au contraire, plus il y a de travail, plus il y a de création de valeur, et qu'ainsi le travail se démultiplie. C'est sur ce chemin que nous allons continuer.
L'amendement no 39 n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon, pour soutenir l'amendement no 303 .

Il y a presque deux ans, la loi El Khomri a profondément bouleversé la législation en matière d'aménagement du temps de travail et de prise en compte des heures supplémentaires. Le précédent gouvernement a, en effet, permis aux entreprises, par accord collectif, de fixer elles-mêmes le rythme et certaines compensations liées à ce grand bouleversement du temps de travail. À l'époque, le Gouvernement prônait, comme le fait La République en marche désormais, la souplesse et l'adaptation des conditions de travail aux aléas de l'activité économique.
Quant à nous, députés du groupe La France insoumise, nous estimons que la banalisation des heures supplémentaires et le chamboulement des rythmes de travail rigidifient les destins individuels et nuisent à l'épanouissement des citoyens. En bousculant les rythmes sociaux, ces mesures nuisent à la cohésion sociale, et mettent la société au second plan, comme si l'économie devait primer sur tout, tout le temps.
Nous défendons, au contraire, l'idée que c'est la vie qui importe, et que les rythmes de travail doivent s'y adapter. Le temps de travail doit être limité ou très fortement compensé s'il empiète sur le temps nécessaire à la vie de famille, à la vie citoyenne, à la vie sociale. L'ordre public est le seul cadre juridique qui doit réguler et limiter le dépassement de la durée légale du travail : nous voulons lui redonner toute sa force.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Avis défavorable. Vous proposez, cher collègue, la suppression de l'article L. 3121-44 du code du travail, qui concerne la modulation de la durée du travail par voie d'accord collectif. Pour l'avoir vécu moi-même, pour avoir accompagné un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices dans ce système, je peux vous assurer qu'il fonctionne très bien. Ce sont souvent les collaborateurs eux-mêmes qui gèrent de façon autonome la répartition de leur temps de travail. Non seulement c'est responsabilisant, mais cela permet de concilier la vie privée et la vie professionnelle. Je suis donc défavorable à votre amendement.
Le dialogue entre nous est très souvent difficile, car un même présupposé est sous-jacent, non seulement à cet amendement, mais aux centaines d'amendements que vous avez défendus : que la France devrait être entièrement administrée, depuis Paris, par des textes de lois.
De notre côté, nous partons du présupposé inverse.
Les ordonnances ont permis, après concertation avec les partenaires sociaux, de renforcer le dialogue social à la fois dans les branches et dans les entreprises. Nous avons trouvé un bon équilibre entre les deux, comme l'ont d'ailleurs souligné les partenaires sociaux. Mais à chaque fois que nous décidons que les règles, dans telle ou telle matière, seront déterminées par le dialogue social, vous nous répondez : cela ne marchera pas ! À chaque fois, vous soutenez que la loi, et la loi seule, doit régler toutes les matières qui concernent les entreprises et les salariés, dans les moindres détails, à la place des partenaires sociaux.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe REM. – Exclamations sur les bancs du groupe FI.
C'est une grande différence entre nous : nous ne pensons pas que la France doive ainsi être administrée jusque dans les plus petits détails. Pour faire vivre notre économie, nous devons faire confiance aux organisations syndicales, qui – contrairement à ce que vous pensez – ne signent pas n'importe quoi.
Allons-y, développons le dialogue social !
Applaudissements sur les bancs des groupes REM et MODEM.

Ce que vous avez dit, madame la ministre, est hallucinant. Où sont vos partenaires sociaux ? Quels partenaires sociaux sont d'accord avec vos ordonnances ? Le MEDEF, le MEDEF et le MEDEF !

C'est faux ! Vous n'étiez même pas présent aux auditions de la commission !

Mais si, écoutez : tous les syndicats de salariés sont opposés à vos ordonnances, …

… et vous le savez très bien, alors ne prétendez pas le contraire !
Et puis, madame la ministre, nous n'avons jamais dit que nous sommes contre les accords d'entreprise. Simplement, jusqu'à maintenant, la loi fixait les exigences minimales, les droits de base en deçà desquels on ne peut pas aller. Nous considérons qu'il est nécessaire, dans une république, de fixer une règle d'égalité pour protéger les salariés. C'est pourquoi les accords d'entreprise devaient accorder des garanties supérieures à la loi pour les salariés. Par ces ordonnances, madame la ministre, vous affaiblissez la valeur normative de la loi, au désavantage des salariés.
Monsieur Maillard, vous avez abordé la question de la réduction du temps de travail. Vous nous dites qu'en réduisant le temps de travail de chacun, on aboutirait à diminuer le temps de travail global : c'est une fausse idée.

Quand on a instauré les 35 heures, c'est exactement l'inverse qui s'est passé : c'est la plus grande augmentation de temps de travail en France de la Ve République, et même du XXe siècle. Quand vous diminuez le temps de travail de chacun, vous créez du travail pour les autres : au bout du processus, tout le monde travaille plus, avec une meilleure productivité.

Mais ces nouveaux emplois étaient subventionnés ! Dites combien cela a coûté !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
L'amendement no 303 n'est pas adopté.

La parole est à M. Michel Castellani, pour soutenir l'amendement no 262 .

Par cet amendement, nous voulons revenir sur le problème du travail de nuit, tirant les leçons du rapport parlementaire dont j'ai cité tout à l'heure un passage. Selon ce rapport, les dégâts sanitaires sont irréversibles au-delà d'un volume de 200 nuits de travail par an sur une durée de quinze ans. Nous considérons donc que le législateur devrait fixer un plafond à ce niveau, afin de préserver la santé des travailleurs.
Nous proposons, pour cela, de compléter l'article L. 3122-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé : « Nul travailleur ne peut effectuer un travail de nuit, plus de quinze ans dans sa carrière à raison d'un maximum de 200 nuits par an. »

Avis défavorable. Cet amendement a été repoussé par la commission. Il s'agit d'un amendement de principe qui me paraît aller à l'encontre d'un certain nombre de droits et de libertés fondamentales. Je ne nie pas l'impact du travail de nuit sur la santé ; toutefois de nombreux métiers s'exercent essentiellement et même nécessairement la nuit. Il s'agit, par exemple, dans les professions médicales, des services d'urgence, mais aussi d'autres services. De nombreuses personnes choisissent même de travailler de nuit, car cela les arrange à ce moment de leur vie. Il faut aussi savoir que le travail de nuit est souvent, en réalité, un travail de soirée.

Nous soutenons cet amendement. Nous en présenterons d'ailleurs un autre, d'une visée plus large, concernant aussi le travail de soirée.
Je voudrais revenir sur la question d'ordre plus général qui a été abordée. Nous sommes opposés à l'extension infinie du temps de travail, la nuit, le jour, le dimanche, etc. Nous avons une autre conception du travail.
À quoi sert le travail ? Pas à produire toujours plus, pas à faire tourner les marchés, pas à verser des dividendes. Il doit servir à vivre, et non survivre. Contrairement à ce qui fut le cas pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, nous sommes aujourd'hui capables de produire suffisamment de richesses pour que tous et toutes puissent vivre décemment. Tout le surplus doit être collectivisé, socialisé, et doit servir à la transition écologique. Pour cela, il faudra lancer de grands chantiers, qui nous conduiront à développer d'autres champs de travail.
Dans tous les cas, il faudra partager encore plus le travail, afin que tous et toutes y participent. De plus en plus de tâches devront être socialisées, notamment au moyen de la technologie. Il faudra, en outre, développer les activités qui ne relèvent pas du travail, mais qui font partie de l'activité humaine, c'est-à-dire qui favorisent l'émancipation humaine.
Certes, il y a là de l'idéologie : ce terme, qui est pour vous un gros mot, est à mon sens profondément politique. À quoi sert le travail ? Comment faire pour qu'il soit un instrument d'émancipation et non d'aliénation ? L'extension infinie du temps de travail, la nuit, le dimanche, va à l'encontre de notre vision, cette vision progressiste que tous devraient partager.
L'amendement no 262 n'est pas adopté.

Dans la continuité d'autres amendements déposés par des membres de notre groupe et d'autres députés, l'amendement no 302 concerne le travail de soirée et le travail de nuit. Cela a été dit, mais il faut le répéter, un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – – ANSES – publié au printemps dernier, a mesuré l'impact de l'extension du travail de nuit sur la santé. D'après ce travail très documenté, très sourcé, les effets sont très négatifs en termes de santé publique : la désynchronisation vis-à-vis du rythme naturel de repos est cause de diabète, d'obésité, etc.
Or la loi El Khomri conçue et adoptée par la majorité précédente a considérablement fragilisé le cadre juridique du travail de soirée et de nuit, auparavant assez strict. Nous ne demandons pas que le travail de nuit soit interdit, mais qu'il soit strictement encadré : c'est pourquoi nous voulons revenir aux dispositions antérieures à la loi El Khomri.
Celle-ci a réduit la fourchette horaire du travail de nuit et du travail de soirée. Elle a aussi permis de déroger à la durée maximale de travail de nuit sur une même semaine, ce qui est totalement contraire aux préconisations sanitaires. Les établissements de vente situés dans les zones touristiques internationales peuvent ainsi recourir au travail de soirée de façon systématique : il ne s'agit pourtant pas là d'un secteur vital, ni pour la santé, ni pour la défense nationale. C'est ainsi que l'ancien cadre strict a été jeté par-dessus bord. Pour nous, la banalisation du travail de nuit et de soirée au profit de l'activité économique est totalement contraire au progrès social et à l'amélioration de la santé des travailleurs.
Nous avons voté ensemble des amendements visant, par exemple, à améliorer l'indemnisation des victimes de l'amiante ou à renforcer la médecine du travail. Des rapports montrent que le travail de soirée et de nuit ont, eux aussi, des effets sanitaires directs et néfastes. Puisque le Gouvernement veut aborder un « virage préventif » sur ces questions, il nous semblerait logique que vous acceptiez cet amendement. Il relève, de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un véritable choix de société.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Avis défavorable. Vous pointez du doigt la loi du 8 août 2016, lui reprochant d'avoir considérablement élargi les possibilités de déroger aux règles en matière de travail de nuit par voie d'accord collectif. Je pense que vous vous trompez : cette loi n'a en rien modifié le travail de nuit. Les dernières réformes en la matière datent d'août 2015 et concernaient uniquement le recours au travail en soirée, comme nous l'évoquions tout à l'heure, dans les établissements commerciaux situés dans certaines zones spécifiques, telles que les zones touristiques et les emprises de gares. Sans doute est-ce à cela que vous faisiez référence.
En tout état de cause, il n'y a pas eu de bouleversement majeur du régime applicable en la matière : les dispositions d'août 2015 n'ont pas vraiment renversé la hiérarchie des normes.
L'amendement no 302 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi no 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l'Assemblée nationale
Catherine Joly