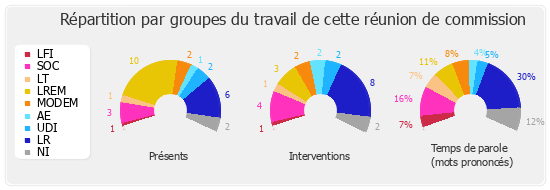Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de coronavirus-covid 19 en france
Réunion du mercredi 24 juin 2020 à 17h00
La réunion
Membres présents ou excusés
Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19
Présidence de Mme Brigitte Bourguignon.

Nous allons maintenant entendre M. Didier Raoult, directeur de l'institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection. Pour reprendre une expression du rapporteur, vous êtes, monsieur le professeur, l'un des visages de la crise sanitaire. Je profite de la grande attention médiatique dont cette audition fait l'objet pour rappeler le cadre et l'esprit de nos travaux. La mission d'information s'est vue doter des pouvoirs d'une commission d'enquête pour six mois, comme le prévoit la loi. Ses membres partagent un même état d'esprit : cette mission n'est et ne sera ni un tribunal populaire, ou médiatique, ni un feuilleton télévisé. En conséquence, il ne nous appartient pas de nous substituer à l'autorité judiciaire et de rechercher des coupables. La justice a d'ailleurs été saisie à cette fin et nous sommes ici attachés à son indépendance. Notre objectif n'est donc pas de juger mais de comprendre, d'établir la généalogie et la chronologie de cette crise. C'est le travail que nous avons entrepris la semaine dernière en auditionnant tous les directeurs généraux de la santé en poste depuis 2003 ainsi que l'actuelle directrice générale de Santé publique France et son prédécesseur. Autrement dit, il s'agit pour nous d'identifier les éventuelles défaillances ou erreurs, d'évaluer l'impact des décisions prises par les pouvoirs publics, afin de tirer les enseignements de cette crise sans précédent et faire en sorte que notre pays soit mieux armé face à une crise sanitaire.
Comptez sur moi pour placer l'exigence de vérité et de transparence au cœur de nos travaux. C'est ce que nos compatriotes attendent très légitimement de nous. Je me félicite de la qualité et la sérénité de toutes les auditions que nous avons menées jusqu'à présent.
(M. Didier Raoult prête serment.)
. Je veux d'abord signaler que j'ai un lien avec Hitachi pour le développement de microscopes électroniques en microbiologie clinique et que je suis membre fondateur de cinq start-up, qui n'ont pas encore rapporté d'argent.
Commençons par la mortalité : sur le Charles de Gaulle, il n'y a pas eu de morts – les sujets, jeunes, ont été pris en charge relativement tôt ; sur le Diamond Princess, il y en a eu 2 % – les passagers étaient plus âgés. La sévérité des cas dépend des caractéristiques de la population touchée. Il est donc difficile de faire des généralités. La mortalité par tranche d'âge est un élément important qui doit amener à réfléchir aux stratégies de prise en charge thérapeutique. En Europe, il y a eu un peu moins de 200 000 morts : 10 % avaient moins de soixante-cinq ans, 50 % plus de quatre-vingt-cinq ans.
J'aime les données chiffrées brutes et me méfie beaucoup de la manière dont on les enrobe et les manipule – Husserl disait que « les méthodes mathématiques sont les habits des idées » – même s'il est bien sûr nécessaire de les pondérer : la perte d'espérance de vie n'est pas la même à vingt ans qu'à quatre-vingt-cinq ans. Il y aura un effort à demander aux uns et aux autres pour une transparence totale sur les chiffres de la mortalité. Des différences s'observent entre régions mais elles sont difficiles à expliquer. Certaines sont liées à des phénomènes d'écosystème. Pourquoi le Grand Est a-t-il été davantage touché ? Est-ce dû à des rassemblements religieux ?
Tous les gens qui vous diront que l'épidémiologie des maladies infectieuses est une chose simple sont des inconscients et ceux qui construisent des modèles projectifs sur des maladies non encore connues sont des fous. Une telle croyance dans les modèles mathématiques s'apparente à de la religion.
La santé publique, c'est 70 % à 80 % de politique et 20 % à 30 % de sciences et de médecine. Jamais des données scientifiques ne pourront prouver le bien-fondé des décisions purement politiques que sont le confinement ou le port du masque dans la rue. La charge de ces décisions a été déplacée sur les scientifiques et des décisions médicales ont été préemptées par le politique, ce sur quoi je suis en désaccord. Il faut réfléchir aux rôles respectifs du politique, du médecin et du scientifique car les délimitations en santé publique sont toujours complexes. Les scientifiques doivent apporter des connaissances supplémentaires, qui ne peuvent émerger que progressivement s'agissant d'une maladie nouvelle ; les médecins doivent faire leur métier, qui est de soigner ; les politiques doivent organiser la société.
Sur le plan épidémiologique, le Covid-19 a des caractéristiques très particulières, qui n'étaient pas prévisibles : les enfants sont très peu touchés et encore moins souvent malades. Nous qui avons beaucoup testé avons pu établir qu'il n'affectait presque pas les moins d'un an, extrêmement rarement les moins de cinq ans, davantage les dix à quinze ans. Ces différences ne sont pas liées à des comportements. Nous avons eu l'occasion d'étudier de très nombreux cas dans la communauté israélite après la fête de Pourim pendant laquelle tout le monde a été exposé de la même manière. Le taux d'attaque a été de l'ordre de 20 % chez les enfants et de 95 % chez les adultes. Cette non-réceptivité des enfants est unique car ce sont eux les plus touchés pour toutes les autres infections respiratoires virales. J'en ai parlé au Président de la République et je pense que cela a hâté sa décision de reprise de l'école. Il est possible que cela soit lié à une immunité antérieure développée au contact de coronavirus, beaucoup plus fréquents chez les enfants, ayant sévi quelques mois avant. Des travaux de 2013 avaient déjà mis en évidence ces réactions croisées.
« L'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu » disait Victor Hugo. Nous ne pouvons pas prévoir. Il faut laisser à chacun sa part de responsabilité. Moi, je ne peux pas prédire l'avenir.
La mise en place du traitement, comme vous le savez, a donné lieu à un énorme conflit. Les premières données étaient tirées d'une étude menée sur le SARS, pour lequel le Dr Fauci avait déclaré que le traitement était la chloroquine. Les Chinois, après des tests, ont rapporté la sensibilité à la chloroquine et au remdesivir et ont décidé d'utiliser la chloroquine qui ne coûtait rien. Nous avons ensuite confirmé leurs résultats préliminaires, en particulier en association avec l'azithromycine. L'opposition pour ou contre a pris les proportions d'une guerre, aux mobiles complexes, qui s'est insérée dans le contexte de la guerre civile entre démocrates et républicains aux États-Unis. Je vous le dis publiquement – et je sais que j'encours cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende si je ne dis pas la vérité : je ne connais ni Trump ni Bolsonaro. Ce n'est pas moi qui leur ai dit d'utiliser la chloroquine, médicament recommandé pour 4,5 milliards de personnes dans le monde.
Jamais dans ma carrière, je n'ai vécu de telles tensions. Des revues m'ont demandé s'il était vrai que j'avais oublié de déclarer des conflits d'intérêts avec Sanofi ou que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ne m'avait pas donné son accord pour la première étude. C'est allé jusqu'à la publication d'un article dans The Lancet dont n'importe qui de mon niveau reconnaîtrait le caractère totalement faux et mensonger. Il est indiqué par exemple qu'en Afrique, les gens fument autant qu'en Asie, ce qui est faux ; que l'obésité est aussi répandue en Afrique qu'aux États-Unis, ce qui est faux aussi. La même équipe a publié dans The New England Journal of Medicine – les meilleurs journaux ont été des cibles – un autre article reposant sur des données d'hôpitaux français indiquant l'ethnicité des patients, chose impossible puisque la loi interdit de faire figurer dans le dossier médical cet élément. Les positions pour ou contre la chloroquine ont même entraîné des fluctuations des actions de la société Gilead Sciences. Je sais que la Fed a commencé une enquête et je crois que nous ne pourrons éviter un examen approfondi de cette question.
S'agissant des tests, je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise de ne pas les généraliser. Dès le début du mois de mars, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé de tester tous les cas suspects ou les cas contacts. Pendant toute cette période, on n'a pas dit la vérité car notre pays avait les moyens de le faire : les tests PCR sont d'une simplicité enfantine, comme je l'ai expliqué au Président, puisqu'il suffit de changer les amorces. Tous les laboratoires peuvent le faire. Nous pratiquons 300 000 tests par an et en effectuer quelques milliers de plus n'a pas été un problème. Des laboratoires vétérinaires nous ont même donné des réactifs. L'ingénieur qui en a la charge à l'IHU a pu faire 450 000 préparations, que nous avons fournies à d'autres établissements, à Nice et Toulon notamment. Le problème principal était l'extraction et nous avons acheté plusieurs machines pour varier les modalités. Beaucoup des problèmes que je soulève sont structurels, et donc anciens. Un des problèmes de fond réside dans ce que l'on appelle les centres nationaux de référence. Il ne pouvait pas y avoir de centre national de référence pour ce coronavirus, lequel n'existait pas jusqu'alors, mais cela n'a pas empêché certaines personnes de décréter que c'étaient elles, la référence. Au début, on m'a même dit que je ne pouvais même pas faire de diagnostics de coronavirus !
Ces tests étaient indispensables pour étudier cette maladie qu'on ne connaissait pas. Les premières déductions, qui ont été faites à partir de la grippe, n'étaient pas justes. On sait maintenant que la dyspnée, l'essoufflement, n'est pas un signe du coronavirus. Pour la grippe, l'insuffisance respiratoire s'explique par une chute du taux d'oxygène et une augmentation du taux de gaz carbonique, qui provoque l'essoufflement. Or, la maladie du covid peut s'accompagner d'une hypoxie heureuse : le taux d'oxygène descend à 95 %, 92 % voire 90 % sans que les patients ne soient essoufflés alors même que leur état réclame des soins en réanimation. L'essoufflement n'est donc pas un signe, mais on ne pouvait le savoir qu'en observant les malades. Nous savons depuis peu qu'avec cette maladie, le taux de gaz carbonique peut diminuer aussi, alors que c'est l'augmentation de ce taux qui provoque l'essoufflement. Cette double diminution caractérise les embolies pulmonaires et les patients atteints par le covid en ont plusieurs petites. Les Chinois avaient déjà décrit cette absence de signes pulmonaires car ils font systématiquement des scanners thoraciques à faible dose, au lieu de téléthorax encore pratiqués dans notre pays, qui accuse un grand retard en matière d'équipements. Il a été établi que 65 % des patients sans signes respiratoires avaient des lésions visibles au scanner et parmi eux, 11 % ont des lésions sévères qui provoquent des séquelles comme des fibroses pulmonaires.
Pour arriver à de telles conclusions, il fallait observer et pour observer, il fallait faire des diagnostics. Tout dans cette maladie apparaissait bizarre. Elle se développe en quatre étapes : virus ; association virus-réponse immunitaire ; réponse immunitaire sans presque plus de charge virale ; destruction des tissus. Appliquer le même médicament à chacune de ces étapes est une fantaisie. Nous le savons depuis la grippe : le Tamiflu, mis au point par Gilead, n'est efficace que pendant les deux premiers jours. Le remdesivir ne peut fonctionner pour les formes graves. Et s'il convient aux formes initiales banales, on ne peut le prescrire car il y a 8 à 10 % d'insuffisance rénale. La fenêtre de tir est donc extrêmement limitée.
Il y a une grande folie autour de l'hydroxychloroquine. Sur les quatre études randomisées, trois disent que ce médicament fonctionne mieux que le placebo. Le temps fera son œuvre. En sciences, les disputes sont courantes. Je pense que le ministre a été mal entouré. Il aurait dû être conseillé par des personnes capables de discerner les solutions raisonnables et d'analyser les articles scientifiques de manière à ne pas se retrouver à faire des déclarations en plein week-end sans qu'ils aient été lus. Dominique Maraninchi, précédent directeur de l'ANSM, et Jean-Louis Harrousseau, ancien président de la Haute Autorité de santé, ont dit leur désaccord dans une tribune.

Vous avez porté un regard critique sur la réponse apportée par les pouvoirs publics. Quelles décisions auraient dû être prises selon vous ? Vous avez émis des doutes sur le bien-fondé du confinement total. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Le 30 avril, lors d'un entretien sur BFM TV, vous estimiez très peu probable l'hypothèse d'une seconde vague, mais le 19 juin vous êtes revenu sur cette analyse. Pourquoi cette évolution ? Sur quelles données vous êtes-vous fondé ?
De manière plus générale, quelles leçons doit-on tirer de la gestion de la crise ?
Les décisions liées au confinement et au port du masque dans la rue ne reposent pas sur des données scientifiques établies, claires et démontrables. Je peux dire que les rassemblements dans de telles situations m'apparaissent déraisonnables, mais le confinement appartient à un domaine politique qui m'échappe, comme j'ai eu l'occasion de le dire au Président, car il renvoie à la gestion de la population et de ses peurs. Je me suis interdit d'avoir une opinion à ce sujet.
Quant à mes propos sur la deuxième vague, je ne sais pas de quels fantasmes journalistiques ils sont issus. Je n'ai jamais dit cela. Pour les maladies qui évoluent selon une courbe en cloche, on peut savoir quand le nombre de cas culmine et quand il diminue, chose que j'ai évoquée devant le Président ; on voyait que l'on avait passé le sommet de la courbe et que celle-ci allait s'arrêter en mai. Nous avons fait un travail important sur la courbe des quatre coronavirus saisonniers, qui représentent 8 % à 10 % des infections respiratoires chaque année : ils évoluent de la même manière mais sévissent pendant la saison froide. Les deux hypothèses les plus plausibles sont soit que le Covid-19 devienne saisonnier soit qu'il disparaisse comme le SARS. L'inversion des saisons de part et d'autre de l'équateur nous donne des indications. Si une épidémie commence en ce moment en Nouvelle-Zélande, située à une latitude analogue à la nôtre dans l'hémisphère sud, nous pouvons penser que nous connaîtrons nous aussi une épidémie pendant la saison froide.

Votre action a suscité une multitude de réactions passionnelles peu habituelles en période de crise sanitaire. Vous êtes ou haï ou adulé, avec peu de nuances entre les deux. Une boutique marseillaise vend même des bougies portant votre effigie, qui rencontrent un très grand succès. Vous avez fait l'objet de propos violents. Cette ambiance un peu irrationnelle est-elle compatible avec la sérénité que l'on peut attendre de la médecine et de la recherche pendant une crise sanitaire ?
Pouvez-vous nous indiquer quels conseils vous avez donnés au Président de la République lors de sa visite à l'IHU le 9 avril dernier ? Comment les a-t-il reçus ?
Pourquoi avez-vous démissionné du conseil scientifique ? Quels différends de forme et fond vous ont opposé à ses membres ?
En matière de tests, tout le monde reconnaît que vous avez été un pionnier. Vous êtes celui qui a testé le plus précocement, le plus rapidement et plus massivement – et le Niçois que je suis remercie le Marseillais que vous êtes de nous avoir fait bénéficier de vos services. Au début du mois d'avril, vous avez effectué dans votre institut un quart des tests réalisés en France. Le président du conseil scientifique, le professeur Delfraissy, a justifié le confinement par un manque cruel de tests au début de l'épidémie : « 3 000 tests par jour, quand les Allemands en avaient plus de 50 000 ». Comment avez-vous réussi à mobiliser autant de moyens matériels et humains ? Estimez-vous que certaines décisions ont entraîné des retards dans la mise en œuvre de ces tests ? Pourquoi les laboratoires privés et les laboratoires vétérinaires ont-ils été écartés dans un premier temps ? Quelle organisation préconisez-vous pour que nous soyons opérationnels ?
C'est un malheur de l'âge d'avoir de l'expérience mais il faut bien que cela serve à quelque chose. C'est en 2001 que j'ai pris conscience, en toute lucidité, que notre pays n'était plus prêt, au moment où les États-Unis ont connu des attaques à l'anthrax via des envois de courrier. Très vite, les enquêtes ont établi qu'il s'agissait d'une souche endogène, provenant de Fort Detrick, base militaire américaine ayant servi à cultiver le bacille du charbon comme arme de bioterrorisme. Ces envois ont suscité une telle peur que des auteurs de plaisanterie de mauvais goût ont été mis en prison. Quand il y a eu des échantillons suspects en France, nous nous sommes rapidement aperçus que nous étions les seuls à Marseille à être équipés d'un laboratoire de type P3 grâce auquel nous avons pu établir en vingt-quatre heures, par des cultures, qu'ils étaient négatifs. Nous avons réalisé le tiers des analyses de poudre en France ; les autres laboratoires ont rendu leurs résultats avec parfois un mois de retard. Cela m'a fait m'interroger sur nos capacités à répondre à une crise, même si en l'occurrence il s'agissait d'une « fausse crise ». Il y avait déjà dans notre pays un problème de fond, à savoir identifier quel acteur pouvait gérer ce type de situation.
En 2003, Jean-François Mattei, alors ministre de la santé, et Claudie Haigneré, ministre de la recherche, m'ont confié une mission sur les crises liées aux maladies infectieuses et le bioterrorisme. Je proposais dans mon rapport qu'il y ait des équivalents de l'IHU, véritable fort à la Vauban, dans sept villes de France afin de recevoir des malades, de pratiquer des milliers de tests, de mener des recherches et d'effectuer une veille épidémiologique. Je n'ai pas changé d'avis depuis 2003. Ce sont les guerres et les épidémies qui ont changé l'histoire de l'humanité. La gestion des épidémies doit relever du domaine régalien. Force est de constater qu'un tel modèle régalien manque toujours. Il est vrai que le fait que les ministres de la santé restent en moyenne en poste deux ans et demi seulement ne facilite pas le déploiement d'une telle politique. Dans ce même rapport, je recommandais de mettre en place une veille quotidienne de la mortalité pour détecter les phénomènes anormaux. Personne ne surveillait la mortalité et le ministre a eu la surprise de constater que depuis la guerre, il y avait eu six pics de mortalité – trois liés à la grippe, trois à la canicule – passés inaperçus alors même qu'ils avaient concerné à chaque fois plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est grâce à une surveillance syndromique que la maladie du légionnaire et le sida ont été découverts. Pour cerner les maladies inconnues, on ne peut, par définition, s'appuyer sur les diagnostics.
En 2005, j'ai eu un choc en visitant à Shanghai un centre, monté en deux ans en réponse au SARS, dix fois plus grand que l'IHU et mieux équipé. Cela m'a redonné l'envie de poursuivre dans les voies que j'avais tracées. Ce qui aurait dû être un projet régalien est devenu un projet de recherche intégrant la construction d'un centre de soins et d'observation et d'un centre de lutte contre les crises. Je crois en ce modèle depuis vingt ans mais il est difficile à mettre en place parce qu'il remet en cause les modes d'organisation établis. Il y a cinquante ans, l'Institut Pasteur accueillait des malades, faisait des milliers de diagnostics et de l'épidémiologie de terrain alors qu'aujourd'hui il est devenu un institut de recherche fondamentale, dans lequel ces activités sont marginales. On ne peut gérer une crise si on n'accueille pas les malades et que l'on n'a pas les moyens d'effectuer 10 000, 20 000 voire 30 000 tests PCR par jour. Cela ne peut se faire que dans les hôpitaux ou les centres hospitalo-universitaires (CHU) au sein desquels l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) n'est plus implanté et l'Institut Pasteur est absent. Il faut déployer une réflexion de fond sur le maillage du territoire par des centres capables de faire face à une crise. L'État doit résister au jeu des élections professionnelles des commissions médicales d'établissement (CME) et aux changements fréquents de directeurs d'hôpital. Dans chaque zone de défense, il faut qu'il impose un centre capable de l'aider à surmonter une crise liée à une maladie infectieuse. C'est, je le répète, une question de pouvoir régalien.
Bien que j'aie moi-même deux centres nationaux de référence, je n'y suis pas favorable s'ils deviennent le petit monopole ou le terrain de chasse de ceux qui les dirigent. Au moment de l'épidémie d'Ebola, seul le laboratoire P4 de Lyon pouvait faire des tests PCR. Dès qu'on avait un malade, il fallait envoyer le sérum là-bas, nous n'avions pas le droit de réaliser des tests, alors même que des réactifs étaient commercialisés pour le faire. Ce sont les militaires, à Paris, qui ont fini par décider de faire eux-mêmes leurs tests, à Bégin. Le risque, quand quelqu'un a un centre de référence, c'est qu'il s'approprie une maladie pour devenir l'homme de l'année. Au début de la crise, nous avons demandé à Bruno Lina de nous envoyer la souche pour avoir un témoin positif vivant, plutôt qu'un témoin positif artificiel : il ne nous a jamais répondu. Les humains sont des humains et il est dangereux de confier la sécurité du pays à des personnes qui considèrent que c'est leur affaire personnelle.
L'IHU a été fait dans la douleur mais j'estime que j'ai fait mon devoir. Nous avons prouvé qu'il fallait une structure de ce type et je pense même qu'il en faut plusieurs, pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a qu'à Marseille qu'on arrive à faire s'écrouler le taux de mortalité et à avoir des statistiques sur les données. L'État doit se saisir de la question des épidémies mais j'ai constaté, quand j'étais chargé de mission auprès de Jean-François Mattei, que l'Institut Pasteur et l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) voulaient tout prendre en charge, alors que leur organisation ne s'y prêtait pas – que fait-on quand on a besoin d'un résultat le week-end ou après dix-neuf heures et que ces établissements sont fermés ?
Ce fonctionnement est d'un autre temps. La seule institution qui est ouverte jour et nuit, c'est le CHU. Dans les gros CHU, il y a du personnel en permanence et des machines. Il faut y regrouper les infectiologues et les microbiologistes capables de faire de la biologie moléculaire pour qu'ils travaillent ensemble. À l'IHU, nous sommes suréquipés et nous sommes les seuls à pouvoir relever le défi technologique lancé par l'Extrême-Orient. Je suis inquiet de voir que c'est la seule région du monde qui a encore un niveau scientifique compétitif : il n'y a rien de comparable, ni en Europe, ni aux États-Unis. Pourtant, si vous avez un synthétiseur pour faire vos amorces et que vous réalisez vous-même la préparation, vous pouvez faire des PCR pour tout ce que vous voulez.

Vous critiquez la prééminence des CNR mais, dans l'organisation actuelle, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
La manière dont tout cela s'est organisé est totalement archaïque. L'idée qu'il faut s'appuyer sur des centres nationaux de référence de diagnostic est vieille de quarante ans. Aujourd'hui, avec le multiplexage, quand quelqu'un a une infection respiratoire, il y a vingt virus à tester et on les fait tous d'un coup : on ne recourt pas à quatre ou cinq laboratoires. À l'IHU, on n'en est même plus là : on fait du séquençage massif. On séquence tout et on regarde ce qu'on a. Quand nous avons eu notre premier cas positif, nous avons eu le génome entier au bout de huit heures. On aurait pu le faire pour n'importe quel virus et l'identification sur une base de données ne nécessite aucune spécialisation.
Avoir des centres spécialisés pour tenir à jour la bibliographie, c'est utile, mais pas pour le diagnostic : cela n'a aucun sens. L'IHU est devenu le centre national de référence pour les Rickettsies, parce que la sérologie était très difficile à l'époque, mais c'est dérisoire. À part dans quelques niches, des tests diagnostiques arrivent sur le marché. Il est tout à fait ridicule que les CNR aient eu à se prononcer sur la valeur des tests qui sont passés au marquage CE (conformité européenne) et FDA (Food and Drug Administration). L'idée selon laquelle on pourrait tout réinventer en France, dans un petit centre de référence, est absurde.
Laissez-moi vous donner un autre exemple, qui ne vous paraîtra pas suspect : on a actuellement une énorme épidémie d'infections à Clostridium difficile, qui m'inquiète beaucoup. Le centre national de référence pour cette infection est tenu par un bon ami à moi, Raymond Ruimy, à Nice. Dès qu'il a eu dix cas, il n'avait plus les moyens de faire la culture du virus et son génotypage. L'IHU s'en est occupé et on en a fait dix par semaine, parce qu'on avait la taille et l'équipement. Il faut sortir de cette logique où Paris répartit les virus entre les différents centres pour ne vexer personne.
Cela fait longtemps que je dis qu'il faut confier les maladies émergentes à deux centres capables de tout faire à la fois – Didier Houssin, que vous venez d'entendre, avait presque accepté cette proposition. C'est le choix qu'ont fait les Chinois : ils n'ont pas des petits centres spécialisés, mais des centres capables de détecter tout à la fois. Il faut pouvoir faire de la culture virale, avoir les moyens de faire du séquençage massif et avoir de la microscopie électronique – je rappelle, en disant cela, que j'ai un conflit d'intérêts dans ce domaine.
Cette organisation est désuète : je l'écrivais déjà il y a vingt ans et je n'ai pas changé d'avis. Je ne tiens pas à ce que l'IHU ait le monopole de la recherche sur les maladies émergentes : j'ai toujours dit le contraire. Il faut six ou sept centres en France, mais il faut que l'État se saisisse de cette question pour éviter l'autogestion des maladies infectieuses par quelques tout petits centres nationaux de référence, car cela ne marche pas. Quand une nouvelle infection arrive, tout le monde y voit une aubaine, cherche à se l'accaparer et les choses deviennent difficiles.
Je l'ai dit en face à Jean-François Delfraissy : on pouvait faire les tests, à condition de le décider – puisqu'on devait les faire, on aurait trouvé le moyen de les faire. J'aurais été ravi de donner mon opinion, mais si je ne suis pas resté dans ce conseil scientifique, c'est parce que je considérais que ce n'en était pas un. Je sais ce qu'est un conseil scientifique et je peux vous dire que celui de l'IHU fait rêver le monde entier : il n'y a que des stars dans leur domaine. Pour moi, le conseil scientifique devait s'occuper de questions scientifiques et non pas réfléchir au confinement ou à des questions de ce genre. Les discussions qui s'y déroulaient ne me concernaient pas. Quand j'ai appris que les essais de Yazdan Yazdanapanah, comme le projet scientifique du ministère de la recherche, avaient été lancés en dehors de tout conseil scientifique, cela a confirmé mon opinion.
J'ai dirigé un certain nombre de conseils scientifiques depuis 1989, dans mon université, puis au ministère de la recherche, en 1993, je sais ce que c'est. Un conseil scientifique, ce n'est pas une bande de types qui ont l'habitude de travailler entre eux et qui donnent leur avis : il faut analyser des données, rien que des données, et lancer des propositions pour faire de la science et de la médecine. Je ne me suis pas fâché et, pour ne pas donner le signe d'une désapprobation publique, je n'ai pas démissionné. J'ai dit que je continuerais d'informer le ministre des solidarités et de la santé et l'Élysée de mes recherches, ce que j'ai fait. Mais le conseil scientifique ne me semblait pas adéquat : il ne comprenait pas un seul des dix spécialistes français du coronavirus – vous pouvez trouver leurs noms sur le site expertscape.com.
Dans mon rapport de 2003, j'avais déjà pointé deux problèmes : les conflits d'intérêts et la sélection des experts. Je disais que les conflits d'intérêts allaient nous polluer. On a eu le Médiator, on va avoir Gilead et les autres : il serait temps de s'en occuper… Dominique Maraninchi, lorsqu'il était directeur de l'ANSM, a créé avec Xavier Bertrand la base de données publique Transparence - Santé (www . transparence-sante.gouv). C'est très bien, mais il faut l'utiliser !

Pardonnez-moi : qui a eu des conflits d'intérêts au sein du conseil scientifique ou autour de lui ?
Tout cela est transparent.
Il suffit de consulter le site Euros For Docs : tout y est, vous pouvez regarder. Moi, je vous ai dit que j'avais un conflit d'intérêts avec Hitachi et je l'ai rappelé quand j'ai parlé des microscopes électroniques. Je n'ai pas le droit de recommander quelque chose en lien avec ce sujet, que ce soit pour ou contre – et cela vaut aussi pour l'hydroxychloroquine.
La sélection des experts est tout aussi problématique. À une époque, l'Institut Pasteur nous envoyait toujours le même expert sur le sujet du charbon, soi-disant polyvalent, mais qui n'était expert de rien du tout. Il a essayé de se faire recruter à l'IHU mais on a découvert qu'il avait bidouillé son CV et doublé le nombre de ses publications – l'Institut Pasteur a fini par le mettre dehors. Il faut s'assurer de la neutralité des experts. L'Observatoire des sciences et techniques est parfaitement compétent dans ce domaine : il faut lui demander une évaluation de la qualité des experts. Et il ne faut pas se contenter de l'autodéclaration des intéressés sur Transparence santé. Les experts, sur les questions dont ils sont saisis, ne doivent pas avoir de conflits d'intérêts. Si quelqu'un qui a travaillé pour Gilead parle de microscopie électronique, cela ne me gêne pas, mais c'est un problème s'il doit s'exprimer au sujet du remdesivir… Il n'y a pas de repas gratuit, disait Milton Friedman.

Dans une interview parue ce matin, vous avez déclaré que, dans ce pays, on adore décapiter les gens. Avez-vous le sentiment qu'on essaie de vous décapiter ? Si tel est le cas, qui cherche à le faire et pourquoi ?
D'après les données de Santé publique France, notre pays a compté 440 décès par million d'habitants, soit 30 000 personnes. À Marseille, où vous appliquez votre protocole, le nombre de décès par million d'habitants a été trois fois inférieur. Si le Gouvernement avait appliqué votre protocole partout en France, aurait-on pu sauver trois fois plus de vies ? Le docteur Christian Perronne dit qu'on aurait pu en sauver 25 000.
Enfin, s'agissant des tests, pensez-vous qu'il y ait eu un blocage volontaire de la part de l'Institut Pasteur et des centres nationaux de référence ? Pourquoi n'étions-nous pas prêts ? Qu'est-ce qui a empêché de mener une politique de dépistage massif, comme celle que vous avez menée à Marseille, notamment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ? Vous avez dénoncé ce monopole : en avez-vous parlé au Président de la République et était-il possible d'évoluer là-dessus ?
Je crois qu'on a évolué et que le ministre des solidarités et de la santé a fini par comprendre qu'il fallait tester massivement, même si cela arrive un peu à contretemps. Je répète que pour comprendre la maladie, il faut en faire le diagnostic. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. Un monsieur chinois de 80 ans qui arrivait du Hubei s'est présenté à la Pitié Salpêtrière avec de la fièvre : il n'a pas été testé, parce que Santé publique France avait dit qu'il ne fallait tester que les gens arrivant de Wuhan, qui avaient de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui et il est revenu sept jours plus tard, après avoir contaminé sa fille, pour mourir à l'hôpital, où on lui a donné du remdesivir. Voilà comment les choses se sont passées !
Il y a une forme d'arrogance à prévoir comment vont se présenter les personnes atteintes d'une maladie qu'on ne connaît pas. Et on a justifié cette attitude en disant qu'on ne pouvait pas faire de tests. Je reçois des milliers de prélèvements du monde entier, de la Mayo Clinic, du Massachusetts General Hospital, pour des PCR et au début de la crise, on m'a empêché d'en faire pour le diagnostic du Covid-19 en France !
Il faut faire la part des responsabilités humaines et celle des problèmes structurels. Si l'on maintient ce système fondé sur de petits centres nationaux de référence, on va développer des personnalités de blaireaux dans leur terrier qui mordent si on s'en approche. Les humains sont attachés à leur territoire et si l'un d'eux pense qu'une maladie est son territoire, on est perdu. Croyez-en mon expérience : créer, dans la République, des territoires pour des problèmes généraux, c'est aller au-devant de difficultés considérables.

Donc cela n'a rien à voir avec le manque d'écouvillons… Avez‑vous une idée du nombre de vies que la généralisation de votre protocole aurait permis de sauver ?
C'est difficile à dire… Dans une étude qui vient de sortir à Paris et pour laquelle nous avons fait un calcul grossier sur 4 500 personnes, dont 600 avaient pris du Plaquenil, on constate une différence de mortalité de 20 %, soit 150 personnes. Ce travail est en ligne : tout le monde peut le consulter. Parmi les auteurs de l'article, beaucoup avaient d'abord été critiques à mon égard, mais la vie est malicieuse… Deux éléments me semblent inquiétants dans cette étude. D'abord, la proportion de personnes de moins de 65 ans qui sont mortes à Paris est de 17 %, contre 10 % en Europe : c'est qu'il s'est passé quelque chose ici dans la prise en charge. Par ailleurs, la mortalité dans les services de réanimation est montée à 43 % à Paris, contre 16 % chez nous. Pourtant, ce sont les mêmes malades…
Pour moi, il y a eu deux problèmes majeurs, en dehors des phénomènes structuraux.
Premièrement, on a fait le choix de placer le soin au second plan et on est allé jusqu'à interdire l'usage de médicaments génériques qui avaient été distribués à des milliards de comprimés. Je rappelle qu'on a distribué 36 millions de comprimés d'hydroxychloroquine en 2019 sans ordonnance et, d'un coup, on a décidé qu'il ne fallait plus l'utiliser. Celui qui a aidé à prendre cette décision a commis une faute. Maintenant, on interdit même l'azithromycine pour traiter les pneumopathies suspectes de covid, alors que c'est le médicament le plus utilisé contre les pneumopathies. Aux États-Unis, chaque année, une personne sur huit prend de l' a zithromycine, et on veut faire passer ce médicament pour un poison violent ! Vous savez, si vous doublez la dose maximale de Doliprane, vous mourez. Les médicaments deviennent dangereux si on ne les prend pas à des doses normales.
Moi, j'utilise le Plaquenil depuis vingt-cinq ans pour les maladies dont je suis le spécialiste : je le prescris pour deux ans, à 600 milligrammes par jour, en faisant des dosages tous les mois. Ce sont des choses qu'on maîtrise. Le papier paru dans le Lancet parlait de 10 % de morts. C'est impossible, puisque nous avions déjà traité deux fois 3 000 personnes avec ce médicament : je ne peux pas avoir laissé passer 600 morts sans m'en apercevoir. Je sais combien de personnes passées par l'IHU sont mortes : elles sont au nombre de 36 et je sais de quoi elles sont mortes. Ce débat a pris un tour déraisonnable.
Deuxièmement, c'est aux docteurs, et non à l'État, de soigner les malades. Au moment de la grippe H1N1, déjà, on a fait vacciner les gens dans des stades ; moi, je disais que c'était aux médecins généralistes de le faire. On a pris du retard dans la vaccination antigrippale à cause de ça. Je ne suis pas favorable à ce que l'État prenne en charge, à la place des médecins, des tâches qui relèvent du soin usuel et qu'il leur interdise de faire des choses tout à fait banales. Je vous le dis très officiellement : je suis surpris que l'ordre des médecins ait accepté une chose pareille et que son président n'ait pas démissionné immédiatement, car la responsabilité des médecins est de faire pour le mieux dans l'état de leurs connaissances. D'ailleurs, quand des médecins ont commencé, sur la base de nos résultats, à utiliser ce traitement dans le soin courant, je me suis assuré auprès du directeur général de la santé qu'ils avaient bien compris les choses de la même manière que moi – j'ai conservé ce mail. Les médecins doivent faire pour le mieux pour leurs malades, en leur âme et conscience, compte tenu de l'état des connaissances. Les priver de cela, je ne sais même pas si c'est constitutionnel : ce serait à vous de me le dire !

L'un des objectifs de notre commission d'enquête est d'analyser la difficulté de la décision publique face à la controverse scientifique. Pendant deux mois, alors même qu'on était en pleine crise, les Français ont découvert sur les chaînes de télévision que des médecins ou des scientifiques préféraient s'opposer et polémiquer, plutôt que d'essayer de se convaincre. Finalement, ils ressemblaient aux hommes politiques dans ce qu'ils ont de moins bon. Vous avez parlé des conflits de personnes et des conflits d'intérêts. Mais comment éviter cela à l'avenir ?
Je répète qu'il y a des problèmes structurels. Nous n'aurions pas ce type de difficultés si le monde scientifique était constitué de vrais sachants, dépourvus de conflits d'intérêts, qui débattent entre eux. Lorsque Philippe Lazar a été nommé président de l'INSERM en 1981, il a commencé par virer les cinq personnes les plus connues en France dans le domaine de la médecine, parmi lesquelles Jean Hamburger, le premier à avoir fait une greffe de rein au monde, Georges Mathé, qui a inventé le traitement du cancer de la vessie par le BCG, qu'on utilise tout le temps, et Jean Dausset, le seul prix Nobel en exercice. M. Lazar avait décidé qu'on ne pouvait pas diriger une unité de l'INSERM plus de douze ans. À ce propos – et je l'ai dit au Président –, quand j'ai été viré par M. Lévy, j'ai eu le sentiment d'appartenir à un club dont je ne savais pas que j'avais le niveau. Ça a été le début d'un mouvement de sortie de l'INSERM des hôpitaux, alors que cet institut avait été créé pour faire de la recherche médicale dans les hôpitaux et que toutes les premières unités y avaient été implantées. La recherche médicale qui reste à l'hôpital manque d'organisation : c'est un vrai problème, qui n'est pas nouveau.
Le législateur a introduit la tarification à l'activité (T2A) et défini des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation (MERRI), dont vous votez le budget tous les ans, sur des critères objectifs, puisqu'ils sont bibliométriques. Mais il se trouve que les sommes que vous allouez à la recherche ne la financent pas, parce qu'on a oublié de prendre un arrêté sur la non-fongibilité de ce budget. Le conseil d'administration fait ce qu'il veut de cet argent et il n'a aucun compte à rendre. C'est pourquoi il n'y a pas d'argent pour faire de la recherche dans les hôpitaux – sauf à faire de la recherche sauvage.
La troisième source de financement, c'est l'industrie pharmaceutique, qui a un budget de financement égal au volume complet du budget de l'INSERM. Comme il existe une agence chargée spécifiquement de la recherche sur le sida et les hépatites, 70 à 75 % de la production scientifique, dans le domaine des maladies infectieuses, concerne le sida, les hépatites et les antibiotiques. Et tout le reste ne représente que 25 %. Si nous n'avons pas de sachants dans ces domaines, et si le financement autonome de la recherche dans les hôpitaux n'est pas assuré, il ne faut pas s'étonner que nous n'ayons pas la recherche que nous méritons. Je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises à ce sujet et c'est d'ailleurs pourquoi le directeur de l'INSERM m'était très hostile.
Je crois, comme Michel Foucault, que la vie sociale, c'est la guerre civile. On se dispute pour faire avancer les choses et il est normal, quand les choses vont mal, qu'il y ait des conflits. Si les choses vont mal, c'est qu'il y a des problèmes de fond. Dans cette affaire, j'ai été l'instrument de ce qu'Hegel appelle la ruse de la raison : à certains moments, la raison utilise des humains, les héros – même si je ne crois pas être un héros, ou alors un héros fictif – pour faire émerger un problème qui n'a pas été résolu et pour le mettre à plat. Je ne vous dis pas que j'ai raison : j'ai écrit cela il y a vingt ans et je le pense encore. En tout cas, je n'ai pas été démenti par les faits que j'ai pu observer.
Le problème n'est pas résolu et il reviendra. Si vous confiez la refondation de la recherche médicale à un groupe réunissant des gens de l'INSERM, de l'Institut Pasteur et quelques personnes qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique, on retombera dans la même crise.

On a du mal à cerner la place exacte qui a été la vôtre dans la gestion de la crise. Vous avez été membre éphémère du conseil scientifique et il serait intéressant de savoir en quoi a consisté votre participation lors des premiers échanges – je crois que vous l'avez quitté au moment du deuxième avis. Vous avez reçu le Président de la République au début du mois d'avril, vous avez discuté avec lui et il a reconnu que, s'agissant des tests, vous aviez été visionnaire et qu'il fallait effectivement les massifier. Vous nous dites que vous avez eu des contacts réguliers avec le Président de la République et avec le ministre des solidarités et de la santé et que c'est peut-être sous votre influence que le président a décidé de rouvrir les écoles. En quoi considérez-vous avoir été écouté ? En quoi, a contrario, pensez-vous ne pas l'avoir été ?
C'est surtout à moi-même que je rends des comptes, car j'essaie d'être en accord avec moi-même. J'ai pensé que je pouvais être utile dans cette crise, parce que j'ai une expérience extrême dans ce domaine. J'ai essayé de le faire comme je pouvais. Il se trouve que j'étais un ovni dans ce conseil scientifique, ou un extraterrestre : il n'y avait pas de compatibilité génétique entre nous. Les gens qui en faisaient partie se connaissaient, ils travaillaient ensemble au sein du groupe REACTing de l'INSERM depuis des années. Je pense que c'est le Président de la République qui a souhaité que j'en fasse partie mais je suis arrivé parmi des gens qui étaient habitués à travailler ensemble, qui avaient déterminé à l'avance ce qu'il fallait faire. Or je n'étais pas d'accord. Il y a deux molécules dont on pensait qu'elles pouvaient être efficaces et je pensais qu'il fallait faire l'essai avec les deux molécules. Mais nous n'arrivions pas à nous parler. J'ai continué à penser que je pouvais être utile et je crois que c'est ce qu'ont aussi pensé le Président de la République et le ministre des solidarités et de la santé. À chaque fois que nous avons trouvé quelque chose, j'en ai toujours informé le ministre ou un de ses conseillers avant d'en parler publiquement.
Je pense avoir convaincu le président Macron qu'il fallait tester massivement. Je lui ai montré le début de l'inversion de la courbe, qui permettait d'envisager une sortie de crise en mai. Je lui ai montré, aussi – j'étais l'un des premiers à le dire à l'époque – que le virus touchait peu les enfants. M. Delfraissy disait que les choses n'étaient pas si claires, mais moi, j'ai sorti le papier que j'avais écrit sur le dosage chez les enfants : comme j'étais le seul à m'être intéressé à cette question, j'étais le seul, dans le pays, à savoir. Cela vous donne une idée du niveau des discussions au sein du conseil scientifique… On doit débattre en mettant des données sur la table. Je ne suis pas un homme de réunions, je suis un homme de données : j'aime en créer et réfléchir à partir d'elles. C'est moi aussi qui ai dit au Président de la République qu'il fallait ressusciter la médaille d'honneur des épidémies, dont peu de gens se souvenaient. Je pense qu'il va le faire, parce qu'au cours d'une épidémie, certaines personnes font preuve d'un dévouement incroyable et il faut que la République reconnaisse leur effort. Cela ne doit pas forcément passer par l'ordre du mérite ou par la légion d'honneur. Vous le voyez, plusieurs des choses dont nous avons parlé ont eu des conséquences.
Dès que j'ai eu des données sur les séquelles, je l'en ai informé – je l'ai fait hier encore. Vous savez que la perte de l'odorat, qu'on a longtemps négligée, est un signe clinique important, notamment chez les personnes de moins de cinquante ans – comme la perte du goût, qui est une question encore plus complexe. La perte de l'odorat est généralement associée à des formes sans gravité de la maladie. Nous avons interrogé 3 000 personnes dont le test sérologique était positif : celles qui ont perdu l'odorat se rappellent très précisément le moment où c'est arrivé. La perte de l'odorat a une valeur prédictive de 66 % : cela signifie que dans 66 % des cas, lorsque vous êtes positif et que vous avez moins de cinquante ans, vous avez une perte de l'odorat. Or 30 % de ces gens n'ont pas récupéré leur odorat.
Au PET scan, on voit que le cerveau olfactif, qui est juste au-dessus des sinus, fonctionne moins bien : il présente un hypométabolisme qui peut s'étendre à l'arrière et toucher la concentration, l'équilibre et la mémoire. Certaines personnes ont aujourd'hui des troubles de la concentration ou de la mémoire, qui sont des séquelles de la maladie. Il est souvent difficile de mesurer ce genre de données subjectives, mais nous avons des outils pour le faire. J'en ai immédiatement informé le ministre des solidarités et de la santé, comme je lui avais dit que les scans low dose montrent un certain pourcentage de fibroses chez les gens qui ont été en réanimation. Tout ce que j'aurais dû transmettre au conseil scientifique – c'est-à-dire des données scientifiques –, je l'ai transmis directement à l'Élysée et au ministère des solidarités et de la santé, absolument tout. Tout ce que j'ai pu annoncer publiquement, je l'avais d'abord annoncé à mes autorités de tutelle.

Y a-t-il des points sur lesquels l'exécutif ne vous a pas écouté ? Et pensez-vous que si on vous avait davantage écouté, il y aurait eu moins de morts ?
Je pense qu'on a tenté de faire une vraie évaluation de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, mais trop tardivement. Le conseil scientifique n'a mis en place aucun essai, aucune évaluation : c'est une faillite totale. On aura peut-être un résultat un jour, mais quand il n'y aura plus de cas. Cela devrait vous amener à réfléchir à l'efficacité d'une telle stratégie.
J'aimerais disposer des résultats de Recovery et pouvoir les analyser moi-même. Ce n'est pas ma faute si l'on ne sait pas organiser les essais dans ce pays. Les essais sur le remdesivir n'étaient même pas réalisables, puisque ce médicament n'était pas disponible, il n'était pas manufacturé. Cette obsession de vouloir traiter les gens avec le remdesivir était absurde, puisque même si on avait pu montrer son efficacité, on n'aurait pas pu en avoir. Était-ce un jeu purement boursier pour faire monter la valeur de Gilead avant la fusion avec AstraZeneca ? Je me le demande…

Pourquoi n'avez-vous pas souhaité randomiser vos études ? Cela aurait permis d'éteindre les contestations. Par ailleurs, vous avez dénoncé le fait que l'on ne respecte jamais votre posologie quand on teste votre traitement : il est aberrant de prétendre que l'on a étudié les résultats d'un traitement si on ne le teste pas avec la même posologie.
Nous avons commencé à publier en ligne nos réflexions et nos cours bien avant l'épidémie ; le coronavirus a simplement amplifié le phénomène. Une fois par semaine, nous nous exprimons directement sur ce que nous savons ou croyons savoir, car les médias déforment la connaissance. L'un des jeudis thématiques de l'IHU, très précisément deux mois avant le début de l'épidémie, était consacré à la méthode : quelles sont les méthodes d'analyse, qu'est-ce que l'historique de la méthode ? C'est de l'épistémologie. Vous pouvez toujours le visionner sur le site : cela s'appelle « Contre la méthode ».
Le rite de la randomisation des grands essais thérapeutiques multicentriques est un phénomène extrêmement récent dans la science. Moins de 5 % des traitements des maladies infectieuses sont fondés sur des essais randomisés en double aveugle. Je ne me laisse pas impressionner par le fait que cela soit devenu la doxa. Les essais randomisés sont plutôt moins performants que les essais comparatifs historiques. Il est intéressant que cette critique ne s'applique qu'à moi, alors qu'il n'y a aucun essai randomisé en France !
La randomisation est un standard très associé à l'industrie pharmaceutique, qui ne me convainc pas. Nous avons donc fait un essai comparatif sur les gens de Nice et ceux de Marseille, avec une mesure très claire et simple : la persistance, ou non, du virus dans les prélèvements. Nous avons donné de l'hydroxychloroquine à un groupe et pas à l'autre et nous avons regardé dans quel groupe le virus disparaissait en premier. Il se trouve qu'un troisième groupe est venu se greffer aux deux premiers : celui des cas les plus graves, que nous traitons comme les affections virales sévères, en ajoutant de l'azithromycine à l'hydroxychloroquine. Nous nous sommes rendu compte qu'avec ce double traitement, la quantité de virus diminuait beaucoup plus rapidement.
Nous avons alors fait des tests statistiques simples et publié les résultats : cela a déchaîné un flot de réactions que je n'imaginais pas ! Si quelqu'un avait eu un doute scientifique après ce premier papier, il fallait refaire l'étude : or personne ne l'a fait. J'ai même été sidéré par une première étude faite en France, publiée dans le British medical journal. Elle comportait un groupe de seize personnes sous hydroxychloroquine et azithromycine, dans lequel on n'a compté aucun mort. Mais les auteurs ont refusé de faire le test de base de significativité pour montrer que ce groupe réagissait différemment des autres groupes – c'était le cas, mais ils ne l'ont pas publié. Je n'en connais pas la raison – j'ai une opinion mais je ne vous la dirai pas. Les méthodologistes ont prétexté qu'ils n'ont pas le droit d'analyser des choses qu'ils n'ont pas décidé d'analyser avant de commencer, même si c'est significatif. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas s'entendre : c'est le principe inverse de la découverte !

Vous êtes en train de nous décrire un monde de conflits d'intérêts, ou d'intérêts très puissants. Vous avez quitté le conseil scientifique parce que, selon vous, vous êtes trop occupé pour participer à des « couillonnades ». Vous nous expliquez par ailleurs que ces gens-là travaillent entre eux et que nous n'avons qu'à regarder où sont les conflits d'intérêts : j'aimerais que vous nous en disiez plus car notre objectif est de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Si vous nous avez donné quelques pistes, notamment sur les centres de référence, vous avez omis de parler de la place du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Enfin, vous avez dit qu'il vous paraissait improbable que nous obtenions un vaccin : j'aimerais savoir pourquoi.
Je vous recommande de faire une véritable enquête sur le laboratoire Gilead et le remdesivir. Gilead ne fonctionne qu'avec très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable : sa stratégie est essentiellement fondée sur l'influence. Quand j'ai parlé pour la première fois de la chloroquine, quelqu'un m'a menacé, à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par découvrir que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis six ans ! Je vous suggère donc d'être attentifs à ce problème. Il n'est pas compliqué de trouver qui a des conflits d'intérêts : consultez la base de données pour les infectiologues ! Nous avons regardé qui s'était exprimé dans la presse contre la chloroquine et avons comparé cela avec les sommes reçues de Gilead : cela correspond parfaitement ! Je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais il y a une coïncidence, au sens étymologique.
Je vous suggère très fortement de mesurer le niveau d'influence de cette compagnie. Cela existait déjà mais, en l'occurrence, cela a pris une ampleur que je n'avais jamais vue. Des liens s'étaient développés entre le groupe REACTing et Gilead lors de la tentative d'utilisation du remdesivir pour traiter Ebola, qui s'est soldée par un échec. Par ailleurs, j'ai été surpris de constater que le directeur de Gilead, devant le Président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19 : je n'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par un directeur de l'industrie pharmaceutique ! S'il le faisait, d'ailleurs, je lui répondrais en le vouvoyant !
Pour vous dire la vérité, je ne sais même pas si ce ne sont que des liens d'intérêts. Je ne vous dis pas que les gens ont été achetés, mais les relations de familiarité et les voyages faits ensemble créent un écosystème favorable, dans lequel se forge une vision du monde différente, de nature à changer le jugement des choses. J'ai vu cela quand j'étais jeune, pour les antibiotiques, et j'ai décidé de ne plus y participer parce qu'une croisière avait été organisée par un laboratoire qui avait invité 700 médecins. La première obligation de déclaration des liens d'intérêts auprès du conseil de l'ordre a été instaurée après que Merck a invité tous les médecins de France à se rendre en Chine pour des congrès factices.
À chaque nouveau virus, j'entends dire qu'un nouveau vaccin va arriver. Mais consultez Available vaccines WHO, sur le site de l'OMS, qui donne la liste des vaccins disponibles, et regardez combien ont moins de trente ans ! Ensuite, demandez-vous pourquoi, en France, on ne fait pas de vaccin contre la varicelle, dont on a plusieurs centaines de milliers de cas par an, ou contre le rotavirus, ou encore contre la grippe chez les enfants, alors que la grippe tue les enfants. L'implantation des vaccins est un problème politique et social. La capacité que nous avons eue dans les trente dernières années à implanter des vaccins est complexe et elle le sera davantage encore avec le coronavirus. Nous en avons fait l'expérience avec le vaccin contre la dengue – un des seuls nouveaux vaccins. Les gens vaccinés qui n'ont pas eu la dengue sont exposés à faire des dengues plus sévères que les gens qui n'ont pas été vaccinés : c'était une très mauvaise surprise.

La controverse sur la chloroquine n'en serait peut-être pas arrivée là si la France n'était pas l'un des rares pays où c'est le ministre de la santé qui dit comment soigner et avec quel médicament. Partout ailleurs, les médecins sont libres de prescrire en fonction de ce qu'ils ont appris. Votre intervention est une ode à la révolution girondine, appelant à mettre fin à la centralisation dans beaucoup de domaines, notamment la santé.
Alors qu'en avril, la France ne teste pas ou peu – sauf chez vous –, les Français découvrent médusés que les pays qui nous entourent font des tests, tandis que de nombreux laboratoires se tournent les pouces. La France n'a commencé à mener des campagnes de détection massives que mi-avril, alors que l'Italie et l'Allemagne disposaient de tests en nombre suffisant début avril. Il aurait fallu 700 000 tests dans notre pays dès début avril, pendant le pic de l'épidémie.
Vous êtes l'un des rares laboratoires à prendre les choses en main, en effectuant 150 000 tests. En a-t-il été pour les tests comme pour les masques ? Comme nous n'en avions pas suffisamment et que nous n'étions pas organisés pour en acquérir et en distribuer, on a expliqué, dès le début de la crise, que cela ne servait à rien de tester.
Selon le professeur Philippe Froguel, du CHU de Lille, tout le monde ment sur les tests, des directeurs d'hôpitaux à Emmanuel Macron en passant par la direction générale de la santé et Olivier Véran. Partagez-vous son sentiment sur l'absence de transparence et la cacophonie ? Combien de temps avons-nous perdu et combien de morts aurait-on pu éviter ?
Sur 4 500 personnes hospitalisées à Paris, il y a eu 20 % de morts en moins avec l'hydroxychloroquine ; on peut calculer assez simplement le nombre de morts que l'on aurait pu éviter, même si c'est complexe.
Philippe Froguel a écrit que sa direction lui avait interdit de faire des tests PCR alors qu'il pouvait en faire des milliers par jour. L'idée était que puisqu'on ne pouvait pas faire les tests, ceux-ci étaient inutiles – alors même que l'idée que l'on ne pouvait pas faire les tests n'était pas vraie. Elle reposait sur le fait qu'il serait compliqué d'obtenir les réactifs Qiagen, utilisés pour l'extraction, les États-Unis ayant tout de suite interdit leur exportation pour faire face à la crise.
J'ai indiqué au Président qu'une crise de cette nature devait être gérée par le SGDSN car j'avais constaté, lorsque j'étais au ministère de la santé, qu'il était le plus raisonnable de tous les directeurs. Le donneur d'ordres, c'est le responsable de la sécurité publique. Cela étant, je suis d'accord avec vous : la sécurité publique ne devrait pas pouvoir interdire aux médecins et aux pharmaciens de distribuer des médicaments qui ont fait la preuve de leur innocuité depuis quatre-vingts ans ! L'histoire de la chloroquine remonte très loin : elle vient du Pérou, du quinquina. Il y a eu un drame similaire concernant l'utilisation du quinquina : Louis XIV, qui faisait des fièvres récurrentes, a pris du quinquina en public, permettant à celui-ci d'entrer dans la pharmacopée française. Cela a donné la quinine, puis la chloroquine et enfin l'hydroxychloroquine, qui sont tous les enfants du quinquina ; c'est un médicament issu des plantes.

L'étude Recovery affirmerait que l'hydroxychloroquine n'aurait pas d'efficacité avérée contre la Covid-19. Vous affirmiez vous-même, il y a quelques semaines, que son efficacité n'était pas encore prouvée, mais vous défendiez tout de même la prescription de cette molécule parce que les premiers résultats de vos recherches s'avéraient concluants et que ces effets secondaires étaient connus. Comment juger cette étude ? Les nombreux rebondissements qui ont suivi ces déclarations rendent particulièrement complexe l'attitude à avoir en matière de politique de santé.
Ainsi, l'essai clinique de Discovery, qui a été « opposé » à votre essai, aurait échoué parce que les autres pays européens n'y sont pas entrés. Mais beaucoup de soignants, dont moi, ont été étonnés que la raison de l'échec ne vienne pas du fait que l'on pouvait deviner très vite, selon la posologie, quel traitement on donnait au patient. Or, dans un essai clinique, on n'est pas censé savoir ce que l'on donne à nos patients.
Ces épisodes successifs montrent à quel point les enjeux de pouvoir sont légion au sein de la recherche et ne servent pas nécessairement l'intérêt général. Pouvez-vous nous indiquer sur quels critères vous vous appuyez pour juger de la crédibilité d'une étude scientifique ? Les financements sont-ils déterminants ? Les critères sont-ils méthodologiques ? La réputation des scientifiques est-elle impliquée ?
Avec toute votre expérience des épidémies et de la crise sanitaire de la Covid-19, avez-vous constaté une efficacité provenant d'une autre molécule que la chloroquine, à un stade en particulier ou à tous les stades de la maladie ?
Pour comparer les études, on a recours à la méthode de la méta-analyse. Nous en avons fait une disséquant les différentes études sur l'hydroxychloroquine. C'était la première fois que l'on voyait cela : les conclusions allaient dans deux sens, de façon tranchée, ce qui n'est pas compréhensible. Quatre randomisations ont été proposées, dont trois montraient la supériorité de l'hydroxychloroquine. Les autres essais étaient des essais comparatifs entre populations. Les seules études qui parvenaient à une conclusion opposée – jusqu'à l'étude Recovery, dont il faut néanmoins attendre qu'elle soit publiée – étaient uniquement fondées sur des données quantitatives hospitalières, du big data – comme celle de The Lancet – n'étaient pas réalisées par les gens qui avaient observé les malades, et toutes avaient des conflits d'intérêts avec Gilead.
J'ai eu une longue discussion avec les gens de The Lancet une fois qu'ils ont sorti cette étude. La même semaine, cette revue a reçu trois articles : notre article sur 3 700 patients, où aucun mort n'était imputable à l'hydroxychloroquine ; l'étude fantasque des Pieds nickelés américains, dont tout le monde pouvait voir qu'elle n'était pas vraie ; une troisième étude, dont j'ai fait la revue, qui rapportait une expérience de l'association internationale des rhumatologues. Dans cette expérience portant sur des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, un groupe de 930 000 personnes a reçu de l'hydroxychloroquine – c'est comme cela que l'on traite cette maladie – et un groupe de 350 000 personnes a reçu du sulfamide : aucune différence n'a été constatée dans les accidents cardiaques, car il n'y en a pas ! Or les gens du Lancet ont rejeté les deux études démontrant qu'il n'y avait pas d'accidents, et publié l'étude des Pieds nickelés. Je ne suis pas paranoïaque mais là, on commence à se poser des questions ! Comme personne ne pouvait croire cette bêtise, ils ont dû se rétracter ; ils ont même reçu une pétition lancée par le spécialiste des maladies tropicales le plus connu au monde, Nicholas White, avec toute l'équipe d'Oxford, leur disant qu'ils ne pouvaient pas publier une chose pareille. The Lancet aurait pu publier deux des trois articles ou un éditorial signalant que personne n'avait jamais vu les 10 % de morts mentionnés dans l'étude qu'ils publiaient. Je ne sais pas si c'est un choix délibéré. Je préfère que ce soit de l'incompétence, mais il y a quand même un problème.
Quand la décision a été prise en France de supprimer la chloroquine, le ministre de la santé de la Guinée a demandé si les Français n'étaient pas un peu bizarres. Les Guinéens connaissent bien la chloroquine : ils l'utilisent plus que nous ! Quand les Anglais ont publié leur méthodologie pour Recovery, des médecins internistes indiens ont dit qu'Oxford ne savait pas se servir de la chloroquine parce qu'il l'utilisait à quatre fois la dose – la dose toxique !
Autre point très inquiétant dans Recovery : l'expérimentation avec les corticoïdes, qui font partie des soins courants en réanimation pour les pneumonies sévères – entre 10 et 30 % des personnes en réanimation reçoivent des corticoïdes, en fonction du tableau clinique. Faire de l'expérimentation avec les corticoïdes, cela revient à transformer les malades en objet d'essais thérapeutiques : ce n'est pas ce qui doit se faire.

Je reviens sur votre comparaison entre les taux de mortalité parisien et marseillais : quelle est l'origine de vos chiffres ? Il n'y a pas de publication de chiffres par ville. Plus on teste, et plus mécaniquement le taux de mortalité baisse. De plus, les populations ne sont pas les mêmes à Paris et à Marseille et les Bouches-du-Rhône et la région PACA ont été moins touchés que la région parisienne. J'aimerais donc connaître votre analyse sur ce point.
Concernant votre départ du conseil scientifique, je veux aborder le sujet de l'humilité et de la modestie dont nous devrions tous faire preuve face à cette maladie. Ce conseil poursuivait également un objectif éthique, et il aurait été intéressant d'avoir des données d'un expert tel que vous pour orienter les décisions concernant l'humain et l'éthique.
Enfin, vous avez associé azithromycine et hydroxychloroquine : je peux comprendre le président du conseil de l'ordre, sachant que ces deux médicaments augmentent les risques cardiaques majeurs. Il faut faire attention de ne pas prescrire sous le coup de l'émotion. Ne pensez-vous pas avoir été finalement le meilleur ennemi de l'hydroxychloroquine, avec ces études dont le protocole présentait des biais et qui ont provoqué un ressenti négatif dès le départ ?
Probablement près de 50 % des médecins dans le monde – et en France aussi – utilisent azithromycine et hydroxychloroquine pour traiter le covid : imaginez le nombre que cela représente ! Le message a bien été entendu par les médecins mais ils n'ont pas eu le droit de le faire. Je veux bien être le bouc émissaire, mais la vraie question n'est pas celle-là.
Les Chinois sont en train d'expliquer comment ils ont géré leur épidémie : commençons donc par regarder ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé que des malades asymptomatiques pouvaient avoir des lésions ; ils ont découvert les premières fibroses, pour lesquelles ils ont fait des greffes de poumons. Beaucoup d'études ont été publiées en Chine : ce sont les premiers à avoir eu le virus, à avoir testé des médicaments, à avoir traité les malades. Ils ont fait des recommandations qui n'ont rien à voir avec les nôtres, et je suis d'accord avec eux. Ils ont conseillé de traiter les malades mais de ne pas leur donner plus de trois antiviraux à la fois, parce qu'au-delà, on ne sait pas ce que cela donne. Leur objectif, c'était de soigner, soigner, soigner, et je suis d'accord avec cela. Les Chinois ont souvent appliqué des stratégies thérapeutiques avec lesquelles je suis d'accord.
Le problème tient à ce que les pays d'Europe de l'Ouest se sont crus plus malins ; or ils ont des mauvaises habitudes. C'est en Angleterre, en France, en Belgique et en Espagne qu'il y a eu le plus de morts. Les Italiens ont commencé à faire des tests massifs et à donner de l'hydroxychloroquine dès qu'ils ont compris comment cela se passait ; après un départ extraordinaire, leur mortalité est désormais plus basse. Les quinze pays les plus touchés, qui ont eu le plus de morts, sont quinze pays riches du groupe Europe-États-Unis. Sait-on encore traiter les maladies infectieuses aiguës sans que cela devienne un marché ou un conflit politique ? Ce débat a eu une répercussion mondiale parce que Trump s'en est emparé, suscitant une guerre civile entre pro et anti-Trump ; je n'ai rien à voir avec cela !
La première molécule testée par les Chinois et qui a donné des résultats, c'est la chloroquine : comment se fait-il qu'en France, on ne l'ait jamais utilisée dans des essais, sauf quand il était trop tard pour le faire ? C'est une vraie question. Je ne suis pas le premier à utiliser la chloroquine : j'ai rapporté ce que faisaient les Chinois. Il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles ! J'ai vu comment ils travaillaient : je n'ai pas vu un laboratoire en France qui ressemblait à ce que j'ai vu en Chine. Je crois qu'ils sont meilleurs que nous.

Je ne voudrais pas laisser penser que les médecins n'ont pas soigné les patients en France, et que les chercheurs français n'ont pas conduit de recherches sur ce virus.
Il faut regarder le chiffre de la mortalité brute par million d'habitants. C'est un phénomène indépendant des tests, qui dépend de l'épidémiologie. En revanche, la structure de la mortalité est témoin de la qualité des soins : dans un même échantillon de 100 personnes, si vous avez 8 % de morts de moins de 65 ans, ou si vous avez le double, cela signifie qu'il s'est passé quelque chose dans la qualité de la prise en charge et des soins. Et cela, c'est indépendant des tests.

Comment expliquer que certaines régions en France aient été plus touchées que d'autres ? Mulhouse, dont je suis député, a ainsi été particulièrement touchée. Vous déclariez récemment que certaines personnes pouvaient avoir une immunité naturelle : pouvez-vous nous en dire plus ? Selon le professeur Delfraissy, il existerait des supercontaminateurs : avec leur très forte charge virale et leurs gouttelettes pouvant rester dans l'air en aérosol, ils peuvent contaminer un nombre beaucoup plus important de personnes. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
Je vais vous dire le peu que je sais – les gens qui vous expliquent qu'ils ont compris quelque chose vont au-delà de l'état de la connaissance : on n'en sait rien du tout ! Les maladies infectieuses sont des maladies de l'écosystème, personnel et général. Je m'y intéresse depuis des années, j'ai même publié des travaux sur le phénomène saisonnier ; or je ne le comprends absolument pas. La grippe est appelée influenza di freddo parce qu'elle survient pendant l'hiver dans les pays tempérés. Mais en Afrique, il y a des grippes toute l'année, particulièrement pendant la saison des pluies, et personne ne peut expliquer pourquoi.
Nous avons passé un contrat avec l'Arabie saoudite pour tenter de comprendre les échanges de microbes lors du pèlerinage de La Mecque, où la densité humaine n'a rien à voir avec ce que l'on a connu à Mulhouse : trois millions de personnes qui tournent ensemble. Nous testons depuis dix ans des volontaires qui s'y rendent : on leur fait des prélèvements avant et après, et on regarde avec quoi ils reviennent. Certains reviennent avec la grippe mais il n'y a pas de cas secondaire parce que les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Nous avons une théorie pour l'expliquer mais c'est extrêmement complexe. La seule chose que l'on sait, c'est que, dans l'histoire de l'humanité, les épidémies se sont toujours arrêtées, même les pires.
Pour donner un exemple récent, des études sur le SARS à Hong Kong ont permis de trouver un supercontaminateur : un homme qui avait attrapé le SARS a vomi au milieu du couloir d'un hôtel et tous les gens qui étaient à l'étage l'ont attrapé. On estime qu'il a contaminé cent personnes, alors que le ratio moyen de contamination n'est que de deux ou trois. Dix ans plus tard, des techniques sérologiques spécifiques ont permis de déterminer que des gens avaient été infectés jusqu'à cent mètres de l'hôtel, sans que l'on comprenne comment. C'est une des raisons pour lesquelles je suis partisan d'observer et de tester : face à une maladie inconnue, toute opinion est fausse. Même après avoir collecté un maximum de données, il reste encore des inconnues – tant mieux, cela laisse du travail aux chercheurs qui viendront après !
Savez-vous d'où vient la recommandation de se laver les mains pour éviter les affections respiratoires ? Lors d'une étude au Pakistan, des chercheurs ont donné du savon à des groupes de personnes, leur ont demandé de se laver les mains tous les jours et de prendre un bain par semaine, et ont regardé l'évolution du nombre de gastro-entérites, qui appartiennent aux maladies dites manuportées. Puis ils ont comparé les résultats avec les cas de pneumonie. Ils ont eu une énorme surprise : les pneumonies diminuaient autant que les gastro-entérites. C'était la première fois que l'on constatait qu'on évitait les pneumonies en se lavant les mains et que celles-ci étaient le principal vecteur des infections respiratoires. Cette découverte, faite par hasard, n'aurait pu se produire avec nos méthodologistes, parce que l'objectif primaire n'était pas de constater une diminution des pneumonies. La plupart des grandes découvertes sont faites par hasard, elles n'ont pas été prévues, sinon on les aurait testées avant !

Vous avez dit au début de l'épidémie qu'il fallait tester, isoler et soigner, plutôt que de recourir à la technique moyenâgeuse du confinement. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas d'autre choix possible compte tenu de l'évolution de l'épidémie et du manque de moyens. Considérez-vous que la France est prête pour éviter un reconfinement, comme cela se produit dans d'autres régions du monde confrontées à une seconde vague ? Quels conseils donneriez-vous aux Français pour se protéger ?
À l'IHU, où nous avons eu la plus grande concentration de malades de France et probablement une des plus grandes au monde – environ 5 000 personnes infectées y sont passées en deux mois et demi –, le taux d'infection du personnel est plutôt inférieur à celui de la ville entière ; seuls un médecin et un interne ont été contaminés dans tout l'IHU. Le masque est indispensable pour les soignants parce qu'ils travaillent à vingt ou trente centimètres des malades. Nous nous passons les mains à l'alcool cent fois par jour : des distributeurs d'alcool ont été installés partout et vous ne me verrez jamais passer devant l'un d'eux sans l'utiliser. C'est le moyen le plus efficace. Je ne l'ai pas attrapé et je n'ai pas pris d'hydroxychloroquine par prophylaxie.
Ensuite, étant marseillais, j'ai une opinion sur les épidémies : cette ville a été soumise à de nombreuses épidémies – cinq ou six pestes, le choléra… Dans les deux bateaux qui ont été mis en quarantaine, presque tout le monde a fini par être infecté ! Le lazaret, c'est l'inverse : on n'isole que les personnes contaminées, afin qu'elles ne propagent pas la maladie tant qu'elles sont infectieuses.
Je veux dire très solennellement que si j'ai des points de désaccord sur la gestion de la crise, jamais personne ne nous a empêchés de travailler, et nous avons été aidés par nos tutelles – l'agence régionale de santé, la direction générale de la santé. Globalement, nous avons pu mener ce que je pensais être notre devoir : je n'ai pas rencontré d'obstacles, personne ne m'a embêté, à l'exception du conseil de l'ordre, qui m'a convoqué pour me dire que je n'avais pas le droit de parler – je l'ai renvoyé à la Constitution, à la liberté d'expression et d'enseignement. Ils avaient déjà essayé de faire cela avec d'autres de mes collègues et ils avaient perdu devant le Conseil d'État.
À l'avenir, nous aurons besoin de faire des tests. La PCR ne prédit pas très précisément l'infectivité mais l'IHU a des moyens de culture considérables. Nous avons isolé 2 000 souches – je ne sais pas si un autre laboratoire dans le monde en a fait autant – et nous en avons séquencé 500 pour l'instant : cela fait deux fois plus que le reste de la France ! Nous ne sommes peut-être pas un centre national de référence, mais nous en faisons beaucoup ! À partir d'un certain seuil, il reste des acides nucléiques du virus mais le virus est mort, il n'est plus cultivable, donc il n'est plus contagieux. Tous les jours, nous faisions sortir les gens qui n'étaient plus contagieux, soit 25 % des malades. C'est comme cela qu'on gère : tant qu'ils sont contagieux, on les garde. Puis, au bout de trois ou quatre jours, ils n'étaient plus contagieux et on les faisait sortir.

Vous nous avez dit être en contact régulier avec les plus hautes instances de ce pays, mais avez-vous l'impression d'être entendu ? À la suite de la déclaration d'état d'urgence, le 23 mars, deux décrets des 25 et 26 mars ont réservé l'hydroxychloroquine à des stades tardifs de la maladie, pour les états cliniques graves. Or ce n'est pas votre protocole puisque vous appliquez la bithérapie dès qu'un patient est testé positif. Lors de la réunion du pré-conseil scientifique, le 5 mars, les laboratoires étaient présents, de même que le chef de service de Bichat, M. Yazdan Yazdanpanah, qui n'a que le mot « remdesivir » à la bouche : peut-être étaient-ils plus écoutés que vous ?
Quand votre dernière étude sera-t-elle publiée ? Cela pourrait aider à déterminer définitivement le protocole à suivre et permettrait, si vous étiez entendu, aux médecins traitants de prescrire à nouveau cette molécule, récupérant ainsi leur liberté de prescription. Je suis, comme M. Olivier Becht, députée d'Alsace : dans notre région, les patients ont sursaturé les établissements. Nous aurions pu éviter le transfert en hospitalisation si les médecins de première ligne avaient eu le droit de dépister et de traiter.
J'ai appelé le ministre, qui m'a confirmé que dans son arrêté, l'hydroxychloroquine était destinée « notamment » aux formes les plus graves : cette subtilité a pu échapper à ceux qui n'ont pas fait l'exégèse des textes. J'ai donc pu continuer à traiter les formes les moins graves.
Quand j'ai commencé à discuter avec le ministère, on m'a tout de suite dit que Yazdan Yazdanpanah gérerait les essais. Or, dès le début, celui-ci n'a parlé que du remdesivir, avant même que sa sensibilité au virus soit testée. Le targocid, un antibiotique injectable, avait été testé sur le SARS et avait donné de bons résultats : des solutions alternatives existaient.
Je suis très sceptique sur la qualité de l'environnement du ministre pour les médicaments et pour les choix thérapeutiques. L'ancien directeur de l'ANSM et l'ancien président de la HAS, et je suis d'accord avec eux, ont exprimé publiquement leur désaccord avec leurs successeurs. Le problème d'un ministre, c'est qu'il ne reste pas très longtemps : il faut donc être extrêmement attentif à la qualité des directeurs qui constituent sa garde prétorienne. Si ces derniers n'érigent pas un mur entre le ministre et le flot permanent d'informations alarmantes, si personne ne traite les données de manière efficace et sérieuse, alors le ministre est exposé d'une manière insupportable. Il ne doit pas être submergé de nouvelles inquiétantes, surtout lorsqu'elles ne sont pas avérées. Ainsi, l'affirmation selon laquelle le traitement à l'hydroxychloroquine provoquait des morts était erronée, mais elle a été transmise directement au ministre de la santé, qui était affolé par ce flux d'informations. Même si le ministre écoute ce que je lui dis, il a d'autres sources d'information. Si les conseils de proximité sont faits par des gens qui n'ont pas les nerfs ou qui n'ont pas la compétence, cela pose un véritable problème.

Vous dressez un constat sévère et grave puisque vous décrivez un ministre sous influence. Quels sont les directeurs que vous ciblez ?
Le directeur de l'ANSM et le président de la Haute Autorité de santé : ce sont eux qui ont pris ces décisions. Le conseiller chargé des maladies infectieuses dans la Haute Autorité de santé a des conflits d'intérêts extrêmement sérieux : il n'est pas difficile de les trouver sur internet.
Un ministre ne peut pas ne pas être sous influence. Il doit gérer une crise avec un cabinet et des directeurs qu'il n'a pas choisis. Si les gens qui représentent la force institutionnelle n'ont pas la capacité de le protéger, voire lui font croire qu'il doit interdire des médicaments qui tuent les patients, on en arrive à cette situation paradoxale où l'on est le seul pays dans le monde à prendre des mesures aussi radicales. Vous devriez donc vous demander pourquoi les prédécesseurs ont un point de vue radicalement différent.

Monsieur le professeur, je souhaite tout d'abord vous dire toute mon admiration, et celle de beaucoup de Français, pour votre transparence et votre travail acharné. Vous êtes un sachant et un faiseur : c'est assez rare en France pour être souligné.
Vous venez de porter des accusations contre l'ANSM et la HAS : parlez-vous de la Haute Autorité de santé, ou du Haut Conseil de la santé publique ?
J'irai également dans votre sens sur les dangers de la concentration des fabricants, tant dans la pharmacie que dans les dispositifs in vitro : vous avez parlé des interruptions de livraison des réactifs Qiagen mais le même problème de blocage existe avec Thermo Fisher Scientific. Or ces deux sociétés appartiennent au même propriétaire.
On a rétabli des lazarets improvisés, on a demandé aux gens de rester chez eux et certains ont des séquelles. Il semble que les malades qui survivent à un syndrome respiratoire sévère subissent des séquelles neurologiques et pulmonaires. Quel est votre avis sur le confinement à la hâte et sur le fait d'avoir négligé les effets à long terme de la pathologie ? La solution alternative n'aurait-elle pas consisté à tester massivement et à appliquer votre traitement simple et peu coûteux ? Les signes cliniques tels que l'anosmie et l'agueusie permettaient de diagnostiquer la maladie et il y avait tout ce qu'il fallait, notamment dans les pays pauvres, pour recourir à des traitements simples. Pourquoi ne pas l'avoir fait dans nos pays développés ?
Cela ne concerne pas que les pays pauvres : la Corée a recommandé de donner un traitement aux patients, dont l'hydroxychloroquine. L'Europe et les États-Unis sont isolés dans cette stratégie qui consiste à ne pas traiter. Le bon sens veut que l'on fasse quelque chose pour les malades, même si l'on ne sait pas à quel point cela marche. La médecine doit soigner les malades ! Et cela concerne non seulement le médicament, mais également tout le soin qui va avec : très tôt, on s'est rendu compte qu'il fallait donner des anticoagulants, parce que certains patients faisaient des embolies. Nous avons appris au fur et à mesure. De même, si l'on fait un test de saturation en oxygène, ce qui est très peu coûteux, et que le résultat est inférieur à 95 %, on intervient sans attendre que le malade soit en détresse respiratoire.
Les gens testés positifs que nous renvoyons chez eux se comportent différemment : ils s'isolent dans leur chambre parce qu'ils savent qu'ils représentent un risque pour leur famille, et ils reviennent se faire tester jusqu'à ce qu'ils soient négatifs : cela fait donc baisser le risque de contagion, même en situation de confinement. La majorité des personnes contaminées n'a pas de fièvre ni de toux : si elles ne sont pas testées, elles ne savent donc pas qu'elles sont contagieuses.
La clef, c'est la détection. Des études montrent que l'extension de la maladie et la mortalité sont liées au nombre de cas testés : ainsi, l'Islande, qui a le plus testé sa population, a aussi le taux de mortalité par habitant le plus bas. Dans une situation comme celle-là, vaut-il mieux donner des médicaments ou ne rien donner ? Nous avons eu recours à deux des médicaments les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité : comment en est-on arrivé à dire qu'ils étaient toxiques ? En 2019, l'hydroxychloroquine était délivrée sans ordonnance ; puis nous n'avons plus eu le droit de la prescrire, ce qui posait problème pour les gens qui en avaient besoin pour d'autres maladies et n'arrivaient pas à s'en procurer en pharmacie. Comment a-t-on pu ainsi passer d'un extrême à l'autre ? Vous devriez vous poser la question ! Ce n'est quand même pas parce que j'ai dit du bien de l'hydroxychloroquine ? Ou alors je serais le diable !

Vous avez critiqué l'OMS, en la traitant de pyromane de la planète dans le domaine des épidémies, et le Haut Conseil de santé publique : pourquoi ? Avez-vous saisi le ministre lorsqu'il a déclaré qu'un dépistage large n'aurait aucun sens d'un point de vue médical et scientifique ? Enfin, que pensez-vous de l'essai de la dexaméthasone en tant qu'anti-inflammatoire nouveau ?
. Je vois que vous souriez en disant que la dexaméthasone est un médicament nouveau. La prescription ou non de la cortisone renvoie à un débat aussi ancien que complexe. Lors du premier staff auquel j'ai assisté, à l'hôpital Claude-Bernard à Paris, la question se posait déjà. Les indications sont à choisir par le médecin au cas par cas. Lors de la première phase du covid, purement virale, la cortisone tend à aggraver l'état du patient car elle affaiblit ses défenses immunitaires au moment même où il doit les mobiliser. Il est vraisemblable qu'elle rende un service quand les défenses immunitaires deviennent folles. Pour les patients atteints d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), elle est prescrite en prenant en compte divers critères, dont l'âge. Elle est déconseillée pour les plus de soixante-quinze ans.
Je ne veux pas faire l'exégèse des déclarations ministérielles. Il est difficile de tenir une ligne continue quand le vent souffle dans toutes les directions.
Les sociétés de l'Europe de l'Ouest, devenues fragiles, sont très réactives aux crises, y compris quand elles n'ont pas de fondement réel. J'ai toujours tenté d'être rassurant en retenant les hypothèses les plus basses car je considère que la peur est très mauvaise conseillère. Il ne faut pas dramatiser. La Chine, qui avait été accusée d'avoir dissimulé l'épidémie de SARS, a surréagi, en lançant une alerte totalement disproportionnée. La province de l'Hubei a une population presque aussi importante que celle de la France entière et le nombre de morts à l'échelle nationale a été équivalent à celui de l'Ile-de-France. Au total, il y a eu 6 000 morts, autant dire que personne ne verra la différence à la fin de l'année.
Je ne vois pas de raisons de ne pas y croire. De toute façon, le plus grand bénéficiaire de la crise, c'est la Chine. Nous avons dû tout acheter là-bas.

En tant que médecin biologiste, j'ai un a priori favorable à l'égard de votre démarche. Vous n'avez plus à faire vos preuves, comme le démontre votre carrière. Des travaux chinois sont allés dans le même sens que les vôtres et à Marseille, la mortalité et la létalité ont été moindres qu'ailleurs. Le plus remarquable est sans doute l'opération de dépistage massif que vous avez menée.
On m'a interdit de pratiquer des tests PCR alors que dès le 1er mars, ils auraient pu bénéficier aux patients qui n'étaient pas hospitalisés. Et quand j'ai pu faire des tests sérologiques, le 1er avril, on m'a opposé qu'ils ne servaient à rien.
Dans des circonstances exceptionnelles, il faut une réponse exceptionnelle. Les essais cliniques, coûteux, supposent une lourdeur administrative peu compatible avec les réactions d'urgence qu'appelle une crise sanitaire. Que pensez-vous de l'essai européen Discovery ? Quelle est l'ampleur de l'échec ? Peut-on même parler de retards alors que les résultats ne seront peut-être prêts qu'après la fin de la crise ?
Quel est votre avis sur les conflits d'intérêts au niveau du conseil scientifique et du Haut Conseil de la santé publique ? Le président de cette instance a reconnu lui-même l'absurdité des avis prononcés et les pressions subies.
De mon point de vue, il y a des hommes qui n'étaient pas à leur place mais il est nécessaire de prendre en compte des phénomènes structurels. Il faudra bien que l'on se rende compte de l'importance de faire de la recherche avec les médecins au sein des hôpitaux.
Concernant les essais, je vous renvoie une fois encore à mon rapport de 2003. Pendant un siècle et demi, les progrès ont été uniquement fondés sur l'innovation, qui supposait qu'on n'utilise les molécules que pendant une vingtaine d'années. Au XXIe siècle, très peu de médicaments nouveaux ont permis un changement thérapeutique, ils concernent essentiellement le traitement du cancer et les hépatites C ; le reste est marginal. Pourtant l'industrie pharmaceutique n'a jamais été aussi florissante. Nous sommes à un tournant. Se pose la question du repositionnement des molécules, qui ont 60, 70, 100 ans, qui peuvent être utilisées pour d'autres pathologies, et la question du financement de ces études. L'État a pris l'habitude de laisser ceux qui développent une nouvelle technologie payer pour la mettre en place. Aucun financement n'est prévu pour financer les recherches thérapeutiques portant sur les molécules génériquées, ne faisant plus l'objet de profits, alors qu'elles sont éternelles. Les antibiotiques, molécules de trois milliards d'années, ne sont connus que ce pour quoi ils ont été testés alors qu'ils sont multifonctionnels – certains servent, par exemple, d'anticancéreux ou d'antiviraux. Il faut trouver un modèle économique pour porter ces travaux, qu'il passe par le monopole d'exploitation ou par le financement public. On ne peut pas laisser à l'abandon les recherches sur le repositionnement, d'autant que les molécules anciennes offrent un avantage de taille : leur toxicité est déjà connue. Nous savons, par exemple, que l'hydroxychloroquine est bien moins toxique que le remdesivir qui provoque des insuffisances rénales. Quand des molécules ont été prescrites des milliards de fois, leur sécurité est établie de manière fine alors que pour celles qui n'ont été testées que sur mille ou deux mille personnes, on ne peut cerner que les problèmes apparaissant dix ou vingt fois sur cent et non une fois sur mille ou dix mille. Les effets secondaires sont moins bien pris en compte.

Vous a-t-on demandé une déclaration publique d'intérêts lorsque vous êtes entré au conseil scientifique ?
. Oui.

Il me semble, madame la présidente, que notre mission doit travailler davantage sur cette question des conflits d'intérêts. Peut-être sera-t-il même nécessaire de créer une commission d'enquête sur les conflits d'intérêts dans l'industrie pharmaceutique.
Le 11 mai, le Président de la République disait : « Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens ». Cette phrase a été reprise par tous les fonctionnaires de l'État. La déléguée de l'agence régionale de santé dans mon département, les Pyrénées-Atlantiques, quand j'évoquais ces tests, m'a répondu d'un ton définitif qu'ils ne servaient à rien et qu'ils n'étaient pas validés en France. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ce sont les raisons pour lesquelles, le 28 mai, le même Président de République a reconnu que vous aviez raison sur la question des tests. Pour quelles raisons le Président a-t-il changé d'avis sur votre analyse et sur le sujet des tests ?
Au-delà du bilan humain, se dégage l'impression d'un fiasco terrible en matière de communication. Il importera de nous appesantir aussi sur les avis changeants des pouvoirs publics sur les masques, les tests, les respirateurs car ils ont fait perdre du temps.
. L'écosystème des responsables politiques est le même que celui des médias. Il est marqué par une vitesse de réactivité qui pose problème. Je ne regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio et je lis rarement les journaux. Je ne suis donc pas perturbé par les horreurs qu'on dit sur moi, d'autant que j'ai interdit à mon entourage de me les rapporter. L'excès de communication nuit à la communication. Je suis aussi avare que possible de prises de parole dans les médias. Statistiquement, plus on parle, plus on dit de bêtises.

Il faut tuer le messager, avez-vous répété à maintes reprises, monsieur le professeur. Rassurez-vous, nous ne sommes là, en tant que parlementaires, que pour vous poser des questions.
Considérez-vous toujours que l'association entre hydroxychloroquine et azithromycine constitue le meilleur traitement pour les patients atteints par le Covid-19 ? Pouvez-vous nous indiquer selon quelles conditions ce traitement a été administré aux patients de l'IHU ? Quelles ont été pour l'institut les conséquences du décret du 26 mai abrogeant les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital ?
. Nous allons publier dans les jours qui viennent un énorme article, qui est le plus complet au monde sur cette maladie : cent personnes ont été mobilisées pour rassembler des données particulièrement denses concernant 3 700 patients. Pour les patients à qui nous avons prescrit ce traitement, dont l'efficacité était évaluée sur trois jours – ce qui est traditionnel pour les pneumonies –, la mortalité a été de 0,5 % et la durée d'hospitalisation et le taux de passage en réanimation ont été moindres que pour les patients qui ne l'avaient pas reçu ou qui avaient eu un traitement différent – même si nous faisons des recommandations, les médecins restent libres de leurs prescriptions à titre individuel. Je ne vois donc pourquoi nous en changerions.
Pour éviter tout problème, nous avons fait systématiquement des électrocardiogrammes, qui ont tous été analysés par un professeur de cardiologie de Marseille spécialiste du rythme et son équipe. Nous avons dû arrêter le traitement dans six cas pour lesquels un allongement de l'intervalle QT a été constaté – réaction souvent observée chez les patients très âgés et souffrant de polypathologies. Nous avons aussi procédé à une mesure de la kaliémie car une concentration basse de potassium favorise ce type de risque. Nous avons même effectué nous-mêmes des dosages de potassium pour en disposer rapidement pour les patients en hôpital de jour et les patients hospitalisés, au nombre de 730, ont été iso – puis anticoagulés. Presque tous les patients hospitalisés et beaucoup de patients en hôpital de jour ont bénéficié de scanners à faible dose, qui auraient dû remplacer depuis très longtemps les téléthorax – la France souffre d'un manque catastrophique d'équipements radiologiques par rapport aux autres pays de l'OCDE. Parmi les 2 400 examens pratiqués grâce à la mobilisation jour et nuit des radiologues, certains ont révélé des lésions pulmonaires chez des patients asymptomatiques. Cela nous a amenés à vérifier leur saturation en oxygène. Ceux qui nous semblaient exposés à un danger ont été hospitalisés et ceux qui sont rentrés chez eux ont été suivis.
Quant à l'IHU, il a mis longtemps à émerger car la création de toute structure nouvelle se heurte à des obstacles. Il n'y avait pas eu de centre de recherche en maladies infectieuses depuis l'Institut Pasteur et nous avons été confrontés à des oppositions à toutes les étapes de sa construction. Si cet institut n'apparaît pas comme une lubie de Didier Raoult mais comme un exemple à suivre, je pourrai considérer que j'ai fait mon devoir.
Il s'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire. Le personnel entier s'est senti investi d'une mission dont il a tiré fierté. Les personnels du CHU de Marseille, beaucoup critiqué ces dernières années, ont été revalorisés. Il n'y a pratiquement pas eu d'absentéisme. L'IHU s'est vu offrir tous les jours des repas gratuits pour tout le personnel, du vin. J'ai également reçu des tableaux…
Le personnel hospitalier a été rassuré sur sa mission alors qu'il était fragilisé. Les soignants n'ont pas compté leurs heures. Vivre une crise tout en s'en occupant a été particulièrement dynamisant.

Des dizaines de milliers de patients prennent chaque jour de l'hydroxychloroquine pour traiter des maladies articulaires d'origine inflammatoire. J'en ai moi-même délivré pendant plus de trente ans en tant que pharmacienne. Savons-nous s'ils ont été moins atteints par le coronavirus ? Des études ont-elles été menées ?
Quand j'ai interrogé le professeur Salomon sur l'interdiction de l'hydroxychloroquine, il m'a répondu que sa médiatisation entraînait des risques d'automédication. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut justifier une telle interdiction de prescription par les médecins ?
. Je ne comprends pas l'interdiction de cette molécule banale. L'année dernière, 36 millions de comprimés ont été distribués en France, y compris sans ordonnance. Du jour au lendemain, il est décidé de ne plus permettre sa délivrance, même sur ordonnance.
Je n'ai jamais recommandé ce traitement, parce que je n'ai pas le droit de recommander un traitement qui est hors autorisation de mise sur le marché (AMM). Écoutez bien mes interventions, et vous verrez : je dis ce que je fais, mais je ne fais pas de recommandation. C'est peut-être une nuance, mais elle est d'importance.
J'ai le devoir d'informer les gens et c'est ce que je fais, mais je ne les informe que des études qui sont publiées. Chaque jour, j'évalue trois à quatre articles sur le covid, qui viennent de toutes les revues du monde : je suis donc au courant de tout ce qui se passe à l'avance. J'ai évalué très récemment une méta-analyse sur l'anticorps monoclonal anti-IL6, que M. Martin Hirsch avait présenté comme un miracle thérapeutique : en réalité, le papier montre que les essais réalisés dans le monde ne sont pas concluants. Il ne faut faire des annonces que lorsqu'un papier a été déposé ou publié, car les gens doivent pouvoir vérifier ce que l'on dit. Je n'ai pas approuvé que Recovery ou FORCE (FOR Covid Elimination) fassent des annonces avant d'avoir publié leurs résultats. Votre papier doit être accessible au moment où vous annoncez vos résultats : cela fait partie de nos mœurs scientifiques.

Professeur, vous avez expliqué que l'immunité croisée de la Covid-19 avec d'autres coronavirus pourrait expliquer la protection des enfants vis-à-vis de cette maladie. Peut-on évaluer cette immunité croisée pour le reste de la population ?
Deuxièmement, vous nous avez fait part de votre scepticisme s'agissant d'un potentiel vaccin. Pour vous, quelle est l'option de recherche thérapeutique à privilégier ?
Troisièmement, il est vrai qu'on a peu de chiffres et de données brutes. Pensez-vous qu'on les aura un jour ?
Quatrièmement, vous m'avez déprimée en décrivant le monde de la recherche scientifique… Vous aviez déjà écrit, dans une tribune parue en 2018, que vous regrettiez que la science soit instrumentalisée au service de l'idéologie et du commerce. Comment mettre fin à cela ?
Enfin, quel est votre sentiment s'agissant du risque d'une deuxième vague ?
Vous aurez compris que je n'ai pas beaucoup de sentiments sur l'avenir : ce n'est pas dans ma nature. Si j'ai un talent, en tant que scientifique, c'est l'observation. Je suis un bon observateur et je vois les choses là où les gens ne les voient pas. Mais ce n'est pas parce que j'ai une barbe que je suis un prophète. Même pour quelque chose d'aussi bête que la grippe, on ne sait jamais, d'une année à l'autre, si l'on va avoir une épidémie de grippe H1N1, H2N3 ; parfois on a une grippe de type B, parfois il n'y en a pas du tout… L'évolution des maladies infectieuses est extrêmement complexe.
Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la recherche médicale et sur son orientation, notamment sur la question de la créativité. Je suis extrêmement heureux de faire le métier que je fais et je pense que cela se voit : ne vous inquiétez pas, je ne risque pas de faire le vôtre, sauf si on me met dehors et encore je trouverais d'autres choses à faire car j'adore écrire – j'ai des facilités pour ça ! Je suis très heureux, parce que nous vivons une époque merveilleuse, celle des découvertes technologiques – ce que l'on appelle les « omics » – mais je regrette que l'Europe soit à la traîne derrière l'Extrême-Orient. Cela a commencé avec le génome : sur cette question, déjà, la France a pris un retard colossal ; l'Institut Pasteur disait que cela ne servait à rien et mes équipes et moi-même étions les seuls à vouloir travailler dessus. Depuis, nous n'avons pas arrêté : tous les jours, nous décidons de séquencer une nouvelle bactérie. Après le génome, il y a eu les protéines, la morphologie et puis les cultures tous azimuts.
Les pays qui sont arrivés les derniers dans la course, la Chine et la Corée, ont pris le train en marche et se sont massivement suréquipés. Ils ont une technologie de pointe extraordinaire et un développement industriel hallucinant. Chaque jour révolutionne nos connaissances et c'est enthousiasmant. Je vous assure qu'à l'IHU, on s'amuse beaucoup : nous avons isolé cent cinquante nouvelles espèces bactériennes chez l'homme, que nous n'avons même pas le temps de décrire. Mais je regrette que cette nouvelle façon de faire de la science et de la recherche médicale ne soit pas plus générale.
Les essais thérapeutiques, pour les maladies infectieuses, ont un intérêt très limité. Il faut changer nos modèles de pensée et arrêter avec les études randomisées. Pour savoir si un médicament marche contre le sida ou l'hépatite C, il suffit de mesurer l'évolution de la charge virale. On abaisserait considérablement le coût du traitement de l'hépatite C si l'on considérait qu'après trois tests où la charge virale est négative, on peut arrêter le traitement. Il suffit de surveiller les gens et de les traiter à nouveau, le cas échéant. Au lieu de ça, on a imposé une durée de traitement que rien ne justifie et qui ne tient pas compte de la grande variabilité d'un patient à l'autre. Ce n'est pas de la médecine, ce sont des recettes.
Je pense qu'il faut faire de moins de moins de théorie parce que, dans le domaine de la microbiologie, la période qui s'ouvre est l'équivalent du XVIe siècle pour la géographie : on est en train de découvrir un nouveau monde. Le microbiote est un changement de perspective majeur. Rendez-vous compte que le médicament le plus révolutionnaire du XXIe siècle pour les maladies infectieuses, si l'on excepte le traitement de l'hépatite C, c'est la greffe fécale ! On sauve des gens en leur faisant une greffe fécale. Voyez où se trouve l'innovation ! Ça irrite ceux qui voudraient le commercialiser, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas rapporter d'argent. Et pourtant, elle permet de traiter la maladie émergente la plus violente qu'on ait connue en France depuis vingt ans, avec 2 500 morts déclarées par an – peut-être le double en réalité.
Cela pose un grand nombre de questions. Par exemple, les changements d'écosystème sont-ils médiés par les microbes ? Le froid a-t-il un effet sur les microbes des muqueuses nasales, qui nous rendrait plus vulnérables ? Nous sommes à une époque de grandes découvertes mais je regrette que nous ne fassions pas la course en tête. L'IHU est compétitif face à la Chine, parce que nous nous équipons en permanence et massivement avec des outils de pointe. La Corée a sorti un appareil pour PCR qui fait les tests en vingt minutes, alors que nous, il nous faut deux heures quarante. C'est un tout petit appareil, dont on pourrait équiper les cabinets médicaux : cela changerait totalement les modes de prise en charge et la place des biologistes – il faudrait revoir la loi actuelle. Regardons toutes ces évolutions en face et leur vitesse. Demain, on fera le génome humain entier pour cent dollars. Aux États-Unis, la société 23andMe peut déjà vous prédire les maladies que vous aurez au cours de votre vie. On est dans un monde complètement fou, celui de la course à la technique, et c'est intéressant.
Nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Nous n'avons pas de modèles expérimentaux, mais nous avons analysé le sérum de 2 000 personnes qui avaient déjà eu une infection à coronavirus. Ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont déjà eu le virus le plus proche, le HKU, ont plus souvent des anticorps contre le covid que tous les autres. Mais, pour des raisons que je comprends mal, et contrairement à ce que je pensais, les enfants n'ont pas plus d'anticorps que les sujets âgés. Le premier papier publié sur le sujet avait pourtant montré que les enfants avaient une immunité 40 % à 70 % supérieure, mais il se fondait sur l'étude des lymphocytes mémoire – une technique qui donne accès à des informations que ne donne pas l'observation des anticorps, même très fine. Il faut continuer à chercher, mais il est très difficile de cultiver le virus HKU. Nous travaillons avec des immunologistes parisiens qui sont des stars mondiales, Laurence Zitvogel et Guido Kroemer. Nous étudions les lymphocytes mémoire pour déterminer s'il existe une immunité croisée entre les autres coronavirus et celui‑ci.

La France est la France parce qu'elle est archipélagique et que le soleil ne se couche jamais sur les trois océans, grâce à ses territoires ultramarins. Il se trouve que le virus a touché les outre-mer d'une manière inégale. Tous les territoires ultramarins, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont tropicaux, avec des températures élevées toute l'année et des taux d'humidité importants. Identifiez-vous un lien entre la propagation du virus et ces conditions climatiques ? Deux territoires sont aujourd'hui plus sévèrement touchés que d'autres, Mayotte et la Guyane. Avez-vous une explication ?
Honnêtement, je ne sais pas. Même si l'on connaît mieux la grippe, on peine déjà à comprendre les facteurs de sa propagation dans la zone intertropicale humide, car elle a fait l'objet de moins de travaux que pour la zone tempérée. Et, même dans la zone tempérée, on ne comprend pas réellement la saisonnalité… C'est pendant la saison des pluies, c'est-à-dire pendant l'été tropical, qu'il y a le plus de cas de grippe, mais il y en a toute l'année, à la différence de ce qui se passe dans les pays tempérés. Il est donc impossible de savoir ce qui va se passer avec le covid. Si l'épidémie continue de se propager dans l'hémisphère Sud, ce peut être une source de réinfestation dans un an chez nous. C'est une question très importante et il faut évidemment surveiller ce qui se passe ailleurs, car les virus voyagent beaucoup.
Les conditions qui font qu'une maladie est épidémique à un instant donné et dans un endroit donné ne sont pas connues. Pour ne prendre que le cas de la France, on ignore pourquoi il y a eu très peu de cas dans l'Ouest alors qu'il y en a eu tellement dans l'Est. Je suis ignorant, mais je crois que tout le monde l'est. Il faut continuer d'observer : c'est de cette manière qu'on y verra plus clair. Et c'est pourquoi, en Guyane comme ailleurs, il faut tester au maximum et observer la cinétique de la courbe.

. En ce qui concerne les tests PCR, quels sont les taux de faux négatifs et faux positifs ? Quelle est la précision de ces tests ?
Les premières publications sur l'hydroxychloroquine remontent au début des années 2000. À l'époque, des études comparatistes ont montré que même le chlorure d'ammonium avait les mêmes effets que la chloroquine sur des cultures de cellules. Pourquoi ne pas avoir poussé plus loin ces recherches, alors qu'on était à l'époque du SRAS ?
Grâce au grand emprunt, vous avez construit l'un des plus beaux IHU de ce pays, l'une des Rolls Royce de l'infectiologie mondiale. La question que je me pose, et je sais que je ne suis pas le seul, c'est pourquoi vous n'avez pas fait des essais cliniques dignes de ce nom dès le départ : vous auriez pu définitivement déterminer si l'hydroxychloroquine avait ou non des effets. Pourquoi vous être cantonné à ces publications, alors qu'on connaît la qualité de vos travaux sur les Rickettsies et les maxivirus ? Vous saviez très bien que ce pseudo-essai clinique n'était pas recevable, puisqu'il ne reposait que sur six patients. Il est un peu facile de remettre en cause le système des essais thérapeutiques : il se trouve que c'est ce qui se pratique et qu'il va continuer très vraisemblablement d'en être ainsi, y compris en infectiologie.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on s'aperçoit, à mi-chemin d'un essai thérapeutique, que quelque chose marche, que les choses deviennent significatives, on doit l'arrêter. C'est une question d'éthique, pas de méthodologie. Je suis désolé que vous n'aimiez pas mon essai. Moi, je l'aime beaucoup et je trouve que c'est la seule manière de faire des essais : faire des essais comparatifs et noter une différence significative. Par ailleurs, je pense que vous faites une erreur majeure : moins il y a de gens, et plus un écart est significatif. Si vous êtes obligé d'avoir 10 000 personnes dans un essai pour prouver que quelque chose est significatif, c'est qu'il n'y a aucune différence. Sachant que 15 % des gens ne prennent pas les médicaments qu'on leur prescrit, quand vous cherchez un écart de 1 %, vous n'êtes plus dans la médecine mais dans le fantasme méthodologique. Tout essai qui comporte plus de 1 000 personnes cherche à démontrer quelque chose qui n'existe pas : c'est la base de la statistique. Je vous assure que je suis un très bon méthodologiste. Des gens qui ne comprennent rien à la science colportent ce fantasme, mais la méthodologie n'est pas la science : c'est un outil de la science. Ne venez pas me dire que mes essais ne sont pas bons. Je suis un grand scientifique, je sais ce qu'est un essai, et je peux vous dire qu'une dizaine des traitements que j'ai inventés figure dans tous les livres médicaux de référence. Et celui-ci y sera aussi !
Dans le domaine des maladies infectieuses, bien peu de thérapeutiques ont été basées sur des essais randomisés. Et ceux qui ont été réalisés, en particulier sur le sida, étaient inutiles, car il suffisait de mesurer l'évolution de la charge virale. Les essais randomisés ne font pas l'unanimité et ils disparaîtront, comme ils sont apparus, d'ici une vingtaine d'années : on trouve autant de gens pour que de gens contre. Du reste, tous les gens qui ont critiqué mon travail n'ont publié que des essais comparatifs non randomisés. Il n'y a pas eu un essai français comparatif randomisé. Aucun essai français, enfin, n'a isolé une stratégie thérapeutique comme nous l'avons fait. Alors ne mettons pas les choses à l'envers. J'étais un grand scientifique et je le reste après cette publication.

Je m'associe aux remerciements de la présidente : cette audition a été très dense et très riche. Elle nous a permis de mesurer vos convictions, vos compétences et votre expérience. Je relève aussi que vous avez porté de graves accusations contre diverses instances et posé la question des conflits d'intérêts. Notre commission explorera la voie que vous nous avez indiquée et nous en tirerons toutes les conséquences. Merci encore pour les éléments que vous nous avez apportés, pour l'éclairage qui a été le vôtre, et aussi pour l'action sanitaire que vous avez menée pour notre pays.
Membres présents ou excusés
Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19
Réunion du mercredi 24 juin 2020 à 17 heures
Présents. – M. Damien Abad, M. Julien Aubert, Mme Sophie Auconie, M. Olivier Becht, M. Philippe Berta, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Éric Ciotti, M. Jean‑Pierre Door, Mme Françoise Dumas, Mme Caroline Fiat, M. Jean‑Jacques Gaultier, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier‑Cha, M. David Habib, M. Patrick Mignola, M. Bertrand Pancher, Mme Michèle Peyron, M. Bruno Questel, M. Olivier Serva, M. Joachim Son‑Forget, M. Jean Terlier, M. Boris Vallaud.
Assistaient également à la réunion. – Mme Josiane Corneloup, M. Nicolas Démoulin, M. Jean‑Christophe Lagarde, Mme Valérie Rabault, Mme Martine Wonner.