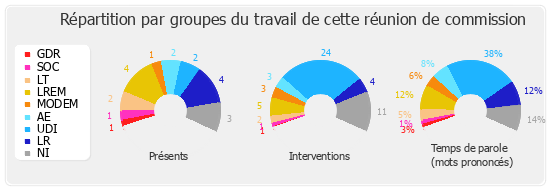Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Réunion du mercredi 17 mars 2021 à 9h30
La réunion
La réunion débute à 9 heures 35.
Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet, présidente.
La Commission examine la proposition de loi visant à lutter contre les individus violents lors de manifestations (n° 3848) (M. Pascal Brindeau, rapporteur).

Dans le cadre de la niche parlementaire du groupe UDI et Indépendants, mes collègues et moi-même avons choisi de vous soumettre cette proposition de loi visant à lutter contre les individus violents lors des manifestations, en instaurant une interdiction administrative de manifester. Personne, ici, ne découvre cette disposition : elle formait l'article 3 de la proposition de loi défendue par le sénateur Bruno Retailleau – devenue la loi no 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer le maintien de l'ordre public lors des manifestations, dite loi anticasseurs. Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel, celui-ci considérant que les modalités de cette interdiction administrative portaient au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'était ni adaptée ni nécessaire ni proportionnée. Tirant la leçon de l'ensemble des griefs ainsi exprimés, le texte qui est soumis répond point par point aux préconisations du Conseil Constitutionnel, et assure un meilleur équilibre entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la protection des libertés constitutionnellement garanties.
En l'état actuel, notre droit comporte seulement deux types d'interdiction de manifester. La première est une interdiction judiciaire, prévue par l'article 131- 32-1 du code pénal. Le juge peut la prononcer comme peine complémentaire à l'encontre d'une personne qui s'est rendue coupable, lors de manifestations sur la voie publique, de violences sur des personnes, de détérioration de biens ou de diffusion de procédés visant à élaborer des engins de destruction. La seconde est l'interdiction de séjour prévue dans le cadre de l'état d'urgence issu de la loi no 55-385 du 5 avril 1955.
Dans ses attendus censurant l'article 3 de la proposition de loi Retailleau, le Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur entendait prévenir la survenue de troubles lors de manifestations sur la voie publique et poursuivait l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il ne remet donc pas en cause le principe de l'établissement d'une interdiction administrative de manifester, mais les modalités de la mise en œuvre de celui-ci.
Il relève que le législateur n'a pas établi de lien entre le comportement de l'individu et les atteintes aux personnes et dégâts matériels ayant eu lieu pendant la manifestation ainsi qu'entre le prononcé de l'interdiction et le fait que la manifestation soit susceptible de donner lieu à des atteintes à l'intégrité physique des personnes ou à des dommages aux biens. Il pointe également que tous les agissements, y compris non violents, peuvent entraîner le prononcé d'une interdiction administrative et qu'aucune limite d'ancienneté des faits reprochés n'est posée pour prononcer l'interdiction. Il a considéré que l'interdiction prononcée à l'encontre d'un individu pouvant aller jusqu'à un mois était disproportionnée. Enfin, la notification de l'interdiction par l'autorité administrative pouvait être prononcée à tout moment, y compris lors du déroulement de la manifestation non déclarée.
La proposition de loi remédie à l'ensemble de ces griefs.
Je proposerai notamment un amendement tendant à fixer une limite de quarante-huit heures avant le début d'une manifestation pour les notifications d'interdiction de participer aux manifestations déclarées, afin de respecter strictement le droit de recours des individus.
Je vous proposerai également un amendement pour porter à quinze jours l'interdiction de participer à des manifestations – après avoir auditionné des représentants des syndicats de police et des représentants de la gendarmerie nationale, nous pensons que ce délai rendrait la disposition opérante en cas de manifestations à répétition, même déclarées ou connues.
La proposition de loi est constituée d'un article unique.
L'alinéa 2 permet au préfet de prononcer une interdiction à l'encontre de toute personne constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Cette menace doit être caractérisée par des agissements ou par la commission d'un acte violent ayant entraîné des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens, à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique organisée il y a moins d'un an. Nous proposerons un amendement tendant à étendre ce délai à un an, notamment pour pouvoir prendre en compte des comportements violents dans des manifestations récurrentes. Je pense aux manifestations du 1er mai, dont les centrales syndicales craignent désormais qu'elles ne soient émaillées d'actes de casseurs, en particulier de la part de black blocs, que les forces de l'ordre ont beaucoup de difficultés à appréhender. La rédaction de l'alinéa 2 établit un lien très clair entre le comportement de l'individu et les atteintes, répondant ainsi à l'objection soulevée par le Conseil constitutionnel vis-à-vis de la rédaction de la proposition de loi Retailleau.
À l'alinéa 3, l'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux et abords de la manifestation.
L'alinéa 4 prévoit que, sous certaines conditions, l'interdiction administrative de manifester peut concerner l'ensemble des manifestations se déroulant en France pendant une période déterminée. Nous visons les manifestations telles que celles qui ont eu lieu pendant la crise des gilets jaunes. Dans ce cas, l'interdiction ne peut être prononcée pour une durée supérieure à dix jours – que nous proposons donc de porter à quinze jours.
L'alinéa 5 instaure, pour la personne visée par une interdiction de manifester, une obligation de pointage auprès de l'autorité désignée par le préfet, à savoir les services de police ou de gendarmerie.
L'alinéa 6 organise les modalités de notification de l'arrêté à la personne concernée. Dans le cadre des manifestations déclarées, l'autorité administrative notifie au moins quarante-huit heures à l'avance à l'individu son interdiction administrative de manifester, ce qui permet à celui-ci d'emprunter les voies de recours habituelles. Dans le cadre des manifestations non déclarées, nous avons tenté de trouver une solution opérante pour l'autorité administrative tout en essayant de préserver la possibilité de recours. Après les auditions que nous avons menées, nous souhaitons renoncer à cette deuxième disposition, pour préserver les voies de recours.
L'alinéa 7 prévoit que les arrêtés puissent faire l'objet d'une procédure de référé-liberté, sans que la condition d'urgence soit requise.
Les alinéas 8 et 9 déterminent les quantums de peine applicables en cas de violation de la mesure d'interdiction. Je vous proposerai un amendement pour revenir au quantum de peine voté en 2019. Nous avions initialement imaginé un quantum de peine supérieur mais, comme nous souhaitons parfaitement garantir la constitutionnalité de la proposition, nous revenons à la disposition de la proposition de loi votée il y a deux ans par notre assemblée.

Nous avons tous pu constater, ces dernières années, que de plus en plus de manifestations donnaient lieu à des délits graves, qu'il s'agisse de violences sur des personnes, de dégradations de biens ou d'affrontements avec les forces de l'ordre. Ces délits sont malheureusement le fait d'une petite minorité d'individus violents, qui n'ont aucunement l'intention de défendre des revendications citoyennes et de débattre, mais qui cherchent le chaos.
Face à ces agissements, les premières victimes sont la majorité de manifestants qui souhaitent pacifiquement faire valoir leurs idées et leur liberté d'expression. Ces violences les privent, d'une certaine manière, de leur liberté de manifester, ce qui est grave. En tant que député de Paris, dont la circonscription couvre le parcours République-Bastille, je confirme que ces événements sont très mal vécus, par les habitants, les commerçants, mais aussi par les Parisiens en général, qui souhaitent participer à ces manifestations dans une forme de tranquillité.
Notre majorité a toujours tenté de préserver un équilibre entre, d'une part, la garantie du droit de manifester, qui découle directement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, d'autre part, la garantie de l'ordre public et la protection de nos forces de l'ordre. À cet égard, nous partageons le diagnostic posé par cette proposition de loi. L'état d'avancement des travaux proposé par le rapporteur décrit bien le fonctionnement des black blocs, mouvement qui incarne cette spoliation des causes par une minorité violente.
L'objectif du texte est d'introduire une mesure administrative d'interdiction de manifester. Cette interdiction concernerait une personne constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, par ses agissements ou par la commission d'un acte violent ayant entraîné des atteintes graves à l'intégrité des personnes ou des dommages importants aux biens, à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique organisée il y a moins d'un an. Le préfet pourrait lui interdire, par arrêté motivé : d'une part, de participer à une manifestation sur la voie publique ; d'autre part, de participer à toute manifestation sur le territoire pour une durée de dix jours.
L'article unique de ce texte reprend donc l'article 3 de la loi du 10 avril 2019, aussi appelée loi anticasseurs, issue d'une proposition de loi venant du Sénat. Cet article, à l'époque, a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'il laissait à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction. L'atteinte à la liberté de manifester a donc été jugée disproportionnée, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation.
Le groupe UDI-I et vous-même, monsieur le rapporteur, avez tenté de tenir compte de cette censure, en revoyant l'écriture de cet article. Nous pouvons saluer ce travail. Cependant, l'équilibre proposé entre préservation de l'ordre public et liberté de manifester reste incertain. Il continue à faire débat, notamment au sein du groupe La République en marche.
Pour l'instant, prendre du recul sur le reste de la loi du 10 avril 2019 semble nécessaire. Elle donne déjà des outils forts au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles. L'article 7 permet de prononcer une interdiction judiciaire de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans. L'article 8 a ajouté la possibilité d'interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD). Ainsi, avant de penser à légiférer de nouveau, nous devons examiner l'efficacité de ces mesures.
Pour toutes ces raisons, le groupe La République en marche, tout en partageant la volonté du rapporteur de répondre aux violences au sein des manifestations, tire les enseignements de la censure du Conseil constitutionnel et se prononcera majoritairement contre ce texte.

Cette proposition de loi vise à lutter contre les individus violents lors de manifestations – sujet ô combien important et d'actualité. Les manifestations en France connaissent, ces derniers temps, une montée des violences : des individus agressent les forces de l'ordre, brûlent le mobilier urbain et pillent les commerces qui ont le malheur de se trouver sur leur parcours. Ces destructions et affrontements sont devenus quasi systématiques ; ils relèguent désormais au second plan les revendications des manifestants pacifiques. Prenons l'exemple des black blocs, qui utilisent un mode opératoire visant à causer le plus de dégâts possible. Ils ont laissé plusieurs fois derrière eux des paysages de désolation, lors de manifestations contre la loi Travail, célébrant le 1er mai ou encore celles des gilets jaunes. Depuis le quinquennat de François Hollande, ce constat est devenu la norme à chaque manifestation.
Le Gouvernement et la majorité ne sont pas toujours très à l'aise avec ces questions. Elles appellent pourtant des réponses de bon sens, garantissant la sécurité et l'ordre public. La liberté de manifester et la liberté d'expression ne permettent pas tout. Agresser un fonctionnaire de police ou de gendarmerie n'est pas faire usage de sa liberté de manifester. Brûler un abribus ou un engin de chantier, piller un magasin ou saccager un lieu public n'est pas faire usage de sa liberté d'expression. C'est de la violence pure et simple. Le rôle de l'État est de tout faire pour l'empêcher, ce qui revient précisément à garantir le droit de manifester et la liberté d'expression.
Depuis les manifestations contre la loi Travail, les médias n'ont plus qu'un seul axe d'information lorsqu'il s'agit de couvrir une manifestation : le nombre de dégradations et d'interpellations. Or cela contrevient à l'intérêt des manifestants, dont les revendications ne sont plus reprises, ou alors de manière anecdotique. La sécurité des manifestants pacifiques est également mise en danger par les agissements de ces individus violents, dont le seul but est de casser et de défier les forces de l'ordre. Voter en faveur de mesures de lutte contre les violences commises pendant les manifestations, c'est s'engager pour le droit à manifester et la liberté d'expression.
Devant l'urgence d'agir, pour ne pas laisser les mains libres aux casseurs et aux pilleurs, le groupe Les Républicains au Sénat a déposé, en 2018, une proposition de loi. Alors qu'elle avait été adoptée, le Conseil constitutionnel a décidé de la censurer partiellement avant son entrée en vigueur, l'année suivante. Ce texte avait pourtant pour objet de renforcer et de garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, en donnant des instruments légaux aux autorités pour mettre hors d'état de nuire les casseurs et les agresseurs des forces de l'ordre.
Cette proposition de loi prévoyait, entre autres dispositions, de donner la possibilité aux policiers, en cas de risque de trouble à l'ordre public, de contrôler les effets personnels des passants ainsi que les véhicules circulant ou stationnant à l'entrée d'un périmètre délimité, pendant les six heures précédant le début de la manifestation et jusqu'à sa dispersion. L'objectif était d'empêcher l'accès à une manifestation aux personnes détenant, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme. Il en était de même pour le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de toute arme par destination. Ce délit devait être puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Enfin, selon le principe du casseur-payeur, le texte prévoyait la possibilité pour l'État de se retourner contre les auteurs des dommages.
En première lecture à l'Assemblée nationale, des modifications ont été adoptées. Elles concernaient la suppression du périmètre de sécurité lors des manifestations, l'allègement des procédures de déclaration préalable d'une manifestation, la création d'un fichier de personnes interdites de manifester et la suppression de l'article relatif aux fusées d'artifice –article finalement incorporé dans la proposition de loi relative à la sécurité globale.
Le texte adopté par le Parlement prévoyait également la possibilité, pour le préfet, d'interdire à une personne constituant une menace pour l'ordre public de manifester. Cette interdiction pouvait s'étendre à tout le territoire national. C'est cette disposition que le Conseil constitutionnel a décidé de censurer, jugeant que le législateur portait au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'était pas adaptée, nécessaire et proportionnée.
Afin de répondre à cette censure, le groupe UDI-I a déposé la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui. Elle vise à lutter contre les individus violents lors de manifestations, en introduisant la possibilité d'une interdiction pour ces derniers de participer à une ou plusieurs manifestations. Concrètement, les personnes constituant des menaces particulièrement graves pour l'ordre public et dont les agissements auront conduit à des violences ou des dégradations pourront se voir interdire, par un arrêté motivé du préfet, de participer à une manifestation au cours de laquelle de telles atteintes seraient susceptibles d'avoir lieu. Ces personnes pourront également se voir interdire de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national, pour une durée ne pouvant excéder dix jours. Le non-respect de ces interdictions sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Au moment de ces manifestations, ces personnes, à l'image des mesures prises à l'égard des hooligans dans le monde du football, pourront être amenées à pointer au commissariat de police.
Cette proposition de loi de nos collègues UDI-I reprend la volonté et le dispositif inclus dans la loi dite anticasseurs de nos collègues sénateurs du groupe LR. Les députés du groupe LR voteront donc pour cette proposition visant à renforcer le dispositif législatif existant.

Cette proposition de loi revient sur un sujet dont nous avons déjà débattu. Elle vise à donner à l'autorité administrative le pouvoir d'interdire de manifestation toute personne présentant une menace pour l'ordre public, en raison de ses agissements ou de la commission d'actes violents. Elle est cousine d'un texte dont le Conseil constitutionnel, en 2019, avait censuré une disposition analogue, la jugeant non conforme à la Constitution en ce qu'elle donnait une latitude excessive à l'autorité administrative dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction. Selon les termes de l'article jugé non conforme, cette interdiction ne pouvait frapper que les personnes ayant commis des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens, ou encore un acte violent lors de manifestations précédentes.
Cette nouvelle proposition appelle de ma part deux observations sur le fond. D'une part, les termes pour déterminer et caractériser les motifs de l'interdiction restent larges et sujets à interprétation par l'autorité administrative. De façon subsidiaire, l'interdiction elle-même a une durée non circonstanciée à une manifestation donnée. Elle peut donc atteindre dix jours et être accompagnée d'une convocation au commissariat.
D'autre part, l'autorité administrative ne dispose d'aucune indépendance, alors que le droit de manifester est une liberté fondamentale. En aucune façon la proposition ne prévoit les conditions de contestation d'une telle décision. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2019, avait in fine considéré qu'il était porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'était ni adaptée ni nécessaire ni proportionnée.
Cette proposition ne nous paraît ni opportune ni conforme à notre droit, tel qu'il est interprété par le Conseil constitutionnel. Notre groupe est opposé à son adoption.

Cette proposition de loi vise à instaurer une interdiction administrative de manifester à l'encontre de personnes pouvant constituer une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique. Avec mes collègues Démocrates, nous comprenons le but de ce texte. Nous avons tous été témoins des violences et des dégradations commises par des individus ultra-violents, notamment les black blocs, qui viennent se mêler à des manifestations pacifiques, mettant en danger les manifestants, les passants, les riverains, les commerçants et les forces de l'ordre. Tous, nous avons été choqués par ces violences, qui ont été largement reprises et diffusées dans les médias.
La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, issue de la proposition de loi du sénateur Bruno Retailleau, visait à prévenir ces violences et à en sanctionner les auteurs. Son article 3 prévoyait la création de l'interdiction de manifester. Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, au motif qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions.
L'article unique que vous nous proposez prévoit de nombreuses interdictions. Or, n'oubliant pas que le droit de manifester est un droit fondamental, essentiel à l'expression collective et publique des opinions et revendications, les membres du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés sont défavorables à son adoption. Même si vous nous dites avoir tenu compte des observations du Conseil constitutionnel, ce texte reste trop attentatoire au droit d'expression collective des idées et des opinions. L'équilibre entre sécurité et libertés publiques n'est pas suffisant.

L'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure permet d'interdire administrativement une manifestation, mais pas à des individus de manifester. C'est le juge judiciaire qui peut, en vertu de l'article 131-32-1 du code pénal, prononcer une interdiction individuelle de manifester pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, dans le cadre d'un jugement faisant suite à des violences en manifestation.
Il nous est proposé ici de créer une interdiction administrative individuelle pour les personnes violentes de participer aux manifestations, en dehors de tout jugement judiciaire. Cette mesure serait prononcée par le préfet du département ou le préfet de police. Au regard des précédentes interventions, cette proposition de loi fait naître un débat sur sa constitutionnalité.
L'exposé des motifs fait explicitement référence à la décision du Conseil constitutionnel censurant l'article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre lors des manifestations, pour préciser que la proposition de loi en tient compte. Les sages avaient en effet estimé que cette mesure portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions, et violait ainsi l'article 11 sur la liberté d'expression de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel écrit : « le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation ». En définitive, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction. Autrement dit, les atteintes aux libertés publiques prises au nom du maintien de l'ordre n'étaient ici ni proportionnées ni suffisamment encadrées.
À la lumière de cette décision, ce n'est pas tant, semble-t-il, le principe d'une interdiction individuelle de manifester décidée par le préfet qui est jugé inconstitutionnel, mais les modalités de cette interdiction. C'est l'interprétation que semble faire le rapporteur, analysant – à tort ou à raison – que le Conseil constitutionnel pourrait juger l'interdiction constitutionnelle si les modalités en étaient adaptées. La proposition de loi est la traduction de cette interprétation.
Il est toujours délicat d'anticiper une décision du Conseil constitutionnel, sauf quand les mesures sont manifestement inconstitutionnelles. Nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises. Nous en avons déjà fait l'amère expérience, d'autant plus que nous nous appuyons sur une décision déjà rendue, et que chacune et chacun se livre à sa propre interprétation. Toutefois, à titre personnel, il ne me paraît pas opportun de rejeter le texte de M. Brindeau au seul motif d'une supposée contrariété à la Constitution.
S'agissant de la philosophie de ce texte, nous partageons toutes et tous la volonté de lutter contre les individus qui confisquent aux manifestants la défense de la cause pour laquelle ils ont choisi de se réunir. Néanmoins, je voterai contre cette proposition de loi, pour deux raisons.
D'une part, notre Constitution prévoit, en son article 66, que c'est bien le juge judiciaire, indépendant, qui est le seul garant des libertés individuelles. Il ne faut déroger à ce grand principe que dans des cas très spécifiques et encadrés, par exemple par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT.
D'autre part, l'effectivité de la mesure pose des difficultés. Pour reprendre de nouveau l'exposé des motifs, « ces interdictions administratives très encadrées permettront de toucher les individus violents que nos forces de l'ordre n'ont pas réussi à appréhender. » Il est compliqué d'imaginer la faisabilité concrète et matérielle d'une interdiction frappant une personne qui a réussi à ne pas être appréhendée. C'est au regard de ce point, et non du supposé caractère inconstitutionnel de la proposition, que je voterai contre.

Je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter notre collègue Pascal Brindeau pour sa ténacité et son courage. S'il n'avait pas permis, par son excellent travail, de faire revenir à l'Assemblée nationale l'article 3 de la proposition de loi de nos collègues sénateurs, que le Conseil constitutionnel avait censuré, ces dispositions, pourtant nécessaires et attendues, auraient certainement terminé dans les oubliettes de l'Histoire. La présente proposition de loi constitue donc un message et un symbole forts envoyés à nos concitoyens, ainsi qu'à nos forces de l'ordre.
Depuis plusieurs années, toutes les manifestations d'envergure pâtissent de la présence d'individus qui font incursion dans les cortèges pour détruire, brûler, casser, piller et s'en prendre violemment à nos policiers et à nos gendarmes. Or, en raison de leur mode d'action, l'interpellation de ces extrémistes, dont beaucoup prennent part au mouvement des black blocs, demeure particulièrement complexe. Si les débordements lors de manifestations ont toujours existé, il n'en demeure pas moins que nos forces de l'ordre sont confrontées depuis quelques années à l'émergence d'un phénomène nouveau, d'une ampleur et d'un niveau de violence intolérables.
Cette évolution inacceptable prend racine dans deux vices originaux : d'une part, la violence entraînant la violence, une montée vers les extrêmes, alliée au sentiment général d'impunité qu'éprouvent les casseurs et que ressentent nos concitoyens ; d'autre part, l'actuelle doctrine française de maintien de l'ordre, héritée du traumatisme de l'affaire Oussekine, en 1986, et dont le principe cardinal est simple : éviter au maximum tout contact direct entre les forces de l'ordre et les manifestants, et contenir la violence plutôt que la réprimer, pour éviter à tout prix un nouveau drame. Si l'intention est juste, certaines conséquences sont inévitables, telle la montée de la violence publique lors des manifestations. Les exemples sont nombreux : protestations contre la loi Travail, célébrations du 1er mai, samedis des gilets jaunes et, plus récemment, manifestations contre la proposition de loi relative à la sécurité globale. Ces phénomènes n'épargnent aucun territoire, pas même la ruralité. Ils sont devenus tellement récurrents qu'ils n'étonnent malheureusement plus personne et passent pour des faits divers aux yeux tant des médias que de nos concitoyens.
Les députés du groupe UDI et Indépendants refusent cette fatalité, tout comme ils refusent que les messages et les revendications des manifestants pacifiques soient constamment confisqués et relégués au second plan par les agissements subversifs d'individus haineux et violents ne désirant que le chaos. En France, chacun doit pouvoir manifester et exprimer librement ses opinions et ses convictions, sans que des petits groupes d'individus en mal d'action ou de notoriété viennent faire obstacle à ce droit fondamental. Les députés du groupe UDI et Indépendants refusent également l'état de terreur dans lequel se trouvent les commerçants, les banques et les restaurateurs qui, au passage du cortège, craignent pour leur vitrine, leurs locaux, leurs produits et parfois même pour leurs clients. Enfin, nous refusons que nos forces de l'ordre soient constamment prises pour cible par des individus ne cherchant qu'à les combattre, les blesser, les lyncher ou les tuer. Où sont l'État et le droit, quand nos policiers et gendarmes viennent à craindre pour leur vie en assurant le maintien de l'ordre ?
Il serait naïf de croire que cette proposition de loi mettra définitivement un terme à ces phénomènes de violence et à ces dégradations ; nous sommes néanmoins convaincus qu'elle constituera un outil pertinent et efficace pour en limiter l'ampleur. Comme nous l'ont dit tous les représentants de nos forces de l'ordre lors des auditions menées par le rapporteur, l'objet de ce texte est, pour eux, d'une importance capitale. Ces interdictions administratives de manifester, très encadrées, couplées au renforcement des échanges européens entre les services de police, à l'utilisation accrue de produits de marquage par les forces de l'ordre et à l'utilisation de matériel permettant une meilleure diffusion des sommations, porteront un coup sévère à ces scènes de guérilla urbaine, que nos concitoyens souhaitent voir disparaître de leurs écrans ou des journaux du soir. Alors que la Belgique et l'Allemagne ont d'ores et déjà instauré un cadre législatif permettant de prendre de telles interdictions de manifester à l'encontre des individus les plus violents, la France se doit de suivre ce chemin.
Cette proposition de loi, qui fait siennes les observations du Conseil constitutionnel, permettra justement de lutter contre ces individus dangereux, qui entravent les droits fondamentaux des vrais manifestants. Alors que les Français ne supportent plus ces scènes de guérilla urbaine, le devoir du législateur est de donner à nos forces de l'ordre et aux représentants de l'État les moyens d'y mettre un terme. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI et Indépendants, particulièrement fier de défendre cette proposition de loi dans le cadre de sa niche parlementaire, vous invite à l'adopter.

Notre groupe avait voté contre la loi anticasseurs de 2019 et avait saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci avait été particulièrement implacable, puisqu'il avait souligné que le législateur avait porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'était ni adaptée ni nécessaire ni proportionnée.
La nouvelle rédaction de l'article 3 ne lève pas un certain nombre d'inquiétudes. D'une part, le préfet peut prononcer une interdiction de manifester sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, bien que cette interdiction soit limitée à dix jours, il n'y a pas de limite dans les reconductions. Nous savons très bien, s'agissant, par exemple, des interdictions de stade, que les préfets peuvent prendre des interdictions les unes à la suite des autres, sans limite. Ces mesures issues de l'ancien article 3 sont disproportionnés et elles constituent une restriction de liberté trop importante.
La rédaction de l'alinéa 4 pose aussi problème. Sont évoquées des « raisons sérieuses de penser que la personne […] est susceptible de participer à toute autre manifestation. » Quelles sont ces raisons sérieuses ? Quels sont les faits avérés, probables ou prétendus ? Autant de questions qui ne nous permettent pas d'y voir clair. Ces dispositions donneraient beaucoup trop de pouvoir aux préfets.
Le problème est aussi là : on décharge le juge judiciaire de ses prérogatives pour donner aux préfets et à l'administration un rôle judiciaire. Nous craignons que cette disposition ne porte une atteinte manifeste au respect des droits de la défense, voire au principe de la présomption d'innocence. Les interdictions seraient prononcées au cas où des personnes pourraient être violentes. Mais, dans notre droit, on ne condamne les gens que s'ils ont commis un délit ou un crime, et non sur une simple intention ! Par ailleurs, le code pénal permet de prononcer des peines complémentaires et ainsi de réprimer de tels actes.
Je crains, d'ailleurs, que nous ne fassions une erreur. La difficulté, avec les black blocs, ce n'est pas de les empêcher de manifester, c'est tout simplement de savoir qui ils sont et de les repérer ! Cette loi ne peut s'appliquer que s'ils sont identifiés, et c'est bien là le problème !
Nous ne pouvons pas, évidemment, soutenir cette proposition de loi, qui nous paraît aller beaucoup trop loin dans la restriction des libertés. Cette mesure, ne l'oublions pas, vient de l'état d'urgence sécuritaire. Subrepticement, on est en train de transférer des mesures de nature sécuritaire dans le droit commun. Or je ne pense pas qu'une société de type sécuritaire soit souhaitable. Il faut chercher à lutter contre les violences dans les manifestations, mais par d'autres moyens que cette proposition de loi. Nous ne la soutiendrons pas.

La niche parlementaire du groupe UDI et indépendants contient des choses intéressantes. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi l'UDI-I vient au secours du soldat Retailleau – à moins que cela ne soit la manifestation du syndrome centriste de faire la balance dans ses textes législatifs – pour sauver une loi inefficace et liberticide, qui a d'ailleurs été, à juste titre, retoquée par le Conseil constitutionnel à la suite de la saisine des trois groupes parlementaires de gauche de l'Assemblée nationale et du Président de la République lui-même.
Les premières victimes des violences dans les manifestations sont, bien sûr, ceux qui en subissent les dégâts, mais aussi les manifestants eux-mêmes qui se voient entravés dans leur liberté de manifester et d'exprimer ainsi leur désaccord. Je sais de quoi je parle, contrairement à M. Retailleau, qui est sans doute plus coutumier des processions que des manifestations, à part en 1984 ….
J'avais déposé une proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête sur les stratégies de maintien de l'ordre, mais cette proposition n'a malheureusement pas été retenue. Agnès Thill a dit que nous sommes victimes d'une stratégie de maintien de l'ordre qui, depuis Malik Oussekine, refuserait le contact. Je suis désolé, c'est l'inverse qui s'est produit lors des manifestations des gilets jaunes : les forces de police allaient au contact des manifestants. Il y a donc bien eu une rupture dans la stratégie de maintien de l'ordre, dont on n'a pas encore fait le bilan. Ce bilan me paraît d'autant plus nécessaire que, selon les syndicats, les policiers n'ont pas été formés pour cela, ce qui explique les blessés et les dérapages constatés.
Aujourd´hui, l'interdiction de manifester est une peine complémentaire décidée par un juge judiciaire. Elle ne repose pas sur la simple suspicion d'un préfet. On ne peut que s'en féliciter quand on voit le préfet de police de Paris, Didier Lallement, s'adresser à une manifestante gilet jaune pacifiste de 60 ans en lui disant : « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Comment oser donner un tel pouvoir à un préfet qui a une conception aussi faible de la République ?
Cette proposition de loi instaure un régime d'exception qui, en plus d'être attentatoire aux libertés, est totalement inefficace. Je connais le problème des black blocs ; j'ai proposé ici des résolutions pour lutter efficacement contre eux. Que l'on arrête la mansuétude à l'égard de ces groupes et les stratégies de maintien de l'ordre qui favorisent leurs exactions. Je pourrais vous en donner plusieurs exemples, mais je me contenterai de celui de la manifestation du 1er mai 2018 : des policiers fouillant les poussettes des mamans et les cabas des mamies alors qu´ils laissaient 1 000 black blocs se regrouper en toute liberté sur le pont d'Austerlitz, sans intervenir. Et au milieu de tout ça, Benalla !
Ayons un recul sur la stratégie du maintien de l'ordre et soyons efficaces pour lutter contre ces groupes et pour garantir le droit de manifester, mais, surtout, prenons garde à ne pas bafouer le droit sacro-saint de manifester et de s'exprimer librement.

Tous les groupes reconnaissent la nécessité de lutter contre la violence dans les manifestations, car elle porte préjudice tant aux manifestants eux-mêmes qu'aux commerçants et aux habitants. J'ai plusieurs raisons d'être défavorable à cette proposition de loi, outre le fait qu'elle reprend des dispositions qui ont pourtant été fermement condamnées par le Conseil constitutionnel.
L'interdiction de participer à une manifestation prévue par cette proposition de loi est inspirée par les dispositions sur les interdictions de stade, à propos desquelles Marie-George Buffet et moi-même avons rédigé un rapport d'information. Les interdictions de stade, introduites dans le code du sport par une loi relative à la lutte contre le terrorisme, sont gravement attentatoires aux libertés et doivent donc être strictement proportionnées et nécessaires. Il y aurait d´ailleurs beaucoup à dire sur leur champ d´application, sur les obligations qui pèsent sur les intéressés ainsi que sur leur durée.
Les modifications que vous avez apportées à votre texte à la suite de la censure du Conseil constitutionnel n'épuisent pas toutes les objections possibles, ainsi qu´en témoigne la formule « sans qu´il soit besoin d´examiner les autres griefs » utilisée dans sa décision.
Par ailleurs, je trouve curieux de vous retrouver, vous qui vous êtes posé en grand défenseur du juge judiciaire lors des débats sur la loi de programmation pour la justice, dans le rôle de celui qui consacre l'autorité administrative.
Enfin, je vous invite au pragmatisme : les black blocs, ce sont par définition des gens que la police ne parvient pas à interpeller. Comment, dans ces conditions, vouloir leur interdire de participer à une manifestation ? Cela pose un grave problème d'efficacité de l'action publique.

Je tiens à remercier M. le rapporteur pour son travail qui a le mérite de prendre à bras le corps l'important sujet de la violence dans les manifestations. Les Français ne supportent plus de voir ces scènes de guérilla urbaine et c'est le devoir de l'État, non seulement d'assurer que les manifestations puissent se dérouler sans que les commerçants soient obligés de se barricader pour ne pas voir leurs vitrines saccagées ou leurs magasins pillés, mais aussi de permettre à nos forces de l'ordre d'exercer leur mission sans craindre pour leur propre sécurité.
Cette proposition de loi est un texte équilibré qui répond de manière ferme à ce phénomène de violence qui exaspère les Français, tout en prenant en compte les objections prononcées par le Conseil constitutionnel à l'article 3 de la proposition de loi présentée par Bruno Retailleau.
Comme le rapporteur l'a rappelé, le Conseil constitutionnel ne remettait pas en cause le principe de l'interdiction de manifester lors de menaces d'une particulière gravité pour l'ordre public, mais seulement les modalités de sa mise en œuvre. Ce texte y remédie. Je n'ai d'ailleurs que quelques amendements rédactionnels à proposer dans cette discussion.
Je ne comprends pas ceux d'entre nous qui sont défavorables à ce texte. Il ne faudrait donc rien faire et subir la loi de ces casseurs ultra-violents sans réagir ? Pourquoi ne pas proposer d'amender ce texte plutôt que de le rejeter ?
Je suis très attentive à la protection de nos libertés fondamentales, mais, lorsqu'il s'agit de mettre en balance deux libertés, je préfère protéger celles des citoyens respectueux de la loi plutôt que celles des casseurs. Samedi dernier, à Béziers, les forains ont manifesté pour réclamer la réouverture de leurs attractions sans qu'une chaise soit renversée ou un pot de fleur cassé ; ils ont distribué pommes d'amour et barbe-à-papa à tout le monde. Malheureusement, tous les manifestants ne sont pas aussi pacifiques que les forains et il est urgent d'agir ! Je voterai donc pour cette proposition de loi.

On ne parle pas ici de porter atteinte aux libertés publiques et individuelles, bien au contraire, puisque, comme je ne cesse de le répéter, et plus encore dans un contexte d'état d'urgence sanitaire, nous en sommes les gardiens. Il ne s'agit pas d'empêcher de braves citoyens de manifester, mais bien de lutter contre une guérilla urbaine menée par des bandes organisées pour terroriser celles et ceux qui veulent manifester dignement et pour casser – du flic, des vitrines, tout. Plusieurs centaines d'individus sont clairement identifiés, mais tous n'ont pas fait l'objet de mesures judiciaires. Il faut donc accélérer le processus judiciaire, même si cela ne résoudra pas le problème des black blocs qui, grâce à leur organisation et à leur anonymat, se jouent des forces de police.
Je comprends donc que l'on puisse reprocher à ce texte de ne pas répondre à tous les problèmes posés par la violence dans les manifestations et je comprends également qu'il suscite des interrogations sur sa constitutionnalité, sur les moyens mis en œuvre ou sur la question de l'autorité administrative qui n'est pas, en France, la gardienne légitime des libertés, mais il faut bien proposer quelque chose ! Le texte qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, d'une certaine façon, désarme la démocratie. Que compte faire le Gouvernement pour permettre aux manifestants pacifiques de s'exprimer librement et éviter la chienlit ?

Je n'interprète pas la décision du Conseil constitutionnel : dans ses attendus, il considère que le législateur poursuivait l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Cet objectif doit, bien sûr, être concilié avec celui de la préservation de la liberté collective d'expression des opinions et avec le droit de chaque individu de contester une décision administrative prise à son encontre. Je pense que ce texte, qui est proportionné et équilibré, y parvient.
« Sans qu´il soit besoin d´examiner les autres griefs » est une formule classique employée par le Conseil constitutionnel et ne signifie pas que le législateur ne puisse réécrire une loi dès lors que le Conseil a rendu une décision à son sujet.
Je ne vois pas, dans le texte, de contradiction entre le rôle de l'autorité administrative et celui du juge judiciaire puisque seul ce dernier peut prononcer une peine complémentaire. L'interdiction de manifester ne peut être prononcée sur la base d'une simple suspicion : elle doit reposer sur la constatation d'actes de violence dont l'auteur a été identifié. Cela pose la question très importante de l'identification des auteurs de violence. Nous devons aider les forces de l'ordre à contrer les systèmes de dissimulation très efficaces utilisés par les black blocs, grâce notamment à l'utilisation des traçages chimiques et la vidéosurveillance.
En conclusion, que Stéphane Peu se rassure, je ne suis pas devenu le porte-voix de Bruno Retailleau. Le groupe UDI-I entend utiliser sa niche parlementaire pour répondre à de vrais besoins de faire évoluer notre droit. Nous entendons ainsi être les porte-voix des commerçants et des riverains qui subissent ces exactions ; des manifestants – les représentants des centrales syndicales nous ont dit combien ils étaient meurtris par les violences commises lors de leurs manifestations pacifiques du 1er mai ; et, bien sûr, des forces de l'ordre, qui n'en peuvent plus d'être prises à partie et de voir leur doctrine de maintien de l'ordre être remise en question.
Face au phénomène des black blocs, les interdictions judiciaires et les mesures d'identification ne suffisent plus. C´est donc notre devoir collectif de compléter l'arsenal juridique à disposition des forces de l'ordre et de l'autorité administrative.
Article unique (art. L. 211–4–1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Création d'une interdiction administrative de manifester
Les amendements CL2 et CL3 de Mme Marie-France Lohro sont retirés.
La commission est saisie de l'amendement CL23 du rapporteur.

Cet amendement vise à mieux assurer la proportionnalité du dispositif en ne mentionnant que les agissements « répétés » des personnes pouvant faire l'objet d'une interdiction administrative de manifester, ce qui est de nature à mieux caractériser la menace qu'ils représentent. Cet amendement est issu des auditions que nous avons menées.
La commission rejette l'amendement.
Elle rejette les amendements identiques CL24 du rapporteur et CL18 de Mme Emmanuelle Ménard.
La commission examine l'amendement CL25 du rapporteur.

Je ne comprends pas pourquoi le groupe majoritaire vote contre des amendements rédactionnels, qui sont pourtant de pure forme. Cela n'élève pas le débat.

Ces amendements ont été rejetés par la majorité des membres présents dans cette salle. Les membres de chaque groupe sont libres d'exprimer un vote qui n'est pas forcément unanime.

Il s'agit ici d'allonger le délai permettant de couvrir, pour l'interdiction, des manifestations récurrentes se tenant à date fixe, telles que les manifestations du 1er mai. Il est nécessaire qu'une personne ayant commis des exactions lors d'une manifestation précise puisse être empêchée d'y participer l'année suivante.
La commission rejette l'amendement.
La commission examine l'amendement CL26 du rapporteur.

En supprimant la possibilité de prononcer une interdiction administrative de participer à des manifestations non déclarées, cet amendement vise à prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2019 s'agissant du droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que des observations faites lors des auditions. Il aurait été préférable de traiter le problème pour toutes les manifestations, déclarées ou non-déclarées, mais ce sont surtout les manifestations déclarées qui subissent les violences des black blocs.
La commission rejette l'amendement.
Elle rejette l'amendement rédactionnel CL27 du rapporteur.
La commission est saisie de l'amendement CL5 de Mme Marie-France Lorho.

La formulation « de leurs abords immédiats » est trop approximative pour être appliquée, notamment en cas de mobilité de la manifestation. S'il pourrait être proportionné de procéder à une interdiction sur le lieu même de la manifestation, interdire les « alentours » de celle-ci ne l'est pas.

Les termes « abords immédiats » sont couramment employés dans le domaine de la police administrative. Par ailleurs, cette disposition n'a pas fait l'objet d'une critique du Conseil constitutionnel. Ces termes me paraissent importants pour garantir son caractère opérationnel. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
La commission examine l'amendement CL4 de Mme Marie-France Lorho.

L'interdiction administrative de manifester reposant sur une simple présomption de participation revient à prêter à un citoyen des intentions politiques particulières. Or, en France, nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques. Cet alinéa va donc à l'encontre des droits les plus fondamentaux des Français et doit être supprimé.

Cet alinéa, qui respecte le principe de proportionnalité, vise les manifestations, comme celles du 1er mai, qui se tiennent simultanément à Paris et en province. Dans ces situations, il est utile de pouvoir étendre l'interdiction de participer à l'ensemble de ces rassemblements. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
La commission examine l'amendement CL22 de Mme Emmanuelle Ménard.

Il semble qu'il y ait une erreur de décompte d'alinéas : c'est bien le premier alinéa de l'article L. 211-4-1 qui doit être visé.
L'amendement CL22 est retiré.
La commission rejette l'amendement rédactionnel CL28 du rapporteur.
La commission examine l'amendement CL29 du rapporteur.

Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition prévoyant une durée de trente jours de l'interdiction de manifester. Afin de garantir la proportionnalité, cet amendement tend à porter cette durée à deux semaines, ce qui demeure utile en cas de mouvement revendicatif s'étendant sur une période longue, comme celui des gilets jaunes
La commission rejette l'amendement.
L´amendement CL6 de Mme Marie-France Lorho est retiré.
La commission est saisie de l'amendement CL30 du rapporteur.

Dans un souci de proportionnalité, cet amendement vise à restreindre l'obligation de pointage à la seule interdiction de manifestation ponctuelle prévue par le premier alinéa de l'article L. 211-4-1 du code de la sécurité intérieure.
La commission rejette l'amendement.
La commission rejette l'amendement de précision CL31 du rapporteur.
Elle rejette les amendements identiques de conséquence CL32 du rapporteur et CL7 Mme Marie-France Lorho.
Les amendement CL8 et CL9 de Mme Marie-France Lorho, et CL19 de Mme Emmanuelle Ménard sont retirés.
La commission examine l'amendement CL33 du rapporteur.

Afin d'assurer la proportionnalité du dispositif, cet amendement vise à revenir au quantum de peine adopté par notre assemblée en 2019.
La commission rejette l'amendement.
L´amendement CL1 de Mme Marie-France Lorho est retiré.
La commission examine en discussion commune les amendements CL21 et CL20 de Mme Emmanuelle Ménard et CL34 du rapporteur.

Je retire les amendements CL20 et CL21 au profit de l´amendement CL34 du rapporteur, qui propose de revenir au quantum des peines de droit commun. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi des peines différentes seraient prononcées à l'encontre d'individus violents selon qu'ils soient interdits de manifester sur un périmètre géographique ou sur tout le territoire national.

Afin d'assurer la proportionnalité du dispositif, cet amendement vise à revenir au quantum de peine adopté par notre assemblée en 2019.
Pour rassurer Mme Ménard, c'est bien la même peine qui est prévue dans les deux cas qu'elle a cités.
Les amendement CL20 et CL21 sont retirés.
La commission rejette l'amendement CL34.
La commission rejette l'article unique.
Après l'article unique
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement CL17 de M. Ian Boucard.
L'article unique ayant été rejeté, la proposition de loi n'est pas adoptée.
La Commission examine la proposition de loi visant à mieux lutter contre la fraude à l'identité dans le cadre des mineurs non accompagnés (n° 3443) (Mme Agnès Thill, rapporteure).

Je suis très heureuse de vous présenter une proposition de loi visant à lutter contre la fraude à l'identité pour mieux protéger les mineurs non accompagnés. Elle vise à mieux distinguer les mineurs non accompagnés (MNA) des majeurs qui prétendent l'être pour bénéficier des protections de l'aide sociale à l'enfance ou des règles de la justice pénale des mineurs. C'est cette confusion entre majeurs et mineurs qui porte atteinte à notre capacité à bien prendre en charge ces enfants dont nous avons la responsabilité.
En matière civile, 60 % des mineurs non accompagnés sont en réalité des majeurs. Ce chiffre, établi par un rapport du Sénat en 2017, met en péril tout le système de la protection de l'enfance dont nos départements ont la charge, ce qui représente pour eux un surcoût considérable. Ils nous demandent de l'aide et nous ne pouvons pas faire comme si ce problème n'existait pas. À cause de cette situation, des mineurs dorment dans des chambres d'hôtel ou des studios tandis que d'autres côtoient des majeurs bien plus âgés qu'eux.
Le contexte n'est guère différent au pénal. Selon le récent rapport de la mission d'information menée par nos collègues Jean-François Eliaou et Antoine Savignat sur les problématiques de sécurité liées à la présence des MNA en France, certaines expérimentations, par exemple à Paris, ont montré un taux de majeurs parmi les MNA dépassant les 90 %. Ces faux mineurs détournent les protections légitimes accordées aux enfants délinquants.
Il est important, comme nous l'avions fait la semaine dernière, de distinguer deux catégories de MNA. La première catégorie, qui ne pose pas de difficultés, regroupe les mineurs pris en charge au titre de la protection de l'enfance. Ils sont souvent originaires d'Afrique subsaharienne et souhaitent travailler, car ils ont été missionnés par leur famille. La deuxième catégorie regroupe les MNA pris en charge au titre de l'enfance délinquante, impliqués dans des réseaux et souvent victimes d'addiction. Ces mineurs, très majoritairement originaires du Maghreb, refusent l'aide sociale à l'enfance et les magistrats sont souvent contraints de les placer en détention provisoire s'ils veulent pouvoir assurer une prise en charge, notamment sanitaire et scolaire, ce qui peut s'avérer difficile quand le mineur a en réalité plus de vingt ans.
Si nous voulons protéger les mineurs et nous mettre au service de l'intérêt supérieur de l'enfant, nous devons recentrer les dispositifs existants sur les enfants et mieux évaluer les jeunes qui se présentent comme des MNA. Personne ne trouve cette situation satisfaisante et il est urgent d'agir. Ma proposition de loi va en ce sens. Elle ne résoudra sûrement pas toutes les difficultés que je viens de décrire mais engagera un effort en ce sens. Je proposerai de la compléter, notamment en m'inspirant des recommandations de nos collègues Jean-François Eliaou et Antoine Savignat.
Au terme des auditions que j'ai menées, il m'a semblé utile d'encourager le recours au fichier d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM), afin d'éviter qu'un même mineur déclare plusieurs identités dans différents départements ou à l'occasion de diverses interpellations. La plupart de nos voisins procèdent ainsi. Il est également urgent d'accélérer la coopération internationale sur ce sujet. D'autres pays, d'origine ou de passage, disposent d'informations utiles pour identifier ces mineurs et mieux comprendre leur parcours. Il faut inciter nos magistrats à les interroger.
L'article 1er de la proposition de loi répond à une difficulté récurrente : le refus de certains jeunes d'effectuer les examens radiologiques, aussi appelés tests osseux, afin que leur majorité ne soit pas reconnue. Cette stratégie est bien connue des réseaux criminels qui les embrigadent et utilisent cette méthode pour les rassurer. Je souhaite donc que l'on puisse, en cas de refus, présumer que l'intéressé est majeur.
Les tests osseux ont été inscrits et encadrés par le législateur dans la loi relative à la protection de l'enfant du 14 mars 2016. En l'état du droit, trois conditions sont requises pour procéder aux tests osseux : l'absence de documents d'identité valables, une décision de l'autorité judiciaire et le consentement éclairé de l'intéressé. Cet examen, qui se pratique à partir d'une radiographie des os – poignet ou clavicule – ou des dents, intervient de manière subsidiaire lorsqu'un doute persiste au cours de l'évaluation d'une personne se présentant comme MNA, c'est-à-dire lorsque les autres informations recueillies ne suffisent pas à certifier la minorité. D'autres garanties protègent le mineur faisant l'objet d'un test osseux : les résultats doivent indiquer une marge d'erreur et ne peuvent suffire à déterminer la minorité. En cas de doute, celui-ci bénéficie à l'intéressé. Mon texte reprend ces garanties car, en aucun cas, un mineur ne doit être considéré comme majeur.
J'ai conscience des limites de la fiabilité des examens radiologiques. Les scientifiques estiment que la marge d'erreur pour ces tests osseux varie de douze à vingt-quatre mois. C'est à la fois peu et beaucoup, car cela signifie que toutes les personnes de plus de 20 ans pourraient être identifiées comme majeures. Pour ma part, je ne vois pas de difficulté à ce que certains très jeunes majeurs puissent intégrer un parcours en protection de l'enfance, à condition qu'ils en respectent aussi les obligations en matière d'éducation et de surveillance.
Au-delà de 20 ans, en revanche, l'écart d'âge au sein des établissements est trop important et pose des difficultés vis-à-vis des autres mineurs et des travailleurs sociaux. Je proposerai donc une rédaction globale de l'article 1er rétablissant la fixation de la marge d'erreur à vingt-quatre mois au maximum et indiquant que le test osseux ne permet pas à lui seul de définir la majorité. C'est un examen réalisé à titre complémentaire, et c'est bien ainsi que nous l'entendons.
Par ailleurs, le référentiel utilisé, qui date de 1940, est ancien et établi à partir d'une population américaine, ce qui explique également cette marge d'erreur. Je proposerai donc son actualisation tous les sept ans.
Je connais également les critiques faites à ce dispositif en raison de sa potentielle inconstitutionnalité. La présomption de majorité est une pratique contraire au droit existant mais elle n'est pas incompatible avec la Constitution. En effet, il semble que la position du Conseil constitutionnel sur le sujet soit moins radicale que certains l'affirment. À l'occasion d'une décision QPC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis le principe des tests osseux, sous réserve des garanties prévues par le législateur et que je viens de présenter. La proposition de loi les préserve et en précise un certain nombre, notamment concernant l'information du mineur et la qualité de l'examen effectué.
Le Conseil constitutionnel indique également que le refus de procéder à l'examen ne saurait entraîner une présomption de majorité. Toutefois, il faut se référer au commentaire de la décision pour mesurer la portée de cette affirmation. Le Conseil constate que ce n'était pas l'intention du législateur en 2016 et indique que ce rappel « vise à répondre à l'argumentation développée par certains intervenants selon laquelle il existerait des pratiques en sens contraire ». En effet, un magistrat ayant des doutes sur l'âge d'un mineur en raison de son apparence physique et faisant face au refus de ce dernier de procéder au test pourrait être tenté de le déclarer majeur. Certains magistrats, y compris des juges des enfants, le font par manque d'éléments fiables, mais cette pratique est contraire à la loi.
En tant que législateur, nous pouvons donc inverser cette présomption dès lors que les protections persistent. En outre, d'autres éléments peuvent compléter la décision et inverser cette présomption qui n'est en aucun cas irréfragable.
Telle est, chers collègues, la présentation que je souhaitais faire de cette proposition de loi et des amendements que j'ai déposés pour l'améliorer et répondre à vos objections. La finalité de ce texte est bien de protéger les mineurs non accompagnés. J'espère que nous aurons un débat constructif sur ce sujet à propos duquel nous sommes très attendus.

La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de vous présenter le rapport relatif à la délinquance de certains mineurs non accompagnés, rédigé avec mon collègue Antoine Savignat. Au cours de cette réunion, nous avons évoqué la difficulté rencontrée par les professionnels de l'aide sociale à l'enfance (ASE), comme par les services de police et de justice, pour identifier ces jeunes de manière certaine. Les vrais mineurs doivent être protégés au titre de l'aide sociale à l'enfance et pris en charge par des juridictions spécialisées, mais il arrive que des jeunes majeurs se fassent passer pour des mineurs afin de profiter de ses dispositifs avantageux.
Je me concentrerai sur le texte de la proposition de loi de notre collègue Agnès Thill. La procédure d'évaluation de la minorité et de l'isolement a fait l'objet de nombreuses discussions tout au long de nos travaux. Ses modalités, précisées par décret, reposent sur un faisceau d'indices pouvant inclure une évaluation sociale ainsi que les informations que le président du conseil départemental peut demander au préfet. C'est dans ce cadre qu'il peut, depuis 2019, consulter le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, mis en place par la loi « Asile et immigration » du 10 septembre 2018. Cette évaluation repose aussi, en dernier recours, sur la réalisation d'examens complémentaires prévus à l'article 388 du code civil, au nombre desquels un examen radiologique osseux, dont la fiabilité est régulièrement remise en cause en raison d'une marge d'erreur de plus ou moins dix-huit mois, ce qui est considérable pour un test diagnostic qui, j'y insiste, n'a pas été conçu pour cela.
Nous nous sommes finalement refusés, avec mon collègue Antoine Savignat, à recommander la généralisation des tests osseux. La piste de l'inversion de la présomption de minorité, qui fait l'objet de la proposition de loi, n'a pas été davantage retenue. Cette présomption bénéficie à chaque individu se revendiquant mineur. Son renversement consisterait à exiger la production de documents d'identité afin de justifier de la minorité de l'individu, faute de quoi il serait considéré et traité comme majeur, c'est-à-dire susceptible d'être envoyé en centre de rétention et éventuellement jugé comme un majeur. Une telle disposition, qui a profondément divisé les personnes que nous avons auditionnées, pourrait encourir la sanction du Conseil constitutionnel. Nous n'avons donc pas souhaité en faire une recommandation dans le rapport de notre mission d'information.
Plusieurs pistes me semblent plus efficaces et réalisables afin d'améliorer concrètement l'évaluation de la minorité. Le fichier AEM gagnerait à être généralisé à l'ensemble des départements. Une marge d'amélioration pourrait être trouvée en favorisant le relevé d'empreintes digitales, soit en les rendant obligatoires, soit en renforçant les sanctions prononcées en cas de refus de s'y soumettre. Enfin, le renforcement de la coopération internationale favoriserait l'établissement de l'état civil de ces mineurs.
Le texte présenté par madame la rapporteure s'inscrit exclusivement dans une logique d'inversion de la présomption de minorité, alors qu'il existe d'autres pistes ne remettant pas en cause les grands principes de protection des mineurs auxquels notre groupe demeure attaché.
La proposition de loi indique, à plusieurs reprises, les conditions dans lesquelles l'individu est présumé majeur, mais elle semble également se contredire. L'alinéa 2 affirme que le refus de l'examen entraîne une présomption de majorité, ce qui me paraît inacceptable. L'alinéa 5 insiste de nouveau sur l'information à donner à l'intéressé concernant la présomption de majorité, mais à l'alinéa 4, il est tout de même fait mention du consentement, bien que celui-ci soit contraint par l'ensemble du texte proposé. Ces dispositifs, que l'on peut juger coercitifs, me semblent contraires à la fois à notre philosophie de protection de l'enfance et au minimum de respect de la vie privée accordé à tout individu, surtout s'il est possiblement mineur.
La proposition de suppression de l'alinéa 3 de l'article 388 du code civil pose également ce problème de changement de philosophie sur le fond, ainsi que celui de la fiabilité des tests. Cet alinéa doit être préservé, car il mentionne la marge d'erreur des examens osseux, important pour les individus d'un âge proche de 18 ans, d'autant que les résultats de ces examens ne peuvent à eux seuls déterminer si l'intéressé est mineur. Je tiens à rappeler qu'en amont du test osseux, il existe des enquêtes sociales sur lesquelles je ne reviendrai pas.
De plus, en termes d'effectivité, la proposition de loi est silencieuse quant à la prise en charge des individus en amont de la réalisation d'un diagnostic et pendant la durée de l'évaluation de la minorité ou de la majorité, qui peut prendre plusieurs semaines.

Je serai bref puisque, comme l'a rappelé notre collègue Jean-François Eliaou, nous avons récemment présenté un rapport conjoint sur ce sujet.
Si, comme vous l'avez rappelé dans votre rapport et comme vient de l'indiquer notre collègue, la manière d'aborder la situation des mineurs non accompagnés sur le territoire national est un sujet prégnant, il nous est difficile de dire que nous ne sommes pas d'accord avec votre texte. L'un des points relevés à chaque audition que nous avons réalisée est la détermination de la minorité, qu'à mon sens, il eût été préférable d'aborder sous l'angle de l'identité de la personne, l'âge n'en étant que l'un des éléments constitutifs. De fait, la difficulté principale rencontrée par tous les professionnels est d'obtenir l'identité.
Comme vient de le rappeler Jean-François Eliaou, le sujet doit être abordé par cercles concentriques. Il convient, d'abord, de rechercher les pays de provenance de ces personnes et les raisons de leur départ, puis leur parcours migratoire. Au fil de nos auditions, nous nous sommes aperçus que la grande majorité de ceux qui avaient des documents d'identité en Espagne n'en avaient plus à leur arrivée en France. Il convient de s'interroger sur le fonctionnement de nos institutions et de notre système pour comprendre pourquoi en passant les Pyrénées, les papiers disparaissent.
Il existe deux sortes de mineurs non accompagnés : ceux qui vont immédiatement à la rencontre de l'aide sociale à l'enfance et sont demandeurs d'accompagnement, et ceux qui, cherchant à passer sous les radars, sont appréhendés par les forces de l'ordre et déférés devant la justice. Pour ceux-là, votre proposition pose un énorme problème. À partir du moment où vous les présumerez majeurs, vous les renverrez devant le tribunal correctionnel qui, en l'absence d'identité et d'âge établis, ne pourra que se déclarer incompétent. Nous nous retrouverons dans un jeu de ping-pong entre le tribunal pour enfants et les juridictions correctionnelles qui ne seront pas en capacité de résoudre les litiges et de prononcer des décisions, dans l'ignorance totale de la minorité ou de la majorité de la personne.
Se pose aussi, comme le rappelait Jean-François Eliaou, le problème constitutionnel de l'inversion de la charge de la preuve. Puisque, selon la convention internationale des droits de l'enfant, chaque enfant a le droit d'être protégé s'il se déclare mineur, il appartiendra aux institutions, conformément au régime de charge de la preuve en vigueur en France, de démontrer le contraire. Mais comment le démontrer par une simple présomption ? Cela nous paraît difficile et incompatible avec les règles et principes fondamentaux du fonctionnement judiciaire de notre pays.
À cela s'ajoute l'incertitude du test osseux que vous voulez imposer et que nombre de professionnels reconnaissent comme non fiable et ne correspondant plus à la réalité des mineurs se présentant sur le territoire national.
Oui, le sujet est bon. Oui, le sujet est important. Oui, il faut que nous trouvions une solution. Avec Jean-François Eliaou, nous ne désespérons pas de voir notre rapport trouver rapidement écho et de parvenir à un texte proposant une solution globale afin de mettre un terme à des situations anormales. On expose les vrais mineurs à un danger en les hébergeant aux côtés de mineurs qui se révèlent être majeurs, ce que nous ne pouvons pas accepter. Mais en l'état, nous ne pourrons faire autrement que de voter contre ce texte.

Je remplace mon collègue Philippe Latombe.
La question des mineurs non accompagnés provoque d'importants débats, notamment sur les modalités de détermination de la minorité. L'évaluation de leur âge repose sur des faisceaux d'indices prévus par le législateur ou par décret, qui ne font pas toujours l'objet de consensus.
Au 31 décembre 2019, selon l'Assemblée des départements de France, l'aide sociale à l'enfance prenait en charge près de 40 000 mineurs non accompagnés (MNA). Pour l'ensemble de l'année 2020, 40 000 personnes étrangères se présentant comme mineures devraient avoir sollicité le statut de MNA, dont la moitié environ devrait être intégrée au dispositif de l'ASE, soit directement par les services du département, soit par le juge après un recours introduit par les candidats recalés, soit un total d'environ 20 000 personnes.
Cette situation engendre des crispations, en particulier dans les départements qui supportent le coût de la prise en charge, lequel s'élève en moyenne à 50 000 euros par mineur et par an. Le coût total pour la collectivité en 2019 s'élevait à 2 milliards d'euros, à la charge des départements qui reçoivent une compensation de l'État pour une partie de ces dépenses, contre 50 millions en 2012. Ce chiffre pourrait atteindre 2,5 milliards d'euros en 2020 et, si la dynamique actuelle perdure, 3 milliards d'euros en 2021.
Votre texte, madame la rapporteure, propose de remplacer la présomption de minorité qui prévaut dans notre droit positif par une présomption de majorité lorsque l'intéressé refuse de se soumettre à un examen médical d'évaluation de son âge. Le groupe Modem et Démocrates apparentés n'est pas favorable à cette proposition de loi qui tend à créer un régime d'exception contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme l'ont dit les deux orateurs précédents, il comporte un risque d'inconstitutionnalité, point que je vais développer pour expliquer notre position.
L'inversion de la présomption de minorité prévue par cette proposition de loi semble contraire à la Constitution. Dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a indiqué que l'impossibilité de déduire la majorité d'une personne de son seul refus de se soumettre à un examen osseux fait partie des garanties attachées à la protection de l'enfance. Par conséquent, la présomption de majorité reviendrait à inverser la présomption du fait du refus de l'examen médical, ce qui est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant qui impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge.
De plus, un certain nombre de juridictions internationales posent le principe d'une présomption de minorité. Celle-ci est également consacrée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), tandis que le comité des droits de l'enfant des Nations unies consacre de manière claire cette présomption de minorité dans ses décisions du 31 mai 2019 contre l'Espagne. Pour cette seule raison, le groupe Modem et Démocrates apparentés est défavorable à cette proposition.
Enfin, le dispositif de cette proposition de loi pose la question des modalités de détermination de la minorité des mineurs non accompagnés. Le recours à des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge en l'absence de documents d'identité valables ne fait pas l'objet d'un consensus. Je précise que cet examen s'appuie sur des données collectées dans les années 1930 à 1940 auprès de mille jeunes Américains, qui ne correspondent plus du tout aux morphologies actuelles. La marge d'erreur, de plus à moins de dix-huit mois, mentionnée par Jean-François Eliaou, montre la fragilité de ce test.
Pour toutes ces raisons, notre groupe ne votera pas cette proposition de loi.

Je représente mon groupe à la commission des Lois car, en tant que coprésidente du groupe d'études sur les mineurs non accompagnés, je suis particulièrement mobilisée sur les problématiques relatives à ces mineurs. Avec ma collègue Elsa Faucillon, nous avons participé à de nombreuses auditions d'associations et d'acteurs de terrain. Je salue, d'ailleurs, le travail de mes collègues Eliaou et Savignat, tout en rappelant que les problèmes de sécurité liés à la présence des MNA sur le territoire sont créés par 10 % d'entre eux, les autres étant avant tout des enfants vulnérables.
Nous devons dépasser les couleurs politiques. En l'état actuel du phénomène, aucun département français ne peut assumer la charge de ce sujet, la situation financière de ces collectivités étant d'ores et déjà catastrophique.
D'après l'Institut Montaigne, pour l'ensemble de l'année 2020, 40 000 personnes étrangères se sont présenté comme mineures et ont sollicité le statut de MNA. Sur ces 40 000, environ la moitié devrait être intégrée au dispositif de l'ASE, soit directement par les services du département, soit par le juge après un recours introduit par les candidats recalés, soit un total de 20 000 personnes. Cette situation ne va pas sans crispation, en particulier dans les départements qui supportent le coût de prise en charge, qui s'élève en moyenne à 50 000 euros par mineur et par an. Ne faudrait-il pas gérer ce phénomène à l'échelle nationale par une enveloppe commune, là où les départements et l'ASE sont débordés et n'ont pas toujours les moyens de faire face ?
Selon les chiffres de 2019 fournis par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, les mineurs non accompagnés présents en France viennent avant tout d'Afrique de l'Ouest et de trois pays en particulier – la Guinée-Conakry, le Mali et la Côte-d'Ivoire –, et 10 % d'entre eux sont originaires du Maghreb. Il existe un vrai sujet de délinquance, puisqu'en 2019, les MNA maghrébins représentaient 75 % de ceux déférés à la justice. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 75 % des mineurs déférés à un tribunal depuis le déconfinement sont des mineurs non accompagnés.
Une autre question se pose quant à la coopération diplomatique avec ces pays. Il faudrait renforcer les partenariats avec les autorités guinéennes, par exemple, sur le modèle de ce qui a été fait avec les autorités marocaines, en 2018. Une équipe marocaine, composée de sept policiers déployés à Paris pour identifier les mineurs de la Goutte-d'Or, a permis d'identifier 320 Marocains, dont 140 étaient majeurs.
Madame Thill, je partage l'objectif visé par le dispositif. Dans la mesure où des individus connaissent très bien le droit de ne pas accepter d'examen médical afin d'établir la minorité, il est insupportable de penser que certains utilisent le statut très protecteur légitimement accordé par la France aux mineurs – et il faut s'en honorer – pour se jouer du droit des étrangers, du droit d'asile et du droit pénal. Néanmoins, l'ensemble des avis et recommandations s'accordent sur le fait que les tests osseux présentent, notamment autour de l'âge de 18 ans, une marge d'erreur de dix-huit à vingt-quatre mois. C'est une raison pour laquelle le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 21 mars 2019, a jugé conformes les alinéas 2 et 3 de l'article 388 du code civil, estimant que la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux.
Il est urgent d'agir. Nous en sommes tous conscients, tout comme nous sommes conscients que cette problématique doit être traitée dans sa globalité, et que le rapport d'information de nos collègues Eliaou et Savignat et les propositions à venir du groupe d'études doivent nous inciter à élaborer un texte commun et global. Les sages de la rue de Montpensier ont été clairs ; la proposition de loi nous semble vouée à l'inconstitutionnalité et, en conséquence, nous ne la voterons pas.

Je voudrais d'abord remercier Agnès Thill pour son travail approfondi sur les mineurs non accompagnés. Comme l'indique le titre de la proposition de loi, lutter contre la fraude à l'identité a pour objectif de mieux protéger les vrais mineurs non accompagnés.
Les chiffres cités par plusieurs de nos collègues montrent que des départements rencontrent d'importantes difficultés, non seulement financières, parce que la prise en charge pèse sur leurs budgets et les compensations de l'État ne sont nullement à la hauteur de l'évolution de ces dépenses, mais aussi en termes d'organisation des services de l'aide sociale à l'enfance. Pour avoir rencontré des agents de ces services, je puis témoigner de leur inquiétude, parfois même de leur peur, de se sentir submergés par le nombre de MNA pour lesquels ils doivent trouver des solutions d'hébergement et d'accompagnement, alors qu'ils se rendent compte que certains d'entre eux sont tout sauf des mineurs non accompagnés.
Dans leur rapport, nos collègues Eliaou et Savignat ont pointé cette question. En voyant 40 000 nouveaux mineurs non accompagnés arriver en France en 2019, nous comprenons que nous faisons face à des organisations et des systèmes d'immigration clandestine qui, contournant le droit de l'immigration européenne et française, utilisent de jeunes personnes à des fins criminelles. Même si beaucoup essaient d'échapper à une situation économique et sociale ne leur permettant pas de s'épanouir dans leur pays et pensent trouver en France ou dans d'autres pays d'Europe une situation économique plus favorable, nous faisons face à un système organisé, frauduleux et criminel. C'est cette extrême difficulté et rien d'autre que notre collègue Agnès Thill a voulu souligner. Dans sa proposition de loi, elle retient, en forme d'appel au débat public, deux pistes de solutions présentant les inconvénients qui ont été rappelés mais qui ont le mérite de la clarté et d'essayer de traiter la problématique de la fraude à l'identité.
Cela me rappelle les travaux que j'ai menés sur la fraude à l'identité génératrice de fraude aux prestations et cotisations sociales. Si vous n'essayez pas d'inverser la preuve, en l'occurrence de la minorité, vous laissez s'engouffrer des réseaux dans cette faille ou fragilité de notre droit français. Sans méconnaître le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, il nous faut travailler sur cet arsenal législatif. C'est l'objet de la proposition soutenue par notre collègue Agnès Thill et que le groupe UDI-I soutiendra.

En instaurant une présomption de majorité pour les enfants qui refusent de se soumettre au test et en créant, de fait, une obligation de s'y soumettre, les enfants isolés risquent de ne plus pouvoir bénéficier de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en France. Or ces tests sont peu fiables et peu efficaces. Une étude réalisée en 2017 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Marseille sur 1 423 garçons et 1 191 filles âgés de 1 à 21 ans, a mis en évidence que pour un individu donné, la marge d'erreur varie de six mois à un an près entre 0 et 10 ans et d'un à deux ans près au-delà de 10 ans. La variabilité la plus grande est observée entre 16 et 18 ans, c'est-à-dire la tranche d'âge la plus fréquente des migrants mineurs.
Dans plusieurs cas des personnes réellement mineures ont été chassées de l'aide sociale à l'enfance car étant considérées comme majeures. En 2014, le journal Le Monde rapportait le cas d'une jeune congolaise de 16 ans victime d'un réseau de proxénètes. Isolée et sans contact à Paris, elle avait pu bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et se construire grâce à cela, mais elle en avait été chassée et s'était retrouvée à la rue à la suite d'un test osseux qui lui donnait 18 ans mais qui s'est finalement révélé erroné.
Ces tests ont été dénoncés par le Défenseur des droits, le conseil national de l'Ordre des médecins, le Haut Conseil de la santé publique, le comité des droits de l'enfant des Nations unies, le Syndicat de la magistrature, la Cimade, Médecins du monde, la Ligue des droits de l'homme, etc. La détermination d'un âge physiologique sur le seul cliché radiologique est à proscrire, a notamment souligné le Haut Conseil de la santé publique, dans un avis de 2014.
La problématique des mineurs étrangers non accompagnés est avant tout humaine. Environ 40 000 personnes seraient concernées sur le territoire français. Elle rejoint la problématique de l'accueil des migrants dans notre pays. Certains majeurs isolés essaient de se faire passer pour mineurs afin de bénéficier de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils risquent de vivre à la rue s'ils ne bénéficient de cet accompagnement.
Le vrai problème est donc bien l'incapacité de l'État à construire une politique d'accueil des migrants respectueuse de la dignité humaine, des conventions internationales et européennes, mais également de la propre législation française qui peine à être appliquée pour cause de sous-dotation en moyens humains, financiers et matériels.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Libertés et territoires n'est pas favorable à cette proposition de loi.

Je tiens à remercier notre collègue Agnès Thill pour son initiative. La problématique des mineurs non accompagnés fait partie intégrante de la question migratoire, qui concerne la France au premier chef. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de la fermeture des frontières et de la « remigration », comme certains aimeraient le croire dans une vision caricaturale et contre-productive, mais de participer à la rationalisation et à l'amélioration de notre politique migratoire.
On ne doit plus voir de « jungles de Calais » ou de camps insalubres comme ceux de la porte de la Chapelle à Paris. C'est indigne. Mais on ne doit plus voir non plus des personnes étrangères bénéficier indûment du statut de mineur. On ne doit plus voir une violence dans l'espace public dont les mineurs non accompagnés, d'après la préfecture de Paris, sont responsables à 60 %. L'auteur de l'attaque devant l'ancien siège de Charlie Hebdo était arrivé en France sous le statut de mineur isolé, alors qu'il avait en réalité 25 ans. C'est un fait qu'on ne peut ignorer et croire qu'il serait un cas isolé relève de la naïveté et de l'aveuglement idéologique. D'après les chiffres de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, 96 % des migrants mineurs interpellés à Paris dont l'identification a été possible se sont révélés être majeurs,
Cela nuit au système entier et surtout aux véritables mineurs non accompagnés, qui sont lésés par ces profiteurs. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qui est affirmé de façon caricaturale, d'écarter les mineurs non accompagnés de la protection de l'aide sociale à l'enfance, mais au contraire de s'assurer que ceux qui sont réellement mineurs puissent en bénéficier pleinement sans que des fraudeurs viennent parasiter leur statut.
Il y a une hypocrisie très forte sur ces questions, en France. J'espère que nous pourrons avoir ici un débat rationnel.

Permettez-moi de m'indigner de la proposition de loi présentée par le groupe UDI et Indépendants, parti centriste qui se fait le porte-voix d'une droite beaucoup plus dure, de thèses idéologiques simplistes et tend à considérer l'étranger uniquement comme un profiteur, en méconnaissant la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la valeur constitutionnelle de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Quel est le rapport entre le titre de votre texte, qui dit protéger les mineurs non accompagnés, et le texte lui-même qui poursuit clairement d'autres objectifs ? Il vise non seulement à rendre quasi-automatiques et systématiques les tests osseux dont on sait qu'ils ne sont pas fiables, mais aussi à introduire une notion de présomption de majorité, c'est-à-dire à ne plus voir dans ces enfants des mineurs à protéger mais des étrangers à rejeter.

Ils seraient 40 000 mineurs non accompagnés sur notre territoire, alors qu'ils n'étaient, selon les chiffres du Gouvernement, que 4 000 à 6 000 en 2007. Cette explosion du nombre des mineurs non accompagnés est confirmée par l'Assemblée des départements de France, qui constatait déjà qu'entre 2016 et 2017, le nombre de MNA pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance des départements avait augmenté de 74 %. Concrètement, à eux seuls, ils représentent 15 % à 20 % des mineurs pris en charge par l'ASE, ce qui est considérable. Cela devient presque choquant quand on sait que 60 % d'entre eux seraient en réalité majeurs. Sachant que, selon les dernières estimations, un mineur non accompagné coûte 50 000 euros par an au contribuable français, l'addition est salée.
De plus en plus nombreux, ils coûtent de plus en plus cher. En outre, un grand nombre d'entre eux ne sont pas mineurs. Les filières qui les utilisent sont de mieux en mieux organisées. Je me réfère au rapport que viennent de publier nos collègues Antoine Savignat et Jean-François Eliaou, qui indique que mystérieusement, les papiers d'identité disparaissent au passage des Pyrénées.
Ce n'est pas tout. N'oublions pas que la violence, quand ce n'est pas le radicalisme, des mineurs non accompagnés dans nos rues ou dans nos prisons est galopante. Le rapport de nos deux collègues confirme cette tendance et précise que les MNA délinquants représentent environ 10 % de l'ensemble des MNA.
Je regrette qu'un amendement que j'avais déposé ait été déclaré irrecevable. Celui-ci prévoyait qu'un mineur non accompagné en situation irrégulière et ayant commis une infraction doit faire l'objet d'une comparution immédiate, et lorsque sa nationalité est établie, peut être expulsé du territoire national et confié à l'autorité administrative pour l'enfance compétente de son pays d'origine. Car malheureusement, ces mineurs non accompagnés se singularisent le plus souvent par un refus de toute prise en charge.
Face à cela, nous avons le choix entre deux options : faire l'autruche, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années, au point que les forces de l'ordre comme les magistrats sont complètement dépassés, ou bien agir. La proposition de loi de notre collègue Agnès Thill entre dans cette seconde catégorie, qui souhaite légaliser les examens médicaux intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. C'est vrai, ces tests ne sont pas fiables à 100 %, personne ne le conteste, mais vous avouerez que le refus de s'y soumettre n'aide pas à considérer la bonne foi des mineurs non accompagnés.
Autant dire qu'au regard des éléments évoqués précédemment et de l'urgence de la situation, je soutiendrai cette proposition de loi, que j'ai d'ailleurs cosignée.

Je remercie chacun d'entre vous pour l'intérêt porté à ma proposition de loi. J'ai rédigé plusieurs amendements allant dans votre sens. Je proposerai une réécriture globale de l'article 1er visant notamment à actualiser le référentiel datant de 1940 et portant sur mille personnes américaines. Un autre de mes amendements vise une meilleure coopération internationale, en sorte que nous nous rejoignons sur beaucoup de points, ce dont je me réjouis.
Monsieur Eliaou évoquait l'absence de fiabilité des tests osseux et leur marge d'erreur allant jusqu'à dix-huit mois. Dans mon propos liminaire, j'ai dit accepter jusqu'à deux ans d'erreur. Allons jusqu'à l'âge de 20 ans mais pas au-delà. Nous devons accepter une marge d'erreur de deux ans. Le cas de la jeune fille de 16 ans ne se produirait plus si on acceptait une telle marge d'erreur.
Je vous rejoins pour la généralisation du fichier AEM. C'est pourquoi j'ai présenté un amendement pour obliger les départements à l'alimenter.
Monsieur Savignat, je vous rejoins en ce qui concerne l'identité. J'avais prévu un amendement sur les empreintes et les photos qui a été déclaré irracevable, alors que dans des pays voisins, dont l'Allemagne, les empreintes sont accessibles afin de favoriser la détermination de l'identité.
Quant au risque d'inconstitutionnalité qui pèserait sur la présomption de majorité en cas de refus de se soumettre aux tests, je ne le crois pas si certain car cette présomption ne serait pas irréfragable. Et, bien sûr, le doute bénéficie toujours à l'intéressé.
J'ai également prévu, madame Firmin Le Bodo, un amendement pour tendre vers une meilleure coopération internationale. On sait très bien que des réseaux de traite d'êtres humains existent et que des délinquants se mêlent aux mineurs. Tout une organisation malsaine entoure ces passeurs qui demandent 5 000 à 9 000 euros à un majeur et 15 000 euros à un mineur pour les conduire en Europe.
Je rejoins également notre collègue Acquaviva, la politique migratoire est bien une compétence de l'État. Claude Bartolone, que personne ne peut taxer d'être de droite, lorsqu'il était président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en 2011, avait ouvert les hostilités en disant qu'il n'accueillerait plus de mineurs isolés étrangers (MIE), rappelant que leur prise en charge relevait de la compétence de l'État. Nous avons été alertés par l'ensemble des présidents des conseils départementaux : le budget qu'ils consacrent aux MNA augmente et ils ne peuvent y faire face, notamment parce que parmi ceux-ci se trouvent des faux mineurs. Cette proposition de loi vise à protéger, éduquer et former les vrais mineurs, qui en ont besoin. Il est même dangereux pour eux de se retrouver dans des lieux avec des jeunes majeurs.
Chaque mineur coûte 50 000 euros par an aux départements, que l'État, dans sa grande mansuétude, rembourse à hauteur de 4 500 euros et uniquement la première année. Les mineurs sont donc presque entièrement à la charge du département alors qu'ils devraient relever d'une politique de l'État.
Enfin, il est tout simplement interdit de frauder. Tout enseignant, éducateur ou parent l'enseigne : on ne triche pas, on ne ment pas. Or 60 % des jeunes qui se présentent comme mineurs ne le sont pas.
La Commission examine l'amendement de suppression CL11 de Mme Bagarry.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 21 mars 2019, cite les garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux lorsqu'ils sont utilisés pour définir l'âge de l'enfant : seule l'autorité judiciaire peut décider d'y recourir et elle doit s'assurer du caractère subsidiaire de cet examen ; la majorité ne peut être déduite du seul refus de s'y soumettre ; le doute doit toujours profiter à la qualité de mineur de l'intéressé, compte tenu de la marge d'erreur de ces examens.
De fait, l'article 1er, en rendant les tests osseux quasiment systématiques, en les autorisant sans décision judiciaire et en introduisant une notion de présomption de majorité, contrevient à l'ensemble de ces garanties. Il porte atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

Je regrette ces amendements de suppression, car leur adoption nous priverait d'un débat utile et riche sur la question des mineurs non accompagnés. Vous avez, d'ailleurs, proposé des rédactions globales de l'article qui me sembleraient intéressantes à discuter.
Je suis d'accord sur la nécessité de renforcer la fiabilité des tests. C'est la raison pour laquelle je souhaite rétablir et encadrer la marge d'erreur au niveau sur lequel s'accordent les scientifiques, à savoir vingt-quatre mois. Je souhaite également actualiser les référentiels pour qu'ils soient adaptés aux mineurs d'aujourd'hui.
Il n'est pas question de porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous voulons, au contraire, ne pas mélanger les mineurs aux majeurs, précisément afin de les protéger. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les jeunes majeurs, mais ce ne peut être dans les mêmes dispositifs.
Pour ce qui est du risque d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a autorisé les tests osseux sous réserve de garanties, que la proposition de loi maintient : le test osseux, compte tenu de sa marge d'erreur, ne peut seul servir à définir la minorité.
La présomption de majorité, quant à elle, peut être renversée. Le Conseil constitutionnel s'y est d'ailleurs montré défavorable au seul motif qu'il ne s'agissait pas de la volonté du législateur et qu'il ne souhaitait pas que des pratiques contraires à la loi se diffusent.
S'agissant du risque médical lié à l'examen radiologique, il faut rester raisonnable. Si la question peut effectivement se poser pour les jeunes filles enceintes, n'oublions pas que 95 % des mineurs non accompagnés sont des garçons.

Je suis favorable à l'amendement défendu par Mme Bagarry. Nous sommes tous d'accord avec les objectifs de la proposition de loi : protéger les mineurs et empêcher que les jeunes majeurs se fassent passer pour des mineurs. Ce qui préoccupe le groupe La République en Marche, c'est le recours aux examens radiologiques osseux pour déterminer l'âge de l'enfant. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 388 du code civil satisfait déjà l'alinéa 3 de la proposition de loi.
Du point de vue scientifique, on ne peut pas dire qu'avec une marge d'erreur de dix-huit mois ou de deux ans, les tests osseux sont fiables. Ce n'est vraiment pas possible.
Pour ce qui est des référentiels, le problème qu'ils posent n'est pas de différence ethnique mais nutritionnelle. En général, les jeunes migrants qui se présentent en France ont un parcours totalement fracassé et sont mal nourris. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Quant à élaborer de nouveaux référentiels tous les cinq ou sept ans, ce n'est pas faisable – à partir de quelles populations et de quelles études cliniques ? Pour tout un tas de considérations méthodologiques, votre proposition de loi n'est pas fonctionnelle.

Le groupe Agir ensemble votera également en faveur de cet amendement de suppression. Outre que j'adhère aux arguments développés par M. Eliaou, voter pour un article qui peut être déclaré inconstitutionnel me gêne.
Nous sommes tous d'accord qu'il faut continuer de protéger les mineurs non accompagnés. Or cette question devrait être discutée dans le cadre d'une loi plus globale, et ne pas être traitée à travers le seul prisme de cette proposition de loi.

Les tests osseux sont complètement détournés de leur finalité médicale originelle, puisqu'ils ont été élaborés pour suivre les effets d'une thérapeutique sur la croissance osseuse d'un enfant.
Plutôt qu'une présomption de majorité, pourquoi ne pas plutôt introduire une présomption de minorité dans le droit français – même si cette possibilité a été récemment retoquée par le Conseil constitutionnel ?
Ayons bien conscience que le problème lié aux jeunes majeurs qui se font passer pour des mineurs non accompagnés ne se réglera pas par cette proposition de loi. La France doit assumer pleinement sa responsabilité d'accueil des majeurs, et la prise en charge des MNA doit être nationale. Les conseils départementaux ne doivent pas avoir seuls la responsabilité de cette question, d'autant que l'évaluation de l'âge des enfants varie d'un département à l'autre, ce qui n'est pas acceptable.

Je voterai contre cet amendement de suppression, car l'objectif de cette proposition de loi est de prendre en charge le mieux possible les mineurs non accompagnés ; il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Certes, cette proposition de loi ne réglera pas tout, mais elle a au moins le mérite d'exister et de se saisir de cette question. Si cet amendement de suppression est adopté, nous ne pourrons pas débattre de cette question avant longtemps. Cela signifiera que, comme avec la proposition de loi précédente sur les individus violents, vous ne voulez pas vous saisir du problème. Vous reconnaissez qu'il existe un vrai problème mais vous ne faites rien, vous baissez les bras, au motif que la proposition de loi ne serait pas adaptée. Il est reconnu que 60 % des MNA sont majeurs, que leur nombre sur le territoire français explose et que la plupart d'entre eux sont victimes de filières de passeurs, mais on décide de ne rien faire !
Cette proposition de loi était l'occasion de se saisir de cette question – vous auriez pu l'amender pour qu'elle soit meilleure. Vous refusez de commencer à travailler sur le sujet, tant pis ! Les Français vous regardent ; ils voient que vous n'êtes pas à la hauteur de leurs attentes sur ces questions majeures de notre société.

Ce n'est pas parce que le problème des mineurs non accompagnés est réel, qu'il faut y apporter une mauvaise solution. D'ailleurs, nous nous en sommes saisis, puisque des avancées ont été apportées par la loi de 2018. C'est pourquoi le groupe Modem et Démocrates apparentés votera cet amendement de suppression.
Les tests osseux sont interdits dans certains pays, notamment au Royaume-Uni. Pour protéger les mineurs le mieux possible, il faut poser le débat aux niveaux européen et international, et non adopter des solutions qui ne sont pas adaptées.

Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut y apporter une mauvaise solution, dites-vous. Faut-il pour autant ne rien faire ? Ce serait pire, je crois.
L'excellent rapport présenté par nos collègues Eliaou et Savignat me semble l'occasion de travailler sur cette question. Nous sommes tous d'accord pour dire que le problème est réel pour les départements, qu'il y a un danger à réunir dans un même lieu les majeurs et les mineurs et que la fraude existe bien. Nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état.
La Commission adopte l'amendement CL 11.
En conséquence, la Commission supprime l'article 1er et les autres amendements portant sur l'article tombent.
Après l'article 1er
La Commission examine l'amendement CL26 rectifié de la rapporteure.

Il s'agit, dans le cadre d'une procédure civile ou pénale, en alternative ou en complément de l'examen radiologique, de permettre au juge de consulter le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité et d'interroger d'autres pays afin de savoir si la personne a déjà déclaré une date de naissance ou a été évaluée dans un autre État. D'une part, ces informations sont insuffisamment exploitées ; d'autre part, la coopération internationale est une voie efficace pour améliorer la lutte contre les faux mineurs non accompagnés.
Cet amendement fait référence au nouvel article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contiendra, à partir du 1er mai 2021, les dispositions de l'ancien article L. 611-6-1, relatives au fichier AEM.

Cet amendement est satisfait par l'article R. 221-15-3 du code de l'action sociale et des familles qui liste les personnes pouvant accéder au fichier AEM. Or le problème n'est pas tant la consultation de ce fichier que la qualité des informations qu'il contient, donc son utilité et son efficacité. Dans notre rapport, Antoine Savignat et moi-même proposons d'y remédier en rendant obligatoires un certain nombre d'éléments. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

Cet amendement est, selon moi, tout à fait pertinent.
La suppression de l'article 1er est une erreur : une nouvelle fois, nous allons passer à côté d'une solution, même si elle est partielle et susceptible de poser des problèmes de constitutionnalité. Le Gouvernement et sa majorité font preuve d'une grande lâcheté en refusant de se saisir de cette question.
Je suis élu départemental et j'ai présidé pendant près de dix ans le conseil départemental des Alpes-Maritimes, un département frontalier confronté à une forte présence de mineurs non accompagnés. Nous en comptons près de 500 dans nos structures d'accueil et nous connaissons de fréquents phénomènes de violence. La fraude à l'identité est manifeste – tous les policiers le constatent – et n'est pas combattue avec la vigilance et la détermination nécessaires. La minorité est devenue un vecteur de fraude à l'entrée sur le territoire national.
Je salue les propositions contenues dans le rapport de nos collègues Eliaou et Savignat, mais il faut maintenant passer à l'action. Cette proposition de loi serait un début. J'avais d'ailleurs déposé un texte, identique dans l'esprit, visant à renverser la charge de la preuve. Une fois de plus, je le regrette, la majorité refuse de s'attaquer au problème. On ne résout pas les problèmes uniquement par des discours, mes chers collègues ; à un moment, il faut passer aux actes.

Deux problèmes se posent, concernant les fichiers AEM. D'une part, ils ne sont pas remplis par tous les départements – seuls les procureurs y ont accès et non les juges pour enfants. D'autre part, ils sont uniquement utilisés au civil.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL24 de la rapporteure.

Le décret du 30 janvier 2019, qui encadre l'utilisation du fichier AEM, prévoit que les départements peuvent y avoir accès et que ce fichier peut contenir le résultat des évaluations.
L'objet de l'amendement est de rendre systématique la transmission des informations aux départements lorsqu'un MNA leur est confié, afin qu'ils puissent savoir s'il a déjà été évalué. Il prévoit également la transmission systématique des évaluations vers le fichier, car certains départements continuent de refuser de le faire, ce qui a des conséquences néfastes pour tous les autres. Il s'agissait de la recommandation n° 2 du rapport sur les mineurs non accompagnés présenté la semaine dernière.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en arrive à l'amendement CL25 de la rapporteure.

Cet amendement vise, lorsqu'un doute persiste, à permettre au juge de réévaluer un mineur en interrogeant le fichier AEM – le décret de 2019 ne donne cette possibilité qu'au procureur de la République –, et l'encourage à interroger d'autres pays en s'appuyant sur les données contenues dans le fichier. S'il dispose des empreintes et photographies, il pourra interroger les pays d'origine supposés et les pays de passage. Certains pays comme l'Espagne acceptent notamment de transmettre des informations concernant des majeurs qui se sont présentés comme MNA sur son territoire.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL15 de Mme Emmanuelle Ménard.

Je redéposerai cet amendement en séance, car il vise un article erroné, puisque modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2020. Quoi qu'il en soit, il tend à modifier un certain nombre de conditions pour la mise en œuvre du traitement automatisé des données à caractère personnel collectées au cours de l'accueil et de la prise en charge des MNA.
Je reviens également sur la question du fichier AEM, qui aurait grand avantage à être généralisé à l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, certains départements refusent d'y recourir pour des motifs politiques – ils refusent de ficher des mineurs. D'abord, il ne s'agit pas toujours de mineurs. Surtout, quand l'expérimentation est généralisée, les aspects positifs de ce fichier sont évidents.
Monsieur Eliaou, vous ne me contredirez certainement pas sur ce point, puisque l'expérience vient d'être faite dans l'Hérault. Le préfet m'a indiqué que sur dix mineurs se présentant à l'ASE, à qui l'on demande de se rendre à la préfecture pour vérifier que les informations données aux départements coïncident avec celles du fichier de la préfecture, huit ne se présentent pas et s'évanouissent dans la nature – justement parce qu'ils ne sont pas mineurs. Ces chiffres ne peuvent pas nous laisser indifférents ; il ne s'agit pas d'un jeune sur cent.
Cette expérience prouve l'utilité du fichier AEM et sa nécessaire généralisation sur le territoire national. Il serait même intéressant de rendre cette généralisation obligatoire.

Cet amendement tend à réintroduire l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visant à autoriser le fichier AEM. Or cet article ne sera abrogé qu'à compter du 1er mai 2021, et il ne disparaîtra pas puisqu'il sera transféré à l'article L. 142-3 du nouveau CESEDA. Si cet amendement venait à être adopté, l'article apparaîtrait à deux endroits dans le texte.
Outre cette difficulté d'ordre légistique, je ne vois pas l'apport de cette rédaction puisque le fichier AEM, tel qu'il existe actuellement contient les informations que vous mentionnez : empreintes, photographies, résultats de l'évaluation. Je comprends donc que vous ayez pu vous inquiéter de la disparition de l'article, mais je ne vois pas le but d'une telle réécriture.
L'amendement est retiré.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL13 de M. Ian Boucard.
Article 2 (art. 575 et 575 A du code général des impôts) : Gage de charges
La Commission rejette l'article 2.
La réunion se termine à 12 heures.
Informations relatives à la Commission
La Commission a désigné :
- M. Jean-Félix Acquaviva, rapporteur sur la proposition de loi relative à l'évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncières et immobilières dans l'île (n° 3928) ;
- M. Charles de Courson, rapporteur sur la proposition de loi organique limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive (n°366) ;
- M. Jean-Félix Acquaviva, rapporteur sur la proposition de loi constitutionnelle relative à la reconnaissance du vote blanc pour l'élection présidentielle (n° 3896).
Membres présents ou excusés
En raison de la crise sanitaire, les relevés de présence sont suspendus.