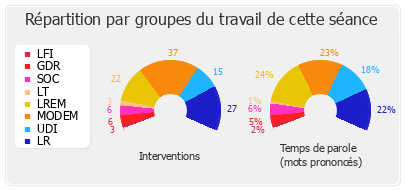Séance en hémicycle du jeudi 4 février 2021 à 21h15
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nos 3649 rectifié, 3797).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles du projet de loi, s'arrêtant aux amendements en discussion commune nos 1075, 1359 et 989 à l'article 4.


Ce sous-amendement fait suite à nos échanges et au chemin que nous avons trouvé ensemble afin d'aboutir à une rédaction qui permette de protéger plus efficacement encore les agents publics, puisque tel est l'objectif l'article 4, que nous avions amendé en commission spéciale. Je rappelle tout de même qu'il déroge à un principe essentiel de notre procédure pénale : « Nul ne plaide par procureur. » Nous devons donc être attentifs aux conditions de ce dépôt de plainte pour autrui, qui en procédure pénale, je le répète, n'existe pas.
Nous avons donc retenu une rédaction qui devrait convenir à l'ensemble de l'Assemblée. L'amendement de M. David Habib, défendu par Mme Untermaier, vise à substituer, à l'alinéa 6, les mots « dépose plainte » à « peut déposer plainte » ; nous proposons d'y ajouter « après avoir obtenu le consentement de la victime ».

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement.
J'ai écouté avec la plus grande attention les interventions des uns et des autres. Tous, vous avez souligné l'impérieuse nécessité d'aider les victimes ; tous, élus ou anciens élus locaux, en citant des exemples recueillis sur le terrain, vous avez dit que ces victimes ont peur. Bien sûr, dans cette hypothèse, il convient que l'administration soutienne ses agents. Pour autant, qu'on le veuille ou non, il est des situations dans lesquelles la victime ne souhaite pas déposer plainte, non parce qu'elle a peur, mais parce que les choses se sont apaisées. Cela se produit dans le cas de ce que tout à l'heure, par souci de simplification, nous avons appelé les « petites menaces ».
M. le rapporteur général et Mme la rapporteure proposent par conséquent une solution de compromis, qui maintient l'importance déterminante du consentement de la victime, mais ne résout pas toutes les difficultés.
D'une part, il y a l'article 40 du code de procédure pénale ; d'autre part, qu'on le veuille ou non, je le répète, il y a aussi des gens qui n'auront pas envie que la plainte prospère. Or, une fois l'action publique mise en branle par le procureur de la République, la victime ne peut arrêter la procédure pénale au seul motif qu'elle le souhaite. Dans ces conditions, je m'en tiendrai à un avis de sagesse, en comptant sur la navette parlementaire pour apporter les précisions souhaitables. Telle est, monsieur le président, la position du Gouvernement.

Je comprends la logique de M. le rapporteur général et de Mme la rapporteure, mais que se passe-t-il si les faits sont graves ? L'employeur, conscient ou informé, veut porter plainte ; l'agent refuse ; l'employeur ne peut passer outre. En d'autres termes, si un service public a été attaqué, la victime a le pouvoir d'empêcher l'action publique. On ne peut retirer à l'administration la possibilité de porter plainte ! Que l'on consulte l'agent, d'accord ; que ce soit lui qui décide du dépôt de plainte revient à priver de cette faculté l'autorité publique, le service public, pourtant victime de l'agression. Il faut trouver un moyen qu'une collectivité locale, par exemple, puisse se défendre et déposer plainte pour son propre compte si l'agent ne donne pas son consentement.

Il s'agit là d'une réflexion dans l'urgence, le sujet étant assez compliqué : si j'ai bien compris, on remplace « peut déposer plainte » par « dépose plainte », en ajoutant que le dépôt de plainte a lieu sous réserve du consentement de l'agent. L'administration serait donc obligée d'agir, mais seulement après avoir consulté l'agent et recueilli son consentement. Je suis plutôt d'accord avec François Pupponi même si l'obligation me semble un peu plus forte.
Madame la rapporteure, j'aimerais vous poser une question : dans la rédaction initiale de l'article, l'administration pouvait-elle ou non déposer plainte sans le consentement de l'agent ? Vous avez l'air de dire que notre droit interdit de porter plainte pour autrui. Comment aviez-vous donc prévu que les choses se passent dans ce cas ? Votre texte était-il efficace ? La nouvelle rédaction que vous proposez lève ce doute en précisant que l'accord de l'agent est nécessaire. Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, il me semble – je ne suis pas spécialiste de la procédure pénale – que si l'administration ne dépose pas plainte, elle doit appliquer l'article 40.

Il me semble qu'elle est dans l'obligation de le faire, comme aujourd'hui.

Je remercie la rapporteure et le rapporteur général d'avoir essayé de faire un geste, mais ce geste est finalement à contresens. Revenons à la réalité de la vie. Si l'agent donne son consentement, il n'est pas nécessaire d'obliger la collectivité à porter plainte ; en supposant qu'elle refuse de le faire, l'agent peut invoquer la protection fonctionnelle et, à condition que les faits tombent sous le coup de l'article 40, l'administration est tenue de les signaler au procureur de la République. Autrement dit, si l'agent est favorable aux poursuites, il n'y a guère de risque que ces poursuites n'aient pas lieu. Certes, comme le disait à juste titre Stéphane Peu, il est possible que l'administration ne soit pas diligente ; c'est pourquoi nous souhaitons remplacer « peut déposer plainte » par « doit déposer plainte ».
Cependant, votre sous-amendement, en subordonnant le dépôt de plainte au consentement de la victime, permet de nouveau à l'administration, qui se retrancherait derrière un refus, d'échapper à l'obligation prévue par l'amendement. Je ne voudrais pas répéter ce qu'a dit François Pupponi, mais s'il vous faut l'approbation d'un gardien de HLM logé sur place, vous attendrez longtemps de pouvoir déposer plainte ! Parce qu'il ne sera pas consentant, il ne témoignera jamais des faits dont il est victime !

Vous n'étiez pas encore en fonction, monsieur le garde des sceaux, à l'époque où une greffière du tribunal de Bobigny, qui vivait dans une cité difficile de cette commune, est venue me trouver : on avait découvert sa profession dans son quartier. Elle n'est pas allée porter plainte, elle est venue me voir, et je l'ai relogée d'urgence à l'autre bout de la circonscription ! Pourtant, l'action publique aurait dû pouvoir être déclenchée. J'ai d'ailleurs connu, sous d'autres législatures, des débats portant sur la question de l'anonymat des agents publics, que quelqu'un a évoquée tout à l'heure.
Le bon équilibre consisterait à ce que l'employeur soit dans l'obligation de porter plainte aussitôt qu'il reçoit un signalement de son employé, lequel se trouve en quelque sorte exfiltré de la procédure, afin de n'être soumis à aucune pression. J'appelle votre attention sur le fait que le mécanisme prévu par l'article 5 du texte oblige l'employeur à effectuer un signalement auprès du procureur de la République. Vous me répondrez que ce n'est pas la même chose. C'est vrai ; mais dans l'un et l'autre cas, la décision d'initier ou non une action pénale ne revient pas à celui qui porte plainte ou qui signale les faits ; c'est le procureur qui la prend, soit sur signalement, soit sur plainte. S'il refuse la plainte et la classe sans suite, l'action civile demeure.
Il faut donc donner à l'employeur l'obligation de déposer plainte, et, si j'ose dire, déresponsabiliser la victime, qui est souvent sous pression. Cela permet de répondre aux deux préoccupations exprimées dans l'hémicycle : d'une part, empêcher que l'employeur fasse semblant de ne rien voir, laissant l'employé dans une situation impossible, et, d'autre part, éviter que l'employeur demande le consentement de son employé car ce dernier se retrouve alors également dans une situation impossible au sein de son environnement, avec tous les risques que cela comporte. D'un point de vue légal, législatif, on peut se dire que ce n'est pas bien ; mais, dans la vie, c'est ainsi que cela se passe. Le dispositif que vous proposez, lui, ne sera jamais appliqué, du moins pas dans les cas graves. Quelqu'un, ne serait-ce que l'avocat de la personne poursuivie, saura que la victime a consenti au dépôt de plainte : vous pourrez toujours courir pour qu'elle témoigne !
Exclamations sur quelques bancs.

Il sera suivi de M. Francis Chouat, puis de Mme Laetitia Avia. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura le loisir de s'exprimer. Je procède par ordre.

Peut-être l'ordre dans lequel vous vous êtes manifestés n'est-il pas celui dans lequel je vous ai vus ; au demeurant, ce n'est pas très grave. Vous avez la parole.

Ce débat fait remonter à la surface beaucoup d'exemples que nous avons vécus ou que nous vivons encore au quotidien, et qui nous ont souvent fait regretter de ne pouvoir être plus efficaces. Il est très fréquent, en particulier dans l'éducation nationale, que la hiérarchie administrative, en cas de problème, regarde ailleurs. En outre, nous avons besoin de textes qui soient au plus près de la vraie vie. Je vais reprendre l'exemple du gardien de HLM, et je ne parlerai même pas de radicalisation : supposons que des dealers exigent de ce gardien, qui habite sur place, les clés d'une cave. Il refuse et se fait casser la gueule.

Dans ce genre de cas, le signalement prévu à l'article 40 ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, la direction de l'organisme HLM n'a pas la possibilité de déposer une plainte nominative contre les dealers, pourtant, elle seule serait en mesure de le faire.
Pour ma part, je proposerais une légère modification de la rédaction du sous-amendement : il ne s'agirait plus de recueillir le consentement de la victime, mais son avis, ce qui n'est pas la même chose. Elle est chargée d'une mission de service public ; c'est cette mission que les agresseurs ont visée ; sa hiérarchie doit donc être en mesure de déposer plainte, afin de défendre l'organisme et l'agent qui le représente. C'est pourquoi je préférerais remplacer « consentement » par « avis », ce qui permettrait de faire mieux face aux diverses situations auxquelles on peut être confronté. Il y a là un vrai sujet. J'ai parlé d'un gardien de HLM parce que je connais bien la question ; j'aurais pu évoquer un brancardier des urgences, un enseignant, un surveillant scolaire, que sais-je ? ou encore l'agent de l'état civil qui refuse d'enregistrer un mariage. Je le répète, je pourrais vous citer des exemples à la pelle.
M. Alain Bruneel, Mme Sandrine Mörch et M. Frédéric Petit applaudissent.

Parce que le temps est compté, et parce que le sujet n'intéresse après tout pas grand monde, je ne vais pas égrener à mon tour, après nos collègues, les exemples auxquels j'ai été confronté lorsque j'étais maire d'Évry – fusionnée depuis avec Courcouronnes – , président de l'agglomération, ou président du conseil de surveillance du Centre hospitalier sud francilien. Je corrobore les propos tenus par M. Peu et M. Pupponi lors de leurs multiples interventions.
Premièrement, monsieur le garde des sceaux, M. le rapporteur général a insisté sur le fait qu'indépendamment de ce débat autour de l'article 4, il est nécessaire de réactiver l'article 40, d'en faire un usage plus systématique et plus suivi. Je partage cet avis. Que les choses soient claires : l'article 40 concerne le signalement, non le dépôt de plainte. Je plaide donc pour qu'on l'associe au futur mécanisme dont nous sommes en train de discuter, tout en les dissociant dans le traitement des priorités et des rappels aux administrations, aux élus locaux. Certains ne savent même dans quelles circonstances ils peuvent recourir à l'article 40 !
Je rappelle pour conclure, comme François Pupponi l'avait fait tout à l'heure, que l'alinéa 6 de l'article 4 ne peut se lire qu'à l'aune de l'alinéa 5. Or celui-ci ne concerne pas n'importe quelles menaces ou intimidations, il les décrit explicitement. On peut d'abord en tirer une conclusion : il s'agit de faits suffisamment sérieux et lourds pour qu'il soit impossible qu'une administration ou une collectivité soit tenue dans l'ignorance de ce qui se passe.

Je suis d'ailleurs dubitatif quant à la formulation « dès lors que l'administration a connaissance », dans la première phrase de l'alinéa 6 : il faudrait écrire « dès que ». Je salue ensuite la recherche permanente de compromis de notre collègue rapporteure Laurence Vichnievsky mais, plutôt que de chercher le point d'équilibre entre « peut » et « doit » et de mentionner le recueil de l'avis de la victime, ou des victimes, d'actes tels que définis à l'alinéa 5, ne serait-il pas plus simple d'indiquer que le responsable de l'administration ou de l'organisme public « dépose » plainte ? Pourquoi faire compliquer lorsque l'on peut faire simple ? Naturellement, il ne pourra le faire qu'après discussion, enquête et recueil de l'avis de la victime, mais aussi de ses supérieurs hiérarchiques lorsque cela est nécessaire. L'alinéa 6 doit être lu à l'aune de l'application par l'administration, et pas seulement par la victime, de l'alinéa 5.

La parole est à Mme Laetitia Avia, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre IV du titre Ier.

J'avoue avoir du mal à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Certes, nous travaillons sur de nouvelles dispositions relatives au dépôt de plainte, mais il existe déjà un arsenal juridique et des procédures, ainsi que des victimes de menaces, de violences et de pressions pour qui ces procédures fonctionnent. Ces personnes ont un droit : celui de déposer plainte. La plainte est un droit rattaché à la personne qui est victime des faits. Certes, dans le délit que nous évoquons, la personne est victime en raison de son statut et de la mission de service public qu'elle exerce mais, quoi qu'il en soit, c'est bien une personne qui est l'objet des menaces et des pressions. Ce n'est pas le service public…
M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Agnès Thill et M. Charles de Courson s'exclament

Ce n'est pas le service public qui pourra imposer la plainte à quelqu'un !
Je trouve hallucinant que l'on impose ainsi l'exercice d'un droit qui est attaché à une personne. Bien sûr, comme sur tout sujet, un meilleur accompagnement est nécessaire ; il faut s'assurer que les personnes déposent plainte, comme on le fait systématiquement en cas de menaces, de violences ou de pressions. Mais le fait d'imposer à quelqu'un le dépôt d'une plainte pour elle me semble assez… exotique !

Je sais que Stéphane Peu propose des stages en Seine-Saint-Denis pour montrer comment cela se passe dans la réalité et dans la vraie vie !
Sourires.

Je suis désolée que notre amendement soit un tel sujet de préoccupations, mais il pose une vraie question sur laquelle nous sommes tous d'accord : nous ne souhaitons pas qu'un agent ayant fait l'objet de menaces importantes telles que mentionnées à l'alinéa 5, comme vous l'avez rappelé monsieur Chouat, reste seul. La solitude, c'est en effet l'angoisse, le silence, le repli. Notre souhait, que je crois partagé sur ces bancs, est que l'employeur prenne en charge la situation. En effet, ce n'est pas à titre individuel que l'agent est visé, mais parce qu'il est chargé d'une mission de service public. Or je crois que l'amendement que nous avons proposé, qui n'a rien d'extraordinaire – et que nous avions déjà déposé en commission spéciale – répond parfaitement à nos préoccupations.
« Lorsqu'il a connaissance des faits » est-il écrit à l'alinéa 6 : si l'employeur a connaissance des faits, c'est que l'agent lui a parlé. Ces faits sont « susceptibles de constituer l'infraction prévue [à l'alinéa 5] » : il ne s'agit donc pas de n'importe quels petits faits. Il faut faire confiance à l'employeur qui est capable de mesurer la gravité de l'infraction. Dans ces conditions, je pense que le dépôt de plainte s'impose. La discussion a lieu et tout ne s'écrit certes pas dans la loi, mais il faut en l'occurrence donner un moyen à l'employeur de se substituer à l'agent pour le dépôt de plainte, ce qui constitue une garantie pour ce dernier, car c'est bien de substitution dont nous parlons.
Je remercie enfin le rapporteur général et la rapporteure Laurence Vichnievsky du sous-amendement qu'ils ont proposé. Après réflexion, ce sous-amendement me paraît cependant réduire la portée de notre amendement. S'il fallait vraiment sous-amender notre proposition, il conviendrait d'écrire non pas « après avoir recueilli le consentement de la victime » …

Mes chers collègues, quel est le devoir du responsable d'un service dont l'un des fonctionnaires fait l'objet de menaces ou violences telles que décrites à l'alinéa 5 ? Il est de défendre son fonctionnaire !

Cela me paraît réellement indispensable. Le terme « peut » affaiblit l'alinéa ; mieux vaut donc écrire « doit » ou bien éventuellement « dépose », peu importe.
Quant au sous-amendement de notre collègue rapporteure, je pense qu'il affaiblit la disposition. On peut indiquer « après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire » – cela ne coûte rien – , mais il ne faut certainement pas subordonner le dépôt de plainte à l'accord du fonctionnaire, qui peut faire l'objet de pressions. J'aimerais donc sous-amender le sous-amendement de notre rapporteure. Cela pourrait susciter, je crois, un assez large consensus ainsi que la bienveillance de M. le garde des sceaux.

Je vous rappelle, cher collègue, que vous ne pouvez pas le faire à l'oral : si vous souhaitez sous-sous-amender, vous devez déposer un sous-sous-amendement !
Sourires.

Je ne tiens pas à consacrer beaucoup plus de temps à ce sujet, mais je constate que Mme Vichnievsky et M. Boudié essayent de nous comprendre, et je souhaiterais que nous arrivions ensemble à tous nous comprendre.
Tout d'abord, madame Avia, les agents mis en cause ne le sont pas à titre personnel. C'est leur mission de service public qui est entravée : c'est elle le sujet, à la limite ce n'est plus eux. Ce qui importe à l'employeur, c'est de protéger son agent mais aussi de faire en sorte que la mission de service public puisse se dérouler. C'est à ce titre que, compte tenu de la gravité des faits, il devrait de toute façon être obligé de porter plainte comme cela a été dit précédemment.
Reste ensuite la situation de l'employé. Deux cas de figure peuvent se présenter. Dans le cas où il souhaite que la plainte soit déposée, le sous-amendement proposé peut parfaitement s'entendre. Mais dans le cas où il craint le dépôt de la plainte, il convient de le protéger. J'aimerais à cet égard que les rapporteurs entendent ce que Stéphane Peu disait sur la possibilité de recueillir plutôt l'avis de l'agent – ils peuvent rectifier leur sous-amendement. Si un employé ne souhaite pas porter plainte, il existe une très grande probabilité pour que l'employeur ne le fasse pas, ne serait-ce que parce que l'employé refusera de témoigner au sujet de ce qui lui est arrivé. Mais l'utilisation du terme « avis » au lieu du terme « consentement » a un avantage : lorsque la victime se retrouvera face à ceux qui sont susceptibles de la menacer, elle pourra rétorquer qu'elle n'avait pas approuvé le dépôt de plainte.

Je vous assure que c'est ainsi que cela se passe dans la vraie vie ! Il m'est arrivé de dire à quelqu'un qu'il n'était en rien responsable du dépôt de la plainte.
On nous dit enfin que l'on ne peut pas porter plainte pour autrui. Or je crois que, lorsque le ministre de l'intérieur porte plainte à la suite de violences commises à l'encontre de policiers…

… il ne demande pas aux policiers qui étaient présents à la manifestation s'ils sont d'accord ou pas : il porte plainte pour défendre l'ensemble de ses effectifs.

Je n'utilise pas notre temps de parole pour m'exprimer, mais tout cela est vrai !

Comme mes collègues, je pense que le responsable de service doit porter plainte. Mais je ne suis pas d'accord au sujet du consentement de la victime. J'ai été très longtemps responsable au sein du service public de l'emploi, qui accueille un grand nombre de visiteurs. Lorsque j'ai débuté, il y a trente ans, il y avait très peu d'agressions et de violences. Puis le nombre d'agressions, d'incivilités et d'atteintes physiques a explosé. J'ai une pensée émue pour la collègue de Pôle emploi qui a été assassinée, car j'ai passé trente ans au sein de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, puis de Pôle emploi. Je peux vous le dire : les agents ne souhaitaient pas porter plainte. Nous avons donc réfléchi, et finalement, à Pôle emploi, c'est le directeur d'agence qui porte plainte, sans se préoccuper de l'avis de l'agent, qui peut en effet avoir peur des représailles. C'est un point important. J'ai vécu l'introduction de ce dispositif : croyez-moi, j'ai travaillé dans des territoires extrêmement difficiles, et je pense que l'on ne peut pas laisser le choix. Le manager doit porter plainte ; il a des responsabilités, notamment celle de la sécurité de ses agents.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LaREM et UDI-I et sur quelques bancs du groupe GDR. – M. Charles de Courson applaudit également.


Il est identique à celui des rapporteurs, à ceci près qu'il prévoit de recueillir l'avis de l'agent, et non pas son consentement.

Mes chers collègues, peut-être vous souvenez-vous que c'est la commission spéciale qui a adopté un amendement, que M. Boudié et moi-même avions déposé, s'agissant de la plainte pour autrui. Ce mécanisme est si dérogatoire que les ministres concernés n'étaient pas très chauds.

Les services des ministères évaluent techniquement, souvent avec une grande fiabilité, les mécanismes proposés, au moins sur le plan juridique – je ne parle pas de politique. Politiquement, nous souhaitions donner un signal fort, et nous le souhaitons toujours, pour accompagner et protéger les agents et éviter que la hiérarchie ne mette la poussière sous le tapis, comme l'indiquait Stéphane Peu et comme de nombreux collègues en ont donné des illustrations. Pour ma part, je comprends cette réticence du Gouvernement. Peut-être l'oublions-nous mais comme l'a rappelé Laetitia Avia, il existe déjà des textes qu'en tant que législateur, nous ne pouvons pas ignorer. Nous avons créé un nouveau délit, nous situons dans le domaine pénal ; or en la matière, la personne qui peut déposer plainte est celle qui est la victime directe du délit, des menaces ou de tout autre acte d'intimidation. Ce n'est pas l'administration. Il arrive que l'administration soit victime et qu'elle puisse alors se constituer partie civile, mais nous nous trouvons avec cet article dans un registre pénal, nécessitant un préjudice direct. Or c'est l'agent qui est victime de ce préjudice.

Pardonnez-moi, mais la victime, c'est l'agent : c'est à son encontre que des menaces sont proférées, et non à l'encontre de l'administration…

C'est l'agent qui fait l'objet de menaces ou est victime de violences, et c'est à cela que nous souhaitions répondre. Instaurer un mécanisme de plainte pour autrui serait tout à fait dérogatoire dans notre procédure pénale…

… et c'est aussi pour cette raison que le ministre de la justice a émis un avis de sagesse. Nul ne plaide par procureur, et je crois que chacun peut comprendre le bien-fondé de cette règle. Mettre en place un mécanisme permettant d'accompagner et de protéger les victimes, c'est ce que nous avons fait avec le dispositif que nous avons voté en commission spéciale. En revanche, imposer le dépôt d'une plainte malgré le refus de la victime directe des faits, c'est une atteinte à nos principes généraux de procédure et de droit pénal.

On a évoqué la plainte que pourrait déposer le directeur de Pôle emploi : s'il s'agit d'une plainte pénale, elle serait déclarée irrecevable, car c'est la victime directe des faits qui doit déposer plainte et être entendue.

L'article 40 du code de procédure pénale prévoit un signalement obligatoire des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, mais cette procédure est bien distincte de celle d'un dépôt d'une plainte. Le mécanisme que nous avons prévu à l'article 4 et la protection fonctionnelle qui a été invoquée sont des dispositifs complémentaires ayant un objectif commun, celui de protéger l'agent, mais il ne faut pas les confondre.
Nous avons beaucoup parlé, s'agissant d'une autre disposition, des risques d'inconstitutionnalité. Il y a quelques instants, Laetitia Avia a estimé que la plainte pour autrui constituerait une disposition « exotique » : pour ma part, je crains surtout qu'elle soit contraire à nos principes généraux du droit. Dans n'importe quel autre domaine du droit pénal, admettriez-vous qu'on laisse quelqu'un déposer plainte pour autrui ? Si vous étiez victime d'un viol, trouveriez-vous normal que votre mère aille porter plainte à votre place ? Ce n'est pas comme cela que les choses se passent, ce n'est pas possible !
Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM. – Exclamations sur les bancs des groupes FI et GDR.

Ce n'est pas possible de dire ça ! Quand un agent de l'état civil est agressé, ce n'est pas sa personne qui est en cause, c'est sa fonction !

Cher collègue, c'est un autre sujet. J'essaie d'être nuancée et d'entendre chacun…

Monsieur Peu, c'est la moindre des choses d'écouter la rapporteure. Vous avez la chance de pouvoir vous exprimer à l'envi, vous aurez donc la parole quand vous souhaiterez la prendre. En attendant, ce n'est pas la peine de vous égosiller !
Vous avez la parole, madame la rapporteure.

Si j'évoque le viol, mon cher collègue, c'est pour faire référence à un principe général du droit pénal, et je pourrais le faire pour n'importe quelle infraction : en aucun cas, on ne peut déposer plainte à la place d'un autre. Nous avons prévu un mécanisme dérogatoire parce que nous nous trouvons dans une situation tout à fait particulière, mais la victime directe est toujours l'agent, qu'il soit privé ou public, et non l'administration. Pour cette raison, nous avons cherché un moyen d'assurer l'accompagnement et la protection de la victime, auxquels l'inertie de l'administration ne doit pas être un obstacle, tout en les conciliant avec des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale qui ont, je crois, une valeur constitutionnelle.
Certes, il est prévu que l'administration dépose obligatoirement plainte, mais nous précisons dans notre sous-amendement qu'elle ne peut le faire qu'après avoir entendu son agent et recueilli son consentement, car elle ne peut pas aller contre sa volonté. J'insiste sur le fait que c'est la victime qui sera entendue sur les faits par les services de police ou de gendarmerie, et non le supérieur hiérarchique – qui, la plupart du temps, n'aura d'ailleurs pas été témoin des faits.
Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre juridiquement.

Il me semble que le raisonnement auquel je fais référence est assez simple à comprendre si on l'applique à la situation que l'on peut connaître concrètement en étant soi-même victime d'une infraction.

Pour la clarté de nos débats, madame la rapporteure, je rappelle que vous avez émis un avis défavorable au sous-amendement n° 2703 de M. de Courson et un avis favorable à l'amendement no 989 , sous réserve qu'il soit modifié par le sous-amendement n° 2702 que vous avez vous-même déposé.
La parole est à M. Florent Boudié, rapporteur général de la commission spéciale et rapporteur pour le chapitre Ier du titre II.

Nous débattons d'une question importante mais, au terme d'une heure et demie de débat, la spirale de la discussion parlementaire nous entraîne parfois un peu loin, c'est pourquoi il n'est peut-être pas inutile de rappeler certaines choses. Nous sommes nombreux ici à avoir exercé des fonctions locales, et parfois à les exercer encore, comme c'est mon cas : l'exemple très concret que vous nous avez donné, mon cher collègue Peu – M. Pupponi et M. Lagarde nous incitaient à être aussi concrets que possible – , nous en a rappelé d'autres.
Le problème, c'est que si la personne victime de menaces, violences, intimidations dans l'intention d'une application différenciée des principes du service public – contraire, par exemple, au principe de neutralité – se trouve obligée de porter plainte par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, elle peut elle-même en subir les conséquences, comme vous l'avez vous-même indiqué en évoquant les représailles que pourraient exercer des trafiquants de drogue à l'encontre d'un gardien d'immeuble. Nous voulons éviter qu'à la suite de la plainte déposée par l'administration, la pression des faits continue de s'appliquer à la victime, qui pourrait alors se trouver doublement victime.
La situation est assez complexe. Il se trouve qu'en droit français, en vertu du principe « nul ne plaide par procureur », il faut que ce soit la victime directe qui porte plainte. M. Lagarde a dit qu'il arrivait que le garde des sceaux ou le ministre de l'intérieur porte plainte au nom des policiers ou des gendarmes. Non ! cela n'arrive jamais. En clair, nous essayons de concilier la notion de victime directe, qui se justifie par le fait que cette personne est la seule à savoir ce qu'elle a pu subir et ressentir, et la nécessité pour l'administration d'apporter sa protection.
Comme toujours, mon cher collègue de Courson, vous faites une proposition habile et intelligente. Cependant, le fait de recueillir l'avis de la personne directement concernée ne permet pas de s'assurer qu'elle se considère elle-même comme une victime. Pour établir la qualité de victime de l'agent de service public concerné, il est nécessaire d'obtenir son consentement. Nous retenons donc le principe de l'obligation pour l'administration de déposer plainte, tout en posant pour condition que le consentement de la victime soit recueilli systématiquement. En effet, nous ne pouvons pas prendre le risque que l'administration porte plainte sans aucun dialogue, sans aucun échange avec la victime.
Ce que nous proposons constitue un progrès considérable car, en plus de l'obligation pour l'administration de déposer plainte – je rappelle qu'initialement, il ne devait s'agir que d'une simple possibilité – , il y aura l'obligation pour elle d'engager le dialogue avec l'agent public concerné, ce qui est une innovation majeure. L'administration ne pourra pas porter plainte sans avoir le consentement de la personne qu'elle doit protéger, recueilli à l'issue d'une discussion avec celle-ci. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'en rester à la formulation issue de nos discussions : elle n'est peut-être pas exempte d'imperfections, mais elle correspond à l'équilibre que nous recherchons collectivement.
J'ai peine à comprendre que le débat s'enlise alors qu'au fond, nous sommes tous d'accord. L'idée, c'est de ne pas laisser des agents qui feraient l'objet de menaces séparatistes seuls avec leurs peurs, mais de faire en sorte que l'administration vienne les soutenir. Nous sommes sortis des travaux en commission avec cette rédaction : « L'administration peut déposer plainte… » Cette solution me convenait et, si elle se transforme en : « L'administration doit déposer plainte… », cela pose une difficulté, à savoir que la victime ne souhaite pas forcément porter plainte. Évidemment, si l'on est en présence de menaces du type de celles subies par Samuel Paty, à savoir des menaces mortifères, constituant une bulle d'échanges assassine, on se dit que l'administration doit absolument porter plainte.
Sans vouloir remettre en cause les situations que certains d'entre vous ont connues et évoquées, je voudrais vous donner un autre exemple. Quand un gamin se comporte mal avec un prof, mais que le dialogue s'instaure et que, ledit gamin faisant preuve de bonne volonté, les choses finissent par s'arranger, est-il vraiment opportun de judiciariser la situation ?
C'est la complexité des situations susceptibles de se présenter qui nous a conduits à poser pour principe que l'administration « doit » déposer plainte, mais après s'être assurée du consentement éclairé de la victime : en d'autres termes, il s'agit pour l'administration de vérifier que la victime n'est pas terrorisée – c'est une évidence pour tout le monde.
Vous proposez, monsieur de Courson, que l'administration recueille l'avis de la victime, mais les mots ont un sens et, en l'occurrence, que la victime dise oui ou non – vous conviendrez que dans les deux cas, elle aura émis un avis – , l'administration aura l'obligation de judiciariser l'affaire, ce qui n'est pas possible. Le Gouvernement a émis un avis de sagesse sur l'amendement n° 989 et il le maintient, en comptant sur la navette parlementaire pour trouver une solution plus aboutie.

Si je comprends bien, vous êtes donc défavorable au sous-amendement no 2703 , monsieur le ministre. Je vais donner la parole à ceux qui la demandent avant que nous ne votions.
La parole est à M. Boris Vallaud.

M. le garde des sceaux a donné l'exemple d'un élève qui aurait menacé un professeur, mais contre lequel il ne serait pas nécessaire de déposer plainte, une simple discussion pouvant suffire à régler le contentieux. Je rappelle que les faits dont il est question à l'alinéa 6 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Nous parlons d'usage de violences ou de tout autre acte d'intimidation : je ne pense que ces problèmes puissent forcément se régler par le dialogue ni que l'exemple donné par le garde des sceaux corresponde au sujet dont nous traitons.
Le consentement a été ensuite évoqué, or celui-ci ne figure pas dans le texte de la commission.

Dans la version actuelle de l'alinéa 6, le consentement de la victime ne constitue en aucun cas une condition pour que l'administration dépose plainte. Ne nous opposez donc pas cet argument au sujet des sous-amendements, ou alors, si vous considérez qu'il y a un problème de constitutionnalité, il faut nous dire que la rédaction de la commission était elle-même inconstitutionnelle.

En réalité, dans ces affaires, il y a deux victimes : la personne physique intuitu personae mais aussi la personne dans l'exercice de ses fonctions, chargée d'une mission de service public. D'une certaine manière, il y a une forme d'intérêt à agir pour l'administration car il y a eu entrave. Samuel Paty a été attaqué non parce qu'il était Samuel Paty mais parce qu'il était professeur de l'école de la République et qu'il enseignait les valeurs de la République. C'est un devoir moral, éthique, de porter plainte en son nom et au nom de toutes celles et tous ceux qui pourraient être victimes de tels agissements.
Les arguments invoqués ne sont pas fondés : le consentement ne figurait pas dans la version initiale ; la plainte est déposée non seulement pour autrui mais aussi pour le compte de l'administration dont l'agent a été entravé dans l'exercice de ses missions. L'amendement de David Habib, qui rend le dépôt de plainte par l'administration obligatoire, sous-amendé dans le sens proposé par Charles de Courson, qui garantit qu'une discussion aura lieu avec la victime, me paraît répondre aux préoccupations qui sont les nôtres.

Le sous-amendement no 2702 rate sa cible car, dès lors que l'on demande à l'agent son accord, on échoue à le protéger des pressions qui pourraient s'exercer à son encontre. Je ne rejoins pas du tout Mme la rapporteure : si l'agent est victime, ce n'est pas intuitu personae mais parce qu'il remplit une mission de service public ; à travers lui, c'est le service public qui est attaqué. Je ne comprends pas la comparaison qu'elle établit avec une femme qui se ferait violer, laquelle est attaquée pour elle-même, si je puis dire, alors que l'agent de service public est visé au titre de ses fonctions. J'entends bien que l'un des principes généraux du droit pénal veut qu'on ne puisse pas déposer de plainte pour autrui, mais ne sommes-nous pas là pour modifier le droit et faire évoluer ses principes, lorsqu'ils ne sont pas d'ordre constitutionnels, en fonction de l'évolution de la société ?

Quand un agent agressé dans l'exercice de ses fonctions ne veut pas porter plainte, c'est l'institution qui devient responsable car elle n'aura pas garanti sa sécurité. On pourrait même déposer plainte contre une institution qui n'aurait pas su protéger ses agents. Un agent qui a refusé de déposer plainte par crainte de représailles contre lui et sa famille peut fort bien être agressé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois puisque l'institution ne le protège pas. C'est grave.
Monsieur le rapporteur, vous dites que tout est déjà dans la loi, mais nous sommes ici pour faire des lois et améliorer le droit. C'est notre rôle. Profitons de l'occasion que nous offre ce texte : demandons une protection pour les agents et permettons à l'institution de déposer plainte dès qu'ils ont donné leur avis.

Monsieur le ministre, il y a vingt ans, en 2001, j'ai été agressée sur le site de l'agence nationale pour l'emploi de Plaisir où je travaillais. J'ai eu peur, je n'ai pas porté plainte, ma hiérarchie non plus. Un mois plus tard, l'épouse du maire de la commune était agressée.
Ne pas déposer plainte si la victime n'a pas donné son consentement, c'est dans une certaine mesure protéger l'agresseur.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LR, Dem et FI. – M. Stéphane Peu applaudit également.

J'aimerais apporter ma contribution au débat et interroger notre rapporteur général. La protection fonctionnelle que tout employeur public doit à ses agents s'applique uniquement si ces derniers ont été victimes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. De deux choses l'une : soit l'agent victime porte plainte en son nom en tant que victime, et l'administration a l'obligation de l'accompagner dans ses démarches ; soit il ne porte pas plainte, et le droit prévoit de manière très claire que l'administration peut se porter partie civile. Il m'est arrivé plusieurs fois d'appliquer ces dispositions en tant que directrice générale des services dans une commune.
Je partage l'objectif poursuivi par plusieurs collègues : il faut que l'administration vienne soutenir ses agents victimes – j'ai moi-même pu constater dans le cadre de mon travail les réactions de peur face aux représailles. Je pose une question au ministre et au rapporteur général : si le consentement n'est pas obtenu, l'administration peut-elle se porter partie civile au titre de sa propre mise en cause ?

Il faut prêter attention à cet aspect : j'aimerais avoir quelques réponses.

La rapporteure, dont je connais la compétence, nous dit que seule la personne victime peut porter plainte. Autrement dit, la rédaction actuelle issue de la commission n'est pas opérante : l'administration ne peut pas véritablement déposer plainte, elle peut seulement accompagner la victime pour que celle-ci porte plainte. Il faudra éclaircir ce point.

Je ferai exactement la même réflexion. Vous avez souligné, madame la rapporteure, qu'en règle générale, on ne portait pas plainte à la place d'autrui. C'est un principe général du droit nous dites-vous. C'est pourtant bien ce que vous proposez de faire dans le texte que vous avez fait adopté par la commission spéciale. Il s'agit, expliquez-vous, d'une exception destinée à réagir à des faits graves, énumérés à l'alinéa 5, consistant à exercer des pressions, et pas seulement dans le cadre de l'intégrisme religieux, sur les personnes participant à l'exécution d'une mission de service public – et nous avons vu que ces personnes étaient nombreuses – pour empêcher son accomplissement.
Vous avez raison : nous savons qu'aujourd'hui, en la matière, les choses ne marchent, et nous cherchons comment cela pourrait fonctionner, c'est le débat que nous avons depuis un long moment. Vous acceptez que le dépôt de plainte par l'administration devienne obligatoire à condition de recueillir le consentement de la victime, mais cela ne règle pas son problème. Piégée dans son environnement, elle n'osera bouger car si elle consent à porter plainte, l'auteur de l'infraction le saura.

Cela aura pour seul résultat que la personne menacée ne signalera rien à son administration au risque sinon de se retrouver coincée dans un tunnel. Avec cet étouffoir, on ne pourra pas savoir ce qui se passe. C'est presque ce que vous nous avez dit, involontairement, en soutenant le sous-amendement no 2702 : si la victime n'est pas d'accord, l'administration ne portera pas plainte, autrement dit, c'est comme s'il ne s'était rien passé. L'agent aura subi une pression le conduisant à modifier la façon dont il accomplit une mission de service public, et nous ne le saurons même pas car il se planquera.
Dans ce que propose, habilement, M. Peu, il n'y a pas plus d'inconstitutionnalité que dans la version initiale ou dans votre sous-amendement puisqu'il s'agit toujours pour l'administration de porter plainte à la place de la victime. Pourquoi mettre en porte-à-faux l'agent exposé à des pressions ? Si on ne lui demande pas son consentement mais seulement son avis, il pourra toujours dire qu'il n'a jamais rien demandé et que c'est son administration qui a agi, renvoyant l'auteur du délit au directeur général, au maire, au directeur de l'hôpital. Cela me semble efficient. Le sous-amendement no 2703 de Charles de Courson, qui reprend la proposition de Stéphane Peu, amendement autour duquel nous sommes nombreux à nous retrouver, est opérationnel : il protège la première des victimes, celle à l'égard de laquelle on éprouve le plus de compassion, c'est-à-dire l'agent, et permet à la deuxième victime, l'administration, de défendre la mission de service public qu'elle a en charge. Puisque le Gouvernement a invoqué la sagesse, je pense que nous pouvons tous arriver à entendre ce raisonnement.
M. Stéphane Peu applaudit.

Tout le monde a pu s'exprimer. Je propose que nous passions au vote des amendements en discussion commune et des sous-amendements.



Non ! Les deux sous-amendements sont exclusifs : si l'Assemblée adopte le premier, qui prévoit le recueil du consentement de la victime, le second, qui requiert son avis, tombera.
L'amendement no 989 , sous-amendé, est adopté.

La parole est à M. Ludovic Mendes, pour soutenir l'amendement no 1299 .

Contrairement à mon amendement précédent, qui concernait la suspension des droits parentaux, il ne s'agit pas d'un amendement d'appel. Je n'utiliserai pas de cas qui ont eu un écho médiatique comme celui de Samuel Paty. Nous avons tous recueilli, Stéphane Peu et d'autres l'ont dit, des témoignages du quotidien de personnes travaillant dans nos écoles, dans nos cantines, dans nos piscines, dans les associations de loisirs ou le périscolaire. L'objectif est de protéger les mineurs de comportements déviants et « sectaristes ». Le danger auquel ils sont exposés ne se limite pas à la maltraitance avérée, il renvoie aussi aux menaces potentielles. Leur vulnérabilité physique et psychologique, leur dépendance matérielle les désignent comme des proies faciles pour les mouvements porteurs de dérives, notamment lorsque la vigilance du titulaire de l'autorité parentale est défaillante, a fortiori s'il fait l'objet d'une plainte.
Il y a des risques lorsque les conditions d'existence des mineurs sont susceptibles de mettre en danger leur santé, leur moralité, leur sécurité ou leur éducation. Si l'enquête confirme l'existence de dérives, alors l'État et les associations pourront les accompagner pour en faire des citoyens éclairés.

Il me semble que l'objet de votre amendement dépasse très largement celui de l'article et, plus généralement, le projet de loi. D'ailleurs, je m'interroge sur l'idée de prévoir systématiquement une enquête menée par les professionnels de la protection de l'enfance, afin de signaler les dérives sectaires des représentants légaux sur les mineurs. C'est un a priori étonnant à mon sens. Avis défavorable.
Nous connaissons tous, monsieur le député, votre implication en faveur de la protection de l'enfance ; vous l'avez encore démontré tout à l'heure avec l'un de vos amendements. Je comprends parfaitement votre position, mais la protection de l'enfance en danger fait déjà partie des prérogatives du procureur de la République et entre déjà dans le cadre de ses missions. S'il reçoit la moindre alerte, il peut aller dans le sens que vous souhaitez qu'il emprunte systématiquement.
Les attributions du procureur de la République, telles qu'elles sont définies dans notre droit, font que je suis défavorable à votre amendement qui se trouve, en d'autres termes, déjà satisfait – même si l'enquête que vous demandez n'est pas systématique, j'en conviens, et c'est bien normal à mon avis. Il reste que, dans le cas d'une alerte, le procureur de la République fait son métier et protège les enfants, comme il se doit.

L'objectif de cet amendement est d'enlever au procureur de la République la liberté de diligenter ou non cette enquête. Malgré ce que vient de dire Mme la rapporteure, il serait surprenant qu'un représentant légal contre qui on porte plainte pour un délit de séparatisme, qui menace la République, n'exerce pas une emprise sur ses propres enfants. Pardonnez-moi de poser le débat, mais je pars du principe qu'il y aura toujours une emprise sur les enfants.
Depuis le début de nos débats, même si nous ne sommes pas d'accord avec certains de nos collègues du groupe Les Républicains ou d'autres groupes, nous rappelons que c'est précisément quand les personnes concernées sont enfants, ou jeunes adultes, qu'elles commencent à dériver. Et l'on ne peut pas dire que cela ne vient pas des parents, c'est une réalité. Certes, il y a internet et bien d'autres facteurs possibles. Mais les parents restent souvent les premiers responsables.
Je suis prêt néanmoins à retirer cet amendement, puisque vous me dites, monsieur le ministre, que le procureur a la possibilité de mener cette enquête. Je souhaiterais cependant que cela se produise plus souvent car les remontées que nous avons du terrain, de la part des tribunaux, des juges ou des avocats tendent à prouver que c'est rarement le cas, malheureusement, et que les enfants ne sont pas pris en considération comme des dommages collatéraux dans ce genre d'affaires. Je retire mon amendement.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.
L'amendement no 1299 est retiré.

La parole est à Mme Caroline Janvier, pour soutenir l'amendement no 2302 .

Il s'agit d'un amendement qui me paraît fondamental puisqu'il porte sur la question de l'égalité de tous devant la loi. En effet, l'article 4 crée une peine complémentaire spécifique ciblant les ressortissants étrangers : en plus d'une peine de 75 000 euros d'amende et de cinq ans d'emprisonnement, une interdiction du territoire français pourra être prononcée à l'encontre des ressortissants d'un pays étranger reconnus coupables de l'infraction dont nous parlons, c'est-à-dire de menaces, de violences ou d'intimidation à l'égard d'un agent du service public.
Cela me paraît parfaitement illégitime car vous tendez à créer ainsi deux catégories de justiciables, les citoyens français et les citoyens étrangers, alors même que les dispositifs pénaux prévoient, dans leur immense majorité, des peines identiques pour l'ensemble des auteurs des faits.

De nombreux crimes et délits peuvent entraîner une interdiction du territoire français, en vertu de notre arsenal législatif ; c'est le cas notamment des violences, du trafic de stupéfiants, du travail illégal ou encore de l'usage de faux papiers. Ne pas vouloir respecter les règles du service public – nos débats précédents illustrent parfaitement combien il s'agit d'un sujet sensible auquel nous devons répondre – en remettant en cause les principes de la République, comme le fait d'exiger des horaires différenciés à la piscine, par exemple, me semble pouvoir faire l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, dont vous savez qu'elle est modulable s'agissant de la durée. Avis défavorable.
Madame Caroline Janvier, nous entendons réprimer les menaces séparatistes. C'est un peu la même discussion que précédemment. Certaines menaces sont gravissimes, d'autres le sont moins. Les juges auront la liberté d'apprécier la peine encourue. Des peines différentes seront prononcées, c'est bien logique, selon la personnalité de l'auteur des faits ou selon la gravité de la menace. Il faut prévoir, me semble-t-il, la possibilité pour une juridiction de prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire, car il est des menaces séparatistes, c'est bien de cela dont nous parlons, susceptibles de porter gravement atteinte à l'ordre public.
C'est pourquoi, nous souvenant que l'on ne peut envisager une peine complémentaire que dans les cas les plus lourds, il nous apparaît qu'il convient de ne pas retenir votre amendement. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement no 2302 n'est pas adopté.
L'amendement no 1076 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.


Face à une augmentation des actes d'intimidation et de violences à l'égard des personnes assurant une mission de service public, nous ne pouvons que nous féliciter du fait que le projet de loi crée une nouvelle infraction pour réprimer ces délits. En complément, cet amendement vise, par principe, et non simplement de manière accessoire comme le prévoit la rédaction actuelle, à interdire de territoire français un étranger qui se rendrait coupable de menaces, d'intimidation ou de violences à l'encontre d'un agent du service public. En effet, attaquer un service public, c'est aussi s'attaquer à l'État. Il convient donc d'être fermes et d'apporter le soutien indispensable de la nation aux agents du service public.

L'article 4 introduit dans le code pénal le délit de séparatisme et y associe la possibilité d'une peine complémentaire d'ITF – interdiction de territoire français – pour les étrangers. C'est très opportun, cela va dans la bonne direction et je voterai cet article.
Mon amendement vise à ce que la peine complémentaire d'ITF soit automatique, sauf motivation expresse de la juridiction de jugement. Nous proposons ainsi d'inverser la problématique, un peu dans l'esprit des peines planchers que le président Sarkozy avait fait voter, très opportunément : un étranger qui commet un délit de séparatisme et, ce faisant, rompt le pacte de confiance qui le lie à la nation, verra prononcée à son encontre une peine d'expulsion, judiciaire et non pas administrative, de façon automatique, sauf si le tribunal estime qu'il peut l'en exonérer. Il devra alors motiver sa décision.

L'amendement no 1380 de M. Philippe Benassaya est défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements en discussion commune ?

Avis défavorable parce que ces amendements sont contraires aux dispositions de notre code pénal, qui prévoit l'impossibilité de prononcer une peine d'interdiction du territoire dans un nombre limité de cas, que vous connaissez bien, cher Éric Ciotti : à l'encontre d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans ; d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; d'un étranger qui réside en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ; d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ; d'un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour soins.
De la même façon que je m'oppose à la suppression de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, en excipant de ce qu'il y a menace et menace, si j'ose dire, avec des degrés de gravité différents, je suis contre l'idée de la rendre obligatoire.
Vous évoquez le souvenir du président Sarkozy avec nostalgie, j'ai cru le comprendre.
Vous avez raison d'espérer, monsieur Ciotti. Mais je vous rappelle que sur la double peine, il a eu une position assez curieuse, qui était aussi la vôtre, puisque c'est vous qui avez réduit la possibilité d'expulser un certain nombre d'étrangers ayant commis des infractions sur le territoire français. C'est donc une nostalgie, si je puis me permettre, sélective de votre part et vous comprendrez, dans ces conditions, que le Gouvernement ne peut pas adhérer à cette forme de peine plancher, cette interdiction du territoire français plancher. Ne faites pas l'étonné ! Je suis, par conséquent, défavorable aux amendements.

M. le ministre de l'intérieur, vous souhaitez également prendre la parole.
Pour compléter les propos de M. le garde des sceaux, que je fais miens du point de vue judiciaire, je rappelle qu'il existe aussi des sanctions administratives. J'espère, monsieur Ciotti, que vous ne présentez pas cet amendement uniquement pour avoir ensuite l'excuse de dire que nous aurions pu aller encore plus loin.
Vous avez souligné que ce texte est à la fois fort et utile ; il fait montre d'autorité, notamment avec la possibilité offerte au juge de prononcer une peine complémentaire, même si ce n'est pas une compétence liée, et c'est bien normal. Mais les personnes qui seront condamnées pour délit de séparatisme feront, bien évidemment, l'objet de mesures de reconduction à la frontière et d'interdiction de retour sur le territoire national – il faut prévoir les deux, vous le savez bien. Ce n'est pas parce que votre amendement sera rejeté et que le juge ne « devra » pas prononcer de peine complémentaire que l'administration ne « devra » pas agir, selon les consignes données par le ministère de l'intérieur. Tant que je serai ministre de l'intérieur, vous pourrez être rassuré, et votre espérance sera ainsi un peu comblée, monsieur le député Ciotti.
L'amendement no 1380 n'est pas adopté.

Je vous informe que, sur l'amendement no 1781 , je suis saisi par le groupe UDI et indépendants d'une demande de scrutin public.
Sur l'article 4, je suis également saisi par le groupe La République en marche d'une demande de scrutin public.
Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Je suis saisi de trois amendements, nos 2552 , 171 et 1323 , pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 171 et 1323 sont identiques.
La parole est à M. Sébastien Huyghe, pour soutenir l'amendement no 2552 .

Je voudrais signaler une erreur matérielle survenue dans le texte de mon amendement et le rectifier. Nous parlons bien sûr d'une durée « maximale » et non « minimale » comme il est indiqué, sinon ça n'aurait aucun sens juridique. Soit je peux effectuer la rectification, soit je me replie sur l'amendement similaire no 1323 de notre collègue Trastour-Isnart qui fait passer la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire de dix à vingt ans. En effet, les atteintes aux représentants du service public sont d'une certaine façon des atteintes à l'État.

Très bien. Puisque j'ai pu défendre mon amendement, j'accepte de le retirer au profit de l'amendement no 1323 .
L'amendement no 2552 est retiré.


Avis défavorable. Ces amendements sont en contradiction avec l'article 131-30 du code pénal qui prévoit que « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. »
Ce rappel des dispositions du code pénal est salutaire. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
L'amendement no 298 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'amendement no 299 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l'amendement no 1781 .

Il concerne la déchéance de nationalité. On pourrait le considérer comme un amendement d'appel si je ne connaissais pas déjà l'avis du Gouvernement sur ce sujet, lequel est le même – et c'est bien normal – que celui du Président de la République.
Aux termes de l'article 4, si un étranger a fait pression contre une personne participant à l'exécution d'une mission de service public pour éviter de se voir appliquer la loi, le juge peut prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Mais si le mis en cause a été naturalisé et est un citoyen français, pas de chance : il restera sur le territoire national.
On peut changer d'avis, vous l'avez dit vous-même, monsieur Darmanin ; mais il reste que, comme moi, vous étiez favorable à ce que l'on puisse déchoir de sa nationalité une personne qui, parce qu'elle combat les valeurs de la France, parce qu'elle propage des idées ou commet des actes séparatistes, n'a pas vocation, selon nous, à rester Français.
Certes, j'aurais préféré que nous décidions d'appliquer une telle mesure à un crime plutôt qu'à un délit, mais il paraît que nous n'en avons pas le droit – c'est du moins ce qu'ont estimé le président de la commission, son rapporteur ou les services de l'Assemblée, je ne sais pas trop.
Si nous avons demandé un scrutin public sur cet amendement, c'est pour rappeler que ce débat, prétendument classé lors de la dernière législature, est en réalité toujours d'actualité. Des gens qui détestent la France au point d'agresser ses agents – je pense à l'assassin de Samuel Paty, dont le crime horrible a inspiré l'article 4 – doivent pouvoir être déchus de la nationalité française et être obligés de quitter le territoire. Or si on peut expulser un étranger pour ce motif, il n'y a pas de raison qu'un citoyen qui combat la nation française ait le droit de rester sur notre sol parce qu'on l'a naturalisé un peu vite.

Je vous rappelle que, dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d'État a considéré que les peines prévues – cinq ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende et une interdiction éventuelle du territoire français – sont adaptées et proportionnées. Il me semblerait tout à fait disproportionné d'ajouter au délit nouvellement créé une peine de déchéance de nationalité. Avis défavorable.
Le Gouvernement pense que la disposition que vous souhaitez faire voter est tout à fait exorbitante.
Vous souhaitez en effet que la déchéance de nationalité puisse être prononcée à l'encontre des personnes ayant proféré des menaces…
Je vous rappelle, puisque vous me vous me faites l'honneur de me montrer votre scepticisme, que l'article 25 du code civil prévoit cette peine pour les actes de terrorisme. Je vous précise également que le Conseil d'État, dans un avis du 11 décembre 2015 sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, a indiqué qu'une telle mesure n'était pas possible dans la loi ordinaire. Voilà deux excellentes raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Il n'est pas question de faire semblant. Je sais parfaitement que cette mesure ne peut pas être adoptée en l'état ; le caractère proportionné de la peine n'est donc pas l'enjeu. Peut-être l'ignorez, monsieur le garde des sceaux, mais nous n'avons pas le droit de présenter des amendements dont certains estiment qu'ils n'ont pas de rapport direct avec le texte. Par exemple, il n'a pas été possible pour le groupe UDI-I de proposer de qualifier de crime – et même, de mon point de vue, de crime contre la République – le fait de se regrouper en groupe ethnique pour attaquer un autre groupe ethnique. Voilà un acte qui me paraît mériter d'être puni par la déchéance de nationalité et le départ du territoire français.
Il en est de même, d'ailleurs, lorsque quelqu'un commet un attentat terroriste d'une exceptionnelle gravité. Ce débat a eu lieu sous le quinquennat de François Hollande et, à l'époque, le ministre de l'économie avait exprimé un sentiment que je ne partage pas. Il me semble que quelqu'un qui combat la République française et ses principes n'a plus rien à faire sur notre territoire, quelle que soit la raison pour laquelle il y a été initialement accueilli. L'objet de cet amendement était seulement de rappeler notre position.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 138
Nombre de suffrages exprimés 134
Majorité absolue 68
Pour l'adoption 17
Contre 117
L'amendement no 1781 n'est pas adopté.
L'amendement no 930 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'amendement no 722 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 134
Nombre de suffrages exprimés 130
Majorité absolue 66
Pour l'adoption 130
Contre 0
L'article 4, amendé, est adopté à l'unanimité.
Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM et sur quelques bancs du groupe UDI-I.

Cet amendement de portée déclarative, qui a été suggéré par des enseignants, a vocation à s'insérer dans la partie relative aux principes généraux de l'éducation. Il reprend une disposition créée par l'article 1er de la loi pour une école de la confiance qui n'avait, lui non plus, aucune portée normative.
Je propose donc la rédaction suivante : « Les personnels de l'éducation nationale sont chargés par l'État d'une mission de service public qui implique le respect des élèves et de leurs familles à l'égard de l'autorité des professeurs dans la classe et de l'ensemble des personnels de l'établissement. »
En commission, M. le ministre de la justice – dommage qu'il ait quitté l'hémicycle – …

… avait parlé d'« amalgame un peu douteux » et objecté que la proposition avait été rejetée par le Conseil supérieur de l'éducation. Mais les enseignants sont ultra-minoritaires dans ce conseil !
En écho à la tragique affaire de Samuel Paty, il paraît important de rappeler que les parents d'élèves et les élèves doivent le respect aux enseignants.

Vous m'avez indiqué les motifs pour lesquels je vais conclure à un avis défavorable : cet amendement n'a qu'une portée déclarative, aucune portée normative.

Madame la rapporteure, votre argumentation pose problème. Vous pouvez dire que, juridiquement, la portée de cet amendement est purement déclarative, mais s'il fallait écarter systématiquement tous les amendements de cette nature, beaucoup de propositions de la majorité devraient être rejetées – il suffit de lire les titres de certains projets de loi.

Vous ne devriez donc pas vous aventurer sur ce terrain.
Nous sommes les représentants de la nation. Dire qu'il est important de manifester un certain respect à l'égard des enseignants, cela a du sens ! Cela heurte peut-être la juriste que vous êtes, mais cela fait partie de notre rôle.
En outre, je le répète, votre majorité reste régulièrement dans le déclaratif. Et ce qui est pire, c'est qu'elle se contente de déclarer sans que les actes suivent.
Protestations sur les bancs du groupe LaREM.
L'amendement no 25 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Cet amendement vise à empêcher toute dissimulation de faits constitutifs d'une infraction aux articles 131-1 et 433-3-1 du code pénal. Il est ainsi proposé de qualifier de faute grave – au sens de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – le fait, pour un responsable d'une administration ou un service administratif, de taire, de faire taire, ou de ne pas signaler de tels faits au représentant de l'État dans le département. Il faut éviter l'omerta au sein des administrations.

C'est en effet l'objectif que nous visons – nous en avons longuement débattu – , mais il me semble plus efficace de prévoir, pour l'administration, la possibilité de déposer plainte. Avis défavorable.
La loi n'a pas à qualifier la faute. En réalité, il revient à chaque administration d'en apprécier les caractéristiques selon les circonstances de chaque affaire. Le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement.

Outre le phénomène « pas de vagues » très bien décrit par Mme Genevard, trop d'enseignants ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie.
Je suis le premier à saluer l'importance de l'article 4, monsieur le ministre, et je reconnais bien volontiers l'opportunité de cette réponse à l'affaire Samuel Paty mais je crains que pour éviter d'avoir des ennuis – avec le ministère, par exemple – , la hiérarchie ne continue malheureusement de bloquer les remontées de terrain qui attestent de l'existence de ces pressions et menaces.
L'amendement no 824 n'est pas adopté.

Les amendements nos 1832 de M. Julien Aubert et 2405 de Mme Emmanuelle Ménard sont défendus.


À l'initiative de notre collègue Genevard, la commission spéciale a adopté cet article important visant à créer un délit d'entrave à l'enseignement. Cet amendement vise à le compléter du point de vue juridique.
La notion de délit d'entrave figure à l'article 431-1 du code pénal, relativement à un certain nombre de libertés, liberté d'expression, de travail, d'association, de réunion ou de manifestation. L'amendement tend à faire de la liberté d'enseignement une de ces libertés fondamentales susceptibles de donner lieu au délit d'entrave.
Par ailleurs, la rédaction de l'article fait référence à des objectifs pédagogiques déterminés par le Conseil supérieur des programmes, conseil qui en réalité n'a qu'un rôle consultatif. Nous proposons de nous référer plutôt à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation qui, lui, fait référence à la liberté pédagogique : « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec me conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. »

La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l'amendement no 2009 .

Comme notre collègue Xavier Breton l'a indiqué, l'objectif est de faire référence de manière explicite à la liberté pédagogique.
Certains m'opposent le fait que le code de l'éducation y fait déjà référence à d'autres endroits, mais je crois qu'il faut tenir compte des aspirations des enseignants, qui sont extrêmement attachés à cette liberté. Il s'agit d'un amendement d'équilibre qui vise aussi à rassurer les enseignants sur ce point.

Peut-être vous souvenez-vous, mes chers collègues, que j'avais en commission manifesté des réserves à l'encontre de l'amendement de notre collègue Annie Genevard – réserves là aussi d'ordre juridique, pardonnez-moi, mais enfin, de la part du législateur cela peut se comprendre. Ma réticence tenait à l'existence d'incriminations générales qui, à mon sens, couvraient les faits que vous souhaitiez incriminer en particulier, ma chère collègue.
Mais après réflexion, je suis revenue sur la position que j'avais défendue en commission spéciale parce que l'enseignement est particulièrement visé par les pratiques séparatistes auxquelles nous souhaitons mettre un terme.

Dans ces conditions, la création de ce nouveau délit de droit pénal spécial peut se comprendre, même si, dès l'examen en commission spéciale, je craignais que l'on étende ce délit à d'autres professions que les enseignants – il y a d'ailleurs eu des amendements en ce sens.
Je crois donc désormais que cette nouvelle incrimination a tout son sens dans le contexte que nous connaissons. Mais en proposant de viser les entraves non plus à la fonction d'enseignant, mais à la liberté pédagogique, il me semble que nous nous écartons quelque peu de l'idée initiale. À mon sens, en effet, la question n'est pas tant celle des moyens utilisés par un enseignant pour appliquer les programmes scolaires que de la possibilité effective d'enseigner les programmes, quels que soient les moyens utilisés.
À cela s'ajoute un argument que vous avez anticipé, mon cher collègue Hetzel, en rappelant que cela figure déjà dans le code de l'éducation. Dans ces conditions, et même si je comprends très bien l'objectif et si je partage vos intentions, je ne crois pas nécessaire de légiférer plus avant. C'est pour ces raisons que j'émettrai un avis défavorable.
Je voudrais très rapidement rappeler la genèse de l'article 4 bis que vous souhaitez modifier.
Lors de l'examen du texte en commission spéciale, j'ai proposé, en réponse à l'amendement de Mme Genevard, dont je comprenais l'objectif, de travailler à en améliorer la rédaction. J'avais également indiqué que, par souci de cohérence et de lisibilité du code pénal, je n'étais pas favorable à la multiplication d'infractions spécifiques à certaines catégories. Très vite, une réunion de travail s'est tenue avec mes équipes et Mme Genevard, en présence du rapporteur général ainsi que de membres du cabinet du ministre de l'éducation nationale.
Ces travaux n'ayant pas encore abouti, il convient selon moi de ne pas modifier la rédaction de l'article 4 bis à ce stade de la discussion parlementaire. Je préfère que nous poursuivions notre travail de coconstruction. J'espère que nous trouverons le texte juste. Il faudra aussi déterminer quel code il convient de modifier car c'est une des questions qui se posent.
Je suis donc à cet instant contraint d'émettre un avis défavorable.

Aujourd'hui la liberté d'enseignement ne figure pas au nombre des libertés fondamentales dont l'exercice est expressément protégé par l'article 431-1 du code pénal. Il serait de ce fait judicieux de combler cette lacune de sorte que le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'enseignement soit également puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Sur le plan politique, un tel choix serait d'autant plus pertinent que le projet de loi apporte par ailleurs de nombreuses limitations à la liberté d'enseignement, en particulier avec l'article 21 sur l'instruction en famille. Le législateur marquerait ainsi son attachement à cette liberté fondamentale qui doit être à nos yeux de rang constitutionnel.

Je voudrais à mon tour rappeler l'histoire de cet article, issu d'un amendement adopté à mon initiative par la commission spéciale. Il l'a été contre l'avis du Gouvernement, mais j'avais saisi la main tendue par M. le garde des sceaux en acceptant de retravailler sa rédaction. La réunion qui a eu lieu dans les conditions que vous avez rappelées, monsieur le garde des sceaux, n'a cependant pas permis de trouver une solution plus satisfaisante. Tel est, pour l'instant, l'état de la réflexion.
Il me paraît en tout cas très important de conserver les fondamentaux de cet amendement, et avant tout la mention du délit d'entrave, parce que, comme les enquêtes menées auprès des professeurs après la mort de Samuel Paty l'ont révélé, beaucoup de professeurs s'autocensurent. Il y a donc bien une entrave à leur métier.
Deuxièmement, je voulais que ce délit d'entrave soit spécifique aux professeurs.
Enfin, je voulais que nous mentionnions que ce qui était entravé, c'était la possibilité même d'exercer le métier de professeur, c'est-à-dire de transmettre son savoir dans des disciplines telles que, on le sait, les sciences de la vie et de la terre, la philosophie, la littérature, l'histoire, l'éducation physique et sportive. C'est cette entrave à la délivrance du savoir que je voulais viser par cet amendement, et c'est la raison pour laquelle je me satisfais, un peu immodestement, de la rédaction dont je suis l'auteure.


Il s'agit là, d'une part de préciser à l'article 431-1 que la liberté d'enseignement est une liberté fondamentale, et d'autre part de substituer à la rédaction actuelle, qui semble confier au Conseil supérieur des programmes le soin de déterminer les objectifs pédagogiques – alors que ce n'est pas son rôle – , une référence à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, relatif au socle commun.

La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l'amendement no 2008 .

J'ajouterai simplement quelques éléments à ce que notre collègue Breton vient de dire excellemment.
L'intérêt de viser l'article L. 912-1-1 est qu'il couvre à la fois le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale, le projet d'école ou d'établissement et le conseil et le contrôle des membres des corps d'inspection. C'est aussi la raison pour laquelle nous insistons autant sur la nécessité de faire figurer la liberté pédagogique de l'enseignant dans l'article 4 bis.

Vous avez raison, chère collègue Genevard, d'être satisfaite de la rédaction de votre amendement, ne serait-ce que parce qu'il a été adopté, même si on peut encore en améliorer la rédaction.
Pour ce qui me concerne, je suis plutôt d'accord avec votre proposition, messieurs les députés, de faire référence à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation plutôt qu'au Conseil supérieur des programmes, qui n'a en effet qu'un rôle consultatif.
En revanche, il ne m'apparaît pas opportun de créer un délit d'entrave spécifique à la liberté d'enseignement. Je rappelle que c'est une liberté constitutionnelle qui renvoie au droit de créer un établissement d'enseignement privé, confessionnel ou non, d'y enseigner ou, pour les élèves, de le fréquenter. Pourquoi alors ne pas créer un tel délit spécifique pour chacune de nos libertés fondamentales ? Je crois que ce n'est pas raisonnable.
M. le garde des sceaux évoquait à propos d'un autre amendement cette tendance que nous avons à tout vouloir judiciariser alors qu'on promet avant chaque échéance électorale qu'on va arrêter de légiférer sur tout et de tout judiciariser.

C'est que nous sommes dans un monde qui ne sait plus s'arrêter. Infidèles à nos promesses, nous ne cessons de vouloir légiférer tant et plus et de vouloir tout judiciariser, ce qui n'est pas nécessairement une bonne solution : beaucoup de sujets qui fâchent pourraient être réglés sans l'intervention d'un juge, et surtout sans l'intervention d'un juge pénal.
Défavorable.

Je suis parfaitement d'accord avec Mme la rapporteure. Les amendements ne peuvent pas être adoptés en l'état, en raison de la modification du code pénal proposée au I : l'enjeu n'est pas là. En revanche, la rédaction proposée par M. Breton et M. Hetzel pour qualifier le délit d'entrave me semble très intéressante. La formulation actuelle de l'article 4 bis, qui mentionne « les objectifs pédagogiques de l'éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes », n'est pas juste : si le Conseil supérieur des programmes définit les programmes, les objectifs pédagogiques relèvent du travail de l'enseignant. Lier ces deux notions n'a aucun sens.
La proposition consistant à définir la fonction d'enseignant en lien avec les seuls objectifs fixés par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qui contient les dispositions générales relatives au contenu de l'enseignement scolaire, me paraît beaucoup plus judicieuse au vu de l'objectif de respect de la liberté pédagogique de l'enseignant exprimé par Mme Genevard.
Si les amendements ne peuvent être adoptés en l'état, il me semble intéressant, pour la poursuite de nos travaux, de garder à l'esprit la rédaction proposée au II.

Je ne me prononcerai pas sur ce débat d'experts, mais je souhaite revenir à la remarque formulée par Mme la rapporteure, selon laquelle il faut se garder de tout judiciariser. L'amendement créant l'article 4 bis est né après la mort de Samuel Paty. Si nous ne nous exprimons pas à l'occasion d'un texte issu de tous les événements dramatiques qui se sont produits, il me semble que nous trahirions notre mission. Mais peut-être vous ai-je mal comprise.

Mme Rilhac vient d'insister sur un point important. Vous pourriez d'ailleurs sous-amender mon amendement pour ne retenir que son II, même si, à titre personnel, je ne souhaite pas le faire.
Cela étant, j'insiste sur le fait que la rédaction actuelle de l'article 4 bis pose, au plan pédagogique cette fois-ci, trois difficultés réelles. La première, c'est la confusion entre objectifs pédagogiques, programmes et socle commun.
Ensuite, la formulation actuelle, assez imprécise, protège une seule manière d'enseigner, définie « selon les objectifs pédagogiques de l'éducation nationale ». Cela pose une multitude de problèmes, par exemple pour l'éducation privée sous contrat, qui pourrait se trouver en difficulté face à cette manière d'envisager les choses.
Troisième difficulté : comme le soulignait Mme Rilhac, le rôle conféré au Conseil supérieur des programmes dans la rédaction actuelle va au-delà du droit positif. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, en effet, « les éléments [du] socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret », le Conseil supérieur des programmes n'en étant saisi que pour avis.
Au vu de ces trois problèmes majeurs, les deux amendements défendus par M. Breton et moi-même visent à améliorer la rédaction actuelle de l'article.

D'autres techniques parlementaires existent peut-être, mais je suis d'accord pour sous-amender vos amendements, si cela vous convient, en en supprimant le I pour n'en conserver que le II.

Il est toujours possible de déposer un sous-amendement, madame la rapporteure, à condition de le déposer par écrit.
La parole est à M. Xavier Breton.

Notre proposition visait effectivement à ce que nous retravaillions la rédaction de l'amendement directement en séance, puisque nous sommes visiblement d'accord sur l'objectif à atteindre. La solution suggérée par Mme la rapporteure me semble pertinente. Un débat demeure à propos de l'article 431-1 du code pénal, mais il ne doit pas polluer la discussion relative au choix de l'article du code de l'éducation sur lequel doit s'appuyer le délit d'entrave à la fonction d'enseignant.
À titre personnel, je suis disposé à ce que mon amendement soit sous-amendé sur la base de la proposition formulée par la rapporteure.

Je me propose de déposer un sous-amendement allant dans le sens de la rapporteure et demandant le retrait du I de l'amendement no 1982 de M. Breton pour n'en conserver que le II.

Si mes collègues, notamment Patrick Hetzel – qui possède, du fait de sa vie professionnelle, des compétences incontestables en la matière – , jugent que la formulation qu'ils proposent est la meilleure, je ne suis pas hostile à son adoption, pour autant qu'elle permette de conserver la notion d'entrave et la référence aux enseignants.
Je souhaitais simplement alerter sur un point : veillons à ce qu'un professeur qui userait de façon négative de sa liberté pédagogique ne puisse pas invoquer un délit d'entrave pour justifier ce qui ne serait en réalité qu'un exercice déficient de cette liberté. Au-delà, je n'ai aucune objection de fond à la formulation proposée.

Le Gouvernement préfère s'en tenir à la version de la commission – sachant que, comme je l'ai rappelé, un travail est en cours. Avis défavorable.

Nous apprécions les tentatives qui sont faites pour trouver des rédactions communes, mais nous préférons nous aussi nous en tenir à la rédaction initiale.

Les amendements nos 1077 de Mme Nathalie Porte, 1750 de M. Julien Dive et 1196 de M. Ludovic Pajot sont défendus.


Les menaces, les violences ou tout autre acte d'intimidation contre le corps enseignant sont inacceptables dans notre République. L'amendement vise donc à faire évoluer le quantum de la peine encourue dans ce cadre. Vous pourrez m'opposer, monsieur le garde des sceaux, qu'il faut bien fixer une limite et que je verse dans la surenchère, mais si je propose de porter la peine maximale d'un an à trois ans de prison ferme, c'est pour une bonne raison : chacun sait que, quand une peine inférieure à deux ans est prononcée, la personne condamnée peut – ou risque – de ne pas passer un seul instant en prison, des alternatives à la détention pouvant lui être proposées. Si le magistrat – qui, le plus souvent, fixe la peine en ayant cette donnée à l'esprit – veut absolument, au vu de la gravité des faits, que la personne condamnée aille effectivement en prison, le fait de fixer la peine maximale à trois ans lui donnera cette possibilité.

La parole est à M. Philippe Benassaya, pour soutenir l'amendement no 1243 .

Après la mort de Samuel Paty en octobre dernier, il était du devoir de la représentation nationale de chercher à prévenir et de combattre ces actes barbares.
L'article 4 bis tend à garantir et à protéger l'exercice de la profession d'enseignant contre toutes tentatives de pression et d'insultes à leur égard liées aux enseignements qu'ils prodiguent. Nous proposons de doubler les sanctions encourues en les fixant à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.

Ces amendements démontrent combien peu évidente est l'articulation entre les articles 4 et 4 bis. S'agissant du quantum des peines, je vous propose d'en rester à la rédaction adoptée par la commission spéciale sur proposition de Mme Genevard, d'autant que ceux qui sont proposés ne correspondent pas aux quantums habituels pour ce type de peine. Certes, en tant que législateur, nous pourrions proposer de nouvelles références mais c'est un argument supplémentaire – quoique non dirimant – pour donner un avis défavorable.
Il me semble que les équilibres ont été trouvés dans le texte adopté en commission. En outre, celui-ci vient s'insérer dans un code pénal qui réprime déjà certaines infractions. Je suis donc défavorable à ces amendements.

La parole est à M. Ludovic Mendes, pour soutenir l'amendement no 2469 .
L'amendement no 2469 est retiré.

La parole est à M. Francis Chouat, pour soutenir l'amendement no 2399 .

En commission, j'avais voté l'amendement présenté par notre collègue Genevard et je m'en réjouis. Celui que je défends est très similaire à celui que vient de présenter notre collègue Benassaya. Ayant bien compris par ailleurs que l'article 4 bis était encore en construction, je le retire.
L'amendement no 2399 est retiré.

Sur l'article 4 bis, je suis saisi par les groupes La République en marche et Les Républicains d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Philippe Benassaya, pour soutenir l'amendement no 1255 .

Il vise à renforcer la libre expression et l'indépendance des enseignants-chercheurs, que le Conseil constitutionnel a élevées au rang de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Leur garantie est en effet une composante du droit à la liberté de communication des pensées et des opinions que consacre l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or elles sont aujourd'hui menacées au sein même de ces temples du savoir que sont les universités. C'est pourquoi nous proposons d'étendre le dispositif de l'article 4 bis à la sphère universitaire et aux enseignants universitaires.

Cet amendement fait partie de ceux, auxquels j'ai déjà fait allusion, qui tendent à créer un délit d'entrave concernant d'autres professions que celles citées par Mme Genevard dans le sien.
Il s'agit ici de l'entrave à l'exercice des missions de service public de l'enseignement supérieur. Or, je le répète, de tels agissements sont déjà réprimés par des incriminations générales.
Plus généralement – et cette observation vaudra pour les amendements suivants – , en précisant la qualité des victimes ou des auteurs, ce qui revient à inclure certaines personnes et à en exclure d'autres, on finit par réduire la portée des incriminations générales. Souvenez-vous de nos discussions à propos de l'article 1er ! Faute de pouvoir être exhaustif, on oublie toujours quelqu'un, alors même que, d'un autre côté, on aura tendance à mentionner des personnes déjà citées par ailleurs.
L'avis est donc défavorable, je propose que nous en restions à la rédaction de l'amendement de notre collègue Genevard.
Mme la rapporteure a parfaitement expliqué les raisons pour lesquelles nous y sommes défavorables.

Je trouve cet amendement très intéressant. On sait que l'université est actuellement traversée par certains courants à l'origine de dérives idéologiques. Une demande de mission d'information sur cette question a d'ailleurs été formulée par nos collègues Abad et Aubert.
Je pense notamment à la cancel culture, selon laquelle on serait autorisé, ou non, à s'exprimer en fonction de sa couleur de peau, de son sexe ou de sa religion par exemple. Ce courant s'infiltre dans les institutions telles que les universités ou même d'ailleurs au sein de cet hémicycle – nous en avons eu un exemple lors de ce débat. Nous devons résister avec force à de tels courants. Manifestement nous ne disposons pas actuellement des moyens juridiques d'empêcher leur développement, à moins qu'il manque une volonté politique de se donner ces moyens.
L'amendement no 1255 n'est pas adopté.

Le délit d'entrave à la fonction d'enseignant a été créé grâce à l'amendement d'Annie Genevard adopté en commission spéciale. J'en profite pour rappeler que cet amendement s'inspire d'une proposition de loi de Julien Aubert. Je tenais à le citer et à l'associer à cette avancée.
Mon amendement vise à étendre ce délit aux missions exercées par les professions de santé pour lesquelles la question de l'application différenciée des règles, mentionnée dans l'article 4, ne se pose pas de la même manière. Dans ce secteur, le problème de l'entrave n'est donc résolu ni par l'article 4 ni par les autres dispositions du texte. Or, particulièrement en période de lutte contre le séparatisme, nous devons penser aux professionnels de santé qui, au quotidien, rencontrent parfois d'énormes difficultés pour soigner.
L'amendement no 2061 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Je regrette que vous ayez fermé la porte à toute discussion sur l'amendement précédent. J'aurais au moins aimé que vous me disiez quelles dispositions protègent les professionnels de santé subissant une entrave.
Cet amendement vise également à étendre le délit d'entrave, cette fois aux missions exercées par les agents des services départementaux d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Alors que la mission des pompiers est de nous sauver, leur action se trouve parfois entravée, comme vous le savez. Or ce type de délit ne me semble pas pris en considération.
Défavorable. J'ai parlé tout à l'heure de la main tendue par le Gouvernement à Mme Genevard, qui l'a acceptée. Le travail n'est pas encore terminé. Nous souhaitons nous en tenir au texte de la commission.

Je ne vais pas poursuivre trop longtemps car je vois que je suis seul face à tout le monde.
Sourires.

Je ne suis pas convaincu par les arguments avancés. Je trouve dommage de vouloir en rester au texte de la commission simplement, au fond, parce que cet article est la réponse à l'assassinat de Samuel Paty. Nous devrions être capables d'explorer un nouveau champ juridique, par exemple en répertoriant les professions qui pourraient être protégées par ce délit d'entrave. Cela aurait mérité que nous en discutions.
L'amendement no 2066 n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l'amendement no 608 .

Par cet amendement, mon collègue Christophe Naegelen propose simplement d'inscrire dans la loi que, eu égard à la mission sacrée qui est celle des enseignants, les parents comme les enfants leur doivent le respect. Avant même les agressions, l'irrespect a malheureusement déjà fait trop de dégâts au sein de l'éducation nationale.

Nous devons bien sûr nous respecter, les élèves doivent bien entendu respecter leurs professeurs, mais faut-il inscrire cela dans la loi ? Avis défavorable.
Même avis.

J'aimerais vous répondre en paraphrasant un fameux ministre des affaires étrangères : « si cela va sans dire, cela ira encore mieux le disant », et donc en l'inscrivant dans la loi.
L'amendement no 608 n'est pas adopté.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 121
Nombre de suffrages exprimés 117
Majorité absolue 59
Pour l'adoption 113
Contre 4
L'article 4 bis est adopté.

Cet article a pour objectif d'étendre le champ du dispositif de signalement mis à la disposition des agents publics qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes.
Les violences et le harcèlement sont des réalités dans la sphère professionnelle et plus particulièrement dans la fonction publique. Nombre de nos agents sont exposés à la violence, aux discriminations et aux actes de harcèlement dans le cadre de leurs fonctions. À titre conservatoire, selon une étude IFOP réalisée pour le Défenseur des droits en 2014, une femme sur cinq, entre 18 et 64 ans, a subi du harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Les femmes sont davantage touchées par ces violences.
Trop souvent, certains de nos concitoyens égarés agressent un agent public parce qu'il est agent public, qu'il soit agent d'accueil, surveillant de piscine, responsable d'une activité périscolaire, agent des cantines, enseignant – une des dix professions les plus maltraitées par le public – , agent de police ou encore, comme la triste actualité en témoigne, agent du service public de l'emploi.
Ces violences ont bien sûr un impact sur la sécurité ainsi que sur le bien-être et la performance au travail de la victime mais aussi sur l'environnement de travail de l'ensemble des agents et agentes du service et sur l'image et l'attractivité des métiers.
Face à cette situation, le rôle du législateur est de mieux protéger ces agents contre les violences et les menaces, y compris lorsque celles-ci sont formulées sur internet. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dont j'ai été rapporteure est venue apporter une réponse en renforçant la lutte contre les différentes formes de violence, discrimination, harcèlement et sexisme. Ainsi, depuis le 1er mai 2020, les employeurs territoriaux doivent-ils mettre en place un dispositif de signalement.
Consciente que nous pouvons aller plus loin encore, notre majorité propose aujourd'hui d'allonger la liste des actes qui peuvent faire l'objet d'un signalement pour y faire figurer les atteintes à l'intégrité physique et les menaces. Les agents concernés seraient ainsi orientés vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
L'extension du champ du dispositif de signalement apparaît comme une avancée majeure dans la protection des agents chargés d'un service public et je me réjouis que nous puissions y procéder dans le cadre de ce projet de loi.

La parole est à M. François Cormier-Bouligeon, pour soutenir l'amendement no 2309 .

Il s'agit d'étendre aux collaborateurs occasionnels du service public le bénéfice du dispositif de signalement.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais je suis impatiente de connaître l'avis de M. le ministre.

La parole est à M. le ministre de l'intérieur, pour donner l'avis du Gouvernement.

J'aurais aimé que ces avis soient plus argumentés mais, à défaut, je rappelle que la commission spéciale a considéré que mon amendement était satisfait, reconnaissant par là même l'existence juridique des collaborateurs occasionnels du service public. Je le retire.
L'amendement no 2309 est retiré.

Le présent article prévoit que les administrations, les collectivités et les établissements publics mettent en place un dispositif destiné à recueillir les signalements des agents s'estimant victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique. Cet amendement propose de prendre également en considération les atteintes volontaires à leur intégrité psychique.

À titre personnel, il me semble que la référence à tout acte d'intimidation, telle qu'elle est définie par la Cour de cassation, est suffisamment large pour couvrir la notion d'atteinte à l'intégrité psychique. Avis défavorable.

La parole est à M. Ludovic Mendes, pour soutenir l'amendement no 1304 .

Grâce aux excellents conseils de M. Florent Boudié, notre rapporteur général, je le retire.
Sourires sur plusieurs bancs du groupe LaREM.
L'amendement no 1304 est retiré.

La parole est à M. Jean-Philippe Ardouin, pour soutenir l'amendement no 2292 .

Nous proposons d'inclure expressément les insultes parmi les actes répréhensibles qu'un agent doit pouvoir signaler, et de remplacer la référence aux « agissements sexistes » par une expression plus générale ayant trait à l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'apparence physique, l'âge ou l'activité syndicale du fonctionnaire.

Pour les raisons que j'ai déjà évoquées et qui valent pour tous ces amendements, il ne me semble pas opportun d'étendre au cas par cas le champ du dispositif. La notion d'acte d'intimidation est déjà interprétée très largement par la Cour de cassation. Avis défavorable.
L'amendement no 2292 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Philippe Ardouin, pour soutenir l'amendement no 2467 .

Il est nécessaire qu'un agent s'estimant victime d'une atteinte à son intégrité physique ou de menaces soit orienté dans un délai raisonnable vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement des victimes et de traitement des faits signalés. Il faut en effet que ce traitement soit rapide si nous voulons que l'article 5 soit efficace.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de préciser que le délai doit être raisonnable. Avis défavorable.
L'amendement no 2467 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir l'amendement no 1582 .

Il aborde également cette question du délai raisonnable. Dans bien des cas, lorsque les fonctionnaires sollicitent la protection fonctionnelle, leur demande fait l'objet d'un refus ou reste sans réponse, ce qui les laisse dans la panade. Il est donc important d'obliger l'autorité compétente à répondre dans un certain délai, que nous proposons de fixer à une semaine à compter de la date du signalement, et à quarante-huit heures lorsque les circonstances et l'urgence le justifient. En effet, tous les fonctionnaires ne bénéficient auprès de leur hiérarchie de la même bienveillance que celle dont a fait preuve le préfet Lallement lorsqu'il a accordé, très rapidement et dans des conditions somme toute assez particulières, la protection fonctionnelle aux policiers qui ont agressé M. Zecler ! Combien de fonctionnaires, en apprenant cela, se sont dit : « Et moi ? Quand je suis confronté à une situation difficile, on ne me répond pas ou on m'envoie balader en me disant que je n'ai qu'à me débrouiller, me tourner vers mon assureur, etc. » Ce n'est pas satisfaisant. Il faut donc aller jusqu'au bout de la logique du dispositif en prévoyant des garanties, notamment en termes de délai.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Mais, mon cher collègue, le projet de loi est beaucoup plus performant que ce que vous proposez…

… puisque le dernier alinéa de l'article 5 prévoit que « lorsqu'elle est informée [… ] de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque ».
C'est donc un avis défavorable.

Je conviens qu'en cas d'urgence, l'expression « sans délai » est préférable au délai de quarante-huit heures que nous proposons. Mais dans les autres cas, un délai d'une semaine apporterait de meilleures garanties. Par conséquent, à moins de nous accordons une petite suspension de séance pour modifier l'article en ce sens, nous n'allons pas tomber d'accord.
Je crois que nous n'allons pas tomber d'accord.

Je voudrais tout de même faire remarquer que Mme la rapporteure n'a pas été jusqu'au bout de la lecture de l'alinéa, qui se termine par ces mots : « Ces mesures sont mises en oeuvre, sur demande ou non du fonctionnaire, pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. » On retrouve exactement le même débat que tout à l'heure à propos de l'article 4, quand nous avions demandé que la hiérarchie dépose plainte après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire, mais pas nécessairement son consentement, afin de s'assurer que ladite hiérarchie aurait à coeur de défendre les fonctionnaires mis en cause.

L'adoption de notre proposition aurait donc amélioré la cohérence entre les deux articles. Toute mesure permettant d'impliquer davantage les hiérarchies aux côtés des agents menacés me paraît bonne. Même si je me félicite de la rédaction de l'alinéa que j'ai cité, je continue de regretter votre vote de tout à l'heure.
L'amendement no 1582 n'est pas adopté.


Toujours dans le souci de renforcer la protection des agents publics, il est proposé que l'administration informe au plus vite le procureur de la République afin qu'il diligente une enquête. Il s'agit de veiller à ce que des suites immédiates soient données à une plainte d'un agent public ayant subi menace ou violence. On sait combien la diligence est nécessaire dans certaines situations.
Par ailleurs, si le code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur de la République doit motiver une décision de classement sans suite, cet amendement prévoit qu'en ce cas, la motivation soit spécialement établie.
Enfin, l'amendement propose que le procureur de la République doive prendre une décision sur les suites à donner dans un délai de soixante-douze heures.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l'amendement no 1803 .

Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement no 1804 , bien qu'il ne fasse pas partie de la discussion commune.
Au préalable, je suis désolé de devoir revenir à mon tour sur le vote de tout à l'heure, mais il faut bien souligner que la majorité a alors décidé de ne pas permettre à l'employeur de se substituer à l'employé pour le protéger efficacement dans le cas où, par crainte des menaces, il renoncerait à porter plainte… Tant pis pour lui, son affaire passera sous l'éteignoir !
L'article 4 concernait le délit d'entrave, consistant à exercer des pressions sur un fonctionnaire pour l'empêcher d'exercer comme il le devrait sa mission de service public. L'article 5 vise un délit plus grave, l'atteinte à son intégrité physique ou psychologique. Mais comme j'ai compris qu'il était inutile de demander que l'employeur public se substitue à son agent, cet amendement propose une procédure simple et qui ne transgresse aucun principe de droit – pas plus d'ailleurs que précédemment, plusieurs collègues l'ont démontré en réponse à l'argument d'inconstitutionnalité – : l'employeur transmettrait sans délai le signalement au procureur de la République, à ce dernier de choisir de poursuivre ou non, en fonction de son évaluation de la gravité des faits.
Une telle disposition aurait deux intérêts : le premier, celui de résoudre le problème du consentement de l'agent ; le second, c'est qu'elle permettrait de quantifier enfin l'ensemble des faits délictueux alors qu'aujourd'hui, les administrations – surtout les administrations d'État, voire les administrations hospitalières – ne savent évidemment pas comment évaluer la face obscure du phénomène, c'est-à-dire le nombre de fois où les victimes renoncent à les signaler. Un signalement systématique de la part des autorités qui dirigent ces administrations permettrait d'objectiver les faits et d'établir enfin des statistiques dignes de ce nom, tout en laissant au procureur de la République le soin d'évaluer la gravité des faits et de décider s'il faut mettre en mouvement l'action publique.
Quant à l'amendement no 1804 , il prévoit que « lors de leur recrutement, les agents sont informés de l'existence de ce dispositif de signalement ». Aujourd'hui, ils sont obligés de toute façon de courber l'échine.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements en discussion commune ?

Ces amendements étant satisfaits par l'article 40 du code de procédure pénale, l'avis sera défavorable. Mais je vous rejoins, monsieur Lagarde, sur le fait que les signalements sont en nombre insuffisant. L'exécutif pourrait envisager d'adresser des circulaires pour rappeler l'existence de l'article susmentionné.

Je me doutais que le Gouvernement et la commission y seraient défavorables par principe, et je le regrette : vous souhaitez que ces dispositions relèvent d'une circulaire et non de la loi, alors que je veux obliger les administrations à les appliquer.

La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir l'amendement no 1585 .

Je vais également défendre l'amendement no 1584 , puisque ces deux amendements s'inscrivent dans une logique commune. Il s'agit de faire en sorte que le dispositif de signalement ne soit pas purement individuel, renvoyant la victime à ses propres responsabilités, mais qu'on puisse en tirer des conclusions collectives. Nous proposons donc d'informer les représentants du personnel en cas d'activation du dispositif de signalement et de veiller à ce que l'ensemble des agents aient connaissance de l'existence de ce dispositif afin d'éviter une forme d'atomisation dans laquelle se retrouvent ceux qui sont victimes de ce type d'intimidation et de violence.

Sur l'article 5, je suis saisi par le groupe La République en marche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Quel est l'avis de la commission ?

Il n'apparaît pas opportun de systématiser l'information des représentants du personnel pour la bonne raison que l'agent victime peut ne pas le souhaiter. Avis défavorable.
L'amendement no 1585 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'amendement no 1584 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l'amendement no 1804 .

Dès lors que le Gouvernement et la majorité ont refusé le dispositif de signalement que je proposais, les fonctionnaires n'ont plus à être tenus informés de son existence. Je retire l'amendement.
L'amendement no 1804 est retiré.

La parole est à Mme Anne-Christine Lang, pour soutenir l'amendement no 2381 .

Dans le prolongement des articles 4 et 18, qui visent à protéger les agents publics, ainsi que de la circulaire du 2 novembre 2020, qui renforce leur protection quand ils sont victimes d'attaques, je propose d'aller plus loin en inscrivant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que l'administration se doit de protéger ses agents contre les pressions et les appels à la haine dont ils sont victimes.
En effet, l'article 11 de la loi de 1983 dispose que « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. »
Dans un souci de cohérence et afin que les fonctionnaires tirent effectivement bénéfice des articles 4 et 18 du présent projet de loi, il convient donc d'étendre la protection fonctionnelle aux pressions et appels à la haine dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

Je comprends le sens de votre amendement mais il me semble que les critères de déclenchement de la protection fonctionnelle, que vous venez de citer, peuvent s'appliquer aux pressions et aux appels à la haine. Pour cette raison, j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement no 2381 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir l'amendement no 2535 .

Il s'agit de supprimer, à la seconde phrase de l'alinéa 7, les mots « sur demande ou non du fonctionnaire » qui ne sont pas utiles. C'est la seule raison du dépôt de l'amendement, mais si on peut éviter ce qui est inutile dans une loi, autant le faire.

Je suis assez étonné : l'article 5 a été soumis au Conseil d'État ; si ce dernier a laissé cette mention, c'est qu'elle doit avoir un intérêt. À moins qu'il ne s'agisse d'un amendement adopté en commission ?
L'amendement no 2535 est adopté.
L'amendement no 1078 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 107
Nombre de suffrages exprimés 107
Majorité absolue 54
Pour l'adoption 107
Contre 0
L'article 5, amendé, est adopté à l'unanimité.

Les amendements nos 119 de M. Éric Pauget, 336 de M. Yves Hemedinger, 789 de Mme Annie Genevard, 122 de M. Éric Pauget et 479 de M. Philippe Meyer sont défendus.

Mes chers collègues, nous allons pouvoir aborder l'examen de l'article 6.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, permettez-moi de vous suggérer de reporter à demain matin l'examen de l'article 6.
Approbations sur divers bancs.
Je constate en effet, et c'est légitime, que de nombreux orateurs se sont inscrits sur cet article important sur lequel beaucoup d'amendements ont été déposés. En outre, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, y a beaucoup travaillé et je pense qu'elle souhaiterait être présente pour débattre avec les députés.
Toutefois, si vous souhaitez poursuivre la séance, je suis à votre disposition.

Monsieur le ministre, il semble que votre proposition recueille une certaine unanimité dans l'hémicycle.
La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine séance.

Prochaine séance, demain, à neuf heures :
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
Suite de la discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.
Le Directeur du service du compte rendu de la séance
de l'Assemblée nationale
Serge Ezdra