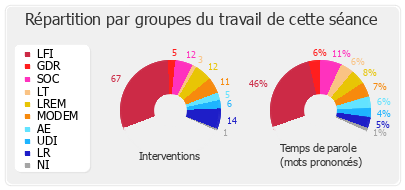Séance en hémicycle du jeudi 13 janvier 2022 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à quinze heures.
Suite de la discussion d'une proposition de loi constitutionnelle


« Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort : il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement ; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. »
Cette formule, limpide et lapidaire, nous la devons à Jean-Jacques Rousseau qui, dans son livre Du contrat social, cherchait à poser les fondements théoriques de l'exercice de la souveraineté pour un peuple libre, réuni au sein de la res communis et délibérant en faveur de l'intérêt général.
Cette méfiance, si ce n'est cette défiance à l'égard du mandat représentatif n'était pas le fait d'un individu isolé : dans sa pratique comme dans son analyse, l'idéal démocratique fait l'objet de débats passionnés depuis la plus haute antiquité. La présente proposition de loi constitutionnelle s'inscrit dans le prolongement de ces débats pour les enrichir.
Comment faire pour que le citoyen puisse librement exercer ses droits, participer de la manière la plus directe à la vie et à l'organisation de la cité, loin des tutelles ombrageuses et des tyrannies de groupes privés ? Voilà la grande question qui nous occupe aujourd'hui.
Nous proposons ici l'organisation d'un référendum révocatoire, à l'initiative d'un quorum de citoyens, qui permettrait de démettre un élu, du conseiller municipal jusqu'au Président de la République, à l'issue du premier tiers du mandat et avant la dernière année de celui-ci.
Mais avant de développer l'esprit de ce texte et de répondre aux critiques émises lors de son examen en commission, permettez-moi de dire pourquoi je me suis saisie de cette proposition dont mon collègue et camarade Corbière est à l'origine.
Je n'ai jamais été élue avant ce mandat ni, étonnamment, cherché à l'être, me tenant à la lisière de la politique professionnelle. Et si j'ai pu, ici ou là, concourir à quelques élections, je considérais celles-ci essentiellement comme des tribunes pour exprimer mes idées, par exemple sur le risque de prolifération des armes nucléaires.
Ainsi, et même si je n'ai cessé, depuis quarante ans, de me mêler des affaires de la cité, loin de moi l'idée de devenir une « femme politique », tant la marche courante des affaires avait fini par m'en dégoûter profondément.
Cette appréhension, je l'ai d'ailleurs ressentie très tôt : déjà, lors de l'élection de nos délégués de classe, il me paraissait pour le moins étrange de parler « au nom de », sans avoir consulté personne. Puis, jeune citoyenne dans les années 1980, j'ai pu apprécier la valeur de certaines promesses électorales – je pense au « changer la vie » d'une gauche qui s'est bien vite décolorée, et dont la rose s'est fanée en perdant une à une ses pétales.
La professionnalisation croissante du monde politique, sa réduction sociologique à un aréopage de notables, le poids des puissances d'argent dans nos décisions publiques puis l'abandon du débat d'idées au profit d'un marketing électoral devenu envahissant : telles ont été les raisons de la colère qui m'a tenue, paradoxalement, éloignée de tout parti politique. Aujourd'hui encore, les simples formules : « les Français pensent que », « les Français veulent que », prononcées par des représentants, me hérissent le poil en raison de leur malhonnêteté.
Or cette impression d'alors est plus que jamais d'actualité. Le fossé entre représentants et représentés ne cesse de se creuser : tous ici, quels que soient nos bancs, nous partageons peu ou prou le même diagnostic d'un épuisement de nos institutions représentatives. « Démocratie de basse intensité », « césarisme démocratique », « despotisme doux » : quelles que soient les images employées, le phénomène persiste. Nos concitoyens se sentent chaque jour dépossédés de leur pouvoir d'agir. J'en veux pour preuve l'abstention que nous connaissons tous. Dans ma circonscription, par exemple, moins de la moitié des électeurs se sont déplacés pour mon élection.

Cette désaffection traduit-elle une indifférence à la chose publique ? Je ne le pense pas. En novembre, j'ai réalisé un micro-trottoir sur mon territoire. Il révèle que, si beaucoup de nos concitoyens méconnaissent nos institutions et nos fonctions, tous ont un point de vue sur les dysfonctionnements de notre société dans différents domaines : handicap, école, chômage, logement, écologie et, justement, démocratie. Ces personnes qui ne disent rien dans les urnes ont donc pourtant quelque chose à dire.
Certes, le problème n'est pas seulement français. Dans toutes les démocraties libérales, on constate une abstention croissante, car c'est le fait représentatif lui-même qui interroge.
Cette interrogation ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Bien avant Rousseau, les cités grecques ont récusé le principe même de représentation. On s'offusquait alors de l'idée même qu'un homme puisse briguer les suffrages de ses pairs. La participation de tous et de plein droit à l'ecclésia était la règle, précisément pour que le peuple reste souverain et pour éloigner le spectre de l'aristocratie et de l'oligarchie.
Plus tard, Rousseau, que j'ai déjà cité, l'a aussi exprimé : « L'idée des représentants […] nous viendrait du gouvernement féodal, de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée et où le nom d'homme est en déshonneur. »
Pour notre pays, le principe de révocabilité est consubstantiel à l'idée même de démocratie et de République. Contre les défenseurs de la représentation nationale élue, comme Sieyès, nombreuses étaient déjà les voix qui s'élevaient : si le peuple est souverain et sa volonté inaliénable, estimaient certains, alors il appartient au peuple de changer son gouvernement et de révoquer ses mandataires. Dans le même esprit, le comité central de la Commune de Paris a déclaré : « Les membres de l'assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion sont révocables, comptables et responsables. »
Certes, je ne méconnais pas les critiques émises en commission ni le fait que cette proposition n'entend pas à elle seule résoudre la grave crise qui affecte nos institutions.
Parmi les arguments qui m'ont été opposés, la révocabilité a été discréditée au nom de l'attractivité du « métier » – je reprends le terme qui a été employé – de l'élu. Il me paraît non recevable. Je n'ai jamais considéré l'élection comme une carrière. Ce devrait même être tout le contraire et j'ose espérer que nous nous retrouvons ici par conviction sincère, non pour des avantages ou privilèges. Nous consacrons d'ailleurs tous beaucoup de notre temps à l'exercice de notre mandat, y compris dans le cadre de notre vie privée et sociale.
On a ensuite objecté l'instabilité supposée que créerait la révocabilité. Rappelons d'abord qu'il s'agit de définir, par une loi organique, un quorum qui puisse déclencher le référendum. Doit-il réunir 5, 10, ou 15 % des électeurs inscrits ? Le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit, l'argument est faible tant on sait la difficulté à mobiliser nos concitoyens hors du tempo électoral. En l'occurrence, il faudrait que le comportement ou la décision d'un élu suscite une réprobation telle qu'elle mette en mouvement une part significative de l'opinion publique. On est donc bien loin de l'élection permanente, crainte formulée ce matin par le ministre de la justice.
On a également évoqué le risque que des groupes d'intérêt, des lobbies dévoient ce dispositif révocatoire. Mais les élus ne sont-ils pas déjà soumis à diverses pressions ? Nos programmes respectifs – quand il y en a – ne s'ancrent-ils pas, chacun à leur manière, dans l'expression d'intérêts variés au sein de la société civile ? D'ailleurs, un programme n'est pas tant une liste de mesures à trier que l'expression d'une vision du fonctionnement de la société. En outre, lesdites mesures feront de toute façon toujours l'objet de débats parlementaires, voire de référendums.

Enfin, il est un argument qui m'a quelque peu interloquée. Il a été dit du pouvoir de révocation que cela revenait à mettre l'élu dans la main du citoyen-électeur. Eh bien oui, en effet, et c'est justement là une des vertus de notre proposition.

Elle est même révolutionnaire – encore faut-il s'entendre sur le sens des mots puisque le ministre, qui nous qualifiait ce matin de révolutionnaires, soutient un président qui, en 2017, déclarait lui-même qu'il entendait mener une révolution.
En outre, cette proposition de révocation éviterait peut-être que des élus – comme un collègue de cette assemblée, numéro deux d'une des principales formations politiques du pays – quittent prestement leur organisation, à la veille d'une élection présidentielle, et ce sans même que ses électeurs aient leur mot à dire. Je sais bien que, sous la V
Cette proposition n'a rien d'un remède miracle. Elle s'inscrit d'ailleurs dans une démarche globale : la reprise en main par les citoyens de la chose publique – soit leur République. Certes, d'autres propositions seraient de nature à revitaliser notre démocratie : introduction de la proportionnelle, non-cumul des mandats dans le temps, référendums d'initiatives citoyennes ou tout bonnement respect des référendums comme celui de 2005.
Mais il existe aussi des innovations, telle la Convention citoyenne sur le climat, que le Président lui-même a impulsée, et qui a permis à des citoyens, de tout âge et de toute condition, tirés au sort, de formuler des propositions pour l'avenir de notre planète. Mais remarquez bien la contradiction : toutes les propositions de cette convention ont été balayées d'un revers de vote par un parlement censément représentatif.
En conclusion, toutes les réflexions et propositions permettant de réaliser l'idéal démocratique sont bonnes à prendre. Mais aucune ne répondra, à elle seule, aux aspirations des citoyens d'aujourd'hui, plus matures, informés et conscients qu'ils l'ont jamais été. La démocratie ne peut se réduire à un schéma institutionnel.

Comme a pu le dire Pierre Mendès France, c'est d'abord un « état d'esprit ».

Alors que nous sommes de plus en plus harcelés, menacés de mort, parfois exposés à des violences – ce que je regrette –, cette proposition devrait nous permettre de sortir de cette crise par le haut.
M. Alexis Corbière, rapporteur, applaudit.

Nos collègues de la France insoumise nous donnent l'occasion de discuter d'un sujet important, singulièrement dans un moment où notre démocratie est bousculée dans des proportions peu communes, comme en témoignent la violence inacceptable exercée contre les élus un peu partout sur notre territoire ou la désertion des urnes, scrutin après scrutin.
Sans jamais justifier les actes de violence, il faut chercher à comprendre ces phénomènes qui nous semblent symptomatiques du désenchantement que les Françaises et les Français éprouvent vis-à-vis de la parole politique et de leurs institutions. Ils accréditent l'idée que nous vivons une crise démocratique très profonde, appelant sans tarder une rénovation institutionnelle de grande ampleur.
Cependant, aussi vertueux soit-il, nous ne croyons pas que le droit de révocation des élus permettra de résoudre ce fléau, dans la mesure où celui-ci s'attaque aux conséquences de ce désamour démocratique et nullement aux causes.
Aujourd'hui, la défiance citoyenne à l'égard de la représentation politique est avant tout exacerbée par notre rigidité constitutionnelle. Voulue comme telle par ses pères fondateurs, la V
En outre, avec l'instauration du quinquennat présidentiel en 2000, dont le corollaire est la synchronisation du calendrier électoral, les épisodes de cohabitation sont devenus beaucoup plus hypothétiques. Cela a pour effet d'amplifier davantage la prééminence du Président de la République en accentuant le fait majoritaire, qui veut que le chef de l'État, élu avec la force du suffrage universel, entraîne dans son sillage la formation d'une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.
Pour le pluralisme politique, le tribut à payer est lourd. Nous devons contrecarrer cette logique mortifère en transformant notre système politique en véritable régime parlementaire. Les solutions sont connues : inversion du calendrier électoral, fin de l'élection du Président de la République au suffrage universel, élection du Premier ministre par l'Assemblée ou encore suppression de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, du vote bloqué et de tous les autres artifices du parlementarisme rationalisé.

Le pouvoir doit revenir dans les mains du Parlement, mais un parlement où la représentation politique et sociologique est en phase avec ce qui se passe dans notre pays. Hélas, nous comptons aujourd'hui bien trop peu d'ouvriers, de salariés ou d'agriculteurs à l'Assemblée nationale, ce qui montre l'écart entre les citoyens et leur classe politique.
Le changement interviendra aussi en favorisant l'expression démocratique au travers des référendums. Le groupe GDR a déposé une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un référendum d'initiative citoyenne législatif et abrogatoire, pensant que la participation directe des citoyens est parfaitement complémentaire du régime parlementaire. C'est ce qui se passe en Suisse, dont le système politique est jugé, à raison, comme le plus démocratique du monde : dans la patrie de Jean-Jacques Rousseau, il n'est pas possible de révoquer des élus, mais nos voisins helvètes sont amenés à prendre très régulièrement position sur des débats politiques, souvent d'une grande importance. Ainsi, c'est par référendum que les Suisses ont eu à décider de l'instauration ou non du passe sanitaire avant que les parlementaires ne s'emparent du sujet, ce qui témoigne de toute la considération que les Suisses accordent à la participation directe des citoyens.
En conclusion, nous pensons que le droit de révoquer les élus n'épargnerait pas les défenseurs de l'intérêt général. Aux États-Unis, un sénateur du Colorado a été destitué de son mandat après le lancement d'une procédure révocatoire impulsée par la très célèbre NRA, la National Rifle Association, parce qu'il avait approuvé un projet de loi réduisant la taille des chargeurs des armes automatiques en vente libre. Cet exemple éclairant montre les risques qu'une procédure révocatoire ferait peser sur les élus, qui pourraient ainsi devenir la cible de certains lobbys heurtés par des propositions sociales ou écologiques jugées par eux contraires aux intérêts du capital.
Dès lors, si nous partageons les constats de nos collègues du groupe La France insoumise sur la crise démocratique que nous vivons, nous divergeons sur les moyens d'y remédier. C'est pourquoi nous ne voterons pas cette proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe GDR. – M. Roland Lescure applaudit également.

La proposition de loi constitutionnelle que vous présentez, monsieur le rapporteur, vise à instituer un mécanisme de révocation des élus par voie référendaire, quel que soit le mandat ; celui du Président de la République, ceux des parlementaires ou des élus locaux. Le système proposé apparaît cependant juridiquement imprécis, inopérant au regard des objectifs visés et contraire à nos fondements démocratiques.
En premier lieu, il paraît délicat que le législateur-constituant débatte d'une proposition techniquement aussi imprécise. En effet, si le principe annoncé est clair, la procédure est à l'inverse floue :…

…le référendum révocatoire serait enclenché à la demande de « toute initiative », sans qu'il soit déterminé qui serait susceptible de la prendre et, surtout, sous quelle forme et combien de fois. De même, cette « initiative » ne serait valide qu'après l'approbation d'un certain pourcentage du corps électoral, inconnu à ce stade. Enfin, les modalités de référendum, local ou national, ne sont pas connues non plus – nombre de signatures requis, quorum, contrôle juridictionnel, motifs de la révocation. En bref, la majeure partie des conditions d'application du dispositif présenté dans ce texte sont renvoyées à une loi organique inexistante à ce jour.
Vous vous référez à des exemples étrangers comme sources pouvant inspirer un l'institution d'un référendum révocatoire français. Mais, outre le fait qu'ils présentent entre eux des différences notables et que toute greffe constitutionnelle est souvent chimérique, le constitutionnaliste Michel Verpeaux reconnaît lui-même dans un de ses ouvrages que ces mécanismes sont si fragiles et tellement lourds qu'ils en deviennent inefficaces. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de partir à l'étranger pour trouver des exemples de mécanismes de destitution puisque nous disposons, dans notre droit interne, de tels outils, comme l'article 68 de la Constitution qui prévoit la possibilité de destituer le Président de la République ou comme la possibilité de révoquer les maires ou leurs adjoints.
En deuxième lieu, cette proposition de loi constitutionnelle se révèle inopérante. En effet, vous estimez que la révocation des élus serait une solution pour lutter contre l'abstention et pour restaurer la confiance des électeurs à l'égard des élus. Les phénomènes d'abstention et de défiance existent et doivent certes nous interpeller, mais comment penser que permettre à chacun de tenter à tout instant de révoquer un élu pourrait améliorer la confiance dans nos institutions politiques ? Pas moyen de se référer aux exemples étrangers pour répondre à cette question puisqu'il n'existe à ce jour aucune donnée empirique suffisante qui permette de faire le lien entre référendum révocatoire et hausse de la confiance ou réduction de l'abstention.
On peut en revanche se tourner vers la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite commission de Venise, qui a publié un rapport sur la révocation populaire : celle-ci alerte sur les risques, voire les dangers, qu'elle qualifie de « considérables » de ce type de système, notamment et précisément le risque de voir s'éroder la confiance des électeurs en leurs élus, soit l'exact inverse de l'effet recherché par ce texte.
En dernier lieu, cette proposition de loi constitutionnelle est une dénégation radicale de notre fonctionnement démocratique. L'article 27 de la Constitution dispose en effet que « tout mandat impératif est nul », et nous protège en consacrant le mandat représentatif, inscrit dans notre histoire politique depuis 1789. Par l'établissement de la souveraineté nationale au cœur de notre modèle représentatif, c'est la volonté de la nation qui prime et non les intérêts de groupes particuliers d'électeurs, c'est notre nation, unie et indivisible, qui fait corps.
Vous, vous proposez un système politique avec des électeurs perçus comme de potentiels censeurs qui pourraient se regrouper au sein de coalitions de mécontents, construites uniquement pour mettre fin aux mandats des élus de façon prématurée. Nous, nous optons pour une société qui permette à chaque citoyen de s'engager et d'être force de propositions afin de devenir un acteur de son quotidien. C'est ce que nous avons fait par l'institution et le renforcement d'outils et de moments de démocratie participative innovants, notamment la Convention citoyenne pour le climat.
Mme Sabine Rubin s'exclame.

Notre responsabilité n'est pas de fonder la confiance sur l'individualisme, mais bien de refonder une confiance collective envers les institutions représentantes de la nation. Cet impératif s'est imposé à notre majorité dès le début du mandat comme l'a montré le vote, en 2017, de la loi pour la confiance dans la vie politique, dont l'objet est de garantir la transparence des élus et de favoriser le pluralisme politique. Notre groupe refuse de participer à la création d'un monde politique fondé sur la suspicion et sur la division. Cette proposition de loi constitutionnelle se révèle être une fausse promesse de revitalisation de la démocratie.
C'est la raison pour laquelle La République en marche votera contre ce texte.
Applaudissements sur plusieurs du groupe LaREM.

Les camarades mélenchonistes voudraient nous en convaincre. Certes, monsieur le rapporteur, vous avez semblé refréner vos ardeurs montagnardes à cette tribune ce matin ,
Sourires

vous n'êtes pas allé jusqu'à requérir le rétablissement de la guillotine – ce qu'il y a en vous d'humaniste vous interdit sans doute de nous appeler à raccourcir physiquement ceux que les Insoumis regardent comme les ennemis du peuple.

Mais votre système de révocation populaire serait, en vérité, une autre forme de raccourcissement susceptible d'expédier dans les poubelles de l'Histoire les représentants incapables d'être, à vos yeux, le reflet parfait, immédiat, immanent, du peuple représenté.
« Très bien ! » sur les bancs des groupes LaREM et Dem.

Même si, comme député de l'Yonne, je suis ici le successeur d'un conventionnel régicide, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau,…
Sourires sur les bancs des groupes LaREM et Dem.

J'aime trop la liberté pour la soumettre absolument à l'égalité. Lecteur de Montesquieu, je sais que « Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité ; mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême, et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. » On en connaît les conséquences, presque mécaniques. Je cite encore Montesquieu : « Il se forme de petits tyrans, qui ont tous les vices d'un seul. Bientôt ce qui reste de liberté devient insupportable. Un seul tyran s'élève – je regrette à ce propos que le président Mélenchon ne soit pas parmi nous ;…

« …et le peuple perd tout […]. » Ce serait donc une folie que de céder à l'ivresse robespierriste, qui confond la démocratie et la dictature populaire, au risque de basculer dans une nouvelle tyrannie personnelle.

Mais je veux dire avec la même force aux députés du Marais, c'est-à-dire de l'actuelle majorité ,
« Oh ! » sur plusieurs bancs du groupe LaREM

qu'il serait bien imprudent, mes chers collègues, de nous croire douillettement installés dans un paisible statu quo institutionnel. La vérité est que le doute démocratique ronge notre république :…

…la démocratie est soupçonnée de tourner à vide lorsque ceux que nous élisons n'exercent pas vraiment le pouvoir pour lequel ils ont été choisis, quelle que soit leur bonne volonté, et lorsque nos institutions, formellement si puissantes, semblent devenues fondamentalement impuissantes.
Aussi la vraie question, me semble-t-il, est de savoir si la promesse de liberté politique que la nation s'est faite à elle-même en 1789 peut être tenue dans la France des années 2020. Ma conviction est que les urnes sont toujours préférables aux barricades. Plutôt que de nous enliser, entre chien et loup, dans l'impuissance moite du doute démocratique, sachons retrouver l'audace des commencements, redonnons au souverain la liberté de choisir plus souvent ses représentants afin que les élus de la nation le soient vraiment.
Ainsi, l'Assemblée nationale sera renforcée si sa légitimité est plus souvent vérifiée et si le Président de la République, lorsqu'il perçoit que l'action du Gouvernement a une assise populaire incertaine, accepte de décorréler son mandat de celui de la majorité parlementaire en faisant à nouveau usage du pouvoir de dissolution qu'il tient de l'article 12 de la Constitution. J'aurais parfaitement compris, par exemple, que notre assemblée fût dissoute en 2019, après la crise des gilets jaunes. Tombée en désuétude depuis un quart de siècle, la dissolution a cette vertu ancienne, mais nullement surannée, de permettre au peuple de s'exprimer librement et de choisir plus tôt à qui il délègue, pour un temps, la liberté de délibérer et de décider en son nom, c'est-à-dire de diriger l'État. Dans cet esprit, la question du mode de scrutin, mes chers collègues, devra être à nouveau posée pour mieux représenter la diversité des courants d'opinions, favoriser les logiques de coalition et encourager le rassemblement des Français de bonne volonté.
Il est tout aussi urgent de nous rappeler que, si « la souveraineté nationale appartient au peuple », celui-ci l'exerce à la fois « par ses représentants » – nous tous en l'occurrence, mes chers collègues – « et par la voie du référendum », comme l'énonce l'article 3 de la Constitution. Les deux branches d'expression de la souveraineté doivent être revitalisées : celle de la représentation, je l'ai dit, mais aussi celle, raisonnée, de l'expression référendaire, que les trois derniers présidents de la République ont eu le grand tort de délaisser depuis déjà dix-sept ans.
Mes chers collègues, dans quelques semaines, cette assemblée aura vécu et une nouvelle assemblée sera élue. Formons ensemble le vœu qu'elle ne cède pas aux tentations extrémistes, celle de l'extrême gauche comme celle de l'extrême droite, mais qu'elle ne s'enlise pas non plus dans l'immobilisme. Sachons être fidèles à la promesse de liberté politique que la nation s'est faite à elle-même en 1789 et qu'elle avait su renouveler en 1958, lors de la refondation gaullienne de notre république. Nous retrouverons alors, peut-être, avec la démocratie française, la force révolutionnaire de l'espérance.
Applaudissements sur de nombreux bancs des groupes LaREM et Dem.

La France fait face à des taux d'abstention inédits et à une profonde remise en question de son modèle représentatif, fondement de notre démocratie. Selon le dernier baromètre CEVIPOF, pour 55 % des Français, la démocratie fonctionne mal et, plus alarmant encore, pour 77 % d'entre eux, la politique évoque les termes de « dégoût » ou de « méfiance ». Sans rien céder au pessimisme ambiant, il faut bien regarder la réalité en face. Ces chiffres nous alertent sur la nécessité d'agir, de rebâtir la confiance et de réenchanter la démocratie.
Nous n'ignorons nullement la profondeur de la crise qui nous affecte. Depuis le début de la législature, le groupe Démocrates travaille sans relâche pour approfondir la participation citoyenne, l'une des conditions d'une revitalisation de notre démocratie. Nous avons défendu des propositions fortes en ce sens, comme la reconnaissance du vote blanc ou l'instauration de la proportionnelle. Nous continuerons d'agir jusqu'au terme de nos mandats pour mettre en avant ces sujets essentiels, en particulier lors de l'ultime niche parlementaire réservée à notre groupe, le 3 février prochain.
La réflexion autour de la création de nouveaux mécanismes démocratiques est noble, et le débat mérite d'être d'avoir lieu comme vous le proposez aujourd'hui, monsieur Corbière. Nous sommes ouverts aux idées formulées en ce sens. Je parle évidemment des nouveaux mécanismes démocratiques et non de votre proposition elle-même, car, malheureusement, votre proposition de loi constitutionnelle n'est pas en mesure de relever les défis que j'ai évoqués.
Votre texte vise à instaurer un référendum révocatoire d'initiative citoyenne, qui permettrait de mettre un terme au mandat de tout élu, national comme local, après l'accomplissement d'un tiers de son mandat et avant sa dernière année – pour un mandat de cinq ans, la révocation serait donc possible un an et huit mois après l'élection.
Vous avez affirmé ce matin qu'une telle disposition permettrait de débloquer des situations ; j'ai plutôt l'impression du contraire, tant elle fait fi de ce qui constitue la démocratie et la spécificité du mandat représentatif : le respect des rythmes démocratiques. Il faut donc réfléchir, comme vous l'avez fait, à la façon dont le citoyen participe à la décision politique dans l'intervalle entre deux élections. Il s'agit d'un vrai sujet sur lequel nous devons travailler.
En revanche, votre proposition est un trompe-l'œil. Elle vise tout simplement à endormir nos concitoyens, sans apporter aucune amélioration concrète à la démocratie française.

Je ne reviens pas sur la forme : l'essentiel a été dit. Le texte que vous proposez n'est en tout cas pas vraiment précis – ce qui est souvent le cas des textes débattus dans le cadre des niches parlementaires. Vous renvoyez tout à une loi organique dont nous ne connaissons pas les termes. C'est dommage, car nous aurions pu, peut-être,…

…définir des seuils et approfondir notre réflexion.
Sur le fond, et cela est plus grave encore, le texte conduirait en réalité à rendre l'élu, tout au long de son mandat, entièrement dépendant des moindres mouvements de l'opinion publique.

Que se passerait-il dans une crise comme celle que nous traversons ? En tant qu'élus, nous avons des responsabilités qui ne sont pas toujours simples à exercer : nous devons parfois prendre des mesures qui ne sont pas vraiment populaires, comme la création du passe sanitaire, puis celle du passe vaccinal. Ces dispositions ne font plaisir à quasiment personne, alors imaginez qu'il suffise que 5 % de la population soit en mesure de révoquer des élus : jamais nous ne pourrions prendre de telles décisions. Ce n'est décidément pas ainsi que l'on apaise une démocratie !
Nous avons besoin de dialoguer et de débattre dans la sérénité. Nous devons sans doute réfléchir à un débat public plus serein et apaisé, et à la façon d'articuler la démocratie représentative et la démocratie participative. Je l'ai dit, lors de la prochaine journée dont l'ordre du jour sera réservé à notre groupe, nous ferons des propositions fortes – ce sera en particulier le cas de notre président de séance, Sylvain Waserman.
Face à la vague de menaces inacceptables que nombre d'entre nous subissent ces derniers temps, il faut rappeler que notre indépendance n'est pas un privilège personnel mais une protection du mandat qui nous est octroyé par le peuple français – ce peuple que vous semblez tant aimer –, mandat que, légitimement, nous exerçons librement jusqu'à son terme.
Monsieur le rapporteur, votre proposition met en danger un principe fondamentalement républicain. En conséquence, vous l'aurez compris, le groupe MODEM s'opposera à votre texte.
Applaudissements sur les bancs du groupe Dem et sur quelques bancs du groupe LaREM.

Un Français sur deux ne connaît pas son député, et quatre Français sur dix remettent en question l'utilité de l'Assemblée nationale. L'abstention ne fait qu'augmenter, dépassant le chiffre terrifiant de 65 % aux élections régionales. Le diagnostic d'une crise de la démocratie est posé depuis longtemps. Jean-Jacques Rousseau l'écrivait dans Du Contrat social, parlant de l'électeur : sitôt qu'il a élu ses représentants, il n'est plus rien.
Si la démocratie participative s'efforce de prendre en considération cette critique, la défiance de la société civile à l'égard des gouvernants reste très forte et trouve en partie ses racines dans le fonctionnement actuel de nos institutions : exécutif fort, fait majoritaire, centralisation des décisions par l'administration, faiblesse du Parlement… Nous sommes donc d'accord sur le constat, monsieur le rapporteur, mais le remède proposé, à savoir la révocation d'un élu en cours de mandat par référendum, appelle plusieurs observations.
Les référendums décisionnels sont prévus par la Constitution qui définit leur objet. Celle-ci ne fait pas mention de révocation des élus. C'est donc bien une proposition de loi de nature constitutionnelle qui devait être déposée. Nous comprenons qu'elle ne s'accompagne pas d'une proposition de loi organique puisqu'il s'agit, à ce stade, de débattre d'un principe.
Le dispositif proposé fait l'objet de nombreuses discussions, en particulier depuis le mouvement des gilets jaunes. Il existe dans d'autres pays, mais dans d'autres contextes et sous d'autres formes. Je pense en particulier au recall américain.
Ce mécanisme risque de provoquer une instabilité permanente – il s'agit de la critique qui est lui est la plus fréquemment faite. En effet, il est sain, dans une démocratie, que les élus puissent aller au bout de leur mandat. À son issue, les électeurs ont la liberté de reconduire ou non les sortants. Je crains que l'émergence progressive en France d'une haine et d'une défiance à l'égard de la représentation trouve dans ce dispositif un terreau qui les fasse prospérer.
Le temps long est en effet une nécessité et une garantie pour qu'un élu puisse mener des politiques de qualité. Or la nouvelle temporalité induite par votre proposition ferait peser le risque que ce dernier soit dans la seule recherche de la satisfaction à court terme de son électorat. La procédure de révocation pourrait conduire les élus à gouverner à vue avec un objectif principal : ne pas déplaire. Il s'agit, selon nous, d'une façon d'introduire le mandat impératif, contraire à notre Constitution et qui remettrait en question la liberté d'appréciation de l'élu, principe qui nous est cher.
Pour répondre à la désertion des bureaux de vote, on demanderait ainsi aux citoyens d'y retourner plus souvent…

…avec l'idée que le candidat qu'ils choisissent n'exercera pas nécessairement son mandat pendant cinq ou six ans. Est-ce le meilleur moyen de les inciter à bien peser leur choix ? Fonder un dispositif sur le doute à l'égard de l'engagement des élus est-il le meilleur moyen de redonner confiance dans les politiques et dans la politique ?
Il reste que des réponses à l'affaiblissement de la représentativité doivent être apportées. L'interdiction du cumul des mandats, que nous avons votée en 2014, participe pleinement de l'exigence que nous devons à nos électeurs, celle d'un mandat lisible, dénué de conflits d'intérêts, laissant au député toute latitude pour développer sur le territoire des outils de participation et d'association des citoyens – ateliers, jurys citoyens, référendum local.
Une réelle articulation du travail entre les élus locaux et nationaux – quelle que soit l'appartenance politique des uns et des autres – est également nécessaire. Il nous faut pour cela franchir l'obstacle posé par les gouvernements, jaloux de leurs prérogatives. Le contrôle in situ de l'application des textes que nous avons votés doit devenir une réalité. Pour cela, la loi doit nous aider à aller dans les préfectures, mais aussi dans les assemblées d'élus et dans les tribunaux.
Encore faut-il, pour conserver la confiance dans la démocratie délibérative, qu'il n'y ait pas un décalage monstrueux entre l'attente exprimée – je pense par exemple au grand débat ou à la Convention citoyenne pour le climat – et les décisions qu'elle suscite, du moins pas sans qu'une explication claire soit apportée et qu'un débat contradictoire ait lieu. La réponse politique peut ne pas coïncider avec ce que nous avons sous les yeux, mais la révocation n'est pas la solution.
Nul doute qu'il nous faut trouver des mécanismes pour améliorer la représentativité des élus et répondre aux attentes, en particulier celles de la jeunesse. Il est urgent de renforcer la responsabilité politique de l'Assemblée nationale. L'article 49 de la Constitution pose le principe de la responsabilité du Gouvernement et l'article 50 prévoit les cas dans lesquels il doit remettre sa démission, mais le fait majoritaire rend ces dispositions quasi inopérantes. C'est pourquoi nous devons travailler, dans le cadre d'une révision constitutionnelle prochaine, à la mise en œuvre d'une responsabilité individuelle des ministres devant l'Assemblée nationale. La procédure devrait être bien encadrée, mais elle serait de nature à changer le regard porté par l'exécutif sur le pouvoir législatif et celui des citoyens sur l'Assemblée nationale.
Vous l'avez compris, le groupe Socialistes et apparentés votera contre cette proposition de loi constitutionnelle.
Applaudissements sur les bancs du groupe SOC et sur quelques bancs du groupe Dem.

En tant qu'observateur de la vie politique, j'avais critiqué les niches parlementaires à l'époque où elles avaient été instituées. Depuis, j'ai changé de point de vue. Elles permettent en effet aux différents groupes d'endosser un autre rôle : en l'espèce, nous pouvons voir ce que le groupe La France insoumise a en magasin et passer ses propositions au crible de notre analyse critique, quitte à se montrer un peu sévère.
Monsieur le rapporteur, nous ne pouvons que vous suivre s'agissant de l'objectif visé par votre texte : remédier à la perte de confiance des citoyens et lutter contre l'abstention. Nous sommes tous d'accord, il est nécessaire de redynamiser notre système institutionnel. J'ai donc regardé avec intérêt et sérieux les dispositions que vous nous proposez d'adopter. Je vous rassure : je ne vais pas, d'où je suis – j'imagine que, pour certains, je suis un Montagnard du Marais, puisque je siège en haut de l'hémicycle –, ouvrir un débat de constitutionnalistes.
Sans entrer dans les aspects techniques de votre texte, permettez-moi de vous dire qu'il me laisse un peu perplexe. Vous proposez un système de révocation des élus sur initiative populaire qui permettrait, en cours de mandat, de se débarrasser d'un président de la République, d'un parlementaire, député ou sénateur, ou d'un élu local, à l'issue du premier tiers du mandat et avant sa dernière année. Mettons de côté le débat constitutionnel et faisons un peu de politique-fiction. Que se passerait-il si cette disposition entrait en vigueur ? Des battus quelque peu amers commenceraient, dès le lendemain de leur défaite, à rassembler les signatures qui leur permettraient, une fois écoulé le premier tiers du mandat de leur adversaire victorieux, de procéder à son éviction. Dès que cela serait possible, on chercherait à perturber l'agenda de l'élu.
Du côté de l'élu, votre dispositif ne serait pas non plus sans conséquence, reconnaissons-le. Il ferait tout pour essayer de plaire, au point de conduire nécessairement des politiques populistes ; ses choix ne seraient plus déterminés en fonction de l'intérêt public, ni même d'une opinion publique bien pensée, mais par la menace d'une potentielle procédure de révocation.
Une telle proposition n'est donc pas tout à fait sérieuse. Vous vous en défendez, mais vous cherchez en réalité à instituer le mandat impératif, qui contraint l'élu à ne faire que ce pour quoi il a été élu. D'ailleurs, selon quel fondement serait-il possible de révoquer un élu si vous n'instauriez pas, de fait, le mandat impératif ? Pour que votre proposition de loi constitutionnelle soit complète, il aurait donc fallu modifier l'article 27 de la Constitution, selon lequel « tout mandat impératif est nul ».
Exiger de l'élu qu'il ne fasse que ce qu'il a annoncé, c'est l'empêcher d'improviser ou de s'adapter à la réalité du moment. Dans ces conditions, que serait-il advenu durant la crise des gilets jaunes ou celle du covid, qui ne pouvaient être prévues au moment de la campagne électorale ?
Mme Sabine Rubin s'exclame.

Votre dispositif obligerait aussi à agir au rythme imposé par les procédures de révocation, toujours pendantes au-dessus de la tête des élus. Imaginez un instant comment fonctionnerait le pays ! La responsabilité de l'exécutif pourrait être mise en cause chaque jour, de même que le mandat des parlementaires, des élus régionaux, départementaux ou communaux. On connaîtrait de nombreuses élections partielles, des changements successifs de majorité… Cela conduirait-il vraiment à une meilleure participation, à moins d'abstention, à plus de confiance dans les institutions ? En réalité, nos compatriotes n'y comprendraient absolument plus rien.
On peut bien sûr chercher à améliorer la représentation, parler d'introduire la proportionnelle, vouloir une participation citoyenne renforcée ; on peut renforcer la probité des élus – beaucoup a été fait en la matière ; on peut vouloir accroître la connaissance de la chose politique et développer l'éducation. Mais la proposition qui nous est faite est irréaliste, idéaliste et, quelque part, surréaliste. Elle revêt quelques contours populistes au vu desquels le groupe Agir ensemble votera bien évidemment contre.
Applaudissements sur les bancs du groupe Dem et sur quelques bancs du groupe LaREM.

Cette proposition de loi constitutionnelle a un mérite majeur, celui de pointer du doigt le plus grand danger qui menace sans doute notre pays, au-delà même de ceux dont nous débattons régulièrement, comme le changement climatique : c'est tout simplement celui qui menace la démocratie. En effet, un nombre grandissant de nos concitoyens s'éloignent durablement du fait démocratique. Les élections législatives de 2017 ont été celles qui ont connu le plus fort taux d'abstention sous la V
Le quinquennat qui s'achève a sa part de responsabilité dans l'aggravation de cette crise démocratique. La situation est telle qu'un certain nombre de nos concitoyens n'ont même plus d'avis, d'envie ni de confiance dans notre système démocratique. Dans un ouvrage paru en 2017, Brice Teinturier appelait les « PRAF », comme « plus rien à faire, plus rien à foutre », ces personnes qui sont à ce point indifférentes qu'elles ne cherchent même plus à savoir si le régime démocratique est le meilleur ou, à défaut, le pire à l'exception de tous les autres.
Face à cette crise, il n'y a évidemment pas de solution unique. Ce n'est d'ailleurs pas le postulat que vous avez choisi de défendre. Comme beaucoup d'autres sur ces bancs, vous faites un certain nombre de propositions, de nature constitutionnelle ou non, pour tenter de contrecarrer le retrait de la vie politique et démocratique d'un nombre croissant de nos concitoyens.
Dans les cinq minutes qui me sont imparties, je ne pourrai pas évoquer les modalités techniques du dispositif proposé – pour lesquelles le texte renvoie d'ailleurs à une loi organique. Je m'en tiendrai donc aux principes. Nous ne pouvons pas soutenir la proposition de référendum d'initiative citoyenne de révocation des élus. La philosophie qui sous-tend ce texte nous ramène deux cent vingt ans en arrière, car le débat pour savoir si le suffrage universel, qui commande la démocratie représentative, peut ou non être mis en concurrence avec d'autres formes d'action politique et de représentation citoyenne, a déjà été tranché sous la Révolution française.

Avec cette proposition, vous mettez en cause le principe de représentativité, et donc la suprématie du suffrage universel. Le choix souverain des électeurs qui s'expriment à un instant T, que ce soit dans le cadre d'une élection locale ou de celle du Président de la République, pourrait ainsi être concurrencé, quelques années après, par le choix de quelques-uns d'appeler à révoquer un élu. Voilà qui fleure bon Robespierre et le Comité de salut public ! Mais cela n'a pas de sens dans notre vie démocratique, sauf si vous entendez remettre complètement en cause notre système de représentation, et par là même le suffrage universel. Par cohérence philosophique, vous pourriez d'ailleurs proposer, en plus de la révocation, un mode de désignation des représentants du peuple par tirage au sort.
Nous ne pouvons pas vous suivre non plus parce que, s'agissant des parlementaires, certains motifs de révocation seraient contraires à l'article 27 de la Constitution qui précise que tout mandat impératif est nul et que le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Il serait en effet contraire à ces dispositions de faire dépendre l'action d'un parlementaire et sa qualité de représentant du peuple de la décision d'un groupe, fût-il majoritaire, aux yeux duquel l'élu n'aurait pas fait correctement le travail pour lequel il a été choisi – par exemple faute de défendre suffisamment certaines thématiques issues de ce que l'on pourrait qualifier de nouveaux cahiers de doléances. Pour cette raison – une parmi d'autres –, le groupe UDI-I s'opposera à votre proposition.

Comme tant d'autres pays européens, la France connaît une crise démocratique majeure et souffre d'une défiance à l'égard du pouvoir politique et des élus. Le problème n'est pas nouveau mais il s'accentue d'année en année. Le fossé ne cesse de s'accroître entre les représentants du peuple et les citoyens qui les choisissent. La proposition de loi qui nous est soumise cherche à apporter une réponse à cette défiance. L'objectif est louable, et je souscris à titre personnel au principe. Toutefois, nous ne pensons pas que la solution proposée soit la plus adéquate, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, alors que notre démocratie souffre déjà de court-termisme, cette proposition de loi risquerait d'aggraver la situation. La gestion d'un État, comme celle d'une collectivité territoriale, qu'il s'agisse d'une commune, d'un département ou d'une région, nécessite de s'inscrire dans un projet de long terme. Or, avec la culture de l'immédiateté véhiculée par le système médiatique et les réseaux sociaux, les démocraties modernes souffrent d'une difficulté à construire des politiques publiques dans la durée, à rechercher le chemin de l'intérêt général. Le système électoral offre déjà des mandats relativement équilibrés, même si une réflexion plus poussée mériterait d'être menée sur le nombre de mandats que l'on pourrait successivement exercer. Personnellement, je suis ainsi favorable à les limiter à deux, à condition d'instituer un véritable statut de l'élu, pour rendre sa mission lisible et la sacraliser.
Aujourd'hui, le Président de la République et les députés sont élus pour cinq ans, tandis que les sénateurs et les différents élus locaux le sont pour six ans. Cela incite déjà les élus à passer une part importante de leur mandat à faire campagne au lieu de se concentrer sur l'exercice du mandat lui-même. Instaurer un droit de révocation des élus locaux risque d'aggraver la situation. En effet, par peur d'être révoqués, la priorité des élus sera de plaire immédiatement à leurs concitoyens et de chercher à gérer d'éphémères polémiques au lieu de se concentrer sur leur travail. Par ailleurs, l'instauration d'un droit à la révocation des élus dans les conditions prévues par la proposition de loi risquerait de conduire à l'institution de nouvelles élections intermédiaires au bout d'un tiers du mandat. En effet, les partis d'opposition s'uniraient pour obtenir les signatures nécessaires afin de déclencher la procédure, et l'élu en exercice, moins de deux ans après son élection, devrait se soumettre à un référendum dirigé contre lui. La réunion des signatures nécessaires serait d'autant plus facile si le pourcentage d'électeurs requis est faible. Votre proposition de loi constitutionnelle renvoie d'ailleurs à un décret le soin de le définir.
Enfin, cette mesure de révocation s'éloigne du souhait d'une démocratie plus participative. En effet, la démocratie participative passe par l'association directe des citoyens à la prise de décision, alors que la révocation des élus se concentre sur la personnalisation du pouvoir. Pour lutter contre la défiance, il convient de responsabiliser davantage les élus, en leur octroyant plus de moyens d'action et, bien entendu, en associant davantage les citoyens à la décision.
Reste que nous sommes d'accord : restaurer la confiance nécessite inévitablement une réforme constitutionnelle pour responsabiliser davantage les élus. La République doit selon nous se transformer en une République décentralisée et être dotée d'un Parlement renforcé. Le Parlement devrait être en mesure d'écrire véritablement la loi plutôt que de devoir simplement avaliser ce que le Gouvernement décide, comme cela est trop souvent le cas. Les collectivités territoriales, quant à elles, devraient se voir transférer de grands blocs de compétences, comme cela se fait dans tous les pays européens voisins, et être dotées d'une véritable autonomie fiscale et d'un pouvoir de décision. Nous croyons en effet que les décisions doivent être prises autant que possible à l'échelon le plus proche, conformément au principe de subsidiarité. En somme, il s'agit de responsabiliser davantage les élus et de rapprocher des populations les lieux et les circuits de décision. Selon nous, un parlementaire ou un élu local disposant de véritables pouvoirs et proche des citoyens ne susciterait pas la défiance, aujourd'hui imputable à son incapacité d'agir.
Enfin, il nous semble souhaitable de sortir de l'hyperprésidentialisme qui caractérise la V
En définitive, la confiance dans les élus est une question essentielle pour notre démocratie – laquelle est, vous avez raison, en bien mauvaise posture. Mais la confiance ne saurait se décréter en faisant planer une menace au-dessus des élus et en jetant sur eux une suspicion supplémentaire et généralisée. C'est pourquoi la majorité des membres du groupe Libertés et territoires ne soutiendront pas la proposition de loi.
Applaudissements sur quelques bancs des groupes LaREM et Dem.

La discussion générale est close.
Sur l'article unique de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe La France insoumise d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Alexis Corbière, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Vous l'aurez compris, nous avons pris le parti de vous présenter un texte dont les plus fins juristes parmi nos collègues ont noté qu'il pourrait être amélioré, car notre volonté était avant tout de discuter du principe.
Des arguments ont été avancés ; ils sont tout à fait respectables et méritent une réponse. Effectivement, il y a un désaccord philosophique et politique entre nous, et c'est peut-être ce qui fait la noblesse de ce débat. Certains collègues ont souligné que notre proposition de loi faisait de manière déguisée la promotion du mandat impératif, qu'ils ont consacré beaucoup de temps à critiquer. C'est absolument faux. La commission de Venise, qui s'est penchée sur les différents exemples d'application du droit de révocation, a d'ailleurs souligné que celui-ci était totalement distinct du mandat impératif. Cet argument ne tient pas.
Il faudrait d'ailleurs se mettre d'accord sur la nature du mandat confié à l'élu, au mandataire ou au représentant – la façon dont on le désigne a son importance sur le plan historique et politique. Durant la Révolution française, beaucoup préféraient le terme de mandataire, voulant marquer par là qu'un mandat était donné. D'ailleurs, vous tous, quand vous vous présentez, vous parlez de votre mandat, de la même façon que le Président de la République a un mandat. Si ce mot est utilisé dans le débat politique, c'est bien pour évoquer un engagement ; ce n'est pas un poste que l'on occupe, mais bien un mandat qui a été donné.
Mais s'il faut peut-être éviter tout mandat impératif, je suis tout autant opposé à ce que l'on pourrait appeler un mandat récréatif, qui consiste à faire ce que l'on veut !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Le garde des sceaux, avec la verve qu'on lui connaît, a dit en gros : « Corbière, si je vous écoute jusqu'au bout, c'est le peuple qui décide ». Eh oui ! Le peuple doit garder le contrôle.
Je récuse l'expression : « rétablir la confiance », car la confiance est un sentiment : en tant que républicain, ce sont des droits que je veux. La confiance sera rétablie dès lors que des droits seront acquis. Il s'agit donc moins de prétendre rétablir la confiance que de savoir quels droits nouveaux nous donnons aux citoyens pour qu'ils puissent contrôler les élus.
Pourquoi cela aggraverait-il la situation ? Pourquoi, quand nombre de nos concitoyens ne sont pas satisfaits par celui qui les représente, la possibilité d'un référendum révocatoire aggraverait-elle la situation ? Ne voyez-vous pas que nombre d'événements que nous avons vécus douloureusement au cours de la législature résultent du fait qu'un nombre significatif de nos concitoyens – voire une majorité, je le crains – considèrent que le système démocratique ne leur permet plus de se faire entendre et que les élus se sont détachés complètement de ceux qu'ils sont censés représenter ?

L'abstention pose un problème de fond auquel vous n'avez pas apporté de réponse. Pour éviter la polémique, prenons mon propre cas : je n'ai été élu que par 21 % des électeurs inscrits de ma circonscription. Et vous êtes dans la même situation ! Vous dénoncez le risque de donner le pouvoir à une minorité agissante mais comme moi, vous êtes élus par une petite minorité.

Plutôt que de se satisfaire d'avoir été désigné par une minorité, ne faudrait-il pas poser les conditions d'un retour du peuple vers les urnes ? Ne faudrait-il pas, pour convaincre les abstentionnistes de participer de nouveau à des élections, leur donner de nouvelles possibilités de le faire ?
Nous avons délibérément renoncé à déposer une loi organique afin de concentrer nos débats sur le principe même du référendum révocatoire. Imaginons que le seuil de déclenchement soit fixé à 20 %. Ce serait énorme, puisque c'est le score que vous avez sans doute obtenu pour vous faire élire. Nos concitoyens sont de braves gens ; personne n'a envie de s'amuser à convoquer en permanence des élections. Ce n'est donc pas par fantaisie que quelqu'un pourrait parvenir à convaincre 20 % des électeurs d'une circonscription de déclencher le processus de référendum révocatoire ! Cela signifierait simplement qu'une part significative de l'électorat, que vous jugez d'ailleurs suffisamment légitime pour vous envoyer à l'Assemblée nationale, souhaite replonger dans le bain du suffrage afin de savoir si celui ou celle qui la représente est vraiment légitime.
En quoi cela aggraverait-il la situation ? Cela ne ferait au contraire que l'améliorer, lui redonner un caractère vertueux, poser les conditions pour que les décisions prises le soient bel et bien au nom du peuple.
Je m'inquiète que certains d'entre vous disent : « Il faut que nous puissions prendre des décisions difficiles, des décisions courageuses. » Ce champ sémantique, que signifie-t-il ? Que nous devrions pouvoir gouverner contre le peuple. Eh bien, je ne suis pas d'accord.
Vous nous taxez de démagogie,…

…mais voyez à quoi nous en sommes arrivés : ici, dans le temple de la République, des députés affirment que l'avantage de nos institutions, c'est qu'elles nous permettent d'agir même si le peuple n'est plus d'accord avec nous. C'est intellectuellement terrifiant !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

« Cela fleure bon le Comité de salut public », dites-vous. La belle affaire ! Et je serais un Marat de carton-pâte ? M. Larrivé ayant de surcroît évoqué la mémoire de Lepeletier de Saint-Fargeau, voilà donc deux députés assassinés à coups de poignard par des ennemis de la République. Préférant être du côté de Jean-Paul Marat et de Lepeletier de Saint-Fargeau plutôt que de ceux qui assassinent des députés, je suis fier, au fond, d'être comparé à ceux qui ont cherché à assurer la souveraineté populaire.
C'est un faux débat. De tels arguments n'ont pas de sens. Il y aurait eu des morts pendant la Révolution française ? Oui, comme il y en a eu pendant tous les siècles de monarchie et encore après. Adolphe Thiers a massacré plus de 27 000 communards ; un tableau le célèbre pourtant dans une salle proche de l'hémicycle, que personne ici n'a jugé nécessaire de faire retirer.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Oui, l'histoire de France a été tragique mais au cœur de la Révolution française il y a eu un débat passionnant : comment la souveraineté populaire s'exprime-t-elle ? Comment faire en sorte, dans un système représentatif, que les décisions ne soient pas prises en brutalisant la volonté populaire, mais dans un lien vivant avec elle ? La crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui est, je le répète, particulièrement inquiétante.
M. le ministre, qui est parti, a dit : « Avec votre système, au bout de six mois on peut être révoqué. » Il aurait dû lire le texte : le processus ne pourrait être lancé qu'au bout d'un tiers de mandat, soit environ dix-huit mois. Surtout, il affirme que les élections intermédiaires sont l'occasion de vérifier que tout se passe bien. Comme le garde des sceaux est un homme robuste, qui aime bien la polémique, je voudrais souligner l'arrogance de cette réponse, sachant qu'il n'a lui-même obtenu, aux élections régionales, que 9 % des voix recueillies auprès de 30 % des électeurs, c'est-à-dire 2 %,…
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Et il se permet de venir parader ? Des ministres ayant fait le choix de se présenter devant les électeurs n'obtiennent que des scores quasi résiduels,…

…et on n'en tire aucune conclusion, personne n'est débarqué du Gouvernement ? Comment voulez-vous que les électeurs les prennent au sérieux ? Collègues, ça ne va pas, cela suscite du dégoût, de la colère. Pourquoi tous ces ministres ont-ils jugé bon de se présenter aux élections régionales ? Pour un poste ? J'espère que non. Je vous connais, madame la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, vous êtes une femme désintéressée ; vous y êtes allée sans doute pour vérifier auprès des électeurs que votre politique recueillait un soutien populaire. Vous, comme d'autres, n'avez obtenu que 9 % de seulement 30 % de gens mobilisés,…
Moi, j'ai été élue !

…et vous n'en avez tiré aucune conclusion. Pas un seul ministre n'a changé. La politique n'a pas changé.
Nous sommes face à un blocage, à un pourrisssement de la situation.
Vous avez évoqué la loi « confiance », le grand débat national qui a fait suite à la crise des gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat. Cette dernière est un exemple intéressant. Vous n'avez retenu aucune de ses conclusions,…

…ou du moins, vous n'en avez retenu qu'une petite minorité. Le Président de la République s'était engagé à les reprendre « sans filtre », à l'exception de trois mesures. Il faut croire qu'il a décidé de mettre un sacré filtre,…

…vu que, hormis quelques mesures, il n'a retenu aucune de ses conclusions.

Collègue, soyez modeste. Ce que je suis en train de dire est la vérité.

Quand vous dites des choses fausses, on réagit, c'est tout ! On ne va pas refaire le débat !

Il n'est pas exact que l'ensemble des décisions de la Convention citoyenne sur le climat aient été retenues. Cela a été utilisé comme un argument à cette tribune il y a quelques minutes pour dire que c'était la preuve que vous aviez fait ce qu'il fallait pour rétablir la confiance. J'affirme que c'est faux.
Je balaie quelques arguments…

…parce qu'à chaque fois que vous prenez la parole, je pourrais vous en dire autant. Plutôt que d'être insultant, ce qui ne vous honore pas, vous devriez réfléchir aux outils démocratiques permettant d'éviter que nos échanges ne prennent ce côté blessant.
Les dispositions que je vous propose existent dans certains pays qui n'ont pas pourtant pas connu le chaos que vous décrivez. Elles permettent des respirations démocratiques plus intéressantes et font du citoyen un acteur respecté de la vie publique, plutôt que de ne le laisser intervenir que tous les cinq ans.
Tout à l'heure, il a été dit que nos propositions avaient un caractère populiste. Nous devons d'ailleurs à notre collègue Euzet une impressionnante collection de mots en « istes » : idéaliste, irréaliste, surréaliste, populiste… Mais on touche le fond du sujet et j'en viens à ce qui sera peut-être une conclusion.
« Ah ! » sur plusieurs bancs des groupes LaREM et Dem.

Ce mot que vous jugez insultant, populiste, je vais le reprendre à mon compte. Que signifie-t-il ? Que l'on veut vérifier, quand on a l'honneur d'exercer un mandat, que nous restons des représentants du peuple, que nous ne le mettons pas à distance, que nous ne voulons pas agir contre lui ? Dans ce cas, populiste, oui, je le suis. Je préfère l'être qu'être « populophobe » ,
Applaudissements sur les bancs du groupe FI. – Exclamations sur les bancs des groupes LaREM et Dem

comme certains se revendiquent, et à se satisfaire d'institutions qui continuent de tourner alors même qu'elles ne rassemblent plus qu'une minorité de gens.
Un président de la République, François Hollande, avait même dit que ce qu'il y a de bien dans la V
Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LaREM et Dem.

…doit trouver une réponse pacifique, démocratique. S'il faut davantage se rendre aux urnes pour vérifier que vos décisions, que nos propositions recueillent une adhésion populaire, nous le ferons. Ce qu'il y a de vertueux quand on convoque le peuple aux urnes, c'est qu'on cherche à convaincre, qu'on fait campagne, et pour cela il faut des programmes, il faut du temps pour que les programmes circulent. J'en profite pour dire à nos collègues du groupe La République en marche – à bon entendeur salut –, il est temps que le Président de la République se déclare candidat,…

Il fait ce qu'il veut ! Il choisit son agenda comme il veut, comme vous choisissez le vôtre comme vous voulez !

…parce que la manière dont il se dissimule dans une non-candidature est aussi une façon de mépriser nos institutions. On ne prend pas le peuple par surprise mais par les idées !
Vifs applaudissements sur les bancs du groupe FI.

J'appelle maintenant l'article unique de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été initialement saisie puisque la commission n'a pas adopté de texte.

Cet article prévoit la révocation des élus, Président de la République, députés, sénateurs, maires et autres élus locaux, par référendum d'initiative populaire. Couramment appelé le RIP, celui-ci a pour but de rendre la parole au peuple. En effet, le peuple est titulaire de la souveraineté et doit pouvoir révoquer les représentants qu'il a élus dans des conditions à définir.
Pourquoi est-ce nécessaire ? Premièrement, pour redonner aux citoyens le goût à la politique. Nous ne pouvons pas, sans agir, constater que les électeurs boudent de plus en plus les urnes.
La confiance est rompue car trop souvent nous constatons des manquements de la part des élus. Le peuple n'est pas dupe s'agissant des élus ou groupes d'élus : ceux qui, corrompus, échappent à la justice, ceux qui sont lourdement condamnés mais restent en poste, ceux qui ne respectent pas leur programme, ce pour quoi ils ont été élus, ceux qui ne respectent pas la liberté et la dignité des gens, ceux qui abusent de leur pouvoir, ceux qui n'exercent pas leurs fonctions mais empochent des indemnités… Nous en avons des exemples.
Inventer un mode de révocation de l'élu sera un moyen de rendre la fonction plus noble et de faire revenir les électeurs dans l'isoloir. Cela permettra de faire fuir ceux qui sollicitent un mandat pour servir d'autres intérêts que celui du peuple. Voter cet article, c'est donc faire preuve de responsabilité.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Je vous demande de ne pas avoir peur du peuple. Veuillez excuser ma franchise.
Mêmes mouvements.

Dans votre propos, monsieur Corbière, vous avez parlé d'un sujet que le groupe Démocrates trouve très important. Vous avez parlé de la responsabilité du peuple, qui doit en effet être placée en parallèle de la responsabilité de l'élu s'agissant des décisions qu'il a à prendre. Oui, monsieur Corbière, c'est le peuple qui décide, nous sommes entièrement d'accord, mais une démocratie, ce sont des institutions, des règles, qui doivent permettre la décision et cette prise de responsabilité du peuple.

Avec ce que vous nous proposez, on sort de l'État de droit et on entre dans une ère de l'incertitude.

Comment pouvez-vous dire cela, avec toutes les dispositions que vous avez votées qui restreignent les libertés publiques ?
Mme Danièle Obono proteste.
Exclamations sur les bancs du groupe FI.

Chers collègues, s'il vous plaît, veuillez écouter l'orateur. C'est le moindre des respects qu'on lui doit.
Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et Dem.

Les propos de M. Corbière étaient intéressants car ils montrent deux visions de ce que peut être la démocratie. La nôtre consiste à donner toutes les clés au peuple pour assainir le débat public, adopter une démarche sereine et constructive. Quant à vous, vous êtes à chaque instant dans la confrontation.
Protestations sur les bancs du groupe FI.

Je conclurai par les mots d'un philosophe, qui est aussi une personnalité politique chère à notre démocratie :…

…pour lui, comme pour notre groupe, la démocratie est « l'organisation sociale qui tend à porter au maximum la conscience et la responsabilité civique de chacun.
Exclamations sur les bancs du groupe FI.

Nous avons achevé l'examen de l'article unique de la proposition de loi.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 89
Nombre de suffrages exprimés 89
Majorité absolue 45
Pour l'adoption 16
Contre 73
L'article unique n'est pas adopté, non plus que l'ensemble de la proposition de loi.


La parole est à Mme Bénédicte Taurine, rapporteure de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

Comme mon collègue François Ruffin la semaine dernière en commission, je commencerai mon intervention, chers collègues, en vous invitant à deviner les auteurs de deux citations : « Nos concitoyens ont le sentiment que les sociétés d'autoroutes se goinfrent sur leur dos. » ; « Le concédant, ou plutôt l'usager, […] paie tous les risques. »
C'est vous qui avez prononcé la première, monsieur le ministre délégué chargé des transports, quand vous étiez député. Vous étiez alors encore relativement libre de vos paroles et vous souhaitiez renationaliser les autoroutes !
La seconde est extraite d'une déclaration de Bernard Roman, également ancien député et désormais président de l'Autorité de régulation des transports (ART).
Pourquoi le groupe La France insoumise considère-t-il que les contrats autoroutiers sont source de dysfonctionnements et qu'il faut nationaliser les sociétés concessionnaires ? Rappelons rapidement qu'au début de l'histoire des autoroutes, le législateur a eu la perspicacité de confier leur exploitation à des sociétés d'économie mixte (SEM) détenues par la Caisse des dépôts et consignations et par les collectivités territoriales intéressées. Je ne m'attarderai pas non plus sur le fait que la brève expérience de gestion privée conduite entre 1970 et 1983 s'est soldée par un échec, lequel a mené la puissance publique à racheter le capital des délégataires.
Il y a vingt ans, pour des raisons discutables – un désendettement modeste et immédiat, au prix de la renonciation à des dividendes publics et à des leviers de contrôle – et dans des conditions peu maîtrisées, les gouvernements Jospin, Raffarin et Villepin ont réduit, puis intégralement cédé, les participations de l'État dans les sociétés concessionnaires dites historiques, tandis que les participations dans les sociétés concessionnaires dites récentes étaient d'emblée attribuées à des personnes privées.
Ces opérations ont rapporté 16,5 milliards d'euros à l'État, soit un manque à gagner de 6,5 milliards d'après le Sénat, et ont placé trois groupes du bâtiment et des travaux publics en position de force. Rappelons, en effet, que treize des dix-sept sociétés concessionnaires privées appartiennent à Vinci, Eiffage ou l'entreprise espagnole Abertis. La fin des concessions devrait intervenir entre 2031 et 2036, certains contrats courant même jusqu'à 2086, mais, jusqu'à présent, l'exécutif a eu la fâcheuse tendance de les rallonger à chaque réforme, de sorte que leur horizon est de plus en plus brumeux.
Ce paysage ayant été brossé, je veux évoquer maintenant la principale dérive des sociétés d'autoroutes, qui est de s'enrichir sur le dos de l'État, des usagers et des contribuables. J'approuve les commentaires de l'Autorité de la concurrence et de la Cour des comptes, qui ont jugé « exceptionnelle » la rentabilité des sociétés concessionnaires. Avec un taux de redistribution des dividendes souvent proche de 100 %, Vinci et Eiffage ont déjà plus que recouvré leur mise initiale et Abertis s'achemine vers la même réussite. Les bénéfices escomptés par ces entreprises d'ici à une quinzaine d'années sont démesurés, et ce pour quatre raisons.
Tout d'abord, comme l'a relevé l'Autorité de la concurrence et contrairement au principe même de la concession, les sociétés concessionnaires n'assument pas de véritable risque : l'évolution du trafic est favorable, les contrats excluent toute baisse du prix des péages et, nous l'avons vu en 2020, la perte d'un dixième de leurs recettes due à l'absence de trafic n'a nullement entamé les bénéfices de ces sociétés.
Deuxièmement, le tarif des péages progresse de manière automatique, non seulement parce qu'il va plus vite que l'inflation, comme l'a dénoncé la Cour des comptes en 2013 et comme l'ont vérifié récemment les associations d'usagers, mais aussi parce qu'il retient toujours l'indice le plus dynamique pour le coût des travaux, contrairement aux recommandations de 1'INSEE et de la Commission européenne.
Troisièmement, à rebours du bon sens et des préconisations du Conseil d'État, les groupes qui possèdent la plupart des sociétés concessionnaires ont obtenu que soit compensée toute augmentation éventuelle des deux impôts qui les frappent spécifiquement. Ils pourront également conserver la jouissance de certaines niches fiscales que les pouvoirs publics avaient tenté en vain de nettoyer.
Enfin, les conventions et leurs avenants sont muets quant aux obligations sociales des entreprises alors que les aménagements de parkings ou l'installation de télépéages sont considérés comme des « opérations environnementales ».
On le voit bien, il faut agir et agir rapidement, d'où notre proposition de racheter les sociétés concessionnaires pour qu'elles n'obéissent plus aux intérêts des actionnaires des grands groupes, qui se les sont d'ailleurs accaparés, mais à l'intérêt général.
Cette nationalisation est-elle possible ? En réalité, elle est prévue par les contrats de concession eux-mêmes et s'inscrit dans la solide jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Il existe, en effet, un principe constitutionnel supérieur à toute loi et à toute clause de contrat, qui interdit aux personnes publiques de consentir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi, ainsi que l'a rappelé M. Paul Cassia, professeur de droit public. De même, le Conseil d'État a rappelé que l'indemnité au titre des investissements n'était due que si les biens n'avaient pas pu être amortis pendant la période d'exécution du contrat.
Fort du constat du déséquilibre financier des concessions autoroutières aux dépens des comptes publics et du portefeuille des usagers, déséquilibre dénoncé par l'ensemble des groupes politiques, si j'en crois les positions qui se sont exprimées lors de l'examen de la proposition de loi en commission des finances, l'exécutif aurait dû décider la rupture anticipée des contrats. Mais l'autorité réglementaire ne s'en préoccupe pas, d'où la nécessité de cette proposition de loi.
Quel serait le coût d'une nationalisation des sociétés concessionnaires ? Monsieur le ministre, vous évoquez le chiffre de 47 milliards d'euros, mais vos services affirment n'avoir jamais été chargés de travailler sur le sujet. En outre, un ancien ministre de l'économie, désormais Président de la République, avançait un montant de 20 milliards. Dans mon rapport, je montre que la dépense pourrait être réduite à 15 milliards tout au plus, certaines sommes ayant déjà été payées deux fois par les Français et n'ayant donc pas vocation à être intégrées dans la compensation versée à Vinci, Eiffage et Abertis.
En conclusion, pour mettre un terme aux profits scandaleux des sociétés d'autoroutes, pour soutenir un aménagement du territoire plus écologique et plus juste et pour donner suite à la revendication de nombre de nos concitoyens, notamment les gilets jaunes, prisonniers de ces monopoles de fait, il convient de modifier radicalement l'application des clauses des concessions en transférant à l'État les actions des sociétés concessionnaires, sans attendre, comme vous le préconisez, la fin des contrats, sans cesse prolongés sous divers prétextes.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et GDR.
Permettez-moi, tout d'abord, mesdames et messieurs les députés, de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Avant de discuter plus en détail de la proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui, je veux vous dire que je trouve sain que nous débattions de l'avenir des concessions autoroutières. La citation que me prête Mme la rapporteure a été un peu raccourcie, mais je me félicite de ce débat. Ce n'est évidemment pas la première fois que le Parlement s'empare du sujet, car les autoroutes font partie de la vie des Français : elles font partie de leur quotidien, de leurs déplacements, de leur paysage ; ils les empruntent pour se rendre au travail, pour rejoindre leur famille, pour faire leurs courses ou pour partir en vacances. C'est parce qu'elles sont si ancrées dans leur vie, si indispensables à leur mobilité, si importantes pour nos territoires, qu'elles méritent un débat exigeant. Elles méritent mieux, en tout cas, que des raccourcis et des idées simplistes.
Tout d'abord, il faut le rappeler, nos autoroutes sont un modèle de modernité, de confort et de sécurité, notamment grâce au professionnalisme des agents de l'État dans le suivi et le contrôle des concessions, grâce aussi, il faut le reconnaître, au modèle des concessions. Ce modèle n'est peut-être pas parfait, mais, sans lui, notre pays n'aurait pas le même visage et la mobilité de nos concitoyens serait probablement bien différente.
Créé par la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, le modèle des concessions a permis de développer un réseau de routes de plus de 9 000 kilomètres, à un rythme qui n'aurait pas été possible autrement. Il a généré plus de 50 milliards d'euros de recettes fiscales entre 2006 et 2018 et permis d'investir 20 milliards dans le patrimoine autoroutier. Par ailleurs, la privatisation des sociétés concessionnaires historiques a contribué à diminuer la dette de l'État, à renforcer l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et à financer de nouvelles infrastructures.
Aucun calcul ni aucune analyse ne démontrent de manière robuste la sur-rentabilité des sociétés concessionnaires. De nombreux chiffres circulent, mais ils sont souvent erronés car le modèle économique de ces sociétés se caractérise par des investissements très importants par rapport aux autres coûts d'exploitation. L'ART, que vous avez citée, madame la rapporteure, a estimé, dans son rapport de juillet 2020, qu'il n'y avait pas de surprofits des concessionnaires. En 2015, le groupe de travail parlementaire sur l'avenir des autoroutes avait abouti à la même conclusion.
Cela ne doit pas nous empêcher de repenser ce modèle, bien au contraire. Vous le savez, les contrats actuels prendront fin entre 2031 et 2036. C'est donc l'occasion de dresser un bilan critique de notre modèle de financement et de gestion des infrastructures, sans complaisance ni démagogie. C'est aussi l'occasion de réfléchir à comment faire mieux, au bénéfice des Français, sans sacrifier ni la sécurité ni la qualité de nos autoroutes.
Il est une idée que, je crois, nous partageons tous : il s'agit de la nécessité de mieux encadrer les contrats. En la matière, l'année 2015 a marqué une étape décisive. Le plan de relance autoroutier et la loi, dite Macron, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que vous avez aussi mentionnée, ont permis de rééquilibrer les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA). Un dispositif limitant les surprofits éventuels a été introduit dans les contrats historiques : en cas de surprofit, les tarifs des péages sont revus à la baisse ou la durée de la concession est réduite. Par ailleurs, l'État récupère toutes les économies réalisées par les SCA sur les investissements, résultant de décalages dans le calendrier ou d'abandons de projets. Enfin, une autorité de régulation strictement indépendante en matière autoroutière a été créée : l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), devenue depuis l'ART. Celle-ci produit annuellement une synthèse des comptes des sociétés concessionnaires et, tous les cinq ans, un rapport sur la rentabilité des contrats – le premier a été publié à la fin du mois de juillet 2020.
En matière de transparence, enfin, depuis 2009, le Parlement est chaque année destinataire d'un rapport sur l'exécution et le contrôle des contrats de concession d'autoroutes et d'ouvrages d'art, et d'un autre sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. En outre, la loi de 2015 a imposé la mise à disposition du public, par voie électronique, des contrats autoroutiers.
Nous avons progressé, donc, mais nous pouvons faire mieux et nous devons nous projeter, anticiper et réfléchir à l'avenir des contrats de concession. Des réflexions ont été lancées conjointement par mon ministère et le ministère de l'économie, des finances et de la relance. L'État a d'ores et déjà engagé un travail d'inventaire, précis et consensuel, des biens de retour des concessions. Mais ce travail doit également se faire à l'aune des impacts de la crise sanitaire, à l'occasion de laquelle les risques liés à la baisse du trafic se sont d'ailleurs concrétisés.
Plusieurs pistes sont sur la table et les parlementaires, les élus et les acteurs concernés seront naturellement associés à ces travaux. Pour ne rien vous cacher, madame la rapporteure, la piste défendue par le groupe La France insoumise ne fait pas partie de celles qui sont envisagées,…
…et ce pour une raison simple : si nous sommes partiellement d'accord s'agissant du constat dressé, nous sommes en désaccord quant à la solution proposée qui, d'après votre groupe, serait évidente – il faudrait, dites-vous, interrompre les contrats avant leur terme.
Mais ce n'est pas une solution ; il en résulterait en effet une dépense extraordinairement onéreuse pour les dépenses publiques, puisque dans un tel cas de figure, les contrats prévoient que les concessionnaires auront droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, soit 47 milliards d'euros. Et ce n'est pas une solution parce que l'État – l'État au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables – n'a pas intérêt à racheter à ce prix exorbitant des concessions qui lui reviendront de toute façon dans dix ans – et à l'échelle de la durée des concessions, 2031, c'est demain. Ce n'est pas non plus une solution parce que cela accroîtrait notre dette publique du montant des dettes des sociétés concessionnaires, qui représentaient près de 30 milliards d'euros à la fin de 2017. Très franchement, je crois que nos finances publiques n'ont pas besoin de cela, en particulier dans le contexte de crise actuel.
Surtout, ce n'est pas une solution parce que cela ne bénéficierait probablement pas aux usagers. Non, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, un rachat des concessions ne garantit ni la disparition des péages ni la baisse de leur prix pour les Français. Voilà la réalité ; voilà les faits.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à la proposition de loi.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe Dem.

Thierry Breton, Bruno Le Maire, Dominique de Villepin, Élisabeth Borne, Alexis Kohler, Emmanuel Macron. Qu'ont en commun toutes ces personnes ? Ils ont organisé ensemble, par leur incompétence ou par leur malveillance, le pillage des autoroutes de France. Ils ont transformé les automobilistes en vaches à lait de la SANEF – Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France –, d'Eiffage et de Vinci. Ils ont fait perdre 15 milliards d'euros à l'État français – j'insiste : 15 milliards.
Qu'on imagine un salarié, un cadre ou une caissière qui ferait perdre à sa boîte 10 000 euros, 100 000 euros, parfois juste un bifteck ou même un crayon à papier, voire un bon d'achat : cet employé-là serait convoqué devant sa direction, aurait droit à un conseil de discipline et risquerait le licenciement pour faute. Mais ces gens-là, Breton, Le Maire, Villepin, Borne, Kohler et Macron, quand furent-ils sanctionnés pour ce pillage géant ? Jamais ! Quand furent-ils poussés devant une arène, un tribunal, pour se justifier et s'expliquer ? Jamais ! Quand a-t-on prélevé, sur leurs comptes en banque, des millions pour réparer leurs fautes ? Jamais !
Au contraire – et c'est le plus formidable, le plus extraordinaire –, depuis, ils ont obtenu une promotion ! Ils sont devenus ministre, commissaire européen, secrétaire général de l'Élysée ou même Président.

Ils ont dilapidé l'argent public, ils y ont mal veillé ; et pourtant, on leur a laissé le carnet de chèques.
Il faut revenir rapidement sur l'histoire de ce désastre. C'est de Bercy, du ministère de l'économie et des finances, qu'est partie « cette idée sublime qui était de privatiser les autoroutes », comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin avec ironie. Mais des hommes politiques d'alors ont résisté, et je veux les citer sans sectarisme, pour éviter le « tous pourris ». Gilles de Robien, ancien maire d'Amiens, à l'époque ministre des transports, raconte : « Chaque ministre des finances […] me reçoit, avec à ses côtés toujours le même conseiller, partisan de la privatisation des autoroutes. On m'explique qu'il faut vendre les autoroutes parce que ça fera baisser la dette de l'État. Mais j'avais [fait] réaliser une étude […]. Elle concluait que les autoroutes étaient une manne financière pour l'État. C'est comme ça que j'ai pu résister à Bercy. Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, a tranché en ma faveur. »
Mais une fois Raffarin parti de Matignon, Bercy est venu prendre sa revanche. Et les autoroutes ont été soldées, en 2006, à Vinci et compagnie, pour une somme sous-évaluée de 10 milliards d'euros. Dix milliards d'euros en moins ! Et les dividendes ont plu sur les actionnaires. C'est la première gabegie, venue de la droite et dénoncée par des rapports – contrairement à votre déni, monsieur le ministre délégué – émanant de la Cour des comptes, du Sénat et de l'Assemblée, concluant à la « rentabilité exceptionnelle » des autoroutes, « assimilable à une rente ».
Qu'a fait la gauche, à son retour au Gouvernement ? Elle y a ajouté une deuxième couche. Élisabeth Borne, qui a travaillé chez Eiffage en tant que directrice des concessions et qui y a conservé des amitiés, Élisabeth Borne, donc, est chargée de renégocier avec les sociétés d'autoroutes, dont Eiffage. On imagine que le dialogue ne fut pas trop tendu. Accompagnée d'Alexis Kohler, elle propose un « protocole d'accord » qui s'est à nouveau révélé désastreux pour l'État.
Je veux ici, une fois encore, ne pas jeter tous les dirigeants dans le même sac : Alain Vidalies, alors secrétaire d'État chargé des transports, refuse de signer le protocole d'accord. Emmanuel Macron, quant à lui, le signe ; il en est tellement fier qu'il va tout faire, durant quatre ans, pour le maintenir secret. Et il faudra une bataille judiciaire, un avis du Conseil d'État, pour que le contenu en soit révélé. Que prévoit-il ? Un allongement de la durée des concessions de dix ans, des tarifs de péage en hausse et même, pour l'État, une interdiction de relever les taxes sur les entreprises concernées, soit un cadeau estimé, cette fois, à 5 milliards d'euros – ce qui fait, en tout, une fois ajoutés les 10 milliards déjà évoqués, 15 milliards.
Le bilan, c'est un gavage gigantesque et formidable des sociétés autoroutières et de leurs actionnaires ; ce sont des milliards, des dizaines de milliards qui manquent pour une transition des transports, pour le fret ferroviaire et pour les lignes du quotidien. Le bilan, ce sont des péages qui, pour tous, pour le Français moyen, augmentent plus vite que l'inflation – la hausse devrait atteindre 2 % en février. Allez-vous, monsieur le ministre délégué, valider ou non cette hausse prévue ?
Alors, que peut-on faire ? Rien, rien, nous répond-on : avec ce contrat, l'État s'est lié les mains. Vous nous dites que vous refusez notre solution, mais, monsieur le ministre délégué, vous n'en avez proposé aucune !

Je vois trop, derrière vos airs navrés – « on ne peut rien faire » –, derrière vos faux regrets, votre complicité. On ne peut rien faire ? Si ! Si, nous pouvons encore, nous pouvons toujours : nous pouvons rompre ce contrat ou le renégocier, mais vous ne voulez pas. Et même pire ! Depuis que vous êtes au pouvoir, ce scandale des autoroutes n'a pas servi de leçon. Vous avez poursuivi la grande braderie en livrant aux financiers nos trésors nationaux : La Française des jeux, les aéroports, Engie. Et vous permettez même, désormais, que des routes nationales soient privatisées ; vous en ouvrez la possibilité. Une à une, vous offrez à vos amis nos poules aux œufs d'or.
En vous finançant, les riches et les actionnaires n'ont pas fait un don : ils ont fait un investissement, et j'espère que les Françaises et les Français ne confieront plus le pouvoir à des hommes qui font le choix de l'argent plutôt que celui des gens.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et GDR. – Mme Christine Pires Beaune applaudit également.

Pour certains d'entre nous, elles sont inévitables ; elles sont parfois synonymes de vacances, mais pour d'autres, il s'agit d'une corvée. Je ne parle pas de venelles mais bien sûr des autoroutes, que des millions de nos concitoyens empruntent quotidiennement. C'est leur caractère inévitable qui rend notre débat du jour absolument indispensable. La demande de nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes n'est d'ailleurs pas un sujet nouveau, car depuis la cession, en 2005, de l'ensemble des participations publiques détenues par l'État, la rente accumulée, les dividendes distribués aux actionnaires, constituent un véritable scandale d'État ; un scandale d'État que les parlementaires communistes n'ont eu de cesse de dénoncer ces dernières années. Nous avions déposé, dès 2014, une proposition de loi exigeant la renationalisation des sociétés concessionnaires, proposition renouvelée en février 2019 puis défendue en mars de la même année au Sénat par le groupe CRCE – communiste, républicain, citoyen et écologiste.
Il ne surprendra donc personne que nous soyons favorables au vote de ce texte, d'autant que ces dernières années, le front de ceux qui dénoncent ce scandale financier s'est largement et inéluctablement élargi. Même la Cour des comptes et l'Autorité de la concurrence n'en peuvent plus des offrandes de l'État à une poignée de sociétés qui s'arrogent tous les pouvoirs, depuis les modalités des concessions jusqu'aux travaux effectués sur le réseau.
En l'état actuel, vingt concessionnaires, contrôlés majoritairement par trois grands groupes industriels, sont en effet chargés d'exploiter et d'entretenir les 9 200 kilomètres d'autoroutes que compte la France métropolitaine. Si leur privatisation a permis à un petit nombre de développer un business juteux, elle a des conséquences catastrophiques pour l'intérêt général. Elle a asséché le financement des programmes d'infrastructures de transports en les privant des dividendes résultant de l'exploitation des sociétés d'autoroutes. On estime à 37 milliards d'euros la somme qu'auraient pu rapporter à l'État les sociétés d'autoroutes entre 2006 et 2032 ; cela représente 1 à 2 milliards d'euros par an de pertes, et ce sans compensation. De l'autre côté – c'est le revers de la médaille –, la privatisation a offert à des entreprises du BTP – bâtiment et travaux publics – une situation de quasi-monopole, qui leur offre une rente exceptionnelle sur le dos des usagers.
De plus, la hausse des tarifs, que subissent régulièrement ces usagers, ne suit pas les investissements consentis par l'État sur le réseau. Des avenants ont été signés en 2017 ; ils prévoyaient 800 millions d'euros d'investissements, moyennant une hausse de 0,4 % des péages entre 2018 et 2020 et une participation des collectivités territoriales. L'ARAFER a jugé que les « augmentations des tarifs de péages prévues excèdent le juste niveau qu'il serait légitime de faire supporter aux usagers. »
Tandis que l'État se serre la ceinture et finance, les usagers mettent la main à la poche, et ce sont les sociétés d'autoroutes qui s'en mettent plein les poches. En 2019, les sociétés d'autoroutes françaises avaient un chiffre d'affaires annuel de près de 11 milliards d'euros, contre 8 milliards deux ans avant. Et elles distribuent quelque 3 milliards d'euros de dividendes chaque année à leurs actionnaires ! Ces chiffres parlent d'eux-mêmes.
L'argent que ces sociétés ont mis sur la table pour obtenir les concessions est déjà presque remboursé : la rentabilité des contrats sera atteinte dès cette année pour Vinci, Eiffage et leurs filiales, soit dix à quatorze ans avant l'expiration des contrats ! La politique tarifaire n'est en aucun cas guidée par les principes de service public et de service à l'usager, mais bien par une stratégie commerciale de profit maximal.
La seule solution et la seule option viable pour faire cesser une telle dérive, c'est de racheter les contrats de concessions. S'il est difficile, certes, d'estimer le coût d'un tel rachat – au total, une fourchette haute de 50 milliards d'euros est souvent avancée –, depuis des années, nous proposons des solutions de financement et des pistes de réflexion, sur lesquelles je ne reviendrai pas par manque de temps. Elles sont sur la table ! Notre responsabilité de parlementaires, attachés à l'intérêt général, devrait nous inviter à voter ce texte en urgence, plutôt que de persévérer à justifier et à être complices des manipulations financières de ces grands groupes qui coûtent si cher aux Français et à l'État.
C'est ce que fera le groupe GDR et nous vous invitons donc, chers collègues, à faire vôtre cette proposition de loi, que je qualifierais de salutaire.
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR, SOC et FI.

La présente proposition de loi prévoit, comme seule et unique mesure, la nationalisation des seize sociétés concessionnaires d'autoroutes. Or est-il judicieux, pour l'État, d'effectuer une telle opération de rachat ? Voilà la seule question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, et notre réponse est non.
D'abord, les conséquences en seraient tout simplement considérables pour nos finances publiques. Le rachat de ces sociétés à capitaux privés serait extrêmement coûteux pour l'État, non seulement en raison du prix du rachat mais également parce qu'il devrait indemniser le préjudice subi du fait de la résiliation des contrats de concession. Les estimations fluctuent entre 45 et 50 milliards d'euros, mais l'État devrait également reprendre les dettes inscrites au bilan de ces sociétés, soit près de 30 milliards.

Chacun mesure donc l'impact financier engendré par une telle opération qui, à ce jour, n'a fait l'objet d'aucun chiffrage précis. En comparaison, son coût représenterait plus de la moitié de celui du plan de relance de 100 milliards d'euros, et il serait supérieur à celui du plan d'investissement France 2030.
Chers collègues, nous assumons d'avoir fortement dépensé pour protéger et pour relancer notre économie face à la crise ; d'avoir investi fortement dans les technologies d'avenir, la décarbonation et la réindustrialisation, pour une économie française innovante, souveraine et compétitive. Mais nous ne dépenserons pas l'argent des Français dans des nationalisations totalement inconsidérées et inopportunes pour l'avenir du pays.
Rappelons que les premières concessions historiques arriveront à échéance dans moins de dix ans. L'État pourra donc, s'il le souhaite à cette date, récupérer automatiquement et gratuitement la gestion de ces infrastructures.
Ensuite, ces nationalisations seraient-elles bénéfiques pour les usagers des autoroutes ? Là encore, la réponse est non.
Le passage de la gestion du réseau du privé au public transférerait à l'État la charge d'assurer les dépenses d'investissement très lourdes pour l'entretien et la création des infrastructures. Un rachat des SCA ne garantit ni la disparition ni la baisse automatique du prix des péages, compte tenu des investissements importants à réaliser et des recettes fiscales pour l'État – 60 milliards d'euros entre 2006 et 2020.
Du point de vue de la qualité des infrastructures, nous pouvons également douter du bénéfice de l'opération, l'État ne disposant ni des moyens techniques ni des services suffisants pour assurer la gestion directe de ces infrastructures. Le dernier rapport du Sénat sur le sujet l'a bien démontré et a exclu cette option.
Or, force est de constater que le modèle de la concession a fait ses preuves, particulièrement en ce qui concerne la qualité de notre réseau national, essentiel pour nos concitoyens et l'attractivité du pays. C'est pourquoi nous assumons de maintenir un État régulateur fort et un système de concession.
En 2017, 97 % du réseau concédé était considéré, selon les évaluations, comme en bon ou très bon état. C'est le résultat d'investissements massifs – de l'ordre de 22 milliards d'euros – effectués par les sociétés concessionnaires d'autoroutes depuis des années, sans que cela ne coûte rien aux finances publiques, donc aux contribuables français, en application des contrats et plans d'investissements. À chaque fois, l'État est garant du respect des engagements des sociétés, notamment en matière de tarif des péages, sous peine de sanctions financières.
Quelque 400 aires d'autoroute ont été réaménagées ; le télépéage, les signalétiques et nouvelles technologies ont progressé ; l'installation massive de bornes de recharge électrique a été engagée ; des systèmes de libre flux – free flow – sans péage commencent à voir le jour, notamment sur l'axe entre Paris et la Normandie.
Nos autoroutes auront en effet à affronter de nombreux défis au cours des prochaines années. Le développement des connectivités, de la gestion intelligente des flux et de la transition écologique du réseau et des véhicules sont au cœur des enjeux de mobilité. Pour rester en pointe dans le déploiement d'infrastructures modernes, les investissements nécessaires seront donc massifs.
Si la rentabilité des SCA a été soulevée à juste titre, ce point est cependant complexe : l'écart entre le taux de rentabilité attendu par les SCA au moment des privatisations et la rentabilité actuelle s'explique essentiellement par la baisse des taux d'intérêt sur les marchés, l'amélioration des coûts d'exploitation et l'usage d'effet de levier par endettement des concessionnaires.
Nous ne pensons pas que cela justifie des renationalisations, mais au contraire des évolutions dans la régulation par l'État. En tout état de cause, l'arrivée à terme des premières concessions historiques nous obligera à nous livrer à un travail d'anticipation au cours des prochaines années.
À aucun moment de ce quinquennat, nous n'avons eu peur de prendre des mesures fortes pour développer massivement l'investissement dans nos infrastructures de transport.
Rappelons le pacte ferroviaire et la reprise de 35 milliards d'euros de dette de la SNCF pour permettre à l'entreprise publique de réinvestir massivement et durablement dans les réseaux du quotidien ; le plan en faveur du fret ferroviaire doté de 1,35 milliard d'euros ; le plan vélo historique de 200 millions d'euros ; la modernisation du réseau routier national ; le renforcement des ponts ; le développement des bornes de recharge électrique. À chaque fois nous sommes au rendez-vous.
En revanche, la nationalisation des seize sociétés concessionnaires d'autoroutes serait un non-sens économique, aurait un coût considérable pour nos finances publiques, sans aucun bénéfice pour le pays en termes d'investissement et de baisse de prix pour les usagers.
Le groupe La République en marche s'opposera donc à cette proposition de loi.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.

Comme le soulignait François Bayrou en 2006, la privatisation des autoroutes était une faute.
C'était tout d'abord une faute politique, le Parlement n'ayant pas été amené à se prononcer à l'époque, contrairement à ce qui s'est passé pour les privatisations effectuées au début de cette législature – elles ont été décidées après débats et votes.
C'était ensuite une faute financière : l'État n'aurait peut-être pas réalisé autant de dividendes que le secteur privé, mais, si cette cession avait été mieux organisée dans le temps, elle aurait pu se faire à un meilleur prix.
C'était enfin une faute parce que ces privatisations étaient mal préparées : les contrats de concessions, déjà anciens, n'étaient pas assez adaptés ; la notion d'équilibre économique n'était pas définie ; les relations entre l'État et les concessionnaires n'étaient pas suffisamment arrêtées.
Les sociétés concessionnaires se sont engouffrées dans ces failles, en adoptant des pratiques jugées parfois douteuses.
La situation s'est fortement améliorée grâce à l'adoption, en 2015, de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, qui a amélioré la régulation du secteur. Cependant, de nombreuses voix réclament – en partie en raison d'un constat déjà daté – la nationalisation des sociétés concessionnaires, qui serait, paraît-il, une poule aux œufs d'or pour nos finances publiques.
En fait, la renationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes est une fausse bonne idée, particulièrement pour nos finances publiques. Rappelons d'ailleurs à l'ensemble de nos concitoyens que les autoroutes sont toujours propriété de l'État, et que, au terme des concessions, la gestion des autoroutes lui reviendra.
Comme l'a rappelé ma collègue Lebec, la nationalisation aurait un coût pour les finances publiques car il faudrait indemniser Vinci, Eiffage et autres pour un montant compris entre 40 et 50 milliards d'euros, auxquels s'ajouteraient quelque 30 milliards d'euros de reprise de dette. Or il suffit d'attendre 2036 pour en profiter gratuitement.
Ne vaudrait-il pas mieux dépenser plus utilement ces 70 à 80 milliards d'euros, dans des modes de déplacement moins consommateurs en carbone – nouvelles voies de chemin de fer ou de navigation fluviale ou infrastructures numériques ?
L'État n'a pas les ressources techniques nécessaires pour assurer la gestion directe de ces autoroutes. Et s'il en disposait, les autoroutes seraient-elles aussi bien gérées et surtout entretenues ? Je n'en suis pas persuadé. Comme nous le savons tous, l'État ne réussit pas toujours à bien concilier son rôle d'actionnaire, de fournisseur de services publics et de régulateur.
Une telle perspective soulève d'ailleurs de nombreuses questions. Dans une telle situation, qui devrait payer le service rendu par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ? Le péage est-il le meilleur système ? Certains pays tels que l'Allemagne ont des autoroutes publiques gratuites. D'autres comme la Suisse ou l'Autriche, fonctionnent avec des vignettes annuelles.
Plus que nationaliser les SCA, il vaudrait mieux préparer la fin des concessions ; ne pas les renouveler sans appel d'offres ; veiller au maintien d'investissements suffisants ; inciter les concessionnaires à préparer les modalités de déplacement de demain – notamment les voitures électriques – sans toutefois en faire payer le coût par les finances publiques ; continuer à aller vers une meilleure régulation du secteur en renforçant les pouvoirs de l'autorité de régulation, notamment en ce qui concerne les questions tarifaires ou les sous-concessions.
En tout état de cause, plus que gloser sans fin, comme nous le faisons depuis quinze ans sur les fautes du passé et la possibilité ou non de renationaliser les SCA, nous devons préparer le futur.
Moins de dix ans nous séparent de la fin des premières grandes concessions autoroutières, notamment celles de Paris-Lille ou de Paris-Strasbourg. En 2035, ce sera le tour des autoroutes de la vallée du Rhône. Alors de grâce, mettons-nous au travail, et relevons ce défi majeur !
Pour conclure, je citerai le poète et écrivain polonais Stanis³aw Jerzy Lec à propos des nationalisations : « La richesse de la pensée est rarement menacée de nationalisation. »
Pour toutes ces raisons, le groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés, que j'ai l'honneur de représenter, votera contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe Dem.

Quand il s'agit des autoroutes, tout est question de chiffres, surtout de celui qui répond à la question : combien coûterait la nationalisation des sociétés concessionnaires ? Or les estimations varient.
En 2014, le rapport Chanteguet citait le montant de l'indemnité évaluée par la Banque royale du Canada – 44 milliards d'euros –, indiquant qu'elle devait être prise comme un « maximum absolu ». Le député Chanteguet avançait une estimation plus basse – 20 milliards d'euros – dans le cas d'une reprise de la dette par un nouvel établissement d'exploitation. Un peu plus tard, l'État donnait sans se mouiller, si vous me permettez l'expression, une fourchette allant de 40 à 50 milliards d'euros. Enfin, intervenant en 2020 devant le Sénat, le ministre délégué Djebbari l'estimait à 47 milliards d'euros.
Comment le coût indemnitaire d'une nationalisation peut-il augmenter, quand on sait que le principal actif des concessionnaires est constitué de contrats dont la valeur diminue avec le temps ?
Rappelons les avantages dont jouissent les SCA : le mode de calcul des péages permet une revalorisation annuelle de facto supérieure à l'inflation ; des clauses – dont on peut questionner la légalité – ouvrent droit à une compensation intégrale de toute évolution fiscale touchant les concessions.
Sur le plan économique, ces avantages se traduisent dans différents indicateurs : des taux de rentabilité négociés élevés ; un rapport entre l'excédent d'exploitation et le chiffre d'affaires supérieur à 60 % dès 2006 ; des recettes nettement plus dynamiques que l'évolution du trafic ; des dividendes versés supérieurs à 90 % – voire à 100 % – des bénéfices nets.
L'asymétrie de l'information sur l'économie des contrats a tendu à se réduire depuis l'introduction d'une régulation par l'ART. Dans un rapport de 2020, l'ART met en évidence 600 millions d'euros de surcompensations des investissements du plan de relance autoroutier. Quel aveu de l'indécent festin des concessionnaires ! Et je pourrais citer l'écart entre le montant du plan – 3,2 milliards d'euros – et les bénéfices supplémentaires escomptés du fait de la prolongation de ces contrats – plus de 15 milliards d'euros.
On peut se satisfaire d'aspects positifs des concessions : un réseau en très bon état, un haut niveau de services. Mais douter de la fiabilité des estimations du coût de la nationalisation, c'est déjà un peu répondre à la question de sa nécessité.
Si l'État ne sait plus dire combien vaut l'exploitation de biens majeurs de son propre patrimoine, valorisés à plus de 160 milliards d'euros, c'est qu'il ne dispose pas des moyens d'un contrôle suffisant, alors même que les concessionnaires jouissent d'une rente caractérisée. En bref, les intérêts des contribuables et des usagers ne sont pas suffisamment protégés.
Comme je l'ai dit, les estimations sur le coût de la nationalisation sont confuses. Pourquoi ? Soit parce que leur mode de calcul est disputé, soit parce que nous ne sommes pas au clair sur ce qu'elles désignent. Il est donc très important de s'entendre sur ce dont on parle.
Notre collègue Taurine et ses cosignataires proposent la nationalisation. Cette option se distingue clairement de la rupture unilatérale des contrats. Il n'y a pas d'ailleurs une nationalisation, mais cinquante nuances de nationalisation. Nationaliser, cela peut vouloir dire que l'État prend 51 % des parts et que rien d'autre ne change. Le choix de la nationalisation offre alors plusieurs attraits : stabilité et sécurité sur le plan de l'exploitation ; minimisation de l'indemnisation des sociétés sur le plan financier. Ce choix dessine aussi la perspective du maintien d'un modèle concessif, avec des concessions exploitées par des sociétés d'économie mixte.
Quel en est le principal risque ? Que les SCA introduisent des recours, ce qui n'empêcherait pas la nationalisation elle-même, le débat portant alors sur l'indemnisation. Cette compensation pourrait se révéler plus faible qu'envisagé dans la mesure où elle ne s'accompagnerait pas d'une reprise de la dette qui continuerait, quant à elle, d'être remboursée par l'exploitation.
Or il se trouve que les concessionnaires ont un intérêt majeur à poursuivre leur participation à l'exploitation en bonne entente avec l'État, c'est-à-dire à pouvoir continuer de gagner de l'argent, voire à envisager de nouveaux contrats. Si nationalisation il y a, elle sera donc logiquement négociée, dans l'intérêt commun des parties.
Une chose est certaine : pour envisager l'avenir librement et dans l'intérêt général, il faut reprendre le contrôle, dans les meilleures conditions mais aussi le plus tôt possible. Pour notre part, nous préférerions interdire toute prolongation des contrats et préparer dès maintenant la reprise future de l'exploitation par des établissements publics, car l'activité autoroutière nous semble structurellement monopolistique.
Il n'en reste pas moins que la nationalisation est une option valable, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. Une option coûteuse, sans doute, mais moins que ce que rapporteraient les autoroutes à l'État, c'est-à-dire, jusqu'à 40 milliards d'euros d'ici à 2036. Le jeu en vaut la chandelle !
Pour conclure, je ferai trois remarques. Premièrement : nationaliser les concessionnaires est possible, cela a même déjà été fait par le passé. Deuxièmement : nationaliser dès à présent serait moins coûteux que ce que les contrats rapporteraient d'ici à leur expiration. Troisièmement : l'État peut et doit cesser de se considérer en position de faiblesse vis-à-vis des concessionnaires.
Les députés socialistes et apparentés voteront pour ce texte.

Beaucoup étaient favorables à une reprise en main des autoroutes, y compris François Bayrou au moment de la privatisation des sociétés en 2006, ou encore Jean-Baptiste Djebbari lorsqu'il était député.
Sourires sur les bancs du groupe SOC.

J'espère donc que vous serez nombreux, mes chers collègues, à voter favorablement à nos côtés.
Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, FI et GDR.

La gestion des autoroutes est une question d'intérêt prioritaire, celles-ci étant des infrastructures stratégiques pour notre pays, permettant la circulation des personnes et des marchandises d'un bout à l'autre du territoire métropolitain. Je tiens donc à remercier le groupe La France insoumise et la rapporteure Bénédicte Taurine d'avoir mis ce texte à l'ordre du jour de notre assemblée.
À quelques mois d'échéances électorales cruciales pour notre pays, le retour au premier plan de ce thème n'est pas une surprise. Plusieurs candidats déclarés à l'élection présidentielle ont d'ores et déjà pris position en faveur de la renationalisation des autoroutes.
J'apporterai en premier lieu une précision importante : comme l'intitulé de la proposition de loi l'indique clairement, il n'est en réalité pas question de renationaliser les autoroutes, mais bien les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Cette différence majeure n'est pas toujours claire pour nos concitoyens, certains responsables politiques instrumentalisant le sujet à des fins politiciennes.
Disons-le donc clairement : les autoroutes n'ont jamais été privatisées ; ce sont les sociétés concessionnaires qui l'ont été. Les autoroutes font toujours partie du domaine public de l'État, qui en délègue la gestion et l'entretien à des concessionnaires privés. À l'issue des concessions, c'est-à-dire entre 2031 et 2036 s'agissant des concessions dites historiques, les autoroutes reviendront à l'État, qui décidera alors soit d'en assurer lui-même la gestion, soit de la déléguer à nouveau.
Ainsi, la question que vous posez par cette proposition de loi est de savoir si nous devons nationaliser sans attendre les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Le groupe Agir ensemble ne le pense pas, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, si, comme vous le préconisez, une telle opération était menée immédiatement, son coût estimé s'élèverait à plusieurs dizaines de milliards d'euros, afin de compenser les concessionnaires d'une fin anticipée de leurs contrats de concession. Il suffirait pourtant d'attendre l'échéance de ces contrats, dans dix ans, pour récupérer les autoroutes gratuitement – si je puis le dire ainsi.
Vous en conviendrez, il s'agirait d'un gaspillage d'argent public que de débourser une telle somme. Ces fonds seraient bien plus utilement dépensés pour continuer de rénover notre réseau ferroviaire, pour développer notre réseau fluvial, pour intensifier la décarbonation des transports, ou que sais-je encore.
À cela s'ajoute que la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes impliquerait la reprise des dettes qu'elles ont contractées, ce qui représenterait encore plusieurs dizaines de milliards d'euros. Aussi oserai-je dire que la nationalisation, telle que vous la proposez, constituerait un cadeau fait aux actionnaires de ces sociétés,…
Sourires sur les bancs du groupe FI.

Cela étant, nous partageons certains de vos constats. Les nombreux rapports parlementaires, de la Cour des comptes ou des autorités administratives indépendantes ont, il est vrai, fait état d'un déséquilibre dans les relations contractuelles entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes. De fait, celles-ci présentent des niveaux de rentabilité plus élevés ou plus rapides que prévu. De plus, les dividendes importants versés par les sociétés concessionnaires à leurs actionnaires choquent à juste titre une partie de nos concitoyens, et doivent nous interroger.
La question centrale est donc de savoir quel modèle de gestion nous voulons pour nos autoroutes. Depuis les années 1950, le réseau autoroutier s'est développé par le biais de concessions accordées par l'État à des sociétés d'économie mixte, transformées dans les années 2000 en sociétés de droit privé, puis privatisées en 2006. Le système des concessions a permis de bâtir un réseau autoroutier de grande qualité et constamment entretenu. Il a néanmoins connu des dérives, notamment parce que l'État était à la fois actionnaire des sociétés concessionnaires et concédant du réseau.
Il convient donc, à l'évidence, de revoir les conditions de l'équilibre économique des concessions, même s'il faut aussi reconnaître que ce modèle procure une expertise et des financements du secteur privé, dont l'État ne dispose plus nécessairement aujourd'hui.
Forts de ces constats, nous sommes convaincus qu'il sera nécessaire d'avoir suffisamment tôt une réflexion sur le futur mode de gestion des autoroutes d'ici à l'échéance des contrats de concession. Dans cette attente, la nationalisation immédiate des sociétés concessionnaires ne nous semble pas une solution souhaitable. Le groupe Agir ensemble votera donc contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe Dem.

Je me souviens très bien du contexte dans lequel a eu lieu, en 2006, la nationalisation, ou du moins la délégation du réseau autoroutier à certaines entreprises privées. Mohamed Laqhila l'a rappelé tout à l'heure, les centristes étaient à l'époque opposés à la manière par laquelle les choses s'étaient déroulées, sans débats et de manière unilatérale. Si vous vous en souvenez, les députés centristes et ceux qui s'opposaient à cette décision estimaient que nous commencions à vendre « les bijoux de famille ». Et des années plus tard, je continue de considérer qu'il n'était pas judicieux de prendre pareille mesure.
La question que vous posez aujourd'hui, chère Bénédicte Taurine, est donc un véritable sujet de préoccupation. À cet égard, et sans faire insulte au travail parlementaire, je ne sais pas si cette question peut être traitée par une simple proposition de loi. Il faudrait certainement aller au-delà, avec un projet de loi,…

…c'est-à-dire une démarche réellement approfondie – même si ouvrir le débat dans l'hémicycle est une bonne chose.
Cela étant, le groupe UDI-I partage l'avis, présenté par Marie Lebec, selon lequel il n'est pas pertinent d'arrêter immédiatement les concessions et de procéder à leur rachat en cours de contrat, en indemnisant les entreprises et en reprenant leurs dettes.
En revanche, je répète qu'il relève de la responsabilité des parlementaires d'interpeller le Gouvernement et de se positionner pour les années à venir. Au moment où nous arriverons au terme des concessions, nous devrons avoir un débat approfondi et, je le crois, sérieusement envisager le retour de ce type d'infrastructures dans le giron de la gestion publique. En effet, les questions relatives aux mobilités et à l'énergie sont de la plus haute importance.
J'ajoute que s'il est pertinent de réfléchir à la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes, il conviendrait aussi de donner une dimension européenne au débat. En effet, se posent ici les mêmes questions que lorsque nous discutions, il y a quelques années, de l'ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence. Ainsi, au terme des concessions autoroutières, le gouvernement en place devra se demander à qui précisément elles pourraient être confiées à l'avenir et par quel type de contrat.
En définitive, il nous semble préférable de suivre les recommandations de la commission d'enquête du Sénat sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières, à savoir renforcer les contrôles, cesser de prolonger les concessions et réfléchir à la manière d'exploiter les autoroutes une fois que les concessions seront arrivées à échéance. Madame la rapporteure, vous l'aurez compris, le groupe UDI-I votera contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe Dem.

Près de seize ans après la privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes, le bilan est implacable pour l'État. Plus qu'une incurie, cette décision historique fut une faute politique et économique majeure – d'autres l'ont déjà dit avant moi. Alors que certaines concessions historiques arriveront à échéance d'ici à 2031, il nous faut engager dès à présent un débat sur l'avenir de la gestion du réseau.
Je rejoins ainsi un grand nombre des critiques formulées par Mme la rapporteure et le groupe La France insoumise à l'encontre des sociétés de concessions autoroutières. La privatisation menée en 2006 par le gouvernement Villepin a été un véritable échec : la cession de parts, effectuée de manière morcelée et sans réelle mise en concurrence, a fortement limité les recettes que l'État aurait pu en retirer. La commission d'enquête sénatoriale sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières évoque un profit inférieur à 15 milliards d'euros, ce qui signifierait une perte de près de 6,5 milliards d'euros pour les finances publiques.
Au-delà de ces seuls enjeux financiers, c'est surtout le déséquilibre des relations contractuelles entre l'État et les sociétés concessionnaires qui apparaît inacceptable. À cet égard, les discussions entre l'État et les sociétés concessionnaires, entre 2013 et 2015, n'ont permis qu'un rééquilibrage partiel. Par ailleurs, le protocole d'accord, trouvé après de difficiles négociations, a conduit à un allongement supplémentaire de la durée des concessions.
Dans cette situation, un contraste saisissant doit nous alerter : d'un côté, la rentabilité exceptionnelle des groupes titulaires des concessions et, de l'autre, des prix de plus en plus élevés pour l'ensemble des automobilistes. Les dividendes de ces groupes atteignent désormais des niveaux si élevés qu'ils s'apparentent à de véritables rentes. À partir de 2022, les trois principaux groupes pourraient ainsi voir leurs profits atteindre les 40 milliards d'euros, dont 32 milliards pour les seuls Vinci et Eiffage. Il paraît difficile d'accepter de tels résultats quand, toujours en 2022, les tarifs des péages poursuivent leur augmentation et pèsent durablement sur l'ensemble des Français.
Face à ce constat, une réaction s'impose, même si le rachat des participations pose de sérieuses difficultés et si agir dans la précipitation pourrait nous faire tomber dans les mêmes travers qu'en 2006. Mettre fin aux contrats de manière anticipée et opter pour une nationalisation auraient un coût substantiel. Votre rapport fait état des différentes estimations, qui oscillent généralement entre 40 et 50 milliards d'euros : il semble objectivement difficile de faire peser une telle facture sur nos finances publiques.
Notre groupe prend acte des annonces que vous avez formulées lors de l'examen du texte en commission. Pour la première fois, vous avez proposé une possible indemnisation réduite à 15 milliards d'euros, même si la présente rédaction de votre dispositif législatif ne prévoit pas explicitement une telle compensation.
Depuis 1982, le Conseil constitutionnel exige pourtant le versement d'une « juste et préalable indemnité » pour toute nationalisation. Vous mentionnez à juste titre cette décision dans votre rapport, mais sans en tirer les conséquences. Aussi paraît-il nécessaire d'inscrire dans le texte le principe d'une telle indemnité, quitte à déterminer ultérieurement les conditions de son paiement.
Au-delà de cette réserve juridique, nous considérons également que la fin anticipée des contrats n'est pas une option raisonnable ni réalisable. Le coût des indemnités à verser aux sociétés concessionnaires, qu'il s'élève à 15 milliards ou à 40 milliards d'euros, demeure excessif.
Faut-il pour autant rester les bras croisés en attendant la fin des concessions historiques ? Non, il appartient à l'État de se préparer dès à présent, afin de les repenser. Commençons par mettre fin aux allongements des contrats sans mise en concurrence, ces prolongations successives ne faisant qu'aggraver la situation.
En outre, une réflexion devrait être envisagée pour réduire sensiblement les tarifs des péages. Une telle baisse serait raisonnable compte tenu de la rentabilité démesurée des concessions autoroutières et dans la mesure où les usagers sont, au fond, captifs dans cette situation.
Plus généralement, il appartient à l'État de repenser en profondeur la gestion de nos autoroutes. Lors des négociations à venir, j'estime que la priorité devra être donnée à un rééquilibrage économique et financier des concessions, sans oublier l'enjeu du verdissement du réseau.
En somme, madame la rapporteure, ce texte soulève un sujet essentiel et je tiens à vous remercier de nous avoir permis d'en débattre.

La Française des jeux, dont la valeur est estimée à 3,8 milliards d'euros : adjugée, vendue pour 1,5 milliard d'euros.
L'activité énergie d'Alstom, incluant les turbines de centrales nucléaires ou les prototypes d'éoliennes en mer dont la France a tant besoin : adjugée, vendue par Emmanuel Macron à General Electric.
Les aéroports de Lyon, Nice et Toulouse, instruments stratégiques de notre souveraineté et du contrôle de nos frontières : adjugés, vendus respectivement à Vinci, à l'Italien Atlantia et surtout au Chinois Casil, lequel a revendu l'aéroport de Toulouse avec une petite plus-value de 200 millions d'euros.
Si vous pensiez qu'Emmanuel Macron était Président de la République, vous vous trompiez : il est commissaire-priseur. Il vend la France à la découpe, avec de larges rabais pour ses amis. Et quand il ne vend pas les biens stratégiques de l'État, il s'emploie à prolonger les concessions d'autoroutes, dont les seuls gagnants sont les mastodontes du BTP, à savoir Abertis, Eiffage et, bien sûr, Vinci, véritable sangsue de l'argent public.
Souvenez-vous : en 2015, quand il était ministre de l'économie dans le gouvernement de Manuel Valls, Emmanuel Macron a validé la prolongation des concessions pour cinq ans, sans publicité ni mise en concurrence, avec des augmentations automatiques aux péages chaque 1er février, de 2019 à 2023, soit un surcoût de 500 millions d'euros pour les usagers. Quel stratège ! Quel visionnaire pour la France ! Vous lui demanderiez d'élaborer une stratégie vaccinale pour le pays qu'il irait demander conseil à des cabinets privés étrangers… Ah, excusez-moi, c'est déjà fait, pour la modique somme de 25 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 50 millions de masques FFP2 ou 85 000 capteurs de CO
S'il y avait une discipline du gaspillage d'argent public aux Jeux olympiques, le Gouvernement serait médaillé d'or. Collègues, ce gouvernement, dans la pure tradition néolibérale, vend notre pays à la découpe pour les seuls intérêts de quelques multinationales – ce que vous appelez la compétitivité des entreprises. Pour quel bilan, monsieur le ministre délégué ? Quel bilan ? Vous n'avez jamais fait celui de toutes les privatisations depuis la fin des années quatre-vingt, mais je peux vous le résumer très facilement : enrichissement des multinationales et des grands actionnaires, appauvrissement de l'État, augmentation des prix pour les usagers, creusement des inégalités d'accès à ces biens.
La gestion des autoroutes par des multinationales n'a pas diminué, comme par enchantement, le nombre de véhicules sur la route, ni résorbé le nombre d'accidents, et je suis à peu près certaine que nos concitoyens rouspètent au volant aussi fréquemment que lorsque l'État était à la manœuvre. La différence, c'est que les prix ont augmenté 22 % plus vite que l'inflation. Tout a été dit, ou presque, sur ce fiasco : l'État a cédé les autoroutes pour 14,6 milliards d'euros alors que la Cour des comptes en estimait le prix réel à 25 milliards d'euros ; un cadeau de 10 milliards aux multinationales, le premier d'une longue série. Surtout, l'État a concédé ses infrastructures autoroutières alors que leur exploitation commençait à rapporter de l'argent, ce qui aurait été bénéfique pour les finances publiques et aurait permis de ne pas augmenter les péages. Mais comment pourrait-il en être autrement, dès lors qu'on a décidé de privatiser des monopoles ?
Je rappelle un principe d'économie élémentaire – sans doute n'est-il pas enseigné à l'École nationale d'administration, mais il l'est dans toutes les facultés de France. Retenez votre souffle : privatisez des monopoles, et vous ferez automatiquement augmenter le prix du service. Un monopole livré au privé débouche mécaniquement sur la création d'une rente, laquelle n'existe pas lorsque le monopole est public. C'est pourquoi il est impossible, dans ce cas, que les prix baissent ou que l'entreprise soit incitée à améliorer le service. Regardez tous les exemples de monopoles privatisés, en France ou ailleurs : EDF, GDF, La Poste, les autoroutes, le train… Pour tous ces exemples, les prix ont-ils baissé ? Le service est-il toujours accessible au plus grand nombre ? La promesse de la magie du secteur privé qui ferait mieux que le secteur public a-t-elle été tenue ? La réponse est non, non et non. Le Royaume-Uni nous l'a encore démontré récemment, en annonçant renationaliser une partie de son réseau ferroviaire. Les privatisations, loin de stimuler l'économie ou d'offrir un meilleur service aux usagers, nous appauvrissent, nous dépossèdent de notre souveraineté, nous volent notre capacité de décider ensemble des orientations de notre économie. C'est un manque à gagner considérable pour l'État que vous vous sentez obligé d'aller rechercher dans les poches des chômeurs, des pauvres ou des retraités.

Collègues, à l'heure de l'urgence écologique et climatique, il est impossible de continuer de confier des secteurs stratégiques de notre économie à des multinationales qui ne pensent qu'à verser toujours plus de dividendes à leurs actionnaires. Leur appât du gain à court terme signe notre mort à long terme. La nationalisation de ce secteur est indispensable, car elle permet la propriété collective sur le temps long. Il s'agit de partir des besoins des gens et de déterminer collectivement, démocratiquement, à tous les échelons, les grandes orientations de notre économie. En privatisant, vous nous privez des moyens de lutter contre les inégalités et le dérèglement climatique, alors même qu'il nous faut impérativement entamer la bifurcation écologique et solidaire de notre économie. Les autoroutes, EDF, Engie, La Poste, la SNCF, le secteur bancaire, les aéroports inter-régionaux, la Française des jeux : la grande braderie de l'État doit cesser. Renationaliser ces entreprises stratégiques est une urgence vitale.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et GDR.

Voilà encore une catégorie de Français que ce quinquennat n'aura pas épargnée : les automobilistes, véritables vaches à lait, à qui l'on aura tout fait subir depuis des années, tout – passage aux 80 kilomètres par heure, explosion du prix de l'essence, augmentation des péages, sans oublier les zones à faibles émissions et une circulation devenue impossible dans certaines grandes villes comme Paris ou Lyon… Aujourd'hui, en France, pays de Nicolas Joseph Cugnot, créateur du premier modèle d'automobiles – cocorico ! –, être automobiliste est devenu un véritable enfer.
Il me semble difficile d'intervenir sur la nationalisation des autoroutes qui fait l'objet de cette proposition de loi sans évoquer globalement les problèmes que vivent au quotidien une grande partie de nos concitoyens. Je pense notamment à ceux de la France périphérique et rurale, véritables victimes de ce mandat ; je pense aussi aux citoyens des métropoles qui, parfois, n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule et qui vivent un parcours du combattant, entre bouchons, radars et problèmes de stationnement. Face à cela, les ressorts sont multiples, et la nationalisation des sociétés d'autoroute est une bonne idée. Cette proposition figure d'ailleurs dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, qui veut rendre aux Français leur pays et leur argent.
Chers collègues, une fois n'est pas coutume – c'est assez rare pour le souligner –, nous sommes d'accord sur un sujet. Votre proposition de loi dresse un très juste constat : les autoroutes françaises sont l'histoire d'une véritable spoliation des Français. Permettez-moi un bref rappel historique. De Gaulle, dès 1955, voulait couvrir le territoire d'un circuit routier moderne, entretenu et performant ; il entreprend alors la création d'autoroutes, confiée à des sociétés concessionnaires qui amortissent le coût de l'investissement et de l'entretien par les recettes des péages. Ce modèle a permis de construire 75 % d'un réseau de 10 000 kilomètres autoroutiers de qualité, véritable atout pour notre pays et pour l'aménagement du territoire. Après les premières cessions sous Lionel Jospin, Dominique de Villepin estimait réaliser en 2006 « une bonne affaire » – je le cite – en cédant les sept principales concessions pour 14,8 milliards d'euros. Une si bonne affaire que la Cour des comptes, trois ans plus tard, a réestimé la valeur de ces sociétés autour de 25 milliards d'euros, soit une perte sèche de 10 milliards d'euros pour les Français ! Aujourd'hui, avec un taux de rentabilité de près de 25 %, on peut dire que les sociétés concessionnaires se gavent sur le dos des Français. C'est une véritable illustration de la captation d'un bien public au profit d'intérêts privés, dont les bénéfices hallucinants ne servent pas l'intérêt général.
En cette période de crise du pouvoir d'achat, chacun comprend les conséquences bénéfiques d'une nationalisation des autoroutes sur le portefeuille des Français. Dans notre vision des choses, cela permettrait de faire baisser de 10 à 15 % le prix des péages, lesquels, rappelons-le, ont augmenté de 20 % en dix ans et représentent un budget moyen de 300 euros par ménage et par an. Cette mesure, essentiellement financée par le rachat des dettes des sociétés, permettrait de rendre 1,5 milliard d'euros par an au budget de l'État, ce qui pourrait servir au lancement d'une politique de réaménagement du territoire. Ce serait, en somme, un contrat gagnant-gagnant avec les Français.
Ainsi, nous approuvons la proposition de loi, tout en émettant une réserve sur la façon dont elle est gagée, à savoir sur la diminution de l'exonération de la taxe carbone ; une légère différence de point de vue qui ne saurait nous empêcher de constater le bon sens de cette proposition.

Le seul point sur lequel je partage votre avis, monsieur le ministre délégué, c'est quand vous dites que l'on circule en sécurité sur les autoroutes. Le souci, c'est qu'une étudiante de la faculté de Toulouse que j'ai croisée dernièrement me disait qu'elle ne pouvait pas emprunter l'autoroute parce qu'elle était trop chère. Tout le problème est là : certains jeunes sont obligés de prendre les petites routes faute de pouvoir payer, alors que les actionnaires, eux, se versent des dividendes importants.

Je voudrais également vous répondre au sujet de la dette. Effectivement, il y avait une dette en 2006, mais celle-ci a depuis été creusée pour verser des dividendes aux actionnaires. Vous ne pouvez pas dire que c'est à l'État de compenser cette dette, alors que les entreprises leur ont versé des milliards !
Mme Mathilde Panot applaudit.
Murmures sur les bancs du groupe La République en marche.

Si j'ai bien compris, vous proposez d'attendre 2031, c'est-à-dire la fin des contrats. Dans l'intervalle, les usagers paieront et les actionnaires continueront de s'en mettre plein les poches. L'État devrait au contraire jouer son rôle et privilégier l'intérêt général en récupérant ces sociétés pour permettre aux usagers de circuler sur les autoroutes. C'est une ineptie de dire qu'il faut attendre.
On sait comment les contrats de 2006 et leurs avenants successifs ont été rédigés. Qu'est-ce qui prouve que les choses changeront en 2031 ? Rien du tout. Au vu des engagements de M. Macron sur la sortie du glyphosate, par exemple, je pense qu'il ne se passera rien et que tout continuera comme avant, au détriment de l'intérêt général.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Sur les amendements n° 4 et 5 , les articles 1er et 2 ainsi que sur l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe La France insoumise d'une demande de scrutin public.
Sur l'amendement n° 6 , je suis saisi par le groupe Socialistes et apparentés d'une demande de scrutin public.
Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n'a pas adopté de texte.

Monsieur le ministre délégué, j'ai entendu, dans votre bouche, des mots qui relèvent du déni. « Aucun calcul ni aucune analyse ne prouve une sur-rentabilité des sociétés concessionnaires », « beaucoup de chiffres circulent et souvent ils sont erronés, car le modèle économique se caractérise par des investissements importants »… Mais c'est le lobby des sociétés d'autoroutes qui a écrit votre discours !

Partout, des rapports prouvent qu'il y a des surprofits. Cela démontre votre complicité à ne pas agir.

Que l'on dise que la nationalisation n'est pas une solution, comme je l'ai entendu sur plusieurs bancs, soit. Mais il y a d'autres possibilités. Je vous demande de vous en saisir.
La première d'entre elles a été présentée par l'UFC-Que Choisir, qui titre : « Péages d'autoroute, une augmentation inédite : à partir du 1er février 2022, les tarifs des péages vont augmenter en moyenne de 2 %. Si ces chiffres sont validés, l'augmentation de 2022 sera la plus importante depuis longtemps. » Vous pouvez dire non dès aujourd'hui à cette augmentation, monsieur le ministre délégué. C'est ce que je vous demande.
Autre piste : les sociétés d'autoroutes n'ont pas respecté leur part du contrat, à savoir l'engagement d'un plan d'investissements. D'après l'Autorité de régulation des transports, les travaux promis n'ont soit pas été effectués, soit sont inutiles ou surévalués. C'est une raison valable de rompre ce protocole, ou du moins de le renégocier.
Dernier point : il y a un an, une demande a été déposée au Conseil d'État en vue de faire reconnaître que Macron…

…n'avait pas l'autorisation d'insérer une clause de neutralité fiscale dans le protocole transactionnel qu'il a signé quand il était ministre. Je pense que l'État devrait s'associer à cette demande et considérer l'accord comme non valable au motif que M. Macron, n'étant à l'époque ni ministre des finances, ni Premier ministre, n'avait pas l'autorisation de se positionner.
Voici trois leviers d'action qui ne relèvent pas de la nationalisation. J'attends vos réponses.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

La parole est à Mme Marie Lebec, pour soutenir l'amendement de suppression n° 4.

Comme je l'ai dit en discussion générale, nous ne soutenons pas la demande de renationaliser les sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Cet amendement de suppression n'a pas été déposé en commission ; par conséquent, c'est à titre personnel que je donnerai un avis défavorable.
Tout ce que vous proposez, c'est d'attendre la fin des contrats.

Il s'agit pourtant d'une situation de rente comparable à celles que vous prétendez combattre par ailleurs. Mais, lorsqu'il s'agit des autoroutes, vous l'accompagnez, et votre seul argument consiste à dire que tout est trop cher. En attendant, vous laissez les actionnaires bénéficier de dividendes réguliers, quand cet argent pourrait bénéficier à l'intérêt général.
D'autre part, l'exposé sommaire de votre amendement me semble incohérent. Vous indiquez que dans dix ans, « l'État pourra récupérer gratuitement la gestion de ses infrastructures autoroutières », mais quelques lignes plus loin, vous ajoutez que « les moyens techniques des services de l'État seraient insuffisants pour assurer une gestion directe » ! Cela me conforte dans mon idée : dans dix ans, quand les contrats seront échus, rien ne changera, car vous-même écrivez que l'État ne sera pas en mesure de modifier quoi que ce soit.
« Oh ! » sur les bancs du groupe LaREM.

Concernant les péages, ni le texte de la proposition de loi, ni le rapport n'évoquent leur suppression.

S'il vous plaît, monsieur Millienne.
En revanche, une nationalisation permettrait de s'assurer que la hausse des tarifs des péages ne sortira pas des clous : qu'elle n'excédera pas l'inflation, et qu'elle ne donnera pas lieu à du foisonnement – pratique normalement interdite, consistant à concentrer l'augmentation tarifaire sur les tronçons les plus fréquentés, ce qui limite leur utilisation par ceux qui ont le moins de moyens.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Avis favorable.
L'ordre de grandeur que j'ai évoqué – entre 45 et 47 milliards d'euros – est toujours d'actualité et repose sur les derniers calculs figurant dans des rapports, y compris parlementaires, par exemple celui réalisé au Sénat l'an passé. Ce chiffre a vocation à diminuer à mesure qu'approche l'échéance des principaux contrats.
Une des mesures introduites dans ces contrats est la récupération des infrastructures à l'état neuf en fin de contrat. Nationaliser, ce serait se priver de la capacité à récupérer gratuitement des infrastructures en très bon état.
Enfin, monsieur Ruffin, concernant la rentabilité, le rapport de l'ART du 30 juillet 2020 sur l'économie des concessions autoroutières pointe une rentabilité moyenne de 7,8 % – elle se situe entre 6,4 % et 9,2 %. C'est un niveau élevé, mais jugé non excessif, et qui ne justifie pas juridiquement une résiliation.
Pour ces différentes raisons et parce que vous prévoyez de gager la nationalisation des autoroutes sur une augmentation tout à fait massive des tarifs des carburants routiers, nous sommes favorables à l'amendement de suppression.

Monsieur le ministre délégué, vous ne répondez pas à ma question : allez-vous oui ou non accepter une hausse des tarifs des péages de 2 %, la plus importante depuis des années, le 1er février 2022, c'est-à-dire dans deux semaines ?

Nous souhaitons obtenir une réponse immédiate à cette question précise.

Par ailleurs, lors de son intervention dans la discussion générale, Mme Lebec a prétendu qu'à un aucun moment, la majorité n'avait eu peur de prendre « des mesures fortes ». Mais si, à chaque instant, vous avez craint d'adopter de telles mesures, dès lors qu'elles concernent les firmes, les actionnaires et les plus riches de ce pays, qui continueront à se gaver grâce aux péages !

Moi, je relève que le groupe La République en marche, qui souhaite la suppression du présent article prévoyant des nationalisations ne propose rien à la place ! Que vous considériez que la nationalisation n'est pas la bonne solution, cela ne me pose pas de problème, mais quelle autre solution proposez-vous ? Rien !

Au fond, ça vous convient très bien ce laisser-aller, cet hyper-gavage. Peut-être est-ce parce que l'argent arrive dans les poches de vos amis, les actionnaires ?
Protestations sur les bancs du groupe LaREM.
M. Adrien Quatennens applaudit.

Nous ne soutiendrons évidemment pas cet amendement de suppression. Certains ici entretiennent volontairement la confusion entre nationalisation et rupture par anticipation des contrats. C'est dommage parce que, comme vous le savez, monsieur le ministre délégué, une nationalisation n'implique pas nécessairement que l'État reprenne toute la dette à son compte ; il serait possible de renationaliser ces sociétés avec 51 % des parts, ce qui ne coûterait plus les 47 milliards que vous évoquez.
J'en profite pour vous interroger : au début de l'hiver, quand tout le monde avait la tête ailleurs, et pensait à la fête et à la famille, le 21 décembre exactement, un avenant à la convention passée avec la société des autoroutes Paris-Normandie a été publié. Celui-ci prévoit de nouveaux investissements – très bien ! – mais également une indemnisation forfaitaire de 55 millions d'euros pour la part non amortie des travaux. Pourquoi choisir un forfait et pourquoi évaluer son montant à partir, je cite l'avenant, « des usages de la profession » ? Une fois encore, l'État se met en position de faiblesse.

Surtout, quand on nous dit qu'il suffit d'attendre dix ans pour reprendre le contrôle, c'est faux et chaque jour qui passe, même si les intérêts publics sont lésés, nous payons quand même.
Enfin, monsieur le ministre délégué, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur l'état de l'inventaire des biens de retour, sujet dont vous vous êtes d'ailleurs défaussé au Sénat.
Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, FI et GDR.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 90
Nombre de suffrages exprimés 90
Majorité absolue 46
Pour l'adoption 64
Contre 26
L'amendement n° 4 est adopté ; en conséquence, l'article 1er est supprimé.

La parole est à Mme Marie Lebec, pour soutenir l'amendement n° 5 , tendant à supprimer l'article.

C'est un amendement de cohérence avec la suppression de l'article 1er .

Cet amendement n'ayant pas été examiné en commission, c'est à titre personnel que j'exprime un avis défavorable.
Monsieur le ministre délégué, vous dites que la nationalisation des autoroutes coûterait entre 40 et 50 milliards d'euros, mais ces chiffres datent de 2013. Après que le ministre des transports de l'époque les avait cachés pendant un an, notre ancien collègue Jean-Paul Chanteguet les a rendus publics en 2014, en les assortissant d'un doute à cause de la méthodologie utilisée pour les calculer. L'année suivante, M. Macron, alors ministre, a jugé cet ordre de grandeur disproportionné et estimé la somme à 20 milliards d'euros. Ces chiffres posent donc problème.
Vos équipes ont refusé de me répondre, quand je leur ai demandé des précisions sur votre estimation de 47 milliards d'euros – je souhaitais connaître, pour chaque société concessionnaire, le coût du rachat des actions ainsi que des éventuelles provisions pour indemnité ou frais de contentieux, et bénéficier d'une estimation des dépenses et des ressources qu'impliqueraient la gestion des autoroutes par l'État ou un établissement public. Il est dommage que nous n'ayons pu obtenir ces réponses lors des auditions.
Dans le détail, on relève que certaines sommes d'un montant élevé sont comptées deux fois, au profit des sociétés. Il faudrait ainsi soustraire 12 milliards d'euros sur les compensations du plan 2015, 1,5 milliard d'euros de provisions pour le renouvellement, près de 12 milliards d'euros de dotations pour amortissement – si ces versements sont jugés illégaux – et 6,5 milliards d'euros captés par les sociétés à cause de la mauvaise conduite des opérations entre 2002 et 2006.
Ainsi, votre chiffrage pose problème et l'on ne peut se fonder sur celui-ci pour avancer que la nationalisation coûterait trop cher et la rejeter.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Les chiffrages sont clairs ; nous pourrons mener cette discussion une nouvelle fois.
Madame Pires Beaune, comme vous le savez, l'inventaire des biens de retour doit être dressé sept ans avant l'échéance des contrats. Je ne me suis pas du tout défaussé de cette question au Sénat. L'an passé, un tel travail d'inventaire a été fait pour les concessions des ponts de Normandie et de Tancarville ; il le sera en temps nécessaire pour toutes les concessions autoroutières, dont les plus importantes, comme vous le savez, arrivent à échéance entre 2031 et 2036.
Nous sommes donc favorables à cet amendement de suppression.

Monsieur le ministre délégué, peut-être aurai-je plus de succès en posant la question avec plus de calme : comptez-vous laisser les sociétés d'autoroute augmenter le tarif des péages de 2 % le 1er février, comme elles le réclament ? Les Français peuvent-ils obtenir une réponse dès maintenant ? Peut-être leur réservez-vous une bonne nouvelle d'ici à quinze jours ?

Je veux bien également une réponse à ma deuxième question : le fait qu'un rapport indique que les travaux prévus dans le contrat signé par Macron…

…n'ont pas été effectués, qu'ils sont inutiles ou que leur coût a été surévalué ne vous paraît-il pas constituer un motif pour rompre celui-ci, ou le renégocier en faveur de l'État et des Français ?
Enfin, nos camarades socialistes avaient déposé un amendement visant à relever les taxes sur les sociétés d'autoroute, que vous rejetez au nom de la clause de neutralité fiscale prévue dans le protocole d'accord. Or une brèche existe : je vous répète qu'un recours a été déposé devant le Conseil d'État afin d'annuler cette clause, car M. Macron n'était pas habilité à la signer, n'étant à l'époque ni Premier ministre, ni ministre des finances. Le Gouvernement appuiera-t-il ce recours, pour ce motif et parce que la clause représente un cadeau excessif aux sociétés d'autoroute ?
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 87
Nombre de suffrages exprimés 87
Majorité absolue 44
Pour l'adoption 62
Contre 25
L'amendement n° 5 est adopté ; en conséquence, l'article 2 est supprimé.

La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l'amendement n° 6 .

Si j'ai bien entendu tout ce qui a été dit dans cet hémicycle, cet amendement devrait être adopté, puisqu'il a pour simple but d'éviter de nouvelles prorogations. Celles-ci seraient interdites pour les contrats « dont l'expiration est prévue à une date antérieure au 1er janvier 2037, dans l'état des contrats au 1er janvier 2022. »
Le déséquilibre entre l'État et les sociétés concessionnaires a été démontré ; il semble que tout le monde s'accorde sur ce constat. Je ne vois donc pas d'obstacle à ce que nous attendions la fin des contrats, en n'en prorogeant aucun. Il m'a semblé que le Gouvernement approuvait cette disposition.

Puisque cet amendement non plus n'a pas été examiné en commission, c'est à titre personnel que j'émets un avis favorable. Cette proposition de repli me paraît opportune, compte tenu du débat que nous venons d'avoir et du déséquilibre des clauses.
Toute prorogation reviendrait à consolider la rente des sociétés privées, au détriment, comme toujours, des usagers contribuables. Comme le groupe La République en marche affirme son opposition aux rentes, il devrait voter pour cet amendement, qui reprend en outre une recommandation ferme de la commission d'enquête du Sénat sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières.
Défavorable.

C'est un amendement de bon sens : les sociétés d'autoroute ont bénéficié des concessions pendant assez longtemps ; n'en rajoutons pas. Nos camarades socialistes permettent ainsi de démasquer l'hypocrisie du ministre délégué et de la majorité qui déclarent : « Nous ne prolongerons pas les concessions, ne vous inquiétez pas, elles ont assez duré, il faut simplement attendre leur échéance, en 2034 ou 2084 ». Pourtant, quand nous proposons un amendement en ce sens, M. le ministre délégué se contente de le rejeter d'un « défavorable » ! Ça, c'est un argument ! Chapeau ! J'imagine que votre ministère l'a travaillé de manière approfondie ? Nous n'entendons pas non plus un mot de la majorité pour nous expliquer pourquoi elle refusera d'interdire la prorogation des concessions.
Nous savons d'avance ce qui se passera, si vous restez au pouvoir – même si j'espère que cela n'arrivera pas – : vous prolongerez sans difficulté la durée des cadeaux à vos amis.
Enfin, monsieur le ministre délégué, je vous ai posé une question on ne peut plus simple : allez-vous laisser les sociétés d'autoroute augmenter de 2 % les tarifs des péages au 1er février 2022 ? C'est dans quinze jours ! Vous n'allez pas improviser votre décision la veille ! Vous devez bien le savoir ! Pouvez-vous répondre devant la représentation nationale et les Français ?
Quand c'est flou, il y a un loup. Pour l'instant, votre réponse semble être un oui. La demande d'augmentation des tarifs des sociétés d'autoroute, la plus importante depuis des années, sera validée sans difficulté – c'est la conclusion que j'en tire.

J'en reviens à l'amendement n° 6 , sur lequel je souhaiterais obtenir une réponse. Son adoption ne coûterait rien à l'État ni aux concessionnaires, puisqu'il vise simplement à maintenir les contrats signés dans leur état actuel.
Dans cet hémicycle, nos collègues de la majorité ont déclaré qu'ils attendaient la fin des contrats et ne souhaitaient pas leur prorogation. Cet amendement ne fait que formaliser la position que vous soutenez !
Pourquoi, monsieur le ministre délégué, ne voulez-vous pas qu'on adopte l'amendement ? Projetez-vous de prolonger des contrats ?
Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, FI et GDR.
Je trouve cette discussion absolument fantastique : d'un côté, le groupe La France insoumise propose de nationaliser les autoroutes et de faire payer lourdement les automobilistes – c'est ce que prévoit la proposition de loi –, à hauteur de 15 milliards au minimum – nous disons 47 milliards, vous dites 15 milliards, ce n'est pas tout à fait rien ; de l'autre, le groupe Socialistes et apparentés reprend – et c'est peut-être encore plus goûtu – la proposition faite par Ségolène Royal en 2015…
…de geler les tarifs des autoroutes, un peu cyniquement.
Protestations sur plusieurs bancs.

Vous avez souhaité que le ministre s'exprime, écoutez-le, c'est la moindre des choses !
Vous voulez reproduire ce qu'a fait Mme Ségolène Royal en 2015 – on peut le dire calmement, ce sont des faits établis : geler les tarifs pour les mêmes raisons et se faire immédiatement condamner, évidemment, puisque dans un État de droit, on respecte le droit des contrats. Je suis stupéfait par la démagogie qui s'exprime du côté gauche de l'hémicycle.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 91
Nombre de suffrages exprimés 89
Majorité absolue 45
Pour l'adoption 26
Contre 63
L'amendement n° 6 n'est pas adopté.

L'ensemble des articles et des amendements portant article additionnel ayant été supprimés ou rejetés, la proposition de loi n'est pas adoptée.


La parole est à M. Loïc Prud'homme, rapporteur de la commission des affaires économiques.

J'ai le plaisir, avec les membres du groupe La France insoumise, de déposer cette proposition de loi, qui demande à l'Assemblée nationale d'interdire l'usage du glyphosate en France. Devant la commission des affaires économiques, une majorité hétéroclite s'est réfugiée dans une défense intégrale de l'agriculture française pour, une fois de plus, décider… de ne rien décider ! Afin de motiver le rejet du texte, ont été invoqués pêle-mêle : l'équilibre économique précaire des exploitations agricoles, la préservation de la souveraineté alimentaire française et l'état des connaissances et des techniques en agronomie.
Mes chers collègues, je ne confonds pas les agriculteurs avec le modèle dans lequel on les enferme. Ce n'est pas rendre service au monde paysan que de lui offrir pour seul horizon une agriculture productiviste qui le conduit à sa perte. Avec ou sans glyphosate, nous pouvons tous constater, année après année, l'affaiblissement inexorable de notre agriculture et la dégradation de notre commerce extérieur. Avec ou sans glyphosate, la détresse du monde paysan constitue une réalité poignante dont chacun peut prendre la mesure. Elle marque les impasses de l'agriculture productiviste, autant que les effets délétères d'un libre-échangisme débridé. Cette réalité douloureuse appelle une nouvelle politique agricole et une action résolue de longue haleine.
Mais, ne nous trompons pas de débat ! Il ne s'agit pas ici de choisir entre d'une part, la compétitivité et la rentabilité économique et, d'autre part, la santé publique. Nous nous refusons à un tel arbitrage. La proposition de loi vise à donner à l'État les moyens de prendre sans délais les mesures de santé publique et environnementale qu'exige une menace sanitaire et écologique réelle et immédiate.
Chacun l'admet désormais : il n'existe plus guère de doutes sur les risques qui entourent l'exposition au glyphosate et son usage. Dans un rapport publié en juin 2021 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), un groupe d'experts pluridisciplinaires a analysé 5 300 documents de la littérature scientifique internationale publiés depuis 2013. Cette relecture critique établit de multiples corrélations ou liens de causalité entre l'exposition au glyphosate et le développement de pathologies cancéreuses. Elle confirme en particulier le lien entre le glyphosate et le lymphome non hodgkinien, fait qui était avéré à la lecture du rapport de l'INSERM.
Au-delà, l'impact du glyphosate soulève une question plus vaste : celle de l'emploi des pesticides et des produits phytosanitaires. En sa qualité de président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), notre collègue Cédric Villani nous a d'ailleurs alertés devant la commission des affaires économiques : de tels produits jouent un rôle majeur dans l'effondrement de la biodiversité. En cela, les pouvoirs publics se trouvent placés devant un choix similaire à celui créé par l'usage du chlordécone. Comme pour ce pesticide utilisé massivement dans les bananeraies des Antilles de 1972 à 1993, nous possédons suffisamment d'éléments pour caractériser un produit probablement cancérigène. Néanmoins, nous tolérons son usage en raison de la place qu'il occupe dans les pratiques agricoles. Depuis décembre 2021, l'État reconnaît les cancers de la prostate provoqués par le chlordécone comme maladies professionnelles pour les agriculteurs de Guadeloupe et de Martinique. Ceux-ci peuvent désormais prétendre à une indemnisation. Je me réjouis que ce dossier ait abouti. Cela dit, je pose la question : le rôle de l'État est-il de réparer les conséquences de scandales sanitaires ou de les prévenir ? Il faut savoir tirer les leçons de l'expérience, et surtout être cohérent.
Voici plus de quatre ans, le 27 novembre 2017, le Président de la République a demandé au Gouvernement de « prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des [solutions] alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans trois ans ». Tranchons cette assertion : une telle démarche, placée sous les auspices d'une transition vers l'agroécologie, n'a pas fait ses preuves, car les résultats obtenus se révèlent sans rapport avec les engagements qui ont été pris.
En France, la consommation de glyphosate ne faiblit pas. Après une baisse de 37 % constatée en 2019, les ventes ont progressé à nouveau de 23 % en 2020. Cette année-là, leur volume a atteint 8 644 tonnes, soit un niveau proche de celui constaté en 2013. Ainsi, la France s'impose comme la championne d'Europe de l'utilisation de glyphosate : sa consommation représentait alors 19 % du glyphosate pulvérisé dans l'Union européenne, ce qui la plaçait devant la Pologne, l'Allemagne et l'Italie. Certains d'entre vous m'objecteront qu'entre 2017 et 2020, les ventes de substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), classées CMR 1 et CMR 2, ont enregistré des baisses substantielles. En vérité, je ne sais si nous pouvons nous satisfaire de tels résultats car nous ne parlons que de quelques molécules, les plus préoccupantes ou les plus toxiques, les suivantes étant amenées à rejoindre cette classification, par un effet de tapis roulant.
En réalité, la stratégie de sortie du glyphosate marque le pas. Concernant cette substance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) se borne aujourd'hui à ne pas renouveler les autorisations de mise sur le marché (AMM) ou à les assortir de nouvelles conditions. Une telle stratégie fonctionne-t-elle ? Certes, le nombre des produits autorisés formulés à base de glyphosate baisse : il est passé de 201 à la fin de l'exercice 2018 à 69 produits devant faire l'objet d'une nouvelle autorisation à la fin 2019.
Toutefois, les chiffres sont trompeurs : en effet, deux tiers des AMM n'ont pas fait l'objet d'une demande de renouvellement. Au-delà, les chiffres de ventes en attestent : la consommation du glyphosate persiste et à des niveaux élevés. Pourquoi ? Je n'incriminerai pas les agriculteurs. Je sais l'attention qu'ils portent à la préservation de l'environnement. Je vois les efforts consentis, notamment par ceux de nos paysans qui convertissent leur exploitation à l'agriculture biologique. Nous touchons là aux manifestations les plus concrètes des verrous socioéconomiques qu'évoquait le président Chassaigne devant la commission des affaires économiques : l'usage du glyphosate ne témoigne pas d'un attachement à une pratique contre-nature ; il révèle des conditions de production dont le poids crée des dépendances et incite au conservatisme.
Ce blocage, vous refusez de le lever, prétendant ainsi soutenir les agriculteurs comme la corde soutient le pendu. C'est la raison pour laquelle nous défendons l'interdiction du glyphosate sur l'ensemble du territoire national. Nous proposons d'édicter cette mesure de santé publique par la loi et dans les meilleurs délais, car désormais, il n'est plus temps de discuter de manière stérile et de tourner en rond.
Les termes du débat ont été largement posés au fil des textes dont le Parlement a été saisi depuis trois ans. Je pense bien évidemment à la proposition de loi de notre collègue Bénédicte Taurine, examinée en janvier 2019 ; mais je n'aurais garde d'oublier le texte déposé par Olivier Falorni. Chacun s'en souvient, nous avons également débattu de l'interdiction du glyphosate au cours de l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGALIM, en 2018, notamment grâce aux amendements défendus par le groupe La France insoumise, ainsi que par nos collègues Delphine Batho et François-Michel Lambert.
Il importe que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et tirent les enseignements de l'expérience s'agissant d'un enjeu de santé publique. Dans cet esprit, l'article unique du texte affirme un principe : il exclut la vente et l'usage du glyphosate sur le territoire national, ainsi que l'y autorise le droit européen. Pour autant, il habilite le pouvoir réglementaire à prendre les dispositions transitoires utiles à sa bonne application. Dès lors, la proposition de loi ne relève pas de la pétition de principe.
Sans pour autant exercer leur droit d'amendement, certains de nos collègues ont affirmé regretter l'absence de mesures d'accompagnement. En réalité, de tels dispositifs ne relèvent pas nécessairement du champ du texte dont nous discutons. Comme l'a relevé notre collègue Jean-Baptiste Moreau, on trouve des financements répondant à cet objectif dans les plans France relance et France 2030. Le législateur a par ailleurs accordé un crédit d'impôt. Dès lors, il conviendrait plutôt de se demander si les ressources correspondent aux besoins. Surtout, que faisons-nous pour promouvoir le développement des solutions alternatives au glyphosate ?
Longtemps, les opposants à son interdiction par voie législative ont tiré argument de l'absence de produits ou de pratiques de substitution. C'est là un point central que je voudrais aborder. Dans une large mesure, les travaux réalisés par l'ANSES depuis 2018 et ceux de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) conduisent aujourd'hui à relativiser cet obstacle, pour ne pas dire à le gommer entièrement. Que montrent-ils ? Qu'il existe des produits non chimiques ou des pratiques agronomiques susceptibles de remplacer le glyphosate pour ses principaux usages : la viticulture, l'arboriculture fruitière, les grandes cultures et la forêt.
Je ne fais ici que me référer aux travaux dont faisait état en décembre 2020 le rapport de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. Devant cette même mission, le 2 mai 2019, les représentants de la Fédération nationale de l'agriculture biologique (FNAB) des régions de France ont décrit de manière très précise des approches agronomiques alternatives dans la gestion des adventices. Celles-ci reposent notamment sur la succession des cultures, sur des rotations plus longues ou sur l'alternance des familles végétales cultivées pour réduire la prolifération des parasites et l'usage des pesticides. Pas moins de 55 000 agriculteurs bio se passent complètement, parfois depuis toujours, de ce pesticide. C'est la preuve par l'exemple, par l'évidence, que des solutions alternatives au glyphosate existent. Les progrès de l'agronomie ne condamnent pas l'agriculture française à un statu quo mortifère.
Mes chers collègues, l'interdiction du glyphosate n'a rien d'une mesure iconoclaste. Elle ne représente pas même une idée neuve en Europe, puisqu'à l'instar du Luxembourg, de la République tchèque, de l'Italie ou de l'Allemagne, des États s'engagent résolument à la pointe du combat. Il ne tient qu'à nous de donner à la France les moyens de montrer l'exemple en mettant sa législation en conformité avec un objectif de santé publique d'intérêt commun. Aussi, je vous appelle à voter la proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Monsieur le rapporteur, vous proposez, au nom du groupe La France insoumise, de légiférer à nouveau sur le glyphosate. Permettez-moi de vous dire, avec beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de conviction, que l'un des pires syndromes politiques est de tomber dans le simplisme. Je crois pouvoir dire que cette proposition de loi est la manifestation concrète de ce syndrome, dont votre groupe et vous-même êtes atteints.
Le simplisme voudrait que tout soit blanc ou noir, que les sujets puissent être traités de manière binaire, avec des 0 ou des 1, impliquant une déconnexion totale du réel. Le monde paysan, notre agriculture, notre souveraineté agricole, meurent de ce simplisme. Je vous le dis avec beaucoup de respect,…
…mais aussi beaucoup de détermination. Le simplisme va parfois de pair avec la stigmatisation ou de fausses informations. J'ai entendu M. Mélenchon dire qu'il existe en France des élevages de plus de 8 000 bovins. C'est totalement faux ! Savez-vous que les élevages bovins de notre pays comptent en moyenne 144 bêtes ?
Vous devriez être fiers de notre agriculture plutôt que la dénigrer, car les caricatures simplistes que vous évoquez existent, mais à l'étranger.
En dépréciant sans cesse notre agriculture, vous contribuez à fragiliser notre souveraineté alimentaire et à favoriser les importations.
À l'inverse, mesdames et messieurs les députés, le courage en politique consiste à affronter la complexité des choses, particulièrement du vivant. Voilà ce que fait ce gouvernement, voilà comment il a agi concernant le glyphosate et les produits phytosanitaires en général. Certes, l'enjeu est important, mais il faut aborder le sujet dans sa complexité, ce qui impose aux responsables politiques que nous sommes d'admettre certains principes.
Premièrement, n'en déplaise à certains, la transition agroécologique ne se décrète pas. Elle ne pourra s'accomplir qu'en investissant massivement. Sinon, cela ne marchera pas. Or, mesdames et messieurs les députés du groupe La France insoumise, vous n'avez voté aucun des budgets d'investissement : ni le plan France relance, avec lequel nous investissons 1,2 milliard dans l'agriculture, ni le plan France 2030, qui prévoit 2,8 milliards pour l'agriculture, ni le crédit d'impôt, que vous avez évoqué, ni aucune mesure d'accompagnement ou d'investissement. Vous n'êtes que dans l'injonction.
Deuxièmement, les transitions ne sont possibles que si on ne laisse personne sans solution. L'inverse conduirait tout simplement à détruire notre souveraineté alimentaire, tout en important des produits qui dégradent l'environnement et qui ne respectent pas nos propres règles de production, parmi les plus exigeantes au monde. Est-ce cela que nous voulons ? À l'évidence, non !
Toute aussi regrettable est le simplisme qui consiste à dire « loin de mes yeux, loin de mon cœur » – j'interdis tel ou tel produit chez moi, mais je continue, sans le dire, à importer des denrées produites avec son utilisation, dans des proportions bien plus graves.
Combien d'exemples avons-nous en tête, de la lentille à la cerise, en passant par la betterave ? Vous connaissez mon attachement au principe de réciprocité, or il n'apparaît nulle part dans votre proposition de loi.
Le courage en politique consiste donc à affronter la complexité en suivant une vision et une méthode, contrairement à ce que fait votre proposition de loi. C'est ainsi que nous avons abordé la question du glyphosate – car nous avons agi. Notre vision nous conduit à n'interdire que lorsque des solutions alternatives existent ; dans ce cas, nous les utilisons. En effet, nous croyons aux transitions agroécologiques, et nous savons qu'elles nécessitent des investissements massifs. Ces derniers doivent aussi concerner la recherche : nous déployons en ce moment même un plan de recherche doté de plus de 7 millions d'euros, qui finance actuellement plus d'une vingtaine de projets R&D (recherche et développement).
La méthode, quant à elle, consiste à replacer la science et la raison au centre des débats. La politique ne doit procéder ni de l'émotion, ni de la vertu, mais bien de la raison. C'est pourquoi nous avons demandé à l'INRAE, que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur, de produire des connaissances sur les solutions alternatives crédibles. Puis, avec l'ANSES, nous avons effectué la révision des autorisations de mise sur le marché en 2021. Cela nous a permis de revoir les quantités d'utilisation, de manière ambitieuse.
Cela marche : grâce à l'engagement des filières, des résultats sont déjà visibles. Soyons-en fiers, plutôt que de les dénigrer. Depuis que l'on mesure les quantités de glyphosate vendues, la moyenne triennale atteinte en 2020 a été la plus faible depuis la période 2009-2011 : nous sommes parvenus à stopper une hausse ininterrompue depuis dix ans. Grâce à la révision des AMM, les quantités utilisées devraient diminuer de 50 %. Un peu plus d'un tiers des exploitations se passent d'ores et déjà du glyphosate ; un autre tiers a commencé à réduire son utilisation, selon une enquête réalisée en 2019. Les transitions agroécologiques sont donc bien en cours et elles se sont accélérées ces dernières années. Nous continuerons à agir en ce sens, toujours avec vision et méthode. Oui, les agriculteurs vivent de l'environnement et chérissent le sol – ce que nous avons de plus précieux.
Ces résultats ne concernent pas seulement le glyphosate ; nous en avons de comparables pour les produits les plus préoccupants, dits CMR1, dont l'utilisation a diminué de 93 % – je dis bien 93 % – depuis 2016 ; les ventes cumulées de produits CMR1 et CMR2 ont diminué de 40 % depuis 2017. Les surfaces exploitées en agriculture biologique ont doublé en cinq ans et le nombre d'exploitations possédant la mention HVE – haute valeur environnementale – a été multiplié par vingt en trois ans. Voilà les résultats que suscitent notre vision, notre méthode et notre détermination. Continuons à agir en ce sens, plutôt que de toujours dénigrer les choix effectués.
La position de la France, fondée sur la raison et la science, est très claire : nous sommes déterminés à faire avancer fortement les transitions agroécologiques, tout en gardant à l'esprit notre volonté de ne jamais, jamais déléguer notre souveraineté alimentaire. Le Président de la République a clairement exprimé cette intention récemment : la transition agroécologique est nécessaire ; elle est engagée, nous devons l'accompagner et investir pour la poursuivre – et non formuler des injonctions. Cela justifie les 4,2 milliards d'euros de budget prévus, si l'on additionne les plans France relance et France 2030.
Nous sommes favorables à l'arrêt du glyphosate, lorsqu'il existe d'autres solutions réalistes, c'est-à-dire viables économiquement et cohérentes en matière environnementale. Ce que la France a accompli avec la révision des autorisations de mise sur le marché, par exemple, les autres États membres de l'Union européenne ne l'ont pas fait, à l'exception du Luxembourg, mais, avec tout le respect que j'éprouve pour le Luxembourg, il ne s'agit pas de la plus grande puissance agricole européenne, loin de là. Aussi avons-nous l'intention de défendre ces décisions au niveau européen, à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union.
Enfin, s'agissant du glyphosate, la complexité du vivant a un visage, c'est celui de l'agriculture de conservation. En effet, elle capte le CO
Par ailleurs, avez-vous mesuré le nombre de tonnes de CO
La situation est complexe et interdit tout simplisme. Elle nous oblige au contraire à agir avec méthode, comme je viens de vous l'exposer. La noblesse de la politique naît de sa réussite à appréhender cette complexité. C'est ce à quoi parvient la majorité présidentielle qui siège devant moi, et je l'en remercie.
Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et Dem.

Le 27 novembre 2017, alors que l'Union européenne avait renouvelé la commercialisation du glyphosate, le Président Emmanuel Macron promettait que l'utilisation du glyphosate serait interdite en France dès que des solutions alternatives auraient été trouvées, « et au plus tard dans trois ans ». Était-ce alors une pensée politique simpliste, monsieur le ministre ? Quoi qu'il en soit, quatre ans et demi plus tard, cette interdiction n'est toujours pas en vigueur.
Ce renoncement environnemental n'est pas isolé. Les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles ont été réintroduits, des fermes usines ont été autorisées…
Où ça ?

…et la cellule de gendarmerie Demeter traque les militants écologistes.
Finalement, le Président de la République et La République en marche accompagnent avec soin le modèle Monsanto. La réglementation sur les pesticides est au service des firmes. Les données fournies par les industriels sont confidentielles. Le vote des États dans les comités d'homologation est secret. Tout cela découle de l'opacité des lois européennes sur les autorisations et les interdictions de pesticides.
D'ici à la fin de 2022, l'Union européenne doit de nouveau statuer sur la prolongation pour cinq ans de l'autorisation du glyphosate. Depuis le début de l'année, La France est présidente du Conseil de l'Union européenne. Elle doit donc être exemplaire et ambitieuse, en l'interdisant immédiatement. C'est ce que prévoit la proposition de loi de mon collègue Loïc Prud'homme.
La situation est dramatique. En 2016, 800 000 tonnes de Roundup – le nom commercial du glyphosate – et de ses adjuvants, ont été répandues sur la planète. En France, la réduction de l'utilisation du glyphosate n'est pas sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs pourtant modestes que s'était fixés le Gouvernement, à savoir une diminution de moitié d'ici à 2022 – nous sommes en 2022. En effet, la vente de glyphosate a augmenté d'environ 42 % entre 2019 et 2020, passant de 6 000 tonnes en 2019 à 8 600 tonnes en 2020.
Or le glyphosate présente un risque avéré pour la santé et l'environnement. Depuis 2015, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) le reconnaissent comme cancérogène probable. Un nouveau rapport de l'INSERM, publié le 30 juin 2021, le confirme ; il pointe le lien entre l'exposition au glyphosate et la présence de lymphomes. Est-ce là une constatation simpliste ?
De plus, on ne compte plus les témoignages et les enquêtes sur les maladies et malformations que ce produit provoque. Selon la Mutualité sociale agricole (MSA), un agriculteur sur cinq souffre de troubles de santé directement liés à l'usage des pesticides. Le glyphosate est rarement utilisé seul, plutôt en association avec d'autres composés, qui renforcent son action.
Nous refusons que le glyphosate alimente, à l'instar du chlordécone, la pléthore des scandales d'État. En France, jusqu'en 2007, il était étiqueté biodégradable et supposé respecter l'environnement, alors même que ses résidus détruisent la biodiversité, s'accumulent dans les nappes phréatiques et contaminent les aliments. Des résidus ont notamment été retrouvés dans le miel. En 2017, l'organisation non gouvernementale (ONG) Générations futures a annoncé avoir trouvé des traces de glyphosate dans les urines de presque tous les Français testés. Sollicité par le collectif ariégeois Campagne glyphosate, j'ai accepté de me soumettre à un test. Le résultat était déconcertant : 1,167 nanogramme par millilitre. Or je ne suis pas un cas isolé : on a trouvé des traces de glyphosate dans les urines de 99,7 % des 6 796 participants.
Plus globalement, le glyphosate est un symbole d'un système agricole à bout de souffle. Verrouillé par l'agrochimie, il ravage la biodiversité. Interdire le glyphosate, c'est mener une politique contre les lobbies et pour la transition écologique. Personne ne peut ignorer combien il est difficile pour les agriculteurs et les agricultrices de vivre de leur métier, ni à quel point le modèle d'agriculture productiviste est cause de souffrance : 18 % des ménages agricoles vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon une étude de l'INSEE parue en octobre 2021. D'après la MSA, 605 agriculteurs se sont suicidés en 2015. Ce sont des faits, monsieur le ministre, pas un constat simpliste. L'agriculture paysanne et biologique constitue la seule issue sérieuse à l'agriculture Monsanto et à la précarité des agriculteurs.
Le rapport publié en 2017 par l'INRAE confirme que l'agriculture biologique est économiquement performante : elle est davantage rémunératrice pour les paysans. Si nous changeons de modèle pour développer une agriculture vertueuse, nous créerons des milliers d'emplois, tout en protégeant la biodiversité. Les conclusions du rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l'agroécologie vont dans le même sens : « les exploitations agroécologiques […] sont en général plus rentables que les exploitations conventionnelles, alors que leurs exigences environnementales sont élevées ». S'il vous faut une preuve supplémentaire qu'un autre modèle est possible, pensez aux 53 000 agriculteurs et agricultrices bio qui font la démonstration que l'on peut se passer du glyphosate !
Alors comment faire ? Sortir du glyphosate implique de passer par la loi.
Nous devons offrir aux agriculteurs et aux agricultrices un cadre leur permettant d'envisager sereinement l'avenir, un engagement ferme pour la santé publique et contre les multinationales des phytosanitaires, qui doit s'accompagner d'un modèle économique qui profite avant tout aux paysans et aux paysannes. C'est la raison pour laquelle nous devons leur garantir un revenu décent durant la transition vers l'agroécologie. Nous proposons de sortir des marchés agricoles mondialisés, de garantir des prix planchers à toutes les productions, de fixer des quotas ou encore d'instaurer un protectionnisme solidaire sur des critères sociaux, environnementaux et sanitaires.
D'autres leviers d'action sont à notre disposition. Contrairement à votre ambition, il faut absolument garantir aux agriculteurs qu'ils ne vendront pas leurs produits à perte, sous la pression d'une concurrence prétendue libre et non faussée. Plutôt que de baisser les prix et les marges des producteurs, vérifions les marges des distributeurs et donnons les moyens à tous les Français d'acheter des produits de bonne qualité, en augmentant les salaires.
Mme Caroline Fiat applaudit.

Nous pouvons aussi garantir un accès au foncier pour les Français et les Françaises souhaitant vivre de l'agriculture, notamment en sanctuarisant les terres arables et en contrôlant l'accaparement des terres. Le levier de la restauration collective doit également être pleinement activé pour orienter la demande et pour garantir des débouchés économiques suffisants aux producteurs.
Enfin, il faut veiller à sortir de l'hyperspécialisation des cultures, qui nuit à l'autonomie alimentaire de notre pays, et retrouver la diversification et la rotation dans les productions. Combinée à ces solutions, l'interdiction immédiate de la vente et de l'usage de glyphosate en France est possible ! Chers collègues, pour la santé de toutes et de tous, pour l'avenir de notre planète et des générations futures, votez la proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Ce débat intervient plus de quatre ans après le fameux tweet dans lequel le Chef de l'État annonçait vouloir « prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France », alors que la procédure pour actualiser l'autorisation du glyphosate suit actuellement son cours au niveau européen et que le Gouvernement semble avoir fait le choix d'une stratégie de sortie très progressive du glyphosate, assortie de dispositifs d'aides et d'alternatives en direction des agriculteurs qui s'imposent mais demeurent très insuffisantes à nos yeux.
Nous nous accordons tous, sur ces bancs, sur la dangerosité de cette substance, sur ses effets néfastes sur la santé humaine et sur l'impact indiscutable de la molécule sur la biodiversité – plantes, adventices et insectes. Si ses effets sur la santé humaine sont des objets de controverses, le CIRC et l'OMS ont inscrit, dès 2015, le glyphosate sur la liste des substances cancérogènes probables. À l'inverse, la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède, qui constituent le groupe d'évaluation sur le glyphosate, ont réitéré, dans leur rapport de juin dernier, l'affirmation selon laquelle « la classification du glyphosate au regard de la cancérogénicité n'était pas justifiée ». Ils ont donc fait droit aux lobbies industriels et proposé de ne pas modifier la classification existante, se contentant de maintenir uniquement les références aux lésions oculaires « graves ».
Le second constat sur lequel nous nous accordons est celui de l'échec des plans successifs de réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Les causes de cet échec sont multiples. Elles ont été étudiées par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'INRAE : ceux-ci pointent notamment le fait que les actions des pouvoirs publics n'ont ciblé que les agriculteurs et leurs conseillers, sans tenir compte des interdépendances qui relient l'ensemble des acteurs économiques engagés dans la logique de systèmes agricoles, dans lesquels les pesticides jouent un rôle de pivot.
Cet échec résulte aussi de l'aggravation des conditions de la concurrence et de l'absence de volonté européenne et nationale d'accélérer la transition agroécologique. Nous le redisons aujourd'hui, avec force, à l'occasion de l'examen de ce texte : la transformation agroécologique de notre agriculture, par conséquent la réduction très importante de l'usage des intrants et des produits phytosanitaires, est un défi agronomique de grande ampleur qui nécessite des politiques structurelles au plan européen comme national : des garanties de prix des productions, une déspécialisation des territoires, une complémentarité entre systèmes d'élevage et de grandes cultures, des actifs agricoles beaucoup plus nombreux sur tous les territoires. La future politique agricole commune (PAC) et les plans stratégiques nationaux, en cours de finalisation, n'ont toujours pas pris la mesure de cette ambition.
Nous aurions néanmoins tort de laisser croire que nous réglerions à bon compte le problème global de l'utilisation des centaines de produits phytosanitaires auxquels recourt l'agriculture, en interdisant, simplement par la loi, l'usage du glyphosate. Si, comme les disent les derniers travaux d'expertise de l'INRAE, il est possible de se passer de glyphosate dans une majorité de cultures, la situation est plus complexe pour les grandes cultures, car se passer sans délai et totalement du glyphosate en grandes cultures suppose un changement brutal des pratiques culturales, avec un travail du sol renforcé et des labours plus fréquents.
Or, le labour régulier influe fortement sur la structure et sur la dynamique de la vie des sols. À l'inverse, moins on travaille le sol, plus on participe à son bon fonctionnement, à la conservation de ses qualités agronomiques, au stockage de matière organique et de carbone, à l'activité microbienne et à la rétention d'eau.
Exactement !

Il s'agit d'objectifs contradictoires, qui sont parfaitement bien référencés dans les évaluations de l'INRAE. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ces obstacles techniques, qui concernent notamment tous les agriculteurs engagés en agriculture de conservation ou dans des techniques limitant drastiquement le travail du sol. En tout état de cause, nous ne saurions interdire le glyphosate sans faire valoir – même transitoirement – des exceptions ou des dérogations à cette interdiction, pour les pratiques agricoles écologiquement vertueuses, ni sans laisser le temps aux alternatives d'être développées et appliquées.
Ainsi, si nous comprenons que l'interdiction du glyphosate ait aujourd'hui valeur de symbole dans le combat en faveur d'une transformation de notre modèle agricole, nous aurions aimé que le texte de nos collègues fasse droit à la réalité extrêmement complexe du terrain, en prévoyant des dérogations. Par conséquent, nous nous abstiendrons sur ce texte.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe Dem.

Une fois encore, nous nous retrouvons à rejouer le match de la question de l'interdiction du glyphosate. Une fois encore, le sujet est mis sur la table par l'opposition. Comme je l'ai rappelé lors de nos débats en commission, le discours de la majorité n'a pas changé et la ligne reste très claire : pas d'interdiction sans solution.
La proposition de loi, avec son article unique, ne prévoit ni accompagnement, ni solution, ni alternatives. Face au constat d'une proposition de loi idéologique, le groupe majoritaire ne peut que se mettre en travers d'une décision qui toucherait notre agriculture, déjà bien fragilisée par les discours dogmatiques et par les campagnes de dénigrement. C'est pourquoi le groupe La République en marche s'opposera au texte. Que l'on ne nous fasse pas dire ce que nous n'avons pas dit : le groupe LaREM est favorable à une réduction de l'usage de produits phytosanitaires en agriculture, ce qui était d'ailleurs l'une des ambitions du Président de la République en 2017. Nous nous opposons cependant à une suppression pure et simple du glyphosate, sans apporter de réponses aux agriculteurs qui en seraient privés.
Si notre position n'a pas changé, les choses ont en revanche évolué dans le monde agricole. Les ventes de substances les plus préoccupantes, dites CMR1, ont été réduites de 93 % par rapport à 2017. Les ventes de produits CMR1 et 2 ont baissé de 37 % entre 2017 et 2020. Ces chiffres ne sont pas contestables. Ils méritent d'être mis en lumière, car ils reflètent tout le travail et l'adaptation du monde agricole.
La position que nous adoptons n'est pas idéologique. Elle s'appuie, au contraire, sur un travail sérieux, mené pendant plus d'un an au sein d'une mission d'information, avec mes collègues Julien Dive – président – et Jean-Luc Fugit – corapporteur. Des conclusions de cette mission, monsieur le rapporteur, vous n'avez retenu que ce qui vous arrangeait et allait dans votre sens. Les conclusions des auditions et des travaux que nous avons menés étaient pourtant claires : pas d'interdiction de l'utilisation en l'absence d'alternative – une alternative s'entendant à la fois comme économiquement viable, mais aussi techniquement efficace.
La proposition n'apporte pas non plus de réponse sur la question économique et sur l'accompagnement, car oui, comme nous l'avions déjà souligné lors de notre rapport l'an dernier, l'interdiction du glyphosate entraînera des surcoûts importants et variables, en fonction des filières et des pratiques culturales, se traduisant notamment par un besoin de recourir à une main-d'œuvre supplémentaire et par la nécessité d'acquérir de nouveaux équipements. L'ensemble des textes relatifs à la question agricole montre à quel point la question du financement est centrale. Allons-nous sérieusement accepter une proposition qui conduirait les agriculteurs à une impasse financière, alors que leur situation économique est l'une des plus fragiles du pays ?
Si certains usages peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'alternatives, comme dans le cas de l'arboriculture, pour laquelle l'ANSES avait conclu que le traitement en inter-rang était possible sans glyphosate – son usage a d'ailleurs été interdit –, d'autres, comme la vigne, ne permettent pas le remplacement du glyphosate sous le rang : pour certaines plantes vivaces, telles le liseron, il n'y a actuellement pas d'autre possibilité que l'utilisation de ce produit. Le président Chassaigne a par ailleurs rappelé la nécessité du glyphosate concernant l'agriculture de conservation des sols.
Par ailleurs, agiter l'idée d'une interdiction du glyphosate prouve une méconnaissance de la complexité et de l'hétérogénéité de l'agronomie et de ses particularismes. En tant qu'ingénieur agronome, je sais à quel point ces situations sont plus complexes qu'elles n'y paraissent et dépassent largement le « y a qu'à, faut qu'on ».
Quand on sait que la moitié des agriculteurs partiront à la retraite d'ici quatre ans, les enjeux de souveraineté agricole et alimentaire demeurent centraux : une interdiction pure et dure ne ferait que créer davantage de difficultés pour nos agriculteurs et pour tout un secteur en proie tant aux conséquences dramatiques du changement climatique qu'à des injonctions idéologiques contradictoires permanentes – sans prendre un instant en considération les efforts qui ont été menés par notre agriculture.
La sortie des produits phytosanitaires les plus dangereux a été largement encouragée par notre majorité, notamment grâce à la séparation du conseil et de la vente permise par la loi EGALIM, grâce à la mise en place, en 2020, d'une stratégie de déploiement du biocontrôle pour faciliter l'accès au marché, grâce à un soutien massif aux investissements pour le déploiement de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, avec France Relance – pour un montant de 245 millions d'euros, comme l'a indiqué le ministre –, grâce aux 600 millions d'euros prévus par France 2030 pour contribuer à la troisième révolution agricole, avec une accélération de la recherche et du développement, et grâce à la mise en place du crédit d'impôt « sortie du glyphosate » d'un montant de 2 500 euros, bénéficiant à tous les agriculteurs qui se passent de glyphosate sur une année. Vous l'aurez compris, notre majorité choisit l'accompagnement plutôt qu'une interdiction sans solution.
Nous devons aussi tenir compte du contexte européen : la France pousse justement à une interdiction à l'échelon européen, car il n'y aurait rien de pire que d'interdire le glyphosate en France, tandis que son utilisation donnerait à nos voisins un avantage concurrentiel très net. C'est pourquoi notre majorité a fait le choix assumé du pragmatisme – pas d'interdiction sans alternative – et s'opposera donc à la proposition de loi.

Je le redis – je l'ai déjà indiqué au nom du groupe UDI-I devant la commission –, l'affaire du glyphosate est devenue un totem : c'est l'arbre qui cache la forêt.
Exactement !

Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un vrai sujet de réflexion : ce produit, dont on doit user avec la plus grande délicatesse, car il s'agit d'un désherbant, contenant des matières actives susceptibles d'être nocives. Ce débat vaut cependant pour l'ensemble des herbicides, pour l'ensemble des fongicides et pour l'ensemble des insecticides utilisés en agriculture. En France, nous devrions être échaudés par ce qui s'est passé avec les néonicotinoïdes : il y a quelques années, on a fait plaisir à certains en les supprimant, puis, ensuite, invoquant le principe de réalité, les acteurs de terrain ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas s'en passer.
Conclusion, le Gouvernement a dû faire machine arrière, c'est le cas de le dire. Nous avons bonne mine vis-à-vis de nos concitoyens, des agriculteurs et des producteurs – c'est-à-dire que nous sommes ridicules. Je le dis au ministre actuel, comme je l'ai dit en son temps à Stéphane Travert, son prédécesseur : à l'époque, la déclaration et le tweet du Président de la République n'ont pas aidé. Disons les choses comme elles sont, il était sous la mauvaise influence de Nicolas Hulot. C'est le ministre de l'agriculture, Stéphane Travert, qui a payé un lourd tribut à ces querelles entre environnement et agriculture ; on a demandé sa tête pour satisfaire les desiderata de celles et ceux qui soutenaient Nicolas Hulot.
Pour suivre les questions agricoles depuis plusieurs années, comme de nombreux députés dans cet hémicycle, je voudrais dire que les agriculteurs ont accompli de nombreux progrès. Nous sommes passés de l'agriculture écologiquement intensive, il y a une petite vingtaine d'années – Michel Barnier était alors ministre de l'agriculture –, à l'agriculture de conservation des sols que vous connaissez, cher Julien Denormandie. Entre-temps, l'agroécologie est apparue – tout le monde en a désormais validé le concept – et s'est notamment s'accompagnée de l'instauration de la certification HVE. Naturellement, nous devons soutenir et encourager l'agriculture bio ; elle est une solution alternative, quoique pas la seule. En effet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le ministre, en cinq ans, la surface agricole du bio a été multipliée par deux.
Revenons à la réflexion globale, qui est l'angle sous lequel nous devons envisager l'ensemble des produits phytosanitaires utilisés dans le monde, dans l'Union européenne et en France. En France, nous utilisons 8 000 tonnes de glyphosate, chiffre que nous devons mettre en rapport avec le volume total des produits phytosanitaires utilisés, soit 75 000 tonnes.
Je reprends l'argument de plusieurs collègues car il renvoie à une réalité : à mon retour dans ma circonscription de Fougères, en Bretagne, j'entends déjà les agriculteurs me demander ce que nous avons encore voté et quels sont les boulets aux pieds que nous leur mettons. En effet, ce type de réflexion devrait, à tout le moins, avoir lieu à l'échelle de l'Union européenne. Si nous instaurons des contraintes supplémentaires qui ne pèsent pas sur nos homologues allemands, italiens, espagnols, et sur les autres pays membres de l'Union européenne, la concurrence sera faussée et la compétitivité entravée.
Pour conclure, je suis favorable à l'objectif recherché de réduction drastique voire d'extinction de l'usage des produits phytosanitaires en France. Mais comme l'a dit André Chassaigne, nous ne pouvons instaurer une telle mesure sans faire preuve de pragmatisme, sans prévoir de dérogations ni sans prendre en considération l'existence d'une réciprocité avec l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient des pays membres de l'Union européenne ou d'autres pays du monde. C'est pour cette raison que le groupe UDI-I ne soutiendra pas la proposition de loi.
Mme Marguerite Deprez-Audebert applaudit.

Collègues du groupe La France insoumise, cette proposition de loi atteste de votre volonté de protéger les Français contre cette substance – nous la partageons –, mais aussi et surtout, je le crains, de votre résolution à faire de ce sujet le caillou dans la chaussure de la majorité. Mais tel ne sera pas le cas. Nous assumons clairement la position qui a été et qui reste la nôtre.
En 2017, le Président de la République s'était engagé à mettre fin au plus vite au glyphosate. Ses dernières déclarations sur le sujet ne vous auront pas échappé : l'objectif de sortie en trois ans n'a malheureusement pas pu être atteint pour des raisons qui ont été largement expliquées – monsieur le ministre les a rappelées. Toutefois, notre détermination est restée la même depuis le début de la législature, comme en témoignent les mesures instaurées pour limiter l'utilisation de cette molécule. En 2017, le glyphosate a été interdit dans les espaces publics ; deux ans plus tard, nous en avons interdit l'utilisation par des particuliers, qui est donc strictement réservée aux agriculteurs ; par ailleurs, depuis l'an dernier, l'usage du glyphosate est autorisé uniquement dans les situations où il n'y aurait aucune solution alternative. Au cours de l'année 2022, cette mesure se traduira par une baisse non négligeable de la consommation de cette substance. Nous nous sommes donc bel et bien engagés dans une trajectoire de sortie du glyphosate.
Surtout, nous sommes conscients de l'ampleur du défi. Cela se traduit aussi dans notre bilan en matière de réduction de l'utilisation des pesticides, en baisse de 20 % en 2020 par rapport à la période 2012-2017. Nous pouvons également nous satisfaire de la chute très significative de l'utilisation des substances les plus préoccupantes relevant de la catégorie CMR entre 2016 et 2020. Dans le cadre du plan de relance et du plan d'investissement France 2030, nous allons plus loin, en renforçant le développement de produits de biocontrôle et en réduisant les autorisations de mise sur le marché de nombreux produits contenant du glyphosate. Quant aux investissements, plus de 800 millions d'euros sont engagés pour renouveler et acheter des équipements de substitution et pour accélérer la troisième révolution agricole. Celle-ci s'appuiera, entre autres, sur l'agroécologie qui se développera.
En effet, chers collègues, le nerf de la guerre est bien la recherche de solutions alternatives. La sortie du glyphosate nécessite un travail de préparation et de recherche sur plusieurs années, dans lequel nous sommes déjà engagés. Néanmoins, il faut reconnaître la réalité, nous ne disposons pas encore d'alternative fiable et pérenne au glyphosate pour l'ensemble des cultures agricoles. Il faut donc avancer avec pragmatisme et surtout renforcer les moyens alloués au développement et à la recherche.
En revanche, sortir du glyphosate de manière immédiate et unilatérale serait lourd de conséquences pour les Français. La sortie immédiate du glyphosate engendrerait des surcoûts de 50 à 150 euros par hectare, mettant à mal la viabilité économique de nos exploitations agricoles et menaçant même certaines de disparition, ce qui aurait notamment pour effet de réduire notre capacité d'exportation et d'aide alimentaire à l'Afrique. La distorsion de concurrence créée par cette interdiction ne serait pas acceptable pour nos agriculteurs : l'interdire en France seulement conduirait à manquer notre cible avec pour premières victimes, les agriculteurs français.
Pour notre bonne information, rappelons que seul un pays en Europe interdit le glyphosate : le Luxembourg. Les autres États membres ont soit renoncé – l'Autriche, par exemple –, soit fait des annonces sans appliquer la mesure. Dans le monde, seul le Sri Lanka l'avait interdit pour finalement revenir sur cette mesure.
Il en résulte mon troisième point : l'actuelle présidence française du Conseil de l'Union européenne sera l'occasion pour notre pays d'être, une fois de plus, la locomotive de ce combat jusqu'à ce que la Commission européenne présente sa proposition sur le sujet d'ici à la fin de l'année. En effet, rappelons que c'est le gouvernement français qui, au mois de novembre 2017, a évité la prolongation de la licence du glyphosate de dix ans en la ramenant à une durée de cinq ans. Nous devons continuer sur cette voie et trouver une solution avec nos partenaires européens pour tendre vers une convergence environnementale et sociale européenne. C'est au niveau européen que doit se résoudre le problème ; notre collègue Chassaigne partage ce point de vue.
Nous sommes nombreux à penser que nous ne pouvons pas laisser nos agriculteurs sans solution, dans une impasse. Pire, l'interdiction immédiate du glyphosate serait susceptible d'engendrer des usages dont l'impact environnemental et sanitaire ne serait pas plus souhaitable. Vous l'aurez donc compris, le groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés est contre cette proposition de loi qui va, qui plus est, à l'encontre de notre objectif essentiel de consolider notre souveraineté alimentaire.
M. Nicolas Turquois applaudit.

Le modèle agricole français est depuis longtemps l'un des plus performants au monde. Mais, au-delà de sa productivité désormais bien acquise, un nouvel enjeu a évidemment émergé : le respect de l'environnement. La question des pesticides, plus particulièrement le glyphosate, cristallise naturellement une grande partie des débats. Nous avons d'ailleurs échangé longuement au sein de mon groupe sur la meilleure stratégie à adopter ; je dois dire que des nuances se sont exprimées sur l'objet de ce texte. Néanmoins, nous nous retrouvons tous sur les effets délétères de ces substances pour la santé et pour l'environnement, qui sont largement étayés, pour ne pas dire incontestables.
En ce qui concerne le glyphosate plus spécifiquement, le rapport publié au mois de juin 2021 par l'INSERM confirme le lien de causalité entre l'exposition au glyphosate et le développement de pathologies cancéreuses. C'était d'ailleurs ce que pressentait le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, lorsqu'il a classé l'herbicide en tant que cancérigène probable. Les preuves de son impact sur l'environnement sont pour leur part de plus en plus nombreuses. Parmi les effets négatifs, on trouve une baisse de l'incorporation des éléments nutritifs des sols, tels que le fer, le zinc et le manganèse. Les impacts non négligeables sont également à noter sur la faune, puisque les animaux qui y sont exposés connaissent une baisse de leur fertilité.
Au vu de ces éléments, nous sommes d'accord avec vous, il y a urgence à sortir de la dépendance au glyphosate. C'était également ce que défendait initialement le président Emmanuel Macron, nous nous en souvenons tous. Le 27 novembre 2017, le chef de l'État demandait au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France au plus tard dans un délai de trois ans. Nous connaissons aussi la suite : à peine deux ans plus tard, un rétropédalage est intervenu.
Aujourd'hui, le Gouvernement renvoie aux instances communautaires la responsabilité d'interdire l'utilisation du glyphosate. Dans un grand marché ouvert, il n'est en effet pas incongru que la réglementation applicable soit la même partout en Europe. Cela tombe bien, la France vient de prendre la présidence de l'Union européenne et la licence de mise sur le marché du glyphosate sur le Vieux Continent expire à la fin de l'année 2022. Nous avons donc une chance unique de faire avancer le dossier. Une seule question demeure : la lutte contre les pesticides sera-t-elle l'une des priorités de l'agenda français ?
Mon opposition de principe au glyphosate n'est pas un aveuglement. Je suis conscient qu'en interdire immédiatement l'usage serait, dans certains cas, synonyme de champs envahis de mauvaises herbes et de baisse de rendement ; dans d'autres circonstances, cela se traduirait par l'utilisation d'herbicides autrement plus dangereux ; dans d'autres, enfin, ce serait un retour au labourage intensif. Finalement, ce sont autant de mauvaises nouvelles pour notre planète et pour nos agriculteurs. C'est pourquoi je défends un calendrier de sortie progressive et déterminée de l'herbicide.
Certains sur ces bancs souhaitent se borner à suivre les préconisations de l'ANSES en matière d'usage de l'herbicide. Pour ma part, je considère qu'elles ne sont pas assez ambitieuses. En 2020, les doses avec lesquelles les agriculteurs pourront traiter leurs cultures ont été réduites de 80 % pour la viticulture et de 60 % pour l'arboriculture et les grandes cultures. Cependant, force est de constater que les quantités utilisées en moyenne par nos agriculteurs sont souvent inférieures au nouveau plafond défini. Aussi, l'année 2021, première année où les restrictions de l'ANSES s'appliqueront, sera déterminante pour évaluer s'il y a réellement eu des changements de pratiques. Bien évidemment, j'espère qu'elle marquera une inversion de la tendance. Mais quoi qu'il advienne, je suis convaincu qu'il faudra mettre en œuvre de nouvelles restrictions pour aller vers une interdiction totale de l'usage du glyphosate.
Cette interdiction, justement, ne pourra se faire sans un accompagnement renforcé de nos agriculteurs afin qu'ils modifient leurs pratiques. Je reconnais que le Gouvernement a appliqué certaines mesures visant à inciter les exploitants à se passer de l'herbicide. Le plan France relance consacre des crédits au renouvellement des équipements ou à l'achat d'équipements de substitution. Lors de l'examen du projet de loi de finances, nous avons également voté un crédit d'impôt spécifique au bénéfice de certaines entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate.
Toutefois, ces diverses mesures restent largement insuffisantes pour permettre la transition de l'ensemble de la filière. À l'avenir, il faudra renforcer les aides pour permettre à ceux qui travaillent la terre de s'engager résolument dans un modèle de production respectueux de l'environnement et de la santé. En attendant que ces mesures soient appliquées et pour en revenir à l'objet du texte, les députés de mon groupe se détermineront en conscience. Pour ma part, vous l'aurez compris, je voterai pour la proposition de loi, en espérant qu'elle permette d'accélérer le calendrier de sortie du glyphosate.

Dans l'entretien qu'il a accordé le 4 janvier 2022, le Président de la République a affirmé : « Sur le glyphosate, je n'ai pas réussi. Certains agriculteurs m'ont dit que si on les obligeait à sortir rapidement, ils allaient mettre la clé sous la porte, parce que les concurrents espagnols ou italiens, eux, pouvaient continuer à produire. C'est l'erreur que j'ai commise en début de quinquennat : il faut agir sur ces sujets au niveau européen. Cela ne marche pas si on le fait tout seul. Je ne peux pas mettre des agriculteurs dans des impasses et sans solution ; l'on est à l'heure des solutions pratiques. »
Voilà qui fait écho à la proposition de loi que nous soumet aujourd'hui La France insoumise. Mais en toute logique, c'est une proposition de résolution européenne que vous auriez dû déposer, et je suis certain que le Parlement vous aurait suivi sur un texte qui demanderait au Gouvernement de redoubler d'efforts dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne pour convaincre nos partenaires européens de ne plus renouveler l'autorisation du glyphosate.
Mais non, comme à l'accoutumée, vous préférez vous enfermer dans une vaine gesticulation verbale qui n'a d'autre finalité que d'affoler la presse et d'embrouiller les esprits.
Je note cependant, et je l'ai dit en commission à notre rapporteur, que pour une fois vous avez soigné l'emballage. D'habitude, La France insoumise ne s'embarrasse pas de considérations juridiques pour décréter le bonheur universel à la place du peuple. Cette fois, notre collègue Loïc Prud'homme décortique soigneusement l'articulation entre la réglementation européenne et le droit national, entre les prérogatives qui sont celles de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil, celles des ministres français et le rôle incontournable de l'ANSES. Cela a au moins le mérite d'être pédagogique pour les insoumis qui suivent nos débats.
En effet, et c'est bien de le reconnaître, la France est engagée par des traités avec ses voisins européens. C'est une sage décision puisque nous avons une monnaie unique, dans un marché unique, dans un espace juridique commun qui garantit la libre circulation des biens et des personnes.
À l'occasion de la pandémie que nous traversons, cette Europe, que d'habitude vous dénoncez, a montré que non seulement elle nous permet de préserver notre économie et notre sécurité, mais qu'elle est également utile pour coordonner nos efforts afin de juguler le virus par l'acquisition et la diffusion de vaccins. Mais cet effort pédagogique tombe, comme souvent, dans le vide, puisque vous persévérez dans votre posture isolationniste en réclamant l'interdiction du glyphosate de façon unilatérale.
Cependant, ce qui me déçoit le plus, c'est que vous ignorez délibérément les travaux de l'Assemblée nationale durant les quatre dernières années. Vous ne mentionnez à aucun moment les travaux de la mission d'information commune présidée par notre collègue Élisabeth Toutut-Picard et dont les rapporteurs étaient Didier Martin et Gérard Menuel.
Dès avril 2018, le rapport a conclu que la question des produits phytopharmaceutiques ne pouvait pas déboucher sur une réponse simpliste, mais qu'il fallait une approche systémique en faveur du développement de l'agroécologie.
Vous prétendez que la France n'a rien fait. Pourtant, à ce jour, l'ANSES a retiré 131 autorisations de mise sur le marché du glyphosate sur les 201 qui existaient en début de législature, soit les deux tiers.
M. Prud'homme semble également ignorer les conclusions de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate, présidée par notre collègue Julien Dive, dont les rapporteurs étaient Jean-Baptiste Moreau et Jean-Luc Fugit : elle n'a droit qu'à une note de bas de page. Pourtant, dès novembre 2019, cette mission a permis au Parlement de définir la ligne de crête pour une réduction progressive des usages du glyphosate. Il s'agit d'un rapport fouillé, et rarement le Parlement a déployé autant d'énergie sur une question, ce qui montre bien que l'Assemblée nationale attache à ce sujet l'importance qu'il mérite.
À la suite de ces travaux qui rappelaient que la SNCF est le premier utilisateur de glyphosate pour le désherbage des voies ferrées, la compagnie nationale vient d'annoncer qu'elle a trouvé une solution alternative et qu'elle renonce dorénavant à ce désherbant. Dans la vraie vie, il faut parfois du temps pour changer les méthodes de travail : plus de deux ans dans ce cas. La France insoumise préfère stigmatiser les paysans français et passer sous silence les pratiques des entreprises publiques où elle espère probablement récolter des suffrages.
Nous l'avons compris : cette proposition de loi n'a d'autre vocation que de mettre en lumière un totem de votre ligne politique. Elle en dit cependant long sur le mépris de La France insoumise pour le travail du Parlement et probablement pour la démocratie en général : pour vous, ce lieu n'est qu'une tribune pour clamer votre harangue.
Comme vous l'avez compris, le groupe Agir ensemble n'apportera pas de majorité à votre texte.

Je me fais le porte-parole de mon collègue Julien Dive qui nous rejoindra dans quelques minutes.
Tout a commencé en novembre 2017, par un tweet vengeur du Président de la République qui a fracturé l'opinion publique, en annonçant l'interdiction du glyphosate en France en 2021.
Calomniés, attaqués, accusés, les agriculteurs ont une fois de plus été la cible d'une annonce terrible pour leur quotidien déjà âpre, une pièce de plus dans le juke-box de l'agribashing.
S'en sont suivis des débats houleux lors de l'examen du projet de loi EGALIM en 2018, avec une proposition de loi du même nom que celle que nous étudions aujourd'hui, et la création d'une mission d'information parlementaire de vingt-quatre mois sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate en France.
Rappelons tout d'abord que la France est avant-gardiste sur ce sujet : depuis 2017, l'usage de l'herbicide glyphosate est interdit aux collectivités pour le traitement des espaces publics. Depuis 2019, sa vente est proscrite à tout particulier. Plus récemment, la SNCF, premier utilisateur individuel français avec 40 tonnes de glyphosate aspergées chaque année sur ses voies ferrées, annonce qu'elle le remplacera en 2022 par une solution à base d'acide pélargonique, dix fois plus cher, ce qui représente un montant de 110 millions d'euros, et qui nécessitera une quantité trois fois plus importante, puisqu'il faut utiliser seize litres contre cinq litres par hectare de glyphosate – dix fois plus que ce qu'utilise en moyenne un agriculteur. Je vous laisse imaginer l'impact sur les sols et surtout sur le revenu de nos exploitants.
Dans les faits, la sortie du glyphosate est bien réelle et nos agriculteurs n'ont pas besoin d'une énième injonction électoraliste pour bobos. Les préconisations d'usage ont été sévèrement modifiées par l'ANSES, qui l'a restreint aux situations où l'herbicide en question n'est pas substituable. Il est interdit entre les rangs de vigne, car des solutions mécaniques existent ; il en va de même dans les vergers. Quant aux grandes cultures, le glyphosate ne pourra plus être utilisé en complément du labour. Là aussi, c'est le bon sens qui prime pour préserver les techniques de conservation des sols comme le non-labour et éviter les situations d'impasse.
En réalité, l'enjeu de la ferme France est bien cerné par la profession. Il faut réduire l'application de produits phytosanitaires en supprimant les substances reconnues comme étant dangereuses et nocives. C'est le cas chaque année avec le retrait d'autorisations de mise sur le marché. Nous devons supprimer le superflu ou l'excès d'usage de produits phytosanitaires grâce aux techniques et aux outils de précision. Enfin, nous devons protéger le budget de l'exploitation, et donc le revenu de l'agriculteur. Personne n'utilise des produits phytosanitaires par pur plaisir, mais uniquement par nécessité. Cela représente un coût. Pour vous en convaincre, prenez l'exemple de l'engrais azoté dont le prix a été multiplié par trois en un an, faisant craindre des perspectives inflationnistes sur le blé en 2023 – on est bien loin de la baguette de pain à 29 centimes.
Les Républicains profitent de cette tribune pour vous alerter, monsieur le ministre. Nous dénonçons la manie du Gouvernement qui consiste à créer sans cesse de nouvelles plateformes numériques de délation des agriculteurs et de leurs pratiques, ce que vous appelez le name and shame, qui contribue à l'hystérisation du débat public. Cela a commencé en 2013, avec la création par Stéphane Le Foll de Phytosignal, un outil en ligne crée par l'État et mis à la main des régions ; deux d'entre elles viennent de s'en emparer.
Puis, en 2018, en plein débat sur le glyphosate, votre prédécesseur met en ligne glyphosate.gouv.fr pour mettre en avant les bonnes pratiques et donc, de manière détournée, pointer du doigt les mauvais élèves. Il aura fallu que mission parlementaire menée par Julien Dive, Jean-Baptiste Moreau et Jean-Luc Fugit s'en émeuve pour que le site soit retiré.
Enfin, il y a deux jours, la ministre de la transition écologique, votre collègue, soutenue par cette majorité, a annoncé le lancement de sites internet pour informer les riverains sur les agriculteurs qui pulvérisent des pesticides.
Arrêtez de dire n'importe quoi !

Monsieur le ministre, nous vous le demandons solennellement, soyez fort et mettez fin à ces pratiques douteuses.

Que le Gouvernement arrête de caresser les agriculteurs dans le sens du poil en public, pour mieux les fracasser ensuite par-derrière.
On sent que les élections arrivent ! Quelle démagogie !

Mais revenons sur le fond de cette proposition de loi. Si l'idée est d'interdire le glyphosate sur le sol français, la logique voudrait qu'on interdise aussi l'importation en France des produits qui en contiennent. En harmonisant les règles au niveau européen, c'est sûrement possible, mais au seul échelon national, c'est impossible, sauf à être favorable à une distorsion de concurrence entre les agriculteurs français et ceux des autres pays européens. Prenons l'exemple du soja : 80 % de la consommation française est importée depuis des pays qui aspergent le glyphosate directement sur la culture et non en interculture comme en France. Ailleurs, le glyphosate est aspergé à mains nues sur le cacao. La mauvaise herbe n'est pas plus verte chez le voisin.
Enfin, monsieur le rapporteur, comment interdire le glyphosate avec un article unique, qui ne prévoit aucune stratégie globale, aucune solution alternative pour nos agriculteurs, aucun moyen d'accompagnement, aucune étude d'impact, ni aucune référence au travail parlementaire mené sur ce sujet ?
En conséquence, le groupe Les Républicains, qui a toujours été du côté des agriculteurs et qui peut s'enorgueillir de n'avoir jamais contribué à ce phénomène d'agribashing, votera pour le pragmatisme, contre le dogme et donc contre ce texte.
Quel discours honteux !

Un des moments qui ont été pour moi les plus gratifiants dans la vie du Parlement, c'est lorsque, il y a trois ans, nous avons organisé avec l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), l'INRAE, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), ainsi que de nombreuses organisations agricoles et ONG, un colloque qui posait une question fondamentale : l'Europe peut-elle se passer des pesticides ? La réponse de l'IDDRI a été discutée de façon scientifique et démocratique par toutes les parties prenantes du colloque. À quatre ou cinq ans près, pour toutes, l'horizon était 2050.
Comme nous avons gagné au siècle dernier la bataille contre les bactéries, nous pouvons envisager une sortie de la chimie. Entre 1950 et 2050 se sera écoulé un siècle de transition de la chimie ; de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes nous permettront de nous en affranchir. C'est cet esprit qui m'anime depuis longtemps. Ce n'est pas une position tiède, mais une ligne d'action.
J'y fais peu référence car je n'aime pas mélanger les fonctions mais il y a trente ans que, à la ferme dans laquelle je travaillais avec mes associés, nous avons arrêté d'utiliser le Roundup et plus généralement tous les pesticides pour changer de système. J'ai poursuivi cette action comme élu local : il y a près de 25 % d'agriculture biologique sur mon territoire et un vignoble dont 90 %, selon les normes de haute valeur environnementale (HVE), relève de l'agrobiologie et 85 % de l'agriculture biologique.
J'ai continué cette action comme député à partir de 2012. Monsieur Dumont, vous avez critiqué Stéphane Le Foll avec une grande injustice. Je pense que le ministre ne partagerait pas vos critiques, qui sont un peu insensées, cependant je me console en me disant que ces attaques sont plutôt bon signe sur le plan politique, dans cette période.
J'ai continué de m'engager en rédigeant le rapport « Pesticides et agroécologie, les champs du possible », à la demande de Stéphane Le Foll, afin de réécrire le Grenelle de l'environnement et le plan Écophyto I. Je me suis engagé à travers ce rapport et ses 68 propositions. J'ai travaillé à la définition du biocontrôle dans le code rural et de la pêche maritime, or le biocontrôle comporte de nombreux avantages. J'ai travaillé également sur la phytopharmacovigilance. Je ne suis pas peu fier, grâce aux amendements que j'ai présentés, d'avoir permis le retrait du métham sodium, par exemple. Douze autres molécules et produits sont en cours d'instruction grâce à ce processus de phytopharmacovigilance. En revanche, la proposition des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) a connu un destin funeste. J'ai participé aux états généraux de l'alimentation qui se fondaient sur quatorze propositions systémiques pour une alimentation durable pour tous. Bref, j'ai mené cette action constante comme paysan, comme animateur d'un territoire, d'un pays, et comme député.
Et pourtant, monsieur le rapporteur, à travers moi, le groupe Socialistes et apparentés dira son opposition à votre proposition. Il le dira de manière singulière, en ne prenant pas part au vote. Je réitère ici la position que j'ai défendue contre vents et marées. En effet, je me suis opposé à toutes les démagogies, à toutes les simplifications et à tous les simplismes.
Je le répète : il n'appartient pas au Parlement de décider du retrait ou non d'une molécule. Sur le plan démocratique et scientifique, ce serait une régression majeure. Tout l'art des démocraties modernes est de constituer des institutions fondées sur l'éthique. Je ne suis pas peu fier d'avoir été l'auteur d'un amendement qui a contribué à déplafonner les moyens de l'ANSES afin qu'elle puisse répondre pleinement à sa mission. Nous devons les renforcer et les conforter. Comme vous, nous savons qu'il y a un immense chantier de réforme de l'agence de sécurité sanitaire européenne, que la présidence française pourrait au moins permettre d'ouvrir.
Mais je refuse l'idée que la dictature du marché soit remplacée par la dictature de l'opinion. C'est la science et la démocratie qui, ensemble, doivent choisir les rythmes. À nous de fixer des cahiers des charges et des conditions d'exercice de ces institutions.
La commission nationale de déontologie et d'alerte sur les risques sanitaires affirme que, en 2017, sur le glyphosate, l'Europe a mal travaillé. Avant de rendre son rapport en décembre 2022, elle doit mieux travailler. Cette commission appelle à une révision totale des cadres, des règles de gestion des conflits d'intérêts et des processus afin d'aboutir à une décision indépendante de tout conflit d'intérêts et de tout lobby, qui détermine réellement, en fonction d'un cahier des charges défini démocratiquement, si nous devons ou non refuser le glyphosate.
La guerre des molécules est sans fin car c'est bien de l'ensemble des pesticides que nous devons nous affranchir collectivement par une agroécologie systémique – comme je l'ai démontré, par exemple, s'agissant des néonicotinoïdes, en proposant la stratégie « un plan B comme betterave ».
Or cette volonté d'imposer une molécule de substitution au glyphosate pourrait aboutir à l'introduction de trois molécules alternatives, dont le fluroxypyr et le dicamba, utilisés sur le liseron et le rumex, plus dangereuses, du point de vue toxicologique et écotoxicologique, que le glyphosate que nous voulons dénoncer aujourd'hui.
Nous devons travailler autrement en conjuguant science et démocratie. Nous refusons d'entrer dans une logique qui, demain, pourrait se révéler démagogique et dangereuse. Imaginons par exemple que nous l'appliquions aux médicaments ou aux vaccins qui sont actuellement en débat. Je propose donc que nous nous engagions dans une autre démarche, celle que j'ai définie dans des articles publiés par la Fondation Jean-Jaurès, l'un sur l'agribashing et, l'autre, plus récent, sur l'approche dite One health – une seule santé.
Applaudissements sur quelques bancs des groupes LaREM et Dem ; M. André Chassaigne applaudit également.

Monsieur le ministre, vous nous accusez d'être simplistes, de refuser la complexité. Pourtant, nous proposons justement d'affronter la complexité alors que le raisonnement binaire que vous avez développé – pulvériser ou ne pas pulvériser – est, lui, simpliste.

Vous nous avez également reproché de ne pas respecter le principe de réciprocité, en citant l'exemple des lentilles ou des cerises. Tout d'abord, ce n'est pas l'objet de ce texte. Mais nous sommes bien sûr sensibles à cette question puisque l'importation de produits contenant ce type de substances a un impact sur le revenu paysan. Or cette question est mon souci principal.

C'est d'ailleurs pour cette raison que nous défendons le protectionnisme environnemental, une idée à laquelle vous souscrivez, monsieur le ministre. En effet, je vous ai entendu, lors d'un discours, évoquer les fameuses clauses miroirs, ce qui était une manière de parler de protectionnisme environnemental sans avoir à prononcer ces mots – ce qui, visiblement, est difficile pour vous. Nous partageons donc la même ambition que vous et nous développons cette idée dans notre programme politique, clairement et sans ambiguïté.
D'autre part, nous nous appuyons bien sûr sur des arguments scientifiques,…

…exposés dans des publications, notamment de l'INRAE. Certaines d'entre elles sont déjà anciennes mais ont sans cesse été confirmées depuis par d'autres études qui attestent de l'existence de solutions alternatives – je l'ai déjà expliqué.
Par ailleurs, vous dites que vous avez fait beaucoup en la matière, par exemple que vous avez multiplié par vingt le nombre d'exploitations labellisées HVE, haute valeur environnementale. Voilà un aveu qui symbolise bien votre politique : de l'affichage mais rien de concret. Je rappelle en effet que l'attribution de ce label n'est assortie d'aucune exigence en matière de réduction de l'usage des pesticides – vous le savez bien.
S'agissant du non-travail du sol, je vous signale qu'il est également possible dans le cadre de l'agriculture biologique.
J'en arrive aux effets sur le bilan carbone, un argument souvent opposé à notre proposition. Monsieur le ministre, pouvez-vous m'affirmer que la fabrication du glyphosate lui-même ne nécessite ni énergie ni émission de carbone ? Si vous souhaitez dresser un bilan carbone lié à l'usage du glyphosate, ne glissons pas sous le tapis la moitié de ce bilan en ignorant que la production de glyphosate entraîne elle-même des émissions massives de carbone.
Plusieurs députés, dont M. Chassaigne, ont évoqué l'agriculture de conservation. Or on ne peut qualifier d'écologique une telle pratique dans la mesure où elle suppose le recours au glyphosate. Les techniques de non-travail du sol, je l'ai dit, existent depuis longtemps, et sans usage de cet herbicide. C'est vrai, elles reposent aujourd'hui sur le savoir et le savoir-faire agronomiques qui font la fierté de nos agriculteurs. Certes, elles demandent un peu plus de travail humain. Mais qui s'en plaindra alors que nous avons perdu 350 000 actifs agricoles en quinze ans ?
Oui, nous plaidons pour une agriculture intensive, aussi bien sur le plan de la main-d'œuvre que de l'intelligence, alors que vous plaidez pour le maintien d'un modèle intensif sur le plan de la chimie qui, en outre, ne rémunère pas nos agriculteurs.
J'ajouterai une précision, notamment à l'intention de M. Herth. On nous dit que tout doit se décider au niveau européen. Or je tiens tout d'abord à rappeler les manœuvres de la France afin de ne pas trop encourager une sortie du glyphosate au niveau européen. Mais, d'autre part, si l'Europe décide, dans les prochains mois, d'une sortie du glyphosate – puisque c'est au niveau européen que tout se joue –, comment nous y préparez-vous ? Personne ne peut me répondre car personne ne s'y est préparé.
Personne n'a envisagé, en cas de sortie globale du glyphosate, de solution alternative ni d'accompagnement alors que nous formulons des propositions en la matière. Je pense notamment au protectionnisme solidaire que nous appelons de nos vœux parce que la fierté du travail de nos paysans, mais surtout la préservation de leurs revenus et la pérennisation de leurs exploitations sont au cœur de nos préoccupations.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.
Monsieur le rapporteur, je ne vous ferai pas l'offense…
…de remettre en cause le caractère scientifique de votre approche car je sais que, contrairement à un membre de votre groupe qui prétend avoir un avis sur les vaccins parce qu'il a grandi dans le département où est né Pasteur, vous avez réellement travaillé dans un grand centre de recherche et que vous êtes un grand spécialiste de ces questions.
Néanmoins, vous devez admettre que la complexité du vivant – que vous connaissez bien – nous impose de fuir tout simplisme. Je note que le président Chassaigne lui-même a démontré que l'agriculture de conservation, qu'on le veuille ou non, posait une question incroyablement complexe à l'ensemble des représentants de la nation : comment concilier différents objectifs environnementaux ?
Il a tout à fait raison. Je constate d'ailleurs que le groupe Socialistes et apparentés et que les groupes appartenant à la majorité présidentielle ont tenu les mêmes propos. J'ai moi aussi tenu ce discours à la tribune cet après-midi. Car, oui, le vivant est profondément complexe. Une approche binaire se révèle toujours nuisible.
Monsieur Mélenchon, permettez-moi à présent de vous interpeller – ce que je fais rarement. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'une telle interpellation soit conforme aux bons usages de l'Assemblée mais disons qu'il vous arrive parfois, vous aussi, de les omettre et que donc, vous m'y autoriserez.
Plusieurs parlementaires m'ont informé que vous veniez de me citer sur les réseaux sociaux.

Ah non, pas les tweets ! Arrêtez, ça fait capoter les commissions mixtes paritaires !
Vous me faites dire en effet, dans un message publié il y a environ une heure : « Recourir au glyphosate, c'est préserver l'environnement. Dire le contraire, c'est du simplisme. »
Or voici la phrase que j'ai prononcée : « Et on voit donc bien là que deux objectifs environnementaux viennent se confronter : biodiversité et lutte contre le changement climatique. C'est clairement complexe et cela empêche tout simplisme. Mais cela nous oblige au contraire à agir avec méthode, ce que je viens de vous rappeler. »
Vous le voyez bien, il s'agit d'une nouvelle démonstration du simplisme dont fait preuve votre groupe et que je dénonce.
Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et Dem.
Monsieur Mélenchon, soit vous avez un problème fondamental avec la vérité, soit vous prenez les Français pour des imbéciles.
Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et Dem.
Dans les deux cas, c'est une honte pour un candidat à la présidence de la République. Puisque je viens de vous démontrer que vous avez menti de manière éhontée sur les réseaux sociaux,…
…et ce alors que vous allez ensuite vous pavaner sur les plateaux télé pour expliquer que nous aurions un problème avec ces mêmes réseaux, je vous le demande très clairement : allez-vous corriger votre erreur et dire, sur les réseaux sociaux, que vous avez menti ? La grandeur d'un homme politique est aussi de reconnaître ses erreurs.
Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et Dem. – Protestations sur les bancs du groupe FI.
Je m'adresse à présent à M. Dive, même si ce n'est pas lui qui se trouvait à la tribune tout à l'heure. Je conçois que la campagne présidentielle a commencé…
…mais dans le discours, dont vous êtes manifestement l'auteur, qui a été lu par un de vos collègues, vous accusez le Gouvernement de choses qu'il n'a absolument pas faites. Une fois encore, j'aimerais que l'on cesse d'adopter ces postures.
Dans le récit que vous avez construit, les députés Les Républicains ont le rôle de ceux qui soutiennent et défendent les agriculteurs. Or, au moment où je vous parle, vous êtes seul sur les bancs de votre groupe. Il n'y a que vous ! Et votre groupe a dit des âneries à cette tribune. C'est insupportable. La démocratie, ce n'est pas ça. Le soutien aux agriculteurs, il se trouve sur les bancs de la majorité.
Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et Dem.

J'appelle maintenant l'article unique de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n'a pas adopté de texte.
Sur cet article unique, je suis saisi par le groupe La France insoumise d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

J'ai bien entendu les propos des uns et des autres, notamment ceux, très violents et agressifs, de M. le ministre.
Exclamations sur les bancs des groupes LaREM et Dem.

Je m'adresserai à mes camarades communistes qui ont annoncé qu'ils ne voulaient pas voter cette proposition de loi parce qu'elle ne prévoit pas d'exceptions et parce qu'il faut davantage de temps. Or, dans cet hémicycle, nous avons le temps d'amender. Par conséquent, si vous le souhaitez, construisons ensemble ce texte.
Je m'adresse à présent à l'ensemble de mes collègues. Le glyphosate est probablement cancérogène. Ce qui met en danger les agriculteurs et l'agriculture, ça n'est donc pas de vivre sans le glyphosate mais de vivre avec lui.
Mesdames et messieurs les députés de la majorité, à combien estimez-vous la valeur financière d'un être humain ? Combien vaut la vie d'un agriculteur ou d'une agricultrice ?
Je conclurai en citant ces mots du chef Sitting Bull, dans une missive adressée au président des États-Unis d'Amérique de l'époque : « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. »
Mme Mathilde Panot applaudit.

Pardonnez-moi, monsieur le président, de ne pas avoir assisté au début de ce débat mais j'arrive du Doubs, où je m'entretenais justement avec des éleveurs laitiers.
Je suis peut-être seul ce soir, mais d'autres députés étaient présents aujourd'hui et, de toute façon, la quantité ne fait pas la qualité – vous le savez bien et cela se vérifie partout.
Lorsque vous dites que nous vous accusons de choses que vous n'avez pas faites, je suppose que vous faites référence à la mise en place des différentes plateformes. S'agissant du dispositif Phytosignal, je reconnais que c'est Stéphane Le Foll, lors de la précédente législature, qui l'a créé. Je constate cependant que cet outil mis à la disposition des régions est toujours en vigueur. Il vous appartient de revenir sur ce choix et de passer à l'action si vous souhaitez le supprimer.
En revanche, le site internet glyphosate.gouv.fr, que je n'étais pas seul à dénoncer à l'époque – nous étions plusieurs de cet avis au sein de la mission parlementaire que j'ai présidée –, a bien été mis en place par ce gouvernement.
Non !
Il n'existe plus !

Je le sais mais il est bon de rappeler ce fait afin que l'on n'ait plus recours à de tels dispositifs, d'autant plus qu'hier, une de vos collègues du Gouvernement a déclaré qu'elle entendait remettre en place ce type de site internet qui, clairement, montre du doigt nos exploitants – nous aimerions d'ailleurs savoir ce que vous en pensez.

Lors des débats autour du glyphosate, nous avons toujours été guidés par un souci de constance. Nous n'avons ni dogme ni idée préconçue, contrairement à nombre de députés ici présents. Nous avons souhaité tenir compte du réel, c'est pourquoi nous avons répété que nous n'envisagions pas d'interdiction du glyphosate sans solution alternative.
D'autre part, s'agissant des traces de glyphosate dans les urines, exemple cité par le collègue Larive, je précise qu'il a été démontré scientifiquement que c'était totalement faux, que c'était une arnaque absolue.

Oui, lorsque l'on procède à un test des urines, on trouve aussi bien des résidus de glyphosate que des résidus de lessive ou de détergent. Voilà la vérité.

L'étude que vous citez est une arnaque dont l'objectif est d'influencer et d'intoxiquer la population.
Sur ces bancs, nous ne sommes pas du côté du dogme mais de la science.

Bien sûr, vous êtes du côté de la raison, de la bonté, de l'intelligence…

Nous prenons nos décisions en fonction de la science et du réel, nous ne vivons pas dans l'illusion. Pour répondre à Sitting Bull, une fois que l'agriculture sera morte, vous n'aurez plus rien à manger.
Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et Dem. – Exclamations sur les bancs du groupe FI.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 62
Nombre de suffrages exprimés 60
Majorité absolue 31
Pour l'adoption 17
Contre 43
L'article unique n'est pas adopté.

Mouvements divers.

Chers collègues, nous poursuivons nos débats. Si vous avez des remarques à formuler sur le fonctionnement de l'Assemblée, y compris sur l'utilisation de purificateurs, vous le ferez en conférence des présidents ou au Bureau. En attendant, chacun met son masque et retrouve sa sérénité.
Vous avez la parole, mon cher collègue.

Je vous remercie, monsieur le président, de me permettre de les défendre globalement parce qu'ils ont une cohérence et, connaissant le prix, sur le plan démocratique, d'une niche parlementaire pour un groupe d'opposition, je ne voudrais pas lancer un débat pirate qui distrairait de l'ordre du jour effectif des propositions déposées par nos collègues de La France insoumise.
Notre non-participation au vote sur la proposition de loi, comme je l'ai dit dans la discussion générale, se justifie par le fait que, pour le groupe socialiste, très engagé dans l'agroécologie et dans la sortie des pesticides, il faut respecter les méthodes, qui associent démocratie, institutions et sciences. Sinon, nous courons le risque que s'impose une dictature de l'opinion et de l'émotion. Cela étant, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je rappelle que j'ai porté plainte auprès du Conseil d'État contre un précédent ministre de l'agriculture de cette majorité pour non-application des certificats d'économie de produits phytosanitaires. Je suis donc très engagé personnellement sur ces sujets et je n'ai pas de leçon de courage à recevoir, monsieur le rapporteur.

Ces amendements, en contrepoint de notre abstention, sont des demandes de rapport et me donnent l'occasion d'interroger le ministre de l'agriculture sur la politique du Gouvernement en la matière. Il y a eu des avancées et des réussites au cours de cette législature, mais il me semble que l'on a raté le rendez-vous du foncier et qu'on est au point mort sur la phytopharmacie. Après un rapport de 2014 resté en souffrance, il y a eu les états généraux de l'alimentation en 2017, après quoi le Gouvernement a annoncé une politique volontariste….
À la fin de cette législature, je constate – sans faire de politique politicienne et sans confondre les agendas – qu'on a supprimé les certificats d'économie de produits phytosanitaires au profit d'une promesse du Président de la République sur la séparation de la vente et du conseil, dont il est de notoriété publique qu'il s'agit d'un échec. Tout le monde l'admet aujourd'hui. On n'a pas non plus fait appliquer le plan Écophyto tel qu'il était prévu au départ, Antoine Herth s'en souvient, c'est-à-dire avec la participation des députés et une animation politique forte. Il aurait pourtant peut-être permis de prévenir la réintroduction des néonicotinoïdes si on avait travaillé sérieusement sur cette question. Vous dites vous-même, monsieur le ministre, que nous pouvons en trois ans nous affranchir de ce pesticide grâce à des solutions technologiques diverses et à leur combinaison – mosaïque paysagère, chimie végétale, etc.
Bref, le plan Écophyto en panne. Les CEPP sont abandonnés au profit d'une solution qui n'a pas marché. Et qu'en est-il du plan stratégique national pour la future politique agricole commune ? Je terminerai sur ce dernier point : il est sans doute trop conciliant au titre de la transition avec la profession concernée, les compromis prévus s'avérant, au vu du défi à la fois de la biodiversité, des marchés du futur et de notre sécurité alimentaire, un mauvais cadeau pour l'agriculture et pas vraiment un cadeau pour les agriculteurs.
Mes trois amendements visent à vous poser la question suivante, monsieur le ministre : durant cette législature, notre pays a-t-il suffisamment engagé les processus permettant de s'affranchir des pesticides par des démarches d'agroécologie, des innovations législatives comme les CEPP et par une négociation européenne à la hauteur des enjeux qui, me semble-t-il, nous rassemblent ?

La parole est à M. Loïc Prud'homme, rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur ces trois amendements.

Tout d'abord, je ne vous ai pas donné de leçons, mon cher collègue – mais peut-être était-ce en commission et que vous aviez un compte à régler avec moi ?
Ces amendements ont fait l'objet d'un vote défavorable en commission mais, à titre personnel, je donnerai un avis favorable à l'amendement n° 1 sur le plan Écophyto parce que le rapport qui en sortirait me semble pouvoir apporter un peu de grain à moudre pour alimenter le débat. Quant aux autres, je rejoins l'avis de la commission.
Vous évoquez le plan stratégique national, qui, monsieur le ministre, n'a absolument pas été débattu dans cette enceinte, ce qui me paraît vraiment un problème. Voilà plus de deux ans que je réclame un débat, en vain.
Enfin, cher collègue Potier, j'ai réagi en commission à une affirmation que vous avez répétée à la tribune, et selon laquelle la décision d'interdire le glyphosate ne reviendrait pas à notre assemblée. C'est ignorer que nous pouvons intervenir dans le domaine sanitaire. Or cette dimension est au cœur du débat sur les pesticides. Et quand il y a une fabrique du doute au point de bloquer le discours scientifique – on l'a connu avec l'industrie du tabac –, c'est bien au législateur in fine de trancher, en l'occurrence de prendre la décision de protéger notre environnement, nos agriculteurs et les consommateurs.
C'est une demande de retrait, mais les sujets que vous avez abordés, monsieur le député, sont importants.
S'agissant d'Écophyto, il y a comme vous le savez une revue des projets.
Pour ce qui est de la négociation européenne sur les enjeux que vous évoquez, c'est à l'évidence une question pour moi essentielle. J'en profite pour confirmer au rapporteur que je suis très clairement pour le principe de réciprocité – qu'on peut considérer comme du protectionnisme sans volonté d'autarcie –, notamment s'agissant des clauses miroirs. La première que je cherche à obtenir porte sur les antibiotiques de croissance dans le monde animal.
Enfin, en ce qui concerne les certificats d'économie de produits phytosanitaires, c'est un vrai débat au vu des choix qui ont été faits, en particulier la séparation entre vente et conseil qu'a évoquée également Jean-Baptiste Moreau. Je crois beaucoup à ces certificats, c'est une approche tout à fait pertinente. Mais il faudra voir comment les faire perdurer et prolonger leur efficacité au fur et à mesure de la mise en place des différentes réformes adoptées. Je prends la balle au bond.

Je rappelle au rapporteur que nous avons eu l'occasion de dialoguer très longuement avec l'ANSES. S'il ne faut jamais cesser d'interpeller ces institutions et de les réformer pour les armer encore davantage, il ne faut pas semer le doute sur leur légitimité ni, en l'espèce, sur la façon dont fonctionne cette agence et ni sur les conclusions qu'elle formule.
Quant au chantier de la réforme européenne, il est fondamental. J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez au moins l'ouvrir et obtenir une certification européenne des avancées françaises en matière de biocontrôle, car elles le méritent.
Sans ouvrir un débat sur l'agroécologie, votre aveu que la séparation n'a pas marché et que le CEPP n'était pas si idiot est une vraie leçon pour nous tous à la veille des présidentielles. Car cela montre que reprendre le slogan d'une ONG, d'un syndicat, d'une entreprise ou de l'air du temps peut peser lourdement sur la construction ou la déconstruction d'une politique publique. C'est un appel à l'humilité. Il faut s'intéresser aux processus et aux objectifs plus qu'à des solutions toutes faites qui sonnent bien à l'oreille mais qui, à la fin, peuvent faire pschitt, et ruiner les efforts accomplis par la majorité sous la législature précédente. J'ai à cet égard noté que chez Les Républicains, on a tout à l'heure attaqué un peu bêtement Stéphane Le Foll, alors qu'une partie de sa politique est mise en œuvre aujourd'hui et dans une forme de continuité. En tout cas, quand nous avions mis en place les CEPP, nous espérions créer un processus associant filières, territoires, entreprises et services publics qui produisent des effets. Je n'ai pas le temps de développer l'exemple du colza ou d'autres cultures, mais je reste absolument convaincu que ce dispositif était plein de promesses.
Si on veut vraiment sortir des pesticides, il y a six mois de présidence européenne où on peut gagner des points, et trois mois de campagne présidentielle où l'on peut éviter toute forme de démagogie, que ce soit à droite, à gauche ou au centre, et proposer de bâtir des politiques publiques respectueuses de la santé du sol, de la santé des hommes et de la santé de la planète.
M. Frédéric Petit applaudit.

Monsieur le rapporteur, avant la mise aux voix, pouvez-vous rappeler l'avis de la commission ?


L'article unique et l'ensemble des amendements portant article additionnel ayant été rejetés, la proposition de loi n'est pas adoptée.
Suspension et reprise de la séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à dix-neuf heures trente.


La parole est à M. Éric Coquerel, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Je viens ici, au nom du groupe La France insoumise, avec l'intention de faire franchir un pas supplémentaire à la question de la légalisation du cannabis sous contrôle de l'État, de la manière la plus constructive possible.
Il s'agit d'un sujet dont tout montre, depuis des mois, qu'il est largement transpartisan. C'est la raison pour laquelle mon groupe a mis sa niche à disposition pour une proposition de loi signée non seulement par ses membres, mais aussi par des députés qui appartiennent à pas moins de cinq des groupes de notre assemblée, sans compter les non-inscrits. J'espère que cette volonté permettra, comme en commission, d'éviter les arguments caricaturaux contre le texte.
Cette proposition de loi prolonge d'ailleurs ce qui constitue une première pendant cette législature : un ensemble de travaux transpartisans. Il y a six mois, la mission d'information commune de l'Assemblée nationale relative à la réglementation et à l'impact des différents usages du cannabis présentait un bilan sans appel : la politique de prohibition du cannabis menée dans notre pays depuis cinquante ans est un échec. Plusieurs des membres de cette mission d'information commune sont d'ailleurs cosignataires de la proposition de loi.
À la suite des travaux de la mission d'information commune, de la proposition de loi défendue au printemps dernier par notre collègue François-Michel Lambert, et de celle que j'ai précédemment déposée avec plusieurs des signataires du texte dont nous débattons, je vous propose de légaliser enfin – comme l'ont fait ces dernières années l'Uruguay, plusieurs États des États-Unis, le Canada et comme le fera prochainement l'Allemagne – la production, la distribution, la vente et l'usage du cannabis, mais sous contrôle strict de l'État.
À l'origine de la proposition de loi inscrite à notre ordre du jour, il y a les dégâts du trafic de drogue. Le trafic, à plus de 80 % dévolu au cannabis, détruit : il détruit socialement les populations qui le subissent, il détruit les consommateurs qui consomment un produit de plus en plus toxique, et il détruit aussi les petites mains de la drogue qui subissent à la fois les conditions d'un travail uberisé et la précarité de vie des petits dealers pour lesquels la case prison et les violences sont la règle.
Alors que la France est aujourd'hui un des pays les plus prohibitifs et répressifs en matière de trafic mais également d'usage du cannabis, elle est aussi la championne d'Europe en matière de consommation. Près de la moitié des adultes de 18 à 64 ans ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, contre moins de 30 % en moyenne en Europe. On dénombre en France 1,5 million de consommateurs réguliers et 900 000 consommateurs quotidiens. Le risque, en cas de légalisation, n'est donc pas de voir exploser la consommation du cannabis : cette explosion a déjà eu lieu.
Malgré les moyens toujours plus importants consacrés à lutter contre le trafic, il ne se tarit pas. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) estime que la lutte contre les stupéfiants, usage compris, équivaut aujourd'hui à un million d'heures de travail policier. Car, comme pour tous les produits considérés comme stupéfiants, la vente et la consommation de cannabis sont interdites en France depuis la loi de 1970. Aujourd'hui, l'usage illicite du cannabis peut donc être puni, en théorie, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Depuis le 1er septembre 2020, une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants d'un montant de 200 euros peut être directement appliquée par les forces de l'ordre. Quant aux crimes et délits liés aux trafics de stupéfiants, le code pénal prévoit des sanctions beaucoup plus lourdes, pouvant atteindre dix ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Pour quel résultat sur la durée ?
Certes, les prises sont plus importantes et nul ne nie la compétence des policiers et des douaniers mais, comme me l'expliquait un douanier, elles sont surtout la preuve que le flux est toujours plus massif, non que le trafic diminue. Ce qui se passe dans ma circonscription en est une démonstration – c'est d'ailleurs aux habitants de ses quartiers populaires que j'ai d'abord pensé en concevant la proposition de loi.
On peut y constater que, si une présence policière quotidienne sur un point de deal freine le trafic quelques jours, celui-ci explose pendant ce temps sur un autre point et reprend sur le premier site dès que les policiers se rendent sur le second. Comme me le disait un syndicaliste policier : on a l'impression de vider l'océan avec une cuillère. Nous sommes en réalité dans la même situation qu'avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 1930. Aucune politique de prohibition n'empêchera la demande de cannabis, pas plus que ne sera jamais éradiquée la consommation d'autres produits psychotropes licites ou pas.
En revanche, la prohibition empêche de mener une politique constante et efficace de réduction des risques et des addictions, ainsi qu'une politique de contrôle des usages, évidemment souhaitable. Il faut en effet resituer le cannabis dans le cadre global de l'usage des produits addictifs si on veut aborder la deuxième raison d'être d'une telle proposition de loi : la volonté d'une politique de prévention sanitaire plus efficace que celle menée actuellement.
M. Ugo Bernalicis applaudit.

Selon le classement établi par la Commission mondiale de politique sur les drogues, le cannabis se situe à la sixième position des produits les plus létaux, derrière l'alcool et le tabac qui se classent respectivement en troisième et deuxième position. Le cannabis se hisse à la huitième position du classement des produits les plus nocifs, encore derrière l'alcool et le tabac qui se situent respectivement à la première et sixième position.
Mon intention, en rappelant ces données, n'est évidemment pas de minimiser la dangerosité du cannabis, mais de replacer la question de sa légalisation dans le cadre plus large de la régulation des substances psychoactives. Comme l'alcool et le tabac, le cannabis est un produit à risque. Sa consommation devient de plus en plus dangereuse à mesure qu'augmentent les taux de THC – le delta-9-tétrahydrocannabinol – contenus dans les produits vendus illégalement. L'encadrement de la production, de la vente et de la consommation de l'alcool et du tabac permettent de réglementer le taux des substances psychoactives et d'élaborer des politiques de prévention à destination des usagers. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour le cannabis ?
J'ai donné des chiffres relatifs à la consommation globale, toutefois, ce n'est pas la consommation modérée de cannabis chez les adultes qui est la plus inquiétante, mais celle des jeunes, en particulier des adolescents. On sait que la consommation de THC a des effets particulièrement néfastes sur le développement cérébral de nos jeunes, qui peuvent développer ou déclencher des troubles psychiatriques.
Certes, les chiffres publiés hier par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) – anciennement Observatoire français des drogues et des toxicomanies – montre un affaiblissement de la consommation du cannabis par les élèves de troisième, mais cette évolution correspond à un phénomène mondial sans doute dû, malheureusement, à un transfert vers d'autres pratiques addictives. Que faisons-nous aujourd'hui pour éviter ou retarder l'expérimentation du cannabis par nos enfants ? Trop peu.
Si la MILDECA a lancé des programmes d'expérimentation intéressants sur les comportements psychosociaux, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Songez que, sur près de 600 millions d'euros dépensés chaque année pour lutter contre le cannabis, seuls 10 % sont consacrés aux dépenses de santé et de prévention !
À l'inverse, la légalisation du cannabis permettrait de développer une véritable politique de prévention des risques, sur le modèle de ce qu'ont fait, par exemple, le Canada ou le Portugal. Le Portugal montre la voie d'une autre méthode d'organisation qui donne au ministère de la santé le leadership des politiques en matière de stupéfiants et permet d'obtenir des résultats. L'usager n'y est pas considéré comme un délinquant mais, au pire, comme un malade avec les traitements et recommandations qui en découlent, ce qui entraîne une réduction des usages de tous les stupéfiants.
M. Ugo Bernalicis applaudit.

Je précise que la légalisation du cannabis ne conduit pas non plus nécessairement à un surcroît de trafic et de consommation d'autres drogues. Je fais référence à ce que l'on appelle la théorie de l'escalade, qui revient souvent dans le débat. Au contraire, en éloignant les usagers du cannabis des dealers qui sont susceptibles de vendre d'autres drogues, on peut mieux prévenir la consommation de drogues plus dures que le cannabis.
Vous aurez compris que, si la proposition de loi que je vous présente se réduit aux seuls aspects de la légalisation, afin de remplir les conditions d'une niche parlementaire, le texte s'inscrit dans un cadre plus global décrit dans l'exposé des motifs. Cette approche globale du sujet inclut une politique de santé ambitieuse, une politique de réinsertion sociale, mais aussi un redéploiement des forces de police vers une police de proximité – en deux ans, au Canada, le commerce illicite a baissé de 60 % –, et davantage de moyens donnés aux polices d'investigation et judiciaire pour démanteler les trafics.
Je voudrais conclure sur notre approche de la légalisation. La tendance mondiale en cours nous amènera inévitablement à la dépénalisation et à la légalisation. Sous quelle forme ? Voilà la question que je pose. En agissant à temps, en régulant ce commerce sous contrôle de l'État, nous parviendrons à éviter le développement d'un nouveau marché juteux et dangereux pour la santé, celui du Big Canna. Voilà pourquoi nous proposons une légalisation sous contrôle strict de l'État. Celui-ci aurait le monopole de la distribution du produit et des licences accordées à des producteurs et vendeurs en développant des modes économiques non capitalistes de type associatifs, ESS – économie sociale et solidaire –, cannabis social club.
Cette filière permettrait de reprendre le contrôle sur les produits en circulation, d'avoir une traçabilité, de s'assurer que le cannabis n'est pas coupé avec n'importe quoi comme c'est le cas aujourd'hui, et de contrôler le taux de THC, qui a littéralement explosé. Ce « commerce » s'appuierait sur une vente régulée, interdite aux mineurs. Il permettrait de créer des emplois licites mais également de faire rentrer des recettes dans les caisses de l'État, recettes qui pourront financer les dépenses de santé et de prévention des risques que j'ai déjà évoquées.
En cohérence avec le caractère transpartisan de cette proposition de loi, de plus en plus de Français se déclarent favorables à la légalisation. Les derniers sondages, dont celui commandé pour notre niche parlementaire, montrent même qu'une très large majorité se prononce en sa faveur. Une consultation citoyenne donne 80 % de votes en ce sens sur 250 000 avis exprimés, parce que les gens ont compris que si la légalisation ne réglait pas tout, la prohibition, elle, n'avait rien réglé, induisant, de fait, du trafic et une explosion de la consommation et des risques. Je vous propose aujourd'hui, chers collègues, que nous rejoignions la sagesse et la lucidité de nos concitoyens en adoptant cette loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI. – Mme Michelle Victory et M. François-Michel Lambert applaudissent également.

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles.
La proposition de loi déposée par le député Éric Coquerel au nom du groupe La France insoumise porte sur un sujet de société majeur, l'un de ceux sur lesquels il est difficile de ne pas avoir une opinion, mais qui malheureusement s'accommode peu de nuances.
Je sais par ailleurs que c'est un sujet sur lequel votre assemblée s'est beaucoup investie, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, notamment dans le cadre de la récente mission d'information commune relative à la réglementation et l'impact de différents usages du cannabis. Le travail de ses rapporteurs a permis d'explorer les différentes facettes de ce dossier, en soulignant sa grande complexité. Je tiens, à mon tour, à saluer la contribution de ces travaux à la discussion.
Ces derniers mois, le cannabis n'a pas été absent de l'agenda du ministère des solidarités et de la santé, et nous pouvons collectivement être fiers d'avoir permis son usage médical, dans le cadre d'une expérimentation qui était attendue depuis très longtemps. Au-delà des opinions vagues et des convictions tranchées sur l'usage dit récréatif du cannabis, il y a des faits et un constat : la consommation de cannabis représente un véritable problème de santé publique. Les auteurs de la proposition de loi ne l'ignorent pas : ils mentionnent d'ailleurs explicitement dans son exposé des motifs « la réalité des dangers du cannabis ».
Les chiffres évoqués à l'appui de la légalisation, nous les connaissons tous. La prévalence de l'usage du cannabis est élevée en France. En population générale, en 2019, on comptait, cela a été dit, 5 millions de consommateurs dans l'année, 1,5 million de consommateurs réguliers et 900 000 consommateurs quotidiens. Ces 900 000 consommateurs quotidiens de cannabis sont potentiellement considérés comme ayant des usages problématiques liés à cette consommation.
Des résultats récents montrent toutefois une dynamique qui contredit l'idée, souvent répandue, que les niveaux de consommation ne cessent d'augmenter. La proportion des usagers dans l'année – 11 %, soit un adulte sur dix – n'a pas varié depuis 2014, et celle des usagers réguliers, qui consomment au moins dix fois dans le mois, apparaît même en léger recul, passant de 3,6 % en 2017 à 3,2 % en 2020.
En fonction des tranches d'âges, les observations sont contrastées. Les niveaux d'usage progressent légèrement parmi les adultes de plus de 35 ans, mais la baisse de l'usage parmi les 18-25 ans, amorcée depuis 2014, se confirme. Le cannabis est donc de moins en moins populaire au fil des générations nées depuis le milieu des années 1980.
Votre proposition de loi parle « d'échec de la politique prohibitive » ; je crois que cet échec est à nuancer dans la mesure où il semble que ce qui était subversif, rebelle et peut-être même branché, il y a quelques années, ne l'est plus tant que cela.
S'agissant des jeunes, l'OFDT a montré que, si la consommation des jeunes français de 16 ans restait, en 2019, une des plus élevées en Europe, elle est dans le même temps une de celles qui a connu la plus forte baisse entre 1999 et 2019, en comparaison avec les autres pays européens.
Nous devons qualifier ce dont nous parlons : le cannabis est une drogue dont le caractère nocif pour la santé humaine est clairement établi par la littérature scientifique française et internationale. La dangerosité du produit est accrue pour les adolescents et les jeunes adultes, parce que leur cerveau, en maturation jusqu'à 25 ans, peut être sérieusement affecté par la consommation de cannabis.
Face à cet enjeu de santé publique, mais qui concerne également l'ordre éducatif, ainsi que l'insertion sociale et professionnelle, nous cherchons tous à atteindre les mêmes objectifs : réduire les risques et prévenir le plus tôt possible l'entrée dans l'usage. Nous assumons vouloir que ce produit soit moins consommé en France, et que son image soit débanalisée.
Il s'agit également de lutter contre les trafics – M. le rapporteur l'a évoqué –, en s'attaquant aux réseaux criminels qui se cachent derrière ce que l'on considère parfois comme le petit trafic. C'est un enjeu à part entière qui est indissociable de la politique de prévention. Le Gouvernement s'est saisi de ce sujet ; nous agissons sur l'offre et sur la demande dans un même effort, et vous savez combien le ministre de l'intérieur est déterminé à mener la vie dure à ceux qui pourrissent la vie des quartiers en vendant de la drogue. La proposition de loi n'élude d'ailleurs pas ce phénomène, preuve que, si nos solutions diffèrent, nous faisons le même constat : la pratique est nocive non seulement pour la santé publique, mais également pour la tranquillité publique. Nous marchons sur deux jambes : la lutte contre les trafics et la prévention.
Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 comporte notamment des mesures fortes en ce sens, qui mobilisent l'ensemble des leviers : le renforcement de la prévention et de la prise en charge conjointe, tant sanitaire que sociale ; le développement de la recherche multidisciplinaire ; la lutte contre les trafics. Ces leviers sont tous associés au maintien de l'interdit.
Monsieur le rapporteur, vous avez donné quelques exemples d'expériences étrangères de légalisation conduites par plusieurs pays occidentaux. Le Gouvernement suit évidemment avec une particulière attention l'expérience canadienne, souvent citée – comme vous l'avez fait – par les tenants d'une légalisation en Europe et en France. Les autorités québécoises ont elles-mêmes publié un rapport sur les premières années de la mise en œuvre de la légalisation. On peut y lire que la baisse des usages chez les adolescents – qui, je le précise, ne sont pas concernés par l'accès légal au produit – s'est poursuivie en raison d'une politique de prévention volontariste en direction des plus jeunes, que nous menons aussi…
…et qui donne des résultats, comme je vous l'ai montré – vous le sauriez, si vous aviez écouté.
En parallèle, on constate également au Québec une augmentation significative de la consommation chez les adultes dès 18 ans, alors que l'accès légal au produit n'est autorisé qu'à partir de 21 ans, une acceptabilité sociale beaucoup plus forte et une moindre perception des risques. Ces résultats me semblent inquiétants.
Vous savez par ailleurs que l'exclusion des mineurs de l'accès au cannabis légal risquerait d'être mal respectée, à l'instar de l'interdiction de vente de tabac et d'alcool aux mineurs, pour laquelle le Gouvernement se mobilise.
Celui-ci n'a choisi pour la France la légalisation du cannabis. Il fait le choix clair, ferme et constant de la prévention des usages, de la restauration de la crédibilité de l'interdit pénal protecteur, et de la lutte contre les trafics.
Notre objectif, c'est la prévention, qui suppose d'empêcher l'installation d'une personne dans des usages répétés et problématiques mais également de repérer précocement ces usages pour orienter efficacement les personnes concernées vers une prise en charge adaptée. Le plan priorité prévention et le plan national de mobilisation contre les addictions comportent des actions en ce sens.
Pour soutenir la priorité faite à la prévention, la France s'est dotée d'un outil puissant pour financer la prévention des addictions. Vous le savez, vous l'avez voté : le fonds de lutte contre le tabac a évolué en 2019 vers le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, doté d'un budget annuel de près de 120 millions d'euros. Ces actions de prévention passent en priorité par l'école, par les universités, par tous les acteurs qui sont à proximité des jeunes. Une stratégie de déploiement à grande échelle des programmes de renforcement des compétences psychosociales est en cours d'élaboration, en lien avec le ministère de l'éducation nationale. Ces programmes, évalués, permettent d'obtenir des résultats majeurs sur les consommations, le climat scolaire et la réussite éducative des élèves.
Vous l'avez vu, au second semestre 2021, nous avons aussi engagé une grande campagne de communication en trois volets, pour informer sur les risques. Nous sensibilisons aussi les professionnels de santé de première ligne pour qu'ils apportent des réponses efficaces à leurs patients.
La diffusion de stratégies d'intervention précoce permet à d'autres professionnels au contact de jeunes de repérer les usages problématiques, d'en tenir compte dans l'accompagnement, d'orienter le cas échéant vers des structures spécialisées et de constituer plus globalement des environnements protecteurs pour les jeunes, mettant à distance les incitations à consommer des substances psychoactives. Ainsi, il nous faut mieux faire connaître les dispositifs d'aide qui sont mis à disposition auprès des jeunes, de leur entourage et du public en général, pour toute question ou difficulté liée à la consommation de produits ou de drogues. Par ailleurs, légaliser l'usage récréatif pourrait banaliser davantage ce produit et renforcer son accessibilité ainsi que la perception positive que les jeunes ont du cannabis aujourd'hui.
Je suis heureux que ce débat ait lieu ; il permet d'échanger dans la clarté sur ce sujet majeur de santé publique. La position du Gouvernement n'en sera pas moins claire, et pas moins défavorable à l'adoption de la proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et sur plusieurs bancs du groupe Dem.

« La drogue, il n'y a pas de vendeurs s'il n'y a pas de consommateurs. Les gens qui consomment de la drogue dans les soirées sympathiques, ce sont des gens qui financent ces systèmes mafieux et entretiennent l'insécurité des quartiers les plus populaires. » Ces propos d'Emmanuel Macron dans son désormais fameux entretien dans Le Parisien du 4 janvier dernier sont emblématiques de la posture dogmatique et de l'impasse politique dans laquelle présidents, gouvernements et majorités successifs enferment notre pays depuis cinquante ans.
La France est depuis de nombreuses années le premier pays européen en matière de consommation de cannabis, drogue largement répandue dans la société qui compte 900 000 usagers et usagères…

…au quotidien, qui ont entre 11 et 75 ans. Près de la moitié des adultes l'a déjà expérimentée en fumant au moins une fois dans sa vie, alors que la moyenne européenne se situe à 29 % et atteint seulement 27 % aux Pays-Bas où le cannabis est légal et en vente libre. L'acharnement, très médiatisé ces derniers mois, du ministre Darmanin contre les consommateurs et les consommatrices, avec l'approbation d'Emmanuel Macron, n'y a rien changé. Au contraire, la consommation a augmenté au cours du confinement, malgré les difficultés d'approvisionnement.
Il est temps de tirer les conclusions de cet échec. La politique répressive menée depuis plus de cinquante ans ne permet pas de faire diminuer la consommation de cannabis ; le trafic prospère et les produits deviennent plus toxiques. Cette stratégie empêche également de mettre en place des politiques de santé publique cohérentes et d'ampleur, et augmente le niveau de violence et d'insécurité lié au commerce illégal.
La légalisation est une exigence sanitaire. Le cannabis est une plante aux effets psychoactifs et médicinaux dont la consommation perturbe le système nerveux central, en modifiant les états de conscience. Si sa nocivité est moindre que celle d'autres substances légales – il occupe la huitième position du classement international, derrière l'alcool qui est à la première place et le tabac qui est classé sixième –, sa consommation peut avoir des effets néfastes sur la santé, la sociabilité et la sécurité, d'autant que sa prohibition est une des causes de l'augmentation du taux de THC, principal constituant psychoactif du cannabis vendu illégalement ; cela participe donc à la dangerosité de ce produit.
La légalisation du cannabis est en premier lieu un impératif de santé publique. C'est le seul moyen de contrôler la qualité des produits consommés, de permettre une prévention et une réduction des risques adaptées à la dangerosité de chaque substance et aux publics concernés. Ces campagnes doivent particulièrement être menées auprès des plus jeunes, dont la consommation est en baisse depuis quelques années, mais pour lesquels les indicateurs d'usage demeurent élevés.
Les études montrent qu'à l'adolescence, le cannabis entraîne des perturbations cognitives, physiologiques et comportementales d'autant plus délétères et persistantes que les consommations sont précoces. Or le discours sanitaire achoppe sur une incohérence majeure – parmi d'autres – des politiques. En effet, l'alcool et le tabac, produits à la fois plus addictifs et plus dangereux que le cannabis – 120 000 personnes en décèdent chaque année –, sont autorisés et en vente libre, l'alcool bénéficiant en outre d'une publicité encadrée. Un « deux poids, deux mesures » qui contribue à brouiller le message de prévention et de réduction des risques. L'expérience canadienne montre d'ailleurs que la légalisation n'a pas fait augmenter la consommation chez les jeunes de moins de 25 ans ; il y a même eu un recul de l'âge des premiers usages. Comme pour l'alcool et le tabac, un solide encadrement législatif et réglementaire permettrait de mieux prévenir la consommation et, à défaut, de la réguler et de réduire les risques.
Le deuxième enjeu porte sur l'inefficacité de la répression qui – ce dont se vante aujourd'hui l'exécutif – s'exerce essentiellement contre les consommateurs et les consommatrices. Depuis les années 1990, cette répression a été multipliée par sept, alors que, pour les autres délits liés aux stupéfiants, l'augmentation n'est que de 3 points. Or seuls 10 % des affaires concernent les trafics. Cette répression nourrit la politique du chiffre, et conduit même à un dévoiement de la mission des forces de l'ordre. Comme l'explique le collectif Police contre la prohibition, « c'est un délit qui est résolu dès qu'il est constaté, c'est du 100 % de taux d'élucidation, et ça, c'est très précieux pour les chiffres de la délinquance. 56 % de l'activité d'initiative des flics, c'est la répression de l'usage des drogues, faire vider les poches et mettre en garde à vue pour le quart de gramme de shit qu'on a au fond de la poche. » La lutte contre le cannabis mobiliserait ainsi un million d'heures de travail des forces de sécurité par an. Un Gouvernement et une majorité qui se targuent d'être sérieux en matière de sécurité pourraient convenir que les forces de police et de gendarmerie auraient certainement mieux à faire, notamment s'attaquer aux trafics internationaux qui financent les drogues et d'autres commerces illégaux.
En 2015, 200 000 personnes ont été interpellées pour infraction à la législation sur les stupéfiants, soit cinquante fois plus qu'en 1970 lors de son adoption. Dans plus de 90 % des cas, il s'agissait de consommateurs et de consommatrices de cannabis ; 83 % ont été interpellés pour simple usage. Les deux tiers des affaires de stupéfiants conduisent à une sanction judiciaire ; il n'y a donc pas de laxisme, contrairement à ce que disent certains et certaines. En 2013, près de 57 000 condamnations ont été prononcées, dont 72 % pour un simple usage, la détention ou l'acquisition, soit 33 000 condamnations, dont 1 400 à de la prison ferme. Depuis dix ans, autour de 20 % de la population carcérale est constituée de personnes détenues pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Là aussi, étant donné l'état des prisons et les nombreuses condamnations de la France en raison de la surpopulation dans les prisons, il y aurait matière à une véritable déflation carcérale.
Pendant ce temps-là, le trafic n'a jamais été aussi florissant : en 2018, une étude de l'INSEE a estimé à 1 milliard d'euros par an le chiffre d'affaires généré. Si le trafic rapporte beaucoup, essentiellement aux têtes de réseau – privatisation des profits –, la prohibition et la répression ont un coût élevé pour la collectivité – socialisation des pertes. Un rapport parlementaire de 2014 a évalué à 2 milliards d'euros, dont 850 millions pour le volet « répression, police, justice, douanes, gendarmerie, administration pénitentiaire », le montant de la facture. En 2018, deux économistes ont calcul le coût de la stratégie répressive par usager et usagère : 724 euros pour la répression policière et 227 euros pour la répression judiciaire, contre 66 euros pour la prévention et 15 euros pour la prise en charge sanitaire. C'est donc près de 1 000 euros par usager et usagère que la collectivité économiserait en légalisant le cannabis, sans compter les ressources nouvelles pour l'État, du fait des taxes appliquées sur les produits de la vente. Aux États-Unis d'Amérique, la légalisation du cannabis a rapporté près de 10 milliards de taxes aux différents États. Selon une note du Conseil d'analyse économique de 2019, l'État français pourrait ainsi récupérer 2 milliards d'euros de recettes fiscales. Pour nous, ce n'est pas le principal argument, mais cela en est tout de même un. On aurait là de quoi financer une robuste politique de santé et d'éducation.
Au final, contrairement à ce que pensent Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité – au moins jusqu'à aujourd'hui, car on espère que vous changerez d'avis –, légaliser c'est faire preuve de courage et de responsabilité.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe FI.

C'est ce qu'ont compris des centaines de professionnels de santé, comme Patrick Aeberhard, cardiologue, ex-président de Médecins du monde, des professionnels du médico-social, du droit, des sociologues, comme Alain Ehrenberg, des philosophes, comme André Comte-Sponville, des économistes, des associations de réduction des risques collectifs d'usagers et d'usagères, des élus de tous bords, dans cette assemblée, en France et partout dans le monde, qui sont régulièrement signataires d'appels et de tribunes en ce sens.
Ainsi retrouvait-on en 2019 dans L'Obs la signature de Michel Kazatchkine, ancien directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et membre de la Commission mondiale de politique sur les drogues qui regroupe des personnalités du monde entier, y compris d'anciens chefs d'État et du Gouvernement, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat du prix Nobel de la paix, Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Suisse, que nous avons auditionnée lors des travaux de ce texte, le prix Nobel de littérature péruvien Mario Vargas Llosa, Michèle Pierre-Louis, ancien Première ministre d'Haïti, Javier Solana, ancien représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, Louise Arbour, ancienne haute-commissaire des Nations unies aux droits humains, Mohamed el-Baradei, directeur général émérite de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et lauréat du prix Nobel de la paix, ou encore César Gaviria, ancien président de Colombie.
Tous et toutes sont favorables à un changement de paradigme en matière de politique des drogues et à la légalisation du cannabis. Ce n'est donc pas une lubie d'insoumis ou de quelque public ou population marginaux, c'est une question prise très au sérieux, y compris au niveau international, par des personnes qui ont été en première ligne dans la politique, menée depuis longtemps, de guerre contre la drogue et qui en ont tiré les conclusions, tout comme d'ailleurs une majorité de Français et de Françaises qui pensent aujourd'hui que la politique de répression n'est pas efficace pour lutter contre la consommation de drogue et se disent favorables à l'organisation d'un débat sur les politiques de drogue, selon un sondage de janvier 2021. En 2016 déjà, un autre sondage rapportait que 84 % des Français jugent inefficace la législation actuelle. En juin dernier, 51 % se disaient plutôt favorables à la dépénalisation. La consultation parlementaire de la mission d'information a montré que 80 % étaient favorables à la légalisation et notre propre sondage confirme ces majorités.
Nous avons l'occasion, collègues, à travers cette proposition de loi, d'engager notre pays aux côtés d'autres pionniers sur cette voie d'intelligence et de progrès au service de l'intérêt général. Ici et maintenant, ne ratons pas l'occasion. En tout état de cause, La France insoumise le fera, une fois au pouvoir.
Applaudissements sur les bancs du groupe FI.

Dans cette attente, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion de la proposition de loi relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l'État ;
Discussion de la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple » durant la première guerre mondiale ;
Discussion de la proposition de loi visant à restaurer l'État de droit par l'abrogation des régimes d'exception créés pendant la crise sanitaire ;
Discussion de la proposition de résolution invitant le Gouvernement à retirer la France de l'OTAN.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures.
Le directeur des comptes rendus
Serge Ezdra