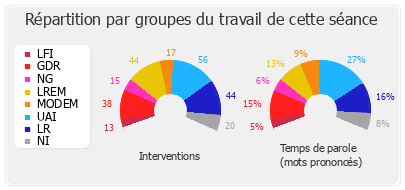Séance en hémicycle du lundi 16 juillet 2018 à 21h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles du projet de loi constitutionnelle, s'arrêtant à l'amendement no 188 portant article additionnel avant l'article 1er.

La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l'amendement no 188 .

Comme on l'a vu avant la levée de la séance de l'après-midi, le référendum n'est pas chose si courante en France. Donc, lorsque le peuple se prononce par référendum, la moindre des choses est de respecter le résultat du vote. Pourtant, cela n'a pas été le cas en 2005, lorsque le peuple s'était clairement prononcé par référendum contre le projet de traité constitutionnel européen.
Le fait d'avoir bafoué peu après la volonté populaire en faisant adopter par le Parlement le traité de Lisbonne, lequel n'est rien d'autre que le traité constitutionnel européen reconfiguré, était tout simplement scandaleux. Les tentatives actuellement constatées en Grande-Bretagne de remettre en cause la décision du peuple en faveur du Brexit sont un autre exemple de ces procédés scandaleux. L'objet du présent amendement est de faire en sorte que le résultat d'un référendum ne puisse pas être contourné par un vote a posteriori du Parlement.

La parole est à M. Marc Fesneau, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission.

La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement.

Je voudrais réagir aux débats qui ont lieu depuis tout à l'heure sur le référendum. Nous examinons ici un projet de loi visant à réviser la Constitution, mais à aucun moment le peuple n'est placé au coeur de la réflexion.
On a entendu précédemment certains collègues exprimer une forme de mépris envers le peuple : il a été dit, par exemple, que certains sujets seraient trop complexes pour être soumis au référendum. Ces propos sont très révélateurs. En 2005, les Français disent non au référendum sur la Constitution européenne. Comme cela ne plaît pas à une certaine caste, le traité de Lisbonne, qui est une copie de ce projet de Constitution européenne, est adopté par le Congrès.
L'amendement d'Emmanuelle Ménard est un amendement de bon sens, visant à faire respecter la volonté du peuple, afin que la trahison envers les Français opérée par l'adoption du traité de Lisbonne ne voie plus le jour.
En tout cas, madame la ministre, si votre projet de loi constitutionnelle avait pour objectif de redonner de la confiance aux Français, en refusant cette série d'amendements relatifs au référendum, vous ne faites qu'accentuer leur défiance envers les élus et la politique. Il ne faut pas s'étonner, dans ces conditions, que l'abstention excède 50 % à différentes élections…
Applaudissements parmi les députés non inscrits.
L'amendement no 188 n'est pas adopté.

La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l'amendement no 1724 .
L'amendement no 1724 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Cet amendement a pour objet de modifier l'article 12 de la Constitution, qui concerne le droit de dissolution de l'Assemblée nationale.
Cette faculté a été ouverte sous la Ve République parce que le Président, au moment où la Constitution a été votée, était un garant, un arbitre : il se trouvait au-dessus de la mêlée. Depuis, le Président de la République est devenu, par l'effet du suffrage universel direct, renforcé par le quinquennat, le patron de l'exécutif. À ce constat s'ajoute la volonté du Président de la République actuel d'entrer en débat avec le Parlement réuni en Congrès.
Pour l'ensemble de ces raisons, il nous semble nécessaire de réencadrer le droit de dissolution, et notamment de supprimer la possibilité des dissolutions pour convenance, à l'instar de celle intervenue en 1997. Même si cette dernière a connu un succès très relatif, le Président de la République peut toujours être tenté de dissoudre l'Assemblée si, à un moment ou à un autre, il pense qu'il a un intérêt politique à le faire.
Nous souhaitons donc restreindre le droit de dissolution à trois hypothèses. La première est celle de l'absence d'élections législatives programmées dans les deux mois qui suivent l'élection du Président de la République : une dissolution peut lui permettre, en pareil cas, d'avoir une majorité. La deuxième hypothèse est celle où le gouvernement ne parviendrait pas à obtenir la confiance, par exemple après l'adoption d'une motion de censure. La troisième hypothèse, à l'instar de ce qui a été fait par le général de Gaulle en mai 1968, …

… est celle d'une crise globale, d'un blocage du pays, qui justifie de redonner la parole au peuple.
Cela nous paraît être un amendement de bon sens, visant à assurer l'équilibre des pouvoirs, compte tenu, notamment, des réformes engagées par le projet de loi constitutionnelle.

Votre commission a donné un avis défavorable à cet amendement. Il vise à limiter le droit de dissolution de l'Assemblée nationale à trois situations : l'élection d'un Président au cours d'une législature ; la censure ou l'absence de confiance accordée à un gouvernement par le Parlement ; enfin, des circonstances exceptionnelles justifiant l'état d'urgence.

Établir des listes ne permet jamais de préjuger de la totalité des hypothèses. Vous parliez ainsi du général de Gaulle. Comment nier le bien-fondé de sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, en réponse à la crise de 1968 – laquelle, je le rappelle, n'avait pas nécessité le recours à l'état d'urgence ? Aurait-il fallu, pour des raisons uniquement procédurales, en passer par l'état d'urgence avant de dissoudre, si cet amendement s'était appliqué ?
On peut imaginer un grand nombre de situations qui n'entrent pas dans votre typologie. Par exemple, si un référendum largement soutenu par la majorité obtenait une réponse très majoritairement négative, ne serait-il pas légitime de se poser la question de dissoudre l'Assemblée nationale ainsi désavouée ? Pour prendre un autre cas de figure, si une divergence forte survenait dans le cadre européen, comme il y en a eu par le passé, ne serait-il pas cohérent de consulter les Français sur la ligne de conduite à adopter ?
Il me semble qu'il ne faut pas céder à la tentation de croire que nous pouvons tout prévoir, comme semble tenter de le faire cet amendement. C'est pourquoi l'avis est défavorable.
Avis également défavorable. Au-delà des circonstances qu'a évoquées M. le rapporteur, le pouvoir de dissolution est déjà encadré, d'une part par un certain nombre de consultations obligatoires, d'autre part par l'impossibilité de dissoudre une seconde fois dans l'année qui suit les nouvelles élections, au nom du principe « dissolution sur dissolution ne vaut ».

Pour ma part, je soutiens cet amendement. En effet, on dit souvent que notre régime présidentiel est trop fort – cela a été répété à plusieurs reprises ici. Or l'amendement en discussion est un amendement d'appel, ou du moins c'est ce que j'en ai compris, qui vise à montrer la nécessité de renforcer le régime parlementaire. Cela me paraît aller dans le bon sens.
On pourrait d'ailleurs imaginer que la Constitution ne permette plus au Président de dissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'il a été élu en même temps que les députés, pour cinq ans. Le régime présidentiel des États-Unis, par exemple, est beaucoup plus fort que le nôtre.
Je soutiens donc cet amendement. Peut-être faudrait-il le sous-amender, afin de le nuancer un peu, mais ce qu'il ne faut pas oublier, dans cette réforme, c'est le rapport entre le Parlement, qui est au fondement du régime parlementaire, et le pouvoir présidentiel. Or cet amendement permettrait d'aller vers cet équilibre. À titre personnel, mais je pense que mon groupe va me suivre, je soutiens cet amendement.

Je comprends ce que vous dites, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mais j'attire votre attention sur le fait que l'amendement gouvernemental qui nous sera proposé et qui vise à permettre au Président de la République d'entrer dans le débat parlementaire à l'occasion du Congrès change fondamentalement la nature des institutions.
On ne peut pas envisager que le Président de la République ait le pouvoir de dissoudre le Parlement, à l'issue, par exemple, d'une discussion au Congrès, sans qu'il ne soit responsable devant cette même assemblée. La seule solution qui m'est apparue logique pour restaurer l'équilibre des pouvoirs est de brider le droit de dissolution. Cet amendement n'est peut-être pas parfait et d'autres hypothèses mériteraient d'être intégrées, mais un sous-amendement peut y pourvoir.
J'insiste sur la nécessité de respecter l'équilibre des pouvoirs : si nous allons vers un régime présidentiel, en aucun cas nous ne devons aller vers un régime présidentialiste.
L'amendement no 592 n'est pas adopté.

La parole est à M. Sébastien Jumel, pour soutenir l'amendement no 1302 .

Cet amendement s'inscrit, madame la ministre, dans le même esprit que les précédents. On peut dire qu'il vise à vous préserver contre vous-même. La solitude du Président de la République et le fait qu'il se coupe souvent du peuple pour s'entourer d'experts et de courtisans ont pu le conduire, sous la Ve République, à dissoudre l'Assemblée nationale « à l'insu de son plein gré ». Cela a même pu se retourner contre lui… Ainsi, en 1997, le président Chirac a été mal inspiré de son point de vue, et bien inspiré du nôtre, de dissoudre l'Assemblée.

Il n'était en tout cas pas prévisible de son point de vue que l'Assemblée sortie des élections qu'il avait provoquées ait cette couleur. Mais M. Chirac était peut-être suffisamment machiavélique pour avoir anticipé sa réélection, comme vous le suggérez, monsieur Lagarde.

Cet amendement propose d'encadrer ce fait du prince qu'est le droit de dissolution, en renvoyant d'ailleurs à une loi organique afin de surmonter l'obstacle, évoqué tout à l'heure, relatif à la complexité de la définition.

Défavorable. Monsieur Jumel, je vous remercie de votre sollicitude pour les présidents de la République qui se sont succédé. La France n'est pas menacée par la multiplication des dissolutions, puisque la dernière, que vous avez rappelée, date de 1997 ; il y en avait auparavant eu deux dans les années 1980 et aucune dans les années 1970, preuve que ce droit est exercé avec parcimonie.
Par ailleurs, les rapporteurs ne voient pas de difficulté dans la possibilité de trancher toute crise politique par le recours à la dissolution. Cet outil existe justement pour permettre de canaliser un mécontentement et de revenir devant les Français au travers des urnes. Quant à la crainte de dissolutions de convenance inspirées par la tactique politique, que vous n'êtes pas le seul à évoquer, les Français sont réputés pour faire payer chèrement les calculs politiques de cette nature, comme on l'a vu en de maintes occasions. Les derniers qui s'y sont essayés n'en ont guère profité au final.
Le problème auquel se heurte immanquablement, je le disais pour M. Becht tout à l'heure, la tentative de dresser une liste est toujours le même : comment être sûr que le législateur organique n'oubliera aucun cas de figure, ce qui pourrait, dans quelques décennies, plonger les Français dans l'embarras en leur interdisant le recours à la dissolution ?
Même avis défavorable.

Monsieur le rapporteur, sans doute peut-on considérer que les dissolutions ont été peu nombreuses et, à l'exception d'une, consécutives à une crise politique majeure, comme en 1968, ou à une élection présidentielle. Mais tous les professeurs de droit constitutionnel disent, tous leurs étudiants apprennent que la dissolution est un canon braqué sur la tempe du Parlement, et plus particulièrement sur la majorité de l'Assemblée nationale !

Ce n'est pas parce que l'on ne presse pas sur la détente que ce canon n'est pas là en permanence. Je veux bien croire que cette majorité, parce que du nouveau monde, serait plus vertueuse que les autres, mais dans n'importe quel pays du monde, quand on parle de dissolution du Parlement, celui-ci cherche une autre solution pour s'en sortir !
Les deux instruments de pouvoir de l'exécutif sur le Parlement sont l'article 49. 3 de la Constitution et la dissolution. Cette dernière est d'ailleurs susceptible d'être déclenchée après application de l'article 49. 3. Il y a donc effectivement aujourd'hui une très forte dissymétrie entre l'exécutif et le Parlement, puisque le premier peut balayer à tout moment le second. Le risque que le peuple français n'apprécie pas existe, j'en conviens, mais il a pour effet de renforcer le canon, puisque du coup la majorité peut se trouver balayée deux fois : par l'exécutif, et par le peuple français. Cela conduit souvent les majorités successives à adopter des textes qu'elles auraient souhaité ne pas soutenir.
L'amendement no 1302 n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l'amendement no 217 .

Il s'agit d'un amendement de repli prévoyant de protéger la nouvelle majorité élue après une élection présidentielle de la menace d'une dissolution pendant un an. Cette protection existe déjà pour l'Assemblée élue après une dissolution, nous souhaitons donc l'étendre aux élections législatives.
Cela revient, chers collègues, à donner la possibilité à une nouvelle majorité de trouver son point d'équilibre. Depuis 2002, les Français ont donné une majorité absolue à un seul parti, mais la situation pourrait être différente et l'on pourrait revenir à la culture de coalition qui était celle du Parlement et des Français auparavant. Si des coalitions étaient à nouveau nécessaires, il ne faudrait pas qu'elles se fassent avec le canon braqué sur la tempe de l'Assemblée nationale à peine élue par les Français. Donner un délai d'un an paraît raisonnable.
Également défavorable. Monsieur Lagarde, le droit de dissolution, qui est un pouvoir propre du Président de la République, s'exerce dans certaines limites. D'abord, il y a les consultations.
Elles ne sont pas négligeables, monsieur le député, vous le comprenez bien.
Non, vraiment.
Il y a aussi des interdictions temporelles, dans certaines circonstances, et cette dernière phrase de l'article 12 qui emporte que « dissolution sur dissolution ne vaut », comme je l'ai dit tout à l'heure.
Surtout, le pouvoir de dissolution est une réponse à l'engagement de la responsabilité ministérielle. C'est cette réponse qui équilibre nos institutions.

Si l'on allait au bout de la logique de Jean-Christophe Lagarde, on transférerait le droit de dissolution du Président de la République vers le Premier ministre. Notre régime est parlementaire, et dans un tel régime, la dissolution est bien le pendant et l'équivalent fonctionnel nécessaire de la possibilité pour l'Assemblée nationale de censurer le Gouvernement.
Du reste, il y a des précédents : en 1955, sous l'empire de la Constitution de la IVe République, le président du Conseil, Edgar Faure, avait dissous la chambre des députés.

Dans le régime originel de la Ve République, le Président de la République était un arbitre. Le choix de l'élire au suffrage universel direct puis le raccourcissement de son mandat à cinq ans ont fait de lui non plus un arbitre, mais le maître du jeu. Et l'on n'imagine pas le maître du jeu être neutre, contrairement à l'arbitre.
Madame la ministre, vous dites que le Président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale dans l'année suivant une première dissolution. Je défends la même logique pour les élections législatives ne faisant pas suite à une dissolution ! En effet, quand le peuple français vient de se prononcer dans des élections générales, la dissolution ne devrait pas être permise pendant un an, même si la composition de l'Assemblée nationale ne plaisait pas au Président nouvellement élu. Pourquoi créer une différence entre les élections législatives provoquées par une dissolution et celles qui suivent une élection présidentielle ? Dans un cas, on interdit la dissolution, et dans l'autre, le maître du jeu peut changer la règle à sa convenance !
Il est peu probable, dans la réalité, qu'un Président de la République veuille dissoudre une Assemblée élue quelques semaines après lui. Mais même dans cette hypothèse, vous considérez, chers collègues, que le Président devrait conserver le droit de presser le canon sur la tempe de l'Assemblée nationale avant qu'elle ne trouve son point d'équilibre ! L'Assemblée nationale représente-t-elle vraiment le peuple français, ou n'est-elle que l'exécutant de l'exécutif ?
L'amendement no 217 n'est pas adopté.

La parole est à M. Guillaume Larrivé, pour soutenir l'amendement no 1506 .

Avec cet amendement, je veux poser la question de la procédure par laquelle l'Assemblée nationale est associée à certaines nominations faites par le Président de la République. Il y a dix ans, la révision constitutionnelle de 2008 avait permis à certaines nominations de faire l'objet d'un avis des commissions des assemblées. Je propose d'étendre le champ de ces avis et de faciliter le contrôle du Parlement, en prévoyant une majorité simple et non plus une majorité des trois cinquièmes.
Au-delà de la technique, l'idée est la suivante : si vous voulez, madame la ministre, diminuer le nombre de parlementaires, cela ne peut avoir de sens démocratique que si ces parlementaires moins nombreux sont plus puissants au coeur de l'État.

Monsieur Larrivé, votre amendement contient deux sujets. Tout d'abord, l'article 13 de la Constitution révisée en 2008 a vocation à encadrer les pouvoirs du Président de la République, en évitant les nominations de complaisance qui ont pu se produire dans le passé. Il ne s'agit pas pour les parlementaires de se substituer à l'autorité de nomination et de s'opposer à celle-ci sur des éléments purement politiques. Un refus doit venir sanctionner une erreur manifeste d'appréciation initiale et donc réunir une majorité qualifiée dans les deux assemblées, au-delà des clivages naturels entre la majorité et l'opposition. Exiger une majorité positive ne reviendrait pas à faire primer la compétence, qui peut être consacrée par des nominations non consensuelles.
Ensuite, l'élargissement des nominations contrôlées par le Parlement à certains préfets, recteurs, ambassadeurs et directeurs d'administration centrale constitue une question tout à fait différente. Il reviendrait alors au législateur organique de sélectionner au cas par cas les postes concernés. Cela pourrait être intéressant pour certains postes stratégiques, sans que la liste soit aussi exhaustive que celle que vous proposez. Vos rapporteurs proposent d'entendre la position du Gouvernement sur ce point. Globalement, j'émets un avis défavorable à l'adoption de votre amendement.
Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur la procédure mise en place, qui permet aux assemblées de s'opposer à une nomination lorsqu'un désaccord important existe avec le Président de la République, mais sans remettre en cause le pouvoir de nomination de celui-ci. La majorité négative des trois cinquièmes est ainsi imposée.
Le cinquième alinéa de l'article 13 renvoie à une loi organique le soin de déterminer les emplois et les fonctions concernés. Certains emplois sont cités par l'article 13, et des lois organiques sont intervenues pour fixer les autres emplois sur lesquels le Parlement est sollicité. Une première loi, de 2010, est relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13. Une seconde, celle du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, a modifié la liste, qui va comporter toute une série de fonctions, comme celles de Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de président de France Télévisions.
Il me semble donc que l'actuelle liste de fonctions est suffisante, et que l'appréciation équilibrée des nominations est garantie. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable, monsieur Larrivé.
Par ailleurs, la liste que vous proposez omet la fonction d'ambassadeur. Il s'agit sans doute d'un simple oubli.

Nous avons longuement débattu tout à l'heure du poids respectif auquel il est souhaitable de parvenir entre le législatif, l'exécutif et le peuple. Il me semble que le présent amendement améliore l'implication du Parlement dans le jeu démocratique et renforce ses pouvoirs.
L'amendement no 1506 n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement no 1295 .

Comme je l'indiquais plus tôt au sujet de la composition du Gouvernement, la parité, trop souvent cantonnée au rôle de simple objectif, doit désormais s'imposer dans nos institutions. Plus qu'un symbole, elle est la concrétisation de l'égalité et de la prise en considération des problématiques de tous les citoyens. La Constitution doit être garante de l'égalité, inscrite dans notre devise.
À l'heure actuelle, la haute fonction publique est largement à la traîne de cette préoccupation. Ainsi, en 2015, on ne comptait que 16 % de femmes ambassadrices et 11 % de femmes préfètes.
Avec cet amendement, recommandé par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, nous proposons de reconnaître la place des femmes dans les emplois publics ainsi que les fonctions de représentation et de commandement soumis à nomination en conseil des ministres. Nous proposons d'assurer une parité nécessaire en énumérant au masculin et au féminin les fonctions mentionnées à l'article 13. Notre proposition vise à reconnaître la place des femmes dans leur représentation institutionnelle quotidienne.
Applaudissements sur les bancs des groupes FI et UDI-Agir.

Comme sur tous les amendements de cet ordre, l'avis de la commission était et demeure défavorable. Nous partageons vos objectifs et votre constat s'agissant des progrès restant à accomplir, cher collègue. Il nous semble néanmoins que l'affirmation des droits des femmes passe par des politiques volontaristes et un engagement sans faille visant à faire évoluer les mentalités – chacun ici en conviendra, sur tous les bancs – et ne passe pas par l'allongement sans fin des termes inscrits dans la Constitution, parfois par effet d'affichage. Je ne dis pas que le présent amendement cherche l'effet d'affichage, mais il faut y être attentif en général. Personne ne doute que les directeurs d'administration centrale puissent être des directrices, ni les préfets des préfètes.

C'est d'autant moins le cas désormais que nous avons voté voici quelque temps, et réaffirmé tout récemment à l'article 1er de la Constitution, l'égalité entre tous les citoyens sans distinction de sexe, ce qui devrait participer aux évolutions souhaitées. Avis défavorable.
Monsieur le député, l'ancienne rectrice d'académie que je suis partage pleinement votre préoccupation. Toutefois, cet alourdissement du texte constitutionnel ne serait pas heureux. J'émets donc un avis défavorable.

Nous avons déjà abordé le sujet. Pour ma part, je voterai l'amendement. En la matière, le monde administratif a énormément de retard sur le monde politique.
Le monde politique a pris des décisions, qui ont été violentes pour une génération d'hommes.

Pour redoutables qu'elles aient été, au moins, nous les avons prises. Comment se fait-il que le véritable pouvoir qu'est le pouvoir administratif – ne nous leurrons pas, mes chers collègues ! – soit épargné ? La logique commande d'aller dans ce sens, avec volontarisme. À titre personnel, je voterai l'amendement et suis convaincu que la plupart des membres de mon groupe le voteront également.

Bien entendu, nous voterons cet amendement. Comme vient de le dire M. Le Fur, rappeler que des choses ont été faites et que ça ira mieux petit à petit, c'est bien beau mais ça ne suffit plus ! Madame la ministre, vous qui avez été rectrice, vous apprécieriez sans doute que l'on compte 50 % de rectrices et 50 % de recteurs !
C'est le cas !

À l'heure actuelle, on constate des différences entre hommes et femmes dans bien trop de professions. Par exemple, dans le monde des soignants, on compte 80 % de femmes, et tous ceux qui dirigent sont des hommes ! Il faut donc faire attention.
Comme le disait M. Le Fur, sur le coup, ça peut faire mal. C'est un peu le syndrome du pansement : on peut l'enlever très doucement, avec un peu d'eau, ou tout arracher d'un coup. En tout état de cause, il n'est plus possible, en 2018, de converser pendant des heures sur la parité : il faut avancer. Les femmes et les hommes sont tous méritants. Demandons l'égalité une fois plus toutes, que nous n'ayons plus à en débattre sur ces bancs !
Applaudissements sur les bancs du groupe FI. – M. M'jid El Guerrab applaudit.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement no 1295 , mis aux voix par assis-levé, n'est pas adopté.

Cet amendement, auquel Mme Pires Beaune a énormément travaillé, vise à transcrire dans la Constitution une certaine idée de la présidence de la République. Au cours de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron déclarait que l'idée du spoil system n'est « ni de droite, ni de gauche ». L'amendement vise à mettre en place ce « système des dépouilles ». Sa rédaction en restreint la portée à un nombre limité de fonctionnaires, en tout état de cause bien moins nombreux que ceux visés par l'article 13 de la Constitution, et même que ceux évoqués par le Président de la République. En effet, ne sont visés que les directeurs d'administration centrale, lesquels doivent soutenir la politique du Gouvernement car ils la mettent en oeuvre.

L'amendement prévoit l'audition de tous les directeurs d'administration centrale par les commissions parlementaires dans les six premiers mois de chaque législature. Vous parlez d'un nombre limité de hauts fonctionnaires, cher collègue, mais on compte approximativement 180 directeurs d'administration centrale. Il faudrait donc en auditionner trente par mois, soit un par jour, dimanches compris, entre le 15 juin et le 15 décembre de la première année de chaque législature, ce qui me semble difficilement réalisable, soit dit du point de vue pratique.
Du point de vue théorique, il ne semble pas bon à vos rapporteurs que le Parlement suive à la loupe la nomination de chaque directeur d'administration centrale. D'ailleurs, je suis étonné qu'un tel amendement provienne de vos bancs. Les directeurs d'administration centrale restent des fonctionnaires chargés d'exécuter les décisions du ministre dont ils relèvent. En cas de mauvaise volonté avérée, celui-ci est tout à fait libre de les remplacer.

Rendre obligatoire leur renouvellement à chaque législature renforcerait le lien entre la haute administration et la majorité politique, menaçant ce que nous défendons tous, me semble-t-il : la neutralité attendue de chaque agent public. Avis défavorable.
Il est également défavorable. Vous proposez, monsieur le député, de modifier les conditions de nomination des directeurs d'administration centrale. Je rappelle que celle-ci est soumise, depuis un décret de 2016, à l'avis d'un comité chargé d'entendre les personnes susceptibles d'être nommées. Cette procédure, qui relève du pouvoir réglementaire et non de la Constitution, assure d'ores et déjà l'obtention d'un avis qui, en raison de la composition de la commission, est très important.
Au nom de la séparation des pouvoirs, il me semble tout à fait essentiel que le pouvoir exécutif demeure seul responsable de la nomination des directeurs d'administration centrale, lesquels sont placés sous son unique contrôle. Il ne me semble donc pas utile d'amender l'article 13 en vue de calquer la procédure de nomination des directeurs d'administration centrale sur celle qui comporte les exigences que vous évoquez.
En second lieu, vous évoquez une obligation de renouvellement des emplois de directeurs d'administration centrale au cours des six mois suivant le renouvellement de l'Assemblée nationale. Un tel système modifierait profondément la lettre de notre actuel système d'emplois publics. Au fond, vous proposez de substituer un système de l'emploi au système de la carrière caractérisant notre fonction publique, même si celui-ci a été de fait légèrement atténué au cours des années.
Officialiser au rang constitutionnel une telle obligation de renouvellement me semble susceptible de faire naître un sentiment de suspicion à l'égard des hauts fonctionnaires, lesquels sont soumis à une obligation de loyauté à l'égard des gouvernements qu'ils servent. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.

D'après nos comptes, quarante-trois directeurs généraux et directrices générales d'administrations centrales ont été nommés depuis l'entrée en fonction du président Macron. De nombreuses nominations sont concentrées dans les secteurs de la défense et de l'intérieur, …

… avec pour principaux changements la DGSI, la DGSE, la direction du renseignement militaire, la direction générale de l'armement, la direction générale des systèmes d'information, la direction de la protection des installations, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale… bref, un nombre important de directeurs généraux. Un point est saillant : les directeurs des principaux services de renseignement ont tous été remplacés au cours de l'année suivant l'élection du Président de la République.
L'amendement no 1188 n'est pas adopté.

La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l'amendement no 1719 .

Il vise à encadrer le pouvoir de nomination du Président de la République en le limitant à certains emplois particulièrement importants « pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », comme le dit l'article 13 de la Constitution. Il s'agit de rendre indispensable l'accord préalable d'une commission composée de parlementaires se prononçant à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur chaque nomination. Un tel dispositif valoriserait le Parlement, qui disposerait ainsi de la possibilité de bloquer une nomination, contrairement à celui actuellement prévu par la Constitution, qui ne prévoit que l'avis simple d'une commission parlementaire, ce qui est dépourvu de toute force contraignante pour le Président de la République.

Contrairement à ce qu'on peut lire dans l'exposé sommaire de votre amendement, madame Dubié, l'avis du Parlement sur les nominations envisagées par le Président de la République n'est pas uniquement indicatif, comme en dispose l'article 13 de la Constitution. En effet, une majorité des trois cinquièmes hostile à une nomination empêche le chef de l'État d'y procéder. Votre amendement nous semble donc formellement satisfait par le texte en vigueur. J'en suggère donc le retrait et émets à défaut un avis défavorable.
L'analyse grammaticale du verbe « nommer » à laquelle M. Fesneau vient de se livrer me semble tout à fait exacte. J'émets donc un avis défavorable.
L'amendement no 1719 n'est pas adopté.

Il vise à modifier le processus d'élaboration de l'avis du Parlement sur les nominations prévues à l'article 13 de la Constitution. Nous proposons la réunion conjointe des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cela me semble avoir beaucoup de sens, tout en conservant la possibilité d'un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes.

C'est une idée opérationnelle : au lieu de réunions séparées, l'une du côté de l'Assemblée et l'autre du Sénat, il y aurait une réunion conjointe. Un seul avis serait donc rendu, et les trois cinquièmes seraient comptés de façon globale. On éviterait ainsi le risque de blocage : que se passerait-il si l'une des deux chambres seulement donnait un avis négatif ? Notre proposition renforce ainsi la stabilité institutionnelle.

La parole est à M. Richard Ferrand, rapporteur général de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur cet amendement.

Je ne vois pas bien quels sont, au fond, les changements proposés. La majorité requise est déjà des trois cinquièmes ; vous ne modifiez pas non plus les organes consultés, à savoir les commissions compétentes des deux chambres, dont les suffrages sont aujourd'hui déjà amalgamés.
La seule évolution que vous proposez, c'est finalement d'imposer aux commissions des deux assemblées de se réunir physiquement.

Cela reviendrait à contraindre les commissaires du Sénat à se rendre à l'Assemblée ou ceux de l'Assemblée à se rendre au Sénat, …
Rires.

… tout cela pour épargner à la personne pressentie une seconde audition. C'est un effort logistique demandé aux deux chambres pour peu de chose. En outre, cela priverait chaque chambre du pouvoir d'organiser sa propre audition de l'impétrant, système qui ne me paraît pas nocif.
Il me semble donc que la sagesse conduirait au retrait de l'amendement. Sinon, avis défavorable.
Au-delà des arguments avancés par M. le rapporteur général, il me semble qu'avec votre amendement, il deviendrait impossible de distinguer les spécificités de chacune des chambres du Parlement. Rien n'empêche qu'elles aient sur l'impétrant des opinions différentes, pour des raisons qui leur appartiennent.
Aujourd'hui, il n'y a que deux cas où les deux chambres statuent ensemble : le Congrès et la commission mixte paritaire. Je ne suis pas sûre qu'il soit judicieux d'en ajouter un troisième. Avis défavorable.

L'amendement de Patrick Hetzel me paraît au contraire plein de bon sens. Aujourd'hui, concrètement, si la commission de l'Assemblée vote en premier, on congèle le vote, ensuite le Sénat vote, puis l'on mélange le résultat des deux. Certains pourraient voir un risque dans cette congélation !
Si les deux commissions siègent ensemble, on vote tout de suite, on dépouille et le résultat est immédiat. Connaissez-vous beaucoup de scrutins, madame la garde des sceaux, où intervient une telle procédure de congélation ?
Rires.

L'amendement Hetzel est donc plein de bon sens, et tout sauf révolutionnaire.

Les arguments de Charles de Courson me paraissent tout à fait pertinents. Je voudrais ajouter qu'en effet, madame la ministre, les deux chambres se réunissent déjà pour les commissions mixtes paritaires. Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, avec cet amendement il y aurait en effet une seule audition, mais surtout un seul débat, commun, ce qui pourrait être très judicieux pour les nominations !

Encore une fois, je n'imagine pas que nous ayons soudain une flopée de nominations. Dès lors que celles-ci se font de manière cohérente, cette nouvelle procédure serait plus efficace. Ce serait aussi l'occasion pour notre bicamérisme de mener une co-construction, qui serait particulièrement judicieuse ici.
Je ne voudrais pas douter que la congélation fût de rang constitutionnel, messieurs les députés,
Sourires
mais j'aimerais savoir, monsieur de Courson, quelle procédure vous proposez pour les membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés par le président du Sénat ou par celui de l'Assemblée, lesquels sont entendus exclusivement par la commission de la chambre concernée.
C'est, vous l'avez compris, une question qui n'exige pas de réponse…
L'amendement no 747 n'est pas adopté.


Introduite en 2008, l'actuelle procédure est certes un progrès par rapport à l'entière discrétion dont étaient jadis entourées les nominations, mais constitue tout au plus un pouvoir de veto à majorité qualifiée : donner au Parlement le droit de s'opposer à une nomination à la majorité des trois cinquièmes, c'est fixer le seuil d'approbation aux deux cinquièmes. Du reste, des revendications en faveur d'une approbation positive de ces nominations à la majorité des trois cinquièmes sont régulièrement émises – je vous renvoie au rapport du groupe de travail sur l'avenir des institutions dirigé par MM. Bartolone et Winock.
Cet amendement tend donc à renforcer le contrôle parlementaire, et en l'occurrence le droit de regard parlementaire sur les nominations, en inversant la logique de la procédure par le passage d'un veto à une majorité renforcée à une habilitation à la majorité simple.

La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l'amendement no 1721 .

L'amendement vient d'être présenté : il s'agit d'inverser la logique en passant d'un veto à la majorité qualifiée à une habilitation à la majorité simple.

Je suis étonné de votre réaction, madame la ministre. Aujourd'hui, le candidat choisi par le gouvernement est toujours confirmé. Toujours.
Il est déjà arrivé que le candidat pressenti soit refusé par le Parlement !

Cela s'est produit une fois, peut-être ! Généralement, il n'y a jamais de veto. Bien sûr, par définition, on pense que c'est quelqu'un de compétent… mais parfois, ce sont des copains ! Des copains de gauche, des copains de droite, des copains du gouvernement… Tout le monde le sait, même si, par charité chrétienne, je ne donnerai aucun nom de personnalités politiques qui sont devenues présidente ou président de telle ou telle organisation.
La majorité des trois cinquièmes pour s'opposer à une nomination, ce n'est pas une vraie condition ! Avec une majorité simple, il y aurait au moins un peu de transparence, même si naturellement la majorité est toujours majoritaire. Aujourd'hui, madame la ministre, ces nominations, ce sont des farces, purement et simplement !

Monsieur Pancher, la procédure créée en 2008 n'est pas restée sans effet. J'en veux pour preuve que sous la précédente législature, alors que Jean-Jacques Urvoas était président de la commission des lois, la gauche et la droite – en l'occurrence, M. Urvoas et votre serviteur – s'étaient entendues pour bloquer la nomination d'un impétrant au Conseil supérieur de la magistrature. Les trois cinquièmes avait été réunis.

La parole est à M. M'jid El Guerrab, pour soutenir l'amendement no 944 .

Les dispositions introduites en 2008 représentent une avancée en matière de contrôle parlementaire, mais des améliorations sont possibles, voire souhaitables. Voilà pourquoi il faudrait inverser la logique de cette procédure et passer à une majorité simple.
Cet amendement-ci s'attaque à un véritable angle mort du droit constitutionnel : absolument rien n'est prévu concernant l'éventuel retrait des personnes nommées. Nous avons connu le cas récemment dans le service public audiovisuel : les révocations s'opèrent à la discrétion de l'autorité jouissant du pouvoir de nomination. Il importe de remédier à cet état de fait. Cela serait possible en instaurant, par parallélisme des formes, un droit de regard du Parlement sur les révocations des fonctions visées par l'article 13 de la Constitution.
Cet amendement vise donc, encore une fois, à renforcer le contrôle parlementaire : si les commissions sont saisies lors de la nomination, il est normal de les saisir en cas de révocation. Une autorité administrative indépendante ne doit pas pouvoir agir seule pour le second cas.

Revenons aux principes. Le souhait des parlementaires, c'est d'avoir face à eux des ministres qui décident, qui s'en donnent les moyens, et qui exercent pour cela une véritable autorité sur leurs équipes. Le pouvoir de nomination revient donc logiquement à l'exécutif, même s'il peut exister des modalités de contrôle. Dans cette logique, le Parlement n'a pas à intervenir en cas de révocation.
Les ministres, je le redis, doivent exercer une autorité, définir une politique, naturellement sous le contrôle du Président et du Premier ministre, et se donner les moyens, notamment par le choix de leurs collaborateurs, de la mettre en oeuvre. Et ce sont bien ces ministres qui, contrairement aux fonctionnaires, sont comptables de leur action devant nous.

Notre philosophie est plutôt celle d'un renforcement permanent du rôle du Parlement. Le pouvoir est tellement concentré de nos jours que les parlementaires ont rarement leur mot à dire ! Lorsqu'il y a des nominations, il faut vraiment que le type soit parfaitement mauvais pour réussir à réunir contre lui une majorité des trois cinquièmes…

Mais passons. Au moins, au moment de la nomination, les commissions se réunissent et il y a un débat : la personne qui va être nommée révise un peu ses fiches, et elle est mise sur le grill. En revanche, quand le Gouvernement décide de se séparer de telle ou telle personnalité, la question n'est pas même soulevée.
Il serait sans doute à peu près impossible de s'opposer pour de bon à une révocation, mais l'organisation d'un débat serait au moins un tout petit début de renforcement du rôle du Parlement. C'est pourquoi nous pensons que cet amendement doit être adopté.
L'amendement no 944 n'est pas adopté.


Cet amendement, dans le même état d'esprit que le précédent, vise à renforcer le contrôle du Parlement, non pas sur les hauts fonctionnaires qui travaillent dans les ministères mais sur les nominations présidentielles entrant dans le cadre de l'article 13 de la Constitution.
Nous proposons donc une inversion, c'est-à-dire que le Parlement donne un avis positif, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Actuellement, la possibilité concrète de s'opposer est particulièrement réduite. Les effets vertueux espérés en 2008 ne sont pas au rendez-vous.
Cet amendement s'inspire du rapport Refaire la démocratie qu'avaient corédigé Claude Bartolone et Michel Winock.

Dans le débat sur la réforme constitutionnelle, il est dit qu'il faut absolument que le Parlement renforce son rôle de contrôle. Vous avez là, madame la ministre, un exemple concret de ce renforcement : dans une belle démocratie telle que la nôtre, renforcer le contrôle des parlementaires constitue une garantie.
Tel est notre point de vue, dont procède cet amendement, conforme à l'état d'esprit que vient d'exprimer notre collègue. Faisons-le ! Quel serait le risque ? Les personnalités nommées, comme le Défenseur des droits des enfants ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté par exemple, ne sont pas des hauts fonctionnaires qui seraient à la disposition du Gouvernement – et dont on peut comprendre qu'il revienne au ministre de les nommer, pour qu'ils exécutent sa politique. Ce ne sont pas les mêmes nominations !

Sur l'amendement no 1425 , je suis saisi par le groupe Nouvelle Gauche d'une demande de scrutin public.
Sur l'amendement no 2247 , je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public.
Sur l'amendement no 1296 , je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public.
Sur l'amendement no 2238 , je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public.
Ces quatre scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Pierre Dharréville, pour soutenir l'amendement no 2247 .

Il est dans le droit-fil des propos de Joaquim Pueyo. Pour certains emplois et fonctions dont la liste est fixée par la loi organique du 23 juillet 2010, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a conditionné le pouvoir de nomination du Président de la République en demandant l'avis public de la commission compétente dans chacune des assemblées. La nomination ne peut avoir lieu si le total des votes exprimés au sein des commissions est négatif à plus des trois cinquièmes.
Cette disposition a déjà renforcé les pouvoirs de contrôle du Parlement sur l'exécutif. Il nous semble utile et nécessaire d'aller plus loin et de renforcer le contrôle du Parlement, ce qui est également souhaité par la majorité, si j'ai bien compris, sur les nominations envisagées par le Président de la République, en substituant au système actuel une majorité positive des trois cinquièmes des membres des commissions compétentes.
Comme cela a été indiqué, cet amendement de bon sens est issu des réflexions du groupe de travail mené en 2015 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Claude Bartolone, et par Michel Winock.
Lorsque cet amendement a été examiné en commission, il nous a été dit qu'il favoriserait des nominations politiques. Il nous faudrait davantage d'explications car de notre point de vue, c'est justement l'inverse : l'adoption de cet amendement obligera à rechercher un minimum de consensus.
Applaudissements sur quelques bancs des groupes GDR et NG.
Également défavorable. Cet amendement inverse la logique qui a prévalu en 2008, en basculant d'un vote négatif des trois cinquièmes vers un vote positif. Cette inversion de logique aboutit à un déplacement de l'équilibre institutionnel.
Le Président ne deviendrait alors qu'une signature d'enregistrement du choix du Parlement, par un vote aux trois cinquièmes. De ce point de vue, il perdrait son pouvoir autonome de nomination, ce qui ne correspond pas à ce que prévoit expressément la Constitution.
Ce qui découlerait de cette inversion, c'est un risque de blocage, le dialogue entre différents groupes d'opposition pouvant conduire à une approche plus politique des nominations que celle qui est aujourd'hui fondée sur la compétence.
Oui, et c'est un véritable marchandage !

Je rappelle tout de même que cela fait des années que nous tentons d'inverser le dispositif et d'aller vers une majorité positive des trois cinquièmes. J'ai participé à la mission parlementaire menée par Claude Bartolone et Michel Winock, dont le rapport a été cité à juste titre. Une très grande majorité s'était dégagée en faveur de cette disposition, non pas dans l'optique de modifier l'esprit de la Constitution, mais en vue de rééquilibrer les pouvoirs entre le Parlement et l'exécutif.
Le pouvoir de proposition, qui est essentiel, appartient au Président de la République. L'assiette étant plus large, un travail de conviction devrait être réalisé, afin d'obtenir une garantie sur les compétences. Cette ouverture serait très favorable.

Madame la garde des sceaux, je ne comprends pas votre argumentation. Vous nous dites en substance que l'amendement aurait pour effet de politiser certaines nominations, mais c'est précisément le contraire !
Soyons concrets : l'adoption de cet amendement, que je voterai, signifierait par exemple que le Président de la République ne pourrait pas procéder à la nomination du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel si cette personnalité ne recueillait pas l'accord des trois cinquièmes des députés et sénateurs concernés.

C'est bien la preuve que cet amendement aurait pour conséquence, non pas une politisation, mais le respect du pluralisme.
Applaudissements sur les bancs du groupe LR.

En effet, pour une nomination aussi sensible, aussi importante que celle du président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel public, nous aurions en réalité un choix transpartisan. Je voterai donc cet amendement.

Cette disposition existe dans certaines démocraties modernes, comme en Allemagne ou aux États-Unis, où elle ne se montre pas de nature à ralentir les nominations, ni à mettre en cause la compétence des personnes nommées.

Ce qui est possible chez nos voisins ne crée pas de risques de blocage, contrairement à ce que l'on nous dit. La proposition n'est donc pas délirante.

Pardon, cher collègue, mais cette proposition nous ramène dix ans en arrière : nous avions déjà eu ce débat. À l'époque, l'exécutif ne voulait pas accorder à l'opposition une capacité de blocage. Quant aux parlementaires, du moins les plus volontaires pour que le Parlement exerce certaines responsabilités, ils expliquaient que dans tous les pays démocratiques, on cherche à rassembler autour d'une candidature plutôt qu'à permettre à la majorité de s'opposer. Tel est le fond de l'amendement.
Dans le système actuel, pour qu'un candidat de l'exécutif ne soit pas nommé, il faut non seulement que l'opposition s'oppose, mais aussi qu'une partie de la majorité n'adhère pas à la proposition. Dit autrement, il suffit de détenir plus de 50 % des voix – ce qui, par nature, est le cas de la majorité – pour nommer qui l'on veut.
Il me semblerait être un vrai progrès démocratique, lorsqu'on veut nommer quelqu'un à une responsabilité importante, que de devoir recueillir un consensus non pas total, mais raisonnable, des deux tiers ou des trois cinquièmes, comme cela se fait dans de nombreuses démocraties. La qualité du candidat ou de la candidate serait alors reconnue par la majorité, mais aussi par une partie de l'opposition.
Nous voterons donc cet amendement car nous préférons que la Constitution permette de se rassembler sur une candidature, plutôt que le Parlement aie à s'opposer à une proposition de l'exécutif pour espérer exercer son droit de contrôle.

Le fond du sujet est là. Ce qui, j'en témoigne, n'a pas été possible à la demande du président Sarkozy, pourrait l'être avec la nouvelle majorité – avec le Président et sa vision de la démocratie, d'une démocratie qui rassemble non seulement en contre, mais en pour.
Trois cinquièmes qui se rassemblent en « pour » ont de la force. Mais trois cinquièmes qui se rassemblent en « contre », non seulement c'est difficile à obtenir, mais cela offre une vision négative du contrôle du Parlement sur l'exécutif.
Applaudissements sur les bancs des groupes LR et NG.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 101 |
| Nombre de suffrages exprimés | 99 |
| Majorité absolue | 50 |
| Pour l'adoption | 33 |
| contre | 66 |
L'amendement no 1425 n'est pas adopté.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 101 |
| Nombre de suffrages exprimés | 99 |
| Majorité absolue | 50 |
| Pour l'adoption | 34 |
| contre | 65 |
L'amendement no 2247 n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l'amendement no 1296 .

Comme on dit chez moi, on ne cale pas ! C'est pourquoi nous proposons de compléter l'article 13 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « Pour chacune de ces nominations, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes nommés ne doit pas être supérieur à un ».
Cet amendement, issu, je le redis, d'une recommandation du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, vise à assurer un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes dans la haute fonction publique, pour les personnalités occupant des fonctions de représentation territoriale ou internationale du gouvernement ou de commandement militaire, nommées en conseil des ministres.
En 2015, je le rappelle, il n'y avait que 31 % de directrices d'administration centrale, 16 % d'ambassadrices et 11 % de préfètes. Je m'interroge : la parité n'est-elle pas la grande cause de ce quinquennat ?

Quel est l'avis de la commission ?
La parole est à Mme Yaël Braun-Pivet, présidente et rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission.

Avis défavorable. Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises, ma conviction est que la parité n'est plus un combat constitutionnel. Elle l'a été, et c'est pourquoi nous avons eu besoin de modifier notre Constitution, notamment pour permettre l'accession des femmes aux responsabilités électives.

Mais maintenant que les femmes sont membres des conseils départementaux, des conseils régionaux, de cette Assemblée, des conseils d'administration, le combat n'est plus dans cet hémicycle, mais au quotidien.

Il faut que les autorités qui procèdent aux nominations nomment des femmes, et je ne souhaite pas que nous leur imposions ces nominations. À elles, maintenant, de passer à cette étape et de nommer des femmes.

Je ne crois pas. Le temps de l'action est venu, mais de l'action quotidienne, non plus constitutionnelle.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.
Même avis défavorable.

Le débat sur ce sujet s'est tenu il y a quelques jours. Olivier Becht avait défendu un amendement pour expliquer que, s'agissant d'un concours, la parité n'est pas nécessaire, puisque le concours établit la compétence et l'aptitude. Je me souviens d'ailleurs que la réponse qui lui avait été faite interprétait mal son propos : il ne s'agissait pas d'affirmer qu'il existe des femmes ou des hommes plus ou moins compétents. Ce n'était pas un présupposé, comme Mme la présidente de la commission l'avait reconnu.
Cependant, nous parlons là de nominations, qui relèvent donc du pouvoir discrétionnaire. Or le pouvoir discrétionnaire, sous la pression de l'opinion publique, a appliqué la parité pour les membres du gouvernement, parité qui a été prévue par la loi pour la majorité des scrutins – pas encore pour tous compte tenu de la difficulté que cela peut représenter. Et ce ne serait pas le cas pour les nominations administratives ?
Je peux entendre votre remarque, madame la présidente et rapporteure de la commission des lois. Mais, dans ce cas, que le Gouvernement et la majorité que vous représentez s'engagent à inscrire dans la loi – pas dans la Constitution, certes – que les nominations administratives respectent la parité ! Il n'y a pas de raison que seules ces nominations ne soient pas paritaires alors que la parité, et heureusement, s'impose progressivement partout.
Je veux bien entendre que cette exigence ne peut pas figurer dans la Constitution mais j'aimerais vous entendre dire que la majorité prend l'engagement, avant la fin de cette législature, de faire en sorte que toutes les nominations administratives deviennent paritaires. C'est alors qu'on pourra croire à cette évolution.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 103 |
| Nombre de suffrages exprimés | 99 |
| Majorité absolue | 50 |
| Pour l'adoption | 33 |
| contre | 66 |
L'amendement no 1296 n'est pas adopté.

La parole est à M. Sébastien Jumel, pour soutenir l'amendement no 2238 .

Il s'agit toujours des mêmes nominations, dont on peut regretter qu'elles ne soient pas suffisamment objectives et paritaires. Cet amendement interdit de nommer à des fonctions d'intérêt général des personnes ayant exercé dans les trois années qui précèdent une activité qui y soit liée dans le secteur privé.
Il est indispensable de définir un cadre plus général, plus efficace et plus transparent pour prévenir les conflits d'intérêts. Cet amendement s'inspire des règles en vigueur pour les membres de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet. Lors de l'examen du projet de loi pour la confiance dans la vie politique, une disposition similaire avait été adoptée grâce à la sagesse des sénateurs, avant malheureusement de disparaître au cours de la navette.
Puisque vous avez refusé de conférer à cette mesure un rang législatif dans la loi pour la confiance dans la vie politique, nous vous proposons de la placer au rang constitutionnel.

Lorsque nous avions refusé d'inscrire cette disposition dans la loi pour la confiance dans la vie politique, ce n'était pas parce que celle-ci était de rang constitutionnel, mais parce que nous pensions que ce n'est pas une bonne mesure. Nous n'avons pas changé d'avis, et elle n'est pas non plus de rang constitutionnel. Avis défavorable.
Les incompatibilités que vous visez, lorsqu'elles existent, sont prévues par la loi organique ou la loi ordinaire. Il ne semble pas utile de les hisser au rang constitutionnel.

Évidemment, cette mesure n'est pas de rang constitutionnel. Mais vous ne pouvez pas en examinant une loi simple dire qu'elle est de rang constitutionnel et en examinant une loi constitutionnelle dire qu'elle n'en relève pas.
Ce sujet est central pour garantir une démocratie honnête et régulée. Combien d'anciens militaires se retrouvent dans l'industrie de l'armement alors qu'ils ont participé à la définition des besoins de l'État ?

Combien de membres de cabinets ministériels ou de directeurs d'administration centrale dans le domaine de la santé se retrouvent dans des entreprises du même secteur ? Combien de fonctionnaires du Trésor sont embauchés dans des banques ?
On passe son temps, et c'est bien, à surveiller les élus, avec des déclarations, des déontologues, des contrôles de l'honnêteté des prises de position de chacun. Et nous nous refuserions à interdire réellement, dans la loi, à des fonctionnaires qui ont pris des décisions au bénéfice – au très grand bénéfice – des industries, qui ont permis de déverser des milliards sur elles, d'être embauchés par elles ?
S'il y a bien une chose suspecte dans la République française, ce ne sont pas les élus locaux ou les parlementaires, c'est une part de ce qu'on appelle le pantouflage, qui est souvent le résultat d'un trafic d'influence.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes UDI-Agir, LR, NG, GDR et FI.
Monsieur Lagarde, avec tout le respect que je vous dois, il me semble que c'est l'inverse. Si j'ai bien compris, l'amendement concerne les incompatibilités qui s'appliqueraient à une personne issue du secteur privé qui souhaiterait exercer une fonction visée par l'article 13. Vous parlez, vous, des personnes qui exerceraient ce type de fonction et qui ensuite la quitteraient. C'est donc exactement l'inverse, il ne faut pas tout mélanger.
Or dans ce cas, la commission de déontologie intervient. C'est son rôle de vérifier cela.
Quant à l'exigence de parité que vous évoquiez, sous l'actuel gouvernement, la stricte parité entre les hommes et les femmes est garantie pour les nominations des ambassadeurs. Il en va de même pour les recteurs. Ainsi la pratique rejoindra vos objectifs.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM.

Si l'objectif est de rétablir le lien de confiance entre les citoyens et nous, les deux situations sont problématiques : le fait d'avoir exercé des responsabilités publiques et de mettre à profit cette compétence dans le secteur privé, et le fait – c'est l'objet de l'amendement – d'avoir exercé dans le privé des fonctions qui peuvent nourrir un conflit d'intérêts avec la fonction publique convoitée.
Je vous rappelle, par exemple, l'émoi qu'avait suscité la nomination en tant que gouverneur de la Banque de France de François Villeroy de Galhau, énarque, directeur général délégué de BNP Paribas. Nos concitoyens n'en veulent plus ! Vous ne pouvez pas imposer aux élus, et à juste titre – j'avais dit lors des débats sur la loi pour la confiance dans la vie politique que cela ne mange pas de pain lorsqu'on n'a rien à se reprocher – des règles légitimes de comportement et d'éthique et ne pas imposer les mêmes à des hauts fonctionnaires qui sont nommés par une seule personne. Ce n'est pas acceptable. Il faut entrer des deux pieds dans le nouveau monde, en appliquant les règles d'éthique aux hauts fonctionnaires.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 104 |
| Nombre de suffrages exprimés | 102 |
| Majorité absolue | 52 |
| Pour l'adoption | 30 |
| contre | 72 |
L'amendement no 2238 n'est pas adopté.

La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour soutenir l'amendement no 1426 .

Cet amendement touche au coeur de la rénovation de notre système politique. Jean-Jacques Rousseau écrivait dans Le contrat social : « Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques ». Plusieurs de nos amendements défendent l'idée que nous devons absolument inscrire dans la Constitution la probité, l'intégrité, la transparence et la déontologie.
L'importance de la fonction de Président de la République exige que les conseillers de ce dernier soient nommés dans le respect des principes de transparence et de déontologie.

Nous souhaitons que le pluralisme puisse être l'un des éléments du contrôle parlementaire ou citoyen.
Le Président de la République affirmait devant le Congrès le 3 juillet 2017 qu'il ne peut y avoir de confiance si le milieu politique continue d'apparaître comme le monde des petits arrangements. C'est pourquoi il me semble que les principes de transparence et de déontologie doivent être inscrits à un endroit ou à un autre de la Constitution, parce qu'ils sont constitutifs de la République que nous voulons.

Madame Untermaier, nous partageons vos préoccupations liées à la déontologie de la fonction publique – la commission des lois a d'ailleurs mené sur cette question une mission d'information qui a rendu ses conclusions récemment. Pour autant, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la Constitution. Avis donc défavorable
Avis défavorable également. Depuis quelques années, notre République s'est dotée de dispositifs pour renforcer les exigences de transparence, de probité et d'intégrité pour les responsables publics, notamment en matière prévention des conflits d'intérêts. C'était le cas dans la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique et dans la loi pour la confiance dans la vie politique de 2018. Le Gouvernement est décidé à poursuivre tous ces efforts. Pour autant, comme vient de le dire Mme la rapporteure, il nous semble qu'élever ces dispositions au rang constitutionnel ne répond pas vraiment aux exigences. La norme constitutionnelle n'a pas à être surchargée de dispositifs qui peuvent concerner les membres des cabinets ministériels ou les conseillers du Président.

C'est assez étonnant. Lors des débats sur la loi pour la confiance dans la vie politique, certains d'entre nous défendions des amendements visant à appliquer certaines règles aux membres des cabinets ministériels, et par voie de conséquence, aux conseillers du premier concerné, à savoir le Président de la République.
Nous en revenons toujours au même problème : l'exigence de transparence vaut pour les élus mais pas pour la présidence de la République ! C'est un sujet majeur.

Une nouvelle fois, vous nous dites que la transparence s'applique aux élus que nous sommes mais pas au Président de la République et à ses conseillers. C'est tout de même incroyable ! C'est au premier d'entre nous qu'elle devrait s'appliquer.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR.
Vous dites n'importe quoi !

Contrairement à Mme la ministre, et malgré tout le respect que je lui porte, je considère que les principes de transparence et de déontologie doivent être inscrits dans la Constitution précisément parce qu'il s'agit de gouvernance et de souveraineté. La souveraineté ne peut pas se concevoir désormais sans déontologie et sans transparence.
En outre, ce que fait la loi, une autre loi peut le défaire. C'est pourquoi les principes que nous jugeons fondateurs doivent être hissés au rang constitutionnel. Les citoyens attendent de notre part comme de celle de l'administration, des cabinets et de l'ensemble de la puissance publique des comportements respectueux de la déontologie et de la transparence. C'est ainsi qu'ils pourront retrouver confiance dans les gouvernants.
Je vous entends bien, madame Untermaier, même si je ne partage pas votre avis quant au niveau de norme qui doit être visé.
En revanche, je suis en désaccord avec vous, monsieur Hetzel, lorsque vous dites que nous renvoyons toujours à des textes ultérieurs. Vous n'ignorez pourtant rien de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, que vous avez votée. Son article 11 précise que les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République adressent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cela n'est-il pas assez clair pour vous ?
Nous parlons bien de la transparence, des conflits d'intérêts et des dispositions qui concernent les conseillers du Président de la République en la matière ! Ceux-ci doivent adresser une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale à la Haute autorité. Que faut-il donc qu'ils fassent d'autre ?
Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.

Madame la ministre, les règles de transparence en matière patrimoniale concernent en effet tout le monde, parlementaires et non-parlementaires, y compris les très hauts fonctionnaires. Cependant, Patrick Hetzel parlait des règles de nomination.

Vous avez fait voter à cette assemblée une loi pour la confiance dans la vie politique. Vous devez faire en sorte que la haute sphère publique obéisse aux mêmes règles que les élus.

Le fait de lever tout doute sur chaque nomination serait plutôt un gage de confiance pour un gouvernement ! On sait très bien qu'il y a eu, ces dernières années, de nombreuses suspicions concernant la nomination de tel ou tel très haut fonctionnaire.

Fixons donc les mêmes exigences pour les très hauts fonctionnaires que pour les parlementaires. À partir de là, les conditions de la confiance seront réunies.
L'amendement no 1426 n'est pas adopté.


Il vise à abroger l'article 16 de la Constitution. Cela s'inscrit toujours dans le fameux débat que nous avons depuis tout à l'heure sur l'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
En temps de crise, le pouvoir exécutif dispose de moyens considérables pour maintenir le fonctionnement des pouvoirs publics et défendre le territoire national. Nous pensons, bien sûr, au dispositif de l'état d'urgence, que le Gouvernement peut mettre en oeuvre sans délai.
Il nous paraîtrait beaucoup plus sain que les prérogatives du Parlement soient sauvegardées, en particulier celle du vote de la loi. Il nous semble que le Parlement serait capable de voter une loi sans délai et de prendre les bonnes décisions pour surmonter un état de crise. Cela éviterait de donner au Président de la République la possibilité de mettre en place un régime de concentration des pouvoirs.
Nous demandons donc la suppression de l'article 16 de la Constitution, d'autant plus qu'il nous paraît superfétatoire, notamment parce que la loi a considérablement évolué pour permettre la sortie de l'état d'urgence.

La parole est à M. Sébastien Jumel, pour soutenir l'amendement no 2248 .

Il existe, comme vous le savez, plusieurs dispositifs juridiques conférant au Président de la République des pouvoirs exorbitants : l'état de siège prévu par l'article 36 de la Constitution, le régime législatif de l'état d'urgence, l'état de guerre prévu sommairement par le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, et ce fameux article 16 de la Constitution. On peut considérer que ce dernier est la traduction de ce qui existait sous la République romaine : le dictateur pouvait se voir confier des pouvoirs pleins et entiers par les Consuls, sur demande du Sénat.
Ces pouvoirs nous semblent dangereux pour la démocratie, d'autant que la décision de recourir à l'article 16 et les actes législatifs pris par le Président pendant sa mise en oeuvre ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle juridictionnel. Dans son arrêt Rubin de Servens de mars 1962, le Conseil d'État a en effet estimé que la décision présidentielle de mettre en oeuvre l'article 16 était un acte de gouvernement, de ce fait insusceptible de recours juridictionnel.
Certes, il n'a été fait usage de l'article 16 qu'une seule fois. Nous pensons néanmoins que, à l'occasion de la présente révision, dont le président de Rugy lui-même a dit qu'elle n'était pas majeure,
Sourires

nous pouvons procéder à un toilettage et supprimer cet article caduc, non majeur et obsolète, afin de nous préserver de toute dérive autoritaire.

Pour un point que vous considérez comme « non majeur », vous y consacrez beaucoup de temps, monsieur Jumel !
Sourires.

Comme vous le savez, il a été conçu pour servir dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, qui n'ont existé qu'une fois dans l'histoire de notre République, mais nul ne peut prétendre dans cet hémicycle qu'elles ne se reproduiront jamais. Il nous semble donc qu'il convient de garder cette disposition, qui a été, de plus, fortement encadrée lors de la révision constitutionnelle de 2008, qui a ajouté un alinéa complet à la fin de l'article. Cet encadrement permet un certain contrôle par le Parlement.
Il ne faut pas aller plus loin : ce n'est pas parce qu'une disposition n'est que très faiblement utilisée, voire qu'elle ne l'est pas, qu'elle est inutile. Ainsi, nous avons discuté en commission dans le cadre de la présente révision constitutionnelle de la seconde délibération des lois. Celle-ci n'est que peu utilisée, mais elle l'est parfois et se révèle alors utile.
Donc, conservons l'article 16, tout en souhaitant qu'il ne soit jamais nécessaire d'y recourir.
Avis défavorable également. Comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, l'article 16 permet de prendre un certain nombre de mesures en cas de circonstances très exceptionnelles, lorsque l'État est mis en péril par une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Son utilisation, très encadrée, l'a été davantage encore par le constituant de 2008. Je pense qu'il n'est pas inutile de garder cet article dans l'arsenal constitutionnel.

L'histoire est tragique, mes chers collègues ! Et c'est évidemment parce qu'elle l'est que le constituant de 1958, pensant aux événements de 1940, a imaginé l'article 16, qui s'est d'ailleurs appliqué une fois.
Si vous établissez un parallèle avec l'état d'urgence, il y a une différence : l'article 16 vise l'hypothèse où les pouvoirs publics eux-mêmes ne fonctionnent pas. Vous dites, madame la garde des sceaux, qu'il n'est pas inutile de garder l'article 16, mais pardon : c'est indispensable !

Nous pouvons être confrontés à des difficultés plus considérables encore que celles que nous avons connues il y a quelques années, celles-ci pouvant d'ailleurs se répéter. À l'évidence, nous voterons donc très résolument contre ces amendements.

Si vous me permettez de faire un peu d'humour, il est assez drôle que cet amendement provienne de nos collègues socialistes. En effet, la suppression de l'article 16 figurait dans le programme d'union de la gauche en 1981.
Sourires.

Ayant été au pouvoir pendant un certain temps, mes chers collègues, il est étrange que vous ne l'ayez jamais supprimé !

Venons-en au fond. L'article 16 tel qu'il est rédigé actuellement n'est plus celui du texte initial de la Constitution de 1958. Je vous rappelle la grande critique que l'on formulait à propos de cet article : la décision d'y recourir était un acte de gouvernement, insusceptible de contrôle. Or nous avons ajouté à l'article 16 son dernier alinéa, qui prévoit que, au bout de trente jours, il suffit de soixante députés ou soixante sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel, qui peut annuler l'acte par lequel le Président a mis en oeuvre le régime prévu par l'article. Donc, l'article 16 est désormais encadré.
Il a été utilisé une fois lors d'une tentative de coup d'État : espérons que cela ne se reproduise pas. Toutefois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce qui est formidable, dans notre pays, c'est que surviennent des choses qu'aucun d'entre nous n'avait jamais envisagées.

Premièrement, l'article 16 n'est, au bout du compte, pas encadré de manière stricte.

La jurisprudence est claire : la décision d'y recourir est insusceptible de recours. Quant au Conseil constitutionnel, il émet un simple avis.
Deuxièmement, un constat devrait nous inspirer, monsieur de Courson : aucune démocratie moderne ne dispose d'un article semblable, permettant de concentrer l'ensemble des pouvoirs dans les mains d'un seul homme.
Troisièmement, pour notre part, nous ne sommes par des théoriciens de la peur, nous ne nous en nourrissons pas. Nous pensons qu'une démocratie moderne, sûre d'elle-même, peut, y compris dans une période de crise profonde, additionner l'intelligence de ses pouvoirs au service de la défense de l'intérêt suprême. Dès lors, nous pensons que la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme est un danger pour la démocratie.
Cela fait trois raisons de voter ces amendements.

Je me fais ici l'écho d'une préoccupation de Jean-Luc Warsmann. Il semblerait que, en 1958, une erreur de typographie, pour ne pas dire une faute d'orthographe ou de grammaire, se soit glissée à l'article 16 : il manque un « e » au mot « menacés ». Nous proposons donc de le rajouter.
Rires.
Sourires.
Pour ma part, j'ai un avis défavorable. D'une part, il convient de garder le texte dans son intégrité.
D'autre part, les éditeurs corrigent d'eux-mêmes l'erreur lorsqu'ils publient la Constitution. C'est notamment le cas dans le petit fascicule que j'ai entre les mains.
Bref, je crois que ce n'est pas indispensable.

Comment avoir un avis ? S'il y a une faute d'orthographe, faut-il la corriger pour l'amour de l'orthographe ou bien la conserver pour l'amour de la Constitution telle qu'elle a été rédigée en 1958 ? Je vous laisse juges, mes chers collègues !
Sourires et exclamations sur divers bancs.

Je ne voudrais pas empiéter sur le domaine de compétence de l'Académie française. Toutefois, il me semble que le texte d'origine a été amendé près de vingt-cinq fois. Donc, si nous reconnaissons qu'il y a une faute d'orthographe ou de grammaire dans la Constitution, par pitié, corrigeons-la !
Ce dernier argument m'a convaincue définitivement. Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

Je me réjouis que vous ayez changé d'avis, madame la garde des sceaux. Pour le reste, si vous aimez tellement le texte de la Constitution dans sa pureté originelle, renoncez tout simplement à cette réforme constitutionnelle ! Nombreux d'entre nous en seront très heureux, en tout cas de ce côté-ci de l'hémicycle.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR.
L'amendement no 1924 est adopté.
Applaudissements sur divers bancs.

La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l'amendement no 2239 .

Face aux certitudes du Gouvernement et aux explications particulièrement précises de la rapporteure, nous proposons un amendement de repli.
L'article 16 de la Constitution, qui autorise le chef de l'État à s'octroyer de larges pouvoirs en période de crise grave et notamment à prendre des mesures appartenant au domaine législatif, nous paraît extrêmement dangereux. Plusieurs intervenants l'ont répété. À défaut de le supprimer, nous proposons, avec cet amendement de repli, de renforcer les mécanismes de contrôle lorsqu'il est mis en oeuvre.
Nous proposons que le Conseil constitutionnel puisse être saisi à tout moment – et non après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels – par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, quarante députés ou quarante sénateurs, ou un groupe parlementaire, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa sont réunies.
Nous proposons ensuite que l'avis du Conseil constitutionnel intervienne de plein droit et qu'il soit rendu dans les délais les plus brefs.
Nous proposons enfin qu'une fois l'avis rendu public, le Parlement puisse se prononcer sur l'opportunité du recours à l'article 16 après un débat en séance publique.
Le comité Vedel avait proposé en son temps que le Conseil constitutionnel saisi par les présidents des assemblées puisse constater que les conditions ne sont plus réunies et préciser la date à laquelle les pouvoirs exceptionnels cessent de produire leurs effets. Pourquoi ne pas reconnaître ce droit au Parlement lui-même ?

Il a la légitimité nécessaire pour l'exercer : ses membres sont les représentants du peuple, et il s'agit de se prononcer sur l'application de mesures législatives, conformément au principe de séparation des pouvoirs. Encore faudrait-il, madame la ministre, que vous soyez réellement attachée à ce principe.

Puisque l'article 16 a été réformé lors de la révision constitutionnelle de 2008, et qu'il n'a pas été utilisé depuis, je souhaite qu'on s'en tienne à cette réforme sans modifier un article qui n'a jamais été utilisé dans sa rédaction actuelle.

Dès lors que l'article 16 a été modifié par le Parlement, avec toute la sagesse dont il a fait preuve à cette époque, et que cette réforme n'a pas apporté la preuve de son inefficacité, je ne vois aucune raison d'y toucher. Avis défavorable.
Dans l'instant, j'émets un avis défavorable, mais vous constaterez, monsieur Chassaigne, que vos voeux seront exaucés dans quelque temps. Dans le projet que nous vous avons transmis et que vous avez lu, nous prévoyons à l'article 11 de modifier l'article 16 de la Constitution afin de remplacer les mots : « soixante députés ou soixante sénateurs » par les mots : « quarante députés ou quarante sénateurs ». Nous reviendrons par conséquent à votre proposition, mais un peu plus tard.
Oui, mais je parle bien de l'article 16 de la Constitution et de la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel.
C'est un scandale, qui répond toutefois aux exigences de M. Chassaigne et sur lequel nous reviendrons.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.

Je soutiens vigoureusement l'amendement de M. Chassaigne. Puisqu'il s'agit d'un symbole, point n'est besoin d'attendre, car il faut parfois envoyer des signaux forts. Je profite de l'occasion pour rappeler que nous devons tous nous mobiliser pour que le projet de loi constitutionnelle ne soit pas adopté. On nous propose un changement total de France que nous ne pouvons pas accepter.

Il est possible de faire tourner ce qu'il y a de plus beau en vinaigre. Je viens d'apprendre que tout le monde est déçu aux Champs-Élysées. Les gens croyaient voir les joueurs, mais M. Macron les a accaparés à l'Élysée. Résultat : ils sont déçus, le peuple de France est déçu, moins de dix heures après que l'on a dansé tous ensemble.

On est obligé de se prendre en main. Je tenais à le dire solennellement dans notre hémicycle. Le peuple français, le petit peuple, n'a pas le droit de voir l'équipe qui vient de triompher en son nom devant la planète tout entière. Sans doute est-il jugé trop petit !
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes FI, GDR, NG et LR.

Je comprends très bien le souci de M. Chassaigne. Au sein du comité Balladur, quand nous avions étudié la réforme de l'article 16, nous avions jugé qu'il fallait absolument encadrer la question de la durée. Lorsque le général de Gaulle a recouru à cet article, nul n'a considéré qu'il le faisait de manière anormale. Reste que ce recours était pratiquement indéfini et que l'on ignorait quand il prendrait fin.
Nous l'avons par conséquent encadré d'une façon satisfaisante en soumettant notre proposition au Conseil constitutionnel. M. Chassaigne souhaite aller beaucoup plus loin, mais je me demande si sa proposition ne sort pas complètement des limites du bon sens
Exclamations sur les bancs des groupes FI et GDR

compte tenu des conditions dans lesquelles l'article 16 peut être utilisé. C'est en effet le cas lorsque la situation est impossible et que les pouvoirs publics ne peuvent plus fonctionner normalement. Dès lors, il n'est pas possible de prévoir les procédures de toute sorte, comme si la situation était normale.
J'y insiste : le recours à l'article 16 n'étant utilisé que dans une situation exceptionnelle, où tous les pouvoirs publics se sont retirés, on ne peut pas multiplier les procédures ou les encadrements visant à soumettre le pouvoir du Président de la République au Parlement. C'est pourquoi je trouve que vous allez trop loin, monsieur Chassaigne, si légitime que soit votre préoccupation.
Applaudissements sur les bancs des groupes MODEM et LaREM., ainsi que sur plusieurs bancs du groupe LR.
L'amendement no 2239 n'est pas adopté.

L'amendement que je vais défendre est encore un amendement de repli par rapport au précédent. Il tend en effet à autoriser un groupe parlementaire à saisir le Conseil constitutionnel sur la prolongation des pouvoirs exceptionnels.
Dans un contexte marqué par le désir de réduire globalement le nombre de parlementaires, nous devons veiller à diminuer également le nombre minimal de députés ou de sénateurs habilités à saisir le Conseil constitutionnel.
L'amendement ne vise à rien d'autre qu'à offrir à un groupe parlementaire la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel sur la prolongation des pouvoirs exceptionnels.

Dans ce cas, ne conservons que six sénateurs et six députés. Ce sera largement suffisant !

Mais si ! Mon absence d'avis sur l'amendement no 1924 était exceptionnelle. Avouez qu'il était difficile de prendre position !
L'amendement no 753 , quant à lui, aurait pour effet de neutraliser le droit de saisine que le texte réserve à un certain nombre de parlementaires.
En effet, le nombre minimal requis de parlementaires pour constituer un groupe n'est pas le même à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il est fixé par le règlement intérieur de chaque assemblée, ce qui le rend extrêmement variable. Retenir le groupe parlementaire comme autorité de saisine du Conseil constitutionnel n'est donc pas une bonne solution. Mieux vaut s'en tenir au nombre minimal de parlementaires défini dans la Constitution, la saisine de chaque chambre restant indépendante.
Comme vient de le dire la rapporteure, il me semble difficile de faire dépendre une règle constitutionnelle importante du règlement intérieur d'une assemblée. Pour cette raison, j'émets un avis défavorable.

Combien de temps mettra-t-on pour réduire le nombre de députés à zéro ?

Je désespérais. En voyant le président Chassaigne arriver dans l'hémicycle, je pensais que je n'allais plus pouvoir m'exprimer. En outre, j'étais jaloux, car je croyais que son amendement allait prospérer. C'est généralement ce qui se produit : le président du groupe arrive, son charme opère et l'amendement prospère. Pas cette fois !
Dès lors qu'on diminue le nombre global de parlementaires, on ne facilite pas la saisine en réduisant aussi le nombre minimal de parlementaires pouvant l'opérer. D'autre part, je confirme que, lorsque l'article 16 vient à s'appliquer, et que, pendant trente jours, le Président de la République ne respecte pas, voire qu'il viole une liberté fondamentale, aucun recours ne peut être fait devant le juge administratif. Vous le savez !
Il est donc important qu'un groupe – en l'occurrence, de l'opposition – puisse saisir le Conseil constitutionnel sur la prolongation des pouvoirs exceptionnels. Tel est le sens de cet amendement de repli, qui va un peu moins loin que celui que nous avons défendu.
Je rappelle que l'amendement no 753 tend à ce qu'en cas d'application de l'article 16, un groupe de l'opposition puisse saisir le juge constitutionnel.
Celui-ci est obligatoirement saisi !

Pour comprendre la question passionnante du contrôle et de l'encadrement de l'article 16, il faut lire en même temps l'article 68, que nous avons également modifié en 2008, et qui donne faculté au Parlement constitué en Haute Cour de destituer le Président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs essentiels.
Si par hypothèse un Président de la République enclenchait la procédure de l'article 16 hors de son champ, le Parlement aurait toujours cette faculté – tout aussi exceptionnelle que l'article 16 – d'engager une procédure de destitution.
Tout cela est très théorique, mais cela prouve que l'équilibre de la Constitution est bien défini.

Voilà qui prouve que les débats parlementaires peuvent être utiles ! Je retire l'amendement. L'argument de Mme la ministre me semble en effet pertinent. On ne peut pas faire reposer la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel sur le règlement de deux assemblées, dans lesquelles le nombre minimal de parlementaires requis pour constituer un groupe politique n'est pas identique : ce nombre est en effet de quinze députés mais vingt sénateurs.
En revanche, l'amendement no 436 de M. Fasquelle, qui sera appelé dans un instant, propose de réduire de soixante à quarante le nombre de parlementaires pouvant saisir le Conseil constitutionnel sur la prolongation des pouvoirs exceptionnels, compte tenu de la réduction annoncée du nombre de parlementaires tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Il faut supporter cela ? La France n'a plus les moyens de se payer des députés ?

Je retire donc mon amendement au bénéfice du suivant, qui me semble proposer une meilleure solution.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR.
L'amendement no 753 est retiré.

Je vais rebondir sur les propos de M. Hetzel.
La réforme des institutions se traduit par trois projets de loi – constitutionnelle, organique et ordinaire – qui conduiront à une diminution du nombre de parlementaires. Cette réduction du nombre d'élus ne s'accompagne pas d'une diminution corrélative du quorum de députés ou sénateurs pouvant saisir le Conseil constitutionnel sur l'article 16, qui encadre l'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République.
Jusqu'à présent, la saisine des Sages est prévue après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels par soixante députés ou sénateurs. Il est logique que la réduction du nombre de parlementaires entraîne une diminution du seuil prévu à l'article 16. L'amendement tend à ce qu'à l'avenir, la saisine puisse être effectuée par quarante députés ou sénateurs.

L'amendement sera satisfait par l'adoption de l'article 11 du projet de loi constitutionnelle, qui prévoit la diminution du seuil prévu à l'article 16.
Je relis l'article 11 du projet de loi constitutionnelle : « Au sixième alinéa de l'article 16, [... ] les mots : "soixante députés ou soixante sénateurs" sont remplacés par les mots : "quarante députés ou quarante sénateurs". Compte tenu de vos propositions, je pense que votre vote sur cet article sera acquis. C'est du moins ce que je souhaite.
Avis défavorable à l'amendement.

Monsieur Cinieri, maintenez-vous l'amendement, sachant qu'il est satisfait par ailleurs ?
L'amendement no 436 est retiré.

J'ai bien entendu les explications données avant la levée de la séance précédente par le président et rapporteur Ferrand, qui a malheureusement quitté l'hémicycle. Il affirmait que cette loi constitutionnelle allait renforcer les pouvoirs du Parlement. Mes chers collèges, je ne le crois pas…

… et je ne suis sans doute pas le seul dans cet hémicycle.
L'amendement no 369 ne vise pas forcément à restreindre les pouvoirs du Président de la République : il vise simplement à les actualiser, à les moderniser. Le droit de grâce est une réminiscence de ce que d'aucuns appellent l'ancien monde – il remonte en tout cas à l'Ancien régime, à l'époque où la France était dirigée par un monarque de droit divin.

Aujourd'hui, notre pays est une démocratie moderne. Notre justice prend ses décisions avec beaucoup de sagesse, après des mois voire des années d'instruction, après des débats contradictoires et avec des voies de recours qui vont de plus en plus loin – je pense à la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, comment peut-on penser qu'un homme seul dans son cabinet puisse revenir sur l'autorité de la chose jugée ? Je ne le conçois pas. C'est la raison pour laquelle je propose l'abrogation de l'article 17 de la Constitution.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l'amendement no 480 .

Dans nos institutions – je ne parle pas ici de l'histoire de France – , le droit de grâce était en réalité le pendant de la peine de mort : il donnait au Président de la République la possibilité d'éviter l'exécution d'un homme par les institutions de notre pays lorsque subsistait, malgré le jugement d'un jury de cour d'assises, un doute qu'il estimait raisonnable. Cependant, depuis que la peine de mort a été heureusement abolie dans notre pays, ce droit a souvent été exercé par des présidents de la République fraîchement élus pour effacer des amendes ou pour intervenir dans le cours judiciaire d'une affaire.
Ce qui était historiquement un droit seigneurial – le seigneur avait le droit de grâce sur ses terres – est devenu un droit monarchique, qui a finalement été transféré à la République française. Au moment du passage de la monarchie à la République, de nombreuses pratiques ont été supprimées, mais pas celle-là. Cela signifie, mes chers collègues, que le Président de la République, parce qu'il a été élu par nos concitoyens – il serait abusif de parler de « l'onction » du suffrage universel – , aurait le droit d'outrepasser toutes les décisions de la justice française et d'accorder la grâce.
Je suis favorable à ce que l'Assemblée nationale puisse voter des lois d'amnistie, lesquelles sont générales, globales – elles visent à effacer des amendes ou d'autres condamnations. Mais qu'un individu, fût-il Président de la République, fût-il élu par la majorité de nos concitoyens, ait le droit d'aller à l'encontre des décisions des juges ou des jurés dans tel ou tel dossier et d'exercer le droit de grâce comme au temps des seigneurs ou des rois, c'est l'illustration même que nous demeurons, hélas, dans une vision monarchique de la fonction présidentielle.
Si nous supprimions cette pratique, de même que nous avons supprimé le mot « race » de la Constitution il y a quelques jours, nous supprimerions une part de cet imaginaire populaire qui veut que le Président de la République est un roi, même s'il est élu et si l'on peut lui couper la tête tous les cinq ans. Non, le Président de la République n'est pas un roi : il ne peut pas remplacer l'ensemble des autres pouvoirs. Il existe un pouvoir exécutif – c'est lui – ,…

… un pouvoir législatif – c'est censé être nous – et une autorité judiciaire, qui serait bien malmenée si nous maintenions ce droit de grâce.

La parole est à M. Michel Castellani, pour soutenir l'amendement no 574 .

Cet amendement va tout à fait dans le même sens que le précédent. Comme cela a été dit, le droit de grâce est un vestige des lettres de rémission existant sous l'Ancien régime. Il pouvait se comprendre lorsque la peine de mort était encore appliquée en France, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Président de la République n'a pas ou peu de légitimité pour interférer dans des décisions de justice. En tout cas, il est difficile de contester le fait que cette pratique constitue un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire.

J'ajouterai quelques éléments à ceux qui viennent d'être exposés.
Tout d'abord, la séparation des pouvoirs me paraît assez nécessaire : je ne vois donc pas pourquoi le Président de la République aurait le droit de grâce.
On peut également se demander pourquoi, pour des faits similaires, certains individus seraient graciés et d'autres non, …

… selon qu'ils aient été ou non aidés par la presse. Il y a donc une inégalité de traitement entre des personnes ayant commis les mêmes forfaits.

Évidemment, cela pose un problème. D'ailleurs, dans notre histoire relativement récente, un certain nombre de grâces ont posé problème. Ainsi, François Mitterrand a gracié Paul Touvier, l'ancien patron de la milice lyonnaise ayant sévi sous l'Occupation. Un autre président a accordé sa grâce à l'ancien préfet du Var, Jean-Charles Marchiani, condamné pour trafic d'influence dans une affaire de commissions occultes. Certaines grâces sont donc un peu curieuses… Maintenant que le Président ne guérit plus les écrouelles, nous nous honorerions à supprimer cette grâce présidentielle.
Enfin, notre excellent collègue Alain Tourret a permis, dans une loi adoptée en 2014, que les procès soient révisés plus facilement. Ainsi, notre arsenal juridique actuel suffit pour que nous n'ayons plus besoin de cette grâce présidentielle.

Sur les amendements identiques nos 369 , 480 , 574 , 694 , 1573 et 2310 , je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Philippe Vigier, pour soutenir l'amendement no 1573 .

Nous sommes à un moment important de notre débat de ce soir. Jean-Christophe Lagarde a bien fait de rappeler tout à l'heure que, dès lors que la peine de mort a été abolie, le droit de grâce, dont l'existence pouvait jusqu'alors trouver quelque justification, perd toute raison d'être.
Permettez-moi d'ajouter un deuxième argument. Nous invoquons toujours et partout le fameux principe de séparation des pouvoirs. Comment se fait-il que le Président de la République ne respecterait pas ce principe…

… et pourrait, selon sa convenance, outrepasser une décision de justice ? En bafouant une décision de justice, le Président de la République piétine la séparation des pouvoirs, qui est pourtant essentielle dans notre État de droit.

Tout à l'heure, Paul Molac a soulevé l'argument de l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi et devant la justice : il a pris l'exemple d'un individu ayant commis un délit lui ayant valu une lourde)) sanction alors qu'un autre individu, initialement condamné à la même peine, aurait bénéficié du droit de grâce. Madame la garde des sceaux, vous êtes extrêmement attentive à l'équité du traitement judiciaire. Comment pouvez-vous justifier le fait que le droit de grâce aboutisse à une telle situation ?

Par ailleurs, je le répète, la peine de mort n'est plus appliquée en France.
Enfin, mes chers collègues, tous les médias ont récemment évoqué le cas d'une femme qui avait tué son mari et qui a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle.

Rappelez-vous le brouhaha médiatique extraordinaire que nous avons connu lors des semaines précédant la décision présidentielle ! Sachant que la justice doit toujours être prononcée dans un climat serein, pensez-vous, madame la garde des sceaux, que cette pression médiatique exercée sur un seul homme ou une seule femme, fût-il élu à la fonction suprême, soit acceptable en 2018 dans une grande nation démocratique ? Nous ne le pensons pas.

La parole est à M. Sébastien Jumel, pour soutenir l'amendement no 2310 .

Répéter, c'est parfois enseigner. Je reprends donc à mon compte les arguments développés par nos collègues.
Je souligne d'abord que la grâce présidentielle a perdu de son caractère opérant avec l'abolition de la peine de mort – plusieurs d'entre nous l'ont dit.
Par ailleurs, l'exercice du droit de grâce pose une difficulté dans la mesure où il dépend fortement de la manière dont les médias s'emparent ou non d'une affaire. C'est, en quelque sorte, une rupture d'égalité entre les affaires traitées.
Enfin, personne ne peut contester le fait que le droit de grâce porte atteinte à la séparation des pouvoirs. De surcroît, ce droit défie non seulement l'institution judiciaire, mais également le peuple lorsque la décision est rendue en cour d'assises.
Voilà ce qui doit nous conduire, me semble-t-il, à nous débarrasser d'une disposition relevant d'un monde très ancien.

La commission avait donné un avis défavorable à ces amendements visant à supprimer le droit de grâce.

Je vais vous expliquer pour quelle raison nous leur avions donné cet avis et pour quelle raison nous le maintenons ce soir.
Le droit de grâce est une prérogative de clémence dont dispose le Président de la République, sans discontinuer depuis le début du XIXe siècle. Comme vous le savez, la grâce n'annule pas une condamnation ; elle ne déjuge pas les tribunaux.

L'article 133-7 du code pénal dispose : « La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine ».

En ce sens, le droit de grâce est moins une remise en cause des décisions de justice qu'une manifestation de magnanimité de la société accordée par une seule personne, celle qui est désignée par le suffrage direct de tous les Français.

Nous ne donnons pas au Président de la République le pouvoir de rendre la justice !

Comme vous le savez, cette prérogative a été réduite en 2008, dans la mesure où elle a été limitée à des bénéficiaires individuels. Sa pratique est donc en forte régression. En 2014 et en 2017, aucune grâce présidentielle n'a été accordée. Aujourd'hui, on n'en compte que quelques unités chaque année.
En revanche, le droit de grâce existe dans tous les pays. Il est de la compétence du chef de l'État, puisque l'exécutif exécute aussi les décisions de justice.
Comme en commission, nous vous appelons à préserver cette faculté de souplesse qui appartient au Président de la République. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une atteinte à la séparation des pouvoirs car nous ne sommes pas du tout dans la même temporalité. Il existe des cas, mes chers collègues, où la grâce est utile et où elle n'est pas contestée.

Je crois me souvenir d'une grâce assez récente qu'un certain nombre d'entre vous aviez réclamée, il y a quelques années, au Président de la République.
Défavorable également.
Les critiques liées à l'héritage monarchique de ce droit n'apparaissent pas pleinement pertinentes : en effet, le droit de grâce a considérablement changé de nature depuis les débuts de la Ve République, pour trois raisons.
Tout d'abord, la révision constitutionnelle de 2008 a restreint l'étendue du droit de grâce en supprimant la possibilité, pour le chef de l'État, d'en faire un usage à titre collectif. Il ne s'agit donc plus d'accorder collectivement des remises de peine pour des motifs sans rapport avec la personnalité de la personne condamnée, comme ce fut le cas pour les grâces prononcées dans la foulée de l'élection du Président de la République. Aujourd'hui, cela n'est plus possible : le droit de grâce est uniquement individuel.
Deuxième raison : le droit de grâce a changé également de nature depuis l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, il ne s'agit plus pour le Président de la République de prendre la décision très difficile de la peine ultime, qui était dictée par sa conscience, mais plutôt de redresser des situations individuelles qui, en raison des rigueurs procédurales, ne peuvent pas l'être autrement que par le droit de grâce. L'usage de ce droit est ainsi devenu, comme l'a dit Mme la rapporteure, tout à fait exceptionnel, en raison notamment du développement des aménagements de peine que l'on observe maintenant et de leur juridictionnalisation.
Il n'en demeure pas moins que, dans certaines hypothèses, aucune solution juridique n'est envisageable. Ce peut être le cas lorsque, pour des raisons médicales, une personne ne peut pas se soumettre aux formalités exigées par la loi pour bénéficier des aménagements de peine.
Je vous en donnerai un exemple.
Troisième raison : je vous rappelle que le Président de la République peut, s'il le souhaite, …
… par l'intermédiaire du garde des sceaux, consulter toute autorité ou juridiction avant de décider d'octroyer une grâce. C'est d'ailleurs le cas actuellement, en pratique, car les autorités judiciaires sont systématiquement consultées pour l'octroi d'une grâce – il s'agit généralement de la consultation du procureur général du lieu de condamnation ou du lieu d'incarcération.
C'est du reste bien ce qui s'est passé pour la dernière grâce octroyée par le Président Macron en faveur d'une femme de 73 ans condamnée à perpétuité pour meurtre et détenue dans un hôpital psychiatrique : c'est sans doute ainsi, en effet, que cette personne a pu bénéficier, à titre humanitaire, d'une grâce partielle qui lui autorise aujourd'hui des sorties thérapeutiques encadrées. Seul le Président de la République pouvait prendre une telle mesure.

Il serait temps plutôt de développer les alternatives à l'incarcération !
Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable à l'ensemble des amendements.

Chers collègues, j'ai été saisi de nombreuses demandes d'intervention. Il ne devrait normalement y en avoir que deux. Puisqu'il s'agit d'amendements identiques, je vous demande qu'il n'y en ait qu'une seule par groupe.
La parole est à M. Michel Castellani.

L'article 34 de la Constitution prévoit un droit de même nature que le droit de grâce : le droit d'amnistie. Il serait certainement opportun d'avancer dans ce domaine en Corse et il y aurait là un progrès très sérieux dans la prise en considération de la situation politique en Corse. Après tant de tensions et de drames, en effet, la Corse connaît aujourd'hui, fort heureusement, la paix civile. Nous nous grandirions vraiment en tenant sérieusement compte de cette situation et en avançant dans ce domaine.

Chers collègues, j'ai déposé cet amendement lors de plusieurs réformes constitutionnelles. En effet, le maintien du droit de grâce est une insulte à la magistrature.
Madame la rapporteure, quand vous dites que ce n'est pas grave et que la grâce n'est qu'une dispense d'exécution de peines prononcées par les magistrats, …

… votre position est indéfendable. Il existe un juge d'application des peines : pourquoi le Président viendrait-il interférer dans la séparation des pouvoirs ? Maintenir le droit de grâce, c'est purement et simplement nier la séparation des pouvoirs.
Quant à vous, madame la garde des sceaux, vous ne pouvez pas dire qu'il faut maintenir le droit de grâce parce qu'il est en voie de dépérissement – car c'était bien là votre argumentaire, même si je le résume. Aujourd'hui, le Président de la République – quel qu'il soit, d'ailleurs – peut aller jusqu'à faire ce qu'a fait un jour le Président Mitterrand en annulant les contraventions de Harlem Désir, qui ne les payait pas, pour un montant de 10 000 euros. C'est tout de même là une drôle de République ! Ce n'est pas possible. Ayons donc un peu de courage.
En outre, supprimer le droit de grâce, c'est rendre service au Président de la République, à qui cela évitera de faire l'objet de grandes campagnes de presse visant à obtenir des aménagements de peine. C'est donc protéger le Président de la République que de lui retirer le droit de grâce et ce n'est pas l'aider que de le lui maintenir.
Si vous êtes tous de bons républicains – et nous ne sommes plus en monarchie – , supprimons le droit de grâce et tout le monde ne s'en portera que mieux.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UDI-Agir.

Madame la ministre, je fais totalement miens vos propos : je suis profondément attaché au droit de grâce dont dispose le Président de la République.

Les Français connaissent encore un peu l'histoire – du moins celle qui leur est enseignée – : ils savent que la peine de mort n'existe plus, mais le droit de grâce est un élément profondément inhérent à l'histoire de notre pays et auquel ils sont très attachés. Je suis donc totalement favorable au maintien de ce droit.
Deuxièmement, il nous faut en revanche, tous ensemble, mettre en garde le Président de la République contre, comment dirais-je, les bêtises que son jeune âge pourrait lui faire commettre. Par exemple, supprimer 220 députés, c'est très grave. Supprimer une centaine de sénateurs, c'est gravissime. Arrêtez de vous battre pour des boutons de braguette ! Allons à l'essentiel : l'essentiel, c'est la France !
Évitons donc au Président de faire des bêtises telles que celle qu'il a faite ce soir en empêchant l'équipe de Didier Deschamps de rencontrer longuement les centaines de milliers de Français qui l'attendaient – je les ai vus – , par une chaleur torride, sur les Champs-Élysées. Ça, c'est lui rendre service. Pour le reste, madame la ministre, je suis, comme vous, favorable au droit de grâce.

Madame la garde des sceaux, à quel point faut-il avoir peu confiance dans l'appareil judiciaire pour penser qu'on ait besoin d'un Président de la République qui joue, en dernier ressort, le rôle de juge d'application des peines pour corriger des décisions lacunaires de celui-ci ? Je pense que vous en avez tout de même une plus haute idée.
Or, le droit de grâce est anecdotique. Il s'applique à très peu de cas. Il est discrétionnaire : c'est le Président de la République qui décide seul, en totale violation de la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il est, enfin, inéquitable, puisqu'il s'applique à certains cas, et pas à d'autres, y compris dans des situations similaires.
Au lieu de protéger ces atours de la monarchie républicaine – dont on pourrait parfois penser qu'elle est de droit divin, tant elle permet à un seul homme de savoir mieux que les autres ce qui est bon pour certaines personnes – , on ferait mieux de réfléchir à un moyen de mieux aménager certaines peines lorsqu'au bout d'un certain temps, compte tenu de la situation des personnes, ces peines nous apparaissent comme cruelles ou disproportionnées. C'est là quelque chose à quoi nous pouvons travailler tous ensemble.

J'apporterai une petite contribution au débat : madame la ministre, l'exemple que vous avez pris était à la fois intrigant est intéressant. Il s'agissait d'une femme détenue, condamnée à perpétuité et placée en hôpital psychiatrique, et qui, compte tenu de son âge avancé, a fait l'objet d'une grâce partielle qui lui a permis de bénéficier de droits de visite.
Il s'agit de droits de sortie.

En tout cas, la grâce avait, de toute évidence, assoupli ses conditions de détention, vu son âge avancé.
Si donc il faut l'intervention de la grâce présidentielle pour obtenir ce résultat, cela interroge tout de même sur la manière dont on applique les peines dans notre pays, notamment pour les publics de ce type. En outre, votre exemple concentre plusieurs problèmes, notamment celui de la santé mentale en prison, question majeure sur laquelle on avance aujourd'hui plutôt à petit pas et à tâtons.
Oui, c'est un sujet majeur.

Plutôt que de valider la grâce présidentielle pour corriger ce que nous ne parvenons pas à faire valoir, emparons-nous du sujet et faisons que la loi et la justice soient plus justes ou, en tout cas, que celle-ci soit plus individualisée et plus adaptée aux parcours de peine et aux personnes condamnées. Voilà quelque chose qui me semblerait plus ambitieux que de trouver des arguments qui, en fonction d'un cas individuel, viennent plus ou moins conforter plus ou moins la grâce présidentielle. Je me sentirais plus utile en faisant cela qu'en validant une forme de passe-droit discrétionnaire – car la dame dont vous avez cité l'exemple n'est peut-être pas la seule dans cette situation.

Comme l'a dit mon collègue Charles de Courson, la suppression du droit de grâce protégerait le Président de la République. En effet, la grâce présidentielle devient finalement une grâce médiatique : il y a ceux qui auront la chance d'attirer l'attention des médias et ceux qui resteront inconnus, dont le cas, puisqu'il ne remontera pas jusqu'à l'opinion publique, ne mobilisera pas l'attention du chef de l'État. C'est un raisonnement assez curieux que celui selon lequel, parce qu'il pourrait y avoir des dysfonctionnements dans notre République, le seul garant qui puisse nous en protéger serait le chef de l'État. Vous rendez-vous compte de ce qui se produirait si nous appliquions ce raisonnement à l'ensemble du fonctionnement de nos institutions ?
Il peut arriver que la justice se trompe et il peut même y avoir des erreurs dans l'administration et l'exécution des peines, mais notre travail est précisément de créer les capacités de recours et de correction, et non pas de nous en remettre à une personne – et je ne vise pas un homme en particulier, le chef de l'État actuel, mais tous les chefs de l'État qui se sont succédé et qui se succéderont – , car telle est en effet la Constitution. Nous devrions nous dire que cet homme serait plus sage que l'ensemble des règles que nous aurons fixées et des jugements qui seront émis ?
C'est là défendre une vision totalement monarchique, quasi divine, de la fonction présidentielle, que je ne partage pas. Supprimer au Président de la République le droit de grâce, c'est le protéger de l'opinion publique et rendre notre République un peu plus démocratique.

Attention aux modes et à cette pente vers la modernité ! Le droit de grâce existe depuis très longtemps, comme vous l'avez parfaitement expliqué, madame la ministre.

Ce n'est pas parce qu'il existe depuis très longtemps que ce droit serait négatif. Je note du reste que toutes les Républiques, jusqu'à présent, ont conservé le droit de grâce, même si elles l'ont encadré, comme vous nous l'avez également parfaitement expliqué.
Il ne s'agit pas, avec ce droit, de remettre en cause un jugement ou une décision de justice, mais simplement d'appliquer à un cas particulier un principe de clémence, d'humanité.

La justice n'est pas parfaite. Elle peut se tromper, ne pas prendre en compte certaines situations très particulières.

C'est la raison pour laquelle nous disposons de cette petite latitude, offerte à celui qui est au sommet de l'État, pour lui permettre de gracier. Sachons la conserver pour des cas exceptionnels.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LR et LaREM.

Contrairement à ce qu'a dit notre collègue Le Fur – à moins que je ne me trompe, ce qui est toujours possible – , le droit de grâce a déjà été remis en cause dans son fonctionnement, voire supprimé à certaines époques de notre histoire. En 1792, par exemple, …

Quand je parle de 1792, ça fait crier le rapporteur, ça lui donne des boutons. Vous réagissez comme si je vous avais agressé en parlant de 1792.
Exclamations sur quelques bancs du groupe LaREM.

Les dates, c'est important, c'est intéressant, ça permet de comprendre.
Le droit de grâce, s'il a été maintenu à certains moments de notre histoire, a aussi été assuré collectivement, en considérant que ce n'était pas un homme seul, le Président de la République, qui pourrait accorder la grâce. Cela a notamment été le cas entre 1871 et 1875, où il existait une commission des grâces. L'approche était donc collective.

N'oublions pas non plus qu'entre 1946 et 1958 – je me tourne à ce propos vers Les Républicains – , c'était le Conseil supérieur de la magistrature qui était chargé d'accorder la grâce. Sur cette question, une réponse possible peut donc reposer sur une étude collégiale, un travail collectif.
En second lieu, ce droit de grâce remet fondamentalement en cause la souveraineté populaire, notamment quand il est assumé par le Président de la République. En effet, les citoyens qui constituent un jury d'assises sont détenteurs de la souveraineté populaire : de quel droit un Président de la République serait-il détenteur, seul, de cette souveraineté ?
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes GDR, NG et FI.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 89 |
| Nombre de suffrages exprimés | 86 |
| Majorité absolue | 44 |
| Pour l'adoption | 29 |
| contre | 57 |


Comme je me doutais que les royalistes l'emporteraient – peut-être pour la dernière fois ! – , j'ai déposé cet amendement de repli, afin que, au moins, le Président de la République ne puisse exercer le le droit de grâce que pour les crimes et non pour les délits et a fortiori pour les contraventions, …

… comme un président célèbre l'a fait, ainsi que je l'ai rappelé dans mon intervention précédente. J'espère, mes chers collègues, que vous aurez au moins la sagesse de limiter cela aux crimes !

Merci, monsieur le député ; cela avait également été utilisé pour un député.
La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l'amendement no 1796 .

Le présent amendement est identique à celui de notre collègue de Courson. Il a pour objet de n'appliquer le droit de grâce présidentiel qu'aux seuls crimes.
Défavorable : le droit de grâce est évidemment tout à fait indépendant de la nature de l'infraction.

Il s'agit d'un amendement de repli. Qu'au moins le droit de grâce ne soit réservé qu'aux seuls crimes ! Du reste, madame la garde des sceaux, je reprendrai très rapidement les deux arguments que vous avez utilisés. Le premier porte sur la pratique : très franchement, si l'on ne se fiait qu'à la pratique, on n'aurait plus besoin de Constitution parce que si la pratique vous paraît suffisante, la Constitution devient inutile. L'évolution de la pratique est positive mais n'est pas suffisante.
En 2008, nous avons d'ailleurs modifié la Constitution pour restreindre le droit de grâce présidentiel. En 2018, avec mon collègue de Courson, nous demandons qu'on le restreigne un peu plus en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et surtout en fonction de la gravité de la peine. Même si je ne crois pas que le Président de la République, quel qu'il soit, ait une sagesse immanente lui permettant, dans tous les cas de figure, de mieux savoir que notre justice ou que le Parlement, réservez au moins ce droit aux cas les plus graves si la sanction est tellement lourde qu'une injustice insupportable pourrait en découler. Voilà le sens de l'amendement que nous défendons avec mon collègue de Courson.

Madame la ministre, votre argument est très faible : si l'Assemblée vote contre notre amendement, ce serait une incitation aux présidents successifs d'utiliser le droit de grâce pour des délits ou des contraventions. C'est affreux ! Les trois derniers présidents s'étaient engagés, lors de leur campagne, à ne pas utiliser le droit de grâce pour effacer toutes les contraventions, comme cela avait été fait par plusieurs présidents démagogues, et de tous bords, d'ailleurs ! C'est donc un progrès, et si nous votons cet amendement, cela sera inscrit dans le texte constitutionnel : il ne sera plus possible d'utiliser le droit de grâce pour balayer toutes les contraventions. Certains avaient même utilisé cela comme argument électoral : « Votez pour moi, et les contredanses que vous n'avez pas payées sauteront ! » C'est affreux, mes chers collègues !

Votre argument, madame la ministre, ne tient pas ! J'en appelle donc à mes collègues de l'actuelle majorité : puisque vous voulez maintenir ce droit, encadrez-le au moins en le limitant aux crimes !
Je m'étonne que M. de Courson reprenne constamment des arguments qui n'ont pas à être depuis 2008 puisque, sauf si vous m'avez mal comprise – je m'adresse également à M. Lagarde, qui avait lui aussi avancé cet argument dans sa première prise de parole – , depuis 2008, il n'est plus possible d'accorder de grâce collective. Votre argumentation reposant sur des contraventions qui seraient balayées…
Je n'ai pas cet argument en mémoire ; je vous prie de m'en excuser. Je constate que depuis 2008, la Constitution interdit les grâces collectives : c'est tout ce que je voulais dire.
Par ailleurs, monsieur le député, une peine délictuelle, je vous le rappelle également, peut aller, en cas de récidive légale, jusqu'à vingt ans d'emprisonnement. Il ne me semble donc pas absurde, si l'on considère le droit de grâce comme un droit exceptionnel destiné à remédier à des situations inéquitables, qu'il puisse aussi, dans certains cas, s'appliquer à des peines délictuelles.
Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.

Ma proposition ne répond pas au dernier argument de Mme la garde des sceaux. Mais nous pourrions proposer un sous-amendement visant à supprimer le mot « seuls » car il y a en réalité, dans la rédaction proposée par M. de Courson, un procès d'intention à l'égard du Président de la République : le droit de grâce devrait être limité aux « seuls crimes » parce que le Président ferait des erreurs, ou bien abuserait de son pouvoir si celui-ci pouvait s'exercer aussi pour des contraventions ou autres. Évoquer simplement « les crimes » signifie que l'on vise les peines les plus lourdes, réprimant les faits les plus graves, sans porter de jugement de valeur ni faire de procès d'intention à l'égard des actes du Président de la République. Cela atteindrait l'objectif poursuivi par M. de Courson sans être désobligeant pour personne, et en particulier pour le chef de l'État.



Ce débat concernant le droit de grâce est passionnant. Pour ajouter une pierre à l'édifice, si l'on ne touche pas au droit de grâce en tant que tel, il s'agit de revenir, avec cet amendement, sur ce que le comité Balladur qualifiait, en 2007, d'« anomalie » dans notre Constitution. En effet, le droit de grâce non encadré du chef de l'État constitue un vestige d'époques très éloignées. Un contreseing ministériel est certes nécessaire pour un tel acte de justice mais la solidarité politique liant habituellement le Gouvernement au chef de l'État a pour conséquence d'en neutraliser les effets.
Du reste, un premier pas a été effectué en 2008, le constituant ayant précisé que ce droit de grâce s'opérait désormais à titre individuel. Il paraît toutefois nécessaire d'aller plus loin en conditionnant la grâce à un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je sais, puisque cela m'a été objecté en commission, que son avis est consultatif, si bien que le chef de l'État conserve une certaine marge de manoeuvre, mais la publicité qui y est attachée empêchera toute dérive. Par coordination, et pour répondre au reproche qui m'avait été fait, il conviendrait alors de compléter la loi organique en ce qui concerne l'application de l'article 65 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de la magistrature.

La parole est à M. Sébastien Jumel, pour soutenir l'amendement no 2311 .

Nous actons le fait que nous ne soyons pas parvenus à supprimer le droit de grâce dans la Constitution mais, avec cet amendement de repli, nous proposons de rendre obligatoire la consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Cette proposition est issue du rapport Balladur.
Par ailleurs, lors de notre débat en commission, notre collègue Larrivé a indiqué que, dans ses mémoires, le président Giscard d'Estaing soulignait l'utilité des avis formulés par le Conseil supérieur de la magistrature. Nous proposons donc, avec cet avis, qui peut être rendu public, d'encadrer et de rendre moins personnel ce pouvoir monarchique exorbitant.

L'avis de la commission est défavorable puisque le CSM est un organe administratif de nomination et de sanction des magistrats de l'ordre judiciaire : il n'a pas à se prononcer sur un certain nombre d'actes relevant strictement de l'autorité judiciaire. Il n'a pas de compétence particulière pour apprécier un dossier pénal.

Au fond, ce serait une manière abusive de demander à un organisme ayant une mission précise de se déporter ou d'étendre sa compétence à un domaine qui n'est pas le sien aujourd'hui. L'avis est évidemment défavorable.
Avis défavorable également.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 76 |
| Nombre de suffrages exprimés | 73 |
| Majorité absolue | 37 |
| Pour l'adoption | 16 |
| contre | 57 |

La parole est à M. Jean-Louis Masson, pour soutenir l'amendement no 370 .

Il s'agit là d'un amendement de repli par rapport à celui que j'avais proposé précédemment concernant la suppression de l'article 17. Il vise à le restreindre en excluant de son champ les périodes de sûreté prononcées par les tribunaux ainsi que les crimes et délits relevant du terrorisme ou de l'atteinte à la sûreté de l'État.
Je veux dire à Mme la garde des sceaux que je suis très surpris par les arguments qu'elle a développés, qui selon moi fragilisent l'institution judiciaire puisqu'elle reconnaît que celle-ci se trompe. Pour ma part, je ne peux pas accepter que notre justice se trompe au point qu'on aurait besoin du Président de la République intuitu personae pour rectifier les erreurs qui auraient pu être commises. Pour être franc, je suis extrêmement choqué par ces arguments.

Si le Président de la République dispose d'un droit de grâce, ce n'est pas pour régler des problèmes d'excès de vitesse : là ne se situe pas le débat. Il lui appartient de l'exercer avec parcimonie et chaque fois qu'à ses yeux, l'intérêt du pays commande l'exercice de ce droit de grâce. Par conséquent, c'est souvent en appréciation d'une situation politique donnée que ce droit de grâce est exercé et, le plus souvent, pour apaiser dans des situations complexes, voire conflictuelles.
C'est même, le plus souvent, dans des enjeux liés à la sûreté de l'État que le Président de la République est le plus légitime à intervenir puisque, par essence, par construction, il est le garant des institutions. Par conséquent, c'est bien à ce niveau-là des enjeux qu'il doit, le cas échéant, intervenir. Qui mieux que le général de Gaulle pouvait décider de gracier la plupart des auteurs de l'attentat du Petit-Clamart ?

Qui mieux que le général de Gaulle pouvait décider de gracier le général Jouhaud, l'un des putschistes d'Alger, avant que le Parlement, monsieur Lagarde, ne décide de voter une loi d'amnistie ?
Par conséquent, il faut bien mesurer les choses : ce droit de grâce peut être un moyen de pacifier à un moment donné des antagonismes dans le pays. Vouloir empêcher le président d'avoir cette faculté reviendrait à priver la République d'un instrument de concorde. C'est pourquoi l'avis est défavorable.
Monsieur Masson, si vous êtes choqué par mes propos, je suis quant à moi étonnée que vous soyez choqué. Il ne s'agit absolument pas pour moi de dire que l'institution judiciaire se trompe. Bien sûr qu'elle ne se trompe pas ! Ce n'est pas le jugement qui est remis en cause par l'exercice du droit de grâce : ce sont les modalités d'application de la peine qui sont modifiées. Cela n'a rien à voir avec le jugement.
Vous me permettrez d'ajouter que dans le cas le plus récent d'exercice de ce droit par M. Macron, les autorités judiciaires y étaient favorables.
Je crois que vous faites là une erreur d'appréciation. C''est pourquoi l'avis est défavorable.

Moi qui ai voté pour la suppression du droit de grâce, je trouve néanmoins très paradoxal l'amendement qui nous est proposé. S'il y a un domaine où le droit de grâce pourrait se justifier, c'est précisément pour ce type d'atteinte à la sûreté qui suscite l'émotion la plus grande dans l'opinion et donc les plus grands risques de décision excessive. S'il y a une justification au droit de grâce présidentiel c'est bien la possibilité donnée au Président de résister à des poussées populaires très compréhensibles et très légitimes en apparence mais qui peuvent conduire à de graves dérives. C'est le type même de cas pour lequel on devrait maintenir le droit de grâce.
L'amendement no 370 n'est pas adopté.

Nous proposons par cet amendement de supprimer la possibilité pour le Président de la République, introduite par la dernière réforme constitutionnelle de 2008, de s'exprimer devant le Parlement réuni en Congrès. En effet, cette mesure renforce la présidentialisation du régime et la personnalisation du pouvoir, d'autant qu'elle apparaît aussi inutile que coûteuse. Le Premier ministre joue pleinement chaque semaine le rôle de messager du Président de la République et du Gouvernement devant le Parlement, ainsi que lors de la déclaration de politique générale.
Pour cette raison, et au nom du principe de la séparation des pouvoirs, il serait sain sur le plan démocratique que cette disposition soit abrogée.

La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l'amendement identique no 2210 .

Le premier alinéa de l'article 18, inséré dans la Constitution par la révision constitutionnelle de 2008, est critiquable sur de nombreux plans. Voilà pourquoi nous vous invitons par cet amendement à le supprimer.
Dans le château de Louis XIV, dans un décor capitonné et sous les ors de la monarchie, le roi-président peut s'adresser aux parlementaires. Cette disposition est une résurgence de la monarchie dans notre système républicain, rappelant à la fois les États généraux et les lits de justice. Comme pour les États généraux de l'Ancien régime, les parlementaires sont « convoqués » par le Président. Comme pendant les États généraux, les représentants et représentantes du peuple doivent ouïr un discours vertical, descendant, sur une question précise. Pendant les États généraux, il s'agissait souvent d'obtenir l'assentiment au prélèvement de l'impôt. Devant le Congrès, il s'agit plutôt d'un recadrage présidentiel sur des sujets de politique générale, destiné notamment à mettre au pas la majorité et à mettre en scène l'autorité présidentielle devant les Français. Comme pendant les États généraux, les parlementaires peuvent débattre, hors de la présence du chef de l'État, dont les augustes oreilles ne peuvent être incommodées par d'éventuelles contradictions.
Il s'agit d'une concentration des pouvoirs dans la main d'une seule personne : le droit de remontrance, dont disposait le roi, lui permettait d'intervenir pour rectifier une loi, faire passer un édit, s'opposer aux membres des États généraux et les mettre au pas. C'est la même logique qui préside à l'adresse du Président au Parlement réuni en Congrès, auquel il s'agit de faire accepter une réforme dans une scénographie autoritaire. Cette pratique, qu'affectionne notre actuel Président de la République, doit impérativement disparaître parce qu'elle est une aberration dans notre régime politique.
Je ne doute pas que la majorité en sera convaincue et qu'elle votera cet amendement.

La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l'amendement identique no 2249 .

Nous nous sommes toujours opposés à la présence du Président de la République, notamment en 2008, quand cette détestable mise en scène a été introduite dans notre Constitution.
Je me tourne d'ailleurs vers mon collègue – et non pas camarade – du groupe de la Gauche démocrate et républicaine de l'époque, le député de Rugy, qui avait alors déposé un amendement, que nous avions d'autant plus soutenu que nous appartenions au même groupe parlementaire, pour s'opposer à cette modification de la Constitution.

Son argumentation était excellente : il disait que cela portait atteinte à la séparation des pouvoirs et qu'il n'était pas juste que le Président de la République vienne dicter sa feuille de route au Parlement, aux sénateurs et aux députés.
Un député du groupe LaREM s'exclame.

J'entends un aboiement derrière moi. Je me retourne pour voir d'où cela vient. Ah ! j'ai compris. J'ai eu peur qu'on ne me morde les mollets…
Rires.

Certes, lorsqu'on a des commentaires à faire, mieux vaut les faire, mais… Cela dit, il m'arrive aussi d'interrompre un orateur quand il s'exprime.
Pour en revenir à notre sujet, je pense que les arguments avancés par le député de Rugy en 2008 sont toujours valables et susceptibles de convaincre l'ensemble de cet hémicycle.
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et FI.

Je vous remercie, monsieur le député Chassaigne mais je vous invite à ne pas vous exprimer à ma place, d'autant que de là où je suis, je ne peux pas vous répondre et vous le savez bien, même si vous m'avez fort gentiment fait membre d'honneur du groupe GDR au nom d'un passé vieux de plus de cinq ans.

Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?

Il est vrai que ce n'est pas très élégant de la part du président Chassaigne de vous faire un tel procès alors que de là où vous êtes vous ne pouvez même pas vous défendre, monsieur le président !

Ce n'est pas un procès, au contraire : M. le président est pour nous une source constante d'inspiration !

Je ne vous défendrai pas, monsieur le président, car vous n'êtes pas accusé. Mais mieux valait le rappeler.
J'ai relu les débats de 2008 car je ne siégeais pas alors dans cette assemblée. Les constituants de 2008 ont estimé qu'il était absurde que le Président de la République ne puisse pas s'adresser aux parlementaires réunis en Congrès lorsqu'il le jugeait nécessaire en raison d'une sorte de mythologie républicaine persistante qui interdisait ce dialogue…

… et alors que tout le monde savait qu'il avait lieu de toute façon de manière informelle. Les constituants de l'époque ont jugé bon de faire cesser cette hypocrisie en permettant au chef de l'État de venir s'exprimer devant le Parlement, comme cela se passe dans de nombreuses démocraties. À l'époque, le débat ne portait pas sur le dialogue mais sur la possibilité pour le chef de l'État de s'exprimer devant le Parlement.
Cette faculté de s'exprimer devant le Congrès a été ensuite utilisée au gré de circonstances hélas dramatiques, notamment par le Président Hollande.

Je vous remercie monsieur Lurton de dire que l'histoire se construit en marchant.

Je n'aurais pas osé le faire mais j'aime à citer les grands auteurs !
Il n'a jamais été dit que cela devait répondre à un état de nécessité particulier : il s'agissait simplement d'instituer une faculté. Le président Hollande s'en est légitimement saisi dans des circonstances dramatiques et le président Macron a décidé que cette faculté lui permettrait à la fois de rendre compte de son action et d'exposer sa stratégie pour le pays.
On aurait pu trouver formidable cette avancée mûrement réfléchie et décidée par le constituant de 2008, dont le Président actuel, qu'on ne peut pas soupçonner d'en avoir été l'inspirateur, fait un usage régulier dans l'objectif moderne...

… de dire ce qu'il va faire et pourquoi. Mais voilà que certains poussent des cris d'orfraie contre quelque chose qui serait monarchique ! Mais non !

Les mêmes qui naguère protestaient contre le fait que jamais le Président de la République ne vînt devant le Parlement s'indignent aujourd'hui qu'il vienne devant eux !
Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.

Voilà que réflexion faite ils jugent que c'était une mauvaise idée et qu'il faut supprimer ce moment de confrontation entre le Président et le Parlement.

Ce qui au fond permettait de recréer un lien, voilà qu'il faudrait le supprimer. Eh bien, à cela nous sommes défavorables.

Monsieur le président Chassaigne, j'ai peut-être moins d'ancienneté que vous mais je suis certain qu'en matière de mensonge, j'ai moins d'avance !
Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.

Monsieur Chassaigne, ne commencez pas à contester les propos d'une autre époque ! Sinon je devrais répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure.
Sourires.
Auparavant les parlementaires écoutaient debout le message du Président de la République lu par le président de l'Assemblée nationale : est-ce à cela que vous voudriez revenir ? J'imagine que non. Alors pourquoi contester la règle nouvelle instaurée par le constituant de 2008 ?
Les raisons en ont été données en 2008. On a dit qu'il s'agissait de rompre avec ce qu'on avait appelé la « Constitution de Broglie » de 1873 qui, au nom de la séparation des pouvoirs, interdisait au chef de l'État de s'adresser directement aux députés et aux sénateurs.
On a dit que la révision de 2008 rompait avec un pilier du parlementarisme républicain mais était-ce bien la réalité ? Ne faut-il pas plutôt voir dans la possibilité donnée au Président de la République de s'adresser directement au Congrès un élément de transparence de la vie politique et de renforcement du rôle du Parlement ?
Avec cette parole directement adressée par le Président aux parlementaires permise par la révision de 2008, certains ont craint craindre que les règles de la responsabilité ne soient bouleversées et que l'interpellation soit réinstaurée, celle-là même qui, sous les monarchies censitaires, permettait au Parlement de s'adresser au roi à la suite du discours du trône.
Ce n'est pas du tout cela dont il est question ! Il est ici question d'un Président qui vient s'adresser au Parlement réuni en Congrès mais cela ne modifie en rien les règles de la responsabilité du Premier ministre face au Parlement.
Bref, il me semble qu'il n'y a là que transparence, considération pour le rôle du Parlement…
… et qu'aucune règle de notre régime républicain et du régime né en 1958 n'est bouleversée. Il n'y a aucune raison d'être favorable à ces amendements.

Pour répondre à la commission et au Gouvernement, je donne la priorité à ceux qui ont défendu les amendements.
La parole est à Mme Danièle Obono.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous savez bien que cette disposition introduite en 2008 dans la Constitution a entraîné un changement, une inflexion. Par la volonté de Jupiter, ce qui devait être exceptionnel est devenu annuel : tous les ans, nous avons droit à un discours de politique générale – parce que c'est bien de cela qu'il s'agit !
Vous n'y étiez pas ! Vous ne l'avez pas entendu !

Selon vous, « tout va bien, madame la marquise », cela ne pose pas de problème. Si tel était le cas, M. le Président Macron n'aurait pas décidé à l'occasion de son discours de changer la nature de cette adresse en la faisant basculer encore plus dans la caricature présidentielle…

… en se permettant de répondre à la réponse des parlementaires.
Vous voyez bien que la procédure change !

Nous n'étions pas, quant à nous, présents justement parce que nous contestons cette adresse, comme nous contestons que le Premier ministre, responsable constitutionnellement devant le Parlement de la politique du Gouvernement, soit encore davantage mis à l'écart. C'est à M. le Premier ministre que les parlementaires répondent, c'est à son Gouvernement que nous nous adressons ! Le Président de la République est censé être extérieur à ce type d'interpellations. Or, la loi de 2008 a changé ce point, comme l'amendement qui sera peut-être bientôt présenté après l'expression de la volonté présidentielle changera significativement la nature des rapports entre l'exécutif et le législatif…

… vous le savez parfaitement, alors que le second souffre déjà d'un déséquilibre par rapport au premier, déséquilibre qui s'accentuera encore jusqu'à la caricature.
Voilà pourquoi nous maintenons notre amendement et que nous continuerons à vous interpeller sur ce sujet : pour témoigner de l'absurdité de ce dispositif.

Sur le fond, nous avons eu l'occasion de dire combien la généralisation de ce procédé affaiblira le rôle du Premier ministre, la parole présidentielle elle-même et, au bout du compte, le Parlement. Triple peine pour les pouvoirs de la République !
Sur la forme, je me référerai aux débats qui ont eu lieu en commission. J'ai l'impression que notre rapporteur général a été touché par la grâce – monarchique ou présidentielle, je ne sais pas. Je cite M. Ferrand : « C'est simple, monsieur Ruffin » – puisque c'est lui qui défendait cet amendement avec lequel je n'étais quant à moi pas d'accord : « sous la Ve République, le Président de la République n'est pas responsable devant les assemblées ; il ne l'est que devant le peuple français. Je suis donc défavorable à cet amendement », lequel proposait que le Président de la République vienne, qu'il entende ce que le Parlement avait à dire et qu'ensuite il puisse y répondre.
En huit jours, vous avez changé d'avis.

Où est l'amendement présidentiel ? Quand tombera-t-il du ciel ? Soit le Président de la République a menti et l'amendement ne viendra pas, soit M. Ferrand a changé d'avis et c'est lui qui ment !

Je me réfère aux propos tenus en commission. J'attends que l'on me dise où se trouve l'amendement du Président. On attend de voir…

C'est un débat très passionnant qui, je le rappelle, avait beaucoup animé le comité Balladur lors de la présentation de son rapport.
L'idée qui prévalait – et que le Congrès a finalement décidé d'entériner – est qu'il était complètement absurde de considérer que le fait de s'exprimer devant les parlementaires, pour le Président de la République, constituait une atteinte aux droits de ces derniers. Ce paradoxe nous paraissait insupportable. Le Président n'a jamais été responsable devant les chambres ; le droit de message a toujours existé, fût-ce sous des formes très bizarres comme dans la loi chinoise de M. de Broglie qu'évoquait Mme la garde des sceaux.
Il s'agit là d'un pouvoir important. Ceux qui ont une bonne mémoire de l'histoire de la République se rappellent que votre prédécesseur, monsieur le président, le président Le Troquer, a lu, blême de rage, le message du Président Coty où ce dernier en appelait au général de Gaulle pour former ce qui serait le dernier Gouvernement de la IVe République. Les messages présidentiels avaient du contenu politique ! En revanche, les messages lus par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat n'étaient pas adaptés aux formes actuelles de communication. C'est pourquoi nous avons fait cette proposition et que le constituant nous a suivis : le Président de la République peut désormais s'adresser directement aux parlementaires.
Avons-nous eu raison sur tous les points ? Je ne le crois pas. Je crois que nous avons trouvé un moyen terme, qui n'est pas satisfaisant, entre débat et absence de débat. Personnellement, je considère qu'il serait préférable de ne pas débattre.

Le Président s'exprime devant les parlementaires, il ne sollicite pas leur avis, il délivre un message, chacun fait son travail.

Je vous remercie, monsieur le député. Vous avez largement dépassé votre temps de parole, monsieur Bourlanges.

Permettez ! C'est tout de même un débat assez important, monsieur le président !

J'ai une proposition à faire.
Voilà ce que je voulais dire sur le plan procédural : nous avons le choix entre deux attitudes, monsieur le président. Soit on supprime le débat, ce qui signifie que l'on adopte une partie de l'amendement de M. Jumel en supprimant la deuxième partie du deuxième alinéa de l'article 18 de la Constitution, soit on suit M. Lagarde, le Congrès débattant en présence du Président de la République.

Tels sont les deux choix, mais il faut sortir de la situation actuelle, qui est impossible…

Vous parlez depuis trois minutes et trente secondes, monsieur Bourlanges. La durée des interventions ne peut pas être à géométrie variable. Je fais respecter les deux minutes de temps de parole pour tous. Le point de vue que vous avez exposé pouvait parfaitement tenir en deux minutes.

En ce qui me concerne, je ne voterai pas la suppression des deux derniers alinéas de l'article 18. En revanche, je suis favorable à ce que le Président de la République puisse s'exprimer devant l'Assemblée et le Sénat réunis en Congrès en cas de circonstances exceptionnelles qui le lui imposeraient. Ce fut d'ailleurs l'interprétation du Président Hollande lorsqu'au lendemain du 13 novembre 2015 il s'est exprimé de la sorte. Les circonstances étaient alors vraiment exceptionnelles.

D'ailleurs, à cette époque, monsieur Ferrand, vous souteniez l'intervention présidentielle.
L'interprétation que donne aujourd'hui le Président de la République Emmanuel Macron d'une telle possibilité – un discours annuel de politique générale destiné à sa majorité devant le Congrès – ne me convient pas : c'est là le rôle du Premier ministre qui, après son discours de politique générale, engage la responsabilité de son Gouvernement devant l'Assemblée nationale, laquelle l'approuve ou non.

Ce n'est aucunement le rôle du Président de la République ! Je n'accepte donc pas cette utilisation de la révision constitutionnelle de 2008. Je n'étais pas moi non plus député en 2008, monsieur Ferrand, mais la lecture des débats montre qu'une telle disposition était prévue en cas de circonstances exceptionnelles imposant au Président de la République de s'exprimer devant le Parlement.
Applaudissements sur les bancs du groupe LR.
Rappel au règlement

Sur le fondement de l'article 58, alinéa 1, afin de savoir dans quelles conditions nous débattons.
Alors que je me suis contenté de lire les propos qu'il a tenus en commission, le rapporteur Ferrand m'a accusé de mensonge.

… ce n'était donc qu'un demi-mensonge.
J'ai assisté au Congrès – nous avons en effet choisi d'y aller et nous nous sommes enquiquinés, pour ne pas dire plus. À cette occasion, le Président de la République a parlé d'un amendement…

Pour le bon déroulement de nos débats, je veux savoir à quel moment il sera présenté. La parole du Président de la République a-t-elle ou non du sens ? Compte-t-elle ? Pour respecter ce que le rapporteur Ferrand a dit en commission, le Président de la République ne sortira-t-il cet amendement présidentiel que devant le Sénat, afin que l'Assemblée nationale soit court-circuitée et qu'elle ne puisse débattre de cette importante question ? Pour le bon déroulement de nos travaux, je veux donc savoir quand arrivera cet amendement qui tombe du ciel. Quand pourra-t-on en débattre ? Quel véhicule législatif sera-t-il utilisé ? Sera-ce un amendement gouvernemental ? Un amendement de la majorité ? Du rapporteur ? Est-ce un OVNI monarchique présidentiel ? D'où nous vient-il, cet amendement du Président qui, en une phrase modifiera la Constitution ?

Monsieur Jumel, je crois que vous avez largement terminé votre rappel au règlement.

Nul besoin, monsieur Jumel de, disons pour rester bienséant, de perturber la séance. Je suis sûr que vous l'avez parfaitement vu : juste après l'amendement qui sera présenté par Mme Kuster, une série d'amendements porte sur cette question. Cela permettra aux uns et aux autres de se positionner et, le cas échéant, de voter pour ou contre.
Avant l'article 1er

La parole est à Mme Brigitte Kuster, pour soutenir l'amendement no 468 .

L'amendement que je défends au nom de M. Fasquelle et de plusieurs de mes collègues va dans le sens de ce qui vient d'être dit avant le rappel au règlement.
Mon collègue Gilles Lurton a très bien résumé la façon dont le Président de la République interprète la Constitution : d'une manière semble-t-il systématique, nous aurons chaque année un discours de politique générale du Président de la République.
Au-delà de son interprétation personnelle de la Constitution – même s'il la respecte – nombre de critiques ont été faites de cette banalisation du Congrès, en particulier s'agissant de son coût puisque nous nous déplaçons tous à Versailles.
Cet amendement propose que le Congrès ne soit plus systématiquement réuni à Versailles, d'autant plus que la réforme dont nous commençons l'examen tendra à diminuer le nombre de parlementaires. Le Congrès soit siéger à Paris. Daniel Fasquelle a déjà réalisé une étude montrant que la réunion pourrait avoir lieu à la Sorbonne, qui dispose d'un amphithéâtre de mille places avec des tribunes. C'est une proposition. En tout cas, dans l'alinéa que nous proposons de modifier, il serait seulement spécifié que le Congrès aurait désormais lieu à Paris.
Le débat mérite d'être posé, compte tenu du coût de l'organisation du Congrès à Versailles, qui est évalué entre 200 000 et 600 000 euros. Peut-être, monsieur le président, pourrez-vous nous dire combien coûte effectivement le Congrès, puisqu'on entend les chiffres les plus abracadabrantesques ? On ne peut pas passer ces chiffres sous silence !
Cet amendement propose donc, je le répète, que le Congrès ait désormais lieu à Paris, pour les raisons que j'ai évoquées.

Madame la députée, je vous donnerai l'information que vous m'avez demandée quand le rapporteur et la ministre auront donné l'avis de la commission et du Gouvernement sur votre amendement. Il n'y a rien d' « abracadabrantesque » dans tout cela et il suffit d'interroger l'Assemblée nationale, qui fournit volontiers toutes ces informations.
Quel est l'avis de la commission ?

Permettez-moi de donner quelques éléments de réponse à ce projet de déménagement. Voyez-vous, si le Congrès se tient à Versailles, c'est d'abord pour des raisons historiques. Versailles est un haut lieu de l'histoire parlementaire de notre pays, puisque l'histoire démocratique de la France y a commencé. Rien que ça !

La Constituante y est née en 1789, chers collègues. C'est là que la démocratie a commencé. Vous voulez bien entendre cela ?

L'Assemblée nationale de 1871, qui a enraciné la République dans notre pays, y a siégé, de même que les deux chambres, jusqu'en 1879. L'Assemblée de l'Union française y a siégé pendant dix ans, et tous les présidents de la IIIe et de la IVe République y ont été élus. Voilà un élément d'histoire qui plaide pour que le Congrès se réunisse là.

Il y a ensuite une raison pratique : la loi du 26 juillet 2005, qui a cédé les lieux à l'établissement public de Versailles, prévoit que les lieux et tous les ensembles attenants sont mis gratuitement à la disposition des assemblées, sur demande. Il est donc possible de se réunir là, sur simple demande, à tout instant.
Vous proposez, madame, que le Congrès, pour des raisons de commodité, se réunisse finalement à La Sorbonne…

… sans racines historiques, sans légitimation particulière, dans un lieu qui appartient à la Chancellerie des universités de Paris.

Faudrait-il prévoir que le Parlement dispose d'un droit qui permette d'évincer celles ou ceux qui auraient réservé ce lieu avant le Parlement ? Qui paierait la facture de la location – puisque vous avez interpellé le Président de Rugy sur ces aspects comptables ?
Très honnêtement, la commission a pensé que les choses étaient simples, enracinées historiquement, et qu'il n'était pas utile de les compliquer.
De surcroît, votre projet serait sans doute plus coûteux. Avis défavorable.
Avis défavorable. Ce n'est pas de rang constitutionnel.

Madame Kuster, le coût du Congrès de l'année dernière est connu, et il s'est élevé à 297 000 euros. Pour cette année, les chiffres ne sont pas totalement consolidés, mais je peux déjà vous dire que, cette année, le Congrès a coûté un peu moins cher, à quelques milliers d'euros près. Il est donc inutile de brandir des chiffres ou de parler de sommes « abracadabrantesques », qui risquent de faire « pschitt ». En l'occurrence, ces chiffres sont connus et sont publics, car il n'y a rien à cacher sur le coût du Congrès à Versailles.
Par ailleurs, j'informe l'Assemblée qu'il n'est nullement précisé, à l'article 18 de la Constitution, que le Congrès doit se dérouler à Versailles. Cet article dispose uniquement que le Parlement est réuni en Congrès.
La parole est à Mme Brigitte Kuster.

Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir rappelé que la Constitution ne précise pas que le Congrès doit avoir lieu à Versailles.
Monsieur Ferrand, je vous remercie de la manière dont vous m'avez répondu, avec le ton qui est le vôtre, systématiquement condescendant.

Permettez au moins qu'un député, quel qu'il soit, fasse une suggestion. Je me suis fait l'écho d'un amendement de M. Daniel Fasquelle, que j'ai cosigné.

Mon amendement indique seulement que le Congrès pourrait se tenir à Paris : je n'ai pas dit qu'il devait obligatoirement avoir lieu à La Sorbonne. C'est seulement l'un des lieux qui semblent envisageables, au terme de l'audit qu'a réalisé M. Fasquelle. Vous nous avez rappelé l'histoire de France : je vous remercie ! Il existe d'autres lieux très symboliques et j'ai seulement fait une suggestion.
Je vous remercie, monsieur le président, de nous avoir donné ces chiffres. Je n'ai pas dit qu'ils étaient abracadabrantesques en tant que tels, mais qu'ils pourraient l'être, au vu de ce que nous avons lu dans la presse.
En tout cas, il me semble que le débat reste ouvert. Prenez en compte l'état de l'opinion publique en ce moment : vous affichez la volonté de faire de la politique autrement, même si cela nous a échappé, vous parlez de « nouveau monde », mais je pense que ces chiffres ne sont pas anecdotiques.

Au moment où nous demandons des efforts aux Français, nous pouvons peut-être aussi faire des efforts en matière d'apparat…

… lorsque nous votons la loi ou que nous écoutons le Président de la République. Très sincèrement, je pense que nous devrions mener une réflexion sur cette question, et je ne suis pas sûre que le Congrès à Versailles s'impose.

Madame Kuster, je tiens quand même à ce qu'on s'en tienne à ce qui a été dit. Vous avez parlé de « chiffres abracadabrantesques » – le compte rendu en fera foi – et l'exposé sommaire de l'amendement dont vous êtes cosignataire indique que le coût est estimé entre 200 000 et 600 000 euros…

… et vous ajoutez : « On regrette, d'ailleurs, un manque de transparence sur les chiffres. » Ce n'est pas la peine d'affirmer de telles choses.
Depuis un an, le Congrès s'est réuni deux fois et les chiffres sont connus. Quand ils seront consolidés, je vous donnerai ceux du Congrès qui s'est tenu le 9 juillet dernier, pour que tout soit totalement clair, mais je vous répète que cette somme sera légèrement inférieure à celle de l'année dernière, qui s'est élevée à 297 000 euros, pour près de 1 000 parlementaires.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.

Je voudrais commencer par remercier Mme la garde des sceaux d'avoir rappelé que cette question n'est pas de rang constitutionnel. Je la remercie également d'avoir rappelé que nos débats ont vocation à s'inscrire dans un continuum, dans une réflexion globale.
Je voudrais revenir sur les circonstances qui nous ont amenés, en 2008, à autoriser le Président de la République à s'exprimer devant le Congrès – je me permets de le faire, parce que nous ne sommes plus très nombreux ici à avoir voté cela à l'époque. Je peux vous dire que, quand on a fait l'expérience d'écouter le message du Président de la République debout dans cet hémicycle, on comprend vraiment ce qu'est la monarchie. Au Congrès, au moins, vous êtes en position de réagir, de discuter. Ici, on écoutait et on sortait. Telle était la réalité.

En 2008, la volonté du constituant était que la convocation du Congrès ait un caractère exceptionnel. Le Président de la République pouvait nous réunir, soit à l'occasion d'un anniversaire symbolique – je me souviens d'avoir assisté à la réception d'un chef d'État, ou d'un chef de gouvernement, allemand, pour célébrer l'amitié franco-allemande – ou à l'occasion d'un événement grave – ce fut le cas du président Hollande, qui nous a réunis après les attentats. C'était exceptionnel, et c'est la décision du président Macron de rendre ce rendez-vous récurrent qui change la nature du Congrès.

Nous avons le choix entre trois possibilités. La première, celle que vous venez de refuser, et qui était proposée, je crois, par le groupe GDR, consiste à supprimer le Congrès. Je pense que c'est une mauvaise chose, parce que ce serait le retour à ce que nous vivions quand nous devions nous tenir debout, ici, pour écouter un message auquel nous ne répondions pas.

La deuxième solution, celle de Mme Cécile Untermaier, consiste à rendre obligatoire la présence du Président de la République. Je pense que ce n'est pas la solution idoine.
La solution que je propose consiste à dire que c'est au Président de la République, dans la mesure où il a décidé de nous réunir quand il le voulait et de façon récurrente, de décider s'il doit être présent, ou non. Et là, nous pourrons avoir un vrai débat. Nous ne pourrons plus lui faire la fausse critique qui consiste à lui reprocher de ne pas rester, alors qu'il n'en a pas le droit. Désormais, nous pourrons lui dire : si vous nous réunissez, acceptez le débat.

Non, monsieur Di Filippo. Il y a deux réponses et Mme Kuster, qui appartient au même groupe que vous, a répondu. Elle était prioritaire car cosignataire de l'amendement.
L'amendement no 468 n'est pas adopté.

Cet amendement vise à prévoir que, lorsque le Président de la République prend la parole devant le Parlement réuni en Congrès, un débat ait systématiquement lieu alors qu'il ne s'agit aujourd'hui que d'une possibilité.
En outre, et surtout, cet amendement prévoit que le Président soit présent durant ces débats, afin qu'il puisse entendre ce que les représentants de la nation ont à exprimer. Il ne prévoit pas qu'il réponde, mais simplement qu'il écoute, après avoir parlé.
Je voudrais par ailleurs m'associer à la question de notre collègue Sébastien Jumel : où est donc l'amendement du Gouvernement, dans le sens annoncé par le Président de la République ?

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l'amendement no 221 . Peut-on considérer, monsieur Lagarde, que vous l'avez présenté tout à l'heure ?

La tentative est habile, monsieur le président. J'ai simplement essayé d'être au moins aussi habile que vous…
Cet amendement représente selon moi un équilibre.
En 2008, on a voulu moderniser la capacité du Président de la République à échanger avec les parlementaires, lesquels, jusque-là, se tenaient debout et cois en écoutant le message présidentiel, avant de s'en aller. Mais l'équilibre qui a été trouvé en 2008 n'est pas satisfaisant, et sans doute ne l'est-il pas, parce que les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux ont également modifié la manière dont on considère le débat démocratique. Or il me semble qu'il faut laisser au Président de la République la capacité de rester, ou de ne pas le faire.
Chers collègues, lorsqu'on reçoit un chef d'État ou un chef de gouvernement étranger – j'ai pris tout à l'heure l'exemple allemand – , est-il absolument nécessaire que le Président de la République reste pendant l'intégralité des débats, ce qui oblige le chef d'État ou de Gouvernement étranger à rester lui aussi ? Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, ce fut une occasion solennelle pour tous les parlementaires, sénateurs et députés, quels que soient leurs bancs, de réaffirmer leur attachement à l'amitié franco-allemande. Ce fut une réunion très symbolique, mais fallait-il que le Président de la République y assiste dans son intégralité ? La réponse est non.
Lorsque les attentats de 2015 ont entraîné la réunion du Congrès, ce fut un moment excessivement émouvant. Le Président de la République, François Hollande, ce jour-là, et je vous le dis comme je l'ai ressenti, a vraiment été à la hauteur de ses fonctions.

Et il nous a donné, non seulement en tant que parlementaires, mais à nous, Français, la force d'essayer de ressortir la tête de l'eau, où on avait voulu nous enfoncer. Fallait-il que le Président de la République soit là pour le débat qui a suivi ? Non ! Mais lorsque le Président de la République veut engager un débat, sur une révision constitutionnelle ou une déclaration de politique générale, et qu'il le fait de façon récurrente, doit-il pouvoir rester ? La réponse est oui ! Et c'est donc au chef de l'État, qui prend l'initiative de nous réunir, de décider si oui, ou non, il est nécessaire qu'il soit présent…

…. ou s'il laisse, effectivement, le Premier ministre nous répondre. Tel est le sens de cet amendement.

Sur les amendements identiques nos 221 , 575 , 790 , 1574 et 1722 , je suis saisi par le groupe UDI, Agir et indépendants d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Michel Castellani, pour soutenir l'amendement identique no 575 .

Nous débattons de cette question depuis plusieurs minutes et nous avons déjà eu un long débat en commission des lois. J'avais par ailleurs cru comprendre que le Président de la République s'était exprimé sur cette question à l'occasion de son discours au Congrès.
Notre amendement vise à instaurer la possibilité d'un réel débat entre le Parlement et le Président de la République. On comprend l'intérêt que pourrait éventuellement revêtir un tel dialogue entre le législatif et le chef de l'exécutif. Cela se discute, et je comprends que certains puissent considérer qu'il y a là une forme d'entorse à la séparation des pouvoirs. Dans notre esprit, en tout cas, cela ne reviendrait pas à abaisser le Président de la République, mais à relever, de fait, le rôle du Parlement.
Sur le fond, on peut s'interroger sur l'intérêt d'un discours présidentiel devant un Parlement muet. Il est préférable, dans ce cas, que le Président de la République s'exprime à la télévision, pour que tout le monde en profite ! La présence directe du Parlement ne semble pas indispensable dans ce cas-là.

La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l'amendement identique no 790 .

Nous ne reviendrons jamais sur l'élection du Président de la République au suffrage universel, ce que je regrette car l'état le plus avancé de la démocratie reste le régime parlementaire. Il y aurait d'ailleurs moins de schizophrénie si l'on ne faisait pas tout reposer sur la tête d'un même homme, le Président de la République.
Son élection au suffrage universel aurait dû entraîner, de facto, un renforcement des pouvoirs du Parlement, comme cela peut s'observer dans les régimes présidentiels, afin, au moins, d'atténuer les risques de concentration des pouvoirs. Ce n'est pas le cas et notre réforme constitutionnelle n'en prend pas le chemin, à voir le peu d'entrain que l'on a mis à tenir compte de notre proposition de renforcer le rôle du Parlement en matière de nominations proposées par le Gouvernement. Puisque le Président de la République est celui qui dispose de tous les pouvoirs, autant qu'il les assume en toute transparence en nous exposant ses projets, et qu'au moins une fois par an, il nous écoute, à défaut de nous entendre.
C'est pourquoi il nous semble utile que le Président de la République, non seulement s'exprime une fois par an devant le Congrès, et au moins reste pour entendre les réponses des groupes parlementaires.

La parole est à M. Philippe Vigier, pour soutenir l'amendement identique no 1574 .

Nous sommes plusieurs à avoir rédigé le même amendement, qui pourrait permettre d'éviter d'accentuer le déséquilibre des pouvoirs.
Si l'on se retrouve à Versailles, c'est que le Président en a décidé ainsi. Or, l'article 18 lui interdit de rester après son intervention, ce que je trouve anormal ! Bien sûr, il peut lire les déclarations de tous les responsables de groupe, mais il serait souhaitable qu'il reste écouter les parlementaires, et, le cas échéant leur réponde ou fasse des propositions.

Cette disposition ne poserait aucune difficulté et éviterait au contraire que le fossé ne se creuse encore davantage entre l'exécutif et le législatif.
Cela étant, lors du dernier congrès de Versailles, le Président de la République a déclaré ceci : « J'ai demandé au Gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui me permettra, lors de notre prochain Congrès, de rester, non seulement pour vous écouter, mais aussi pour vous répondre ». Le Gouvernement a-t-il satisfait l'exigence du Président de la République ? Si ce n'est pas le cas, nous le ferons à votre place, mais nous aimerions que vous éclaircissiez cette question.

La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l'amendement identique no 1722 .

Cet amendement est d'autant plus justifié aujourd'hui, que le Président de la République a décidé de revenir chaque année devant le Congrès, pour dresser le bilan et présenter la politique qu'il entend conduire.
Il paraît légitime que ce discours de politique générale fasse l'objet d'un débat contradictoire et que l'ensemble des groupes puissent s'exprimer à la suite des déclarations du Président.

J'indique que l'amendement identique no 2240 de M. Chassaigne a été retiré.
Quel est l'avis de la commission sur ces cinq amendements identiques ?

Finalement, des propositions d'amendements peuvent émerger à l'unisson, n'était M. Chassaigne qui, au dernier moment, a retiré son amendement lequel, comme les cinq autres, tendait à supprimer de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18 de la Constitution les trois mots : « hors sa présence ». Autrement dit, le Président de la République se verrait autorisé à rester écouter les réactions des parlementaires.
Sur l'ensemble des bancs, on souhaite introduire cette modification, à l'exception de M. Chassaigne, semble-t-il, qui a retiré son amendement in extremis.

Je remercie M. Jumel d'avoir fait une lecture fidèle de mon intervention en commission…

Non. Ce qui était mensonger, monsieur Jumel, était de voir une contradiction entre ce que j'allais dire et ce que vous avez cité. La commission a rejeté l'ensemble des amendements visant à ce que le Président de la République reste écouter les déclarations des présidents de groupe. Mais reconnaissons le caractère inabouti de cette procédure de 2008 : il n'a jamais été prévu par le constituant de l'époque, que le Président de la République puisse, après s'être exprimé, rester écouter les parlementaires, voire leur répondre. Le constituant de 2008 a simplement prévu que le Président de la République puisse s'exprimer devant le Congrès et qu'ensuite les présidents de groupes parlementaires s'expriment. Ce dispositif peut paraître incomplet, boiteux, mais ainsi en a-t-il été décidé.
Par ailleurs, si le Président de la République demain s'exprimait, cela signifierait, plusieurs orateurs l'ont souligné, qu'il répondrait devant le Parlement alors que son élection ne procède que du peuple et qu'il n'a de comptes à rendre qu'au peuple, tandis que le Premier ministre, lui, investi par la confiance du Parlement, doit rendre des comptes au Parlement, et ne peut être destitué que par l'Assemblée nationale. C'est ce que prévoit notre Constitution.
Par conséquent, la commission a rendu un avis défavorable à ces amendements et, me concernant, je n'ai pas d'avis personnel autre que celui qui pourrait desservir le Gouvernement, ce qui ne saurait être mon intention.
Exclamations sur les bancs du groupe GDR.
En 2008, le constituant a souhaité moderniser nos pratiques en permettant au Président de la République de s'exprimer lui-même devant le Congrès, sans pour autant bouleverser les équilibres de notre régime, notamment en fixant une nouvelle répartition des rôles entre le Président de la République et le Premier ministre.
Le Président de la République est, aujourd'hui, la clé de voûte de nos institutions. Il est élu par les Français sur un programme et des engagements qui seront ensuite mis en oeuvre par le Premier ministre et l'Assemblée, devant laquelle il est responsable.
La nouvelle disposition prise en 2008 ne bouleverse pas les équilibres de la Constitution. Cependant, M. Bourlanges le relevait tout à l'heure, nous sommes restés au milieu du gué. C'est pourquoi le Président de la République a annoncé, lors de son discours devant le dernier Congrès, que de nouvelles propositions seraient faites pour faire évoluer cette procédure, de sorte qu'un véritable débat démocratique puisse se dérouler devant le Congrès en lui donnant la possibilité d'écouter ceux qui voudraient lui répondre et, le cas échéant, de participer au débat.
Ceux qui, aujourd'hui, contestent cette proposition, sont ceux-là mêmes qui critiquaient hier le caractère empesé résultant de la disposition votée en 2008.
Mais, contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas cette nouvelle disposition qui pourrait modifier les grands équilibres et, en particulier, redéfinir le régime de responsabilité du Premier ministre, lequel ne dépend que de l'Assemblée nationale devant laquelle il est responsable.
Tels que rédigés, les amendements no 221 et suivants, qui visent à supprimer de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18, les trois mots « hors sa présence », permettent au Président de la République de prononcer son discours, d'écouter les réponses qui pourraient y être apportées, et, le cas échéant, de prendre la parole, sous la forme d'une circonstance singulière qui ne remet pas en cause les grands équilibres de notre Constitution. C'est pourquoi je serai défavorable à l'amendement no 1389 de Mme Untermaier, en ce qu'elle fait de cette présence une obligation qui ne me semble pas nécessaire.
En revanche, je serai favorable aux amendements identiques nos 221 , 575 , 790 , 1574 et 1722 . Leur parfaite rédaction rendait inutile un amendement du Gouvernement, qui aurait été rédigé dans les mêmes termes. Je regrette sincèrement que l'amendement présidentiel – je veux dire celui du président André Chassaigne !– , ait été retiré au dernier moment, car j'aurai eu grand plaisir à l'accepter.

L'amendement no 221 et ceux qui lui sont identiques – dont l'amendement no 2240 de M. Chassaigne qui a été retiré – visent à faire évoluer la pratique inscrite à l'article 18 de la Constitution, de l'expression du Président de la République devant le Congrès, afin que le Congrès puisse réagir aux propos du Président, comme l'avaient souhaité de nombreux parlementaires.
Un second débat concernait l'origine de l'amendement. Devait-il être gouvernemental ou parlementaire ? Si l'on s'inscrit dans le droit fil de la révision constitutionnelle de 2008, cet amendement devait être d'origine parlementaire, puisqu'il vise à renforcer les droits du Parlement et que le Président de la République se présente devant le Parlement réuni en Congrès pour y rendre des comptes ou exposer sa politique générale.
S'agissant des institutions en elles-mêmes, j'ai entendu certaines interrogations quant à ce que deviendrait le rôle du Premier ministre. Mais chacun sa chambre si je puis dire !
Rires

Le Premier ministre, qui dirige et coordonne l'action du Gouvernement, dispose de l'article 49 qui l'autorise à engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, avec le risque toujours possible d'une censure.
Quant au Président de la République, il s'exprime, lui devant une autre assemblée, le Congrès, et, si ces amendements sont votés, il pourra y rester pour entendre les interventions des parlementaires.
À titre personnel, je voterai donc ces amendements.

Il y a des moments où l'on ne regrette pas d'être restés dans l'hémicycle jusqu'à une heure aussi tardive car il faut vraiment le voir pour le croire. Quel revirement par rapport aux discussions en commission des lois, pas plus tard qu'il y a deux semaines !
Monsieur Ferrand, vous qui aimez à relever les contradictions des uns et des autres, et vous tous, qui avez bataillé contre ces amendements en commission des lois, vous les soutenez aujourd'hui pour la simple et bonne raison que le Président de la République a sifflé et que vous vous mettez tous au diapason. Au-delà du ridicule, il y a un peu de honte ! En tout cas, il devrait y en avoir…
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR.

Vous commettez une grave erreur. De notre côté, notre ligne de conduite n'a pas dévié.

Si seuls les idiots ne changent pas d'avis, vous êtes tous très brillants ! C'est une certitude.
Au regard du principe de la séparation des pouvoirs, vous commettez une gravissime erreur en plaçant le Président de la République au niveau du Premier ministre. Puisque vous voulez qu'il débatte avec nous, qu'il réponde de sa politique par un vote du Parlement à l'issue des débats, qui ne seront que de pacotille, puisqu'il se contentera de répondre, sans aucun échange.
Je fais enfin partie de ceux qui se plaignent du coût réel du Congrès. Vous avez dit, monsieur le président, qu'il a coûté 286 000 ou 296 000 euros. Ce montant ne prend pas en compte le repas organisé par le Président de la République, ni le transport sur place des forces de sécurité, ni le taux horaire des agents mobilisés sur place qui ne sont pas à leur travail ce jour-là à l'Assemblée ou au Sénat. Le coût réel est donc bien supérieur.
À un moment où on demande tellement d'efforts à nos concitoyens, notamment aux plus modestes, – c'est dès 920 euros de pension que les retraités, lorsqu'ils sont en couple, paient davantage de CSG !– , bientôt à ceux qui touchent une pension de réversion, vous devriez avoir honte de dépenser autant d'argent pour la communication et le marketing politique de votre chef, le Président de la République.
Exclamations sur les bancs des groupes LaREM et MODEM

Mes chers collègues, il reste peu avant que l'on ne passe au vote que la séance ne soit levée. Écoutons-nous encore quelques instants !
La parole est à Mme Danièle Obono.

La gymnastique à laquelle le Gouvernement et sa majorité se sont astreints pour faire passer, aux ordres de Jupiter,
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe LaREM

un amendement, est assez impressionnante. La réalité n'en demeure pas moins la même : que le Président Macron décide de prononcer tous les ans un discours de politique générale devant le Parlement puis, sur un coup de tête ou sous la pression, de rester pour écouter les parlementaires qui s'exprimeront après lui et pour leur répondre, c'est toujours l'expression d'un présidentialisme accentué, portant atteinte à l'équilibre des pouvoirs au détriment du Parlement.
Comme l'a dit notre collègue Di Filippo, la logique de l'exercice voudrait que le Président de la République reste pour un vote, puisque son intervention, devenue un simple discours politique, n'est plus exceptionnelle. Il devrait donc demander aux parlementaires d'approuver sa ligne politique. Ne vous en déplaise, monsieur le rapporteur, madame la ministre, il prend là la place du Premier ministre, qui, il est vrai, n'était déjà plus qu'un fusible en cas de problèmes politiques, notamment de popularité. Le Premier ministre devient inutile puisqu'il a perdu sa fonction propre devant le Parlement, son rôle se réduisant à celui d'un simple exécutant.
En retournant complètement l'argumentation que vous aviez avancée en commission, vous ne faites qu'exécuter ce que Jupiter a dit à Versailles.

Merci, madame Obono. Votre temps de parole est écoulé.
La parole est à M. Olivier Becht.

C'est un drôle de pays que celui où on vote une réforme aussi fondamentale à une heure quinze du matin !
Les députés du groupe UDI, Agir et indépendants voteront ces amendements, même si ce n'est pas tout à fait pour les mêmes raisons : nous pensons, en effet, que cette réforme, loin de renforcer les droits du Parlement, renforcera ceux du Président. Si nous la votons, c'est que nous pensons qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique de la Ve République qui a fait, madame la garde des sceaux, du Président de la République non seulement la clé de voûte des institutions, mais également le véritable patron de l'exécutif, du fait, d'une part, de son élection au suffrage universel direct et, d'autre part, de l'instauration du quinquennat : son mandat a désormais la même durée que celui des députés, lesquels sont, de plus élus quasiment au même moment que lui.
Il est donc normal que le Président de la République, chef de l'exécutif, puisse venir s'expliquer devant le Parlement et qu'un débat soit rendu possible. Toutefois, ce débat ne saurait se tenir sans contrepartie : c'est pourquoi nous devons en avoir un sur l'équilibre des pouvoirs. Ces amendements ne peuvent être votés qu'accompagnés d'autres, visant à restaurer les pouvoirs du Parlement face au Président de la République.

Je suis un esprit libre, mes chers collègues. J'ai écouté le Président, à Versailles. Qu'a-t-il déclaré ? « J'ai demandé au Gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que, lors d'un prochain Congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais aussi pour pouvoir vous répondre. »
Je vous ai répondu sur le sujet.

Madame la garde des sceaux, je ne vous ai pas interrompue. Voilà pour la forme.
Monsieur le rapporteur, vous n'avez pas voulu rappeler la position qui était la vôtre en commission.

La majorité a voté contre ces amendements.
Si je rappelle ces deux événements, c'est pour montrer qu'il n'y a plus de pensée. On dit blanc, on dit noir ! On change d'avis ! Mais derrière ces amendements, se pose le problème, beaucoup plus grave, de l'avenir même de nos institutions. Pensez-vous, mes chers collègues, que cette disposition renforcera la position du Premier ministre ? Non, elle l'affaiblira. Elle ne renforcera pas non plus la position du Président, contrairement à ce que vous pouvez croire et à ce que croit peut-être le Président lui-même. Pourquoi ? Si le Président prononce chaque année un « discours sur l'état de l'Union », selon la formule consacrée aux États-Unis, que se passera-t-il ? La majorité applaudira, l'opposition critiquera, et la position du Président en sortira affaiblie.
Ce petit débat pose une question fondamentale : que voulons-nous ? Soit nous voulons un régime présidentiel – c'est ma position : alors il faut aller jusqu'au bout de cette logique, avec ses avantages et ses inconvénients, en supprimant notamment le droit de dissolution de l'Assemblée nationale par le Président. Soit nous voulons revenir à un régime parlementaire. Or, avec cette mesure, nous faisons un pas supplémentaire vers un régime présidentiel sans vraiment le dire, si bien que nous affaiblirons simultanément et la position du Président de la République et celle du Premier ministre.
Vous avez cosigné l'amendement no 221 !

Le moment est venu de faire mentir le cardinal de Retz. Nous devons sortir de l'ambiguïté sans que cela se fasse à notre détriment. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Soit nous options pour un débat sec, si j'ose dire, vertical, traditionnel – c'était à mes yeux la meilleure solution – : nous ne l'avons pas retenue. Soit il faut aller jusqu'au bout de la logique pour permettre un vrai débat. Je ne vois pas en quoi la gloire et l'autorité du Parlement seraient préservées, parce qu'il aurait le privilège de parler en l'absence de celui à qui il s'adresse. C'est aberrant. Quand une personne quitte la salle au moment où on lui adresse la parole, c'est généralement qu'elle ne vous écoute pas. Il faut donc maintenant sortir de l'ambiguïté et choisir une solution claire.
La solution proposée par les amendements identiques est la meilleure : la suppression des mots « hors sa présence » laisse au Président de la République le soin de gérer, à sa manière, comme il l'entend, c'est vrai, cette procédure. De grâce, n'allons pas croire que l'avenir de la République se joue dans cette disposition ! Tout est dans la pratique présidentielle. Nous n'avons pas attendu la présence du chef de l'État au Congrès pour entendre qualifier le Premier ministre de collaborateur du Président. De même, la présence du chef de l'État au Congrès n'interdira pas la réhabilitation du Premier ministre et du Gouvernement.
Je le répète : tout est affaire de pratique. Les amendements identiques qui sont proposés à notre vote nous permettent de sortir de l'ambiguïté sans interdire la flexibilité et la souplesse. Nous espérons que le Président de la République fera de son discours devant le Congrès, qui est un acte fort, un usage modéré.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe MODEM.

Monsieur le rapporteur Ferrand, je tiens à vous féliciter : vous êtes le plus fort de tous !

Je suis fier d'avoir retiré mon amendement : je ne cherche pas à occulter ce geste. Vous, en revanche, en commission, vous avez dit : « Selon l'esprit de l'article 18 de la Constitution, il s'agit cependant de faire en sorte que le Président de la République ne puisse être pris à partie ni interpellé directement – ce serait remettre en cause le fait qu'il n'est pas responsable devant le Parlement. »

Vous êtes plus malin que cela ! Vous savez très bien que, lorsqu'on n'a pas le cul propre, on ne peut pas monter au mât de cocagne.

C'est la raison pour laquelle vous avez été suffisamment habile ce soir.
Acte II : le Président de la République déclare qu'il demandera au Gouvernement de présenter un amendement lui permettant d'assister aux interventions des parlementaires au Congrès et d'y répliquer.
Acte III : afin de ne pas être trop en contradiction, et de peur de porter atteinte à la séparation des pouvoirs, le Gouvernement ne présentera pas l'amendement mais s'arrangera pour qu'il soit déposé par d'autres. Devant le spectacle de cette mèche lente avançant sur un bâton de dynamite, nous avons décidé de retirer notre amendement avant la discussion, et fort heureusement !
En effet, ceux qui ont déposé l'amendement pensaient que la suppression des mots « hors sa présence » ne visait que la simple présence du Président de la République. Or, si cet amendement est adopté, que deviendra l'article 18 ? Mécaniquement, le Président de la République pourra s'exprimer sans qu'il soit nécessaire qu'un autre amendement soit adopté au Sénat. En effet, le texte sera le suivant : « Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. » Vous êtes super, monsieur le rapporteur Ferrand ! Je tiens à vous féliciter. Avec votre nouveau monde, vous êtes bien meilleur que les députés de la IIIe République et de la IVe République : vous êtes passé maître !
Applaudissements sur les bancs du groupe GDR ainsi que sur plusieurs bancs des groupes NG et LR. – Exclamations sur les bancs du groupe LaREM.

Moi aussi, je m'exprime librement. Et je dois avouer mon sentiment de malaise. Ces amendements identiques, qui ont fait l'objet de discussions individuelles, font quelque peu l'effet d'un coup monté.
Exclamations sur les bancs du groupe LaREM.

La commission s'est tenue avant le Congrès : il aurait fallu être fort.

Le groupe Nouvelle Gauche a déposé un amendement sur lequel nous avions des réserves parce que nous avons entendu le rapporteur Ferrand faire des observations justes. Lorsque j'ai entendu M. Bourlanges, je me suis, moi aussi, posé des questions sur l'amendement que nous avions déposé. Je ne suis pas certaine, en effet, que nous puissions nous engager, ainsi avec une certaine légèreté, sur cette voie car l'équilibre des pouvoirs législatif et exécutif risque quand même d'en être modifié. Je donne raison à la première analyse de M. Bourlanges.

Nous verrons ce que fera le Sénat, mais je crains que ces amendements, en supprimant ces trois mots, ne nous éloignent de la voie de la raison en bouleversant complètement notre approche du Congrès, si, après la parole présidentielle, que nous sommes très honorés d'entendre, se tient un débat en présence du Président, qui aura la possibilité de répliquer. Pouvons-nous adopter une telle disposition par la simple voie d'un amendement parlementaire sans étude d'impact préalable ? J'ai le sentiment que nous avons une approche quelque peu brouillonne d'un sujet qui ne doit pas l'être.

Je tiens à apporter une précision : peut-être cela calmera-t-il quelques ardeurs. L'amendement que j'ai présenté, et que j'ai cosigné avec ma collègue Sylvia Pinel, a été préparé bien avant le discours du Président devant le Congrès. Nous l'avons maintenu. Le reste n'est qu'un concours de circonstances.

Pour éclaircir les choses, je rappelle que les numéros des amendements correspondent à leur ordre de dépôt. J'ai entendu le président Chassaigne dire qu'il y aurait eu je ne sais trop quel arrangement. Lorsque j'ai déposé l'amendement no 221 , bien avant tout le monde, ce n'était pas pour me prévaloir d'un quelconque droit d'auteur. J'étais même convaincu qu'il ne serait pas accepté par la majorité. Je le dis pour la clarté des débats : il n'y a pas eu de coup monté, madame Untermaier ; il n'y a même pas eu de discussion individuelle. Comme Philippe Vigier et Bertrand Pancher, j'ai simplement prolongé le débat que nous avions eu à l'occasion de la révision de 2008. Nous considérions – ce qui avait été refusé par le chef de l'État de l'époque – que l'on pouvait offrir la possibilité au Président de la République de s'exprimer devant le Congrès et, s'il le souhaitait, d'écouter les interventions des parlementaires. Il n'y a donc eu aucun coup monté.

Il me semble qu'entre l'interdiction faite au Président de la République, d'une part, de venir s'exprimer devant le Congrès – ce que vous défendiez précédemment – c'est-à-dire le retour à l'ordre ancien, où on était debout, dans cette assemblée, à écouter ce que le Président avait bien voulu nous faire lire, et, d'autre part, la possibilité ou l'obligation de le faire venir, cet amendement permet de parvenir à un équilibre. Il ne s'agit en rien de rendre le Président de la République responsable devant le Parlement, puisque, comme en dispose l'article 18 de la Constitution, le débat « ne fait l'objet d'aucun vote » ; pour qu'il y ait mise en cause de la responsabilité, en démocratie, devant un Parlement, il faut qu'il y ait un vote.
Exclamations sur divers bancs.

Vous vouliez justement qu'il puisse y avoir un débat avec le Président de la République !

Mes chers collègues, je vous en prie. Les uns et les autres se sont largement exprimés sur ces amendements identiques, alors qu'il n'aurait dû y avoir qu'une réponse à la commission et au Gouvernement.
Nous allons maintenant procéder au vote par scrutin public.
Rappels au règlement

La parole est à M. Fabien Di Filippo, pour, je l'espère, un véritable rappel au règlement.

Monsieur le président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 58, alinéa 1, et a trait à la bonne tenue de nos débats. Le sujet que nous examinons a fait l'actualité et sera l'un des points cruciaux de cette réforme constitutionnelle, l'un de ceux qui auront la plus forte incidence sur l'évolution de nos institutions. En ce qui nous concerne, nous trouvons regrettable de l'examiner dans ces conditions, en catimini, à une heure trente du matin, avec un débat et un vote tronqués.
Vives exclamations sur les bancs du groupe LaREM.

Je trouve que cela méritait bien mieux qu'un débat, dans la nuit de lundi à mardi, à une heure trente du matin. De surcroît, comme l'a très bien dit M. Chassaigne, le Gouvernement s'est livré à une manipulation pour rebondir sur des arguments de l'opposition. Ce n'est pas digne…
Exclamations persistantes.

Mes chers collègues, un peu de calme, je vous prie.
M. Jumel demande lui aussi à faire un rappel au règlement qui, je l'espère, est un vrai rappel au règlement, faute de quoi je serai contraint d'abréger son intervention.
Je tiens à préciser que vous avez été dix à intervenir en réponse à la commission et au Gouvernement, sans parler des présentations des amendements et du débat que nous avons eu, auparavant, sur d'autres amendements, qui a permis d'amorcer cette discussion. Je l'ai relevé dans le cours du débat, mais plusieurs d'entre vous ont souhaité intervenir sur ce sujet avant même l'examen des amendements actuellement en discussion – je le dis, par exemple, à M. Bourlanges, qui a largement dépassé son temps de parole. La discussion d'un amendement visant à ce que le Congrès se tienne à Paris a aussi été l'occasion d'une pré-discussion sur le sujet qui nous occupe actuellement. Il ne faut donc pas vous plaindre ensuite, monsieur Di Filippo, que l'on soit obligé de voter à une heure trente : d'une certaine manière, tout a été fait pour qu'il en soit ainsi.
Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.

La parole est à M. Sébastien Jumel, pour ce que j'espère être un vrai rappel au règlement, avant que nous ne passions au vote.
Exclamations.

Tout d'abord, monsieur le président, prétendre que mon rappel au règlement pourrait ne pas en être un, c'est faire preuve de suspicion.

Non, j'insiste simplement sur le fait que les rappels au règlement doivent respecter certaines règles, ce qui relève de mes prérogatives de président.

Ce rappel au règlement est tout aussi « vrai » que ceux que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à présent…

… et se fonde, comme les précédents, sur l'article 58, alinéa 1, relatif à l'organisation de nos débats. Le projet de loi soumis à notre approbation a pour objet d'améliorer la représentativité, la responsabilité et l'efficacité. Est-il donc responsable qu'un amendement d'inspiration présidentielle soit débattu et voté à une heure aussi tardive ?
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR, LR et NG. – M. Jean-Christophe Lagarde proteste vivement.

Ceux qui hurlent ont d'ailleurs participé à la turpitude à laquelle nous sommes confrontés et que j'entends dénoncer.
M. Jean-Christophe continue de protester vivement.
Avant l'article 1er

Il n'y a jamais ici d'amendement présidentiel. Et, dans le cas qui nous occupe, il n'y a même pas d'amendement gouvernemental. Tous émanent de députés.
L'amendement no 1389 n'est pas adopté.
Il est procédé au scrutin.
| Nombre de votants | 60 |
| Nombre de suffrages exprimés | 53 |
| Majorité absolue | 31 |
| Pour l'adoption | 40 |
| contre | 13 |
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Élection d'un vice-président ;
Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.
La séance est levée.
La séance est levée, le mardi 17 juillet, à une heure trente-cinq.
Le Directeur du service du compte rendu de la séance
de l'Assemblée nationale
Serge Ezdra