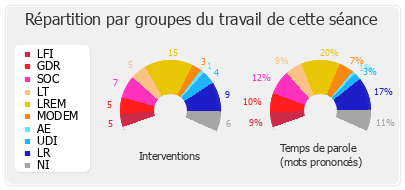Séance en hémicycle du mardi 11 janvier 2022 à 9h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures.

La parole est à Mme Bénédicte Peyrol, pour exposer sa question, n° 1614, relative à la liste complémentaire pour le recrutement des professeurs des écoles.

L'académie de Clermont-Ferrand, et le département de l'Allier en particulier, est en déficit de remplaçants de professeur des écoles pour cette rentrée scolaire 2021-2022, quand bien même le nombre d'élèves dans le primaire est en repli. Alors que chaque année ce déficit pouvait être comblé en faisant appel, notamment, aux candidats de la liste complémentaire du concours de recrutement de professeurs des écoles – CRPE –, le choix a été fait, cette année, de n'avoir recours qu'aux agents contractuels. Cette situation pose question quand on sait que le recours massif aux contractuels concourt à la précarisation de ceux-ci et qu'il empêche les enfants de bénéficier d'enseignants suffisamment formés.
Aujourd'hui encore, dans le contexte de reprise de l'épidémie, les écoles de ma circonscription doivent faire appel à des remplaçants. Le vivier de contractuels est extrêmement tendu et justifierait pleinement le recours aux candidats de la liste complémentaire.
Par ailleurs, il a été proposé à ces mêmes candidats d'être recrutés sous le statut de contractuel, afin qu'ils puissent effectivement exercer des remplacements. Comment pourraient-ils se satisfaire d'une telle proposition, alors qu'ils se sont formés, qu'ils ont passé un concours et qu'ils peuvent prétendre à une titularisation à l'issue de leur période de stage ? Qu'est-ce à dire de la reconnaissance de leur parcours, même s'ils ont échoué de peu au concours, sinon que tous les efforts ne valent qu'un retour à la case « contractuel » ? Nous sommes à ce jour trop avancés dans l'année pour que ces candidats puissent prétendre à une titularisation pour l'année scolaire 2021-2022, mais cela peut encore être envisagé pour l'année scolaire 2022-2023.
Le choix de recourir exclusivement à des enseignants contractuels ne s'explique pas quand, dans le même temps, par exemple dans l'académie de Paris, alors que le nombre d'élèves dans le primaire a diminué de 6 000, 45 candidats sur la liste complémentaire ont pourtant été appelés pour des remplacements. Il ne s'agit pas, bien entendu, que les trente-quatre candidats de la liste soit appelés pour effectuer des remplacements, mais il est demandé simplement que, comme chaque année, le rectorat ait recours à cette liste.
Aussi, j'aimerais connaître les raisons qui amènent à ne pas recourir à la liste complémentaire du CRPE, et les pistes envisagées pour ces candidats, afin que leur titularisation puisse être reportée sur l'année 2022-2023.

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire.
Je vais commencer par vous répondre sur l'académie de Clermont-Ferrand, où 105 postes ont été ouverts au recrutement de professeurs des écoles pour la rentrée 2021, et où le taux de rendement a été de 100 %.
S'agissant de la situation générale, vous savez qu'au vu du contexte sanitaire très tendu pour nos professeurs, nous faisons massivement appel en ce moment aux contractuels, aux vacataires et même aux professeurs retraités.
J'en viens maintenant aux règles générales. Le volume des postes offerts au concours de recrutement des professeurs du premier degré public est déterminé, dans le respect des emplois votés en loi de finances, au regard de critères tels que la prévision d'effectifs d'élèves et le nombre de départs à la retraite dans chaque académie. Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste principale, classant par ordre de mérite les candidats jugés aptes par le jury. Si la liste principale est complète, le jury peut établir une liste complémentaire de candidats, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. La mobilisation des listes complémentaires est adaptée pour chaque académie au regard notamment de la consommation des emplois et des postes vacants à la rentrée scolaire. Toutefois, en application du décret relatif au statut particulier des professeurs des écoles et afin d'assurer l'accès dans les mêmes conditions au dispositif de formation de l'ensemble des lauréats, il n'est pas fait appel à cette liste complémentaire en remplacement des candidats inscrits sur la liste principale au-delà d'un mois après le début de la formation.
Pour la rentrée 2021, 9 890 postes étaient ouverts au recrutement de professeurs des écoles. Le taux de rendement du concours est bon, puisqu'il est de 98 % environ. Eu égard aux besoins d'enseignement de la rentrée 2021, huit académies ont fait appel à la liste complémentaire au-delà des désistements, à hauteur de 151 candidats, dans le respect du volume global de postes ouverts à la session 2021.
Lorsqu'il n'est plus possible de recourir à la liste complémentaire, les besoins nouveaux qui apparaissent sont, en effet, pris en charge par des professeurs contractuels. Le recrutement de droit commun des agents contractuels correspond au niveau de qualification exigé pour se présenter aux concours internes des différents corps d'enseignement d'éducation et de psychologue concernés. De plus, afin de leur permettre un accès à l'emploi pérenne au sein de la fonction publique, ce qui est en général recherché, ces contractuels sont accompagnés et disposent de facilités tout au long de l'exercice bien sûr, mais également pour se préparer aux concours.

Je serai très franche : cette réponse ne me satisfait pas et elle ne répond pas à la situation de l'Allier qui n'a pas du tout eu recours cette année aux listes complémentaires. Il est donc incompréhensible que l'on ne fasse appel qu'à des contractuels. Je sais qu'il peut y avoir une discussion au sein du département avec l'inspection d'académie, mais ce dialogue est aujourd'hui insatisfaisant.
J'espère avoir le soutien du Gouvernement pour que ce dialogue puisse véritablement avoir lieu, car je ne suis pas en mesure d'expliquer aux enseignants qui sont sur liste complémentaire pourquoi on recourt aux contractuels.

La parole est à Mme Nadia Ramassamy, pour exposer sa question, n° 1619, relative à l'Union nationale du sport scolaire en outre-mer.

Je viens vous parler d'une injustice, celle qui touche aujourd'hui tous les élèves ultramarins qui pratiquent le sport scolaire par l'intermédiaire de l'Union nationale du sport scolaire – l'UNSS. Ces derniers sont les victimes du règlement fédéral de l'UNSS voté pour la période 2020-2024, qui prévoit pour certains sports un système de roulement pour les départements et territoires d'outre-mer.
Alors que tous les champions des académies hexagonales ont la possibilité de participer chaque année aux championnats de France, cette opportunité est refusée à la plupart des élèves ultramarins. En effet, selon l'article D2 du règlement fédéral, chaque département ou territoire ultramarin doit attendre huit ans avant de pouvoir envoyer ses champions académiques aux championnats de France. Pensez-vous qu'il soit normal qu'il existe encore aujourd'hui une telle différence de traitement entre académies hexagonales et ultramarines ?
En 2022, la Guadeloupe sera en première position sur la liste et pourra donc envoyer aux championnats de France ses champions académiques de basket, de handball, de football, de volley-ball, de rugby et d'autres sports organisés en « poule », alors que les champions des académies de Guyane, de La Réunion, de la Martinique et des autres territoires ultramarins seront automatiquement disqualifiés et ne pourront pas participer aux championnats, et ce quel que soit leur niveau ; ainsi, les sportifs réunionnais devront attendre jusqu'en 2025.
Je souhaite donc connaître les raisons de l'instauration d'une telle rupture d'égalité entre académies de l'hexagone et académies ultramarines, et les raisons qui écartent arbitrairement nombre de jeunes sportifs ultramarins pour qui le sport scolaire pourrait être une porte d'entrée vers le sport de haut niveau. Je souhaite aussi savoir si M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en sa qualité de président de l'Union nationale du sport scolaire, a prévu de réparer cette injustice qui discrimine les collégiens et lycéens ultramarins et qui s'inscrit surtout en porte-à-faux par rapport aux déclarations du Président de la République, qui affirmait aux médaillés olympiques, en septembre 2021, vouloir faciliter l'entrée des lycéens sportifs de haut niveau dans des filières sélectives et d'excellence.

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire.
L'Union nationale du sport scolaire organise chaque année 140 championnats de France, toutes catégories confondues, sur l'ensemble du territoire ; elle attache beaucoup d'importance à la participation des équipes ultramarines à ces différents championnats de France.
Votre question porte sur la qualification de ces équipes ultramarines aux championnats de France de sports collectifs. Ces championnats regroupent seize équipes en général. La qualification à ces championnats donne lieu à une phase de qualification interacadémique regroupant plusieurs équipes championnes d'académie. En ce qui concerne les équipes ultramarines, on peut comprendre qu'il soit contraignant d'organiser cette phase interacadémique. Par souci d'équité toutefois, une place minimale leur est réservée. Au total, le système de rotation, tel qu'il est construit, ne désavantage pas nos territoires d'outre-mer par rapport aux autres territoires. C'est même un principe d'équité qui est la règle.
En outre, le règlement fédéral approuvé en assemblée générale précise qu'afin de ne pas mettre en concurrence entre elles les équipes ultramarines, deux règles sont reconduites sur la période 2020-2024. Premièrement, les services régionaux d'outre-mer procèdent au préalable à une préinscription qui doit parvenir à la direction nationale pour le 15 novembre de chaque année. En fonction des inscriptions recensées, une qualification par la direction nationale est alors effectuée. Deuxièmement, les engagements définitifs doivent ensuite être effectués sur le site dédié à cet effet, trente jours avant la date butoir de qualification académique ou interacadémique indiquée dans le calendrier des championnats de France.
Pour l'année 2022, en cas d'inscriptions multiples d'équipes d'outre-mer dans la même catégorie d'âge, de sexe et dans le même sport, la priorité sera donnée, comme vous le savez, selon un ordre préétabli. Ainsi, la priorité est donnée cette année aux équipes de la Guadeloupe, puis, l'année prochaine à Mayotte, ensuite à La Réunion, et ainsi de suite, selon un système de rotation.
Avec le ministre Jean-Michel Banquer, nous avons demandé au nouveau directeur national, Olivier Girault, ancien champion olympique de handball et originaire de la Guadeloupe, d'être particulièrement attentif à ces sujets, et je ne doute pas qu'il le sera.

Vous venez de dire que la priorité était donnée aux équipes de la Guadeloupe, que Mayotte devra attendre l'année prochaine et La Réunion 2024. Vous confirmez, de fait, ce que j'ai dit, à savoir qu'il y a une inégalité de traitement entre les académies hexagonales et les académies ultramarines. Ce n'est pas normal. Une telle injustice n'a pas sa place en France, et je regrette que vous ne soyez pas de mon avis. Il faudra se battre pour que tous les sportifs soient égaux.

La parole est à Mme Michèle Victory, pour exposer sa question, n° 1631, relative à la situation des dumistes.

Les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI), que l'on appelle couramment les dumistes, interviennent principalement dans les classes du premier degré et jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la politique de l'éducation artistique et culturelle (EAC) et du développement du chant choral, que votre gouvernement souhaite généraliser auprès de tous nos jeunes. Il est important de noter que leur travail favorise le lien social au sein des territoires et que, dédié à la coordination des projets, il leur permet d'assurer un relais de qualité entre les collectivités territoriales et les établissements scolaires. En outre, ils conçoivent, conduisent et encadrent des projets musicaux pour développer l'enseignement du chant choral et permettre l'accès à la pratique musicale pour tous, en collaboration étroite avec les enseignants de l'éducation nationale.
Si ces intervenants et intervenantes – 70 % de femmes –, dont le diplôme de niveau 6 au répertoire national des certifications professionnelles atteste d'une excellente formation, sont des agents de catégorie B de la fonction publique territoriale, ils souffrent pourtant d'un manque de reconnaissance institutionnelle, sur lequel porte ma question. Abandon de carrière, reconversion professionnelle, crise des vocations et pénurie à l'embauche, conditions de travail parfois difficiles et salaires insuffisants, ils ne bénéficient d'aucune progression de carrière dans leur discipline. Alors qu'au départ le DUMI était placé à égalité avec le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) des instituteurs, au niveau bac + 2, une réforme a permis aux professeurs des écoles d'accéder à la formation conduisant au diplôme de master et ainsi d'obtenir, à terme, un reclassement en catégorie A.
La reconnaissance du DUMI au niveau 6 en 2017 devrait leur permettre d'accéder aujourd'hui à la catégorie A, comme c'est le cas pour les autres agents de la fonction publique territoriale. Pourtant, ces personnels restent agents de catégorie B, avec une grille salariale très inférieure, dans les premiers grades, à celle des autres agents de même niveau de diplôme. C'est donc une impasse pour les dumistes, qui contribuent pourtant au développement d'une politique d'accès à la pratique artistique et culturelle pour nos enfants dans le cadre scolaire, ce qui est un élément essentiel en termes d'égalité des chances. En plus de rester bloqués dans leur catégorie, ces agents ne sont pas éligibles aux primes perçues par les enseignants intervenant au sein des réseaux d'éducation prioritaire REP et REP+, ni à la nouvelle bonification indiciaire, et se trouvent exclus du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État, le RIFSEEP – régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
Aussi, je souhaite vous interroger sur les améliorations que le Gouvernement entend mettre en place afin de mieux valoriser ce joli métier. Que répondez-vous à la proposition des dumistes de créer une nouvelle discipline de professeur d'éducation artistique et culturelle dans le cadre d'emploi de catégorie A à plusieurs grades, qui viendrait remplacer l'actuel cadre d'emploi de catégorie B dans la discipline « intervention en milieu scolaire » ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire.
Dans la fonction publique, les statuts particuliers définissent notamment les conditions de recrutement et les missions applicables aux membres de chaque cadre d'emploi. Ainsi le statut des assistants territoriaux d'enseignement artistique, fonctionnaires de catégorie B, diffère-t-il de celui des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, fonctionnaires de catégorie A. Ces deux cadres d'emplois ne sont pas régis par les mêmes règles, notamment en termes d'accès au corps et de conditions de diplômes.
Si le DUMI permet l'accès au concours externe du cadre d'emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique, il ne permet pas d'accéder au statut de professeur territorial d'enseignement artistique. Cependant, depuis 2007 et à titre dérogatoire, un dispositif d'équivalence pour l'accès à la profession de professeur territorial d'enseignement artistique est prévu au profit des titulaires d'un diplôme universitaire de musicien intervenant. Les titulaires du DUMI peuvent ainsi s'inscrire, dans le cadre de ce dispositif, en vue de l'accès au concours externe de professeur d'enseignement artistique, spécialité musique.
Par ailleurs, le concours interne sur titres et épreuves pour la spécialité musique en vue de l'accès au cadre d'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique est ouvert aux assistants territoriaux d'enseignement artistique justifiant au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de service public effectif. Les formations au diplôme permettant de participer à ce concours interne, notamment dans la spécialité musique, sont précisées par décret et le DUMI fait partie de ces diplômes.
Plus généralement, la ministre de la transformation et de la fonction publiques a confié à MM. Paul Peny et Jean-Dominique Simonpoli une mission portant sur les perspectives salariales dans la fonction publique. Leurs travaux, qui associent les organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des employeurs publics, permettront d'établir un diagnostic commun du système actuel de carrière dans la fonction publique, afin d'envisager de possibles évolutions.

Je vous remercie pour votre réponse. Vous avez évoqué certaines possibilités, mais les choses restent compliquées pour les personnes qui sont en poste, et les carrières des dumistes souffrent réellement d'un manque de perspectives ; c'est pourquoi je souhaite vraiment que cette mission d'information puisse faire avancer les choses.

La parole est à Mme Stella Dupont, pour exposer sa question, n° 1617, relative à l'université d'Angers.

L'université d'Angers a célébré ses 50 ans le 23 novembre 2021, lors d'un événement mettant en valeur la diversité des parcours de ses étudiants ainsi que son engagement pour dispenser un enseignement de qualité. Pourtant, depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) en 2008, l'université peine à bénéficier d'une dotation par étudiant garantissant un niveau satisfaisant d'encadrement. Un plan pluriannuel de rattrapage a été mis en œuvre entre 2013 et 2017, période durant laquelle 141 postes ont été mobilisés. Cela a permis la titularisation de contractuels dans le cadre du dispositif Sauvadet, mais n'a pas eu d'impact réel sur le taux d'encadrement global de l'université.
La situation de sous-encadrement au sein de cette université s'est accentuée ces dernières années en raison de l'augmentation rapide des effectifs d'étudiants, due à l'arrivée des générations 2000 et à l'attractivité croissante de cette université affichant d'excellents résultats. De la campagne d'emploi de 2018 jusqu'à celle de 2021, l'université d'Angers n'a bénéficié d'aucun poste d'État notifié. Elle a toutefois réussi à créer quelques postes – contractuels en majorité –, grâce à une gestion maîtrisée de sa masse salariale, à l'augmentation de ses ressources propres, à l'engagement de sa communauté dans la réponse au plan d'investissement pour l'avenir (PIA) et aux appels à projets de recherche.
J'ai interpellé à plusieurs reprises Mme la ministre de l'enseignement supérieur, et l'université d'Angers s'est elle-même beaucoup mobilisée, obtenant 2 millions d'euros de moyens supplémentaires. Cette enveloppe complémentaire a permis la création de dix postes d'enseignants et enseignants chercheurs sur le plafond d'État, dans le cadre de la campagne d'emploi de 2022. Si cela représente une avancée considérable dont il faut se réjouir, ces 2 millions d'euros ne suffiront pas à rattraper le sous-encadrement structurel que l'université connaît depuis 2008 ni à assurer aux 26 000 étudiants un taux d'encadrement proche de la moyenne universitaire. Afin d'améliorer les conditions de travail des équipes et d'assurer un enseignement de qualité, un engagement pluriannuel de l'État permettrait un rattrapage à la mesure des résultats et du rayonnement de l'université d'Angers. Une telle perspective est-elle envisagée ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire.
Je tiens vraiment à vous assurer que la situation de l'université d'Angers fait l'objet d'un examen attentif de la part du ministère de l'enseignement supérieur. Elle a en effet bénéficié depuis 2018 de ressources nouvelles au titre de la mise en œuvre de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE). Ces financements pérennes s'élevant à 1,7 million d'euros au titre des rentrées 2018 à 2020 ont été attribués en contrepartie d'engagements de l'université à déployer des dispositifs et parcours de réussite des étudiants ainsi qu'à ouvrir des places supplémentaires. Au total, la subvention pour charges de service public allouée à l'université d'Angers a été augmentée de 10 % entre 2017 et 2021 et, si le montant moyen de subvention par étudiant demeurait en 2020 à un niveau inférieur à la moyenne constatée pour les universités pluridisciplinaires comprenant un cursus santé, l'établissement a bénéficié en 2021 d'un soutien financier important, lui permettant de résorber cet écart.
En 2021, la subvention allouée à l'université d'Angers a donc été abondée de 6 millions d'euros. Ces moyens supplémentaires correspondent à un soutien financier, à des financements complémentaires pour la mise en œuvre de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, et à des ressources nouvelles, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche (LPR), à hauteur de 1,5 million d'euros – au titre des moyens aux laboratoires, du financement de nouvelles mesures destinées notamment à améliorer la rémunération et les carrières des personnels de recherche, et de la création de deux chaires de professeur junior ; par ailleurs, dans un souci d'amélioration continue de la qualité de l'enseignement dans le supérieur, dix emplois ont été notifiés à l'université en 2021, à la fois pour renforcer sa politique de recherche et améliorer les taux d'encadrement. Enfin, une participation financière du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) pour le financement de projets validés dans le cadre de la seconde phase du dialogue stratégique et de gestion, constituant une déclinaison concrète des priorités du contrat de site, illustre avec force les efforts de l'établissement pour mettre en œuvre les objectifs conjointement définis avec l'État.
Par ailleurs, en matière immobilière, l'université d'Angers est également soutenue par le MESRI. Neuf opérations immobilières sont inscrites dans le contrat de plan État-région (CPER) 2015-2020 des Pays de la Loire pour l'université, représentant un montant total d'investissements de 29,5 millions d'euros, dont un peu plus de 10 millions d'euros financés par le MESRI.
Comme vous le voyez, l'État est au rendez-vous du développement de l'université d'Angers, particulièrement depuis 2017, après une décennie de gel budgétaire. Le Gouvernement souhaite que cette politique de consolidation des moyens des universités perdure au cours des prochaines années.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie d'avoir rappelé le soutien apporté de manière générale par l'État, mais je me permets d'insister sur le fait que le taux d'encadrement de l'université d'Angers est essentiel à la politique que peut mener une telle université et nécessite un soutien spécifique, ainsi que de la visibilité dans le temps.

La parole est à Mme Aude Bono-Vandorme, pour exposer sa question, n° 1616, relative aux places en instituts médico-éducatifs.

Je souhaite appeler l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées sur le manque de places disponibles au sein des instituts médico-éducatifs (IME) dans mon département de l'Aisne. Bien que, depuis cinq ans, le Gouvernement ait fait du handicap l'une de ses grandes priorités, la question de l'accès à une place en IME pour les enfants reste d'actualité. Je suis consciente de tout le travail réalisé depuis le début du quinquennat et je salue la volonté – je cite Mme Sophie Cluzel – de « normaliser le chemin des élèves handicapés vers l'école pour les regarder désormais comme des élèves en capacité d'apprendre avec les autres. » Il n'en reste pas moins vrai que des difficultés peuvent persister, y compris quand la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) oriente vers ce type d'établissement.
Dans l'Aisne, il existe quinze IME disposant au total d'une capacité de 992 places. Pour la ville-préfecture de Laon, on ne compte qu'un établissement d'une capacité d'accueil de soixante-neuf places. La prise en charge et l'accompagnement adapté des enfants et des jeunes en situation de handicap constituent une source d'inquiétude pour de nombreux parents. Ainsi, trente enfants sont déjà sur liste d'attente, faute de place disponible. Cette attente s'avère particulièrement longue et difficile pour les enfants, évidemment, mais aussi et surtout pour les parents. Dans certains cas, faute de solution adaptée, l'un des parents est même obligé de quitter son emploi pour accompagner son enfant.
Je sais tout l'attachement accordé par Mme Cluzel à la question du handicap et je tiens encore à saluer la qualité du travail mené par son ministère, avec notamment la mise en place de nombreux dispositifs permettant de soulager le quotidien des familles, comme j'ai pu le constater lors de la visite de Mme la secrétaire d'État à Laon. Ainsi, dans le cadre des différents plans nationaux engagés entre 2017 et 2021, il est prévu la création de 1 400 places en IME. Pouvez-vous m'indiquer si cet objectif pourra être réalisé et me préciser le nombre de places qui ont été et seront créées dans l'Aisne ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire.
Madame la députée, je vous remercie pour la justesse de votre question. Si le ministère de l'éducation nationale, que je représente, est pleinement mobilisé aux cotés de Sophie Cluzel pour faire de l'école un lieu d'accueil toujours plus inclusif pour tous nos élèves, j'entends évidemment à travers votre question le désarroi de certaines familles. C'est vrai, il n'y a pas encore une réponse adaptée à chaque enfant, mais nous travaillons vraiment à remédier à cet état de fait, et je tiens à ce que les familles concernées en soient assurées.
Depuis le début du quinquennat, nous travaillons pour sécuriser les parcours des élèves en situation de handicap. Nous avons déployé des équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Ces nouveaux dispositifs ont pour objectif de favoriser la continuité du parcours de l'élève, en apportant un étayage médico-social aux équipes enseignantes. Ces équipes mobiles, organisées en réseau départemental, sont une ressource et un appui précieux pour soutenir les enseignants, et bien souvent pour permettre aux enfants handicapés de poursuivre leur scolarité à l'école.
À la rentrée 2021, 166 équipes mobiles sont mobilisées pour apporter une réponse maillée sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, nous continuons à renforcer les moyens des associations, ce qui a notamment donné lieu au déploiement de nouvelles solutions médico-sociales en 2021.
Dans l'Aisne, environ 600 places relevant des services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et près de 1 000 places en IME ont été créées.
Depuis 2017, nous avons renforcé les moyens alloués dans ce département en le dotant de trois équipes mobiles de soutien à la scolarisation des enfants autistes, avec l'ouverture prévue d'une nouvelle classe à la prochaine rentrée de septembre, de dizaines de nouvelles places de SESSAD, de deux dispositifs d'accompagnement innovants – les pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) –, d'une maison de répit à partir d'avril, mais également de nouvelles places vouées à conforter les parcours des jeunes devenus adultes, dans le cadre du plan de prévention des départs en Belgique, auquel 90 millions d'euros ont été consacrés.
Madame la députée, grâce à toutes ces actions, nous répondons aux situations sur lesquelles vous appelez l'attention, dans le double objectif d'assurer l'inclusion pour tous et d'apporter des solutions adaptées à chacun.

Madame la secrétaire d'État, merci infiniment pour toutes ces précisions. Je sais votre implication, je sais les efforts qui sont fournis depuis quatre ans dans les ministères, mais je vous assure que recevoir des parents dont les enfants n'ont pas de place en IME reste une vraie souffrance, quand on ne peut pas leur en offrir une, quand il faut les entendre nous dire qu'ils vont devoir partir à l'étranger ou quitter leur emploi. En tant que députée, c'est un moment terrible à vivre. Mais je parle peut-être aussi en tant que maman : il faut trouver des solutions pour ces enfants sur liste d'attente qui ont terriblement besoin de vous, de nous.
M. André Chassaigne applaudit.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour exposer sa question, n° 1630, relative à la situation au sein des instituts médico-sociaux en Isère.

Madame la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, je souhaite également appeler votre attention sur la menace qui plane sur la qualité de l'accueil des enfants en situation de handicap, dont l'État a récemment décidé de changer les modalités. En Isère comme ailleurs, ces modifications suscitent à raison l'inquiétude des familles.
L'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la décision de fermer en Isère 200 des 1 200 places en institut médico-éducatif (IME). Ces fermetures visent à transformer les places à temps plein en places à temps partiel afin d'accueillir davantage d'enfants à coûts constants, changement qui va déstabiliser de nombreuses familles.
Il est en effet prévu que les enfants relèvent le reste du temps des services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : ils seront soit accompagnés à domicile, soit en inclusion scolaire, comme le préconise l'ONU. Or il existe d'ores et déjà de très longues listes d'attente pour accéder aux SESSAD. Les familles sont orientées vers des prises en charge libérales qui sont difficiles à coordonner pour l'ensemble de la journée. Le choix du Gouvernement renvoie donc aux familles la charge de l'accompagnement de leurs enfants, de la coordination des interventions des professionnels ou encore de l'organisation des transports. Celles-ci risquent donc de se retrouver encore plus isolées qu'elles ne le sont déjà.
Le recours accru au temps partiel en IME permet certes de prendre en charge d'avantage d'enfants, mais il augmente aussi le risque de désocialisation pour ceux qui passeront le reste du temps à la maison. Quant aux enfants qui seront inclus dans les écoles, ils se heurteront au manque de moyens de l'éducation nationale en matière d'accueil du handicap. Les enseignants redoutent d'ailleurs de ne pas pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions face au manque de formation et à la pénurie d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH).
Des parents très inquiets pour l'avenir de leurs enfants s'organisent, se mobilisent pour faire entendre leur voix car ces fermetures se font sans concertation : il n'y a de discussion ni avec les familles, ni avec les gestionnaires des établissements qui sont mis en demeure de s'exécuter pour obtenir leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM).
Madame la secrétaire d'État, il est nécessaire de renforcer et d'améliorer la prise en charge des enfants en IME et en SESSAD. Pour cela, il faut écouter et entendre les familles et les professionnels du secteur qui ne demandent qu'à être associés aux réflexions pour avancer sur ces sujets.
Comment le Gouvernement entend-il répondre aux inquiétudes fortes que ceux-ci expriment ? Quel est votre plan pour répondre aux besoins des parents pour lesquels le maintien à domicile n'est pas une solution possible, compte tenu du handicap de leur enfant ou simplement parce qu'ils travaillent ? Comment se fera la prise en charge médicale, paramédicale, scolaire et sociale des enfants ? Enfin, quels moyens le Gouvernement compte-t-il donner à l'éducation nationale pour accueillir et répondre aux besoins particuliers des enfants porteurs de handicap à l'école ?
Sans réponse adaptée, la prise en charge « hors les murs », ne pourra se faire qu'au détriment des enfants et de leurs familles.

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire.
Madame Battistel, merci pour votre question qui se situe dans la continuité de celle de votre collègue. Nous œuvrons collectivement pour une société toujours plus inclusive, et j'entends le désarroi de ces familles qui ne trouvent pas de solutions pour leurs enfants. Vous excuserez le caractère un peu technique de ma réponse. J'aurais aimé pouvoir manifester plus d'empathie s'agissant d'un enjeu profondément humain.
La transformation de l'offre d'accompagnement en direction des personnes en situation de handicap dans laquelle nous nous sommes engagés se fonde sur la prise en compte des besoins et des attentes des enfants et de leurs familles. Cette politique d'adaptation de l'offre n'est pas une option et nous nous y attelons chaque jour. Partant des besoins des territoires, en concertation avec les associations et avec les ARS, nous mettons au point des solutions en matière d'offre médico-sociale.
Dans ce cadre, il n'a jamais été question de dégrader l'offre d'accueil en supprimant 200 places d'IME en Isère, pas plus qu'il n'a été envisagé de faire reposer le poids de l'accompagnement et de la coordination médico-sociale sur les familles. Il s'agit de réorienter les moyens alloués aujourd'hui de modalités d'accueil peu demandées par les parents et les enfants…
…vers des dispositifs davantage sollicités. On note, par exemple, une moindre demande des parents pour l'accueil en internats, lesquels, selon les secteurs, affichent des taux d'activité de l'ordre de 60 %. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de places vacantes. C'est pourquoi nous transformons des places d'internat en places d'accueil de jour ou encore de SESSAD. C'est ce que demandent les familles et c'est ce que nous souhaitons leur proposer.
Ainsi près de soixante et une places d'IME vont-elles être réorientées, et non pas supprimées, pour être transformées en places d'accompagnement spécialisé répondant davantage aux besoins exprimés par les familles. Il s'agit d'une transformation inclusive, qui se traduit par la création de 185 places, notamment en SESSAD.
Par ailleurs, les moyens relatifs à l'inclusion sont développés. Le département de l'Isère est entièrement couvert par les équipes mobiles d'appui à la scolarisation, qui ont pour but de renforcer la scolarisation des élèves en situation de handicap, en apportant une expertise et des ressources aux professionnels de l'éducation nationale. Le département possède également deux unités d'enseignement en maternelle autisme (UEM) et une unité d'enseignement en école élémentaire autisme (UEEA), qui viennent compléter les possibilités de scolarisation des jeunes enfants.

Madame la secrétaire d'État, on perçoit, à vous entendre, une motivation forte de votre part, qui traduit votre engagement. Ce que vous dites, c'est très bien sur le papier mais, sur le terrain, il se passe tout autre chose. La réorientation conduit à ne prendre en charge les enfants que sur des durées très limitées. Le reste de la journée, la charge de l'organisation repose sur les parents, ce qui n'est pas du tout acceptable. En Isère, les familles sont en profonde détresse. Je peux vous dire que c'est un sujet de préoccupation majeur. Il faut engager beaucoup plus de moyens et ouvrir davantage de places en IME.

La parole est à M. André Chassaigne, pour exposer sa question, n° 1608, relative aux ateliers et chantiers d'insertion et au financement européen.

Je souhaite appeler l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le financement des ateliers chantiers d'insertion par l'axe 3 du programme opérationnel national du fonds social européen (FSE) en période de crise sanitaire liée au covid.
Alors que les confinements ont provoqué une importante baisse d'activité, qui a entraîné une diminution des recettes, les aides au chômage partiel ont élevé artificiellement le montant des subventions sans permettre de rééquilibrer les budgets.
Ainsi, l'association Détours, basée à Cunlhat dans le Puy-de-Dôme, a-t-elle dû renoncer à l'intégralité des versements FSE au titre de 2020. Portant sur cinq chantiers, la perte est de 152 000 euros dont 52 000 euros d'avances à rembourser. Le budget de l'association sera ainsi amputé de 10 % de ses recettes, ce qui remet en cause l'équilibre financier de la structure.
Alors que le FSE est le principal instrument financier de l'Union européenne dans sa stratégie publique pour l'emploi et l'inclusion sociale, et qu'il constitue à ce titre une source de financement essentielle pour le secteur de l'insertion par l'activité économique, de nombreuses structures voient leur équilibre financier mis en péril et sont menacées dans leur pérennité. Ces problèmes conjoncturels s'ajoutent aux difficultés structurelles : délais d'obtention et de versement des subventions FSE, lourdeur des dossiers à constituer, rigueur excessive des contrôles exercés par les services gestionnaires. Il apparaît même que c'est une spécificité française.
Il est indispensable que la programmation 2021-2027 de FSE puisse enfin s'accompagner d'un réel allégement des procédures, qui découragent aujourd'hui de nombreux acteurs, notamment dans le domaine de l'insertion, et qui entraînent une sous-consommation des crédits du fonds dans notre pays.
Quelle solution allez-vous apporter au blocage des subventions FSE dû à la crise sanitaire ? Si aucune n'est trouvée, quelles mesures compensatoires seront mises en œuvre ? Enfin, plus largement, quelles évolutions concrètes la France compte-t-elle encourager pour faciliter la gestion du FSE ?
Je vous remercie pour cette question relative au financement des ateliers et chantiers d'insertion par le FSE. C'est l'occasion pour moi de revenir sur le fonctionnement de ce fonds, sur la situation de l'association Détours et d'évoquer aussi mes actions en la matière.
Les fonds européens ne peuvent être mobilisés que pour rembourser les dépenses effectivement engagées par les structures bénéficiaires. Or, l'activité partielle était prise en charge par l'État. Par ailleurs, ces structures ont pu compter sur une Europe qui protège, avec l'augmentation des fonds européens liée à l'initiative de soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe (REACT-EU) : 55 milliards ont été déployés au plus près des territoires pour soutenir la reprise.
S'agissant des blocages rencontrés par l'association Détours, il faut souligner que le FSE ne dépend pas directement de l'État mais du conseil départemental, qui en a la gestion. Le conseil départemental du Puy-de-Dôme a d'ailleurs bien mis en place des mesures compensatoires spécifiques pour les ateliers et chantiers d'insertion, notamment grâce au fonds REACT-EU. Il semblerait que l'association Détours n'ait pas encore finalisé son dossier pour pouvoir en bénéficier.
En tant qu'élue locale pragmatique, j'ai pu constater l'apport majeur du FSE pour l'insertion mais aussi les réelles difficultés, il faut le dire, pour y accéder. C'est pourquoi j'ai souhaité, dès mon arrivée au ministère, simplifier son fonctionnement. Nous y sommes parvenus en mettant en place un fonds d'avances de l'État pour la nouvelle programmation afin de réduire le délai de paiement pour les structures, en facilitant les démarches de recours grâce à la dématérialisation, en permettant aux territoires volontaires qui étaient jusqu'alors des zones blanches du FSE d'en bénéficier et enfin en définissant avec les réseaux un périmètre de dépenses cofinancées par le FSE favorable aux chantiers d'insertion. Par-là, j'ai voulu accroître l'attractivité de ces fonds pour les structures d'insertion.
Je reste évidemment à votre disposition, monsieur le président Chassaigne, si vous souhaitez davantage de précisions.

Je vous remercie, madame la ministre déléguée, pour cette réponse précise, et je forme le vœu que les efforts destinés à améliorer la gestion des fonds FSE en France se concrétisent. En matière de financements européens, la France est, semble-t-il, le pays qui rencontre le plus de difficultés. Les lourdeurs administratives sont telles que certaines structures ont renoncé à déposer des dossiers.
Je peux vous citer un autre exemple, celui de la mission locale du Livradois-Forez, que j'ai présidée pendant de nombreuses années, qui en est arrivée au point de renoncer à toucher une subvention de 13 000 euros ! La masse des justificatifs demandés décourage totalement les acteurs de terrain. L'allégement de procédures doit être une priorité, comme vous l'avez vous-même souligné. J'espère que les efforts en ce sens se concrétiseront dans les années à venir.

La parole est à M. Jean-Luc Lagleize, pour exposer sa question, n° 1602, relative aux difficultés persistantes dans la mise en place des zones à faible émission

Ma question, qui s'adresse au ministre délégué en charge des transports, porte sur les imprécisions réglementaires qui persistent autour de la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) et sur les difficultés qu'elles induisent pour les collectivités.
Toulouse Métropole prévoit d'instaurer de manière imminente sa propre ZFE. Celle-ci s'étend sur les trois quarts de la commune dont la rocade ouest, interne à la ville, ainsi qu'une petite partie de Colomiers et de Tournefeuille, soit un périmètre global de 72 kilomètres carrés. Par ailleurs, les restrictions de circulation dans cette ZFE sont prévues vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
La loi d'orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019 précise bien que les collectivités locales concernées par la mise en place d'une ZFE disposent d'une totale liberté dans la définition des modalités de restriction de circulation, et nous constatons que certaines villes ont adopté des mesures de transition plus progressives que d'autres.
À Paris, qui concentre pourtant une pollution très importante, l'interdiction des véhicules polluants dans la ZFE ne s'applique qu'en semaine et de huit heures à vingt heures ; en outre, les véhicules de collection bénéficient d'une dérogation, ce qui est aussi le cas à Grenoble – ville particulièrement polluée – ou encore à Strasbourg, où l'eurométropole a également instauré un dispositif permettant aux usagers qui ne disposent pas d'un véhicule agréé d'accéder à la ZFE, de façon ponctuelle, en cas de nécessité. La libre appréciation des collectivités territoriales génère donc des interprétations très diverses, ce qui rend difficile pour les communes de connaître leurs prérogatives et compromet parfois l'acceptation sociale de ces zones.
De nombreuses questions se posent concernant leur périmètre, les véhicules visés, les jours et heures d'exclusion. Le décret d'application de la loi LOM, annoncé pour septembre dernier, n'est, à ma connaissance, toujours pas paru. Pourriez-vous nous indiquer la date de publication envisagée pour ce décret et nous éclairer au sujet de son contenu ? Par ailleurs, quelles seraient vos recommandations aux décideurs locaux en matière de modalités d'application du texte, afin que les ZFE soient créées dans les métropoles d'une façon progressive, mesurée et socialement acceptée ?
Monsieur Lagleize, vous interrogez le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari : celui-ci, étant absent, m'a chargée de vous répondre.
Les ZFE constituent un outil à la main des collectivités en vue d'améliorer la qualité de l'air respiré par nos concitoyens. Ce sont donc ces collectivités qui en définissent le périmètre d'application, les critères et les échéances retenues. Les étapes de concertation et d'information prévues par le code général des collectivités territoriales visent à permettre la prise en compte des contraintes des acteurs économiques et des populations locales, en adaptant par exemple, comme vous l'avez dit, les horaires de restriction.
La LOM a rendu obligatoire la création d'une ZFE avant le 31 décembre 2020 dans les territoires où les normes de qualité de l'air ne sont régulièrement pas respectées. Un décret du 16 septembre 2020 a précisé les modalités d'application de ces dispositions, qui concernaient une dizaine de métropoles, dont celle de Toulouse. Depuis, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fourni un socle minimal au schéma de restriction de circulation qui doit s'appliquer dans ces zones ; elle impose également la création d'une ZFE avant le 31 décembre 2024 dans les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants. Un décret définira prochainement les modalités transitoires applicables aux métropoles qui n'avaient pas encore satisfait à la LOM lors de la publication de la loi « climat et résilience ».
L'État met à la disposition des collectivités territoriales des statistiques de répartition du parc automobile par vignette Crit'Air, ce qui leur permet de définir une trajectoire de restriction de circulation ambitieuse, mais réaliste et socialement acceptable, afin que les normes de qualité de l'air soient respectées dans les délais les plus courts. Il continue également de soutenir les territoires qui souhaitent ou qui doivent créer une ZFE : vingt-trois territoires, investis dans une démarche de faisabilité de développement d'une ZFE, font ainsi l'objet d'une attention régulière, d'un suivi et d'une animation spécifiques.

La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo, pour exposer sa question, n° 1638, relative aux tuk-tuk havrais.

Comme un certain nombre d'autres grandes villes françaises, Le Havre voit fleurir les tuk-tuk, ces véhicules de transport légers. Depuis juin dernier, la toute jeune société havraise T'tuktuk ?, lancée par Alban Collet et forte d'une dizaine de véhicules électriques, propose de faire découvrir la ville, à partir des parcours détaillés par une guide conférencière havraise, aux nombreux touristes ou aux habitants désireux de voir la cité océane sous un autre jour.
Très apprécié des uns comme des autres, ce projet novateur est cependant affecté par un vide juridique. En effet, cette activité est considérée comme impliquant des véhicules motorisés à deux ou trois roues (VMDTR) et doit donc se conformer à la réglementation en la matière. Or un tuk-tuk n'est pas tout à fait un taxi-moto, et nous n'avons pas affaire à un simple transport de personnes mais à des balades touristiques. La réglementation appliquée aux tuk-tuk en France se trouve donc inadaptée aux services proposés. Aussi, je souhaiterais que vous m'indiquiez quelles mesures rapides vous envisagez afin que cette activité touristique puisse reprendre en toute légalité.
Madame la députée, le ministre délégué chargé des transports m'a chargée de vous répondre.
Même assorti de commentaires touristiques, le transport de personnes par les véhicules communément appelés tuk-tuk relève bien des règles du transport public particulier de personnes. Au niveau réglementaire, ces activités sont donc soumises aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-5 du code des transports. Ce cadre juridique précis répond à deux exigences principales : d'une part, assurer la sécurité des passagers et des autres usagers de la route ; d'autre part, garantir des conditions de concurrence équilibrées entre les opérateurs. C'est pourquoi les conducteurs de ces VMDTR doivent posséder une carte professionnelle, les opérations entrer dans le cadre de la réservation préalable et les véhicules respecter la signalétique définie par le code des transports.
À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer ces règles, qui sont adaptées aux enjeux évoqués à l'instant – sécurité et équilibre de la concurrence. Afin de prévenir toute différence de traitement, elles ont d'ailleurs été rappelées aux préfets, qui veilleront à leur bonne application sur l'ensemble du territoire national.

La parole est à M. Stéphane Testé, pour exposer sa question, n° 1609, relative à MaPrimeRénov'.

Madame la ministre déléguée, je souhaite appeler votre attention sur les retards constatés dans le traitement des dossiers MaPrimeRénov' par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en Seine-Saint-Denis, retards au sujet desquels j'ai été alerté tant par des habitants que par des professionnels.
Depuis son lancement en janvier 2020, cet excellent dispositif a incité de nombreux ménages à engager des travaux de rénovation énergétique. Dans mon département, le versement de l'aide, je le répète, a parfois pris du retard. Pourtant, au premier abord, le dispositif paraît clair, accessible : il suffit de créer un compte sur www.maprimerenov.gouv.fr, de renseigner des informations sur ses revenus, son logement, de détailler les travaux envisagés et de transmettre le devis de l'artisan retenu. Aussitôt la demande finalisée, l'ANAH procède à sa vérification. Si elle est jugée recevable, une notification confirmant l'attribution de la prime et son montant est envoyée. La subvention est ensuite versée à la fin des travaux, après l'envoi de la facture.
Dans les faits, de nombreux foyers attendent son versement depuis plusieurs mois, alors que le délai annoncé est de deux mois au maximum. Ces retards, dus aux couacs et autres bugs qui ont bloqué les dossiers, entraînent des conséquences sérieuses pour les entreprises du secteur de la rénovation énergétique, ainsi que pour les artisans locaux et les bénéficiaires eux-mêmes. En outre, ils dissuadent les ménages précaires d'engager des opérations de rénovation pourtant nécessaires. D'autres particuliers regrettent l'absence d'explications et de visibilité concernant la date du versement ; ils se plaignent de la complexité de la procédure et du fait que le montant de la prime est parfois revu après la validation du dossier ; ils manquent d'interlocuteurs pour obtenir les renseignements indispensables, signalent des temps d'attente importants lors des appels, et une certaine opacité de la plateforme.
Je souhaiterais donc savoir quelles actions envisage le Gouvernement pour pallier ces dysfonctionnements et accélérer le traitement des dossiers MaPrimeRénov' en Seine-Saint-Denis.
Vous l'avez dit : depuis son lancement en 2020, le dispositif MaPrimeRénov' rencontre un succès incontestable. Les Français sont au rendez-vous de la rénovation énergétique, et nous pouvons en être fiers. En 2021, près de 760 000 dossiers ont été déposés, près de 660 000 engagés, pour un montant considérable – plus de 2 milliards d'euros – ; 99 % des dossiers complets sont traités en vue de leur engagement dans les quinze jours ouvrés ; 60 % le sont dans le même délai en vue du paiement, le tout en tenant compte des contrôles ciblés destinés à lutter contre la fraude. Les résultats des enquêtes de satisfaction sont significatifs : 87 % des bénéficiaires se déclarent satisfaits du dispositif, 92 % du montant de l'aide obtenue, et 71 % n'auraient pas entrepris de travaux sans MaPrimeRénov'.
Toutefois, vous avez raison de souligner qu'en Seine-Saint-Denis, comme, d'ailleurs, dans d'autres départements, des bugs informatiques et l'importance de la demande ont pu entraîner d'importants retards de traitement. C'est là un problème que j'ai identifié il y a quelques mois, en lien avec l'ANAH, et que nous travaillons à résoudre avec la plus grande détermination. J'ai ainsi demandé à l'ANAH – qui a créé une équipe à cette fin – de régulariser au plus vite ces dossiers, dont certains sont en attente depuis des mois, bloqués à la suite d'un problème technique de la plateforme ou requérant un traitement individualisé en raison de difficultés d'instruction.
Les dossiers concernés représentaient à la fin de l'année 2021 environ 0,5 % des dossiers déposés, contre 12 % en février, c'est-à-dire que leur proportion a très fortement décru ; en outre, toujours fin 2021, l'équipe a été renforcée, si bien que la moitié des dossiers encore en souffrance en décembre ont pu être débloqués en ce début d'année, et les primes enfin versées aux ménages, qui sont systématiquement informés par téléphone ou courriel. L'ANAH a reçu pour objectifs d'achever de traiter ce stock courant janvier et surtout de pérenniser le traitement particulier de tels dossiers, avec une communication adaptée vis-à-vis des ménages, ainsi qu'une gestion des bugs qui évitera que le cas ne se reproduise.
Comme vous le voyez, nous sommes attentifs à la massification du dispositif, mais aussi au traitement des cas particuliers ; en effet, un dossier bloqué met en difficulté à la fois le ménage, qui n'obtient pas sa prime, et l'entreprise, qui n'est pas payée. Heureusement, je le répète, leur stock est réellement en voie de résorption.

Je tenais à vous remercier, madame la ministre déléguée, pour votre réponse détaillée et rassurante. Nous améliorerons ainsi un dispositif dont l'utilité et l'efficacité ne sont plus à démontrer.

La parole est à M. Stéphane Buchou, pour exposer sa question, n° 1613, relative au manque de logements en Vendée.

Ma question porte sur l'épineux problème du logement en Vendée, plus particulièrement en Vendée littorale. La construction s'y porte bien, très bien même, notamment dans les communes de la bande côtière, qui constituent l'essentiel de ma circonscription ; en contrepartie, sous les effets conjugués d'une activité touristique substantielle, de l'installation de nombreux retraités de fraîche date et du désir d'espace suscité par les confinements chez de jeunes actifs pour qui le télétravail constitue une option viable, la pression foncière devient intolérable aux salariés les plus modestes. Les plus jeunes, notamment ceux qui entrent dans le monde du travail, ne trouvent pas à se loger, même en location. Beaucoup d'entreprises voient leurs plans de développement freinés, faute de pouvoir embaucher. Croyez-moi : je suis interpellé à ce sujet lors de chacune de mes visites sur le terrain !
Non seulement le logement social ne peut absorber la demande croissante, mais cette dynamique de la construction privée, individuelle ou collective, est telle qu'il devient impossible aux communes de mettre en chantier un nombre suffisant de logements sociaux pour augmenter leur proportion et diminuer ainsi l'écart avec l'objectif de 20 % imposé par la loi. Tout au plus peuvent-elles espérer maintenir la proportion déjà atteinte. En 2021, dans le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour 1 286 logements sociaux, tous occupés, plus de 700 demandes étaient en attente ; fin 2021, le département totalisait 14 000 de ces demandes. Le délai d'attente s'élève à seize mois en moyenne et vingt-deux mois dans l'agglomération des Sables-d'Olonne. Dans le même temps, le taux de résidences secondaires est de 40 % dans cette même agglomération et de 67 % sur l'île de Noirmoutier !
Pour tenter de réorienter des résidences secondaires ou des logements vacants vers l'offre de logements à l'année, l'agglomération des Sables-d'Olonne se lance dans une politique de taxation : taxe annuelle sur les logements vacants, ce qui nécessite au préalable d'être reconnu par l'État en tant que secteur tendu – la demande est en cours –, et majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. D'autres stations balnéaires pourraient lui emboîter le pas.
Pour ma part, je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse là d'une politique de l'habitat efficiente et pérenne. Les effets attendus de ces taxes resteront marginaux ; elles ne peuvent être, au mieux, que l'un des instruments d'une panoplie plus large.
Madame la ministre déléguée, ce problème constitue un enjeu majeur pour l'avenir de notre territoire. Pouvons-nous imaginer des outils globaux qui diminuent la pression foncière, pour le bien-être des habitants, dans un territoire à la fois très recherché et très contraint par les conséquences du changement climatique ainsi que par l'objectif de réduire à zéro l'artificialisation nette des sols ?
Vous appelez mon attention, monsieur le député, sur les difficultés d'accès au logement social et au logement en général en Vendée. J'ai été sensibilisée à cette question pour en avoir discuté avec les élus, lorsque je me suis rendue dans ce département il y a plusieurs mois. Tous sont mobilisés pour que le problème de l'accès au logement ne se transforme pas en un goulot d'étranglement qui nuirait à l'attractivité, très forte, de la Vendée. En 2021, 962 nouveaux logements sociaux ont été agréés dans le département, ce qui correspond à 99 % de l'objectif fixé. Cela démontre une très bonne performance, une capacité à reprendre une trajectoire ambitieuse de production de logement social ainsi qu'une forte mobilisation des bailleurs, notamment des grands groupes.
Cette mobilisation pourra se poursuivre en 2022, puisque les moyens alloués par l'État à l'agrément de logements sociaux seront maintenus et que le montant des aides à la pierre sera encore largement bonifié dans le cadre de l'accord conclu entre l'État et Action logement début 2021. Le logement social est l'une des solutions pour répondre à la tension sur le marché du logement en Vendée et, même si elle n'est pas la seule, cette solution est aujourd'hui pleinement mobilisée.
Un autre élément de réponse important est la mise à disposition de foncier constructible. Celui-ci reste un facteur déterminant – en particulier, comme vous l'avez souligné, dans la zone littorale. Il s'agit en l'occurrence de mobiliser pleinement l'établissement public foncier de Vendée, qui se remet à disposition des territoires pour mener les politiques foncières les plus ambitieuse possible, dans le but de créer des réserves foncières pour les allouer ensuite à des projets de construction immobilière.
Pour cela, il faut cependant que les communes puissent délivrer des permis de construire pour des logements, qu'ils soient sociaux ou non – un point qui a constitué un facteur très limitant à l'échelle nationale en 2020 et même en 2021. C'est pourquoi, à la suite des travaux de la commission présidée par François Rebsamen sur la relance de la construction et pour répondre à votre souhait d'une réponse plus globale, le Gouvernement a mis en place des mécanismes incitatifs à destination des collectivités afin de leur garantir des recettes nouvelles à proportion des logements créés. Le logement social bénéficie ainsi de la compensation intégrale de l'exonération de taxe foncière pour une durée de dix ans, et un mécanisme similaire est prévu pour le logement intermédiaire. Les collectivités, communes et intercommunalités auront aussi la possibilité de signer avec l'État des contrats de relance du logement, au travers desquels sera octroyée une aide à tous les logements collectifs autorisés. Ces mesures nouvelles sont autant d'outils supplémentaires qui soutiendront l'effort de construction des collectivités, tout en respectant nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols.
C'est l'ensemble de ce panel d'outils que nous devons mobiliser pour favoriser la construction, retrouver des emprises foncières et permettre aux collectivités de financer l'équilibre des projets ainsi que les équipements qui doivent les accompagner. J'ai confiance en notre capacité à atteindre nos objectifs grâce à la mobilisation de tous ces outils, y compris en Vendée.

Je vous remercie pour vos réponses, madame la ministre déléguée. Néanmoins, la question des logements vacants et des résidences secondaires se pose réellement. Je vous invite à venir en Vendée, dans la bande littorale, à la rencontre des élus et des chefs d'entreprise, avec qui j'échange régulièrement et pour lesquels il s'agit d'un vrai problème.

La parole est à Mme Florence Lasserre, pour exposer sa question, n° 1601, relative à la nécessité d'un meilleur financement de la rénovation du bâti existant.

La loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a fixé un objectif national de « zéro artificialisation nette » d'ici 2050. L'artificialisation des sols augmente les temps de déplacements, éloigne des emplois et des services publics et fait perdre leur attractivité à nos centres-villes. Surtout, elle réduit les espaces naturels et agricoles, accroît la vulnérabilité de nos territoires aux catastrophes naturelles comme celle que nous avons subie le mois dernier, et détruit la biodiversité. Je suis donc fière de cette avancée collective qui empêchera l'artificialisation de milliers d'hectares d'espaces naturels, agricoles ou forestiers comme il en disparaît chaque année.
La protection de nos terres ne doit toutefois pas se faire au détriment de la capacité des citoyens à se loger. Nous connaissons les difficultés que rencontrent un nombre croissant de Français pour trouver un logement décent à un prix raisonnable. Vous le savez, madame la ministre déléguée : ce problème est particulièrement pressant au Pays basque, qui connaît une crise du logement sans précédent. Il existe, pour faire face à cette situation, un éventail d'outils sur lesquels nous avons eu l'opportunité de nous pencher lors de l'examen du projet de loi 3DS – relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique local : plafonnement des loyers, bail réel solidaire (BRS) et taxation des résidences secondaires, pour n'en citer que quelques-uns.
Il existe un autre levier simple, qui permet à nos territoires de disposer de nouveaux logements sans artificialiser leurs sols. C'est la rénovation de l'immobilier existant, ancien et abandonné, la réhabilitation des résidences insalubres et la requalification des friches à l'abandon.
Certes, la rénovation d'une grange pour la transformer en logements coûte bien souvent plus cher qu'une construction neuve. Mais nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir pour objectifs à la fois de diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols, au cours de la décennie à venir, et de bétonner pour produire des solutions de logement. Cela est d'autant moins possible qu'il nous faudra loger de plus en plus de monde sur une planète qui, quant à elle, ne peut pas changer de taille selon notre bon vouloir. Il faut donc à tout prix utiliser notre bâti existant, insalubre, vieux et sans usage, pour le recycler en logements.
La mobilisation massive de l'État est nécessaire car, pour rénover plutôt qu'artificialiser, il va falloir des financements. Sans cela, nous n'arriverons pas à tenir l'objectif de réduction de l'artificialisation que nous nous sommes fixé. Nous avons déjà fait de grands pas dans la bonne direction avec la rénovation énergétique, le plan de relance et des appels à projets, mais il faut aller plus loin.
Madame la ministre déléguée, quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour financer ces rénovations, afin de parvenir à diviser par deux le rythme d'artificialisation au cours des dix prochaines années ?
Vous l'avez rappelé, madame la députée : la loi « climat et résilience » fixe l'objectif d'atteindre « zéro artificialisation nette » en 2050. Cette loi dessine une trajectoire très progressive consistant à diviser par deux le rythme de consommation de terres naturelles et agricoles dans les dix prochaines années, puis de poursuivre cet effort jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. C'est un objectif sur lequel nous travaillerons avec les collectivités locales dans une approche très territorialisée – le Premier ministre a eu l'occasion de le rappeler dans une circulaire récente aux préfets –, afin que l'artificialisation, qui décroît de façon globale, le fasse à un rythme différencié selon la situation et les besoins des territoires.
La lutte contre l'artificialisation des sols doit s'accompagner d'une politique volontariste en faveur du développement du logement, pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Mes discussions régulières avec les élus, du Pays basque notamment, me permettent de mesurer la sensibilité du sujet sur ce territoire comme ailleurs. Nous accompagnons donc notre politique d'un effort sur le bâti existant, d'abord avec le dispositif fiscal « Louer abordable », dont l'objectif est de convaincre des propriétaires de mettre en location des biens existants grâce à une rentabilité fiscale améliorée lorsque les loyers sont inférieurs au prix du marché ; c'est une manière de lutter contre la spéculation foncière. Nous avons également prévu, dans le projet de loi 3DS, la prolongation de l'expérimentation sur l'encadrement des loyers et la possibilité, pour de nouvelles collectivités locales qui le souhaiteraient, de se porter candidates.
Vous avez raison de souligner, madame la députée, que la rénovation de l'existant est absolument clé. Notre soutien à cette démarche passe par les programmes Action cœur de ville et Petites villes de demain, qui permettent de concentrer des financements, notamment de la Caisse des dépôts et d'Action logement, sur la rénovation. Le fonds pour le recyclage des friches permet par ailleurs la création de 100 000 logements supplémentaires dans d'anciennes friches, au travers de deux appels à projet successifs, dans le cadre desquels près de 1 100 opérations ont été validées. Ce fonds, qui a atteint 650 millions d'euros en 2021, est pérennisé en 2022 ; une première enveloppe de 100 millions d'euros a ainsi été annoncée samedi dernier par le Premier ministre.
Il faut citer enfin l'effort général de rénovation, mené notamment dans le cadre de programmes, spécifiques à l'ANAH, de requalification des centres-villes et de rénovation de l'habitat, y compris insalubre. Quant à MaPrimeRénov', cette aide plus large est maintenant ouverte non seulement aux propriétaires occupants mais aussi aux propriétaires bailleurs.
Certaines dispositions sont encore en discussion dans le cadre du projet de loi 3DS, dont j'espère qu'il fera l'objet d'une CMP (commission mixte paritaire) conclusive. Au total, l'ensemble de ces mesures est au service d'une politique du logement n'opposant pas la préservation des terres naturelles et agricoles au développement de logements, qui vise à répondre aux besoins de nos concitoyens.
Suspension et reprise de la séance
La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à dix heures vingt.

La parole est à M. Vincent Rolland, pour exposer sa question, n° 1624, relative à l'attractivité du secteur médico-social.

Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie, je souhaite vous interroger sur la situation des professionnels du secteur social et médico-social.
Le secteur traverse actuellement une crise grave et profonde, tout particulièrement les établissements associatifs privés. Pour ce qui est du secteur public en effet, un complément de traitement indiciaire de 183 euros net mensuels a été accordé, et la grille des salaires a été revue et corrigée pour le personnel soignant, dans le cadre du Ségur de la santé. Certains départements, comme la Savoie, ont d'ailleurs appliqué cette augmentation dès le printemps dernier. La majorité des personnels des établissements associatifs privés sont, quant à eux, exclus de ces mesures, alors que leur mission s'exerce auprès des mêmes populations.
L'annonce faite par le Premier ministre début novembre que ce complément de 183 euros bénéficierait notamment aux soignants et aux aides médico-psychologiques des établissements du secteur du handicap, quelle que soit l'autorité compétente, est une réponse partielle mais insuffisante. Que compte faire le Gouvernement pour mettre fin à cette injustice et faire en sorte qu'à travail égal il y ait salaire égal ?
Plus généralement, pour le public comme le privé, la question des rémunérations est au cœur du déficit d'attractivité de ces métiers. Nous observons actuellement des situations inouïes, des structures devant fermer pendant quelques jours, faute de professionnels disponibles, contraignant des familles à s'occuper de leurs proches à domicile dans des conditions évidemment très compliquées. C'est pourquoi, après l'urgence de la revalorisation salariale, il y a également urgence à agir pour que, dans quelques mois ou quelques années, nous ayons formé suffisamment de personnels pour répondre aux besoins. Dans cette optique, je souhaite également connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour inciter de futurs soignants à s'inscrire dès maintenant dans les filières de formation du médico-social.
Monsieur le député, le Gouvernement a pris des engagements forts pour assurer une reconnaissance pleine et entière de tous les personnels, tant du public que du privé. La reconnaissance des soignants s'est traduite de façon prioritaire par l'instauration d'un complément de traitement indiciaire d'un montant de 183 euros net au bénéfice des personnels des établissements de santé et des EHPAD. La mesure a été étendue en 2021 par la signature de trois accords de méthode, dans le cadre de la mission confiée à Michel Lafourcade.
Ces mesures ont été reprises par l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui étend également, à l'initiative du Gouvernement, le bénéfice de la mesure socle aux personnels soignants, auxiliaires de vie sociale, aides médico-psychologiques ou chargés de l'accompagnement éducatif et social, qui exercent dans ces établissements et dans les services accompagnant les personnes handicapées, financés par les conseils départementaux, les accueils de jour autonomes et les résidences autonomie.
L'entrée en vigueur de la mesure a été avancée pour le secteur privé au 1er novembre 2021. S'agissant du secteur non lucratif, ces dispositions ont d'ores et déjà fait l'objet de transpositions dans des textes conventionnels, signés par le Gouvernement début janvier. Le secteur de l'aide à domicile n'est pas en reste, l'avenant 43 ayant permis une revalorisation historique de ses rémunérations de 13 à 15 %. Les structures qui ne relèvent pas de cette convention collective peuvent néanmoins bénéficier d'un tarif socle de 22 euros, ce qui était leur revendication principale, ainsi que de la dotation qualité, qui va rehausser le prix de l'heure de 3 euros. C'est autant de moyens supplémentaires pour leur permettre de revaloriser le salaire de leur personnel.
Pour faire face aux besoins de recrutement que vous évoquez, nous avons augmenté cette année de 12 600 le nombre de places dans les formation d'aides-soignants, d'infirmiers, d'accompagnement éducatif et social ; un partenariat entre Pôle emploi, les ARS et les régions permet d'orienter les demandeurs d'emploi vers ces métiers en tension depuis très longtemps.
Enfin le Premier ministre a annoncé la tenue d'une conférence sociale dédiée aux autres catégories professionnelles que vous évoquez, qui comptent surtout des travailleurs sociaux.

La parole est à M. Pierre Morel-À-L'Huissier, pour exposer sa question, n° 1633, relative à la prime Ségur dans les secteurs sanitaire et médico-social.

La question que je vais vous poser est un peu de la même veine que la précédente. Je voudrais à cette occasion rendre hommage à tous les soignants et tous les personnels des EHPAD, des centres pour personnes handicapées et des hôpitaux – en Lozère, nous comptons quarante-neuf centres pour personnes en situation de handicap et vingt-sept EHPAD.
Le Ségur de la santé était une bonne initiative mais qui pose aujourd'hui un certain nombre de questions, notamment celle de l'appartenance à tel ou tel établissement, ou du statut – selon que les personnels relèvent de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, des conventions collectives 51 ou 66, du secteur sanitaire ou médico-social, qu'ils soient soignants, infirmiers, infirmières, éducateurs, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, personnels administratifs, personnels techniques, travailleurs sociaux.
Aujourd'hui les annonces du Gouvernement et l'affectation de crédits créent des distorsions entre établissements et des disparités entre salariés. Cela concerne également les hôpitaux de proximité. Je souhaiterais donc une clarification sur la répartition des crédits entre ces structures, qu'il s'agisse des aides de l'État ou des dotations des départements.
Je tiens d'abord à rappeler que le Ségur de la santé s'adressait prioritairement aux personnels de santé dont la solidarité nationale souhaitait revaloriser la rémunération. Puis est venu s'ajouter le secteur du médico-social et de l'accompagnement social, qui a légitimement revendiqué les mêmes revalorisations.
Quelque 10 milliards d'euros sont d'ores et déjà consacrés à la revalorisation des rémunérations de près de 2 millions de professionnels : je crois qu'on n'a pas connu plan aussi important depuis très longtemps. Nous avons souhaité agir vite, faisant à l'été 2020 un premier geste substantiel, au bénéfice des soignants d'abord, hospitaliers ou en EHPAD, en prenant l'engagement d'une extension progressive aux autres catégories professionnelles. Ça a été l'objet de la mission Lafourcade, qui a donné lieu à trois accords de méthode successifs et à des revalorisations qui se sont échelonnées jusqu'au 1er janvier. Tout le monde dans cet hémicycle a reconnu qu'il s'agissait d'une avancée.
Cependant, nous sommes confrontés sur le plan technique à l'immense éclatement des conventions collectives régissant le secteur sanitaire et médico-social, fruit d'un siècle d'histoire. Nous avons donc missionné l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour voir dans quelle mesure on pouvait opérer certains rapprochements.
Nous avons dû procéder à ces extensions progressives plutôt que d'agir en bloc, ces diverses catégories professionnelles relevant en effet d'employeurs différents. Même quand l'État est employeur, il ne peut rien faire sans concertation avec les autres acteurs principaux du financement – les départements s'agissant des travailleurs sociaux, par exemple. On entre là quasiment dans le champ des relations contractuelles entre des personnels et leur employeur.
Le Premier ministre et le Président de la République ont donc annoncé la tenue, à l'issue de la mission de l'IGAS, d'une conférence sociale qui aura la charge de tout mettre à plat et de voir comment on peut revaloriser progressivement les rémunérations de tous ces personnels, en concertation bien sûr avec leurs principaux employeurs.

Mon interrogation portait précisément sur la nécessité de mettre à plat la complexité des statuts et des relations entre les directeurs d'établissement, les présidents de conseil d'administration et les salariés. Ce travail de clarification est aujourd'hui nécessaire si on veut apporter des réponses.

La parole est à M. Stéphane Peu, pour exposer sa question, n° 1607, relative aux agents de la fonction publique hospitalière en Seine-Saint-Denis.

Belle démonstration du rôle du Parlement, c'est sur la base d'un rapport parlementaire qui avait fait l'unanimité parmi nous qu'il y a deux ans le Premier ministre Édouard Philippe était venu en Seine-Saint-Denis annoncer le plan « Un État fort en Seine-Saint-Denis », construit sur ces trois piliers d'une politique régalienne que sont la police, la justice et l'éducation. Dans ces trois domaines en effet, ce rapport montre à quel point, en termes d'effectifs de fonction publique, la Seine-Saint-Denis est victime d'une injustice républicaine, du fait non seulement d'une répartition inéquitable mais aussi d'un turnover incessant.
Entre autres mesures prévues par ce plan, les personnels d'éducation, de police et de justice restant cinq ans en poste dans le département auront droit à une prime de fidélisation de10 000 euros.
Il est encore trop tôt pour évaluer précisément les conséquences de cette mesure mais, selon les directions administratives et les représentants du personnel, elle a d'ores et déjà produit des effets positifs : les demandes de mutation ont ainsi été réduites de 20 % dans l'éducation nationale, et les syndicats de policiers estiment qu'elle a amélioré l'attractivité et freiné, là aussi, les demandes de mutation. L'équilibre ainsi obtenu entre des fonctionnaires expérimentés et d'autres plus novices est le garant d'un meilleur service public.
Cependant, lors de l'élaboration du rapport publié en 2018, le choix avait été fait, en raison d'un volume de travail déjà considérable, de se concentrer sur les trois missions régaliennes que sont la police, la justice et l'éducation et de ne pas aborder le secteur de la santé – ce choix avait d'ailleurs fait l'objet d'un débat à l'époque.
Depuis, la crise sanitaire est intervenue, les problèmes ont été gigantesques partout en France et dans le département de la Seine-Saint-Denis en particulier, qui a connu le plus fort taux de mortalité lié au covid-19 et a pâti d'un nombre de lits de réanimation par habitant trois fois inférieur à celui des départements voisins des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. La crise de l'hôpital public y est sans doute plus forte que partout ailleurs, même si elle est aiguë dans toute la France.
Les personnels hospitaliers vivent donc comme une injustice cette impasse qui fait que l'hôpital public n'a pas été pris en considération au même titre que les missions régaliennes précitées lors de l'élaboration du plan « L'État plus fort en Seine-Saint-Denis ».
Les représentants de salariés ou d'agents hospitaliers comme ceux des directions hospitalières s'accordent pour dire que cette mesure, sans être la clef de tous les problèmes, constituerait un élément positif de fidélisation.
J'ai interpellé à ce sujet le Premier ministre, qui a laissé entendre que la porte n'était pas fermée à une évolution du dispositif. La semaine prochaine, le préfet du département dressera un bilan du plan « L'État plus fort en Seine-Saint-Denis », et le groupe de la Gauche démocrate et républicaine inscrira ce thème à l'ordre du jour de la semaine de contrôle du Gouvernement, début février.
Nous souhaitons donc connaître votre avis et vous interroger sur la possibilité d'inclure dans le périmètre de ce plan, qui représente un engagement majeur du Gouvernement, le personnel de la fonction publique hospitalière, afin que celui-ci bénéficie également de la prime de fidélisation.
Depuis le 1er octobre 2020, le Gouvernement a décidé d'instaurer, sur la base, comme vous l'avez rappelé, des recommandations d'un rapport parlementaire, une prime de fidélisation territoriale d'un montant de 10 000 euros, versée au terme d'une durée de cinq années de services effectifs dans le département de la Seine-Saint-Denis et destinée aux corps de la fonction publique d'État que vous avez cités. Elle a vocation à remédier au problème de fidélisation des ressources humaines, problème que je constate également dans d'autres domaines et qui appelait une réponse spécifique pour la continuité de l'action de l'État dans ce département.
Néanmoins, cette prime n'a pas vocation à être élargie à la fonction publique hospitalière, pour laquelle des dispositifs spécifiques existent déjà : en premier lieu, la prime d'attractivité, d'un montant annuel de 470 à 940 euros en fonction de la rémunération de l'agent, vise à renforcer l'attractivité des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans les territoires en tension, dont la Seine-Saint-Denis ; en second lieu, la prime d'engagement, dispositif plus spécialisé destiné aux postes de rééducation, vise à récompenser les agents qui s'engagent à exercer dans les territoires présentant un risque de fragilisation de l'offre de soins. Cette prime, d'une valeur totale de 9 000 euros, est versée en trois fractions égales à l'issue de chaque année d'engagement pendant trois ans.
Sur décision de la direction générale de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, les établissements de la Seine-Saint-Denis peuvent bénéficier de ce second dispositif.
Comme vous l'a indiqué le Premier ministre, la porte reste ouverte à d'autres aménagements en raison des besoins particulièrement criants de votre département. Le Gouvernement est ainsi pleinement investi à vos côtés.

La parole est à M. Nicolas Meizonnet, pour exposer sa question, n° 1636, relative à la situation des soignants suspendus.
Le 15 septembre dernier, l'obligation vaccinale des soignants est entrée en vigueur. Depuis, plus de 15 000 soignants, nous dit-on, ont été suspendus faute de s'être fait vacciner, alors que nous traversons une crise de l'hôpital public sans précédent, pour laquelle vous avez une part de responsabilité.
J'ai eu l'occasion de recevoir dans ma permanence, à Vauvert dans le Gard, certains d'entre eux, qui exerçaient aux centres hospitaliers universitaires (CHU) de Nîmes ou d'Alès. Tous ont évoqué la façon dont ils ont vécu la crise sanitaire, dans leur chair, avec une mobilisation et un investissement total au service de la population, malgré les conditions indignes dans lesquelles ils ont dû affronter la pandémie dès le départ : manque de masques, de gel, de blouses.
Tous se souviennent de ce qu'ils ont ressenti lorsque, dans l'enceinte même de l'hôpital, les applaudissements retentissaient à vingt heures précises. Mais tous se souviennent désormais de la façon dont ils se sont vu notifier leur suspension par un agent de sécurité, au détour d'un couloir, en plein service, dans l'ingratitude et l'humiliation, se retrouvant sur la paille et dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
J'aimerais, dans un premier temps, que vous dressiez un état des lieux des suspensions intervenues tant au niveau national que départemental – s'agissant du Gard –, dans la mesure où je rencontre les plus grandes difficultés à obtenir des chiffres précis.
Je souhaite également connaître avec exactitude le nombre de personnels qui ont remis leur démission, qui se sont mis en disponibilité ou qui sont en arrêt maladie et qui ne semblent même pas indemnisés pour certains d'entre eux, ainsi que le nombre de ceux qui ont été radiés pour abandon de poste – en somme, le nombre de ceux dont on a détruit la vie.
Nous comprenons tous désormais que les vaccins existants n'ont pas l'efficacité attendue : aucun n'empêche la propagation du virus ni n'assure une protection totale contre les formes graves de la maladie. Les soignants vaccinés peuvent donc transmettre le virus à leurs patients ou être eux-mêmes contaminés par ces derniers. Seul le test négatif offrirait une garantie : pourtant, les personnels soignants ne sont plus testés. Pire, certaines directions d'hôpital appellent les personnels testés positifs – et donc contagieux – à venir travailler ; de la même manière, on empêche les professionnels libéraux non vaccinés de réaliser des téléconsultations ou de trouver un remplaçant. On marche sur la tête ! La sanction, encore la sanction, toujours la sanction ! Chacun comprend qu'il ne s'agit plus de lutter contre le virus mais bel et bien d'emmerder les Français !
Pourtant, il est question de déprogrammations, d'interventions vitales urgentes reportées et de saturation des services hospitaliers.
Ma deuxième question est donc simple : au nom de la science, de la rationalité, du bon sens sanitaire et surtout au nom de ce que nous leur devons, qu'attendez-vous pour autoriser les soignants qui ne sont pas vaccinés à retrouver le chemin du travail ?
Je peux vous prouver tous les jours l'efficacité de la vaccination. Si vous veniez avec moi dans les EHPAD, les hôpitaux ou les centres de réanimation, vous constateriez que les non-vaccinés paient un lourd tribut dans cette cinquième vague et vous seriez convaincu.
M. Nicolas Meizonnet s'exclame.
Le principe de l'obligation vaccinale des personnels soignants a été voté par le Parlement et est inscrit dans la loi du 5 août 2021.
Des enquêtes ont été menées, depuis le mois de septembre dernier, afin de mesurer précisément l'adhésion à cette obligation, et je peux témoigner d'une énorme mobilisation des personnels, très fiers de s'être fait vacciner pour accompagner les patients dont ils ont la charge et la responsabilité : plus de 94 % des salariés et des agents justifient actuellement d'un schéma vaccinal complet à deux doses, sans compter les professionnels concernés par un certificat de rétablissement de covid-19 ou de contre-indication à la vaccination.
En novembre, 0,6 % seulement des professionnels concernés par l'obligation vaccinale faisaient l'objet d'une suspension. Les toutes dernières enquêtes ont montré que de nombreuses suspensions ont été progressivement levées en raison, dans deux situations sur trois, d'une adhésion à cette obligation. Tout au long des enquêtes menées, le nombre d'agents en mesure de fournir un justificatif de vaccination n'a cessé d'augmenter ; les taux de suspension ont même connu une baisse assez nette. Les incidences liées à l'obligation vaccinale sont donc restées très modérées d'après les établissements – et c'est tant mieux.
Le nombre total de suspensions intervenues au CHU d'Alès est de huit, tandis qu'il est de trente-quatre pour celui de Nîmes soit, dans les deux cas, moins de 0,5 % des effectifs. C'est ainsi moins d'une personne pour 200 soignants et, heureusement, ces chiffres baissent régulièrement dans ces deux établissements depuis octobre dernier.
Par ailleurs, un dialogue est ouvert entre la direction des établissements et les personnels qui ne respectent pas l'obligation vaccinale, afin de les accompagner dans leur parcours vaccinal.
Cependant, conformément à la loi qui a été votée dans cet hémicycle, nous ne lèverons pas les mesures en vigueur pour une raison simple : nous attendons des soignants qu'ils se fassent vacciner, à la fois pour se protéger eux-mêmes et pour protéger leurs patients. Car, oui, le vaccin diminue drastiquement la proportion des personnes affectées, leur contagiosité, le développement de la maladie et il renforce notre capacité à combattre le virus, quoi que vous en pensiez.

La parole est à Mme Stéphanie Atger, pour exposer sa question, n° 1610, relative aux pathologies psychiatriques dans les EHPAD.

Ma question porte sur la détection et la prise en charge des résidents atteints de pathologies psychiatriques et neurodégénératives au sein des EHPAD, où ces pathologies devraient devenir de plus en plus prégnantes dans les années à venir.
En effet, alors qu'on estimait en 2015 que 40 millions de personnes dans le monde souffraient de la maladie d'Alzheimer, ce sont 135 millions d'individus qui devraient être touchés d'ici à 2050. La France n'échappera malheureusement pas à l'augmentation de ces pathologies, dont l'exemple que je viens de citer ne concerne qu'une des maladies neurodégénératives actuellement connues.
C'est pourquoi il importe de définir des protocoles afin de détecter précocement les résidents d'EHPAD souffrant de ces maladies et de leur apporter un soutien actif, si nous ne voulons pas accélérer plus encore leur dépendance.
Pourtant, il apparaît que ces protocoles ne sont pas connus de l'ensemble des directions d'EHPAD en France, ce qui ne favorise pas un suivi personnalisé des résidents concernés, qui se trouvent dans des situations de grande fragilité.
Le cas d'une femme de ma circonscription atteinte de psychose et vivant dans un EHPAD m'a profondément marquée. N'étant pas accueillie dans un établissement adapté à la prise en charge de sa pathologie, cette résidente m'a contactée afin de faire entendre sa détresse. Après avoir pris contact avec l'établissement concerné et l'agence régionale de santé, il m'est apparu nécessaire que l'ensemble des EHPAD disposent d'éléments précis leur permettant de détecter ces troubles et d'y apporter une réponse adéquate.
Aussi, madame la ministre déléguée, pouvez-vous nous indiquer la manière dont sont formés les personnels de ces établissements pour déceler les troubles et les pathologies psychiatriques et neurodégénératives des résidents, et si des protocoles spécifiques existent ?
Le rapport des professeurs Jeandel et Guérin, que vous avez peut-être consulté, souligne que plus de la moitié des résidents en EHPAD – 57 % très exactement – sont atteints d'une maladie neurodégénérative, la maladie d'Alzheimer pour la très grande majorité d'entre eux.
Les pathologies psychiatriques touchent plus de 15 % des résidents. Leur détection et leur prise en charge constituent un enjeu majeur en EHPAD.
Afin d'assurer le repérage de ces pathologies, la feuille de route sur les maladies neurodégénératives pour 2021-2022 prévoit d'améliorer la formation des personnels en EHPAD, mais également l'accompagnement des familles lors de l'annonce du diagnostic et le suivi des résidents concernés.
En ce qui concerne la prise en charge de ces pathologies, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 comporte des avancées, avec tout d'abord la création d'EHPAD de type « centres de ressources territoriaux » : ouverts sur l'extérieur, ils permettront de diffuser l'expertise disponible dans le territoire entre EHPAD mais aussi auprès des services à domicile avec lesquels ils sont en interaction. Ainsi, par exemple, un EHPAD bénéficiant d'une expertise dans la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson pourra organiser des formations, des partages de bonnes pratiques ou des échanges entre pairs.
Les missions de ces EHPAD dits « centres de ressources » seront financées à hauteur de 20 millions d'euros en 2022, et la loi de financement prévoit des crédits supplémentaires pour déployer des pôles d'activités et de soins adaptés (PASA) et des unités d'hébergement renforcées (UHR) en EHPAD. Ces dispositions permettront d'assurer un accompagnement renforcé des personnes souffrant de ces pathologies et favoriseront également, dans la continuité des assises de la santé mentale présidées par le Président de la République, le renforcement tant attendu des équipes mobiles de psychiatrie qui interviennent en EHPAD et qui bénéficieront d'un surcroît de financement de 5 millions d'euros.
Nous travaillons à la réalisation d'une feuille de route entre EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD) pour les années à venir, afin de dessiner plusieurs pistes d'action en vue d'une meilleure médicalisation des EHPAD et afin de porter une attention toute particulière à ces maladies neurodégénératives, dont le nombre ne cesse de progresser.

Je remercie Mme la ministre déléguée de ces éléments concrets sur un sujet de santé très important, dont il nous faut aujourd'hui nous saisir.

La parole est à M. Guillaume Vuilletet, pour exposer sa question, n° 1615, relative aux « vacances répit familles ».

Le 23 octobre 2019, le Gouvernement a lancé le plan national Agir pour les aidants, assorti d'un budget de quelque 400 millions d'euros sur trois ans. Ce plan répond à une nécessité : en effet, les 8 à 10 millions de nos concitoyens qui assistent et accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap ou de dépendance vivent souvent un enfer et subissent une pression considérable. En janvier 2019, à l'occasion d'un déplacement dans ma circonscription, dans la communauté de communes Carnelle Pays-de-France, le Premier ministre Édouard Philippe a d'ailleurs rencontré des aidants qui lui ont fait part de leur souffrance, de leur solitude et de leur épuisement.
Dans sa quatrième priorité, le plan Agir pour les aidants entend accroître et diversifier les solutions de répit : il s'agit d'accueillir les aidants et la personne qu'ils accompagnent dans des lieux où ils puissent « souffler ». Une enveloppe d'environ 100 millions d'euros était prévue à cet effet. Cette mesure était nécessaire, et je crois savoir qu'elle est mise en œuvre. Quel en est le bilan ?
Par ailleurs, les questions orales sans débat étant aussi l'occasion pour les députés de parler de leur territoire, j'aimerais savoir si les fonds destinés aux solutions de répit peuvent être employés à la reconversion de sites. Je pense particulièrement au site de Saint-Martin-du-Tertre, qui fait partie du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise : nous nous interrogeons sur son fonctionnement depuis plusieurs années, et sa reconversion est à l'ordre du jour. Des projets se font jour en la matière. Les fonds relevant du plan Agir pour les aidants, s'ils sont encore disponibles, peuvent-ils accompagner sa reconversion – ce qui permettrait de surcroît à son personnel de poursuivre une carrière dans le domaine où il a toujours exercé ? Ce serait une transformation harmonieuse pour le territoire.
Votre question me permet de rendre hommage aux aidants, qu'ils soient salariés ou qu'ils accompagnent un proche, tant nous savons que leur quotidien est souvent difficile. Le soutien aux aidants est le corollaire indispensable d'une politique de maintien à domicile : si nous ne réussissons pas à mieux aider les aidants – ce que nous faisons –, nos efforts de maintien à domicile seront inutiles.
Les villages répit familles, auxquels vous faites référence, proposent aux aidants et à la personne qu'ils accompagnent des solutions de répit et des séjours de vacances – moments où l'on peut « souffler » –, grâce à une offre différenciée, à la fois touristique et médico-sociale. Des crédits sont prévus pour le développement d'une offre de répit intégrant de tels séjours, à hauteur de 35,55 millions d'euros, sur une enveloppe pérenne de 52,55 millions. Ils relèvent de la stratégie Agir pour les aidants et ont été délégués aux agences régionales de santé (ARS). Dix millions d'euros supplémentaires ont été votés à cette fin dans la loi de financement de la sécurité sociale, et seront délégués cette année. Ces crédits pérennes permettront notamment de poursuivre le développement de projets tels que celui que vous évoquez, en faveur du répit des aidants.
Concernant le projet qui vous occupe plus particulièrement, dans le Val-d'Oise, une proposition devra parvenir aux autorités compétentes du territoire, à savoir l'ARS et le conseil départemental : une autorisation conjointe de leur part est en effet nécessaire pour créer des places médico-sociales d'hébergement temporaire. Le développement de ce type de projet dans un territoire est soumis à une analyse des besoins et de la population locale, réalisée conjointement par l'ARS et le département ; ceux-ci doivent également mener une réflexion concertée sur le modèle économique pertinent. Notez que l'offre de répit est soumise à la saisonnalité, et que le reste à charge pour les usagers peut être très élevé. Il convient donc de s'assurer que ces projets sont viables, que les fonds mobilisés à ce titre sont pérennes, et qu'ils reposent sur une étroite collaboration avec le secteur du tourisme, avec l'appui des établissements de santé médico-sociaux.

Merci pour ces informations précises, que je transmettrai aux intéressés. La mécanique que vous décrivez n'est pas intuitive, tant ces projets sont complexes. Pour autant, l'utilité d'établissements de cette nature ne fait aucun doute. Il nous reste à conjuguer les bonnes volontés, et je ne doute pas que nous réussirons.

La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour exposer sa question, n° 1626, relative à l'EHPAD de Pressac.

Je souhaite appeler votre attention sur l'EHPAD de Pressac, petite commune située dans ma circonscription. Cet établissement est né d'un appel à projet de l'agence régionale de santé (ARS) et du conseil départemental de la Vienne lancé en 2013, portant sur vingt-huit lits et comportant une deuxième tranche optionnelle, soit une capacité totale de cinquante-six lits.
L'association Audacia, retenue par l'ARS, a proposé un projet de vingt-huit places, dont trois éligibles à l'aide sociale pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, en partenariat avec l'office HLM de la Vienne, propriétaire du site. Le premier projet architectural a opportunément intégré, dès l'origine, la possibilité de réaliser une deuxième tranche de vingt-huit places. Les espaces collectifs, la cuisine, l'installation de chauffage et les locaux des professionnels ont été pensés à cet effet. L'unité de pathologie, soit quatorze places sur les vingt-huit places initiales, a été dédiée par la suite à la maladie d'Alzheimer, afin de répondre à des besoins grandissants.
Cette stratégie a bien fonctionné, puisque l'EHPAD a atteint un taux d'occupation normal et assure des prestations dont la grande qualité est reconnue et appréciée par les familles et les résidents. Il est désormais complet, et dispose d'une liste d'attente de huit personnes. Pourtant, il enregistre chaque année un déficit financier important, en raison de son trop faible dimensionnement : moins 200 000 euros en 2019, moins 160 000 euros en 2020, et probablement moins 250 000 euros en 2021. L'ARS a été sollicitée à plusieurs reprises pour remédier à cette situation préoccupante et accorder les vingt-huit lits supplémentaires ; or elle y oppose un refus, arguant que la Vienne ne manque pas de places d'EHPAD, et que l'ensemble des moyens doivent désormais être consacrés au maintien à domicile. Pour autant, l'ARS admet qu'avec seulement vingt-huit places l'EHPAD est condamné à court terme.
La localisation de l'établissement, au sud du département de la Vienne et à proximité de la Charente et de la Haute-Vienne, le rend pourtant très attractif et propre à répondre à une demande avérée. Il est indispensable de lui accorder les vingt-huit lits supplémentaires qui étaient envisagés dès l'origine dans sa deuxième tranche. Quelle que soit son histoire, il n'y a que deux issues possibles pour cet EHPAD : soit le porter à cinquante-six lits, soit le voir disparaître – ce serait évidemment dramatique pour les populations concernées, alors qu'il répond à de réels besoins et que son fonctionnement est unanimement jugé exemplaire.
Je ne peux envisager que cet établissement disparaisse. Aussi, j'en appelle à votre haute autorité, madame la ministre déléguée, pour donner les instructions nécessaires afin que les vingt-huit places sollicitées lui soient accordées, et que les patients, les familles et le personnel ne soient pas laissés sans solution de proximité, dans un secteur où les besoins sont criants.
La programmation des places en EHPAD relève d'une compétence partagée entre le conseil départemental et l'agence régionale de santé. La situation que vous évoquez, qui préoccupe également vos collègues députés de la Vienne, est identifiée par ces autorités de tarification et de contrôle. Le 27 février 2014, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental ont pris un arrêté conjoint portant création d'un EHPAD de vingt-huit places. Par la suite, elles ont constaté une modification non concertée des plans par rapport à ceux qu'avait présentés le gestionnaire de l'établissement. Aussi ont-elles indiqué à ce dernier qu'un accroissement des places d'EHPAD ne pouvait être engagé, compte tenu du taux d'équipement déjà favorable de la Vienne, et plus particulièrement de ce canton.
Si le compte de résultat consolidé de l'association – qui gère deux autres EHPAD – témoigne d'une situation financière saine, les résultats de l'établissement qui nous occupe sont déficitaires en matière de dépendance et de soin sur les deux dernières années, soit moins 49 903 euros en 2019 et moins 48 535 euros en 2020. En effet, le prix de la journée de dépendance fixé par le département se situe dans la moyenne basse.
Le sujet demeure circonscrit. Outre la méthode employée, la situation locale ne plaide pas pour l'ouverture de vingt-huit places supplémentaires, puisque le taux d'équipement y est supérieur de 6 % à celui de la région, et que, dans ce canton, près de 10 % des places sont disponibles.
Néanmoins, quelques perspectives demeurent. Ainsi, une révision de la politique d'admission de l'établissement, en vue d'accueillir des profils plus lourds, lui permettrait d'accroître ses moyens. L'offre de services pourrait également être diversifiée, comme proposé depuis 2019 : accueil de jour, hébergement temporaire et résidences autonomie. Enfin, une unité d'hébergement de personnes handicapées vieillissantes pourrait être créée par appel à projet, à hauteur de dix places – une étude des besoins est en cours dans le territoire Sud-Vienne, et le gestionnaire pourra se porter candidat dès la publication de l'appel à projet. Ces éléments ouvrent des perspectives territoriales pour l'établissement, sans mettre en cause nos efforts en faveur du virage domiciliaire attendu par nos concitoyens, en pleine cohérence avec le renforcement et la médicalisation accrue des EHPAD.

Initialement, cet établissement n'était pas destiné à accueillir des personnes dépendantes. Progressivement, il est toutefois apparu que les besoins de prise en charge de cette population étaient prioritaires. Le maintien à domicile étant de plus en plus long – ce qui est souhaitable –, les personnes qui entrent en établissement sont très largement dépendantes, et ne relèvent pas d'un foyer classique. Les besoins vont croissant, et nous devons y répondre ; aussi ne faut-il pas condamner cet établissement.

La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour exposer sa question, n° 1628, relative à l'irresponsabilité pénale et au lieu d'hospitalisation.

Je souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la justice sur une affaire complexe, dans laquelle l'auteur d'un crime a été déclaré irresponsable pénalement une première fois, puis une deuxième fois à la suite d'un nouveau crime. Il avait été libéré entre-temps, et cette sortie fut fatale. Sa famille est très inquiète, sachant qu'il souffre d'une maladie qui le conduit à tuer « ceux qu'il aime ». Elle souhaite connaître le lieu où il a été hospitalisé d'office, et être assurée qu'elle sera informée de son éventuelle sortie.
J'ai écrit à M. le ministre de la justice à ce sujet, et j'ai eu des échanges par visioconférence avec ses services. Le sujet me semble justifier un prolongement législatif – c'est l'objet de ma présente question. En effet, il est difficile d'admettre qu'en cas d'irresponsabilité pénale d'un individu, ses victimes ne puissent pas être informées du lieu où il est hospitalisé – décision du ministère de la santé sur laquelle le ministère de la justice n'a aucune prise. Bien que je défende l'irresponsabilité pénale – chacun en convient : on ne juge pas les fous –, il me paraît essentiel que les victimes sachent où la personne est hospitalisée, et qu'elles soient associées à une éventuelle décision de sortie.
Votre question est particulièrement sensible, parce qu'elle a trait à la situation particulière d'un individu et de sa famille. Elle est aussi sensible à cause des violences inhérentes à la pathologie que vous décrivez, une forme de schizophrénie, de ses conséquences littéralement dramatiques et des liens gardés par les membres de cette famille.
Dans ces circonstances, je voudrais tout d'abord exprimer mon soutien aux membres de la famille que vous évoquez, qui ont vécu ces terribles épreuves. Je comprends leur inquiétude, leur désarroi, leur douleur. Je tiens à les assurer de l'attention que nous portons à leur situation, malgré les difficultés que cela représente compte tenu à la fois de l'état du droit et des grands débats que cette question peut soulever pour le législateur.
Cette famille souhaite connaître le lieu d'hospitalisation et être assurée qu'elle sera informée de la sortie de la personne internée. La loi prévoit bien l'information de la famille par le préfet en cas de levée de la mesure de soins sous contrainte, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision. La famille sera donc prévenue si la levée de la mesure de soins concernant cette personne était prononcée. L'obligation de notification de la sortie du patient est bien prévue dans les textes.
Cependant, je vous confirme qu'en droit, tout patient doit voir respecter sa vie privée et protéger le secret des informations le concernant. Par principe, le lieu d'hospitalisation d'une personne ne peut donc être divulgué. Ces dispositions générales s'appliquent à chacun, notamment aux patients hospitalisés en psychiatrie, y compris dans ces circonstances.
Une évolution des dispositions législatives en vigueur nécessiterait un travail approfondi au sein de cet hémicycle, et une concertation étroite avec tous les acteurs concernés, afin de concevoir un système préservant à la fois le respect du droit fondamental des patients – le secret médical – et l'utilité d'une réponse dans des cas exceptionnels à l'image de celui-ci.
Malgré toute la difficulté que présente cette situation pour toutes les parties, le droit est clair en la matière, mais le débat que vous soulevez a toute sa place au sein de cette assemblée. Je vous remercie de me permettre de le rappeler, tout en apportant mes sincères hommages à cette famille en souffrance.

Merci, madame la ministre déléguée, de me transmettre cette réponse du ministre de la justice. Si je lui reconnais une réelle volonté de travailler sur cette question, j'aimerais quand même soulever les aspects problématiques de sa réponse.
Il est ainsi difficile d'opposer le secret médical à la famille, puisqu'il ne s'agit pas de divulguer la pathologie dans son détail mais simplement de connaître le lieu d'hospitalisation d'un individu dont l'irresponsabilité pénale a été reconnue. C'est demander à la famille de faire preuve de beaucoup de compréhension !
À mon avis, le secret médical ne devrait pas être opposé dans cette affaire. L'irresponsabilité pénale a été admise, la chambre de l'instruction a rendu un jugement consultable par tout le monde. Il me paraît donc nécessaire d'avancer rapidement sur ce point.
Ensuite, nous devons nous interroger sur une disposition qui, dans les faits, ne s'applique pas : l'obligation d'information par le préfet dans les vingt-quatre heures. Il faudra aller plus loin dans l'irresponsabilité pénale si nous voulons conserver ce dispositif indispensable. Puisqu'il s'agit d'une affaire de justice, il faudrait que la chambre d'instruction ayant prononcé l'irresponsabilité pénale puisse revenir sur le sujet avec les parties concernées pour évoquer la sortie et les mesures qui peuvent être prises.

La parole est à Mme Valérie Bazin-Malgras, pour exposer sa question, n° 1618, relative à la protection des insectes pollinisateurs.

Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, je souhaite vous interroger sur l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Cet arrêté « abeilles » remplace le précédent datant du 28 novembre 2003.
Il est essentiel de préserver les abeilles qui, en raison de leur rôle de pollinisateurs, rendent d'innombrables services aux cultures et à l'environnement. Or votre arrêté ne permet pas de répondre à cet impératif, alors qu'il crée des règles inapplicables pour nos agriculteurs. Il prévoit ainsi d'étendre la mention « abeilles » aux fongicides et herbicides, qui seraient désormais interdits d'usage pendant les périodes de floraison et de production d'exsudats.
Outre la distorsion de concurrence que cette nouvelle réglementation créerait vis-à-vis des autres États membres de l'Union européenne et des pays tiers, la protection des cultures serait particulièrement fragilisée. La compétitivité des produits agricoles français s'en trouverait amoindrie. Cela favoriserait les productions de pays ayant des normes moins-disantes sur le plan environnemental, ce qui entraînerait des pertes de revenus importantes pour nos agriculteurs alors que le monde agricole est déjà en crise.
En outre, les dérogations prévues apparaissent inapplicables. La tranche horaire nocturne réduite pendant laquelle l'utilisation de produits phytosanitaires serait autorisée s'accompagne de nombreux écueils.
Le travail de nuit ainsi imposé induit des problèmes de sécurité pour les travailleurs et il aura des conséquences inacceptables sur leur vie familiale. La pulvérisation de produits phytosanitaires en soirée risque aussi d'accentuer les conflits de voisinage et de tendre les relations déjà difficiles entre la population et les agriculteurs.
Au lieu de créer des normes inapplicables et délétères sur le plan social, environnemental et sociétal, vous devriez soutenir la recherche pour nous permettre de trouver des produits de substitution à ceux qui sont les plus néfastes pour l'environnement.
Les agriculteurs ne demandent qu'à ce qu'on leur offre la possibilité de changer leurs pratiques tout en conservant le même niveau de rendement, nécessaire pour tous nous nourrir. Cependant, force est de constater qu'aucune solution de rechange ne leur est proposée.
Comment justifiez-vous votre incapacité à proposer une solution alternative, fruit de la recherche, permettant d'assurer la nécessaire préservation des abeilles, ce qui vous conduit à imposer de nouvelles normes au détriment de l'activité des agriculteurs ?
Excusez-moi de vous le dire comme cela, madame la députée, mais votre question comporte un nombre d'erreurs assez colossal.
Premièrement, contrairement à ce que vous prétendez, l'arrêté « abeilles » n'impose en aucun cas le travail de nuit : c'était même la ligne rouge que j'avais résolument tracée d'emblée.
Deuxièmement, cet arrêté est le fruit d'une très large concertation, car il faut trouver un équilibre parfois compliqué entre des intérêts divers. Votre intervention en apporte d'ailleurs un témoignage criant : vous commencez par vous poser en défenseure des abeilles avant de conclure que tout ce que nous avons entrepris est bon à jeter à la poubelle.
C'est parce que la réalité est complexe que nous avons prévu des dérogations destinées à trouver de justes équilibres. C'est pour cela que nous avons adopté une approche pragmatique et défini des conditions d'application pour cet arrêté. Quant au cadre familial, il a été au centre de mes préoccupations et à l'origine de mon choix de ne jamais imposer de travail de nuit. Ce n'est pas ma vision d'une société de progrès !
Si votre énumération ne correspond pas à l'arrêté pris, vous avez raison sur deux points sur lesquels je voudrais insister.
Premier point : ces débats sur les produits utilisés dans l'agriculture doivent avoir lieu au niveau européen ; quand ils sont traités à un niveau national, les décisions prises entraînent des distorsions de concurrence. Aussi ai-je décidé d'en faire un objectif prioritaire de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.
Deuxième point : l'importance de la recherche. À cet égard, je vous ferais observer que nous avons investi massivement dans ce domaine, comme peu de gouvernements l'ont fait, notamment en saisissant les occasions offertes par de nouveaux plans tels que le plan France 2030.
Néanmoins, la recherche peut prendre beaucoup de temps quand elle doit résoudre des problèmes compliqués – ce n'est pas le ministre, mais l'ingénieur agronome qui vous le dit. À juste titre, on dit souvent qu'en agriculture, on a l'année culturale pour tester une recherche. Ce seul considérant donne une idée du temps nécessaire.
Il nous faut rattraper des retards dus à des années de sous-investissement dans la recherche, même si nos instituts, qu'ils soient publics ou privés, font partie des meilleurs au monde. J'ai appelé « troisième révolution agricole » celle qui a lieu autour du vivant et de la connaissance, et qui passe par le numérique, l'agrorobotique, la génétique, le biocontrôle.
Trois mots résument donc notre action : pragmatisme, équilibre, investissements. Les transitions nécessaires ne se feront pas sur injonction mais grâce à des investissements, et c'est pourquoi nous investissons 2,4 milliards d'euros dans cette révolution agricole.

Votre temps de parole est épuisé, chère collègue : vous connaissez les règles et il me semble que vous y êtes attachée.

La parole est à M. Didier Quentin, pour exposer sa question, n° 1620, relative aux difficultés de la filière ostréicole.

Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, je souhaite vous poser trois questions rapides, mais dont les implications sont importantes pour l'économie maritime de ma circonscription.
La première concerne l'ostréiculture. À la suite de la question que je vous avais posée le lundi 8 novembre 2021, l'inspection du travail a accepté la dérogation demandée par les ostréiculteurs de la Charente-Maritime : pouvoir travailler jusqu'à soixante heures entre le lundi 6 décembre et le dimanche 12 décembre 2021, et même jusqu'à soixante-six heures entre le lundi 13 décembre et le dimanche 26 décembre.
Quatre grandes entreprises avaient introduit un référé devant le tribunal administratif de Poitiers afin d'obtenir une dérogation leur permettant de travailler jusqu'à soixante-douze heures par semaine pendant les deux dernières semaines de décembre. Leur demande a été rejetée.
À l'avenir, il serait souhaitable de porter la durée maximale hebdomadaire de travail de soixante-six à soixante-douze heures pour les entreprises qui le souhaitent, ainsi que l'autorise une disposition du code rural, à la condition que le nombre total d'heures effectuées n'excède pas soixante heures sur douze mois.
Quelles mesures comptez-vous prendre, en accord avec la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, afin de rouvrir une négociation sur la convention collective de l'ostréiculture et d'éviter que ces problèmes ne se reposent à la fin de l'année.
Ma deuxième question porte sur les conséquences de la baisse drastique de 36 % du quota de pêche de soles accordé au port de Royan et à celui de La Cotinière, situé dans l'île d'Oléron. Cette pêche représentant plus du tiers des prises pour Royan, la réduction du quota va engendrer au moins 2 millions d'euros de perte de chiffres d'affaires pour ce port.
J'ai bien noté que Mme Annick Girardin, la ministre de la mer, venait d'annoncer la mise en place d'un « arrêt temporaire aidé » pour les pêcheurs de soles. Je vous serais donc reconnaissant de me préciser les modalités d'application de cette disposition, ainsi que les mesures de compensation que le Gouvernement entend prendre, notamment par la mobilisation du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
J'en viens à ma troisième question : le projet de création d'un parc éolien en mer au large de l'île d'Oléron. Avec 80 à 120 éoliennes de 237 mètres de haut, ce parc risque d'avoir un sérieux impact sur la ressource halieutique et l'accessibilité des zones de pêche.
Je m'interroge sur la cohérence de ce projet et de la modernisation du port de La Cotinière, qui est en cours d'achèvement et a coûté quelque 60 millions d'euros. Alors que le débat public sur ce projet arrive à son terme, je tiens à vous informer qu'il suscite une hostilité quasi générale. Quelle va être la position du Gouvernement sur ce sujet très sensible ?
Commençons par la première de vos trois questions, celle du temps de travail des ostréiculteurs, auxquels j'ai rendu visite il y a quelques mois sur ce territoire que je connais très bien ; j'ai donc longuement échangé avec eux sur le sujet.
Comme vous l'avez rappelé, les dérogations demandées ont été octroyées, conformément à l'engagement pris par mon ministère et nos équipes locales.
Je ne ferai évidemment pas de commentaire sur la décision du tribunal administratif. En revanche, je voudrais insister sur un point que vous n'avez pas abordé : il est nécessaire d'harmoniser le temps de travail sur tout le territoire, car les règles peuvent actuellement varier de manière très significative d'une région à l'autre.
Cette harmonisation constitue une priorité pour mon ministère et pour celui du travail, de l'emploi et de l'insertion. Nous sommes décidés à avancer sur ce sujet qui peut être compliqué, comme le montrent la décision du tribunal administratif et ses implications juridiques.
Dans l'ostréiculture, où le problème est récurrent, les exploitants demandent et obtiennent les mêmes dérogations tous les ans. Il faut leur donner une lisibilité. Avec Élisabeth Borne, je vais continuer à travailler à l'harmonisation du temps de travail, en tenant compte de la réalité du terrain, notamment celle de nos exploitants ostréicoles. Je sais que ma réponse ne vous satisfera pas totalement, mais voilà l'objectif que nous nous sommes fixé.
S'agissant du quota de soles, la ministre de la mer m'a chargé de vous apporter les éléments de réponse suivants : vous avez raison de souligner qu'ils accusent une baisse, conséquence de la nécessaire adaptation au plan de gestion européen adopté en 2019. C'est pourquoi les services de l'État ont créé un dispositif d'accompagnement spécifique. La ministre de la mer a notamment lancé un plan d'aide aux pêcheurs, qui seront indemnisés à hauteur de 70 % de la perte du chiffre d'affaires pour les chantiers et de 85 % pour les fileyeurs, sous réserve du respect des conditions détaillées par le ministère concerné. L'objectif consiste à aider tous les pêcheurs de sole, c'est-à-dire tous ceux qui ont obtenu une autorisation de pêche et pour qui la sole représente un certain pourcentage de la valeur totale de la capture.
S'agissant du parc éolien, je manque de temps pour répondre, mais j'ai bien pris note du point que vous soulevez et de la nécessité de prendre en considération l'activité des pêcheurs concernés.

La parole est à M. Aurélien Pradié, pour exposer sa question, n° 1622, relative à l'agriculture lotoise.

Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, vous étiez il y a quelques mois en déplacement dans le département du Lot. À cette occasion, vous avez pris des engagements clairs, que je tiens à vous rappeler, car les promesses ne valent que si elles sont tenues. Les agriculteurs de ce département, où l'agriculture est essentielle, vous avaient appelé à lancer un plan expérimental de développement de l'accès à l'eau et des lacs collinaires. Alors que plusieurs projets en ce sens existaient dans le département du Lot, beaucoup n'ont pas pu aboutir, notamment du fait de nombreux blocages de nature administrative, et parfois judiciaire.
À cette occasion, vous avez annoncé que le département pourrait expérimenter de nouvelles modalités d'accès à l'eau et de déploiement de lacs collinaires. C'était il y a de longs mois. Nous n'avons depuis reçu aucune nouvelle. Pourtant, le Lot, comme les autres départements de France, a besoin de l'accès à l'eau. Ce n'est pas un détail : cet accès est vital non seulement pour la production agricole, mais aussi pour l'avènement d'une agriculture plus raisonnée. Il se trouve que de nombreux projets, notamment de lacs collinaires, sont sur les rails dans le Lot.
De nombreux producteurs attendent une accélération des procédures administratives. Il faut pour cela que des consignes soient passées. Nous espérons toujours que le département du Lot devienne pilote en matière d'accès à l'eau et d'irrigation, notamment pour développer de nouvelles productions, qui restent actuellement difficiles dans un territoire comme le nôtre.
Cet engagement sera-t-il tenu, non pas dans les mois, mais dans les semaines à venir – puisque vous arrivez, comme nous, au terme de la mission qui nous a été confiée par nos concitoyens ?
Au-delà de ce point, je tiens à souligner – mais vous le savez sûrement – que la profession agricole souffre de maux qui ne sont pas traités en profondeur : la question du revenu, celle de l'assurance face aux calamités, dont nous débattrons demain et qui nécessitera, plus qu'une politique de petits pas, une action réellement volontariste, et celle de l'agribashing insupportable dont souffrent les producteurs, qui exercent sûrement un des plus beaux métiers du monde et qui sont terriblement affectés par l'ambiance actuelle.
Beaucoup d'entre vous commencent à me connaître. Il me semble que vous tombez très mal avec votre question, monsieur le député, car on peut me faire beaucoup de reproches, mais pas celui de ne pas tenir mes engagements.
M. Aurélien Pradié proteste.
Je crains que vous ne soyez plutôt, en réalité, dans la position de l'arroseur arrosé. Plusieurs exemples le montrent.
Vous avez évoqué la nécessité de proposer une assurance récolte ambitieuse. La commission chargée d'expertiser cette question s'est tenue la semaine dernière. Vous n'y étiez pas !
Vous n'y étiez point, monsieur le député.
Je m'étais engagé à créer cette assurance récolte. J'ai tenu le calendrier annoncé.

Vous êtes invraisemblable ! Vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'Assemblée !
Ensuite, le Varenne de l'eau…
C'est ce que je fais, monsieur le député. Gardez votre calme. L'assurance récolte constitue l'un des piliers de l'accès à l'eau. Vous l'avez d'ailleurs évoquée dans votre question.
Deuxième élément : si le premier groupe de travail mobilisé dans le cadre du Varenne de l'eau a traité de l'assurance récolte, la deuxième thématique concernait l'adaptation des cultures au changement climatique. Là encore, l'engagement a été tenu, puisque nous avons annoncé les résultats le 20 décembre. Le troisième groupe…
C'est bien de cela qu'il s'agit, monsieur le député ! Simplement, il faut aborder la question de manière cohérente. Tout ce dont je parle, c'est l'eau !

Monsieur Pradié, veuillez écouter la réponse qui vous est apportée par le ministre. Vous disposerez d'un temps de parole pour répondre si vous le souhaitez.
La troisième thématique portait précisément sur l'accès aux ressources en eau. Plus de 800 personnes ont participé à ce groupe de travail. Vous n'y étiez point – jamais !
Toutes les rencontres étaient ouvertes, monsieur le député : pas de ça avec moi !
Les conclusions de ce troisième groupe seront rendues à la fin du mois de janvier. Ces travaux ont commencé au début du mois de mai. Vous n'y étiez point – jamais !
Troisième élément : vous expliquez que les agriculteurs souffrent et que la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGALIM, ne va pas assez loin. Je ne vous ai jamais vu dans l'hémicycle participer aux débats sur la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi EGALIM 2, que nous venons d'adopter. Pas une fois ! Cessez donc de tenir de grands discours pour nous accuser de ne pas aller assez loin et agissez avec nous ! Pas de ça avec moi !
Je salue vos nombreux collègues mobilisés sur ces questions, avec qui nous travaillons de façon constructive, mais arrêtons avec les postures qui consistent d'un côté à travailler de façon constructive pour le bien des agriculteurs et de l'autre, à prétendre, comme vous venez de le faire, qu'aucun engagement ne serait tenu. Car c'est faux, archifaux ! Je vous le dis avec sincérité : ce double discours est consternant. Ce n'est pas ma conception du débat politique.
Mettez les mains dans le cambouis et travaillez avec nous sur toutes ces questions et vous verrez : nous irons beaucoup plus vite.

J'étais élu local avant même que vous ayez l'idée de vous engager en politique.
Et alors ? Quelle condescendance !

Figurez-vous qu'à cette époque, j'ai eu amplement l'occasion de « mettre les mains dans le cambouis », comme vous dites, notamment pour défendre les zones défavorisées : je ne vous ai pas attendu pour le faire.
Peut-être pourriez-vous remballer votre arrogance…
Insupportable !

…et répondre à la question précise que je vous ai posée. Il y a plusieurs mois, dans le causse de Gramat, vous avez annoncé aux agriculteurs et aux éleveurs d'agneaux,…
Eux, ils s'impliquent !

…qui vous accueillaient que le Lot deviendrait un département pilote en matière d'accès à l'eau.

Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à ma question.
Bien sûr que si !

Tenez au moins cet engagement. Ensuite, vous pourrez donner des leçons de morale.

La parole est à Mme Marietta Karamanli, pour exposer sa question, n° 1629, relative à la situation des agriculteurs sarthois.

De nombreux exploitants, notamment des éleveurs, connaissent de fortes difficultés liées au renchérissement des matières premières. C'est notamment le cas des éleveurs de porcs et de volailles. Les prix de vente des productions ont peu évolué, alors que les coûts de l'alimentation, eux, sont en hausse.
À ces difficultés liées au marché s'ajoutent les négociations avec la grande distribution. La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, puis la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, ont tenté d'apporter des réponses. Cinq centrales d'achat gèrent 80 % à 90 % des achats de la grande distribution et s'approvisionnent, directement ou non, auprès des exploitations agricoles, qu'elles contraignent fortement. Dans ces conditions, ce sont les centrales d'achat qui fixent les prix de leurs fournisseurs. Certains producteurs agricoles sont ainsi conduits à vendre aux distributeurs à un prix inférieur à leurs coûts de production, ce qui met en cause la survie même de leur exploitation.
Si tout le monde s'accorde à dire que les prix doivent être calculés sur la base des coûts de production des agriculteurs et non plus sur les seules orientations de la très grande distribution, les méthodes pour y parvenir divergent. Ni les interprofessions ni l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), un organisme indépendant, ne peuvent définir des indicateurs s'imposant à tous.
Parallèlement, dans l'ensemble du pays, des tensions liées à des achats de natures différentes – spéculation, terres dédiées à la production d'énergies alternatives, fonds d'investissement rendant difficile l'accès aux terres sauf à recourir à un fort endettement – se font jour sur le marché des terres. Récemment, le législateur a d'ailleurs entendu lutter contre une forme d'accaparement des terres agricoles par la cession de parts de sociétés, en créant un nouveau mécanisme de contrôle déclenché par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), mais la question du grignotage des terres reste posée.
Ma question est donc triple. Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour faire face aux fluctuations des marchés ? L'État ne doit-il pas privilégier des prix minimums garantis et des contrats tripartites contraignant l'industrie agroalimentaire à travailler sur la base du coût de revient des agriculteurs ? Enfin, quelles mesures et pistes de réflexion privilégiez-vous en vue de mieux protéger les terres agricoles, peut-être en lien avec, parmi d'autres acteurs, les collectivités territoriales ?
Le premier point que vous soulevez renvoie au débat qui nous a occupés lors de l'examen de la loi EGALIM 2, qui encourage la contractualisation que vous appelez de vos vœux. Cette loi, adoptée il y a maintenant trois mois, est appliquée avec beaucoup de force et de détermination.
Comme vous le savez, la spécificité du monde agroalimentaire réside dans les négociations commerciales annuelles, qui se déroulent en ce moment même et jusqu'à la fin du mois de février. L'application de la loi EGALIM 2 permettra de favoriser la contractualisation, que nous avons généralisée et qui me paraît essentielle, parce qu'elle donne de la visibilité aux producteurs, garantit la transparence et permet de lutter contre les comportements que vous avez dénoncés.
Mais le texte va plus loin, puisqu'il dispose que les prix doivent être fixés en prenant pour socle les coûts de production. Mieux encore, la loi crée des indicateurs d'indexation automatique revus année après année – ce qui constitue un point capital – et impose la non-négociabilité du prix des matières premières agricoles. En revanche, elle n'a pu aller – ne serait-ce que parce que le texte aurait probablement été censuré – jusqu'à prévoir l'établissement de prix fixés par la loi, car cela aurait contrevenu aux principes de libre commercialisation et de libre entreprise.
La loi EGALIM 2 va donc aussi loin que possible dans la régulation. La même détermination qui a animé le député Grégory Besson-Moreau et la majorité pour défendre ce texte sera consacrée à en assurer l'application. Nous prévoyons notamment de quadrupler le nombre de contrôles effectués par les organismes de contrôle, au premier rang desquels figure la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour s'assurer du respect de la loi.
Vous m'interrogez sur une autre question très importante, à savoir celle du foncier. Cet actif représente ce que l'agriculteur a de plus précieux : il s'agit non seulement de son outil de production, mais surtout du sol, que tous les acteurs du monde agricole chérissent.
Sur ce volet, l'Assemblée nationale a réalisé il y a peu une très grande avancée en adoptant la proposition de loi de Jean-Bernard Sempastous portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, votée ensuite par le Sénat et validée en commission mixte paritaire (CMP) à l'unanimité des deux assemblées.
Cette loi permettra de traiter un point spécifique qui, s'il peut paraître technique, n'en est pas moins essentiel. Jusqu'à présent, en effet, le contrôle du foncier ne s'étendait pas aux parts sociétaires. On pouvait ainsi l'exercer pour les structures – les exploitations agricoles –, mais pas quand les terres étaient détenues par des entreprises sous diverses formes sociétaires, ce qui donnait lieu à des détournements massifs. Le texte récemment adopté a apporté des éléments de réponse que nous nous emploierons à déployer.

La parole est à Mme Sophie Métadier, pour exposer sa question, n° 1632, relative à la gestion des eaux de pluie.

L'eau est au cœur des enjeux liés à la volonté de la France d'assurer sa souveraineté alimentaire. Celle-ci ne sera possible que si la France dispose d'une agriculture forte et durable. Dans mon département d'Indre-et-Loire, l'eau utilisée pour l'irrigation agricole provient majoritairement de pompages, quand nos voisins étrangers privilégient le stockage de l'eau de pluie.
La multiplication des aléas climatiques rend primordiale une meilleure gestion de l'eau par le monde agricole. C'est une des raisons pour lesquelles l'agriculture doit être qualifiée d'intérêt général et consacrée, à l'instar des espaces, ressources et milieux naturels, comme patrimoine commun de la nation.
Comme les travaux du Varenne de l'eau l'ont montré, tous les leviers de gestion de l'eau doivent être actionnés. Une politique ambitieuse et préventive du stockage de l'eau doit être déployée pour toutes les cultures agricoles, des grandes cultures aux plus petites surfaces comme le maraîchage bio. Cette politique est également nécessaire pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs.
À l'heure où le Gouvernement entend permettre à la France de « reconquérir sa souveraineté alimentaire » et où s'ouvre la présidence française du Conseil de l'Union européenne, quelles actions le Gouvernement entend-il entreprendre pour résoudre ce problème, notamment pour améliorer le stockage et la gestion des eaux de pluie ?
Il nous semble indispensable de développer les infrastructures de stockage et de transfert d'eau pour assurer non seulement la production agricole, mais aussi l'alimentation en eau potable, la préservation des milieux naturels ou la défense contre les incendies. Je songe à la station d'épuration de Château-Renault, en Touraine, dont l'eau est réutilisée en irrigation, ou encore à l'exemple de la bien nommée commune de Nouans-les-Fontaines, où les agriculteurs sont prêts à coconstruire un projet d'irrigation et de maintien de l'étiage.
Votre question appelle plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, il faut construire un projet politique, créer un momentum autour de la question de la gestion de l'eau. Le Président de la République a demandé au Gouvernement de s'y atteler en nous chargeant, Bérangère Abba et moi-même, de lancer le Varenne de l'eau et du changement climatique. Ce rendez-vous est d'autant plus important que le thème de l'eau n'avait sans doute pas été suffisamment mis en avant jusqu'à présent par mon ministère, alors même qu'il est absolument essentiel en matière d'agriculture.
Ensuite, ce momentum politique doit permettre d'aller au-delà des postures que l'on peut observer de part et d'autre. Il convient pour les éviter de remettre au centre des débats la science, la raison, la pensée. C'est ce que nous avons entrepris depuis le début du mois de mai en lançant trois groupes de travail dans le cadre du Varenne de l'eau et du changement climatique.
Le premier est consacré aux moyens d'accompagner les agriculteurs une fois la catastrophe survenue. C'est tout le sujet de l'assurance récolte. Nous nous étions engagés à proposer un projet de loi : c'est chose faite, nous en débattrons dans cet hémicycle dès demain après-midi.
La thématique abordée par le deuxième groupe de travail est celle de l'adaptation des différentes formes d'agriculture au changement climatique. Là encore, des travaux ont été menés, puis restitués au début du mois de décembre. Les instituts techniques agricoles, notamment, ont fourni un travail considérable – je tiens ici à saluer Mme Anne-Claire Vial, qui pilotait ce groupe. Nous avons ainsi pu établir des feuilles de route et un calendrier sur lesquels les filières elles-mêmes s'engagent, l'État venant en contrepartie financer les investissements nécessaires à travers les plans France relance et France 2030.
Le troisième groupe de travail se penche sur l'accès à l'eau. Ses travaux, qui sont en cours de finalisation et doivent être remis entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février, s'intéressent à trois enjeux.
Le premier est la nécessité de trouver les moyens de faire vivre et d'améliorer les fameux PTGE, les projets de territoire pour la gestion de l'eau. S'ils sont très importants, une concertation ne saurait durer dix ou quinze ans, sous peine de ne mener à rien. Il faut donc réfléchir à une manière d'être plus proactif et d'améliorer ce cadre.
Le deuxième enjeu est la nécessité d'une approche résolument territoriale : il s'agit d'identifier à l'échelle de chaque bassin versant, de chaque agence de l'eau, les projets prioritaires à une échéance de dix, quinze, vingt ou trente ans. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas l'État qui défend un projet. Il peut financer, faciliter ou encore améliorer le cadre normatif, comme nous l'avons fait il y a quelques mois en publiant un décret sur les débits d'usage de l'eau qui était attendu depuis plus de dix ans, mais c'est bien le territoire qui est porteur du projet – c'est là un point essentiel.
Le troisième groupe de travail réfléchit enfin à la possibilité d'identifier de nouvelles ressources en eau. Par exemple, existe-t-il un consensus scientifique et technologique autour de la captation des eaux issues des pluies diluviennes hivernales, qui seront de plus en plus fréquentes ?
Les travaux sur ces trois thèmes, qui sont en cours de finalisation, nous permettront de conclure sur le sujet de l'accès à l'eau, comme je vous l'ai dit, entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février.

Je vous remercie, monsieur le ministre. Vous avez raison lorsque vous dites que les territoires doivent être les porteurs de projet. Je suis convaincue – je le sais pour en rencontrer régulièrement – que de nombreux agriculteurs sont prêts à avancer sur ces thématiques. Il faudra donc les écouter puis les accompagner, comme vous l'avez dit, sur un plan à fois réglementaire et financier.

La parole est à M. Olivier Falorni, pour exposer sa question, n° 1627, relative la certification biologique des producteurs de sel.

Je voudrais évoquer la grande crainte qui agite les sauniers et les paludiers de la façade atlantique depuis quelques mois. Je ne parle pas de leur statut, puisque nous avons, ici même, mis fin à une injustice qui les touchait depuis trop longtemps, celle de ne pas être reconnus comme des agriculteurs. Non, il s'agit ici des travaux que mène actuellement la Commission européenne afin d'établir des critères pour labelliser en bio la production de sel en Europe.
Vous le savez, la Commission prépare en ce moment une proposition d'acte délégué comprenant les règles de production du sel bio qui permettrait à toutes les méthodes de production de sel d'être éligibles au label AB, y compris la production de sel de mine, pour le moins peu respectueuse des principes du bio européen.
Nous ignorons toujours quand la Commission publiera ce document – certainement dans les prochaines semaines. Mais lorsqu'elle le fera, les États membres devront rendre un avis. C'est précisément là que la position de la France et de son ministre – vous-même – devra être la plus pertinente. Jusque-là, en effet, la Commission montre une volonté constante d'inclure les autres sels que le sel de mer.
Un mouvement d'ampleur transnational et transpartisan voit le jour afin de soutenir la filière artisanale du sel. L'enjeu est de taille. Il s'agit de préserver un patrimoine historique et culturel, un modèle de production ancestral, respectueux de son environnement et de la biodiversité, qui contribue à l'attractivité des territoires, mais qui pourrait disparaître, comme ses 800 emplois, en raison de la position dominante des groupes industriels face aux producteurs artisanaux.
Dans ma circonscription, sur l'île de Ré, les sauniers s'inquiètent du projet de label bio sur lequel travaille l'Europe. Selon eux, les critères du futur label ne sont pas assez exigeants. Ce texte rendrait éligible au label AB presque toutes les méthodes de production existantes, ce qui représente 90 % de la production européenne.
Si le projet est validé en l'état, le consommateur risque de se retrouver dans l'incapacité de distinguer le sel marin récolté à la main, séché par le vent et le soleil, du sel de mine obtenu en envoyant dans la roche de l'eau sous pression et mélangé à des antiagglomérants.
Au-delà de la question de la production de sel, ce qui se joue aujourd'hui avec la définition des critères qui caractérisent le label agriculture biologique, c'est la cohérence et la crédibilité d'un label unanimement reconnu par les consommateurs. En lui faisant confiance, notamment pour les modes de production, ils s'assurent du respect de l'environnement, mais aussi de la qualité du produit in fine. L'an dernier, plus de neuf Français sur dix déclaraient avoir consommé des produits biologiques, 15 % d'entre eux en consommant même tous les jours.
Monsieur le ministre, je vous sais très attentif à cette question. C'est pourquoi toute la filière de production de sel artisanal, de Guérande à Oléron en passant par Noirmoutier et l'île de Ré, vous demande de défendre une position ambitieuse, forte et exigeante, pour faire respecter la force qualitative du label bio.
La réponse est oui : la France défendra – et je défendrai en son nom – une position exigeante pour différencier les méthodes de production du sel, qu'il soit biologique ou considéré comme plus conventionnel.
J'ai dressé exactement le même constat que vous tout au long du processus européen. Il faut se rappeler que ce débat est ancien. La Commission européenne a d'abord formulé une première proposition en matière de labellisation, mais la distinction établie entre les différentes méthodes était très faible. Plusieurs États membres sont alors montés au créneau pour exprimer leur opposition, ce qui a conduit à la création d'un groupe technique dont la dernière réunion a eu lieu en octobre dernier. Nous attendons à présent l'acte délégué de la Commission européenne sur la base duquel les États membres devront prendre position.
Ma position a toujours été très claire : premièrement, il est important d'établir une distinction, car cela correspond à une préoccupation du producteur mais aussi du consommateur ; deuxièmement, cette différenciation doit être claire.
À ce sujet, je vous donnerai un autre exemple auquel sont très attachés les acteurs de la filière bio : il n'est pas possible, sur une même exploitation, de cultiver du bio sur une partie du terrain et du non-bio sur une autre partie, car cela induit un risque de mélange, les différents produits ne pouvant être distingués, et des contournements seraient dès lors possibles.
La filière bio doit pouvoir être clairement distinguée de la filière conventionnelle, et le consommateur doit pouvoir disposer de cette information. Soyez assuré que j'aurai une position exigeante sur cette question.

La parole est à M. Charles de Courson, pour exposer sa question, n° 1625, relative au septième programme d'actions national nitrates.

Je souhaite appeler votre attention sur le projet d'arrêté interministériel rectificatif du septième programme d'actions national nitrates, dit PAN.
Il semble que la version actuelle de ce projet d'arrêté prévoit de modifier la classification des effluents et de leurs périodes d'épandage sur les terres agricoles. Un tel projet, s'il était adopté en l'état, aurait de très lourdes conséquences pour les filières de la betterave, de la pomme de terre de fécule et de la luzerne.
Selon les informations disponibles, ce projet d'arrêté prévoit de classer ces effluents en type 2, ce qui revient à une interdiction d'épandage dès le 15 octobre, un mois après le début de la campagne des sucreries et des féculeries. Il prévoit également de limiter les apports sur luzerne à 70 kilos d'azote dans toute la France, contre 250 kilos par hectare actuellement dans le Grand Est.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'inquiétude des filières concernées, envisagez-vous de modifier ce projet d'arrêté pour prendre en considération les demandes légitimes de filières déjà touchées par la désindustrialisation ?
Je commencerai par rappeler le contexte. La révision du plan d'actions national et de la cartographie – les deux aspects sont importants – de mise en œuvre de la directive sur les nitrates est un exercice qui nous est imposé tous les quatre ans. Il est d'autant plus important que, vous le savez, la France s'est vu reprocher de ne pas avoir appliqué cette directive européenne et de l'avoir sous-transposée ces dernières années – nous y remédions actuellement.
Il faut toutefois agir avec beaucoup de méthode et de pragmatisme. C'est le chemin que nous avons emprunté, non par manque d'ambition mais parce que c'est ainsi que l'on agit efficacement, en prenant en considération les réalités du terrain.
Dans cette perspective, nous nous sommes d'abord attelés à l'établissement de la cartographie des nouvelles zones concernées – vous y avez fait allusion dans votre question. Cela a demandé un très gros travail, notamment de concertation entre le monde agricole et les services de l'État, que nous avons achevé il y a peu puisque la nouvelle cartographie a été officialisée à l'automne dernier.
D'autre part, l'entrée en vigueur du plan d'actions national n° 7 – car il s'agit de la septième révision de la directive – était prévue en septembre dernier. Afin de tenir compte des inquiétudes qui se sont exprimées et de prendre le temps d'échanger – qui plus est dans le contexte que nous avons tous à l'esprit et qui ne facilite pas la tâche –, il a été décidé de la décaler à septembre 2022, comme nous l'avons annoncé il y a quelques mois.
Les consultations au niveau territorial et national ont débuté – ou sont sur le point de débuter, selon les territoires et les dossiers. Là encore, les réalités de terrain sont prises en considération.
Pardonnez-moi de ne pouvoir vous répondre aussi précisément que j'aime à le faire d'habitude sur les cas très spécifiques que vous avez évoqués, pour la simple raison qu'à ce jour, aucune décision n'a été définitivement arrêtée. Ces textes font actuellement ou feront bientôt l'objet de consultations. Le travail d'écoute, de concertation et de prise en considération des demandes des uns et des autres sera au cœur du plan d'actions national qui entrera en vigueur à la fin de l'été ou au début de l'automne 2022, conformément à notre engagement d'adapter le calendrier pour donner toute sa place à la concertation.

Monsieur le ministre, vous avez de bonnes paroles, mais vous ne me rassurez pas, parce que ce projet d'arrêté circule bel et bien. Prenez l'exemple de la dérogation – 250 kilos d'azote à l'hectare – dont bénéficie tout le Grand Est : l'apport devrait dorénavant être limité à 70 kilos dans le texte, et vous ne me dites même pas que vous êtes prêt à réexaminer ce point. Si vous maintenez la limitation à 70 kilos, ce n'est pas compliqué : une partie des investissements disparaîtront faute de profitabilité, et avec eux toute la filière agro-industrielle en aval qui en dépend. Prenez un second exemple : celui des effluents dont les épandages devraient être interdits à partir du 15 octobre. Comment les féculeries pourront-elles dès lors fonctionner ? Il n'y en a plus que deux en France ; si vous maintenez cette mesure, elles fermeront toutes les deux. Quand on parle de la désindustrialisation du pays, il ne faut pas oublier que certaines mesures administratives en sont aussi à l'origine. Si vous n'y prenez pas garde, la désindustrialisation dans l'agroalimentaire va continuer, alors que c'était un des deux ou trois secteurs qui tenaient encore du point de vue de la compétitivité.

La parole est à M. Joachim Son-Forget, pour exposer sa question, n° 1634, relative aux problématiques des agriculteurs français.

Je souhaite vous interroger, monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sur les problématiques que connaissent les agriculteurs français aujourd'hui. Les chiffres sont éloquents : la France a perdu près de 100 000 exploitations agricoles en dix ans et alors que l'on recense 14 000 nouvelles exploitations chaque année, il en faudrait 7 000 de plus par an pour compenser tous les départs ; les chefs d'exploitation vieillissent – 58 % d'entre eux avaient plus de 50 ans en 2020, seulement 20 % moins de 40 ans, et la moitié des chefs d'exploitation actuels prendront leur retraite d'ici 2030 ; elle est passée en trente ans de la deuxième à la sixième place des exportateurs mondiaux de produits agricoles et alimentaires. C'est un bilan sans appel : nous sommes face à une perte de puissance continue de la France agricole depuis de nombreuses années.
L'enjeu est de taille et les agriculteurs font face à de nombreuses problématiques : la grande distribution, qui se dispute avec les industries agroalimentaires la marge faite sur le dos des producteurs ; le manque de compétitivité grandissant, qui déroule le tapis rouge aux importations ; la Commission de Bruxelles ; les coopératives.
Souvent familial, ce secteur doit s'élargir, s'ouvrir à d'autres acteurs. Restaurer l'indépendance alimentaire de notre pays passe probablement aussi par une revalorisation du métier d'agriculteur. Monsieur le ministre, de quelle manière entendez-vous fidéliser les agriculteurs français et en attirer de nouveaux ? Comment les aider à valoriser leurs produits face à la pression de la grande distribution qui les écrase souvent ? Si le système actuel – qui privilégie le consommateur par rapport au producteur – ne change pas, ce sont les éleveurs et les agriculteurs qui vont disparaître dans notre pays, alors qu'ils sont déjà bien mis à mal par certaines idéologies qui veulent, entre autres, supprimer la viande des cantines scolaires. Je pose ces questions alors même que nous peinons à valoriser à l'étranger le fruit du travail de nos exploitants – je me souviens fort bien du dossier de l'exportation en Corée du bœuf français, confrontée aux barrières non tarifaires. Comment souhaitez-vous redonner à la France sa puissance et sa souveraineté agricoles afin qu'elle ne soit plus dépendante de ses nombreuses importations alimentaires ?
Il faut commencer par dire à tous nos concitoyens : « Soyons véritablement fiers de notre agriculture. » Vous le savez, toutes les études à travers le monde mettent en avant que l'agriculture française, dans sa diversité, est l'une des plus durables. En tant que député des Français de l'étranger, vous êtes bien placé pour savoir à quel point tous les autres pays envient nos agricultures françaises. Disons donc, y compris la représentation nationale, à l'ensemble de nos concitoyens de faire le choix des productions de nos territoires, de l'excellence de nos produits. Quand j'entends des oppositions, pour faire le buzz ici ou là et dans une perspective électoraliste, caricaturer, stigmatiser, dire des choses complètement fausses au détriment de nos agricultures, les bras m'en tombent ! Notre responsabilité collégiale est de porter haut et fort cette fierté agricole française et de dire à l'ensemble de nos concitoyens : « Vous votez trois fois par jour, petit déjeuner, midi et soir : faites le choix des produits du territoire, choisissez ces produits qui viennent de nos belles productions dès lors que vous en avez la possibilité. »
Le deuxième élément de réponse, c'est la valorisation du métier d'agriculteur. Je connais particulièrement bien le secteur, étant moi-même ingénieur agronome, et j'ai défini ce métier dès le premier jour comme celui des entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Cette définition est en tout point importante, tout d'abord parce qu'elle souligne que c'est une noble mission que de nourrir le peuple, quand beaucoup de nos concitoyens cherchent aujourd'hui des métiers qui font sens. Or lequel a plus de sens que celui de prendre soin des autres, en l'occurrence à travers leur nutrition ? S'il est parfois très difficile d'être entrepreneur, il l'est doublement d'être entrepreneur du vivant, parce que vous n'êtes à l'évidence pas maître des éléments. La mère des batailles, c'est donc la rémunération, pour laquelle le Gouvernement se bat avec beaucoup de force, notamment à travers la loi EGALIM 2. Vous n'étiez pas élu à cette date, mais vous vous souvenez certainement qu'en 2008, la majorité de l'époque avait osé voter une loi dite de modernisation de l'économie – LME –qui prévoyait dans un de ses chapitres, pour relancer le pouvoir d'achat des Français, de déréguler les relations commerciales dans le secteur agroalimentaire. Le plus fort, en l'occurrence le plus en aval, allait donc peser de tout son poids sur l'amont, c'est-à-dire sur nos agriculteurs, au point de pouvoir baisser ses prix d'achat à ces mêmes agriculteurs alors que les charges de ces derniers ne faisaient qu'augmenter. C'était une facilité déconcertante, une position qui faisait sans doute plaisir à beaucoup, qui allait dans le sens du vent, mais stratégiquement contreproductive, parce qu'elle mettait en question notre propre souveraineté alimentaire.
Je ne m'adresse pas qu'au député, mais aussi au médecin que vous êtes : vous savez bien qu'Hippocrate disait que le premier des médicaments, c'est l'alimentation. Et l'une de nos premières souverainetés, ce doit être la souveraineté agroalimentaire. Pour y parvenir, oui, il faut se battre sur la rémunération – c'est EGALIM 2 – et oui, il faut investir massivement dans nos moyens de production et dans nos agricultures – c'est France 2030.

La parole est à M. Patrick Loiseau, pour exposer sa question, n° 1600, relative à l'opérateur Orange.

Ma question s'adressait à M. le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques.
Mon problème est le suivant : les dépannages de l'opérateur Orange, en l'occurrence dans ma circonscription de Vendée. On note des délais trop longs, des rendez-vous auquel personne ne se présente, des déplacements gratuits facturés, voilà ce que me dit la population. Les pannes d'internet fixe sont de plus en plus fréquentes : c'est le constat de beaucoup de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire, alors qu'ils sont encore nombreux à se connecter à internet grâce au réseau ADSL, le réseau filaire téléphonique – tout le monde n'a pas la fibre. Celui-ci est fortement perturbé, au point d'engendrer par moments la suspension de la fourniture du service. La réparation peut prendre des semaines, voire des mois ; parfois le réseau fonctionne, mais les poteaux sont à terre, les lignes reposent sur des panneaux d'entrée de village ou sont enroulées autour des arbres en l'absence de support, voire dénudées.
Orange a déjà été mis plusieurs fois en demeure pour son entretien du réseau cuivre par le régulateur, l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; mais l'opérateur historique a fixé la date de l'extinction du réseau cuivre à 2030 et entend opérer la bascule du cuivre vers la fibre le plus rapidement possible à compter de 2023. Cette décision est mal perçue par les territoires ruraux, qui craignent d'être les oubliés de la fibre et de devoir subir encore plusieurs années la situation actuelle dans l'attente d'une solution pérenne pour pouvoir accéder au très haut débit.
Ma question est donc double. Face au mauvais état du réseau téléphonique historique d'Orange, comment exiger du gestionnaire qu'il restaure ce réseau, qu'il garantisse un accès fiable et permanent à internet et au téléphone et une remise en service rapide lors des pannes ? Comment faire pour qu'Orange, délégataire du service universel, mette les moyens nécessaires pour garantir une extinction apaisée du réseau cuivre dans les territoires ruraux encore dépourvus de tout accès au très haut débit afin de permettre des solutions de connectivité alternative ?
Vous interrogez le Gouvernement sur la couverture et sur l'accès à internet via les services de téléphonie en ayant bien conscience, je l'ai noté, des efforts qui sont déployés pour la couverture en fibre. Il y a en effet le plan France très haut débit, mais aussi le New Deal mobile pour la 4G, lesquels mobilisent énormément de financements puisque l'État consacre plus de 3,5 milliards d'euros à accompagner l'investissement des opérateurs dans les zones les plus difficiles, en complément des investissements privés déjà massifs et qui s'accélèrent. En juin 2021, 53 % des locaux situés dans les territoires les plus en difficulté étaient éligibles au très haut débit, donc à la fibre, soit une augmentation de 5 % en six mois et, au cours du troisième trimestre 2021, leur nombre s'est accru de 710 000, soit une augmentation de 60 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Cela étant dit, il reste un grand nombre de territoires et d'habitations qui ne sont pas reliés à la fibre et qui dépendent encore du réseau traditionnel. Pendant cette période charnière, l'opérateur historique doit maintenir son réseau cuivre pour garantir à nos concitoyens des communications de qualité – je le rappelle à la fois comme membre du Gouvernement et comme élu de l'Ardèche, département particulièrement concerné par la nécessité de maintenir actuellement le réseau cuivre. Les problèmes que vous avez soulignés ont été mis en lumière par le rapport de votre collègue Célia de Lavergne rendu le 10 février 2021, et nous avons apporté au nom de l'État deux réponses à ces difficultés liées à la maintenance et à l'état du réseau cuivre.
Premièrement, le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a intensifié les contrôles qu'il exerçait sur la qualité du service d'Orange en matière de téléphonie fixe et lui a fixé des obligations de qualité de service au niveau du marché de gros dans une décision du 17 décembre 2020. Celle-ci porte entre autres sur les délais de fourniture de prestations, sur le taux de conformité desdites prestations, sur la qualité du service après-vente et sur les taux d'incidents mensuels sur le parc. Cette exigence de qualité aura bien entendu des conséquences positives sur les prestations de détail de l'ensemble des opérateurs – l'ARCEP y est particulièrement attachée.
Deuxièmement, nous avons mené avec Orange des discussions qui ont permis d'aboutir à un accord, que le Premier ministre a annoncé le 21 mai dernier lors d'un déplacement dans la Drôme. L'opérateur s'est ainsi engagé à maintenir 500 millions d'euros annuels d'investissements consacrés à l'entretien du réseau cuivre sur l'ensemble du territoire national, et ce malgré un nombre de lignes actives en forte décroissance, l'augmentation de 22 % du budget par ligne active depuis 2018 s'expliquant donc par la diminution du nombre de ces lignes – l'an dernier, 3,3 millions de Français ont souscrit un abonnement fibre et 2,5 millions ont résilié leur abonnement cuivre. Mais les lignes actives, moins nombreuses, n'en doivent pas moins être entretenues. De plus, dans le cadre de cet accord, 10 millions d'euros sont alloués à dix-sept territoires prioritaires qui ont été déterminés en concertation avec les élus, et l'opérateur renforce son recrutement avec 123 nouveaux postes, affectés en priorité aux départements en tension, les effectifs nationaux d'intervention en cas de crise augmentant de 30 %. Enfin, en cas de dysfonctionnement, Orange s'engage à fournir une solution de secours mobile en vingt-quatre heures au maximum à partir du signalement de l'incident et, à défaut de couverture mobile et pour les cas d'interruption de service collective sur une portion plus ou moins importante du réseau, une solution de téléphone satellitaire sera mise en disposition en mairie pour apporter les premiers secours en matière de communication. Nous veillons aussi, dans le même cadre, à ce que l'offre de service universel de téléphonie soit maintenue.
Par ailleurs, je rappelle que le suivi de l'important plan France très haut débit est assuré avec des comités de concertation locaux, sous l'égide des préfets, et avec un comité de concertation nationale.
Le Gouvernement veillera évidemment à ce que l'intégralité des engagements demandés par l'ARCEP et pris par l'opérateur historique soient tenus pour apporter une réponse à vos questions.

La parole est à Mme Clémentine Autain, pour exposer sa question, n° 1605, relative à la transformation de la fonction publique.

À Sevran, à Tremblay-en-France et à Villepinte, les villes que je représente ici, des mobilisations impressionnantes ont récemment eu lieu contre la loi de transformation de la fonction publique votée en 2019. Celle-ci contraint les communes à augmenter le temps de travail des fonctionnaires territoriaux, menaçant les communes qui ne le feraient pas d'attaques en justice de la part de l'État. Au fond, le Gouvernement veut faire plier les collectivités pour qu'elles se mettent au pas de sa régression sociale. Cette nouvelle offensive contre les droits intervient dans un contexte où les salaires des fonctionnaires territoriaux sont déjà en moyenne très faibles, voire diminuent puisqu'ils sont gelés malgré l'inflation généralisée. L'augmentation de leur temps de travail sans hausse de traitement, couplée à la suppression de jours de congés et à la suppression de postes, montre où est votre priorité. Même les métiers pénibles, avec des horaires décalés, ne sont pas épargnés. Or les territoriaux sont surreprésentés dans les métiers de la fameuse première ligne que nous avons applaudis pendant les débuts de l'épidémie. Au fond, vous voulez les essorer !
Je vous parle des éboueurs qui nettoient nos villes, des aides-soignantes qui veillent sur nos concitoyens les plus fragiles dans les EHPAD, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) qui accompagnent nos enfants. Pensez-vous vraiment que la priorité aujourd'hui soit de rogner sur leurs conditions de travail, de vous en prendre à l'autonomie des communes, inscrite dans la Constitution, et d'augmenter le temps de travail alors que le chômage de masse nous pousse logiquement à le réduire ?
Nous vivons une période de forte paupérisation et nous sommes percutés de plein fouet par une crise sanitaire et sociale de grande envergure. Le choix de concentrer vos attaques sur les populations déjà précarisées reste l'alpha et l'oméga de la politique du Gouvernement. Envisagez-vous de revenir sur la loi du 6 août 2019, aussi injuste qu'improductive ? Aiderez-vous enfin les communes à faire face à la légitime contestation à laquelle elles sont confrontées ?
Je connais bien la loi du 6 août 2019, car j'ai défendu ce texte devant l'Assemblée nationale et le Sénat.
Je me permets de contester certaines des affirmations énoncées dans votre question.
Tout d'abord, la loi de transformation de la fonction publique n'augmente pas le temps de travail ; elle rappelle que le temps de travail légal dans notre pays est de 1607 heures en vertu de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Selon la loi du 6 août, les collectivités doivent, dans l'année qui suit le renouvellement de leur assemblée délibérante, délibérer sur un accord en matière de temps de travail dans le respect des 1607 heures. Cela amène des collectivités qui n'avaient pas revu leurs protocoles en matière de temps de travail depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2000 à les réviser. Les collectivités devront d'ailleurs les revoir systématiquement dans l'année qui suivra un renouvellement de leur assemblée délibérante et elles s'attacheront à respecter la loi.
La loi fixe le temps de travail à 1607 heures. Il ne s'agit pas d'une augmentation du temps de travail : il s'agit de réaliser la durée du travail pour laquelle une personne travaillant à temps plein est rémunérée.
Je rappelle que les collectivités doivent appliquer la loi : l'autonomie sur laquelle vous avez insisté ne dispense aucune d'entre elles de le faire, puisqu'elle s'exerce dans le respect des lois qui s'appliquent à chacune des collectivités et à chacun des acteurs du pays.
Ensuite, les métiers que vous qualifiez de pénibles – je partage l'utilisation de ce terme, même si nous savons qu'en droit, il existe d'autres définitions – peuvent, comme dans le secteur privé, bénéficier d'aménagements particuliers dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Je pense aux métiers de nuit, au travail séquencé, au travail du week-end. Ces sujétions sont prises en compte et peuvent se traduire par des réductions du temps de travail en deçà des 1607 heures dès lors que les critères de pénibilité évoqués par les assemblées délibérantes répondent à la définition qui en est donnée dans la loi.
En 2021, un certain nombre de collectivités ont dû modifier de façon assez importante le régime et les accords relatifs au temps de travail qui prévalaient précédemment. Dans la plupart des cas, cela s'est bien passé et les délibérations ont été adoptées. Certaines collectivités cherchent en revanche à mettre en avant des sujétions ou des caractéristiques qui ne répondent pas au cadre légal, ce qui a pu donner lieu à la saisine de la justice administrative, et d'autres ont peut-être rencontré un peu plus de difficultés lors des négociations. L'objectif reste cependant le même : faire en sorte que lorsque l'on est rémunéré à temps plein pour exercer un métier qui ne connaît pas de sujétions particulières, le temps de travail corresponde à une rémunération à temps plein, soit 1607 heures annuelles dans le public comme dans le privé. Je le répète, c'est un simple rappel de la loi, et en aucun cas une augmentation du temps de travail, contrairement à ce que vous affirmez.
Nous tenons compte de la pénibilité, nous appliquons la loi dans un cadre d'égalité et nous respectons l'autonomie des collectivités. Lorsque sont prises des délibérations qui ne correspondent pas au texte de la loi et qui sont donc manifestement illégales, les préfets n'usent ni de menaces ni de sanctions : ils font simplement leur travail, qui consiste à soumettre aux tribunaux administratifs les délibérations en question.

Monsieur le ministre délégué, je suis désolée, vos propos sont tout simplement une négation de la réalité vécue par les agents. Concrètement, certains vont travailler davantage pour le même salaire. C'est cela la réalité ! Vous pouvez nous emballer tout ça comme vous voudrez au nom de l'égalité et de l'application de la loi, les personnels vivent véritablement une détérioration de leurs conditions de travail.

La parole est à M. Pierre Dharréville, pour exposer sa question, n° 1606, relative aux centres des finances publiques.

Une restructuration massive est à l'œuvre dans l'administration des finances publiques sous l'appellation chantante de « nouveaux réseaux de proximité ». Elle recouvre de nombreuses fermetures de centres et prévoit des suppressions de postes – 107 dans les Bouches-du-Rhône.
Vous entonnez le refrain « Adieu Venise provençale » en annonçant la fermeture de la trésorerie d'une commune de 50 000 habitants, Martigues, quatrième ville du département, trésorerie qui couvrait un secteur comptant près de 100 000 habitants. Au 1er janvier 2023, la gestion comptable des communes de Martigues, Port-de-Bouc, Châteauneuf-les-Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, et au 1er septembre 2023, celle des centres communaux d'action sociale (CCAS) et du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Pays de Martigues seraient transférées vers le service de gestion comptable d'Istres. La gestion comptable du centre hospitalier de Martigues, qui couvre un secteur beaucoup plus large encore, serait transférée vers Arles, à plus de 45 kilomètres.
Ce choix, qui raye de la carte l'une des grosses trésoreries du département et supprime une vingtaine d'emplois qualifiés sur le territoire de la ville, affectera la relation de travail nouée entre l'administration des finances publiques, par le biais de ses agents, et les institutions concernées. C'est une mise en cause de l'accompagnement du quotidien et de la relation de travail et de confiance installée avec les ordonnateurs dans une certaine fluidité, alors que la complexité des situations nécessite souvent une relation directe.
Les maires que j'ai interrogés s'opposent à cette perspective et les agentes et agents avec lesquels j'ai pu avoir un échange s'y refusent pour des raisons professionnelles et s'inquiètent des transformations que cela va produire à la fois dans leur travail, mais aussi, évidemment, dans leur vie personnelle.
Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics, je vous demande de surseoir à cette décision pour réexaminer la situation en prenant en compte tous les éléments. Il y a sur la table une proposition visant à conserver au moins une antenne, mais la meilleure formule demeure de conserver une trésorerie de plein exercice à Martigues.
J'en profite pour vous poser une question subsidiaire concernant l'avenir du poste de douane de Port-de-Bouc et le contrôle de la TICPE – taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – effectué sur place, avec des rentrées de l'ordre de 4 milliards d'euros par an.
Vous avez raison, les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) connaissent une réorganisation importante. Nous déployons le nouveau réseau de proximité qui se caractérise par trois points.
Le premier consiste à multiplier les points de contact, soit dans des bâtiments uniquement occupés par les services des finances publiques, soit dans le cadre des maisons de service public. Notre objectif est que les usagers puissent être accueillis dans 3 000 points physiques, contre 2 000 dans l'ancien réseau.
Le deuxième point vise à installer des conseillers aux décideurs locaux : plus de 1 500 seront nommés à l'échelle de tout le pays, avec comme unique mission d'apporter des conseils aux élus dans cette relation singulière de confiance que vous avez décrite.
Le troisième point consiste à regrouper un certain nombre de services administratifs d'instruction pour atteindre des tailles critiques alors que dans bon nombre d'endroits, les postes comptables ne comptent aujourd'hui que quelques unités qui nécessitent ces regroupements.
Pour ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, la concertation a été menée par le préfet de département, préfet de région, avec des réunions par arrondissement et des réunions en séance plénière. Il y a eu un certain nombre d'adaptations.
Dans la zone de l'étang de Berre, sur laquelle vous m'interrogez, nous ne fermons pas le centre des finances publiques de Martigues. Nous maintenons le service d'impôts des particuliers et un accueil des usagers sur le site. Les effectifs du service des impôts des particuliers ont même augmenté, puisqu'ils passent de 23 agents aujourd'hui à une cinquantaine, du fait du rapprochement avec le service d'Istres que vous avez évoqué.
Par ailleurs, le transfert d'autres activités relatives à la fiscalité des professionnels ou encore à la trésorerie hospitalière, soit à Istres soit à Arles, ne modifie pas non plus l'ordre de grandeur du nombre d'agents sur le site de Martigues. Il s'agit d'une réorganisation. Même si le poste de trésorerie ne sera effectivement plus localisé à Martigues, l'accueil des particuliers restera sur place, où l'on comptera environ une cinquantaine d'agents.
Nous opérons cette réorganisation avec un double souci d'efficacité dans l'organisation de nos services et d'amélioration des capacités d'accueil et de maintien d'un maillage le plus serré possible du territoire. Cette réforme que nous menons depuis 2019 a vraiment pour objectif de multiplier par 1,5 le nombre de points physiques dans lesquels les contribuables pourront rencontrer des agents des finances publiques. Il vise aussi à libérer de toute tâche administrative les conseiller aux décideurs locaux – celui de la zone de l'étang de Berre a été nommé le 1er janvier dernier –, pour leur permettre de se consacrer uniquement au conseil aux élus. C'est, je crois, sur cette mission qu'ils sont attendus. Nous continuerons évidemment de mettre en place ce réseau avec la concertation et la préparation que j'ai évoquées.
S'agissant de l'implantation douanière que vous avez évoquée, je me permettrai de revenir vers vous avec des éléments plus précis, de manière à être tout à fait sûr de vous apporter la réponse la plus juste pour ce qui concerne tant la mission en question que le calendrier de redéploiement dans le cadre de l'unification du recouvrement, qui se caractérise par des transferts de missions entre la douane et la DGFIP.

Monsieur le ministre délégué, j'ai bien vu la carte des nouveaux points de contact, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de votre argument relatif à leur multiplication. En effet, ces points de contact ne sont pas de véritables centres des finances publiques tels que nous les connaissons. Ils sont davantage à la charge des collectivités pour une part d'entre eux. En effet, elles doivent désormais pallier la réduction drastique des véritables services publics.
Vous répondez en évoquant les conseillers aux décideurs locaux qui seraient implantés localement et déchargés d'autres missions. En réalité, il ne s'agit pas du même service ; ils vont faire des relations publiques alors que nous demandons le maintien du véritable service qui existe aujourd'hui, et non la création d'une sorte de gestionnaire de patrimoine. Je ne sais pas exactement comment leurs missions se définiront au fil du temps, mais il nous semble que cela pose un problème.
J'ajoute qu'il ne faut pas aller vers une industrialisation des tâches. Rediscutons-en ensemble, monsieur le ministre délégué, en évoquant le cas de Martigues !

La parole est à Mme Catherine Pujol, pour exposer sa question, n° 1637, relative à la demi-part fiscale des veuves d'anciens combattants.

Madame la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, les veuves de titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissantes à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Elles se félicitent de l'élargissement de l'accès à la demi-part fiscale supplémentaire à partir du 1er janvier 2021 et ce, dès lors qu'elles auront atteint 74 ans. Cette mesure s'appliquera aux veuves dont l'époux avait perçu la retraite du combattant, attribuée à partir de 65 ans.
L'attribution de la demi-part fiscale est désormais étendue aux veuves dont le conjoint est décédé entre 65 et 74 ans. Néanmoins, la référence à l'âge du décès n'a pas été supprimée. Les veuves des titulaires de la carte du combattant décédés avant 65 ans sont ainsi exclues de cette nouvelle mesure. Les veuves concernées par cette exclusion considèrent légitimement que cela porte atteinte à la reconnaissance par l'État du service rendu au pays par leur époux défunt.
En tant que membre de la commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale, j'ai récemment été sensibilisée à ce sujet par plusieurs associations d'anciens combattants. Je tiens à relayer aujourd'hui leur incompréhension légitime et leur mécontentement.
Il serait opportun d'envisager rapidement toute mesure qui aurait pour effet de supprimer la discrimination envers certaines veuves en supprimant une inégalité fondée sur l'âge de décès de leur époux combattant. Quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière ?

La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Comme vous l'indiquez, cette mesure d'extension de la demi-part fiscale a satisfait de nombreuses veuves et anciens combattants ainsi que de très nombreuses associations qui la réclamaient depuis bien longtemps. Le Parlement l'a finalement mis en œuvre.
Je rappelle que la carte dite 62-64 – pour les services effectués en Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964 – permet à plus de 37 000 anciens combattants supplémentaires de bénéficier de la retraite du combattant depuis 2019 et, en conséquence, de la demi-part fiscale à partir de 74 ans. L'obtention de cette demi-part est liée à l'obtention de la retraite du combattant à 65 ans. C'est le cas pour les anciens combattants comme pour les veuves.
Ces dernières sont très diverses, par leur âge, leur parcours, leur niveau de vie. Je pense tout d'abord aux veuves et veufs de guerre et d'invalides de guerre affectés par la perte de leur conjoint ou par les importantes blessures de ce dernier. Ces conjoints bénéficient d'une pension militaire afin de pourvoir à leurs besoins. Ils bénéficient aussi d'une demi-part fiscale, sans condition d'âge pour eux comme pour leur conjoint décédé au combat.
J'ai aussi défendu en 2019 et en 2020 des mesures favorables pour les veuves de grand invalide.
En 2022, j'ai souhaité que nous puissions revaloriser le point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), qui est passé de 14,70 à 15,05 euros, ce qui a un effet visible et immédiat pour le niveau de vie des veuves qui perçoivent les pensions militaires d'invalidité et de réversion de leurs conjoints.
Pour toutes les autres veuves, en plus de la demi-part fiscale liée à l'obtention de la carte du combattant de leur conjoint, ma priorité a été d'augmenter et de maintenir les moyens permettant de soutenir les plus fragiles. Je veux le rappeler : les plus fragiles ne sont pas imposables et doivent faire face aux frais de la vie courante, et parfois à ceux de la dépendance. C'est là que le budget de l'action sociale de l'ONACVG est essentiel en complément de l'action résolue du Gouvernement en faveur des petites retraites, qui relève du droit commun. En 2021, ce budget a été consommé totalement grâce à la mobilisation des services de proximité de l'ONACVG. Telles ont été mes priorités : la règle de l'attribution de la demi-part fiscale en fonction de l'obtention de la retraite du combattant pour les anciens combattants et pour les veuves à partir de 65 ans et, bien sûr, le soutien aux veuves les plus fragiles qui ne sont pas imposables.

Madame la ministre déléguée, je vous remercie de vos explications. Que les veuves de combattant paient des impôts ou non, il y va du devoir de mémoire que la France doit exercer à l'égard de ses anciens combattants et de l'honneur de leurs veuves.

La parole est à M. Julien Ravier, pour exposer sa question, n° 1623, relative à la protection et au soutien dus à l'Arménie.

Je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur l'attitude de la France à l'égard des intrusions azerbaïdjanaises en territoire souverain arménien. La fin de l'année 2021 a vu éclater de nouveaux affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec une violation du territoire arménien par l'armée azerbaïdjanaise et de nouveaux prisonniers arméniens. Ces malheureux viennent s'ajouter à ceux toujours détenus par l'Azerbaïdjan en violation totale du cessez-le-feu et des accords de paix conclus à la suite du conflit du Haut-Karabakh de 2020, au cours duquel l'armée azerbaïdjanaise avait attaqué la République du Haut-Karabakh avec le soutien des forces turques et de mercenaires djihadistes aux ordres d'Ankara. Je ne reviendrai pas sur ce conflit qui a coûté la vie à près de 5 000 personnes dans le silence assourdissant de la communauté internationale, démontrant toute la faiblesse du groupe de Minsk dans sa mission d'encourager une résolution pacifique et négociée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan concernant le territoire du Haut-Karabakh. Sans la force d'interposition pacifique de la Russie, les populations arméniennes du Haut-Karabakh auraient été totalement décimées. Une fois de plus, je ne peux que regretter que la France ne soit pas intervenue aux côtés de la Russie pour préserver la paix dans cette région.
Comme je le disais au début de mon propos, les choses sont encore plus graves aujourd'hui. J'étais en Arménie le 15 novembre dernier, quand la région a connu l'incident le plus grave entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis la fin de la guerre au Haut-Karabakh il y a un an. Les forces azerbaïdjanaises ont attaqué le territoire souverain de la République d'Arménie, prenant deux positions militaires arméniennes et faisant de nouveaux morts et blessés, ainsi que douze nouveaux prisonniers arméniens selon le ministère arménien de la défense. Cette situation est parfaitement inacceptable. Or la réponse de la France, par voie de communiqué de presse du Quai d'Orsay, est arrivée bien tardivement par rapport à la communauté internationale. Pire encore, elle ne condamnait pas ces attaques, ce qui suscite l'incompréhension, pour ne pas dire l'indignation, de la part d'un certain nombre d'élus dont je fais partie et de toute la diaspora arménienne de France. Nous sommes face à une véritable guerre de civilisation aux portes de l'Europe. Le peuple arménien a plus de 2 000 ans d'histoire, l'Arménie est l'un des berceaux de notre humanité et de la chrétienté. Allons-nous attendre passivement que nos frères arméniens soient rayés de la carte sans réagir ? Mes questions sont simples. Qu'entend faire la France pour libérer les prisonniers de guerre arméniens toujours illégalement retenus à Bakou ? Que compte faire la France pour protéger les frontières du territoire souverain de la République d'Arménie, afin d'éviter que le projet panturc de conquête du sud de l'Arménie par l'alliance turco-azérie se réalise ?

La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Plus d'un an après le conflit qui a frappé le Haut-Karabakh, le Caucase du Sud demeure en proie à des tensions qui freinent l'établissement d'une paix durable dans la région. L'accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020, qui a mis fin au conflit de l'automne 2020, reste imparfaitement mis en œuvre et ses angles morts laissent plusieurs questions sans réponse. La France, coprésidente du groupe de Minsk avec la Russie et les États-Unis, reste déterminée et travaille à l'établissement d'une paix durable entre les deux parties. C'est le sens des échanges que le Président de la République a eus avec le Premier ministre arménien et le président de l'Azerbaïdjan à Bruxelles le 15 décembre dernier. C'est aussi le sens de l'effort de Jean-Yves Le Drian : le 10 novembre 2021, il a réuni à Paris ses deux homologues pour la première fois depuis la fin de la guerre. Nous devons traiter plusieurs enjeux clés pour parvenir à stabiliser la situation et discuter des paramètres d'une solution durable. Je pense par exemple à la délimitation de la frontière entre les deux pays, qui reste inachevée et suscite des tensions importantes. L'incursion en mai 2021 des forces armées azerbaïdjanaises en territoire arménien, que le Président de la République a été le premier à dénoncer, est un héritage du passé des deux anciennes républiques voisines de l'URSS. La France a toujours insisté sur l'importance de mener ce travail par le biais d'une négociation, loin de tout fait accompli sur le terrain. Je pense aussi, en second lieu, aux discussions que nous poursuivons sur l'ensemble des problèmes humanitaires liés au conflit de l'automne 2020 qui restent à résoudre, à commencer par la libération des prisonniers de guerre et le déminage. Les développements de ces dernières semaines sont encourageants, puisque vingt prisonniers ont été libérés par l'Azerbaïdjan au mois de décembre et que l'Arménie a remis toutes les cartes des champs de mines qui étaient en sa possession.
Vous connaissez notre engagement sur le plan de l'aide humanitaire. En 2021, nous avons consacré 2 millions d'euros au financement des activités du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui est aujourd'hui l'unique organisation internationale active au Haut-Karabakh et qui rend visite aux détenus arméniens et continue les recherches des personnes portées disparues. Nous sommes donc au rendez-vous de la responsabilité, sur la base de notre mandat de coprésident du groupe de Minsk, en recherchant avec les deux parties des solutions pragmatiques aptes à établir la paix. Par ailleurs, et ce n'est évidemment pas exclusif, nous restons au rendez-vous de la solidarité avec le peuple arménien, eu égard aux liens historiques et culturels qui nous lient à lui. Dans ce cadre, nous travaillons au renforcement de nos liens de coopération avec l'Arménie, avec laquelle nous avons récemment conclu une feuille de route bilatérale. Je peux vous l'assurer : en sa qualité de coprésident du groupe de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la France ne ménagera aucun effort pour favoriser la paix dans le Caucase du Sud, et nous continuerons à œuvrer sans relâche dans ce sens.

La parole est à M. Stéphane Travert, pour exposer sa question, n° 1612, relative aux états généraux de la justice.

Le Président de la République et le Gouvernement ont lancé les états généraux de la justice, et nous avons ici, au Parlement, voté une hausse sans précédent des crédits de la justice. Depuis 2017, on constate une augmentation du budget qui y est consacré de près de 32 %. Des actes forts ont ainsi été posés.
Dans le cadre des états généraux de la justice, le Gouvernement souhaite restaurer le lien entre les justiciables et ceux qui la font vivre au quotidien. Vous connaissez certainement le statut des magistrats à titre temporaire, qui sont des juges non professionnels recrutés sur dossier par le Conseil supérieur de la magistrature pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Les magistrats à titre temporaire exercent de manière partielle et ponctuelle des fonctions juridictionnelles et sont rémunérés à la vacation. Parallèlement, l'âge limite est fixé à 75 ans, comme pour les magistrats honoraires ou les juges de tribunaux de commerce. Comme vous le savez, certaines juridictions souffrent d'un manque de magistrats – c'est notamment le cas dans le département de la Manche. Cette situation engendre des retards dans les décisions de justice et peut donner à nos concitoyens le sentiment d'une justice trop lente. Aujourd'hui, ce sont près de 450 magistrats à titre temporaire qui sont affectés dans différentes juridictions où ils sont d'une très grande utilité.
Madame la ministre déléguée, serait-il envisageable de permettre aux magistrats à titre temporaire qui, à la fin de leurs deux mandats de cinq ans, n'ont pas atteint l'âge limite des 75 ans, de prolonger l'exercice de cette profession en en demandant régulièrement le renouvellement par une simple reconduction annuelle du contrat ? Les magistrats à titre temporaire pourraient ainsi utilement continuer de servir la justice et les justiciables jusqu'à l'âge limite prévu par la loi.

La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Monsieur le député, je vous prie tout d'abord d'excuser Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, qui a été retenue au dernier moment à l'Élysée et m'a demandé de vous répondre.
Je tiens à vous remercier de votre intervention qui pose une question particulièrement pertinente, même si elle n'est pas sans se heurter à certains de nos grands principes juridiques. Elle nous donne d'abord l'occasion de saluer chaleureusement le travail accompli par tous les magistrats à titre temporaire issus de la société civile. Ils apportent un concours vraiment très précieux à la justice. En matière civile comme en matière pénale, ils contribuent à rapprocher celle-ci du citoyen. Au cours du quinquennat, nous avons d'ailleurs significativement renforcé leur intervention en augmentant le nombre de vacations disponibles pour chaque magistrat exerçant à titre temporaire.
Comme vous l'avez rappelé, leur statut prévoit une nomination pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Malheureusement, il n'apparaît pas envisageable d'aller au-delà, au risque de se heurter à la Constitution. Comme leur nom l'indique, ils ne peuvent exercer leurs missions qu'à titre temporaire, pour ne pas assimiler leurs fonctions à une carrière professionnelle. En outre, la reconduction annuelle que vous préconisez soulève un autre problème de conformité à la Constitution : ces magistrats étant nommés dans les formes prévues pour les magistrats du siège, une nomination sans avis du Conseil supérieur de la magistrature et sans décret du Président de la République serait inconstitutionnelle et par conséquent frappée de nullité. Je ne peux donc répondre favorablement à votre demande.

La parole est à Mme Danièle Obono, pour exposer sa question, n° 1603, relative aux méthodes et moyens utilisés dans le cadre de verbalisations sans interpellation.

« Avant, on mettait des coups de matraque à nos enfants ; aujourd'hui, on les matraque à coups d'amendes. » Le 17 octobre 2021, sur l'esplanade de Belleville, ce témoignage d'une mère de famille rejoint celui de beaucoup d'autres : toutes constatent le même procédé, des amendes qui arrivent par La Poste et accusent leur enfant de déversement de liquide insalubre, de tapage, de consommation d'alcool sur la voie publique ou de dépôt de déchets hors des emplacements autorisés, sans que les principaux concernés n'aient été verbalisés. Les chiffres sont vertigineux : 5 000, 10 000, jusqu'à 25 000 euros d'amende. Un endettement insupportable pour des jeunes qui voient leur horizon bouché, mais aussi pour leurs familles, qui se retrouvent prises à la gorge et enfoncées un peu plus dans la précarité. Ce phénomène n'est pas cantonné au nord-est parisien, mais touche bien l'ensemble des habitants et des habitantes des quartiers populaires, et majoritairement des jeunes de moins de 25 ans racisés. C'est ce qu'a pu observer la juriste et sociologue Aline Daillère, qui étudie cette réalité depuis maintenant quatre ans. D'Argenteuil dans le Val d'Oise à Saint-Martin-le-Vinoux dans l'Isère, en passant par Calais dans le Pas-de-Calais, les enquêtes de terrain révèlent les mêmes motifs de verbalisation, profils et méthodes. Au mois de mai 2020, la procureure de la République d'Évry alertait les autorités locales sur ce phénomène, soulignant que « les verbalisations opérées à distance, parfois de façon successive, sans que les contrevenants n'en aient expressément connaissance, sont irrégulières. »
Il y a deux mois, en novembre 2021, j'adressais au ministre de l'intérieur une question écrite sur le non-respect du code de procédure pénale, selon lequel l'avis et le procès-verbal de contravention doivent être dressés en présence de l'auteur de l'infraction. Cette question est restée sans réponse, tout comme celle de mars 2021 portant sur le même procédé appliqué aux amendes lors de la première vague de covid-19 pour non-respect du port du masque ou du confinement. En juin 2020, j'avais posé une question sur le même sujet ; le ministère y a répondu de manière évasive et partielle. Juin 2020, mars 2021, novembre 2021 : quand ces jeunes Françaises et Français, qui voient aujourd'hui leur vie mise entre parenthèses, auront-elles, auront-ils le droit d'obtenir une réponse sur la légalité d'un phénomène qui brise leur avenir ? Pourquoi tant de mépris à l'égard de ces citoyens et citoyennes, habitants et habitantes des quartiers populaires ? Doit-on y voir de l'embarras à justifier une procédure tout simplement illégale ? Il faut que ces discriminations cessent.

La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Permettez-moi d'abord de saluer nos policiers et nos gendarmes, qui sont mobilisés jour et nuit sur le terrain pour assurer la protection de tous les Français.
Je condamne fermement l'insinuation selon laquelle il existerait une police qui emploierait des méthodes illégales dans les quartiers sensibles, notamment dans les procédures que vous mentionnez.
J'en viens au fond de votre question. Les infractions de nature contraventionnelle peuvent être constatées par les agents de police sans interpellation. Ces opérations donnent lieu à la délivrance d'une contravention papier ou à un procès-verbal électronique.
Il s'agit bien là du rôle de la police, et nos concitoyens sont en droit d'attendre que la délinquance ou les incivilités qu'ils observent ou subissent soient réprimées.
Quant aux différents motifs de verbalisation que vous citez, je vous confirme la possibilité pour les policiers d'agir par voie de contravention pour chacun d'eux. En premier lieu, la consommation d'alcool est réglementée. En particulier, les mineurs ne peuvent acheter ou consommer de l'alcool dans les lieux publics, l'ivresse sur la voie publique est illégale et la consommation d'alcool peut également être interdite dans certains lieux par arrêté préfectoral ou municipal.
Pour ce qui est des tapages diurnes ou nocturnes, les interventions sont le plus souvent motivées par les plaintes du voisinage et les appels à Police secours. Les constats sont effectués sur place par les policiers, qui jugent alors de la situation et verbalisent si le tapage est constaté.
Rien qu'à Paris, les verbalisations pour ces motifs ont augmenté de 80 % entre les onze premiers mois de l'année 2020 et ceux de 2021 : 3 486 verbalisations en 2020, 6 188 en 2021, et ce dans tous les arrondissements de la capitale. Je précise qu'à Paris, la police municipale, créée en octobre 2021 grâce à l'action de la majorité présidentielle, est dorénavant compétente pour lutter contre les incivilités et les nuisances et qu'elle pourra, elle aussi, verbaliser les personnes qui commettent des incivilités.
Que ce soit à Paris, en banlieue, à Bordeaux ou dans les Landes, la situation est la même, et police et gendarmerie ont les mêmes possibilités pour que les incivilités ne nuisent pas à la tranquillité de la population.

Madame la ministre déléguée, ce ne sont pas les agents qui sont en cause, mais la politique du chiffre qui explique ce genre de procédures. Par ailleurs, vous n'avez pas bien écouté ou entendu ma question : il ne s'agit pas des verbalisations en soi, mais des verbalisations sans la présence des personnes concernées – les amendes reçues par la Poste, les verbalisations à distance. C'est là où se pose un problème de légalité, auquel vous n'avez pas répondu. Votre réponse trahit l'embarras à justifier ce type de procédures, qui ont un impact non seulement sur les personnes et leurs familles, mais aussi sur l'ensemble des quartiers concernés, lesquels se voient d'autant plus stigmatisés. Vous confirmez ainsi le choix politique qui est le vôtre.

La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour exposer sa question, n° 1635, relative à l'organisation de l'élection présidentielle.

À environ trois mois de l'élection présidentielle, la recherche des parrainages par les candidats bat son plein. Depuis la loi d'avril 2016, les noms des élus qui parrainent un candidat sont rendus publics de façon systématique. Cette publicité constitue un véritable problème pour notre démocratie, voire un danger.
Depuis l'application effective de cette nouvelle loi, les maires sont beaucoup plus réticents à présenter un candidat à la plus haute fonction. Pourquoi ? Même si personne n'osera l'affirmer franchement, nous savons pertinemment que c'est par peur de ce qu'on peut qualifier légitimement, même si le mot semble fort, de représailles. Les subventions sont souvent vitales pour la bonne marche d'une commune. Le maire d'un petit village y réfléchira donc à deux fois avant de donner sa signature, et par là même de jeter son nom en pâture, à un candidat qui n'est pas du même bord que celui des présidents des collectivités dont il dépend. Évidemment, rien n'est écrit, rien n'est dit, mais cela existe, cela peut exister, et le doute qui s'installe dans les esprits est déjà de trop. Oui, les prises de position politiques peuvent se payer cher.
En vertu de cette sacro-sainte transparence, va-t-on empêcher certains candidats de se présenter au suffrage des Français alors qu'ils représentent un courant de pensée ? Le risque est réel, et si d'aventure certains candidats ne pouvaient pas se présenter à l'élection présidentielle par manque de parrainages, imaginez un instant les conséquences que cela aurait dans l'opinion française. Quel discrédit sur l'élection tout entière !
Notre démocratie comme notre peuple sont assez matures pour permettre à chacun de faire son choix le jour venu. Encore faut-il que toutes les opinions puissent être représentées, et les parrainages d'élus locaux, redevenus anonymes, continueront de remplir leur rôle et d'empêcher la candidature d'un farfelu ou d'un extrémiste dangereux. Madame la ministre déléguée, je m'adresse à vous puisque le ministre de l'intérieur n'est pas là : seriez-vous prête à modifier la loi organique en vue de supprimer la publicité des parrainages à l'élection présidentielle ? Il suffit d'engager une procédure accélérée et de supprimer l'article 3 de la loi organique de 2016.
Applaudissements sur certains bancs des députés non inscrits.

La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Les règles encadrant l'élection du Président de la République ne sauraient être modifiées à moins de trois mois du scrutin : il y va de la lisibilité de l'élection. La modification des règles au plus proche du scrutin pourrait être interprétée par nos concitoyens comme une tentative de manœuvre, d'autant plus que la loi de 1962 relative à l'élection du Président de la République a été modifiée plusieurs fois depuis l'élection présidentielle de 2017 et que ces modifications ont fait l'objet, au début de l'année 2021, d'un débat parlementaire qui a conduit à l'adoption de la loi organique du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République.
Sur le fond, comme vous le savez, le filtre des parrainages vise à éviter des candidatures trop nombreuses à l'élection présidentielle et notamment à écarter les candidatures que je dirais « fantaisistes » ou « de témoignage ». La publicité des parrainages découle du principe de responsabilité politique et de l'exigence de transparence que nous devons aux électeurs : les élus ayant décidé de présenter un candidat doivent assumer ce choix devant leurs électeurs. Cette publicité n'enfreint aucune règle constitutionnelle, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel, qui a rappelé que « la présentation de candidats par les citoyens élus habilités ne saurait être assimilée à l'expression d'un suffrage » et n'a donc pas à être secrète.
La situation que vous décrivez, à savoir que des élus feraient face à des représailles à cause du parrainage qu'ils ont octroyé, est pénalement répréhensible et constitue une très grave atteinte à la liberté d'opinion fondamentale dans toute démocratie. Ce n'est pas par un recul de la transparence que nous devons, en tant qu'élus, aux électeurs que je veux y répondre, mais bien par une attitude très ferme à l'égard de ceux qui menaceraient leurs élus au motif qu'ils se seraient exprimés librement. Voilà, madame la députée, ma conviction et celle du Gouvernement.

C'est le même argument qu'on nous renvoie chaque fois : il serait d'usage qu'on ne change pas les règles à moins de trois mois de l'élection. Mais c'est un usage, et cet usage pourrait empêcher trois candidats – M. Mélenchon, Mme Le Pen et M. Zemmour, qui représentent chacun plus de 10 % des intentions de vote, plus de 40 % à eux trois – de se présenter à l'élection présidentielle.
Vous savez très bien que l'on peut modifier la loi organique en engageant la procédure accélérée – il suffit d'une volonté du Gouvernement. Si, dans trois mois, ces trois candidats, pour une raison ou pour une autre, ne bénéficiaient pas des parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, cette élection serait entachée d'un énorme sentiment d'illégitimité, quel que soit le Président élu au terme de cette élection : quel qu'il soit, il sera considéré par une partie des Français comme illégitime. C'est une vraie responsabilité que prend le Gouvernement. Il a la possibilité d'engager une procédure accélérée pour réviser la loi organique : la balle est dans votre camp, madame la ministre déléguée !
Applaudissements sur certains bancs des députés non inscrits.

La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon, pour exposer sa question, n° 1604, relative à l'application de la LOPPSI à La Réunion.

La Réunion et ma circonscription sont sujets depuis quelques années à des excès de violences insupportables. Si la ville de Saint-André, avec son nouveau commissariat de police et un dispositif de proximité, a su faire baisser les actes de violence, un climat inquiétant règne à Saint-Benoît, autre ville de ma circonscription. Le 3 novembre dernier, nous avons assisté à de grandes violences entre jeunes, au moyen d'armes à feu, d'armes blanches et de rochers de diverses tailles. Des gendarmes ont également été pris à partie par une quinzaine d'individus. Cet acte de violence gratuit a occasionné de nombreuses dégradations de biens.
Une personne âgée agressée, une femme à qui on a volé son sac à l'arraché, un enfant à qui on a subtilisé son téléphone ou même ses vêtements, des vols dans les habitations…, voilà le quotidien dans certains quartiers et trop de gens vivent dans un climat non apaisé. Des actes de violences ont également eu lieu le jour d'Halloween : jets de pierres, poubelles brûlées, pompiers menacés.
Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et les groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD) mis en place dernièrement à Saint-Benoît ne peuvent à eux seuls répondre à cette problématique. Il faut amplifier la politique sociale et la présence d'acteurs sur le territoire. Une politique de développement territorial créatrice d'emplois, d'activités associatives, culturelles et sportives est nécessaire.
Avec la région Réunion, je travaille à une orientation pour un rééquilibrage de la microrégion Est, le territoire qui a accumulé trop de retards. Parallèlement, l'État doit créer les conditions pour une protection optimale de la population – et c'est ma question, madame la ministre déléguée. La délinquance chez nous est notamment due à l'arrivée de nouvelles drogues, au mimétisme des jeunes qui cherchent à vouloir ressembler à d'autres et aux différences culturelles de certains groupes d'individus ne s'adaptant pas à l'île.
Ne pas freiner cette attitude maintenant, c'est avoir plus de difficultés à le faire par la suite. Gendarmes et policiers ont les compétences APJ 20, c'est-à-dire qu'ils sont agents de police judiciaire selon l'article 20 du code de procédure pénale, mais seuls les policiers possèdent des brigades anticriminalité et des compagnies d'intervention spécialisées dans le maintien de l'ordre. Pourquoi la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite loi LOPPSI 2, votée il y a plus de dix ans, n'est-elle pas appliquée à La Réunion et à Saint-Benoît ? Cette loi dispose que les communes de plus de 10 000 habitants peuvent bénéficier de commissariats de police, dans l'Hexagone comme en outre-mer. Huit communes de La Réunion – dont Saint-Benoît, qui compte 31 000 habitants – ne sont pas en zone police. Cela permettrait en outre de créer des emplois et de voir le retour de policiers réunionnais de l'Hexagone qui demandent leur mutation dans leur île.

La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.
En outre-mer comme en métropole, le Gouvernement mobilise depuis le début du quinquennat des moyens exceptionnels pour apporter des réponses concrètes aux problèmes de délinquance et d'insécurité. Le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes sur le quinquennat permet de renforcer la présence sur la voie publique. À La Réunion, les effectifs de police ont ainsi augmenté de 238 et ceux de la gendarmerie de 20.
Cet effort porte ses fruits, puisque la délinquance a baissé de 15,4 % entre 2019 et 2021 en zone gendarmerie nationale (ZGN).
Le budget du ministère de l'intérieur augmente de 1,5 milliard d'euros en 2022 afin de donner aux forces de sécurité intérieure les moyens d'assurer leurs missions dans les meilleures conditions d'efficacité possibles.
Les questions de gouvernance et de doctrine opérationnelle et l'adaptation aux évolutions de la délinquance sont également essentielles. La police nationale a accompli d'importantes réformes, avec par exemple la création en janvier 2020 de directions territoriales de la police nationale (DTPN) à Mayotte, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Les coopérations entre police et gendarmerie constituent également un enjeu important pour développer les synergies et les complémentarités et renforcer l'ancrage dans les territoires.
La résolution des troubles ne ressortit pas exclusivement au domaine sécuritaire. La gendarmerie s'est donc engagée dans un important volet de prévention, avec notamment des patrouilles de contact composées d'au moins un gendarme parlant créole, allant à la rencontre des jeunes, le déplacement des gendarmes dans les collèges afin de créer un lien de confiance, le porte-à-porte d'un gendarme de la brigade locale accompagné d'un imam et d'un représentant des bailleurs sociaux pour aller au-devant de la population.
Pour des résultats durables, le travail de la gendarmerie doit être accompagné par d'autres mesures : mixité sociale, rôle des médiateurs, complémentarité avec la police municipale. Ces mesures seront discutées lors d'un prochain CLSPD. En accord avec le procureur de Saint-Denis, un GLTD a été validé et mis en place pour apporter une réponse adaptée et globale.
De toute évidence, la situation est complexe et les mesures à prendre le sont également. Néanmoins, l'augmentation des moyens et les actions de prévention que nous avons lancées devraient permettre de répondre aux besoins de l'île de La Réunion.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures quarante-cinq.
Le directeur des comptes rendus
Serge Ezdra